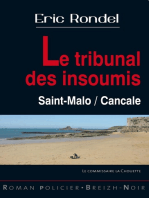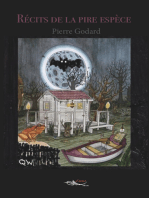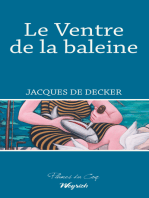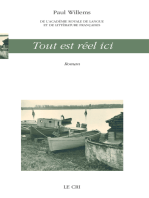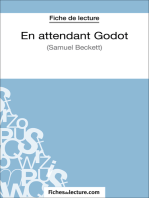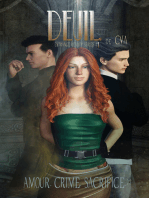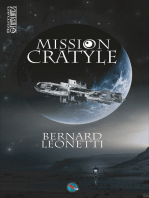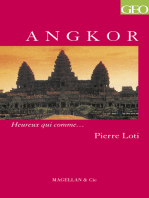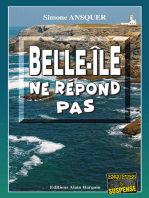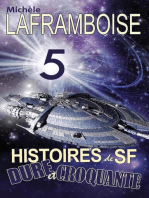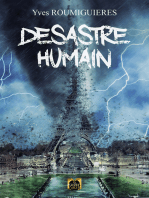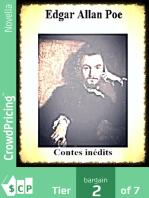Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
AUMONT Dieu Est Dans Les Détails PDF
Transféré par
inadequacaoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
AUMONT Dieu Est Dans Les Détails PDF
Transféré par
inadequacaoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dieu est
dans les détails
Note sur Stalker *
par Jacques Aumont
I
l y a dans Stalker trois moments de pur fantastique, répondant au programme
implicite de ce film de science-fiction merveilleuse : le numéro de télékinésie
de la petite fille infirme, sur lequel s’achève le film ; l’arrivée au seuil de la
Chambre et la succession de petits miracles ambigus qui s’y produit ; la disparition
d’un oiseau, sur les vagues sableuses du « hachoir ». 1
Les deux premiers de ces moments sont spectaculaires, longuement développés.
Devant la Chambre les trois aventuriers sont assis, au terme d’une épuisante expé-
dition. Ils ont cheminé durant toute une journée, et durant presque tout le film, pour
parvenir là ; pourtant ils restent assis, sans chercher à entrer ni à profiter des dons
magiques que la Chambre leur promet. On les quittera dans cette posture ; à la fin
du film, bien malin qui pourrait décider si, oui ou non, ils y sont entrés. Leur longue
station sur cette frontière invisible aura été l’occasion, pour le film, de nous éblouir
de miracles visuels et auditifs, peut-être inaperçus des personnages et destinés à
nous seuls, spectateurs : un jeu de lumière, le blanc se muant en bleuté pour céder
la place à un feu orangé-pourpre, un jeu sonore, l’avion devenant orage, un jeu de
matière, l’eau omniprésente devenant pluie. Cela est si frappant qu’on y a souvent vu
le culmen du film, et qu’on a proposé de comprendre cette scène comme une grande
métaphore spirituelle et artistique à la fois1. 2
La scène des trois verres sur la table de marbre est spectaculaire autrement,
comme de la prestidigitation. On y voit l’impossible : des objets se déplaçant seuls. On
subodore quelque ficelle. Mais la mise en scène – durée du plan, lente avancée de la
caméra, regard insistant, vers nous, de la petite fille – nous suggère que ce n’est pas
* Ce texte est la reprise – passablement transformée – d’une intervention à l’auditorium du Louvre, en
mai 2010, dans un cycle de films autour de la prière, dans le cadre de l’exposition « Sainte Russie ». (R.B.)
1. Voir notamment Alain Bonfand, Le Cinéma saturé, PUF, 2007. 1
Aumont.indd 1 14/09/10 18:24:29
un numéro de foire mais vraiment de la magie, du surnaturel. Nous nous prenons à
croire que ce personnage monstrueux est bien une « mutante », qui a des pouvoirs
mentaux, psychiques, parapsychiques, que sais-je. Là encore, cependant, le film nous
laisse sur notre faim : non seulement rien n’est dit, rien n’est commenté, mais la fin
de la scène fait advenir sous la musique, de plus en plus reconnaissable, le bruit d’un
des trains qui passent sans cesse à proximité, si fort qu’il se communique à la table
et fait bouger les deux verres qui ne sont pas encore tombés : et si tout cela n’avait
été, depuis le début, que les vibrations du chemin de fer ?
Le troisième moment est différent, à la fois très bref et indiscutable. Un oiseau vole
devant nous, et soudain il n’est plus là ; un autre oiseau (ou le même) surgit alors
de l’avant-champ à droite et se pose à son tour – mais ne disparaît pas. C’est tout.
Aucun commentaire, là non plus ; l’événement est si rapide qu’on peut d’ailleurs le
manquer. Mais si on le voit, son caractère fantastique est indubitable. Les lumières
étranges de la chambre sont peut-être des caprices de la météo ; les verres qui
glissent sur le marbre sont peut-être agités par le train qui passe. Mais l’oiseau, lui,
disparaît, et sous nos yeux. Prestidigitation si on veut, mais avouée, et réussie. Rien
de compliqué : un trucage par substitution, à la Méliès ; tout le monde connaît cela et
tout le monde y pensera après avoir vu ce plan. Mais l’effet est là : disparition à vue.
Ce n’est pas grand-chose, un détail. Le film pouvait s’en passer sans peine – alors
que l’apothéose dans la Chambre, même équivoque, était indispensable, comme le
transport d’objets du finale. Ce détail de l’oiseau est saisissant, par la disproportion
entre son importance narrative (nulle) et sa force visuelle (miracle pur et simple).
Sorti en 1979, Stalker avait demandé deux ans de réalisation et a connu deux
versions. La première a été perdue, apparemment parce que le laboratoire soviétique
n’a pas su traiter la pellicule Kodak. Le second tournage a été très dur – réalisé en
partie dans une usine hydroélectrique estonienne à demi désaffectée, et dans une
eau copieusement contaminée par divers poisons. On dit qu’il a été fatal à plusieurs
des protagonistes, notamment Tarkovski, sa femme et l’acteur Solonitsyne, tous trois
atteints du même type de cancer. Tarkovski est mort en décembre 1986 ; en avril
de la même année se produisait à Tchernobyl le plus grave accident nucléaire de
toute l’histoire humaine. Une zone gigantesque, affectant plusieurs pays (surtout la
Biélorussie), a dû être décontaminée durant des années. En 2008 est sorti un jeu vidéo
nommé S.T.A.L.K.E.R, inspiré à la fois de Tchernobyl et du film de Tarkovski, et qui a
obtenu un grand succès. L’aura de Stalker s’est encore accrue de ces deux occurrences,
et ce film a été l’objet d’innombrables commentaires, analyses, interprétations, auxquels
il prête singulièrement, et même qu’il suscite.
On ne saura jamais ce qu’est la Zone : météorite, invasion par des aliens (le film
Alien est exactement contemporain de Stalker), explosion d’une bombe atomique, on a
2 le choix. On sait seulement qu’elle inspire la peur. Quant à ses supposés pouvoirs, on
Aumont.indd 2 14/09/10 18:24:29
n’en sait jamais rien que ce que raconte le Stalker, lui-même ne faisant que reprendre
le récit de stalkers plus anciens. Au reste, son discours est suspect. Cet homme
ne fonde visiblement pas sa vie sur la raison, mais sur la foi ; sa femme nous le dit
crûment à la fin : c’est un innocent, un « fol en Dieu ». Inutile d’en espérer une vérité
rationnelle.
C’est sans doute pourquoi le film a si souvent été lu comme une allégorie ou comme
une parabole. Allégorie de la société soviétique, alors qu’elle commençait à se fissurer
de l’intérieur. La police est partout, elle n’hésite pas à tirer sans sommation, mais
elle est inefficace et facile à berner. La Zone est un certain dehors de la société totali-
taire : un passé perdu, dégradé, à l’état de ruine, néanmoins encore idyllique ; ou bien
le dehors mental où chacun, sous la dictature la plus obtuse, peut se réfugier ; ou, au
contraire, la négation de tout espoir. Quant au Stalker, il est alors un opposant poli-
tique, un homme de samizdat (voir sa vaste bibliothèque à la fin) et de goulag (il sort
de prison), un alter ego déjeté de Soljenitsyne. Ou bien, à cette allégorie un peu plate,
on peut préférer la parabole : la foi contre la raison, la folie de la société combattue
par plus fou encore, la vanité de la vie, sa brièveté aussi (le voyage dans la Zone
condense trois existences, il ne dure qu’une journée).
Mais ce sont là des lectures lointaines. Le film raconte, c’est vrai, une exploration
dans la Zone. Il raconte aussi, on n’y a peut-être pas assez pris garde, une journée
dans la vie de cet homme singulier qui s’appelle Stalker et n’a pas d’autre nom (le
prénom ou diminutif, Nastia, prononcé par sa femme, est plutôt féminin). La structure
du film est claire cependant : la parenthèse du voyage dans la Zone se termine par
où elle a commencé, en noir et blanc et dans le décor quotidien, glauque, pauvre, du
Stalker (si l’on excepte l’apostille, en couleur, du miracle des verres). Au début du
film il est là, dans son lit, avec sa femme et sa fille ; on le découvre, au terme d’un
lent travelling passant dans l’ouverture de la porte, quand il se lève et part pour son
expédition. Au soir du même jour il revient, ou plutôt il est revenu : on le retrouve
au bistro, dans la même pose que le matin, avec ses deux comparses eux aussi dans
la même posture, exactement. Un instant, on peut presque se demander s’ils sont
vraiment partis, si tout cela n’a pas été un rêve – ce que le passage à la couleur peut
aussi suggérer (c’est le côté Wizard of Oz du film 1).
En plan d’ensemble (l’expédition, la journée du Stalker) comme en plan rapproché
(la Chambre, la télékinésie), tout est ambigu, énigmatique, irrésolu. Nous ne saurons
pas, ne devons pas savoir ce qu’il en est au juste : c’est le projet même du film.
(D’ailleurs une des décisions premières a été d’écarter le récit du film de celui du
roman adapté, où la Zone était, sans équivoque, la trace du passage des E.T.) Je
remarque ici qu’un stalker, en anglais, ce n’est pas un guide, pas un éclaireur. C’est
1. Relevé par Michel Chion, Andréï Tarkovski, Cahiers du cinéma, coll. « Grands cinéastes », 2007. 3
Aumont.indd 3 14/09/10 18:24:30
quelqu’un qui observe subrepticement : par exemple un chasseur qui suit à la trace
un animal en prenant garde d’être aperçu, un traqueur. Que traque le Stalker ? la
Chambre ? la vérité ? Et s’il était là pour observer ses deux compagnons ? (stalker
veut dire aussi cela : quelqu’un qui persécute un autre en l’observant de façon
obsessionnelle). C’est cette ambiguïté qui est précieuse, elle est, sinon vraiment le
sujet du film, du moins son but esthétique. Au reste, la Zone – nous l’avons sous les
yeux – n’est jamais qu’un paysage assez ordinaire, augmenté de quelques ruines
spectaculaires, et qui n’a rien de fantastique non plus ; ou qui n’aurait rien de fantas‑
tique, sans l’art diabolique qu’a Tarkovski de l’épaissir, de la faire consister, de la
faire exister visuellement comme mystère.
Quiconque connaît un peu le cinéma de Tarkovski reconnaît là son tropisme pour
les situations ambiguës, où l’on ne sait au juste quel est le degré de réalité de ce qui
est vu. La lévitation de la servante dans Le Sacrifice, l’apparition d’un fantôme dans
Le Miroir, le chien qui arrive de nulle part dans la chambre d’hôtel de Nostalghia
– événements d’autant plus énigmatiques qu’ils sont donnés comme allant de soi,
non soulignés, vus d’assez loin par une caméra aussi neutre que possible et pourtant
très présente comme regard. On ne sait jamais qui regarde. Jamais un personnage, ce
sont des points de vue propres au film, ou, mieux, propres au cinéma comme machine,
et pour cela presque surnaturels. Cette machine d’ailleurs est également apte à
fouiller le réel alors même qu’il semble banal, indifférent. La main du Stalker en gros
plan, les objets incongrus qui défilent ensuite ; les étranges jeux de lumière dans la
maison de Domenico (Nostalghia) ; le très gros plan d’une oreille (Solaris) ; l’irruption
secrète d’un tableau hollandais dans un paysage de neige russe (Le Miroir) – ce ne
sont pas des visions d’homme mais la vision d’un esprit, pour qui l’image n’est pas
seulement la photographie d’un aspect du monde, mais quelque chose qui résonne,
qui sent et se fait sentir. Le cinéma pour Tarkovski est sans doute « un mystère »,
comme pour Godard, mais au sens d’une mystérieuse puissance psychique.
Dans cette énigme et ce mystère, le détail est essentiel. Je l’ai déjà suggéré à propos
des trois moments de magie, dont l’un n’est lui-même qu’un détail, au double sens
désormais canonique du mot 1. Mais il en est d’autres, et de toutes sortes, certains
très visibles – et cependant rarement commentés, telles les deux momies enlacées
devant lesquelles veille le chien, dans sa pose hiératique de dieu égyptien, et entre
lesquelles pousse un arbre, la vie dans la mort (et en plus, les deux corps momifiés
sont dans une espèce de réduit, dont la porte bat sans fin, faisant alterner lumière et
ombre : vie et mort, aussi). Ou encore les graines de roseau qui traversent le dernier
1. Depuis le livre de Daniel Arasse – Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion,
1992 –, il est consensuel de distinguer particolare et detagglio, soit, en simplifiant, détail de mise en
4 scène et détail de figuration, l’un fonctionnel, l’autre arbitraire.
Aumont.indd 4 14/09/10 18:24:30
plan comme un souffle. Je laisse les momies et les roseaux (pourtant très connotés),
et m’intéresse à deux types de détails, récurrents l’un et l’autre.
D’abord, à propos des objets. Comme dans tous les films, il y a évidemment beau-
coup d’objets, mais ils n’ont pas tous le même statut. Certains s’épuisent dans leur
fonctionnalité, comme la motocyclette du policier : elle est étrange, avec son side-car
inhabité, surtout dans le plan où son conducteur l’a abandonnée (pour aller faire
quoi ?) – mais enfin, elle marche, et cela suffit à la justifier. Ou les verres sur la table
du bistro : ceux-là ne glissent pas subrepticement ni obrepticement pour tomber par
terre, ils ont un caractère tranquille de chose. Ou, dans le même genre, la bouteille
de vodka de l’Écrivain, voire le pistolet qu’il sort de sa poche au moment d’approcher
de la Chambre, et que le Stalker le contraint à jeter dans l’eau sale : objets empêchés
de jouer leur rôle – mais qui en avaient un, et sans équivoque.
Je suis plus intéressé par d’autres objets, parsemés dans le film et dont on ne sait
au juste à quoi ils servent, voire ce qu’ils sont. Le plus flagrant, dans le genre, c’est
la théorie d’objets incongrus qui défilent sous nos yeux, au milieu du film, alors que,
faisant une pause, les trois personnages s’assoupissent (ces objets, sur fond d’Apo‑
calypse de Jean, n’ont peut-être d’existence qu’onirique). Je ne les énumère pas
exhaustivement, l’ayant fait ailleurs à répétition 1, et me contente de noter que ceux-
là ne sont guère fonctionnels : une reproduction du Jean-Baptiste de Van Eyck, des
pièces de monnaie qui probablement n’ont plus cours, un pistolet absolument noyé,
la photo d’un arbre (à l’envers), un aquarium : bric-à-brac dénué de sens, de finalité,
d’utilité, qu’on n’a plus qu’à prendre comme métaphore ou allégorie (de la vanité,
comme je l’ai fait, ou d’autre chose si l’on préfère).
Il n’en va pas de même d’une autre collection d’objets, qui partage avec ceux-là un
filmage en noir et blanc et à la verticale ou presque : je veux parler du plateau rond
posé sur une chaise, au commencement du film, quand les personnages sont encore au
lit. Un plateau en métal, semble-t-il, et disposés dessus un verre d’eau, du coton, deux
cachets blancs et ronds, un mouchoir, une seringue ou peut-être un thermomètre. Je
nomme sans être certain, on voit mal et certaines formes ne sont pas identifiables
– rien n’est identifiable avec certitude. Ma liste (cachets, verre d’eau, coton, mouchoir,
seringue ou thermomètre) est celle d’un vraisemblable médical que le film rend
plausible, mais chaque terme en est contestable. Ce qui m’intéresse est le double
lien établi entre ce plateau chargé d’instruments et d’autres moments du film. Lien
vraisemblable de ces paraphernalia de la médication domestique avec la fin du film,
quand le Stalker, épuisé par l’effort physique et spirituel fourni, est au bord de la
crise nerveuse (ou d’une épilepsie dostoïevskienne) et que sa femme lui fait prendre
un cachet avec un verre d’eau. Lien figuratif, avec le défilé des objets dans l’eau ;
ceux-ci comprennent aussi un plateau d’infirmière avec une seringue et d’autres
1. « Vanités », paru dans la revue Cinémathèque (1999) et repris dans Matière d’images puis dans
Matière d’images, Redux (2009). Stalker y était considéré parmi d’autres films où l’on pouvait discerner
un possible souvenir du genre pictural de la « vanité ». 5
Aumont.indd 5 14/09/10 18:24:30
instruments (à peine aperçus) ; des pièces de monnaie, rondes comme les cachets ; pas
de verre, mais un aquarium rond, rempli d’eau, étrange comme de l’eau dans l’eau.
On pourrait aussi, je l’ai suggéré tout à l’heure, rapprocher les trois verres qui glissent
des trois verres sur la table de bistro : table pour table, usage pour usage, peut-être, qui
sait ?, nature pour nature. C’est un peu la même chose que le rapprochement des objets
dans l’eau et des objets sur le plateau : une parenté visible, mais pas explicable. Dans
tout cela je pense, peut-être un peu vite ou un peu arbitrairement, aux paragrammes
que le malheureux Saussure ne pouvait s’empêcher de voir (ou d’entendre) dans des
poèmes latins : des bribes du texte, prises çà et là, parfois une seule lettre dans un
mot, et qui, au total, délivrent un nouveau message, souvent obscur 1. Le verre d’eau
destiné à avaler le cachet, le verre (de bière ?) bu au bistro, le verre qui tombe et se
casse, la grosse boule de verre pleine d’eau dans l’eau – cela ferait une « phrase »
secrète, lisible pour quelque déchiffreur obsessionnel, et dont le sens hésiterait.
Je crois vraiment que le montage de Tarkovski se préoccupe de ce genre de détails,
et des phrases que l’on peut en faire. Par exemple (c’est le second type de détail
auquel je voulais m’intéresser), certains mouvements de caméra : des détails si l’on
veut, mais plutôt figurationnels que figuratifs, ceux-là. Comme les objets, ils sont
abondants ; comme eux aussi, ils ne s’épuisent pas dans leur fonctionnalité. Au reste,
il est facile ici de citer les plus remarquables (car chacun les a, justement, remarqués).
Trois travellings dans la profondeur scandent le film : le premier, au premier plan du
film (après le générique), pour entrer dans la chambre par la porte entrouverte ; à la
fin de l’aventure, le fameux travelling arrière qui découvre la Chambre et ses jeux de
lumière ; enfin, entre les deux, peu après l’arrivée dans la Zone, un autre travelling
avant, spectaculaire parce qu’il passe à travers une carcasse de voiture abandonnée
pour récupérer, de l’autre côté, les trois explorateurs. Trois mouvements, lents tous
les trois, immotivés tous les trois – immotivés fictionnellement, j’entends, car par
ailleurs, en termes d’énonciation, ils sont parfaitement limpides : ils incarnent un
regard, innomé et innommable.
Ces trois mouvements ne sont pas uniques. À deux reprises, l’Écrivain s’avance seul,
d’abord pour entrer prématurément dans la maison, puis pour franchir le « hachoir » ;
la caméra s’attache à son dos, manifestant encore sa présence et son regard. Ou bien
c’est un panoramique vertical sur le bord d’une butte de terre, révélant par un change‑
ment d’échelle que la mare qu’on apercevait était une vaste étendue d’eau. De tels
plans, vus par personne, n’appartenant qu’au maître du récit et des images, ne sont
pas rares au cinéma. Mais dans ce film où plane l’ombre d’un esprit invisible et
incompréhensible, on ne peut se retenir de les attribuer à cet être mystérieux qui
regarde, qui nous force à regarder sans comprendre : et si c’était la Zone qui regarde ?
Nous voyons ; nous savons que nous ne savons pas ce que nous voyons ; et nous pou-
vons bien croire que « quelqu’un », lui, le sait – et nous force à voir. Le film en somme
1. La référence est toujours Jean Starobinski, Les Mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand
6 de Saussure, Gallimard, 1971.
Aumont.indd 6 14/09/10 18:24:30
nous met exactement dans la position des deux explorateurs livrés au bon vouloir
du Stalker – mais ce qui m’intéresse, là aussi, c’est surtout la manière dont le film
organise des réseaux, des circuits, qui ne passent pas par le déroulement de l’histoire,
et relient des événements semblables mais disjoints.
Que disent ces rimes, ces renvois souterrains du film à lui-même (il y en aurait
d’autres, par exemple en termes de décor et de perspective) ? que dit ce paragramma-
tisme discret mais têtu ?
Un autre détail encore – très souligné, celui-là – pourrait nous souffler une réponse.
Arrivés tout près de la Chambre, les deux explorateurs nous font (et se font) une scène,
à mi-chemin du théâtre existentialiste et du théâtre de l’absurde – hédonisme contre
mélancolie, cynisme contre sincérité. Quand finalement le Stalker les ramène plus
sobrement à la situation, l’Écrivain, d’un geste désabusé et ironique, coiffe une
couronne de fil de fer barbelé. L’image est soudaine, saisissante, univoque – un Christ
aux outrages – et sans grâce. S’il est un particolare intentionnel, un détail d’auteur,
c’est bien celui-là. Mais bizarrement, et dans la mesure même où il est aussitôt
commenté dans le dialogue, ce détail archivisible acquiert moins d’importance pour
le tissu du film que ceux que j’ai cités, et qui ne nous avaient pas été autant jetés
aux yeux. La discrétion du détail serait la condition de sa prégnance. (Combien de
spectateurs voient les efflorescences de roseau qui tombent en neige sur la petite fille,
dans le dernier plan ? – pourtant faciles à mettre en rapport avec l’image de saint
Jean-Baptiste, et aussi avec le vent qui souffle, où il veut.)
Tarkovski est célèbre pour son obsession du temps filmique : un temps idéal, qui
coule, et auquel on ne puisse échapper ; un temps qui ne résulte pas de l’opération,
laborieuse et contre nature, du montage. La création d’un temps est une opération
miraculeuse, plutôt réservée à la musique (mais il y a un pouvoir musical des films
de Tarkovski : comme la musique, si on ne s’y abandonne pas on ne les supporte pas).
Et Tarkovski lui-même a toujours rapporté le montage aux passages de plan à plan, à
la façon dont une charge de vie mystérieuse, un flux immatériel, circule d’un plan au
suivant, interdisant tout bricolage et tout meccano. Ce que j’ai relevé est d’un autre
ordre ; le montage paragrammatique fait circuler quelque chose, mais pas un flux
– plutôt une vertu, une aura, un mana, en tout cas une qualité secrète. En outre, ces
détails plus ou moins ostensibles, c’est moi qui les articule, pas le film ; personne n’est
obligé de relier les verres entre eux, les pistolets entre eux, les travellings entre eux,
le roseau et le prophète. Cela me semble, pourtant, une partie importante, peut-être
même essentielle, de l’esthétique voire de la philosophie de ce film (il est possible que
je sois victime du syndrome de l’interprète : quand on a repéré un effet de sens, on ne
voit plus que lui).
Puisque nous sommes dans un cycle placé sous l’invocation de la prière, je rappel-
lerai la phrase de Flaubert, reprise par Aby Warburg et par bien d’autres ensuite : 7
Aumont.indd 7 14/09/10 18:24:30
« Le Bon Dieu est dans les détails. » Il y a bien des façons de prier : dans la supplique
ou dans l’extase ; comme un héros et comme un martyr ; comme un innocent et
comme un idiot (version plus proche du film). Je me demande si on ne pourrait pas, à
partir de Stalker, ajouter cette proposition étrange, que l’on peut prier en se rendant
attentif au détail, ce détail où loge le Bon Dieu. Ma métaphore est peut-être équivoque
– et je ne cherche pas à déterminer si Tarkovski était ou non un bon chrétien. Il ne
faisait pas mystère de son attachement à sa religion d’enfance, et la culture chrétienne
imprègne son film (Christ aux outrages, Apocalypse, pèlerins d’Emmaüs, Jean-
Baptiste, et bien sûr la sainte idiotie du Stalker), mais enfin, il ne fait pas un prêche.
Je dis « prière » à propos de l’attention au détail : je pourrais aussi bien dire « poésie »,
et de manière tout aussi vague. La façon dont les choses se relient – verre à verre,
pistolet à pistolet, travelling arrière à travelling avant – n’a rien du puzzle, rien de
l’énigme policière. À l’arrivée, après qu’on a opéré tous ces liens, on n’a pour ainsi
dire rien de plus : pas un atome d’explication, pas un iota de compréhension supplé‑
mentaires. L’opération a été un pur performatif (comme la prière, comme la poésie).
Cela ne la rend pas sans reste, tant s’en faut : mais ce reste, c’est précisément
la charge ineffable, l’aura, le mana.
Lorsque les explorateurs sont sur le point de passer le premier barrage – la grille
qui s’ouvre fugitivement devant le train –, un plan sur la locomotive nous la montre
baignant dans une lumière trop forte, quasi spielbergienne. Rien de nécessaire, rien
de fonctionnel, rien même de justifié dans cette lumière. Encore un détail, figuratif
et même figural celui-là, et où il est presque trop facile de voir une incarnation du
dorénavant célèbre aphorisme d’Oliveira, les « signes magnifiques baignant dans leur
absence d’explication ». La conjonction de la splendeur et du mystère, vue par Oliveira
comme fondement de la poiesis filmique, est aussi ce qui définit la divinité – toutes
les divinités peut-être, mais à coup sûr le Dieu unique des chrétiens. C’est exacte-
ment ce que nous donne cette image de lumière, et aussi, en un sens, toutes celles
que j’ai relevées dans le film de Tarkovski – à condition d’accepter que la splendeur
puisse revêtir un aspect misérable (c’est le dostoïevskisme du cinéaste). Encore une
fois, je ne veux pas insister sur l’aspect spirituel de la chose, souvent glosé. Ce qui
m’a frappé, en revoyant Stalker, c’était bien cette étonnante dispersion des signes
et de leur splendeur, ces liens ténus mais intimes entre eux, ce paradoxe d’un
cinéma du flux temporel qui s’ancre aussi, souterrainement, profondément dans des
méditations instantanées (des satoris, si on veut changer de registre) où se révèle,
bien plus que dans le théâtre si lourd des dialogues de ce film, quelque chose comme
le sens de la vie.
Aumont.indd 8 14/09/10 18:24:30
Vous aimerez peut-être aussi
- L’œuvre de Christopher Nolan: Les théorèmes de l’illusionD'EverandL’œuvre de Christopher Nolan: Les théorèmes de l’illusionPas encore d'évaluation
- Je m’appelle Paul, John, Monika, Scottie, Mark… et papa ou une petite histoire du cinéma - Tome 1: De 1895 à 1969D'EverandJe m’appelle Paul, John, Monika, Scottie, Mark… et papa ou une petite histoire du cinéma - Tome 1: De 1895 à 1969Pas encore d'évaluation
- Fausses notes à Larmor Plage: Les enquêtes du commissaire Landowski - Tome 20D'EverandFausses notes à Larmor Plage: Les enquêtes du commissaire Landowski - Tome 20Pas encore d'évaluation
- L'île de BeckettDocument5 pagesL'île de BeckettchevallierPas encore d'évaluation
- Phase Paradoxale: Un petit voyage au coeur du rêve et de l'évasion...D'EverandPhase Paradoxale: Un petit voyage au coeur du rêve et de l'évasion...Pas encore d'évaluation
- OvocephaleDocument121 pagesOvocephaleamicxjoPas encore d'évaluation
- Extrait Michel Chion PDFDocument9 pagesExtrait Michel Chion PDFrobertPas encore d'évaluation
- En attendant Godot de Samuekl Beckett (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandEn attendant Godot de Samuekl Beckett (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Westernesse IDocument70 pagesWesternesse INuma BuchsPas encore d'évaluation
- La Psychologie Selon Star Wars - Jean-François MarmionDocument149 pagesLa Psychologie Selon Star Wars - Jean-François MarmionNianguidiPas encore d'évaluation
- Ahouvati Le Kobek - Daniel PiretDocument114 pagesAhouvati Le Kobek - Daniel PiretchrisvialarPas encore d'évaluation
- Ces maisons qui tuent. Comment guérir le malefice des pierresD'EverandCes maisons qui tuent. Comment guérir le malefice des pierresÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Du Cinéma: CahiersDocument68 pagesDu Cinéma: Cahiersz74h80st2Pas encore d'évaluation
- Angkor: Un récit de voyage autobiographique et historiqueD'EverandAngkor: Un récit de voyage autobiographique et historiqueÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)
- h2g2 Tome 3, La Vie, L'univers Et Le ResteDocument221 pagesh2g2 Tome 3, La Vie, L'univers Et Le ResteAna Fran100% (1)
- La Conspiration des Colombes: Le Fanal des MondesD'EverandLa Conspiration des Colombes: Le Fanal des MondesPas encore d'évaluation
- Roméo et Juliette de William Shakespeare: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandRoméo et Juliette de William Shakespeare: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- HuitfemmesDocument26 pagesHuitfemmesSite Commune LanguePas encore d'évaluation
- Des Espera DosDocument28 pagesDes Espera DosChabuel Humbert100% (1)
- Démasqué - L'Homme Venu d'Ailleurs: Des Secrets Célestes dévoilésD'EverandDémasqué - L'Homme Venu d'Ailleurs: Des Secrets Célestes dévoilésPas encore d'évaluation
- Agel - Activité Ou Passivité Du Spectateur? - Dans SouriauDocument8 pagesAgel - Activité Ou Passivité Du Spectateur? - Dans SouriauMireille BertonPas encore d'évaluation
- Six planches et une poignée de clous: Les enquêtes de Cicéron - Tome 16D'EverandSix planches et une poignée de clous: Les enquêtes de Cicéron - Tome 16Pas encore d'évaluation
- Le Cinéma fantastique: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLe Cinéma fantastique: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Pascal Laurent: L'OmbreDocument63 pagesPascal Laurent: L'OmbreSabrina IkoloPas encore d'évaluation
- Herbert Frank Conscience 1 Destination Vide 1966 OCR French Ebook Alexandriz PDFDocument305 pagesHerbert Frank Conscience 1 Destination Vide 1966 OCR French Ebook Alexandriz PDFRémi SeffacenePas encore d'évaluation
- L'Emerggence de La Posture de Trois Quarts Dos Dans Le Portrait Individuel Du Debut Du Xvi SiecleDocument172 pagesL'Emerggence de La Posture de Trois Quarts Dos Dans Le Portrait Individuel Du Debut Du Xvi SiecleinadequacaoPas encore d'évaluation
- Petite Histoire Du PortraitDocument17 pagesPetite Histoire Du PortraitinadequacaoPas encore d'évaluation
- Une Semiotique Du PortraitDocument18 pagesUne Semiotique Du PortraitinadequacaoPas encore d'évaluation
- Iconographie de L'aret Profane Au Moyen Âge Et À La RenaissanceDocument550 pagesIconographie de L'aret Profane Au Moyen Âge Et À La RenaissanceinadequacaoPas encore d'évaluation
- L Objet Cinematographique Et La Chose Fi PDFDocument26 pagesL Objet Cinematographique Et La Chose Fi PDFinadequacaoPas encore d'évaluation
- Pour L'analyse Des ImagesDocument13 pagesPour L'analyse Des ImagesinadequacaoPas encore d'évaluation
- ALBERA François Cinéma Et Peinture Peiture Et CinémaDocument11 pagesALBERA François Cinéma Et Peinture Peiture Et CinémainadequacaoPas encore d'évaluation
- AUMONT AnnonciationsDocument20 pagesAUMONT Annonciationsinadequacao100% (1)
- ALBERA François Cinéma Et Peinture Peiture Et CinémaDocument11 pagesALBERA François Cinéma Et Peinture Peiture Et CinémainadequacaoPas encore d'évaluation
- Jean Epstein - Le Cinema Du Diable PDFDocument80 pagesJean Epstein - Le Cinema Du Diable PDFinadequacaoPas encore d'évaluation
- Barthes - La Chambre ClaireDocument108 pagesBarthes - La Chambre ClaireinadequacaoPas encore d'évaluation
- 001 PDFDocument80 pages001 PDFCarlos LondoñoPas encore d'évaluation
- Ouvrir Les Camps, Fermer Les Yeux - HubermanDocument48 pagesOuvrir Les Camps, Fermer Les Yeux - HubermaninadequacaoPas encore d'évaluation
- AUMONT Dieu Est Dans Les Détails PDFDocument8 pagesAUMONT Dieu Est Dans Les Détails PDFinadequacaoPas encore d'évaluation
- Le Manifeste StalkerDocument24 pagesLe Manifeste StalkerGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Stalker NotesDocument3 pagesStalker NotesSatyana ChristPas encore d'évaluation
- StalkerJDR LaLoutreRoliste PDF ExtraitDocument25 pagesStalkerJDR LaLoutreRoliste PDF ExtraitShems Aérographie67% (3)
- StalkerJDR LaLoutreRoliste PDF DynamiqueDocument250 pagesStalkerJDR LaLoutreRoliste PDF DynamiqueSénéchal StevePas encore d'évaluation