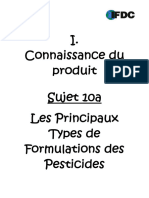Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rap Electrochimie
Rap Electrochimie
Transféré par
hellloTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rap Electrochimie
Rap Electrochimie
Transféré par
hellloDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chimie 3e/2e Module 4
Électrochimie
Électrolyse
Expérience : Électrolyse d’une solution de nitrate de plomb entre électrodes de plomb
Des cristaux de plomb métallique se forment et se
déposent à la cathode :
P b2+ + 2e− −→ P b(s)
Les ions plomb(II) sont réduits par des électrons
fournis par générateur.
A la cathode (électrode ⊖) : Réduction
Expérience : Électrolyse d’une solution de sulfate de potassium entre électrodes de cuivre
Des ions cuivre(II) se forment et se dissolvent à
l’anode :
Cu − 2e− −→ Cu2+
Les atomes Cu de l’anode sont oxydés en perdant
des électrons sucés par le générateur.
A l’anode (électrode ⊕) : Oxydation
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 1 de 7
Chimie 3e/2e Module 4
Généralisation
– L’oxydant 1 est n’est pas assez fort pour arracher spontanément des électrons au réducteur
2.
– Le générateur est une pompe d’électrons. Il force l’échange d’électrons qui ne serait pas
possible autrement.
– À la cathode, il force la réduction de l’oxydant le plus fort qui s’y trouve (en solution ou
dans l’électrode)
– À l’anode, il force l’oxydation du réducteur le plus fort qui s’y trouve (en solution ou dans
l’électrode)
– Dans la solution, le courant est assuré par la migration d’ions positifs vers l’anode, d’ions
négatifs vers la cathode.
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 2 de 7
Chimie 3e/2e Module 4
Le rôle de l’eau : Électrolyse d’une solution d’iodure de potassium entre électrodes inertes
Une partie de l’eau se dissocie toujours en ions hydrogène et hydroxyde :
H2 O −→ 2H + + OH −
Cette dissociation est très faible (une molécule sur 10000000 ! environ), mais elle suffit pour qu’on
doive tenir compte des ions H + et OH − dans la prévision des électrolyses en solution aqueuse !
Dans notre cas, nous sommes en présence des espèces suivantes :
K+ I− H+ OH − H2 O
En consultant le ☞le tableau des couples d’oxydo-réduction, nous constatons que
– H + est l’oxydant le plus fort. C’est lui qui sera réduit à la cathode :
2H + + 2e− −→ H2 (g)
Après disparition de l’ion hydrogène, il reste un excès d’ions hydroxyde et c’est cela qui colore
la phénolphtaléine.
– Br− est le réducteur le plus fort. C’est lui qui sera oxydé à l’anode :
2Br− −→ Br2
On voit y apparaître la couleur brunâtre caractéristique du (di)brome.
☞Exercices
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 3 de 7
Chimie 3e/2e Module 4
Piles
Expérience : La pile citron
Par les temps qui courent, l’éner-
gie devient rare. Pour éclairer
votre lanterne, voici comment bri-
coler un éclairage autonome à
l’aide d’un citron :
Expérience : La pile Daniell
Voici la version plus "scienti-
fique" de cette pile.
– Un pont électrolytique rempli
d’une solution de sulfate de so-
dium empêche le contact direct
entre Cu2+ et Zn
– Si Cu2+ et Zn étaient en
contact direct, ils réagiraient
normalement suivant :
Cu2+ + Zn −→ Cu + Zn2+
– Le conducteur électrique per-
met l’échange d’électrons par
voie détournée : ☞
– Zn − 2e− (passent dans le
conducteur)−→ Zn2+ (passe en
solution)
– Cu + 2e− (proviennent du
conducteur)−→ Cu(se dépose
sur l’électrode)
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 4 de 7
Chimie 3e/2e Module 4
Généralisation
– L’oxydant 1 est assez fort pour arracher des électrons au réducteur 2.
– Il ne peut cependant pas réagir avec lui à cause de la paroi semi-perméable ou du pont
électrolytique qui les séparent.
– Alors l’échange d’électrons se fait par l’intermédiaire du circuit extérieur
– Dans le compartiment 2, le réducteur 2 cède des électrons au circuit extérieur : Il est oxydé.
– Dans le compartiment 1, l’oxydant 1 prend des électrons au circuit extérieur : Il est réduit.
– Dans le circuit extérieur, les électrons circulent donc du réducteur 2 le plus fort vers l’oxy-
dant 1 le plus fort. Il se produit ainsi un courant électrique d’intensité I dont le sens (sens
conventionnel de la physique) est opposé au sens de déplacement des électrons.
– I circule toujours dans le circuit extérieur du pôle positif au pôle négatif.
– Le pôle positif de la pile est donc du côté de l’oxydant 1 le plus fort et le pôle négatif du
côté du réducteur 2 le plus fort.
– Les pertes ou gains de charge dans les deux compartiments 1 et 2 sont compensées par la
migration d’anions ou de cations à travers la membrane semi-perméable ou le pont électro-
lytique.
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 5 de 7
Chimie 3e/2e Module 4
Potentiels d’oxydo-réduction
Pour trouver la position d’un couple dans ☞le tableau des couples d’oxydo-réduction
, on procède de la manière suivante :
– Dans un des compartiments d’une pile, on introduit l’oxydant et le réducteur (et éventuelle-
ment les ions H + ) en question avec des molarités de 1 mol
L
s’ils sont solubles, sinon purs.
– L’autre compartiment sera occupé par l’électrode standard d’hydrogène :
L’électrode proprement dite (1) est en platine qui dissout le gaz (di)hydrogène (2) amené
constamment avec une pression de 1 atm, le tout plongé dans une solution (3) de molarité
en ion hydrogène [H + ] = 1 mol
L
.
– On mesure ensuite la tension (en Volt) aux bornes de cette pile.
– Cette tension E o appelée potentiel standard du couple d’oxydo-réduction est le nombre
que vous trouvez en marge du couple dans le tableau des couples d’oxydo-réduction. Elle
détermine la place dans le tableau .
– Le potentiel réel d’un couple dépend des concentrations : il augmente avec la concentration de
l’oxydant (ou des ions H + éventuels) et diminue si la concentration du réducteur augmente.
Tension d’une pile
La tension d’une pile ( avec des molarités de 1 mol
L
) est la différence des potentiels d’oxydo-réduction
de ses couples, par exemple :
La pile Cu2+ 1 mol
L
/Cu ; Ag + 1 mol
L
/Ag
possède une tension aux bornes de 0,81 - 0,35 = 0,56 Volt ; son pôle positif est du côté de l’oxydant
le plus fort Ag + et son pôle négatif du côté du réducteur le plus fort Cu.
☞Exercices
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 6 de 7
Chimie 3e/2e Module 4
Accumulateurs
Définition Les accumulateurs sont des piles rechargeables par électrolyse.
Exemple : ☞L’accumulateur au plomb.
L’accumulateur est constitué de plaques de plomb plongeant dans l’acide sulfurique. L’acide sulfu-
rique attaque superficiellement le plomb pour former du sulfate de plomb recouvrant les électrodes :
2H + + SO42− + P b −→ P b2+ SO42− + H2
La couche de sulfate de plomb est mince et empêche une attaque ultérieure. Dans l’interprétation
nous allons seulement considérer l’ion P b2+ qui y est renfermé.
Charge = Électrolyse : Décharge = Pile :
– À la cathode : – Du côté du réducteur P b :
Pb 2+
+ 2e −→ P b (dépôt sur électrode)
−
P b − 2e− −→ P b2+ ( pôle ⊖)
– À l’anode : – Du côté de l’oxydant P bO2 :
2+ +
P b + 2H2 O − 2e −→ 4H + P bO2
−
P bO2 + 4H + + 2e− −→ P b2+ + 2H2 O
(dépôt sur électrode) (pôle ⊕))
☞Exemples de piles et accumulateurs
Référence: bc-1-electrochimie.pdf page 7 de 7
Vous aimerez peut-être aussi
- Anatomie Et Physiologie Humaines 11e Édition (Elaine Marieb, Katja Hoehn)Document1 489 pagesAnatomie Et Physiologie Humaines 11e Édition (Elaine Marieb, Katja Hoehn)Cyril JACQUENOT100% (1)
- Présentation Cours N°9 SolubilitéDocument14 pagesPrésentation Cours N°9 SolubilitéinessPas encore d'évaluation
- TP ComplexesDocument6 pagesTP Complexesayyoub dhbPas encore d'évaluation
- Les CompréseuresDocument24 pagesLes CompréseuresZINODIDIN100% (6)
- Devoir de Sciences Physiques (3ème) ' NDSDocument2 pagesDevoir de Sciences Physiques (3ème) ' NDSissoufPas encore d'évaluation
- PropagExamen06 07 Sess1 CocodyDocument1 pagePropagExamen06 07 Sess1 CocodyissoufPas encore d'évaluation
- Deug 105Document148 pagesDeug 105Paul Adrien Maurice DiracPas encore d'évaluation
- TD N°1 Cinetique Chimique 2012-2013Document2 pagesTD N°1 Cinetique Chimique 2012-2013issoufPas encore d'évaluation
- MathDocument2 pagesMathissoufPas encore d'évaluation
- Tenseurs PDFDocument60 pagesTenseurs PDFkass_ecsPas encore d'évaluation
- PersonnelDocument89 pagesPersonnelissoufPas encore d'évaluation
- Programmation Reseau PDFDocument25 pagesProgrammation Reseau PDFissoufPas encore d'évaluation
- Debuter ProgrammationDocument384 pagesDebuter ProgrammationAnge ThalesPas encore d'évaluation
- Cours Chimie Organique Complet Pcem LicenceDocument63 pagesCours Chimie Organique Complet Pcem LicenceYami le Chimiste100% (1)
- Cours C++Document468 pagesCours C++taqanadotcomPas encore d'évaluation
- Resume de Chimie OrganiqueDocument20 pagesResume de Chimie OrganiqueissoufPas encore d'évaluation
- Copywriter 3eme Partie PDFDocument21 pagesCopywriter 3eme Partie PDFsuccesplus100% (1)
- Génétique MicrobienneDocument38 pagesGénétique MicrobienneZa Hra100% (1)
- !!champignonnière (5 Chambres)Document3 pages!!champignonnière (5 Chambres)Alexy NdeffoPas encore d'évaluation
- 573Document144 pages573MohamedZenaidyPas encore d'évaluation
- Les PompesDocument55 pagesLes Pompesadilos1067% (3)
- P13 UE1 Constitution Des Molécules Organiques 24fDocument16 pagesP13 UE1 Constitution Des Molécules Organiques 24fAZAZNAPas encore d'évaluation
- Technologie de Fabrication PTDocument249 pagesTechnologie de Fabrication PTCéline Lutti100% (1)
- 02.schema de LewisDocument4 pages02.schema de LewisadokflorentPas encore d'évaluation
- TP HydrauliqueDocument10 pagesTP Hydrauliqueboudiaf diaaeddinePas encore d'évaluation
- Chap1 Suite MDCDocument15 pagesChap1 Suite MDCkokoxoniekiePas encore d'évaluation
- Cin PDFDocument31 pagesCin PDFMeryam AmsPas encore d'évaluation
- Brochure Securite SoudageDocument136 pagesBrochure Securite SoudageyahiaPas encore d'évaluation
- Table FRDocument1 pageTable FRAyoub GhabriPas encore d'évaluation
- TP 2 Tda L3 GDPDocument3 pagesTP 2 Tda L3 GDPMål ÆkPas encore d'évaluation
- Comparaison des performances de deux types de technologies associées à un bâtiment à énergie positive une pompe à chaleur réversible en ORC et une pompe à chaleur couplée avec des panneaux photovoltaïques.pdfDocument8 pagesComparaison des performances de deux types de technologies associées à un bâtiment à énergie positive une pompe à chaleur réversible en ORC et une pompe à chaleur couplée avec des panneaux photovoltaïques.pdffarfarfifi3Pas encore d'évaluation
- m22 - Resistance Des MateriauxDocument66 pagesm22 - Resistance Des Materiauxwwwkader100% (10)
- Teza Hs - Dechoz - JDocument210 pagesTeza Hs - Dechoz - Jflorentin01Pas encore d'évaluation
- TP2 SimulationDocument7 pagesTP2 SimulationKamel BousninaPas encore d'évaluation
- 2010 AmNord Exo1 Correction Eau 6 5ptsDocument3 pages2010 AmNord Exo1 Correction Eau 6 5ptsla physique selon le programme FrançaisPas encore d'évaluation
- 10a Les Principaux Types de Formulation de PesticidesDocument9 pages10a Les Principaux Types de Formulation de PesticidesJamm MenguePas encore d'évaluation
- Corrige TD2 CDSDocument2 pagesCorrige TD2 CDSrahma rahmaPas encore d'évaluation
- Le Muscle PDFDocument121 pagesLe Muscle PDFYounes BroukiPas encore d'évaluation
- Chap8 TP Force Acides BasesDocument3 pagesChap8 TP Force Acides BasesfranbillesPas encore d'évaluation
- Hardness ConversionDocument3 pagesHardness ConversionCarlos DueñasPas encore d'évaluation
- Catalogo ClimaxDocument55 pagesCatalogo ClimaxLucho CruzPas encore d'évaluation
- Cerat Galien 2006Document2 pagesCerat Galien 2006listesel788Pas encore d'évaluation
- Fragilisation Par Hydrogène en PratiqueDocument2 pagesFragilisation Par Hydrogène en Pratiquebassoum_sPas encore d'évaluation