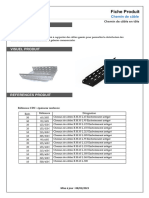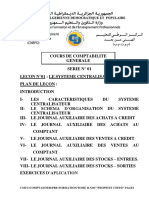Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Autonomie
Transféré par
Zêdka ChâmàýtôTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Autonomie
Transféré par
Zêdka ChâmàýtôDroits d'auteur :
Formats disponibles
L’organisation du travail, clé de toute pédagogie différenciée
réduire les inégalités, mais ne font rien, strictement rien de convaincant dans ce
sens. Aussi injuste et discutable soit-il, ce livre pose une question qu’on ne peut
pas esquiver : y a-t-il une volonté politique de réduire les inégalités, de faire en
sorte que chacun atteigne un niveau décent de connaissances et de compétences à
la fin de l’école obligatoire ? Quand 20 % des adolescents qui ont passé dix ans sur
des bancs d’école ne savent pas lire couramment, la question n’est pas absurde.
Et elle n’épargne pas la gauche qui, lorsqu’elle est au pouvoir, n’empoigne pas
davantage le problème à bras-le-corps.
Jean-Michel Berthelot (1983) mettait en évidence une tension interne à la
classe dominante : les modernistes se soucient de compétitivité dans un monde
globalisé, ils craignent aussi l’extension et les désordres que pourrait provoquer
une société duale. Mais une fraction plus traditionnelle de la classe dirigeante
se préoccupe primordialement de transmettre son capital économique, social et
culturel à ses enfants et donc ne fait rien pour les mettre en concurrence avec des
enfants issus des classes populaires.
Les rapports entre ces deux fractions de la classe dominante ne sont pas
stables. On a pu croire que les modernistes l’emporteraient, mais la crise dessert
leurs perspectives : dans une société dont la croissance est en panne, l’inflation
des diplômes grossit le flot des indignés. Ces derniers regroupent en effet non
seulement les plus pauvres, mais aussi et peut-être d’abord tous ceux auxquels
l’école a promis un emploi stable et bien rémunéré et qui se retrouvent au
chômage ou dans des jobs précaires malgré un niveau d’instruction élevé. Dans
le même temps, la crise fait craindre aux classes moyennes une régression sociale
et menace même les enfants des classes privilégiées. Alors oui, peut-être faut-il
simplement conclure que la volonté politique de lutter efficacement contre l’échec
scolaire et l’inégalité n’existe pas ou ne s’impose pas dans la classe politique. En
dépit des discours qui tendent à faire croire le contraire.
À cela s’ajoute l’évolution (rapide mais inachevée) vers ce que Laval et al.
(2011) appellent « la nouvelle école capitaliste », qui conçoit la formation comme
une préparation à l’employabilité dès le plus jeune âge. Non pas comme préparation
précoce à des postes de travail définis des années à l’avance. La rapidité des
changements économiques et technologiques interdit de planifier l’évolution des
emplois et d’orienter les carrières scolaires sur cette base. La crise économique qui
touche depuis 2008 les pays développés, projetant une fraction importante des
jeunes dans le chômage et la précarité, rend encore plus utopique l’idée d’adapter
leur formation aux emplois prévisibles. Il serait plus réaliste, mais politiquement
incorrect et en apparence cynique de les préparer au chômage…
Les auteurs mettent en évidence un changement de paradigme : on « confie »
Vous aimerez peut-être aussi
- 3 - AMDEC - Exemple Processus Réception - HRNDocument15 pages3 - AMDEC - Exemple Processus Réception - HRNXavier MaringildaPas encore d'évaluation
- Republique Du Niger Ministere de L'Enseignement Superieur, de La Recherche Et de L'InnovationDocument54 pagesRepublique Du Niger Ministere de L'Enseignement Superieur, de La Recherche Et de L'InnovationIkram HammadiPas encore d'évaluation
- L3 CCF Corrigé Exercice 1 TD 3Document1 pageL3 CCF Corrigé Exercice 1 TD 3Peter AsPas encore d'évaluation
- PROJET DE TRANSFORMATION DU CEREALE SOJA Juillet 2021 - 2 2Document8 pagesPROJET DE TRANSFORMATION DU CEREALE SOJA Juillet 2021 - 2 2bessama84Pas encore d'évaluation
- Iso Iec 27001 Lead Implementer 4p FRDocument4 pagesIso Iec 27001 Lead Implementer 4p FRshadi ryanPas encore d'évaluation
- Booklet MVola VISADocument28 pagesBooklet MVola VISAMaroharilala RakotomananaPas encore d'évaluation
- Contrat de BailDocument2 pagesContrat de BailIke Kashaka TshikungPas encore d'évaluation
- Actuariat Vie-Chap3Document17 pagesActuariat Vie-Chap3chaymaPas encore d'évaluation
- Taxes Foncières (Avis) (VAISON-LA-ROMAINE (84) )Document2 pagesTaxes Foncières (Avis) (VAISON-LA-ROMAINE (84) )jerem charlesPas encore d'évaluation
- Facture ProximusDocument2 pagesFacture ProximussimilonantoinePas encore d'évaluation
- Projet OeufsDocument4 pagesProjet OeufsmohamPas encore d'évaluation
- Principe de Continuité D'exploitation:: Principes ComptablesDocument2 pagesPrincipe de Continuité D'exploitation:: Principes Comptableschaimaa chaaibitaPas encore d'évaluation
- Rapport D'evaluation Du Profadel Phase 2Document22 pagesRapport D'evaluation Du Profadel Phase 2Mammane YaoubaPas encore d'évaluation
- Exercice Champs D'application TVA Prof Nabil LAAGADDocument6 pagesExercice Champs D'application TVA Prof Nabil LAAGADOussama Bouharaoui50% (2)
- Contribution MINESUPDocument7 pagesContribution MINESUPJean OnanaPas encore d'évaluation
- De La Valeur Des Choses Dans Le Temps - WWW - Histoire-GenealogieDocument15 pagesDe La Valeur Des Choses Dans Le Temps - WWW - Histoire-GenealogieXander HrPas encore d'évaluation
- Formulaire Sf-225 Pour Mettre en Stock, Reviser Ou Mettre en Desuetude Un ArticleDocument18 pagesFormulaire Sf-225 Pour Mettre en Stock, Reviser Ou Mettre en Desuetude Un ArticleAbdoulaye CissePas encore d'évaluation
- Catalogue Franklin France PDFDocument60 pagesCatalogue Franklin France PDFSerhane YacinePas encore d'évaluation
- Microéconomie2 - Séance03 - PR - ELIMRANI - OUAIL - 20.21Document43 pagesMicroéconomie2 - Séance03 - PR - ELIMRANI - OUAIL - 20.21BOU KDORPas encore d'évaluation
- Business Plan QuincaillerieDocument30 pagesBusiness Plan QuincailleriewdjabiamPas encore d'évaluation
- TD MRPDocument3 pagesTD MRPhaourch aminePas encore d'évaluation
- BouyguesTelecom Facture 20230721 11675988980723Document4 pagesBouyguesTelecom Facture 20230721 11675988980723Guichel MouanouPas encore d'évaluation
- Bulletins de Salaire Fevrier 2022 v1 TRAORE IbrahimaDocument1 pageBulletins de Salaire Fevrier 2022 v1 TRAORE IbrahimaTRAORE Ibrahima100% (1)
- Chapitre 5 Comptabilisation Ulterieure Des Actifs FinanciersDocument9 pagesChapitre 5 Comptabilisation Ulterieure Des Actifs FinanciersMakram ZouariPas encore d'évaluation
- Banque DiversificationDocument3 pagesBanque DiversificationThosma La dPas encore d'évaluation
- Fiche Produits CDC - 0Document13 pagesFiche Produits CDC - 0idriss.ouamouPas encore d'évaluation
- Méthodes Comptables, Changements D'estimations Comptables Et Erreurs (IAS 8)Document30 pagesMéthodes Comptables, Changements D'estimations Comptables Et Erreurs (IAS 8)sarfoutiPas encore d'évaluation
- La Véritable Histoire Du Club BilderbergDocument255 pagesLa Véritable Histoire Du Club Bilderbergkouadio yao Armand100% (2)
- PDF Chap3 AugmentationDocument50 pagesPDF Chap3 AugmentationAminePas encore d'évaluation
- Ptabilite Generale - S01-Cii - LFDocument52 pagesPtabilite Generale - S01-Cii - LFFodil SlimPas encore d'évaluation