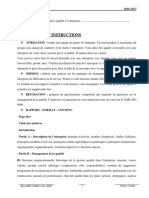Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
MP-Ch3 - Planification PDF
MP-Ch3 - Planification PDF
Transféré par
Noomen AlimiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- Devoir de Synthèse Math N°1 - 2ème Economie (2009-2010) PDFDocument2 pagesDevoir de Synthèse Math N°1 - 2ème Economie (2009-2010) PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Economie Services (2010-2011) MR Gary Badredine PDFDocument2 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Economie Services (2010-2011) MR Gary Badredine PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Gestion (2018-2019) MR Chaabane Mounir 2 PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Gestion (2018-2019) MR Chaabane Mounir 2 PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir Corrigé de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2012-2013) MR BELLASSOUED MOHAMED PDFDocument4 pagesDevoir Corrigé de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2012-2013) MR BELLASSOUED MOHAMED PDFNoomen Alimi100% (1)
- Devoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFDocument2 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Cours MOQDocument72 pagesCours MOQNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Services (2018-2019) MR Hamdi Zantour PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Services (2018-2019) MR Hamdi Zantour PDFNoomen Alimi100% (2)
- TP AtelierDocument2 pagesTP AtelierNoomen Alimi100% (1)
- Importance Des NormesDocument56 pagesImportance Des NormesNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Chapitre II QSEDocument20 pagesChapitre II QSENoomen AlimiPas encore d'évaluation
- ISO v1Document45 pagesISO v1Noomen AlimiPas encore d'évaluation
- MP-Ch0 - FondamentauxDocument11 pagesMP-Ch0 - FondamentauxNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Pico PanfDocument2 pagesPico PanfDavid UrbainPas encore d'évaluation
- Etapes Creation LogoDocument7 pagesEtapes Creation LogoImane Aachab100% (1)
- Résumé Elec BacDocument29 pagesRésumé Elec BacFethi BenmassoudePas encore d'évaluation
- TIA - Chap03 - Réseaux Neuro-FlousDocument6 pagesTIA - Chap03 - Réseaux Neuro-FlousNassr eddine100% (1)
- Guide Elec LEGRAND 2Document43 pagesGuide Elec LEGRAND 2ludoPas encore d'évaluation
- 3 GestionrisquescriticiteDocument35 pages3 GestionrisquescriticiteHassan HoudoudPas encore d'évaluation
- Toute L Algebre de La Licence 4e Ed Cours Et Exercices Corriges 2100747401Document1 pageToute L Algebre de La Licence 4e Ed Cours Et Exercices Corriges 2100747401GamzPas encore d'évaluation
- Dell Precision T3500 Brochure 1 FR PDFDocument2 pagesDell Precision T3500 Brochure 1 FR PDFYoucef BensenouciPas encore d'évaluation
- Recapitulatif Des GarantiesDocument4 pagesRecapitulatif Des GarantiesWayzzOnTop ftnPas encore d'évaluation
- Partie 1 Cours ExcelDocument9 pagesPartie 1 Cours Exceldarni japhet MBADINGA MOMBOPas encore d'évaluation
- Cours Algo IN1-1Document15 pagesCours Algo IN1-1gladys cheuffaPas encore d'évaluation
- EPITA BrochureDocument96 pagesEPITA BrochurevenanceharoldPas encore d'évaluation
- Amplificateur Classe ADocument11 pagesAmplificateur Classe AHiba RosaPas encore d'évaluation
- Badri Yassine CVDocument1 pageBadri Yassine CVYassine BadriPas encore d'évaluation
- 1 BI IntroductionDocument17 pages1 BI IntroductionImene AssousPas encore d'évaluation
- Programmation GPU-IRIIADocument51 pagesProgrammation GPU-IRIIASweat SweatPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ESTS ANAS EL BASSBASIDocument35 pagesRapport de Stage ESTS ANAS EL BASSBASISalma BelbsirPas encore d'évaluation
- Fiche D'appreciation ESTGDocument1 pageFiche D'appreciation ESTGOthmane EL BAROUDIPas encore d'évaluation
- CV SalimDocument3 pagesCV SalimTaha SenniaPas encore d'évaluation
- Setup Sheets TutorialDocument47 pagesSetup Sheets TutorialLaith HashimPas encore d'évaluation
- Expose Sur OptimaintDocument6 pagesExpose Sur OptimaintBiba DieyePas encore d'évaluation
- Module 5Document16 pagesModule 5FerdianadPas encore d'évaluation
- Delphi Réseau-Présentation InterbaseDocument4 pagesDelphi Réseau-Présentation InterbaseMayaLabelle67% (6)
- Stratégies Industreilles Cours 2Document27 pagesStratégies Industreilles Cours 2carton SPSPas encore d'évaluation
- Mail RDV Pole Emploi 22 AoutDocument1 pageMail RDV Pole Emploi 22 AoutKouna LOPas encore d'évaluation
- HAMRICH Halima - CVDocument1 pageHAMRICH Halima - CVYoussef DecaPas encore d'évaluation
- Sciences Et Technologies de Lindustrie eDocument5 pagesSciences Et Technologies de Lindustrie eDan CheridanPas encore d'évaluation
- Cours OptoElectronique PDFDocument77 pagesCours OptoElectronique PDFselmaPas encore d'évaluation
- Disomat - Opus - Zing FIleDocument136 pagesDisomat - Opus - Zing FIleGopalPas encore d'évaluation
- CoursDocument19 pagesCoursfouad akroudPas encore d'évaluation
MP-Ch3 - Planification PDF
MP-Ch3 - Planification PDF
Transféré par
Noomen AlimiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
MP-Ch3 - Planification PDF
MP-Ch3 - Planification PDF
Transféré par
Noomen AlimiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Chapitre 3
La planification du projet
OBJECTIFS DU CHAPITRE :
A la fin de ce chapitre les étudiants doivent pouvoir :
• Connaître les étapes d’élaboration d’un planning.
• Estimer les charges et les actions d’un projet.
• Elaborer un réseau PERT.
• Calculer les marges d’un projet.
• Représenter un diagramme Gantt.
La planification consiste à établir un planning détaillé permettant d’identifier les tâches,
d’estimer les durées et les charges et d’affecter les ressources.
Habituellement, un premier planning sommaire ou macro-planning est réalisé lors de la
phase de cadrage afin d’ordonnancer les principales activités entre elles, d’indiquer les
principales dates de référence du projet et notamment les dates de début et de fin.
A ce stade de préparation du projet, il est possible de procéder à une planification plus
détaillée.
I. LES ETAPES D’ELABORATION D’UN PLANNING
L’élaboration d’un planning détaillé passe par les étapes suivantes :
• Le choix d’un environnement de planification,
• La réalisation de la liste détaillée des tâches,
• L’estimation des durées et des charges,
• L’identification des interdépendances entre les tâches et l’ordonnancement, et
• L’affectation des ressources matérielles.
M. Bel Cadhi Page 24
Chapitre 3
1. Le choix d’un environnement de planification
Le choix d’un environnement de planification consiste à fixer et à sélectionner les
principales références de travail nécessaires à la planification telles que : les horaires de
travail, le nombre de jour de travail, le type de représentation à utiliser, les unités de
durées et de charge, la codification des tâches et des ressources…
2. La réalisation de la liste détaillée des tâches
Si le WBS a précédemment été réalisé, toutes les activités et les tâches nécessaires à la
réalisation du projet sont identifiées. Il est possible à ce moment-là de procéder à une
planification plus détaillée. A défaut, il devient primordial à ce stade d’identifier toutes
les tâches relatives à l’atteinte de l’objectif du projet.
3. L’estimation des durées et des charges
Il s’agit d’évaluer les durées et la charge de travail des différentes tâches de chaque étape.
Le détail de l’estimation des durées et des charges sera présenté dans la section suivante.
4. L’identification des interdépendances et l’ordonnancement
Il s’agit là d’identifier les différentes contraintes liées au tâches, de les lier entre-elles et
de les ordonnancer afin de déterminer le chemin critique, les marges et les principales
dates du projet.
A cet effet, plusieurs systèmes de représentation sont possibles. Ils seront présentés dans
les sections ultérieures.
5. L’affectation des ressources matérielles.
L’affectation des ressources humaines et matérielles pour la réalisation des tâches
dépend des ressources disponibles et du mode de leur utilisation. Une bonne affectation
dépendra donc d’une identification préalable claire des ressources.
II. L’ESTIMATION DES CHARGES ET L’AFFECTATION DES ACTIONS
Il s’agit en premier, d’évaluer la charge de travail des différentes tâches de chaque étape
(combien d’heures ou de journées va-t-on consacrer à chacune ?).
M. Bel Cadhi Page 25
Chapitre 3
Cette évaluation est effectuée par rapport aux moyens potentiellement disponibles. Elle
est exprimée au moyen d’un indicateur de mesure appelé unité d’œuvre.
Selon les types de projets, l’unité d’œuvre peut-être un nombre (exemple : nombre
d’instructions écrites/jour dans les projets informatiques), une durée (exemple : demi-
journée/homme dans les projets d’étude d’organisation…).
Après avoir effectué les estimations de charges, l’équipe projet procède à la
détermination des dates prévisionnelles de fin de tâches et d’étapes. Le calcul des dates
est indispensable pour faciliter le suivi d’avancement. Il sert également de référentiel aux
responsables de tâches pour organiser leur propre travail (par exemple, fixer un rendez-
vous pour une réunion).
Souvent, il est nécessaire de disposer de données très précises pour avoir une
approximation suffisamment indicative. On peut alors, si l’on n’a pas de données
statistiques antérieures, ou pour recouper celles-ci, effectuer une estimation
approximative – ou la demander par interview aux agents d’unité.
1. La technique des estimations corrigées
L’estimation est une façon de quantifier d’un usage simple et très pratique. Elle peut, en
première analyse, donner une idée correcte des volumes, durées, quantités, délais, taux
d’erreur, coûts…
La méthode dite du « pendulage » consiste à effectuer trois approximations chiffrées
successives : le temps minimum pour réaliser l’activité (a), le temps maximum pour
réaliser l’activité (b) et le temps le plus probable (c).
Puis, on détermine une « moyenne corrigée » (la plus proche de ce qu’on trouverait si
l’opération était effectuée un grand nombre de fois si le phénomène répond à la « loi
normale réduite » décrite par la courbe de Gauss).
Celle-ci s’obtient par la formule :
Moyenne corrigée = (a + (4 x c) +b)/6
Si l’on veut apprécier le degré d’incertitude (di) de la moyenne, on pourra se servir de la
formule :
Degré d’incertitude = (b-a)/6
M. Bel Cadhi Page 26
Chapitre 3
Plus le résultat di est élevé, plus l’incertitude est forte. Il pourra alors être nécessaire de
procéder à un découpage plus fin de l’activité.
Exemple :
Dans un service de ressources humaines, une offre d’emploi a drainé 200 demandes qui
seront traitées par le service. Pour une journée de 8 heures de travail, l’unité d’œuvre est
la demi-journée/homme.
L’estimation de la durée de l’entrevue est au minimum de 9 minutes (a),au maximum de
35 minutes (b) et la plus fréquente de 25 minutes (c).
Combien de jours faudrait-il pour traiter ces demandes et avec quel degré
d’incertitude pour deux employés du service?
Moyenne corrigée = (9 + 25 x 4 + 35)/6 = 24 minutes
di = (35-9)/6 = 4,33 minutes.
Demi-journée/homme = 4 heures
Nombre d’entrevues par jour = (4 h x 60 mn)/24 = 10 entrevues
Durée du travail total = 200 entrevues/10 = 20 demi-journées/homme
Sachant qu’il y a 2 employés, la durée de traitement des demandes est de : 20/2 = 10
jours.
2. L’affectation des actions
Les travaux sont affectés à différents intervenants, en fonction de leurs compétences et
de leur disponibilité. Les intervenants concernés sont principalement des membres de
l’équipe projet, et également des collaborateurs de l’entreprise non directement
concernés par le projet. Cette affectation est formalisée par des supports spécifiques
(tableau d’affectation des tâches, plan de charge). Cela permet de s’assurer que toutes les
tâches sont bien affectées. Enfin, le côté contractuel de toute formalisation implique une
responsabilisation des personnes ayant en charge les différentes tâches.
M. Bel Cadhi Page 27
Chapitre 3
III. L’ELABORATION DES PLANNINGS ET LES SYSTEMES DE REPRESENTATION
Le planning est un outil qui facilite l’ordonnancement du travail. Il s’agit principalement
d’optimiser les délais de traitement et l’utilisation des hommes, des machines et des
locaux, en tenant compte du positionnement dans le temps des opérations, et de
visualiser les charges à réaliser, prévoir et contrôler la répartitions des affectations, et
pouvoir ainsi ajuster les moyens à la situation.
On utilise pour cela plusieurs systèmes de représentation.
• Le réseau PERT (Program Evaluation and Review Technic)
Développée aux Etats-Unis dans les années 50, la méthode PERT est une méthode
conventionnelle utilisée en gestion de projet. Elle présente une méthodologie et des
moyens pratiques pour décrire, représenter, analyser et suivre de manière logique les
tâches et le réseau des tâches à réaliser dans le cadre d’une action à entreprendre ou à
suivre. Le concept perfectionne l’outil Diagramme de Gantt (1910) et a suscité le
développement de méthodes comme la « Méthode MPM » (ou méthode des potentiels et
antécédents métra) développée par Bernard Roy (1958).
• Le Diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt est un outilutilisé (souvent en complément d’un réseau PERT)
lors de l’ordonnancement et la gestion de projet et permettant de visualiser dans le
temps les diverses tâches composant un projet. Il s’agit d’une représentation graphique
permettant de renseigner et de situer dans le temps les phases, tâches et ressources du
projet.
• Milestones
Il s’agit d’une représentation des évènements (Jalons) axée sur le calendrier.
IV. LE RESEAU PERT
1. Eléments constitutifs
Le réseau PERT est constitué des éléments suivants :
M. Bel Cadhi Page 28
Chapitre 3
• Tâche, c’est un travail ou une fonction élémentaire ayant un début et une fin. Elle
est représentée par une flèche. A chaque tâche correspond un code et une durée
(D).
• Étape, c'est le début et la fin d'une tâche. Chaque tâche possède une étape de
début et une étape de fin. A l'exception des étapes initiales et finales, chaque étape
de fin est étape de début de la tâche suivante.
• Tâche fictive, représentée par une flèche en pointillés, elle permet d'indiquer les
contraintes d'enchaînement entre certaines étapes.
• Conditions d’entrée d’une tâche : Réalisation des toutes les conditions appliquées
au nœud où débute la tâche (fin des tâches précédentes).
• Date « au plus tôt »: Date la plus « en avance » possible qui permet de débuter les
tâches suivantes en respectant toutes leurs conditions de démarrage (DTO).
• Chemin critique : Trajet constitué des mailles considérées les plus longues
permettant de satisfaire toutes les conditions de réalisation de toutes les tâches
pour atteindre l’objectif final « au plus tôt ».
• Date « au plus tard » : Date la plus tardive possible qui permet de démarrer les
tâches suivantes sans faire reculer le délai final défini par le chemin critique
(DTA).
2. Etapes de réalisation du réseau PERT
1. Dessiner l’enchaînement des tâches
2. Affecter à chaque tâche une durée.
3. Calculer pour chaque étapela « date au plus tôt » en progressant dans le sens
du temps et en tenant compte de toutes les contraintes.
4. Repartir de la date finale et calculer pour chaque étape la « date au plus
tard », en remontant le temps.
5. Définir le chemin critique : pour lequel « la date au plus tard » est égale à « la
date au plus tôt ».
6. Définir pour toutes les tâches non critiques les marges de temps.
M. Bel Cadhi Page 29
Chapitre 3
3. Calcul des dates de fin de chaque étape
• Chaque étape peut lui arriver une ou plusieurs tâches et il peut en partir une ou
plusieurs tâches.
• Pour chaque étape, on calcule la date de fin au plus tôt (FTO) et le temps de fin au plus
tard (FTA).
a) Date de fin au plus tôt d’une étape
FTO (étape i) = Sup. [Durée tâche (Xi) arrivant à l’étape (i) + FTO étape de départ de la
tâche (αi)]
b) Date de fin au plus tard d’une étape
FTA (étape i) = Inf. [FTA étape d’arrivée de la tâche (Xi) - Durée tâche (αi) partant de l’étape (i)]
c) Boîte de date d’une étape
Tâche X
Etapei Etape j
D
DTO DTA FTO FTA
d) Méthode de calcul
• FTO (étape 0) = 0
• On commence par calculer tous les FTO (étape) jusqu’à la dernière étape.
• FTA (dernière étape) = FTO (dernière étape).
• On calcule tous les FTA (étape) dans le sens inverse jusqu’à l’étape de départ (0).
• On doit trouver FTA (étape 0) = 0.
M. Bel Cadhi Page 30
Chapitre 3
4. Détermination du chemin critique
Une tâche de A vers B est critique si la différence entre la date au plus tard de B et la date
au plus tôt de A est égale à la durée de la tâche à accomplir. L'ensemble des tâches
critiques constitue le chemin critique, c'est-à-dire le chemin sur lequel aucune tâche ne
doit avoir de retard pour ne pas retarder l'ensemble du projet.
Pour déterminer le chemin critique il faut :
• Repérer toutes les étapes telles que : FTO (étape) = FTA (étape) ⇒ Etape critique
• Repérer toutes les tâches qui se trouvent entre des étapes critiques successives.
• Le chemin critique est l’ensemble des tâches critiques successives.
5. Définition et calcul des marges
Il existe trois types de marges.
• La marge totale : Cette marge correspond à la durée dont une tâche peut être
prolongée ou retardée sans augmenter la durée totale du projet. Quand cette
marge s’annule la tâche devient critique.
• La marge libre : Cette marge correspond à la durée dont une tâche peut être
prolongée ou retardée sans déplacer aucune autre tâche du projet. C’est la réserve
de sécurité attachée à la tâche.
• La marge certaine : Cette marge correspond à l’écart de temps entre la fin d’une
tâche débutée « au plus tard » et le besoins « au plus tôt » des tâches suivantes.
Cette marge n’est pas nécessaire et n’est pas utilisée.
Chaque Tâche du graphe est affectée de 5 paramètres temporels :
• La date de début « au plus tôt » (DTO)
• La date de début « au plus tard » (DTA)
• La durée de la tâche (D)
• La date de fin « au plus tôt » (FTO)
• La date de fin « au plus tard » (FTA)
Ces paramètres vont permettre de définir les marges :
M. Bel Cadhi Page 31
Chapitre 3
a) Marge totale d’une tâche :
Marge totale =
Date de fin au plus tard – Durée - Date de début au plus tôt
Ou encore :
MT = (FTA) – (D) - (DTO)
b) Marge libre d’une tâche :
Marge libre =
Date de fin au plus tôt – Durée - Date de début au plus tôt
Ou encore :
ML = (FTO) – (D) -(DTO)
c) Marge indépendante d’une tâche :
Marge indépendante=
Date de fin au plus tard - Date de fin au plus tôt
Ou encore :
MI = MT – ML ou MI = FTA - FTO
6. Application :
L’entreprise Delta est sut le point de lancer un nouveau produit sur le marché.
Le lancement nécessite la réalisation d’un certain nombre de tâches dont les
caractéristiques sont les suivantes :
A B C D E F G H I
Durée 5 2 5 4 2 4 3 2 6
Antécédents D G–H B - G-H E –I - D A
M. Bel Cadhi Page 32
Chapitre 3
a) Représentation PERT
1 A=5 3 I=6 4
D=4 F=4
H=2
Début
E=2 Fin
G=3 C=5
2 4
B=2
b) Détermination des dates au plus tôt
1 A=5 3 I=6 4
4 9 15
D=4 F=4
H=2
Début
E=2 Fin
0 19
G=3 C=5
2 4
6 8
B=2
c) Détermination des dates au plus tard
1 A=5 3 I=6 4
4 4 9 9 15 15
D=4 F=4
H=2
Début
E=2 Fin
0 0 19 19
G=3 C=5
2 4
6 12 8 14
B=2
M. Bel Cadhi Page 33
Chapitre 3
d) Détermination du chemin critique
1 A=5 3 I=6 4
4 4 9 9 15 15
D=4 F=4
H=2
Début
E=2 Fin
0 0 19 19
G=3 C=5
2 4
6 12 8 14
B=2
e) Calcul des marges
A B C D E F G H I
D 5 2 5 4 2 4 3 2 6
DTO 4 6 8 0 6 15 0 4 9
DTA 4 12 14 0 12 15 0 4 9
FTO 9 8 19 4 15 19 6 6 15
FTA 9 14 19 4 15 19 12 12 15
MT 0 6 6 0 7 0 9 6 0
ML 0 0 6 0 7 0 3 0 0
MC 0 6 0 0 0 0 6 6 0
V. LA REPRESENTATION GANTT
De même que pour le réseau PERT, le Diagramme Gantt nécessite la détermination des
différentes tâches à réaliser et leur durée ainsi que la définition des relations
d’antériorité entre elles.
On représente tout d’abord par un trait épais (rectangle) les tâches n’ayant aucune
antériorité, puis les tâches dont les tâches antérieures ont déjà été représentées, et ainsi
de suite en les reliant par des flèches …
M. Bel Cadhi Page 34
Chapitre 3
On peut reconstituer le chemin critique et représenter les tâches critiques d’une couleur
différentes.
Le diagramme peut être enrichi par la représentation des marges existantes sur certaines
tâches.
Représentation Gantt à partir de Ms project
VI. LA REPRESENTATION MILESTONES
La représentation Milestones est une représentation synthétique qui permet de
visualiser l’ensemble des dates importantes du projet qu’on appelle également Jalons.
Les jalons permettent de scinder le projet en phases clairement identifiées, évitant ainsi
d'avoir une fin de projet à trop longue échéance. Un jalon peut être la production d'un
document, la tenue d'une réunion ou bien encore un livrable du projet. Les jalons sont
des tâches de durée nulle, représentées sur le diagramme par un symbole particulier, la
plupart du temps un losange ou un triangle à l'envers.
M. Bel Cadhi Page 35
Vous aimerez peut-être aussi
- Devoir de Synthèse Math N°1 - 2ème Economie (2009-2010) PDFDocument2 pagesDevoir de Synthèse Math N°1 - 2ème Economie (2009-2010) PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Economie Services (2010-2011) MR Gary Badredine PDFDocument2 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Economie Services (2010-2011) MR Gary Badredine PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Gestion (2018-2019) MR Chaabane Mounir 2 PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Gestion (2018-2019) MR Chaabane Mounir 2 PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir Corrigé de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2012-2013) MR BELLASSOUED MOHAMED PDFDocument4 pagesDevoir Corrigé de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2012-2013) MR BELLASSOUED MOHAMED PDFNoomen Alimi100% (1)
- Devoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFDocument2 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°1 - Math - 2ème Sciences (2011-2012) MR Meddeb Tarak PDFNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Cours MOQDocument72 pagesCours MOQNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Services (2018-2019) MR Hamdi Zantour PDFDocument1 pageDevoir de Contrôle N°2 - Math - 2ème Economie & Services (2018-2019) MR Hamdi Zantour PDFNoomen Alimi100% (2)
- TP AtelierDocument2 pagesTP AtelierNoomen Alimi100% (1)
- Importance Des NormesDocument56 pagesImportance Des NormesNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Chapitre II QSEDocument20 pagesChapitre II QSENoomen AlimiPas encore d'évaluation
- ISO v1Document45 pagesISO v1Noomen AlimiPas encore d'évaluation
- MP-Ch0 - FondamentauxDocument11 pagesMP-Ch0 - FondamentauxNoomen AlimiPas encore d'évaluation
- Pico PanfDocument2 pagesPico PanfDavid UrbainPas encore d'évaluation
- Etapes Creation LogoDocument7 pagesEtapes Creation LogoImane Aachab100% (1)
- Résumé Elec BacDocument29 pagesRésumé Elec BacFethi BenmassoudePas encore d'évaluation
- TIA - Chap03 - Réseaux Neuro-FlousDocument6 pagesTIA - Chap03 - Réseaux Neuro-FlousNassr eddine100% (1)
- Guide Elec LEGRAND 2Document43 pagesGuide Elec LEGRAND 2ludoPas encore d'évaluation
- 3 GestionrisquescriticiteDocument35 pages3 GestionrisquescriticiteHassan HoudoudPas encore d'évaluation
- Toute L Algebre de La Licence 4e Ed Cours Et Exercices Corriges 2100747401Document1 pageToute L Algebre de La Licence 4e Ed Cours Et Exercices Corriges 2100747401GamzPas encore d'évaluation
- Dell Precision T3500 Brochure 1 FR PDFDocument2 pagesDell Precision T3500 Brochure 1 FR PDFYoucef BensenouciPas encore d'évaluation
- Recapitulatif Des GarantiesDocument4 pagesRecapitulatif Des GarantiesWayzzOnTop ftnPas encore d'évaluation
- Partie 1 Cours ExcelDocument9 pagesPartie 1 Cours Exceldarni japhet MBADINGA MOMBOPas encore d'évaluation
- Cours Algo IN1-1Document15 pagesCours Algo IN1-1gladys cheuffaPas encore d'évaluation
- EPITA BrochureDocument96 pagesEPITA BrochurevenanceharoldPas encore d'évaluation
- Amplificateur Classe ADocument11 pagesAmplificateur Classe AHiba RosaPas encore d'évaluation
- Badri Yassine CVDocument1 pageBadri Yassine CVYassine BadriPas encore d'évaluation
- 1 BI IntroductionDocument17 pages1 BI IntroductionImene AssousPas encore d'évaluation
- Programmation GPU-IRIIADocument51 pagesProgrammation GPU-IRIIASweat SweatPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ESTS ANAS EL BASSBASIDocument35 pagesRapport de Stage ESTS ANAS EL BASSBASISalma BelbsirPas encore d'évaluation
- Fiche D'appreciation ESTGDocument1 pageFiche D'appreciation ESTGOthmane EL BAROUDIPas encore d'évaluation
- CV SalimDocument3 pagesCV SalimTaha SenniaPas encore d'évaluation
- Setup Sheets TutorialDocument47 pagesSetup Sheets TutorialLaith HashimPas encore d'évaluation
- Expose Sur OptimaintDocument6 pagesExpose Sur OptimaintBiba DieyePas encore d'évaluation
- Module 5Document16 pagesModule 5FerdianadPas encore d'évaluation
- Delphi Réseau-Présentation InterbaseDocument4 pagesDelphi Réseau-Présentation InterbaseMayaLabelle67% (6)
- Stratégies Industreilles Cours 2Document27 pagesStratégies Industreilles Cours 2carton SPSPas encore d'évaluation
- Mail RDV Pole Emploi 22 AoutDocument1 pageMail RDV Pole Emploi 22 AoutKouna LOPas encore d'évaluation
- HAMRICH Halima - CVDocument1 pageHAMRICH Halima - CVYoussef DecaPas encore d'évaluation
- Sciences Et Technologies de Lindustrie eDocument5 pagesSciences Et Technologies de Lindustrie eDan CheridanPas encore d'évaluation
- Cours OptoElectronique PDFDocument77 pagesCours OptoElectronique PDFselmaPas encore d'évaluation
- Disomat - Opus - Zing FIleDocument136 pagesDisomat - Opus - Zing FIleGopalPas encore d'évaluation
- CoursDocument19 pagesCoursfouad akroudPas encore d'évaluation