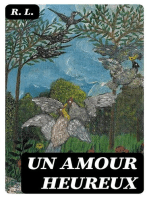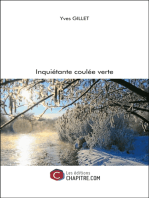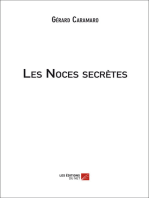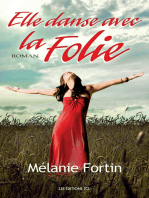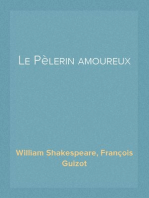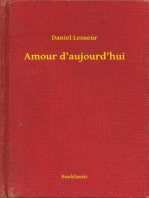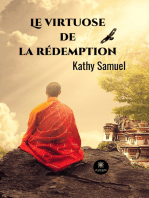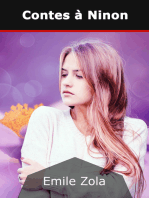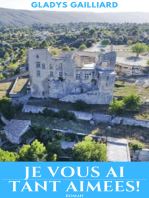Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Extrait Madame Bovary
Transféré par
SmiljaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Extrait Madame Bovary
Transféré par
SmiljaDroits d'auteur :
Formats disponibles
II, 9
D’abord, ce fut comme un étourdissement ; elle voyait les arbres, les chemins,
les fossés, Rodolphe, et elle sentait encore l’étreinte de ses bras, tandis que le
feuillage frémissait et que les joncs sifflaient.
Mais, en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage. Jamais elle
n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur. Quelque chose
de subtil épandu sur sa personne la transfigurait.
Elle se répétait : « J’ai un amant ! un amant ! » se délectant à cette idée comme à
celle d’une autre puberté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin
ces joies de l’amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle
entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire ;
une immensité bleuâtre l’entourait, les sommets du sentiment étincelaient sous
sa pensée, et l’existence ordinaire n’apparaissait qu’au loin, tout en bas, dans
l’ombre, entre les intervalles de ces hauteurs.
Alors elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus, et la légion lyrique
de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de
sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de
ces imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant
dans ce type d’amoureuse qu’elle avait tant envié. D’ailleurs, Emma éprouvait
une satisfaction de vengeance. N’avait-elle pas assez souffert ! Mais elle
triomphait maintenant, et l’amour, si longtemps contenu, jaillissait tout entier
avec des bouillonnements joyeux. Elle le savourait sans remords, sans
inquiétude, sans trouble.
Gustave Flaubert, Madame Bovary, 1857.
Vous aimerez peut-être aussi
- Vocabulaire Progressif Du Français, Niveau Perfectionnement: Avec 675 Exercices CorrigésDocument308 pagesVocabulaire Progressif Du Français, Niveau Perfectionnement: Avec 675 Exercices Corrigéskadido100% (5)
- Le Passe-Miroir T2 - Les Disparus Du Clairdelune PDFDocument303 pagesLe Passe-Miroir T2 - Les Disparus Du Clairdelune PDFRawan LoulouPas encore d'évaluation
- Chiss Jeanlouis David Jacques Didactique Du Francais Enjeux PDFDocument338 pagesChiss Jeanlouis David Jacques Didactique Du Francais Enjeux PDFSmiljaPas encore d'évaluation
- Du BellayDocument35 pagesDu BellaySmiljaPas encore d'évaluation
- FRA C1.0506G Using Logical Connectors PDFDocument25 pagesFRA C1.0506G Using Logical Connectors PDFSmiljaPas encore d'évaluation
- Le Corpus Des FemmeDocument10 pagesLe Corpus Des FemmeLea MariaPas encore d'évaluation
- La RencontreDocument21 pagesLa RencontreKarim Ben AbdallahPas encore d'évaluation
- Le Récit D'une HeureDocument4 pagesLe Récit D'une HeureThierry LessardPas encore d'évaluation
- MARYLIN DOLL-ClaraDocument17 pagesMARYLIN DOLL-ClaradomrozoPas encore d'évaluation
- Le Projet Final A2-LOUANEDocument6 pagesLe Projet Final A2-LOUANESANTIAGO ANDRES ALVAREZ GUTIERREZPas encore d'évaluation
- Les Confessions: Souvenirs d'un demi-siècle 1830-1880 - Tome IVD'EverandLes Confessions: Souvenirs d'un demi-siècle 1830-1880 - Tome IVPas encore d'évaluation
- Leçon L'eau Dans La Nouvelle Héloise de RousseauDocument6 pagesLeçon L'eau Dans La Nouvelle Héloise de RousseauYana PONOMAROVAPas encore d'évaluation
- Madame Bovary - Première Partie - 7 - WikisourceDocument7 pagesMadame Bovary - Première Partie - 7 - Wikisourcenawressmannai3Pas encore d'évaluation
- Textes Bac 2022 GrammaireDocument16 pagesTextes Bac 2022 GrammaireqqqqqqqqqqqqqqPas encore d'évaluation
- Coeur de Cristal French Edition Free PdfsDocument8 pagesCoeur de Cristal French Edition Free PdfsBoukambou mavyPas encore d'évaluation
- Balzac Le Lys Dans La ValleeDocument2 pagesBalzac Le Lys Dans La ValleeYoama RodriguezPas encore d'évaluation
- Banks, Iain M.-La Plage de Verre (1993) .OCR - French.ebook - AlexandrizDocument625 pagesBanks, Iain M.-La Plage de Verre (1993) .OCR - French.ebook - AlexandrizleroseauPas encore d'évaluation
- Dumas PaulineDocument303 pagesDumas Paulinefatisar944Pas encore d'évaluation
- Voltaire-L Education D Une FilleDocument7 pagesVoltaire-L Education D Une FilleelnonopololoPas encore d'évaluation
- ÉgalitéDocument1 pageÉgalitéSmiljaPas encore d'évaluation
- SKMBT 22321060211110Document1 pageSKMBT 22321060211110SmiljaPas encore d'évaluation
- Qu Est Ce Qu Un EssaiDocument5 pagesQu Est Ce Qu Un EssaiSilvia CorolencoPas encore d'évaluation
- Grille D'évaluation, SynthèseDocument2 pagesGrille D'évaluation, SynthèseSmiljaPas encore d'évaluation
- Le Cadre Europeen Evolutions Visibles deDocument422 pagesLe Cadre Europeen Evolutions Visibles deSmiljaPas encore d'évaluation
- 065 Glossaire Mots-Clés ÉvaluationDocument7 pages065 Glossaire Mots-Clés ÉvaluationSmilja100% (1)
- Spira 0994-3722 1990 Num 4 1 1930Document8 pagesSpira 0994-3722 1990 Num 4 1 1930SmiljaPas encore d'évaluation
- Cali GrammesDocument1 pageCali GrammesSmiljaPas encore d'évaluation
- Enjeux de SociétéDocument6 pagesEnjeux de SociétéSmiljaPas encore d'évaluation
- Biographie ApollinaireDocument2 pagesBiographie ApollinaireSmiljaPas encore d'évaluation
- Se Precc81senter en Arabe Phonecc81tiqueDocument1 pageSe Precc81senter en Arabe Phonecc81tiqueSmiljaPas encore d'évaluation
- Roumain 07 05 16Document2 pagesRoumain 07 05 16Seema KrPas encore d'évaluation
- Les SymbolesDocument11 pagesLes SymbolesSmiljaPas encore d'évaluation
- ToléranceDocument8 pagesToléranceSmiljaPas encore d'évaluation
- Cuq ValuationDocument22 pagesCuq ValuationsaidPas encore d'évaluation
- Atelier ComedienDocument10 pagesAtelier Comedienelga74Pas encore d'évaluation
- CoursdetheatreDocument19 pagesCoursdetheatreSmiljaPas encore d'évaluation
- 6.1 La Notion de CultureDocument2 pages6.1 La Notion de CultureSmiljaPas encore d'évaluation
- Structure de L Article de Presse 4e 3eDocument3 pagesStructure de L Article de Presse 4e 3eÐânĩĕl JøŚĕ CäŚŧrø ÂrïźăPas encore d'évaluation