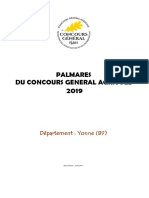Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
g2 Les Espaces Maritimes
g2 Les Espaces Maritimes
Transféré par
PFECopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
g2 Les Espaces Maritimes
g2 Les Espaces Maritimes
Transféré par
PFEDroits d'auteur :
Formats disponibles
E.
Prud’homme R Ferré - TL /ES Histoire-Géographie Lycée Emile Roux, CONFOLENS, 2019-2020
GEOGRAPHIE – Thème 2 – Chapitre 2 : Les espaces maritimes : approche géostratégique
Problématiques :
Pourquoi les espaces maritimes sont-ils devenus stratégiques dans un contexte de mondialisation ?
Plan du cours :
Introduction.
I . Les espaces maritimes, principal support de la mondialisation.
A. Une mise en relation du monde par les mers et océans.
1 . Une planète océane, 70% de la surface terrestre.
2 . 90% du transport de marchandises mondiales
3 . Une maritimisation favorisée par les progrès techniques. (conteneurisation, gigantisme des navires ...)
B. La littoralisation et le rôle des façades maritimes.
1 .La mondialisation renforce la littoralisation.
2 .Les principaux flux de marchandises concentrés au sein de quelques routes maritimes.
2 .L’émergence de façades maritimes, point nodales de la mondialisation.
3 .Les routes maritimes ponctuées de point stratégiques majeurs (cap, détroit, seuil...)
II . Mers et océans, un espace en cours d’appropriation.
A. Un espace, riche en ressources.
1 . Gaz, pétrole, minerais.
2 . Halieutique.
B. Source de tensions majeures.
1 .La question de la ZEE, objet de toutes les convoitises.
2 .La maîtrise des océans, un enjeu de puissance.
3. La piraterie et le terrorisme.
4. Un enjeu environnemental majeur.
Au baccalauréat :
À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition, un croquis ou une étude critique de document(s).
Sujets de composition envisageables : Les espaces maritimes: approche géostratégique
Idée de plan :
I° Un support majeur de la mondialisation.
II° Un espace riche en ressources.
III° Au cœur de tensions à toutes les échelles.
ou
I° L’importance des ressources maritimes.
II° L’importance des flux et façades maritimes.
III° Les tensions.
Sujet de croquis pouvant être demandé :
«les espaces maritimes : approche géostratégique».
A connaître :
Localisations :
- Connaissance de base en Géographie.
- Les principaux caps et détroits. (Panama, Suez, Gibraltar, Malacca, Ormuz).
Vocabulaire :
Cap :
Pointe de terre qui s’avance dans la mer.
Détroit :
Passage maritime entre deux terres.
Façade maritime :
zones littorales qui regroupent les ports jouant un rôle d’interface entre l’arrière-pays de cette façade (hinterland) et son avant-pays (foreland).
Halieutique :
Qui concerne la pêche.
Haute mer :
Regroupe l’ensemble des espaces maritimes situés au-delà de 200 milles des côtes. Représentant 65 % de la surface océanique mondiale, la navigation, la
pêche et l’extraction y sont totalement libres. Cette absence de souveraineté, qui signifie aussi une absence de règles contraignantes, accroît les risques de
pirateries ou de surpêche, dont les répercussions se font sentir sur tous les espaces marins.
Littoralisation :
Concentration des hommes et des activités le long des littoraux.
Offshore :
Désigne l’extraction de matières premières dans les sous-sols marins. L’exploitation du gaz et du pétrole offshore nécessite des technologies de pointe très
coûteuses et n’est donc rentable que, comme c’est actuellement le cas, lorsque les cours de ces matières premières sont particulièrement élevées.
Pétrolier :
Aussi appelé « tanker », il s’agit d’un chimiquier destiné au transport des produits pétroliers sous forme liquide. Les plus gros peuvent convoyer jusqu’à 320
000 tonnes par voyage.
Piraterie :
Détournement d’un navire par la force afin de s’approprier sa cargaison ou, le plus souvent, d’obtenir une rançon. Les régions les plus touchées par cette
pratique sont le détroit de Malacca et le golfe d’Aden.
Porte-conteneurs :
Navire conçu pour transporter des conteneurs entassés les uns sur les autres. Leur capacité est calculée en « équivalent vingt pieds » (EVP, ou TEU en
anglais), c’est-à-dire en fonction du nombre de conteneurs de 20 pieds (6 mètres) qu’ils peuvent transporter. Les plus gros porte-conteneurs, longs de près de
400 mètres, peuvent transporter jusqu’à 15 000 conteneurs par voyage.
Surpêche :
Pêche en quantités trop importantes qui ne permettent pas d’assurer le renouvellement des stocks halieutiques.
Zone économique exclusive :
Bande maritime s’étendant sur 200 miles au large du littoral d’un État dans laquelle celui-ci est le seul à pouvoir procéder à des activités économiques. En
revanche, la circulation des navires y est libre.
Zone grise :
Région qui échappe en partie ou totalement au contrôle des États, soit parce que ces derniers sont défaillants, soit parce que la région en question n'est placée
sous la souveraineté d'aucun d'entre eux. Elles constituent donc des zones propices aux activités illicites.
Zone industrialo-portuaire.
Espace littoral dominé par un grand port de commerce autour duquel se sont greffées, souvent pour profiter de dispositions fiscales avantageuses, des
industries. Celles-ci bénéficient également d’une situation qui leur permet de s’approvisionner rapidement en matières premières et d’exporter sans délai
leurs productions.
Parcours d’Education Artistique et Culturel :
Art du visuel :
Cinéma :
Waterworld de K Reynolds, 1995.
Les Seigneurs de la mer de R Stewart, 2008.
Océans de J. Perrin, 2010.
L’odyssée de Pi de A Lee, 2012.
Capitaine Philips de P.Greengrass, 2013.
En solitaire de C.Offenstein, 2013.
All si lost de J.C Chandor, 2013.
Pictural :
La naissance de Vénus de A Botticcelli, 1484-1485.
La Grande Vague de Kanagawa, 1829-1832.
Le radeau de la Méduse de T Géricault, 1818-1819.
Art du son :
La mer de C Trenet, 1946
Le port d’Amsterdam de J Brel, 1964.
Dès que le vent soufflera de Renaud, 1983.
Art du langage :
L’odyssée de Homère, VIIIe siècle av JC.
Oceano nox de V Hugo, 1840.
Moby Dick de H Melville, 1851.
Vingt Mille lieues sous les mers de J Verne, 1869-1870.
Le vieil homme et la mer de E Hemingway, 1952.
Vous aimerez peut-être aussi
- A Hypochondriac's Song PROOF5b-ADocument11 pagesA Hypochondriac's Song PROOF5b-AMycah WesthoffPas encore d'évaluation
- Dossier Technique Pour L Apprentissage Des KuatsuDocument10 pagesDossier Technique Pour L Apprentissage Des KuatsuDanieri Saris FerreiraPas encore d'évaluation
- Rdii 30611Document6 pagesRdii 30611PFEPas encore d'évaluation
- File 30865Document10 pagesFile 30865PFEPas encore d'évaluation
- File 67457Document22 pagesFile 67457PFEPas encore d'évaluation
- Rdii 30557Document14 pagesRdii 30557PFEPas encore d'évaluation
- Rdii 30457Document2 pagesRdii 30457PFEPas encore d'évaluation
- Exercices PrevisionsDocument3 pagesExercices PrevisionsPFEPas encore d'évaluation
- Politique Intelligente Pour La Chaîne Logistique MaritimeDocument7 pagesPolitique Intelligente Pour La Chaîne Logistique MaritimePFEPas encore d'évaluation
- INTRODUCTIONDocument4 pagesINTRODUCTIONPFEPas encore d'évaluation
- Les Espaces Maritimes, Enjeux Géoéconomiques Et GéopolitiquesDocument17 pagesLes Espaces Maritimes, Enjeux Géoéconomiques Et GéopolitiquesPFEPas encore d'évaluation
- Assurance FacultésDocument5 pagesAssurance FacultésPFEPas encore d'évaluation
- Assurance CoprsDocument3 pagesAssurance CoprsPFEPas encore d'évaluation
- Horaire Été 2018Document3 pagesHoraire Été 2018hihouPas encore d'évaluation
- 476550611Document300 pages476550611Tampolla SergePas encore d'évaluation
- ED 2 de Biologie Cellulaire FMMDocument5 pagesED 2 de Biologie Cellulaire FMMbmnkhalilPas encore d'évaluation
- Gestion Des Matière Récupérer Finissage-ConvertiDocument5 pagesGestion Des Matière Récupérer Finissage-ConvertiSa Lou100% (1)
- Description Du Processus de Fa - El IDRISSI JAZOULI Khadija - 2216Document30 pagesDescription Du Processus de Fa - El IDRISSI JAZOULI Khadija - 2216MENARA BETPas encore d'évaluation
- Fiches 3asc Parcours Période 6Document69 pagesFiches 3asc Parcours Période 6jamila1989ramocPas encore d'évaluation
- Minutes Executivecommitteemay2021 French PDFDocument43 pagesMinutes Executivecommitteemay2021 French PDFPhilippe GossouPas encore d'évaluation
- Poly SIDocument120 pagesPoly SIEssaid AjanaPas encore d'évaluation
- Ed826 PDFDocument60 pagesEd826 PDFjavi_de_garciaPas encore d'évaluation
- EBOOK Daniel Cohen - La Prosperite Du ViceDocument87 pagesEBOOK Daniel Cohen - La Prosperite Du Vicepauline.kamalaPas encore d'évaluation
- Fireworks - LDP - 1re Chapitre 11 - Is It A Brave New WorldDocument46 pagesFireworks - LDP - 1re Chapitre 11 - Is It A Brave New WorldplumagathaPas encore d'évaluation
- Guérir Par L'ÉnergieDocument21 pagesGuérir Par L'ÉnergieAchraf MouhjarPas encore d'évaluation
- Apprentissage À La PhotographieDocument26 pagesApprentissage À La PhotographieGilles-Axel EsmelPas encore d'évaluation
- Avis de Recrutement FBRDocument2 pagesAvis de Recrutement FBRBouba DiambaPas encore d'évaluation
- CleoCE2 AffichesDocument27 pagesCleoCE2 Afficheskitarof100% (1)
- Automation Studio P7 Brochure Francais HighDocument15 pagesAutomation Studio P7 Brochure Francais Highkado alexanderPas encore d'évaluation
- You TubeDocument3 pagesYou Tube80cc9667b5Pas encore d'évaluation
- Fiche Lecture Cuisines Cuisine Et ClassesDocument3 pagesFiche Lecture Cuisines Cuisine Et ClassesGerard BeuretPas encore d'évaluation
- TP Réseau 2 - 092603Document2 pagesTP Réseau 2 - 092603Mask'àGazPas encore d'évaluation
- CV Exemple CompetencesDocument2 pagesCV Exemple CompetencesAbouZakariaPas encore d'évaluation
- 2018 JCI Plan of Action - FRE PDFDocument4 pages2018 JCI Plan of Action - FRE PDFChristian Trésor KandoPas encore d'évaluation
- #Gabon: Rapport SC CPI Version Finale PDF. #AliBongoAPerduLeDroitDeNousGouverner FJDocument33 pages#Gabon: Rapport SC CPI Version Finale PDF. #AliBongoAPerduLeDroitDeNousGouverner FJFranck Jocktane100% (1)
- CDG CCDocument97 pagesCDG CCAli AmarPas encore d'évaluation
- DR COCHARD-Examen PupillesDocument71 pagesDR COCHARD-Examen Pupillesandreea.aignatoaiePas encore d'évaluation
- Salon de L'agriculture: Découvrez Les Vins de L'yonne Médaillés D'or Du Concours Général Agricole 2019Document10 pagesSalon de L'agriculture: Découvrez Les Vins de L'yonne Médaillés D'or Du Concours Général Agricole 2019Myriam LebretPas encore d'évaluation
- Dossier de Montage EcomurDocument15 pagesDossier de Montage EcomurEco-Logis-InnovationPas encore d'évaluation
- Fic 4Document92 pagesFic 4Faress RabiPas encore d'évaluation
- Thies Phares SVT 2nd Cycle RevuesDocument90 pagesThies Phares SVT 2nd Cycle RevuesMichel NDOURPas encore d'évaluation