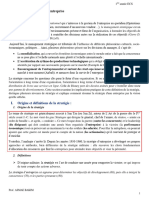Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Conduire Et Accompagner Les Changements
Conduire Et Accompagner Les Changements
Transféré par
Sekoun Jean Martial N'GATTATitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Conduire Et Accompagner Les Changements
Conduire Et Accompagner Les Changements
Transféré par
Sekoun Jean Martial N'GATTADroits d'auteur :
Formats disponibles
FICHE TECHNIQUE N° 33
CONDUIRE ET ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS
En bref
Cette fiche technique constitue un cadre de
réflexion sur la conduite et l’accompagnement
du changement. Dans une période d’évolutions
qui affectent en profondeur le ministère et
T oute organisation et, par conséquent,
tout manager sont amenés à antici-
per et à conduire le changement pour répondre
ses agents, elle s’adresse à tout agent d’enca- à des facteurs de changement.
drement ayant à piloter un projet de change- Au Ministère, ces principaux facteurs sont :
ment au niveau de son équipe, de son unité ou
de son service. Elle a pour objectif de facili- • Les décisions politiques et les évolutions
juridiques
ter ce pilotage. Sa valeur ajoutée réside moins
dans la livraison d’un outil que dans un trans- • Les évolutions technologiques
fert de connaissances permettant d’orienter • La demande sociale
les pratiques quotidiennes et les décisions
relatives aux changements à conduire.
Les décisions politiques et les Plus généralement
évolutions juridiques Les contraintes économiques, l’efficience des
Le pouvoir politique décide de faire évoluer les ressources, la modernisation, l’innovation, la ré-
missions attribuées à : solution de problèmes internes d’organisation
• Un Ministère : cas de la route pour le Ministère entraînent des changements.
de l’Equipement, Exemple : la réforme de la notation, la réforme
• Un service : délocalisation de certaines enti- de l’ingénierie publique, le passage de la suite
tés, suppression de certains services, … bureautique sous licence « Microsoft office » à
• Certaines catégories d’agents : cas des secré- la suite libre « Open office », …
taires, des dessinateurs, …
Dans la pratique, ces principaux facteurs de
De nouvelles « règles du jeu » en matière de fonc- changement sont interdépendants. Un change-
tionnement des organisations font apparaître,
ment technique, par exemple, induit souvent
évoluer ou disparaître certains emplois-types ou d’autres changements de type structurels et/ou
postes de travail. Dans le cadre de la LOLF par culturels pour l’organisation et nécessite toujours
exemple : des changements individuels. Dans la mise en
• apparaissent : des responsables de budget opé- œuvre des politiques publiques, tout responsa-
rationnels, ble se situe à l’interface de ces deux types de
• évoluent : les comptables, les contrôleurs de
changements qui renvoient à des processus dif-
gestion, les chargés de mission GPEC, … férents : le changement organisationnel et les
• disparaissent : certains postes de comptables changements individuels qui en découlent.
(économies d’échelles).
Les pilotes du changement auront ainsi les mis-
Les évolutions technologiques sions suivantes :
L’apparition ou la disparition de certains outils • conduire les changements nécessaires à
conduit à : l’adaptation de l’organisation aux évolutions du
• créer de nouveaux emplois-types (ex. : infor- contexte environnant,
maticiens il y a quelques années, webmestres • accompagner les changements individuels in-
plus récemment, …), duits,
• en faire disparaître certains (ex. : dessinateurs • assurer la continuité entre ces deux proces-
d’exécution). sus indissociables.
La demande sociale Dans cette perspective, le propos de cette fiche
Les besoins et attentes des usagers ont conduit est :
par exemple les administrations à renforcer leurs I. d’aborder, par des définitions, les éléments per-
compétences en matière de : mettant de caractériser la notion de changement,
• communication, II. de donner quelques points de repère sur les
• gestion des conflits (médiateurs, …), processus permettant de conduire et d’ac-
• sécurité, compagner les changements.
• protection de l’environnement, …
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 1
I - Comment caractériser le changement ?
Un changement est un processus de passage d’un état A vers un état B.
Ce processus s’opère en réponse à des modifications de l’environnement, à la fois sur les
organisations et sur les individus qui les composent.
Exemples : individuels à un nouveau contexte. Cette modifi-
- Le passage de l’ingénierie publique (IP) à l’ingé- cation de comportement est précisément l’ap-
nierie d’appui territorial (IAT) résulte d’un choix prentissage d’un nouveau comportement. Ce pro-
stratégique de l’organisation. Ce changement, cessus individuel nécessite une attention parti-
qui conduit notamment à un déplacement des ac- culière de la part de l’encadrement : c’est l’ac-
tivités de maîtrise d’œuvre vers l’assistance à maî- compagnement du changement qui permet,
trise d’ouvrage (AMO) induit des changements in- par agrégation des changements individuels, l’évo-
dividuels et nécessite la mise en place d’un plan
lution de l’organisation.
de professionnalisation des agents concernés.
- En bureautique, le passage de Microsoft office à Face à un même changement organisationnel
Open Office est un changement organisationnel (changement de mission, de logiciel, de lieu de
qui induit des changements individuels. La migra- travail, de chef de service, …), les individus
tion technique totale (remplacement sur tous les s’adapteront plus ou moins facilement. Pour
postes informatiques) ne suffit pas à la réussite du certains, il s’agira d’un apprentissage routinier.
changement. Le changement organisationnel ne Pour d’autres, il pourra s’agir d’un apprentissage
sera réalisé que lorsque les individus concernés plus difficile nécessitant un investissement per-
auront appris, à leur rythme, à maîtriser ce sonnel en temps et en travail important. Pour
nouvel outil. d’autres enfin, il pourra s’agir d’une remise en
On distingue donc deux types de processus cause identitaire difficile à accepter.
interdépendants : le changement organisation-
nel et le changement individuel. Les différents niveaux du
changement
Le changement organisationnel
Il est le processus par lequel une organisation On distingue deux types de changements : les
(le Ministère, une DDE, un service… ) s’adapte, changements de niveau 1 qui interviennent à
en continu ou par rupture, sous la contrainte ou l’intérieur d’un système et les changements de
par anticipation, aux évolutions de son envi- niveau 2 qui affectent le système lui-même.
ronnement. La conduite du changement dé- Cette approche « systémique » vaut à la fois pour
signe le pilotage du changement organisation- les changements organisationnels et pour les
nel : c’est l’ensemble de la démarche qui va de changements individuels (1)1.
la perception d’un problème d’organisation à la • Le changement de niveau 1 est une modifi-
définition d’un cadre d’actions qui permet l’éla- cation de certains facteurs à l’intérieur d’un sys-
boration, le choix et la mise en œuvre d’une tème qui demeure relativement stable. Lorsque
solution dans des conditions optimales de réus- les conditions du changement sont défavorables,
site. La conduite du changement fait appel aux le changement de niveau 1 peut générer des phé-
outils du pilotage par projet. nomènes d’autorégulation destinés à assurer la
permanence du système et sa continuité dans
Le changement individuel un environnement fluctuant.
Il est de nature radicalement différente : il s’agit • Le changement de niveau 2 est une modifi-
d’un processus psychologique d’apprentissage. cation qui affecte le système lui-même et l’amène
Le changement individuel peut être appréhendé à se modifier.
comme une adaptation des comportements
Niveau du Impact sur/dans
Exemples
changement le système
Mineur La réforme de la notation des agents est un changement de niveau 1 dans le
système « règles de gestion des corps ».
I Le passage de l’ingénierie publique (IP) à l’ingénierie d’appui territorial (IAT)
Majeur peut être considéré comme un changement de niveau 1. A l’intérieur du
« système ingénierie » du ministère, l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)
se développe au détriment de la maîtrise d’œuvre.
En bureautique, le passage de Microsoft Office à Open Office. Il ne s’agit
Mineur pas ici d’adopter une version améliorée, mais de changer de logiciel, de
référentiel, de système.
II Le transfert aux Départements des routes nationales d’intérêt local s’accom-
pagne de la réorganisation des services routiers de l’Etat, avec la création
Majeur de 21 services régionaux de maîtrise d’ouvrage (SMO) et de 11 directions
interrégionales des routes (DIR).
1. Les nombres entre parenthèses renvoient à la bibliographie
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 2
La perception du changement par un changement organisationnel seront
complexes, plus les résistances au changement
Pour les individus, seul le changement « perçu »
seront longues et difficiles à gérer pour le pilote
compte.
du changement.
Un changement organisationnel de niveau 1
pourra être perçu comme étant un changement
Les étapes de la réponse
individuel de niveau 2 s’il nécessite un appren- individuelle au changement
tissage complexe. L’inverse vaut également pour organisationnel
un changement de niveau 2 ayant un impact or- Appliquée au changement, la théorie du cycle
ganisationnel majeur : les agents peu touchés de réponse au deuil de Kubler-Ross décrit,
par ce changement percevront un changement malgré les différences individuelles, cinq étapes
de niveau 1 n’affectant qu’à la marge leur sys- successives caractérisées par une réponse émo-
tème de référence. tionnelle au changement. Ce cycle vaut surtout
Exemple : la réforme de l’ingénierie publique et le s’il s’agit d’un changement imposé et subi. Ces
déplacement de la maîtrise d’œuvre vers l’ assis- étapes sont, à partir de l’annonce du change-
tance à maîtrise d’ouvrage peuvent être considérés ment :
comme des changements de niveau 1 du point de • Le déni, le refus de comprendre : « ça n’est
vue de l’organisation. En revanche, pour un agent pas possible, pourquoi moi ? Cela ne peut pas
dont la maîtrise d’œuvre est le cœur de métier, il
m’arriver… ». L’individu ne comprend pas ce qui
s’agit d’un changement de niveau 2 qui affecte son
système de référence (ses valeurs, son expérience,
(lui) arrive ;
ses savoir-faire, ses habitudes, …) et qui peut • La colère, la révolte : « jamais je n’accepte-
induire une remise en cause identitaire difficile à rai… ». L’individu « accuse » les responsables
accepter. apparents du changement ;
• Le marchandage : « si c’est comme ça, alors
De même, le niveau du changement et le sys-
en échange il faudra que… ». L’individu essaie
tème concerné sont dépendants de la place de
de négocier, de diminuer les pertes attendues
l’observateur et des choix qu’il peut faire.
ou supposées ;
Exemple : la réforme de la notation des agents est • La dépression, la résignation : « de toute
un changement organisationnel de niveau 1 dans façon, il n’y a rien à faire…». L’individu « appré-
le système « règles de gestion des corps ». Au ni- cie » la réalité de la perte ;
veau des notateurs, il peut cependant être perçu • L’acceptation, l’intégration du change-
comme étant un changement organisationnel de
ment, l’établissement d’un compromis :
niveau 2 dans le système « notation des agents ».
Cette perception, légitime en soi, n’est pas perti- « après tout, c’est peut-être un mal pour un
nente du point de vue de l’organisation et du pilo- bien… ». L’individu accepte la situation et ses
tage de cette réforme. multiples implications.
Il en résulte au moins deux conséquences pour Ces étapes sont celles de la mise en place de
l’organisation : l’apprentissage qui préside au changement indi-
• D’une part, une négociation entre acteurs doit viduel. Cette « résistance au changement »
permettre d’ajuster les différentes représentations « n’est ni plus ni moins rationnelle, ni plus ni
afin de trouver un consensus sur le changement moins légitime que l’action qui la provoque » (2).
à conduire, Ainsi, c’est autant le type ou le niveau de chan-
• D’autre part, le pilotage stratégique du change- gement concerné que la gestion de ce change-
ment doit être conduit au niveau du système ment par les responsables qui en ont la charge,
concerné, et non pas au niveau de l’un de ses qui détermineront la durée de ce cycle in-
sous-systèmes. compressible et son amplitude.
Le niveau (dans ou sur le système) du change-
Les « résistances au(x) change- ment organisationnel concerné, croisé avec le
ment(s) » niveau des apprentissages individuels, détermine
En physique, la résistance est une qualité par à chaque fois des situations particulières. De
laquelle un corps résiste à l’action d’un autre. plus, ces situations sont sous la responsabilité
Dans le sens commun, une résistance est une de cadres qui ont eux-mêmes des styles de
force qui s’oppose au mouvement. management (participatif, délégatif, directif, …)
différents. Ainsi, en matière de conduite et d’ac-
La résistance qu’une action de changement peut compagnement du changement, il n’y a que du
rencontrer ne doit pas être comprise comme une « sur-mesure ».
simple inertie mise en travers d’une évolution,
mais comme une phase de maturation néces- Moyennant cet avertissement, il est cependant
saire dont on ne peut faire l’économie. Les indi- possible de donner quelques éléments sur les
vidus ont besoin de comprendre les changements étapes du processus à conduire pour gérer au
qui les concernent avant d’agir en conséquence. mieux les changements dans l’intérêt conjoint
Plus les apprentissages individuels nécessités des services et des agents.
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 3
II - Quel processus pour conduire et accompagner
les changements ?
Les invariants communs à toutes les démarches
Avant de proposer les principales étapes d’un • d’expliciter les contraintes et les freins,
processus, il est possible de souligner les inva- • de mettre en évidence les gains potentiels indi-
riants requis pour conduire le changement, viduels,
depuis le diagnostic de la situation jusqu’à l’ac- • de dédramatiser le changement en objectivant
compagnement du changement. Ces invariants les « pertes » supposées ou réelles,
sont le portage politique, la communication • de générer un foisonnement d’idées qui enri-
et la participation. chit le processus et l’accélère,
• et enfin d’adapter la démarche aux différents
Le portage politique acteurs et à leur position.
La stratégie de changement doit être « portée
politiquement ». La direction doit incarner la né- Tout au long du processus, les pilotes peuvent
cessité de changer et le sens du changement être pris entre deux exigences parfois contradic-
voulu. toires :
• être suffisamment explicites pour que les diffé-
« L’expérience montre que souvent, après avoir rents groupes d’acteurs puissent y adhérer,
lancé une initiative de changement, le manage- • être suffisamment ouverts pour ne pas contrain-
ment s’en désintéresse, pour se consacrer à dre a priori le changement.
d’autres dossiers. Il fait comme si, après avoir
pris les grandes décisions et accepter le plan Il conviendra donc de trouver un juste milieu en-
de travail, il suffisait de déléguer la suite aux ni- tre la communication qui donne le cap et la par-
veaux inférieurs de l’organisation pour que la ticipation qui co-élabore le processus permet-
magie se produise » (3). tant de l’atteindre.
Si la délégation convient au fonctionnement cou- La négociation et la participation
rant de l’organisation, elle n’est pas appropriée Le portage politique et la communication ne suf-
pour la gestion du changement. En effet, l’enca- fisent pas à garantir la qualité du pilotage du
drement intermédiaire risque de se désengager changement. La négociation entre acteurs doit
à son tour, car il interprète cette façon d’agir permettre de trouver un consensus sur le chan-
comme un changement de priorité de la direc- gement à conduire. Lorsque le but à atteindre
tion. Ce comportement, que l’on peut qualifier n’est pas négociable, les moyens pour y parve-
de « résistant au changement » est dû à la diffi- nir le sont. Au cours de ce processus, il s’agit
culté, pour les agents concernés, d’entrer d’engager les individus concrètement, par la par-
« seuls » dans le processus d’apprentissage du ticipation, dans l’expérience du changement.
changement individuel qui permet l’abandon des Le diagnostic de la situation, qui doit surtout ve-
pratiques en vigueur au profit des nouvelles pra- nir des acteurs mêmes du système, est un préa-
tiques. « La probabilité de réussite sera propor- lable indispensable et une condition nécessaire
tionnelle aux efforts d’accompagnement fournis à la conduite du changement. C’est à cette
par le management » (3). condition que le diagnostic devient « l’affirmation
La continuité du pilotage stratégique est primor- d’un écart entre un existant et un état jugé plus
diale. C’est à ce niveau que des commandes souhaitable vers lequel il faudrait se diriger » et
sont passées à une (des) équipe(s) projet permet « une prise d’initiative et de responsabi-
animée(s) par un (des) chef(s) de projet qui lité pour enclencher les actions permettant de le
assure(nt) la conduite opérationnelle du chan- réaliser » (2).
gement. La participation (séminaires, réunions d’informa-
La communication tion, groupes de travail, …) de tous les agents
Une opération de changement repose sur des concernés est indispensable à la concrétisation
efforts importants de dialogue et de communi- du changement, car elle aide à lever les résis-
cation à tous les niveaux de l’organisation et tout tances et assure la pérennité du changement
au long du processus de changement. Il s’agit : grâce à l’implication directe des agents.
• d’engager la discussion sur le changement et
les ruptures,
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 4
Les trois phases d’un processus de changement
La démarche proposée n’est pas un outil livré 1. L’éveil : un processus en deux
« clé en main » : les pilotes du changement doi- étapes pour préparer le change-
vent s’adapter en fonction des caractéristiques ment
de l’organisation, des acteurs et du changement
concernés : chaque changement est unique L’éveil est le processus de prise de conscience
et appelle en réponse une démarche contex- de l’écart entre la situation prévue et la situation
tualisée. actuelle. L’objectif est à ce stade de préparer le
changement pour en faire émerger les possibili-
Qu’il s’agisse d’un individu, d’un groupe ou d’une tés et les conditions. Pour un changement im-
organisation, le changement peut être appré- posé ou subi, le processus de deuil se déroule
hendé comme un processus composé de trois essentiellement pendant cette phase.
phases successives : l’éveil, la transition et
la ritualisation (3). Evaluer les conditions du changement
Beaucoup de démarches de changement sont Pour conduire le changement, il est nécessaire
difficiles parce qu’elles se réduisent à la phase de vérifier si les conditions du changement sont
de transition : ni l’éveil ni la ritualisation ne sont réunies afin de pouvoir mettre en place le dispo-
organisés. Les processus d’apprentissage ne sitif d’accompagnement le plus adapté. La grille
s’enclenchent pas, les évolutions formelles de suivante (3) présente une trame de réflexion pos-
l’organisation restent sans effet au niveau des sible pour le comité de direction. Elle permet :
comportements. Pourquoi apprendre à se • D’avoir une idée de la façon dont le change-
comporter de manière différente quand on ment est perçu par les agents concernés,
n’a pas perçu la nécessité ou l’intérêt de chan- • D’estimer les ressources disponibles pour
ger ? (4). conduire ce changement,
• D’évaluer le contexte dans lequel ce change-
Exemple : Dans le cadre de la réorganisation ment intervient.
des services routiers de l’Etat, le processus qui
aboutit à l’adoption d’un nouvel organigramme Ces informations, permettront d’orienter le plan
dans une DDE est une évolution formelle qui ne d’action.
préjuge pas de la réalité des changements dans Le barème « +2, +1, -1, -2 » est donné à titre
l’organisation. Il y aura changement durable par indicatif. La pondération de chacun des points
acquisition de nouveaux comportements des peut-être différente en fonction du contexte.
acteurs si ce processus a été préparé en amont
et accompagné en aval. Dans le cadre de la dé-
centralisation et du transfert de personnel, les
phases amont et aval (et pas seulement la tran-
sition) sont à organiser pour ceux qui restent et
pour ceux qui partent.
D’accord Plutôt Plutôt en En désac-
(+ 2) d’accord désaccord cord
(+ 1) (- 1) (- 2)
1 - Les agents perçoivent que le changement proposé leur
est utile
2 - Les agents perçoivent que la situation visée est
importante pour l’avenir de l’organisation
3 - L’organisation a les ressources humaines et les
compétences pour mener à bien le projet
4 - Au niveau des relations de travail, le contexte est
propice
5 - La direction affiche clairement son intérêt pour le projet
6 - Il n’y a pas d’autres changements majeurs prévus
durant la mise en œuvre du projet
Total a b c d
Total général a+b+c+d :
+9 à +12 : Conditions favorables, ressources disponibles
La stratégie à adopter pour
+1 à +8 : Conditions plutôt favorables
conduire le changement sera
0 à -8 : Conditions plutôt défavorables
fonction du résultat obtenu
-9 à -12 : Conditions défavorables, ressources rares
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 5
Arrêter une stratégie de changement
La deuxième étape consiste à choisir la stratégie la plus adaptée au contexte.
Les deux principaux déterminants de la stratégie sont :
• Les conditions plus ou moins favorables de ce changement (cf. tableau ci-dessus),
• Le niveau I ou II du changement à conduire.
Six types de stratégies peuvent être identifiés (3) :
Evaluation des conditions du changement
Conditions plutôt Conditions plutôt Conditions
favorables défavorables défavorables
Pour un
changement de Conditions Les ressources Les ressources Les ressources
Niveau I favorables disponibles sont disponibles sont insuffisantes
encore en adéqua- commencent et les contraintes
tion avec les objec- à manquer sont fortes
tifs à atteindre
1- Stratégie de 2- Stratégie de 3- Stratégie 4- Stratégie
vigilance développement d’adaptation transitoire de
Un changement de Elle consiste à Cette stratégie est Cette stratégie, recadrage (4)
niveau I appelle procéder à des volontariste et plus défensive que Le recadrage
des stratégies ajustements en prévoit des actions volontariste, permet de sortir
fondées sur la réponse à des spécifiques ciblées consiste essentiel- d’une situation de
continuité qui visent signaux internes en réponse aux lement à optimiser blocage en
à améliorer ou ou externes. Elle points faibles de l’utilisation des changeant de
optimiser les suppose la mise l’organisation vis à ressources par la système de
ressources en place d’un vis du changement révision des référence pour
existantes, à faire dispositif de veille à conduire. pratiques, des basculer dans un
plus, mieux ou permettant de processus de changement de
moins ce que détecter les évène- production, de niveau II et adopter
l’organisation fait ments internes et l’organisation du une stratégie de
déjà. externes suscepti- travail… ré-invention.
bles d’affecter
l’organisation.
Plus les conditions du changement sont défavorables, plus les résistances au changement seront
fortes et plus le nouvel équilibre recherché sera difficile à obtenir, car les apprentissages individuels des
nouveaux comportements seront partiels et réversibles.
Evaluation des conditions du changement
Pour un
changement de
Niveau II Conditions Conditions plutôt Conditions plutôt Conditions
favorables favorables défavorables défavorables
Un changement de 5- Stratégies de ré-invention plus ou 6- Stratégies de crise plus ou moins
niveau II appelle moins marquées en fonction des radicales qui visent surtout à « limiter les
des stratégies ressources disponibles. Elle vise non dégâts » lorsque les quatre composan-
fondées sur la pas à faire mieux, mais à faire autre tes de l’organisation sont touchées et
discontinuité qui se chose, autrement. que tout « recadrage » s’avère impossi-
traduisent par un ble. Elles doivent s’accommoder des
changement de fortes « résistances au changement »
logique dominante qui accompagneront les « pertes »
dans l’une au importantes vécues par les agents
moins des quatre concernés et tenir compte d’un long
composantes de cycle Kubler-Ross de réponse au deuil.
l’organisation :
objectifs, structures,
techniques et
culture.
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 6
Le recours à une stratégie inadéquate peut re- - En bureautique, le plan d’action du passage de
tarder ou mettre en échec le projet. Il convient Microsoft office à Open Office doit éviter toute
donc de ne pas se tromper sur l’appréciation des « technicisation du processus d’intervention ».
conditions du changement et de bien définir le Il ne s’agit pas seulement d’un problème infor-
système qui doit changer et le niveau I ou II de matique qui appelle en réponse une solution in-
ce changement. Seuls un diagnostic co-élaboré formatique gérée par des « experts » techniques.
avec les agents concernés et un choix partagé Il s’agit d’un changement qui concerne tous les
permettent de limiter cet écueil. acteurs du système. Il nécessite un plan d’ac-
Ce choix n’est pas neutre quant à la stratégie de tion global, incluant notamment la profession-
gestion du changement à adopter : le change- nalisation des utilisateurs, la coordination avec
ment de niveau 1 pourra plus facilement être géré les partenaires extérieurs…
dans la continuité, tandis que le changement de
niveau 2 sera plus souvent associé à des ruptu- 2. La transition, ou la mise en
res. Lorsque cela est possible, il est préférable
œuvre du plan d’action global
de privilégier la continuité à la rupture, afin de
respecter le rythme de développement des pro- Lorsque la stratégie a été choisie et qu’un plan
cessus individuels d’apprentissage. d’action a été défini, il faut mettre en œuvre
concrètement les actions prévues et assurer le
Exemples :
passage effectif de la situation actuelle à la si-
- Pour le transfert aux Départements des routes tuation visée.
nationales d’intérêt local et la réorganisation des
La transition est le processus par lequel on
services routiers de l’Etat : il s’agit d’un change-
passe de l’état ancien à l’état nouveau. C’est
ment de niveau 2 qui ne peut se faire sans rup-
une phase durant laquelle on expérimente une
ture (la suppression d’une subdivision par exem-
nouvelle manière de faire les choses, où on tente
ple). Le droit d’option de deux ans des agents
d’abandonner les anciennes pratiques pour en
travaillant sur les routes nationales transférées
acquérir de nouvelles. Elle se traduit par la mise
est une mesure d’accompagnement du change-
en œuvre opérationnelle du plan d’action.
ment permettant d’atténuer cette rupture. Tout
recadrage est ici impossible : le système sur Deux catégories d’outils peuvent être utilisées.
lequel s’opère le changement étant le ministère Ils sont empruntés à la conduite de projet (5) :
lui-même, il ne peut être question de l’élargir. • les outils de pilotage (ex : note de cadrage,
organigramme du projet, plan de communication,
- Le passage de l’ingénierie publique (IP) à l’in-
tableau de bord du projet, plan d’actions, fiche
génierie d’appui territorial (IAT) est un change-
de relevé de décision),
ment de niveau 1 qui peut être conduit grâce à
• les outils techniques (ex : fiche de définition de
une stratégie fondée sur la continuité. La
fonction, tableau des charges et des ressour-
professionnalisation des agents est l‘une des me-
ces, tableau de suivi des activités, ...).
sures permettant de mieux accompagner ceux
qui sont au cœur de ce changement et qui le La démarche proposée n’est pas une suite li-
vivent comme une rupture. néaire d’étapes chronologiques et se distingue
ici des trois étapes « cadrer , conduire et
Par ailleurs, le plan d’action qui résulte de la stra-
conclure » de la conduite de projet. Elle est compo-
tégie arrêtée doit être global. Il ne doit pas seg-
sée de cycles successifs dans lesquels l’éva-
menter l’organisation « selon les techniques et
luation des actions menées constitue le diagnos-
les sous-objectifs ». Il ne doit pas non plus faire
tic de la nouvelle situation, jusqu’à ce que le ni-
l’objet d’une « technicisation » (2).
veau de consolidation des nouveaux comporte-
Exemples : ments (la ritualisation) requis par le changement
- La réforme de la notation des agents est en soit jugé satisfaisant par le pilote du changement.
réalité un « sous-objectif ». L’objectif est Ces cycles successifs sont mis en œuvre par
l’évolution des règles de gestion des corps. C’est une équipe projet animée par un chef de projet. Il
à ce niveau stratégique, avec l’ensemble des ac- conduira l’action qui lui est confiée selon le pro-
teurs concernés pour chacun des corps, qu’elle cessus ci-après (5) :
doit être pilotée. La réforme de la notation
ne peut à elle seule « faire bouger » le sys-
tème plus global dans lequel cette pratique
s’inscrit.
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 7
Cadrer l’action Evaluer l’action
• Initialiser l’action : analyser la demande initiale, L’évaluation de l’action permet de :
formuler les objectifs du projet et les résultats à • mesurer le niveau de consolidation des nou-
atteindre, faire valider par le comité de pilotage ; veaux comportements requis par le changement,
• Lancer l’action : organiser le dispositif néces- • préparer le cadrage d’une nouvelle action.
saire en fonction des objectifs définis ;
• Constituer l’équipe de projet ; 3. La ritualisation par l’accompa-
• Définir la démarche ; gnement du changement
• Elaborer le planning de l’action ;
C’est la phase de consolidation des nouveaux
• Evaluer son coût ;
comportements requis par le changement. Elle
• Organiser le dispositif de pilotage opérationnel.
consiste à pérenniser les nouvelles pratiques,
Conduire l’action sans quoi les anciennes habitudes se rétablissent.
Le chef de projet : Lors de la ritualisation, « les nouvelles pratiques
• Organise les séances de travail, se stabilisent, les doléances s’apaisent, les in-
• Suit l’état d’avancement des travaux et le plan- dividus développent graduellement des automa-
ning de réalisation, tismes (…) Le changement est adopté à des
• Assure le retour d’information vers le pilotage degrés divers, selon les personnes, mais on a
stratégique, atteint un seuil de non-retour » (3).
• Anime le dispositif de communication.
Conclusion
Conduire les changements organisationnels et accompagner les changements individuels induits
ne relèvent pas d’une procédure normalisée. C’est une construction humaine aléatoire et parfois
chaotique.
« Il n’y a pas pour le changement de recette universelle ou de solution miracle qui ne serait
plus “« qu’à appliquer ”» et qui pourrait toujours garantir le succès (…) L’action de changement est
une action politique, au sens plein du terme, qui ne relève pas d’une logique d’optimisation ni même
de maximisation ».
« Une stratégie de changement doit donc inventer et articuler un ensemble d’actions « “ sur me-
sure ”» qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques des jeux et du système d’acteurs dont
il s’agit de transformer la structuration » (2).
Philibert de Divonne - CEDIP
Bibliographie
1 - P. Watzlawick, J. Weakland, R. Fisch, Changements, paradoxes et psychothérapie, Seuil, 1981.
2 - E. Friedberg, Le pouvoir et la règle, Seuil, 1993.
3 - P. Collerette, R. Schneider, P. Legris, ISO Management systems, La gestion du changement
organisationnel, octobre 2001, mars-avril 2002, septembre-octobre 2002, janvier-février 2003, mai-juin 2003
et novembre-décembre 2003.
4 - Eric Delavallée, Les méthodes de gestion du changement organisationnel, Encyclopédie des ressources
humaines, Vuibert, 2003.
5 - Le pilotage par projet au Ministère de l’équipement, Analyse et repères, Le délégué à la modernisation
et à la déconcentration, mai 1999.
• B. Grouard, f. Meston, L’entreprise en mouvement, conduire et réussir le changement, Dunod,1998.
• INSEP Consulting, conduite du changement, mars-avril-mai 1999.
• D. Autissier, J.M. Moutot, Pratiques de la conduite du changement, Dunod, 2003.
• Jean Baechler, Dictionnaire de sociologie, Larousse, 1989.
• MARC Edmond, PICARD Dominique L’école de Palo Alto, Retz, 1984.
• Le stress au travail, Service public fédéral Emploi, Travail et concertation Social du gouvernement
belge, mai 2004.
• Les organisations face au changement, Revue française de gestion, N°120, 1998.
• Ministère de l’équipement, séminaire communication et changement, 2004
• Philippe BERNOUX, Sociologie du changement, Seuil, 2004.
La Lettre du CEDIP - En lignes n° 33 - octobre 2005 - page 8
Vous aimerez peut-être aussi
- TEST n7 QCM CC1Document45 pagesTEST n7 QCM CC1claracpz13Pas encore d'évaluation
- Methode PERTDocument15 pagesMethode PERTbricePas encore d'évaluation
- These M. RIANTSOA Donatien René - Version Officielle - Janvier 2021Document286 pagesThese M. RIANTSOA Donatien René - Version Officielle - Janvier 2021genyjean98Pas encore d'évaluation
- Equations Inequations CorrectionDocument7 pagesEquations Inequations CorrectionSeydou TraoréPas encore d'évaluation
- Integral de CheminDocument112 pagesIntegral de CheminLouani NadjibPas encore d'évaluation
- FR Parador Catalogue Vinyle 05-2021 1746008Document36 pagesFR Parador Catalogue Vinyle 05-2021 1746008manu PintoPas encore d'évaluation
- Article Bernard Savoy PDFDocument2 pagesArticle Bernard Savoy PDFStauffacher LauriePas encore d'évaluation
- Algebre Lineaire Premiere PartieDocument4 pagesAlgebre Lineaire Premiere PartieAs MaaPas encore d'évaluation
- LOhayonSVT - Th1-Chap 1 Atmosphère Terrestre Et LDocument1 pageLOhayonSVT - Th1-Chap 1 Atmosphère Terrestre Et LNouna LovePas encore d'évaluation
- Patrice Lumumba - Le Congo - Terre D'avenir, Est-Il Menacã© - S.A. Ã - DITEURS (1961)Document221 pagesPatrice Lumumba - Le Congo - Terre D'avenir, Est-Il Menacã© - S.A. Ã - DITEURS (1961)katek123Pas encore d'évaluation
- Transposition DidactiqueDocument53 pagesTransposition DidactiqueOumayma El YamaniPas encore d'évaluation
- TD TH8Document4 pagesTD TH8bergerPas encore d'évaluation
- Maths FR 1college 1Document3 pagesMaths FR 1college 1Anonymous kAVA6ALXNPas encore d'évaluation
- Notion DEseDocument12 pagesNotion DEseIkram beautyPas encore d'évaluation
- Chapitre IDocument11 pagesChapitre IBeichaPas encore d'évaluation
- APP Analyse Des Pratiques ProfessionnellesDocument51 pagesAPP Analyse Des Pratiques ProfessionnellesSid ahmed Zerrouki sbaPas encore d'évaluation
- Partie 3-Data Mining - DRC - 2021-2022Document47 pagesPartie 3-Data Mining - DRC - 2021-2022ahlem meftahPas encore d'évaluation
- Test Baron Ice - 60 ArticlesDocument9 pagesTest Baron Ice - 60 ArticlesScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Logique PropositionsDocument13 pagesLogique PropositionsAmine ZeggadaPas encore d'évaluation
- Support de Cours StratégieDocument18 pagesSupport de Cours Stratégieayoubelgachi12Pas encore d'évaluation
- Jurys - CE1D - 2022-2023-2 - Géographie - Consignes (Ressource 17680)Document3 pagesJurys - CE1D - 2022-2023-2 - Géographie - Consignes (Ressource 17680)salcer1975Pas encore d'évaluation
- CHM-1903 87234Document10 pagesCHM-1903 87234OURADI LPas encore d'évaluation
- Abaques j2Document6 pagesAbaques j2Anais DelabiePas encore d'évaluation
- Bac C 1990 Maths RCIDocument1 pageBac C 1990 Maths RCIJe suis LàPas encore d'évaluation
- DM1 SolDocument7 pagesDM1 Solmehdi benmassoudPas encore d'évaluation
- Support Stratégie D'entrepriseDocument36 pagesSupport Stratégie D'entrepriseyoulyane97Pas encore d'évaluation
- Lettre 0019 Observations Études Du Tronçon Test Et Fiches Techniques Soumises Par ELECTRO-PLOMB - SAFARELEC - SignéDocument3 pagesLettre 0019 Observations Études Du Tronçon Test Et Fiches Techniques Soumises Par ELECTRO-PLOMB - SAFARELEC - SignénnangamerveilPas encore d'évaluation
- Exercices Preparation Licence Ii SeaDocument6 pagesExercices Preparation Licence Ii Seameleiruth01Pas encore d'évaluation
- 1-StatistiqueDescriptive 04052023Document24 pages1-StatistiqueDescriptive 04052023Akadiri AdjibadéPas encore d'évaluation
- Magie MalifauxDocument11 pagesMagie MalifauxDamien MoermanPas encore d'évaluation