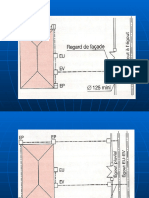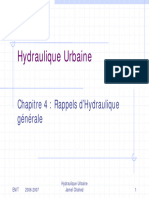Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
NM 10.09.205 (2008)
NM 10.09.205 (2008)
Transféré par
Mohamed HOUGGAALI0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
41 vues34 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
41 vues34 pagesNM 10.09.205 (2008)
NM 10.09.205 (2008)
Transféré par
Mohamed HOUGGAALIDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 34
NM 10.9.205
Norme Marocaine 2008
Produits de marquage routier
Produits de saupoudrage
Microbilles de verre, granulats antidérapants et mélange de ces
deux composants
Norme Marocaine homologuée
Par arrété conjoint du Mi
re de Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies et du
inistre de ’Equipement et des Transports
N° 874-08 du 29 Avril 2008, publié au B.O N° 5636 du 5 Juin 2008.
Correspondance
La présente norme est en large concordance avec la NF EN 1423/1997 +
Amendement A1/2004.
Modifications
Elaborée par le comité technique de normalisation de signalisation routiére
Editée et diffusée par le Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)
© SNIMA 2008 ICS : 93.080.30
ANNEXE A (NORMATIVE)...
NM 10.9.205 2
SOMMAIRE
DOMAINE D'APPLICATION.........
REFERENCES NORMATIVES ........0000
DEFINITIONS ..
PRESCRIPTIONS POUR LES MMICROBMLES DE VOUE 4
EXIGENCES POUR LES GRANULATS ANTIDERAPANTS 7
MELANGES DE MICROBILLES DE VERRE ET DE
GRANULATS ANTIDERAPANTS ANTIDERAPANTS ....
ECHANTILLONNAGE.
10
ANNEXE B (NORMATIVE)... 13
ANNEXE C (NORMATIVE)...
ANNEXE D (NORMATIVE) .....
ANNEXE E (NORMATIVE)..
ANNEXE F (NORMATIVE) 24
ANNEXE G (NORMATIVE).. 25
ANNEXE H (NORMATIVE) ..... 28
NM 10.9.205 3
1 DOMAINE D'APPLICATION
La présente norme marocaine spécifie les exigences relatives aux essais en laboratoire
(contréle de production) et aux procédures de qualification s'appliquant aux. produits de
saupoudrage suivants utilisés en marquage routier.
Ces produits sont saupoudrés sur les peintures, les enduits & chaud, les enduits a froid et tout
autre produit de marquage appliqué a l'état liquide, immédiatement aprés mise en oeuvre sur la
chaussée.
Les prescriptions formulées dans la présente norme concernent :
~ microbilles de verre : la granularité, l'indice de réfraction du verre, la résistance chimique,
la qualité et les traitements de surface ;
~ granulats antidérapants : la granularité, les caractéristiques chimiques, la friabilité et Ia
couleur ;
~ mélanges de microbilles de verre et de granulats antidérapants ; et ensemble des
prescriptions pour les deux composants.
2 REFERENCES NORMATIVES
180 565, Tamis de contréle - Tissus métalliques, t6les métalliques perforées et
feuilles électroformées - Dimensions nominales des ouvertures.
ISO 787-9 Méthodes générales d'essai des pigments et matiéres de charge - Partie 9 :
Détermination du pH d'une suspension aqueuse.
180 2591-1 Tamisage de contrdle - Partie 1 : Modes opératoires utilisant des tamis de
contréle en tissus métalliques et en tles métalliques perforées.
1807724-2 _Peintures et vernis - Colorimétrie - Partie 2 : Mesurage de la couleur.
ISO/CIE 10526 Illuminants colorimétriques normalisés CIE.
180 5725 Fidélité des méthodes d’essai — Détermination de la répétabilité et de la
reproductibilité d'une méthode d’essai_normalisée par essai
interlaboratoires.
3 DEFINITIONS
Pour les besoins de la présente norme maro
rine, les definitions suivantes s'appliquent
3.1 Microbilles de verre
Particules transparentes, sphériques, destinées 4 assurer la visibilité de nuit des marquages
routiers par rétroréflexion des faisceaux incidents des projecteurs dium véhicule vers son
conducteur.
3.2. Granulats antidérapants
Grains durs, dorigine naturelle ou artificielle, destinés augmenter des qualités
antidérapantes des marquages routiers
NM 10.9.205 4
3.3 Récipient de vrac intermédiaire (RVI)
Récipient d'une capacité d'environ $00 kg 4 1 000 kg servant de solution intermédiaire entre
les sacs (25 kg & 50 kg) et Ie transport en vrac.
4 PRESCRIPTIONS POUR LES MICROBILLES DE VERRE
41 Granularité
La granularité des microbilles de verre doit étre décrite en fixant les limites inféricure et
supérieure des pourcentages en masse du total cumulé des microbilles retenues sur les tamis de
contréle en tissu métallique : ISO 565 - Dimension R 40/3 - a l'aide de la méthode d'essai définie
dans l'ISO 2591-1.
les granularités devront étre décrites en choisissant les tamis selon les régles suivantes (voir
aussi le tableau 1) :
~ Ie tamis supérieur de sécurité doit étre tel que le refus en masse des microbilles est
compris entre 0.% et 2%;
Je tamis supérieur nominal doit étre tel que le refus en masse des microbilles est
compris entre 0 et 10%;
si nécessairé, des tamis intermédiaires doivent étre ajoutés pour limiter le rapport entre
«Jes dimensions nominales des ouvertures de deux tamis suecessifs a un maximum de
17213
pour chacun des tamis intermédiaires, Vintervalle entre les pourcentages de refus
cumulé en masse minimaux 4; % et maximaux N2% doit étre inférieur ou égal 4 40 %
(No- Ny: < 40);
le tamis inférieur nominal doit étre tel que le refus cumulé en masse des microbilles est
compris entre 95 % et 100 %.
‘Tableau 1 : Choix des tamis pour les microbilles
Tamis:180 565 R 4g | Refuscomulé on masse
Supérieur de séeurité oa?
Supérieur nominal oa
Intermédiaire Ma Ne
Inférieur nominal 95 & 100
Des exemples d'interprétation des régles pour spécifier Ja granularité des microbilles de verre
sont donnés dans les tableaux 2 et 3
NM 10.9205 5
Tableau 2 : Granularité fine
‘Tamis : ISO 565 R 40/3 | Refus cumulé en masse
wm %
500 oa2
as 0a 10
250 208 60
a 60.8 95
i 95.4 100
Tableau 3 ; Granularité moyenne
Tamis : ISO 565 R.40/3 | Refus cumulé en masse
um %
70 0a2
600 alo
355 30470
212 70a 100
125 954100
La granularité des microbilles de verre doit étre déterminée suivant IISO 2591-1
4.2 Indice de réfraction
Lindice de réfraction n des microbilles de verre, déterminé comme indiqué dans l'annexe A,
doit étre conforme 4 l'une des classes suivantes :
~Classe A:n > 1,5;
~ Classe Bin 1,75
~ Classe C sn = 1,9.
43 Résistance 4 eau, & I'acide chlorhydrique, au chlorure de calcium, au sulfure de
sodium
Aprés avoir subi les essais de l'annexe B, les microbilles de verre ne doivent présenter aucune
altération de surface aprés avoir été mises en contact avec les produits suivants : eau, acide
chlorhydrique, chlorure de calcium et sulfure de sodium.
4.4 Exigences de qualité
Aprés avoir subi les essais de 'annexe D (méthode de référence), les microbilles de verre
doivent étre considérées comme défectueuses si elles présentent des imperfections comme celles
décrites dans Vannexe C.
NM 10.9.205 6
En appliquant la méthode de référence, et en ne tenant compte que d'un seul défaut par
microbille, le pourcentage pondéré de microbilles défectueuses doit étre au maximum de 20% pour
un diamétre inférieur 4 1 mm et de 30 % pour un diamétre égal ou supérieur A 1 mm, le
pourcentage de grains et de particules étrangéres étant au maximum de 3 % dans les deux cas (voir
tableau 4). Si une granularité s'étale de part ct d'autre de 1 mm, les microbilles doivent étre séparées
au moyen d'un tamis dont ouverture nominale est de 1 mm et les deux fractions doivent étre
‘examinées séparément. i
Tableau 4 : Pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses
Diamétre des mierobilies Pourcentage pondéré maximal | Pourcentage pondéré maximal
de verre de microbilles de verre de grains ct de particules
défectueuses 1) étrangres
mm % %
1,3), la
microbille de verre ovale est considérée comme défectueuse.
¢
(
Figure C.1 : Microbille de verre ovale
C2. Satellites (voir figure C.2)
Si une mictobille de verre supporte plus de deux microbilles plus petites, appelées satellites,
ou si, dans le cas de deux satellites, le rapport entre le diamétre ddu plus grand des deux et le
diamétre Dde la microbille support est supérieur 0,25 (d/D> 0,25 ), la microbille de verre est
considérée comme défectueuse.
oO
Figure C.2: Satellite
NM 10.9.205, 6
C3 Microbilles de verre en forme de goutte (voir figure C.3)
Quand le rapport entre 1a plus grande dimension L et la plus petite dimension 1 est supérieur
41,3 (L/P 1,3), la microbille de verre est considérée comme défectueuse.
t
Figure C.3 : Microbille de verre en forme de goutte
C4 Microbilles de verre ayant fusionné (voir figure C.4)
Lorsque Je rapport entre Ja grande dimension Dz et la petite dimension D, est supérieur & 1,3
(D,/D, > 1,3), la particule est considérée comme étant une microbille de verre défectueuse.
% 0
Figure C.4 : Deux microbilles ayant fusionné
C5 Microbilles de verre ayant une forme quelconque sans aréte vive (voir figure
cs)
Si le rapport entre la plus grande dimension L et la plus petite dimension lest supérieur a 1,3
(L/ > 1,3), la microbille de verre est considérée comme défectueuse,
L
oe
Figure C.5: Microbille de verre ayant une forme quelconque sans aréte vive
NM 10.9.205 7
C6 Microbilles de verre opaques (voir figure C.6)
Les microbilles de verre opaques sont toujours considérées comme étant défectueuses.
Figure C.6: Microbille de verre opaque
C.7 Microbilles lactescentes (voir figure C.7)
Liaspect lactescent est dil A des inclusions gazeuses dans une partie ou dans la totalité des
microbilles. Les microbilles de verre lactescentes sont toujours considérées comme étant
défectueuses.
Figure C.7 : Microbille lactescente
C8 Microbille contenant des inclusions gazeuses (voir figure C.8)
Si le rapport entre la somme de la surface projetée des bulles a l'intérieur d'une microbille de
verre Esi, et la surface projetée de Ia microbille, S, est supérieur a 0,25 (Esi/S > 0,25), la microbille
de verre est considérée comme défectueuse.
Figure C.8 : Inclusions gazeuses
NM 10.9.205 18
C9 Grains (voir figure C.9)
Particules de verre qui présentent une ou plusieurs arétes vives.
Figure C.9 : Grain
C.10 Particules étrangéres
Particules qui ne sont pas composées de verre.
NM 10.9.205 »
ANNEXE D
(normative)
Méthode de détermination de la qualité des microbilles de verre
DA Mode opératoire
La détermination du pourcentage de microbilles présentant un défaut dans un échantillon est
obligatoirement faite 4 partir des fractions obtenues sur chaque tamis aprés I'analyse
granulométrique réalisée conformément a ISO 565 et ISO 2591-1, Je tamisat final n’étant pas
considéré comme une fraction. L'examen des défauts des microbilles de verre doit étre effectué
Taide dun dispositif optique grossissant permettant d'obtenir dans le champ visuel des microbilles
dau moins 4 mm 5 mm de diamétre apparent.
Les microbilles recueillies sur un tamis (par exemple 300 jum) doivent étre homogénéisées
Par au moins cing passages dans un petit diviseur puis un échantillon de petite taille (environ 0,5 g)
doit atre réalisé par divisions successives.
Cet échantillon est ensuite passé dans sa totalité dans un tamis dont le maillage est
légérement plus grand que celui du tamis oi le refus a été recueilli (par exemple 500 um en cas de
refus avec un tamis de 300 um d'ouverture) sur une bande adhésive transparente de largeur égale
ou inférieure & 20 mm et de longueur égale au diamétre du tamis. Les microbilles non retenues sont
récupérées et redéposées jusqu’a fixation de ensemble sur Ia bande adhésive. En cas d'excés,
préparer un nouvel échantillon et réaliser une nouvelle bande adhésive. It est recommandé de
déposer les microbilles sans les faire rouler, afin d'éviter de provoquer une séparation entre les
microbilles sphériques et les autres.
L'éprouvette ainsi réalisée doit étre examinée sous le dispositif optique. Pour faciliter son
examen, la bande adhésive supportant les microbilles peut étre découpée en morceaux qui doivent
tous étre traités dans les mémes conditions :
~ le nombre de microbilles de verre défectueuses porte sur Vobservation d'au moins 600
microbilles par tamis, provenant d'au moins six plages différentes uniformément réparties sur
toute Ia surface de Ia bande adhésive (ou de l'ensemble des morceaux) supportant les
microbilles, Dans le cas du tamis correspondant a la plus grande quantité de matériau retema,
il faut également remplir les deux conditions supplémentaires suivantes :
1) chaque plage ne doit pas contenir moins de 100 microbilles. Si ce n'est pas’ le cas,
plusieurs plages vojsines sont regroupées pour satisfaire & ce critére ;
2) Vécart entre le plus grand et le plus petit nombre de microbilles défectucuses dans les
différentes plages contenant au moins 100 microbilles (plage unique ou plages adjacentes
regroupées) ne doit pas dépasser 20 en valeur absolue. Si ce ctitére ne peut pas étre
satisfait, il faut préparer une autre bande adhésive.
Exempl plage n° | : 17 microbilles défectueuses sur 108 microbilles ;
plage n? 2 : 21 microbilles défectueuses sur 119 microbilles :
plage n° 3: 18 microbilles défectueuses sur 103 microbilles;
plage n° 4 : 23 microbilles défectueuses sur 141 microbilles ;
plage n® 5 : 16 microbilles défectueuses sur 123 microbilles :
plage n° 6 : 27 microbilles défectueuses sur 106 microbilles.
art entre les nombres extrémes de microbilles défectueuses est égal a:
2T-16=11
NM 10.9.205 0
= _seules Jes microbilles entiérement situées dans le champ visuel sont examinées ;
~ compter dabord toutes les microbilles présentes dans le champ visuel et ensuite les
microbilles qui présentont au moins une des imperfections mentionnées au paragraphe 4.4 et
définies dans t'annexe C.
Dans le cas d'un examen effectué par projection sur un écran, les microbilles doivent étre
immergées dans un liquide dont l'indice de réfraction est proche de celui du verre pour révéler Iss
inclusions gazeuses, parmi les autres défauts,
NOTE : Dans le cas d'un examen direct effectué & aide d'un microscope stéréoscopique, le comp-
tage peut éare facilité en utilisant un oculaire muni d'un réticule et en travaillant sur des plages
rresireintes @ une vingtaine de microbilles é la fois.
D2 _ Résultats des comptages
Lors du tamisage d'un échantillon représentatif d'une granularité de microbilles travers ses »
tamis spécifiques, le pourcentage pondéré total de microbilles défectueuses doit étre calculé a l'aide
de la formule suivante
M,D,+M,0,+M,D,
M+ M+ M4,
w
ou
W est le pourcentage pondéré total de microbilles de verre défectueuses ;
M; est le pourcentage en masse des microbilles retenues sur chacun des n tamis;
Di est la moyenne arithmétique du pourcentage en nombre des microbilles défectueuses
comptdes sur au moins cing échantillons diment prélevés sur chacun des » tamis.
Le pourcentage pondéré total de grains et de particules étrangéres doit étre calculé de la
méme maniére. Los résultats des comptages sont présentés conformément au tableau D.1, donné a
titre d'exemple pour une granularité comprise entre 125 jum et 600 um.
NM 10.9.205,
a
Tableau D1 : Exemple de présentation des résultats de comptage en fonetion
de Vouverture des mailles du tamis (600.tm 4 125 wm)
Cia | wrttine | Pontes demi deere | apmcincn | onde
rs lages D. défectueuses
% mt | n2] n°3 | ned | nes | n°6
125 18,2 9 I g w uw 9 9,7 1,80
daisies aa gi ga hon
1)” Les valeurs figurant dans ecte colonne sont ealculées Comme indiqué ci-dessous pour a premiére ligne
187 =
Gig VOC 97,9 = (62 309+ 24,7 19,7 18.2)
NM 10.9.205 2
ANNEXE E
(normative)
Méthode de détermination de la présence d'un traitement d'hydrofugation
E.1_ Mode opératoire A
Utiliser le mode opératoire A si on a besoin d'une indication rapide.
Le contréle du pourcentage des microbilles hydrofugées se fait suivant la méthode décrite ci-
dessous.
Pour cet essai, 1 ml de microbilles est nécessaire, mesuré a Taide d'un tube de diamétre
intérieur compris entre 2 mm et § mm et gradué tous les 1/20 ml.
Surface d'erviren 1 gm?
Tipe craduée
Figure E.1 : Entonnoir
Les microbilles sont saupoudrées d'une hauteur de 5 mm sur un plan d'eau immobile,
environ] dm’, situé dans un entonnoir muni d'un tube de diamétre intérieur compris entre 2 mm et
‘5 mm et gradué tous les 1/20 ml a partir de sa base obturée.
‘assurer que
~ la partie de la paroi intérieure du récipient située au-dessus de l'eau soit séche ;
~ la surface de l'eau soit immobile ;
~ les microbilles ne tombent pas les unes sur les autres.
Résultats
Vétant le volume en millilitres des microbilles recucillies dans Je tube 5 min apris le
saupoudrage, le pourcentage de microbilles hydrofugées est égal 4:
(1-V) x100
AVERTISSEMENT : Ne jamais mettre de microbilles de verre non hydrofugées dans un
récipient ayant contenu précédemment des microbilles hydrofugées ou de I'hydrofugeant.
NM 10.9.205 23
E.2_ Mode opératoire B
11 faut suivre le mode opératoire B si des résultats précis sont requis
E21 Appareillage
~ tm entonnoir ayant une profondeur de 120 mm avec un diamétre supérieur de 150 mm et
un col de diamétre intérieur de 6,25 mm ;
~ lm sac en coton lavé, au pas des fils de 48 x 48 (dimensions approximatives 450 mm x 250
mm) ;
7 unseau dune capacité minimale de 41 rempli d'eau claire & température ambiante ;
+ un vase de 500 ml.
E22 Mode opératoire
Soha Se Servant de microbilles de verre prélevées sur un échantillon représentatif (voir article 7
~ Echantillonnage), vérifier que la masse est approximativement de 400 g.
Retoumer le sac de coton (voir E.2.1) comme un gant et y verser Féchantillon,
Immerget le sac contenant téchantillon dans le seau d'eau pendant 30 s ou jusqu’a son
immersion compléte, suivant la plus longue des deux durées.
Retire Ie sac et l'échantillon de Teau et chasser l'excés deau du sac en tordant la partie
rencticure- Le haut du sac étant toujours maintenu bien serré, le suspendre pendant 2 h pour
Végoutter a température ambiante,
Au terme de la période de 2 h, bien mélanger l'échantillon en desserrant le haut du sac et en le te
Secouant pour détacher les microbilles du fond et des parois.
Tiansférer Uéchantillon dans un entonnoir propre et sec (voir B2.1 et la figure E.1)
Léchantillon entier doit s'écouler sans arét A travers Yentonnoir. Si Téoulement se fat mal,
considérer que l'essai n'est pas satisfaisant.
Siles microbilles s'écoulent sans arrét, comme décrit ci-dessus, Tessai est jugé satisfaisant
NOTE Dans le cas ois les microbillesbloguent Ytonnoir des leur introduction, i xt permis de tapoer le cot
de Fenonnoir afin de provoquer écoulement
NM 10.9.205 4
ANNEXE F
(normative)
‘Méthode de détermination de la présence d'un traitement de flottation
NOTE : Cette méthode d'essai est valable uniquement pour des microbilles de verre dont la gramy-
lométrie est comprise entre 180 jm et 300 wm. .
F1_ Principe
Déterminer la présence d'un traitement de surface faisant flotter les microbilles de verre en
estimant le pourcentage de microbilles flottant & la surface du xyléne ou du n-heptane.
F2 Appareillage et réactifs
= un verre de montre ou une boite de Pétri d'un diamétre de 50 mm 75 mm ;
~ une seringue, pipette ou compte-gouttes d'une capacité de ml & 20 ml ;
- une série de tamis satisfaisant aux prescriptions de ITSO 565 ;
~ du xyléne, comme réactif ;
- du n-heptane, comme réactif.
F.3 Mode opératoire
a) A partir dun échantillon représentatif (voir l'article 7), isoler Ja fraction passant dans un
tamis de 300 um mais retenue par un tamis de 180 pm.
) Disposer une monocouche de cette fraction de microbilles de verre sur le verre de montre
bien propre et, a l'aide d'une seringue, introduire lentement depuis le bord du verre de
monire le xyléne jusqu'a ce que la quantité de liquide soit suffisante pour faire flotter les
microbilles. Veiller 4 ne pas agiter les microbilles en ajoutant le xyléne.
¢) Estimer visuellement le pourcentage de microbilles flottant a la surface du xylene.
4) Répéter les opérations a) et b) en utilisant un nouvel échantillon de microbilles de verre et
du n-heptane au lieu du xyléne.
F4 Résultats
L'essai est concluant si le pourcentage minimal de microbilles flottantes est conforme au
tableau F.1.
‘Tableau F.1 : Pourcentages des microbilles de verre
traitées pour flottation
Réactif
Xylene 90
n-heplane 5
NM 10.9.205 28
ANNEXE G
(normative)
Méthode de détermination du coefficient de friabilité des granulats antidérapants
G1 But
La présente méthode d'essai a pour but de définir fe mode opératoire permettant de
déterminer la résistance des granulats a la fragmentation.
G.2_ Domaine d'application
La présente méthode dessai s'applique aux granulats d'origine naturelle ou artificielle, utilisés
dans le batiment ou les travaux’publics.
G3 Références
‘Tamisage de contrdle : L'analyse granulométrique doit étre réalisée selon NSO 2591-1.
Enude statistique : La reproductibilité de 1a méthode dessai a été vérifige suivant !'1SO 5725
«Fidélité des méthodes d'essai - Détermination de 1a répétabilité et de la reproductibilité dune
méthode d'essai normalisée par essais interlaboratoires».
G4 Généralités
G41 Principe
Liessai consiste a mesurer la variation granulométrique de granulats produits dans un cylindre
rotatif dans des conditions strictement définies, par un procédé de fragmentation utilisant une
charge en présence d'eau.
La granularité d'un échantillon représentatif de granulats doit étre comprise entre 0,2 mm et
2mm ou entre 0,2 mm et 4 mm.
Des granulats de taille inférieure 4 0,2 mm ne sont pas pris en considération.
G42 Le coefficient de friabilité est défini par Ia quantité de matériau de taille
inférieure 4 0,1 mm produite.au cours de essai.
Si M est la masse du matériau soumis a Vessai et m celle du matériau de taille inférieure &
0,1 mm produit au cours de essai, le coefficient de friabilité est, par definition
G5. Appareillage
G5.1 Appareillage standard
Equipement nécessaire pour échantilionner le matériau ct réaliser Vanalyse granulométrique
Par tamisage, ainsi qu'une série de tamis dont le diamétre est au moins égal 4 200 mm avec des
ouvertures de 0,1 mm, 0,2 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm et 8 mm.
NM 109.205 6
G52 Appareillage spécial
Cylindre rotatif (appareillage micro-Deval).
Une charge abrasive constituée de billes en acier inoxydable X30 Cr]3 de diamétre
, aay
30797 |mnm, [187 © lim, ot (10 # 0,5) mm
-05j 0 05
G.6 Matériau 4 contréler
Gol Pri
ement de I'échan
La masse du matériau envoyé au laboratoire doit étre au moins de 2 000 g.
Lessai doit étre conduit sur un échantillon de 0,2 mm &2 mm ou de 0,2 mm a 4mm.
G.6.2 Préparation de I'échantillon
Preparer I'échantillon comme suit :
= tamiser les 2 000 g de matériau humecté & Vaide des tamis 0,2 mm et 2 mm ou 0,2 mm et
4mm;
+ sécher le matériau dans une étuve & 105 °C jusqu’d masse constante, cest-A-dire jusqu’a ce
que deux pesages successif’ de l'échantillon, & 1 h diintervalle, ne différent pas de plus de
01%;
- homogéngiser et peser un échantillon de (500: 2) g.
Préparer comme suit les billes d'acier utilisées pour la charge :
+10)
- prendre 9 billes de 30 mm de diamatre et d'une masse totale de fos! 50} 9?
- ajouter 21 billes de 18 mm de diamétre et d'une masse de (10! a} a:
- compléter la charge a l'aide de billes de 10 mm de diametre, de sorte que la niasse totale
de la charge soit égale 4 (2 500 + 4)
NOTE : L'usure de la charge doit érre contr6lée périodiquement. Les billes de 18 mm et 30 mm sont
‘pesées globalement, et les plus usées sont remplacées, par pesages séparés, jusqu'a ce que la
‘charge soit & nouveau dans les limites de tolérance. Les billes de 10 mm sont contrélées par
lots de 10 ; si le lot pése moins de 34 g, elles sont remplacées par des billes conformes.
NM 10.9.205, 27
G7 Déroulement de l'essai
~ Intyoduire la charge dans le cylindre d'essai, disposé avee Touverture vers le haut ; puis
verser les 500 g de matériau préparé conformément aux prescriptions de G.6.1 et G62;
+ ajouter 2,5 I d'eau et refermer ;
~ faire tourer le cylindre & une vitesse de (100 4 5) min pendant 1 500 rotations ou
15 min;
~ verser lente ment tout le contenu du plateau au-dessus de deux tamis superposés l'un de
8 mm (pour collecter la charge abrasive) et l'autre de 0,1 mm, respectivement ;
~ aver Je tout au jet d'eau jusqu’a ce que Peau ressorte claire, puis retirer le tamis de 8 mm ;
~ sécher le tamis de 0,1 mm dans une étuve a 105 °C jusqu’a masse constante ;
~ tamiser 4 see fe matériau de grain trop gros & l'aide du tamis de 0,1 mm ;
~ peser tout le matériau de grain trop gros sur le tamis de 0,1 mm. Soit m'cette masse.
G.8_ Expression des résultats
La masse m du matériau de taille inféricure a 0,1 mm produite au cours de essai, & partir des
500 g versés au départ, est égale a 500 - m'. (m= 500 - m').
Le coefficient de friabilité est done de :
= 100 x (800-m')_m
7 500 5
arrondi au nombre entier le plus proche
GI Fidelité
La répétabilité (1) et Ia reproductibilité (R) ont été déterminées d'aprés des essais répétés
effectués pour chaque produit dans 18 laboratoires. L'interprétation a été faite conformément A la
norme {SO 5725. Les valeurs établies entre les niveaux 16 et 38 sont les suivantes :
= pour F= 16: répétabilité
reproductibilité = R= 4,2
= pour F, = 38: répétabilité 62
reproductibilité © R=8,4
NM 10.9.205 28
ANNEXE H
(informative)
Méthodes d’essai alternatives pour la détermination
de la qualité des microbilles de verre
H.1 Domaine @’application 7
La présente annexe décrit deux méthodes altematives pour la détermination de la qualité des
microbilles de verre. La méthode ¢essai définie 4 Annexe D doit étre considérée comme la
méthode d’essai de référence.
Ces méthodes alternatives indiquent les valeurs-seuils corrélées 8 utiliser, correspondant au
pourcentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses indiqué dans le Tableau 4.
H.2 Méthode d’essai visuelle
2.1 Appareillage et matériaux
‘Une série complete de diviseurs 1/1.
Un projecteur équipé d’un objectif de grossissement 25 placé a une distance permettant
Pobtenir une image de diamétre compris entre 750 mm et 800 mm sur un éeran muni
‘une grille carrée de 500 mm divisée en 25 carrés ; ou un dispositif optique grossissant
permettant d’obtenir une projection de 50 a 150 microbilles de verre.
+ Une capsule a fond plat dun diamétre intérieur compris entre 60 mm et 70 mm, ou une
plaque de verre d’une surface minimale de 700 mm”,
‘+ Une graisse silicone ou une bande adhésive transparente.
+ Un liquide avee un indice de réfraction proche de celui des microbilles de verre.
H.2.2 Mode opératoire
Un échantillon représentatif @'une masse approximative de 0,3 g doit étre préparé par
divisions successives a aide de diviseurs 1/1.
L?échantillon représentatif ainsi obtenu est placé dans la capsule a fond plat, préalablement
enduite dune fine couche de graisse silicone, ou sur une bande adhésive transparente, et
uniformément réparti de fagon a recouvrir complétement Ja grille carrée de I’écran avec une seule
épaisseur de microbilles.
Si l'on obtient une projection de plus de 150 microbilles, le nombre total de microbilles est
déterminé en comptant les éléments dans trois carrés altemés disposés sur une diagonale. Le
nombre ainsi obtenu est multiplié par 25, puis divisé par 3. Si I’on obtient une projection de moins
de 150 microbilles, toutes les microbilles présentes dans le champ visuel sont comptées. Le nombre
total de microbilles doit étre compris entre 150 et 400.
Un second comptage permet de déterminer le nombre de microbilles non sphériques
défectueuses présentes sur toute la grille carrée ; c"est-d-dire : les microbilles ovales, les satellites,
les mictobifles en forme de goutte, celles ayant fusionné, celles d'une forme quelconque sans aréte
vive, les grains et les particules étrangéres.
NM 109.205 »
Recouvrir I'échantillon avec le liquide ayant un indice de réfraction proche de celui des
tmicrobilles de verre. Dans ces conditions, seule la forme des microbilles est visible et les inclusions
‘gazeuses apparaissent sous forme de taches sombres.
Un troisiéme comptage consiste a dénombrer les microbilles sphériques défectucuses
présentes sur toute la grille carrée, c’est-a-dire : les microbilles présentant des taches sombres sur
plus de 25 % de la surface, tes microbilles opaques et les microbilles lactescentes.
Les microbilles défectueuses ne sont comptées qu’une seule fois méme si elles présentent
plusieurs types de défauts.
H23 Résultats des comptages
Le pourcentage de microbilles défectucuses est calculé a l'aide de la formule suivante :
Md = (100 x Nmd)/Nm
ot:
Md _ est le pourcentage de microbilles défectueuses 3
‘Nid est le nombre total de microbilles défectueuses obtenu en faisant la somme des deux
demiers comptages ;
Nm_ est le nombre total de microbilles.
La valeur finale de Md est la moyenne d’au moins trois déterminations.
H24 — Valeurs-seuils corrélées
Lorsqu’on utilise cette méthode d’essai visuelle alternative, le pourcentage pondéré maximal’ +
de microbilles de verre défectueuses, tel que défini dans le Tableau 4, doit respecter les valeurs du
Tableau H.1.
Tableau H.1 — Poureentage pondéré maximal de microbilles de verre défectueuses
Diamétre des microbilles Pourcentage pondéré maximal Pourcentage pondéré maximal
de verre de microbilles de verre défectueuses | de grains et de particules étrangires
mm % %
Vous aimerez peut-être aussi
- Assainissement Des Batiments (Présentation1)Document20 pagesAssainissement Des Batiments (Présentation1)Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Consistance Des Locaux Technique Et Administratifs de L'ormvaoDocument2 pagesConsistance Des Locaux Technique Et Administratifs de L'ormvaoMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Connaissance Des Reseaux Divers BTP TSCT PDFDocument54 pagesConnaissance Des Reseaux Divers BTP TSCT PDFAnonymous uueSiA7ZCx100% (1)
- Esau UseéeDocument15 pagesEsau UseéeMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Mission de L - OpcDocument5 pagesMission de L - OpcMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NM 13.1.046-2005Document12 pagesNM 13.1.046-2005Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Scemas Et Systemes D'assainissement1Document13 pagesScemas Et Systemes D'assainissement1Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NM 13.1.024Document8 pagesNM 13.1.024Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- DEVISDocument1 pageDEVISMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NM 13 1 042 200ererDocument9 pagesNM 13 1 042 200ererMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NM 13 1 044 2005dfdfDocument6 pagesNM 13 1 044 2005dfdfMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NM 13.1.004Document8 pagesNM 13.1.004Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- ANALYSE PAR TamisageDocument1 pageANALYSE PAR TamisageMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Analyse Par SedimentationDocument2 pagesAnalyse Par SedimentationMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NM 10.1.107Document9 pagesNM 10.1.107Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Liste Des Essais Pratiqués Au CESDocument2 pagesListe Des Essais Pratiqués Au CESMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Essais Sur GeotextilesDocument4 pagesEssais Sur GeotextilesMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Fsac LP Gamu Tae 10Document20 pagesFsac LP Gamu Tae 10Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Norme Marocaine: Mélanges BitumineuxDocument42 pagesNorme Marocaine: Mélanges BitumineuxMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NF en 13108-2Document28 pagesNF en 13108-2Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- NF EN 12848 Stabilité Au Ciment 2009Document11 pagesNF EN 12848 Stabilité Au Ciment 2009Mohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Tableau AuscultationDocument6 pagesTableau AuscultationMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- Etude de DurabiliteDocument3 pagesEtude de DurabiliteMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- R M WXWXWX M 'E T WXWXWX D E PDocument18 pagesR M WXWXWX M 'E T WXWXWX D E PMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- CH5 Réseaux AssainissementDocument61 pagesCH5 Réseaux AssainissementMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation
- CH4 Rappels HydrauliqueDocument38 pagesCH4 Rappels HydrauliqueMohamed HOUGGAALIPas encore d'évaluation