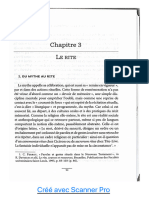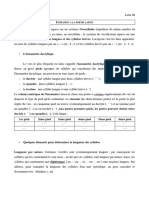Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Gerber - Quatre Hymnes
Gerber - Quatre Hymnes
Transféré par
Daniel CARLANA0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
19 vues8 pagesTitre original
Gerber - Quatre hymnes
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
19 vues8 pagesGerber - Quatre Hymnes
Gerber - Quatre Hymnes
Transféré par
Daniel CARLANADroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 8
352 DISCOURS ET RECIT EN LUC-ACTES
récit primaire du narrateur au chapitre 9, I'événement est re-raconté 2 dew:
reprises dans un discours autobiographique de Paul (Ac 22 et 26). On a
‘comment, au travers de ces discours, le narrateur sc fait I'herméneute de Ja ruptu
entre juifs et chrétiens et ouvre au lecteur le sens de sa propre histoire. Danie
Marcuzrat, « Le discours, liew de (re)lecture du récit. Actes 2 et 26 », montres
que le discours, dans le livre des Actes, n’investit pas seulement de sens T’événe-
‘ment auquel il est attaché ; il est un lieu ott le narrateur travaille & la compréhen-
sion du récit global et fournit au lecteur un code de lecture ou de relecture de’
Vensemble de son récit. La démonstration opére sur le discours inaugural des
Pierre a la Pentecdte (Ac 2) et sur Ie discours d’adieu de Paul devant les représen-
tations de l'autorité impériale (Ac 26).
Daniel Marguerat, Université de Lausanne
A la mémoire d’Etienne Trocmé
LE MAGNIFICAT, LE BENEDICTUS,
LE GLORIA ET LE NUNC DIMITTIS :
(QUATRE HYMNES EN RESEAU POUR UNE INTRODUCTION
EN SURPLOMB A LUC-ACTES
Daniel Gerber
Faculté de théologie protestante
de !'Université Marc Bloch, Strasbourg
Liintérét grandissant de la recherche pour Ia rhstorique narrative dSployée
‘par Tauteur de Iceuvre & Théophile a sensiblement réorienté I'approche du
Nunc dimitis (27.99.42) Rin que Ie flot des travaux susctés par des questions
Etelevant plus spécifiquement d'une démarche diachronique ne soit pas tari, une
ABE sxention plus soutenve se porte désormais sur la fonction occupée par ces can-
(iques dans le récit lucanien?, Sl peut aujourd"hui étre admis qu’me intention
ADP ssivecée a commandé leur insertion dans le « commencement narratif» de Lue-
YAP ces, les raisons précises pour lesquelles Luc a situé ces hymnes en cet endroit
particulitrement stratégique de sa narration restent clarifier. Aussi este & cere
1. Novs emploieros les noms «lynne » ct « canque» pour désigner de fagon commode ces
Gute tenes.
“2. Deux monographiesatestent, bien que ts timidement, ce sous dexpligquer la présence do
is testes en ouverture de PauvrebToEoplale. Maré le sus-tize do ouvrage de Stephen FARIS,
21 GARE Ts Hoyo of Lae’s Infancy Narratives: This Origin, Meaning and Significance QSNESS 9), Sho?
2. IE fn, ISO Press, 1985, on remazquera outefois le dSéqulibre Ragrant ene le dex premibres par-
sp 14-98 5p 99-150) endemic (p,151-160) tv pscisement det fonction du Magnes,
fr Bonediws et da Nu dime ds Verwoe de Lac. Uke MIFIMANO RICHEY, Mognitiat nd
eneaow. Die altasteZeugniste der jadenchristlichen Tredtion von der Gebwrt des estas (WUNT
290), Tubingen, Moi, 1996, ne consacre elle aussi qu'an minimum de pages (p. 231-238) 4
-pesionde Ia foncton rédacionnele des doux cantghts analyses. Toutefos, comme nods auren=
Toceasion de le relever, plusieurs articles ou commentaires tmotgneat deer porta Ta fonction
es byes dans levi e La.
384 DISCOURS ET RECIT EN LUC-ACTES (QUATRE HYMNI
ENRESEAU 355
‘che qu’aprés d'autres nous voulons nous employer, dans les limites de esp La fonction des hymnes dans le contexte étroit de Le 1-2
‘apart’.
‘Vu leur emplacement, il n'est que naturel de s'interroger en priorité sur
Jeffet recherehé par V'insertion du Magnificat, éu Benedict, du Gloria ct du
= Mune dimittis dans le contexte proche des deux chapitres introductifs &Luc-Actes,
E Pour ce faire, note attention so fixera tout d’abord sur la manitre dont ces can-
liques ont été enchissés dans la narration des événements initiaux afin d’@re
mieux a méme d’apprécier ce que les contenus apportent au récit,
‘Mais avant de chercher & spécifier la fonction de ces quatre cantiques i
fois dans le contexte plus restreint de Le 1-2 et dans le cadre plus large.
Luc-Actes, il nous faut au préalable nous expliquer quant & La prise en cot
de acclamation de I'armée céleste dans notre questionnement. Sl est vii
gue le Gloria se distingue doublement des autres hymnes, tant au nivean de
forme que de Iidentité des locateurs, estil pour autant & écarter d'une enquéte
menée sur le plan synchronique et privilégiant 1a logique inteme au texte,
Tucanien ? Trois raisons au moins s'y opposent* : d'une part, on observera que
le Gloria et le Nunc dimittis sont introduits dans le récit par ene formule sii
laite (Le 2,13 : aivotvrav bv Gov Kat heySurav ; Le 2,28 : eddbynocv 7h
dv Kat clnev) ; d'autre part, on relevera que le Gloria, tout comme les tk
autres cantiques, stoppe Iui aussi momentangment I'action ; enfin il va de s0i @
due, du point de vue narratif, Pimportance d’une parole n'est pas uniquemeat
fonction de sa longueur. Supposer en conséquence que acclamation oe
Yarmée esleste est investie d’un role qui recoupe celui des trois autres hymes
nous parait donc justifié. Plus encore, nous aurons & nous demander si les:
quatre cantiques ne sont pas autant d’éléments d’une construction qui, se
superposant aux événements narrés en Le 1~2, participe a la programmation:
de Ia lecture de l’euvre & Théophile. Aussi serons-nous attentif, certes.a ge
‘que chacun de ces hymnes apporte en propre & la narration lucanienne, mai
surtout & la maniére dont, ensemble, ils informent le lecteur du projet
ture de Lue*
© 11 Quelques sutures lexicographiques uniquement
La premiére impression pouvant gagner le lecteur est celle d'un accrochage
rnimum des quatre hymnes avec leur contexte précédent, du moins si l'on
rezarde aux seules sutures Iexicographiques vraiment significatives. Ainsi, pour le
Magnificat : 800k (1,38.48), paxapia / uaxapiotow (,45.48b), dBwvaTHet /
tuavés (137.499) ; pour le Benedicus : axcmov xupiou (1.15.76) + Edeos
fe (58.72.78); TaiSiov (,59.76); edhoyay rev eedv/ctdoynrés 6 Bebs
(164.688) ; pour le Gloria: 86Ea xupiov /65Ea 8 (2,9.14) ; pour le Nunc
dimitis: 59 J e180» (2,2630). On concédera donc volontiers 4 Raymond
{E-Brown que les quatre cantiques pourraicnt assez facilement re détachés de la
-tarration sans que, pour autant, son fil ne soit rompu*. Mais fant-il pour autant
‘enir oes hymnes pour de seuls omements” ? De fait, leur relatif décalage avec les
® événements rapportés n’est qu’ apparent. A y regarder de plus prés, leur présence
‘est en effet pas aussi artificielle qu'll n'y parait de prime abord, du moins pour
fois d’entre eux, en Poccurrence le Magnificat, le Benedictus et le Nune dimies.
Excela n'est pas pour étonner quand on sait avec quel soin Lc compose.
|]2 Une articulation néanmoins logique et calculée
3. Uce publication for stimutane,&Isquolle nous sommes rts redevabl, est celle de Noe
‘Lown, « Die Lieder in der Kindnesgeschche bei Lukas», dans: Cornelis Mave, Kate
‘Mute et Geilard ScuMALensexo, 6s, Nach den AnfangenSragen (Herm Pro Dr. theo. Gera
Dautzenberg), Giessen, Seistverlag Evangel. . Kathel. Teolops U. deen Dida, 1994, p38
4404, Reprenant 'enguéte mene en soa temps sous le méme te par Hecbaan Gutkel au eit
vee pertinence sur les hymnes lueaiens les concisions relatives ses travaux comactés
Paumes et antes cantigues de Ancien Testaent a
4, Pour les deux premitres, fa ertique adessée par Norbert Lows, ibidem,p.392,0.24) (§
‘Stephen Pata, The Hymns of Liles Infaney Noratve (te 2), gu, apes avoir bovement ep
les isons pour lesqueles il renoneait a prendre en compte Le 2,14 dans sa monograpie, dear ®
peu rapidement, p12: « Reprtily i moat be Ind ade a
5. On ne saat de méme ople pour une lsture uniquement dssoige des dscoas isin,
aires des Actes qu cea st admis, reavoient Is uns ux anes. Pour coux de Piee en paculieg cf
Robert C. Tanai « The Functions of Peter's Mission Speeches in the Narrative of Acts», NIST
1851, p. 400-414 (oirp. 40). *
E On observera en effet avec Joel B. Green que le Magnificat, le Benedictus et
Ee Mane dims sinscrvert dans un schéma narraif analogue aricalan: une pro-
‘psse, son accomplissement et un élan de reconnaissance’. Il est un fit que les
E amonces de "ange du Seigneur & Zacharic t A Marie (Le 1,11-20.26-38) comme
6-Rayenond E. Brown, The Birth of the Messiah. A Cortmentary onthe Infancy Narratives in the
Be Garris of Mettow and Lae, New York, Doubleday, 1982. 645
7.C’éait'avis de Hermann Gunkel, ainsi rapponé pac Norbert LOHR, « Die Liederin der
Kindhcitgsschictte bes Laas» (note 3, p. 383-386 Dare Keine Erweteringen seen [Magni
‘ac und Benedicns) "von einem {.] Scbrifsteller, der de Lagende rach der Site des Alten Test
J sexs mix Godichen, de den handeaden Personen in en Mund geegt waren chicken wol
f; Biofigung in de chon vorhandene Frzahlang von TX 1-2 zberetel werden»,
8. Joel B, Gres, The Gospel of Luke (NICNT), Gand Rapids, Berdnans, 1997, p. 143,
356 DISCOURS ET RECIT EN LUC-ACTES
Vinformation une révélation faite par VEsprit saint & Syméoa (Le 2.26)
mméaiatement confirmées, sinon totalement, du moins partiellement, parle ei
(Le 1,39-45.57-66 ; 2,27-30), d’olt In réaction de louange attribuée & chacun d
‘wois personages’. Aussi estit permis de conclure & une présence somme
Togique de ces trois cantiques en Le 1-2, du moins si ’on se souvient que Luc,
maniére générale, aime 4 noter les réactions suscitées par la manifestation: deg
‘Jésus ou par le témoignage qui lui est rendu. S'ily a lew de s'étonner, stp
‘au sujet de extension des réactions prétées & Marie, & Zacharie ot & Syméon 0
‘encore de la forme & elles donnée,
Concemant le caractére plus inattendu du cheeur de V'armée oéleste, il pet's
quant & lui Etre expliqué par Ia volonté de Lue de surprendre le lecteur par we!
voix autorisée supplémentaire que rien n’amnoncait. Ce que laisse d’ailleurs exh
citement entendre l'adverbe &Eaigyns (cf. Ac 9,3 ; 22.6) en introduction au bet
4épisode de Le 2,13-15a surajouté a la scéne des bergers et qui imprime & ces
sets tne comnotation de soudaineté.
shal ees baat oiled lta ae
ciel des quatre hymnes dans 1a narration des événementsinitiaux, que penser
leur apparente distance avec l'histoire racontée, étant donné qu'ils ne reisent
simplement, en un langage lyrique, ce qui a 6 préédemment narré ? Neste
pas Je moyen choisi par Luc pour amener le lecteur & prendre immédiatem
quelque recul par rapport aux événements rapportés en vue de I'aider Xen sas
sens absolu?
1.3 Des espaces d'interprésation privilégiés
Si on regarde 3 action déroulée en Le 1-2, force est de constr gue
chacun des quatre hymnes suspend ia marche du récit, ouvrant comme Unt!
parenthése pour délivrer une information d'un autre ordre ®, De fait, si le mouye-
‘ment de Ia narration est ainsi régulidrement arrété, est vraisemblablement dans
Vintention de placer |'événement central que représente la venue de Jésus dati,
une perspective élargie et ¢'ofirir ainsi au lecteur des espaces dinterprétaion 59
privilégiés pour qu’il soit & méme d’apprécier Pimportance réelle de ce qui est
9. Michael Woures, «Wann wurde Maria schwanger? Eine verochissige Frage unt ih
Bedeutung fir das Vestindnis dor lkanisehen Vorgescichte (LK 1-2)» dang: Rogll Heer @
Ulich Busse, 6s, Vor Jess com Christus. Ohstolopsche Salen. Featgabe fr Hoffmann, Beta
[New York, de Groyte, 1998, p, 40422, a rami en cauye le fait que le propos pe Elisabeth
Le 142-45 annonces grosseste de Mae 13
10. Norbert Lonrov,« Dic Lieder in der Kindhlisgescictte bei Laka » (note 3), p39
«Die Handlangsunteroechong. durch oie Hyman (..] entepricht genan den aliestameniches
Parlelen»
(QUATRE HYMNES EN RESEAU 357
‘jaré "En fixant le nombre de pauses & quatre, Luc se donnait autant d’occasions
Ede jeter un éclairage latéral sur les faits exposés. Il entendait ainsi créer autant de
tieox de (re)lecture du récit » en son démarrage et, ce faisant, fournir au lecteur
les clés pour découvrir le sens dernier de la naissance de Jésus, du moins celui que
E iméme avait percu.
Aussi peut-on considérer que les quatre cantiques se présentent avant tout
F comme des réponses interprétatives & l'aveénement de Jésus visant & informer de sa
ignification profonde.
414 Un discours autorisé sur Dieu
‘Une des caractéristiques communes aux quatre hymunes est encore gu'ls par-
lent avant tout et explcitement de Dieu ®. Certes, la premitre strophe da Magni-
E ficat (Le 1,48-50) concemne également Marie, mais c'est essentiellement en tant
‘ue bénéficiaire de V agir divin. De méme, 2 I'intérieur du Benedictus, les v. 76 et
E77 constituent une prophetic au sujet de Jean-Baptiste. Et la personne de Syméon
f west pas absente du cantique 3 lui attribué. Il n’empéche. C’est bien la personne et
ection de Dieu qui sont mises en avant en ces cantiques™. Aussi peut-on égale-
tent considérer que Luc a utilisé ces hymnes pour mettre & honneur le person-
‘age principal de Vhistoire racontée qu’est Dieu et que, eu égard & son rang, il ne
tonvenait pas de mettre directement en scéne.
‘Meme si les cantiques définissent en tout premier lieu Ia figure et 'agir de
Dien, il n'est pas sans importance toutefois de noter que ces discours sont placés
1, Use compasion et nns poste par Robert Taxa, « The Magnificat as Peem », JBL
1, 1974, p. 263.275 « Viewed ints narative context, the Magrfies is Hike an ara in opers. The
_atticeceventons of opera allow te emmporer to op the ction a ny point 0 thal, throagh a poe
8 deeper awareness of what is
apening ray be achieved. A similar deep parcipaton inthe meaning of an event sade possible
by he placemen’ of his poem i Lake's narrative» (p- 65)
12. Crested a contibation a présen volume de Daniel Macias: «Le discos, ea de
B llectre do ect Actes 2c 26 » (tp. 395-09); voir ce sje Daniel Maxourxar et Yvan Bou.
a Pour lire es és bblgues.Pliation &analse narrative, PrstGeabvelMontal,Cr/Labor et
$FicsNovalis, 2002p, 112-119; « Dans anaratin bibigu, la fonction des pases es raremeat exe
‘qe, mais togjours wilt. [..] Lors d'une pause, mses action ne progres plus, la consis
foc di lcteur peut eugmenter de manieeappréciable. ..] La pause est dose ce moment ob le ma
f earpetfoornir au lecteur uns el de eture gui fra appeécir la pone du ci
13, CE Mark Coupon. The Birth othe Eakan Narrative. Navrate at Christology in Like I~
2 SITS 88), Sheffield, ISOT Pres, 1983, p. 163 p. 167
14.CF, Norbort Lorene, « Die Lieder in de Kindhsisageschichte bel Lukas» (ate 3), p.295-
596: « Man wird (.]kaum sagen kine, dass de ver Psamen der Charabeiscrang tree Sige
fincen od Singer disoen, ..] Im srengen Sinne charalserisiee wird dagogen or er
{gazae Ecahlung : dr bolsgeschichichhandelnde Got (.] Das ensprics |] dem Bafend inden
‘estamentichen Paalelen»,
358 DISCOURS ET RECIT EN LUC-ACTES (QUATRE HYMNES EN RESEAU 359
surles levees de persoanages des pls fiables, du moins dans la logique du moad Bthléem le projet divin de paix pour humanité en son enier (Le 2,14) ? Aussi
du récit lucanien : Marie, dont il est précisé qu'elle est l'objet de la faveur de Di peut-on considérer qu’en état, ces textes, en leur complémentarité, voire meme
(Le 1,28.30) ; Zachacie, dont il est dit qu'il parle sous Peffet de I’ Esprit Sai ‘eur progression’, offrent suffisamment d’éléments pour reconstituer en ses
(Le 1,67) ; Parmée oéleste, instance crédible par excellence (Le 2,13) ; Syni¢enegg f.srandes lignes le dessein originel de Dieu pour Israél, projet étendu, depuis la
présenié comme un homme sur lequel repose le Soufte civin (Le 2,25), Par aisance de Jésus, & Pensemble des peupes.
qualité des locuteurs done, personnes ou groupe hautement accredits, Luc dom MMA ~ Cp cecond constat venant confer le premier, il est done possible de consi
ainsi ces réactions de recomnassance qu soffent comme avant de Ciscoun AMM sie que, toot en consitaat separcaica des Elémeats bee mlesrse dave le
Dieu toutes les garanties d'une réelle eréaibilté b ccommencement narra», le Magnifica, le Benedictus, le Gloria et le Nunc
f dimittis ajoutent encore, & eux quatre, cette hautcur de vuc propre & mettre en pers~
petive les événements narés en transcendant & la fois le temps et espace”
Aussi convientil certainement de distinguer entre une fonction paticulicre de
F chacun de ces quatre hymnes et leur fonction collective, celle d’ esquisser par voie
de complémentarité le large arere-plan de I'ction rapportée en Le 1-2.
‘il revient assurément & ces quatre cantiques de souligner importance de la
> veaue de Jésus telle qu'elle est mise en récit par Luc dans les deux chapitres limi-
mires du troisigme évangile, ne leur est-il pas de plus confié d'initicr & leur
‘manidze la lecture de Luc-Actes en son entier ?
Mais & bien y regarder, ce dire autorisé au sujet de Dieu, malgré son fraction:
‘ement en quatre moments, n'est pas aussi éclaté qu'il n'y para
1.5 Une certaine complémentarité
Avec Norbert Lobfink, il est effectivement légitime de s*interroger pour
savoir sila récurrence d’un certain vocabulaire employé dans les hymnes, loin
etre foruite, ne révele pas au contraire une intention delibérée du narateur de
‘mettre oes textes en réseat. Ainsi, au nombre des liens lexicographiques significt-
tifs, om relevera, entre le Magnificat et le Benedictus: own / our:
(1,47.69.11) 5 rote (1,49.51.72) ; Bde0s (1,50.54.72) ; a.8b5 abro0 (154.69),
pemotiivas (1.54.72) ; kale Ekddnaev (155.70) ;* ABpadys (1.55.73) ; ente Je
Benedictus et le Gloria: wdkotou | bhous / eslovois (1,76.78 3 2,14) ; eigivn,
(1.79; 214); ent le Gloria et Ye Nunc dimitis: lpm (2.14.29); Bafa. |
(114.32); enfin, entre le Mune dimittis ot le Magnificat: 1485
Bodhos /Bo6n (2,295 148); owmiprov /ourp (2.30; 147) :"Toparh 22; «
1,54)
2. La fonetion des hymnes dans le contexte large de Lue-Actes
Arrivé au terme de ce qui se présente comme le « commencement narratif »,
lelertenr s’attend fort logiquement 4 ce que la suite du récit confirme ou recadre
Vinformation distribuée dans les deux chapitres liminaires'*. Aussi faut-il, en vue
‘apprécier plus particulizrement dans quelle mesure les cantiques concemnent
Fensemble de I'ceuvre, s‘interroger quant aux prolongements donnés dans le
somps de la narration aux thémes majeurs qu’ils activent. Ds lors que sera vérifiée
Js reprise conséquente de quelques motifs saillants du Magnificat, du Benedictus,
fF du Gloria et du Nunc dimiitis en Luuc-Actes, nous chercherons encore i établir de
quelle manigre et & quelle fin ces hymnes veulent guider la lecture de I'éerit 2
ThEophile
Si V'hypothése d'une connexion entre les quatre cantiques se voit dené,
encouragée par ce relevé, sans doute peut-on I’appuyer sur une autre observation
encore, portant cete fois sur les contenus. Il apparaft en effet qu’d eux quate, ce
hhymnes esquissent a grands traits la trame méme de Ibistoire du salut. Par leu
intermédiaize, un arc sotcriologique est de fait tendu, par-dela Ihistoire raconé:,
cnire cet instant fondateur d'une promesse faite Abraham (Le 1,55.72-73) eee
‘<1maintenant » eschatologique (Le 2,29) inauguré par la venue de Jésus. Nesta
as précisément pour ce salut préparé (Le 2,30) par le Dieu sauveur (Le 141). 9
depuis le serment prété au patriarch (Le 1,73) et maintenant incarné en Fésus que
Dieu est glorifé parla multitude de Marmée eéleste reconnaissant en V'enfant né 16. Mak Cousot, The Birth ofthe Lukan Narratve he 13) p18,
17. Ave Norbert Loum, «Die Linde index Kindigpchict boi Lakes » goto 2)p. 397
39s: «Die ver Hymmen scheinea kesesweps gunz eigenstncig 2 sei. Sie baven Vietnehr aun
ander au wed fen einandr weiter [.] Obwohl so dufebaus Tele der eeetten Gosche snd,
fut in nen offetar noch em egens Austagoprogramm ab, dis gegenber dem aaravea Pro.
sranm der Legenden ein goss Unabhingiei bet
18, Cf, Rober C, Tasema, The Nara Unity of Lid Ac(ote 15), 2 eB. Gui
F Me Gospel af Lake (oot 8), 9.48.
CE. idem, p. 399-400. Le ee ewployé par ase ex celui de « Verkettung », Dsus
comsmeatcurs ont pas manqué de souigncr le Hen eat les dents ymues. Aisi Robt ©.
‘TaswcnL, The Narrative Unie of Lake-Acts. Literary Iaerpretaton, vol. 1, Philadelphia, Frwes
Press, 1986, 31-32; Raymond E. Drown, The Buh of te Messiah (ooie 6), p. 391; Sepia
Faun, The Hymns of Lake's Infancy Narratives (ote 2), p
360 DISCOURS BT RECIT EN LUC-ACTES (QUATRE HYMNES EN RESEAU 361
2.1 Quelques themes activés par les kymnes Pareillement, il n'a pas échappé & attention des commentateurs que l’accl
F nation de la multitude de l'armée oéleste en Le 2,14 (B6Ea év infioro.s Bed rat
2a yis clpfyn) trouve un écho dans celle de la multitude des disciples en
F Lc 19.38 @v obpannp el prin xal 88Ea év WYlorois). Mais la délocalisation de Vet
‘7m en ce second passage ~ au ciel et non plus sur la tere — est significative dun
recadkage, ¢aillcurs explicitement annoncé en Le 12,51 — Soxetre 811 eiprvey
rape yev6yiny Boivat 2v 774 5 obxL, Myw Outv, GDN Srapepiopsy ~ et trans-
bparissant encore clairement de la plainte de Jésus sur Jérusalem en Le 19,41-44.
En ce demier épisode, on observera que le vocabulaire de la paix (ra. npos
ipfumv), & nouveau repris sous forme négative, est encore associé A deux themes
<&ja 6voqués dans le cantique de Zachati, ceux de la visite de Diea (Le 1,68.78)
G ct de la présence des ennemis (Le 1,71.74). Une fois encore, force est de constater
F coc les hymnes de Le 1-2 préparent la suite du récit en amoreant des motifs qui
seiontexploitésultérieurement.
+ Caractéristique également, pour prendre un demier exemple, est le theme du
F reaversement des positions abordé par le Magnificat (Le 1,52-53). Avee Robert C.
‘Tannchill en particulier, on notera qu’il connait de multiples variations dans I’évan-
dil, le récit de la manifestation publique de Jésus composé par Luc offrant de rom-
ress illustrations de ce principe énoncé fort 6 parle premier des quatre cantiques.
Ces quelques observations, & elles seules, sont certainement suffisamment
antes. Elles fondent ’hypothése d’une insertion raisonnée des hymnes dans le
des événements initiaux et justfient le présupposé dun rOle 4 eux confié
out imputser fa Iecture de Luc-Actes en posant quelques jalons importants
Les exemples de motifs introduits par les hymnes et permottant de conclu:
leur earactére préparatoire peavent certainement étre multipliés. Contentons-not
pour nous convaincre que les cantiques Incaniens fonctionnent bien comme tine
introduction spécifique & lintétieur de Vintroduction générale de [’eeuvre & Taé
phile, de relever quelques-uns de ces themes parmi Jes plus démonstratifs,
a souvent été remarqué que, par wn subiil effet de surcharge & la fin
second stique, I'exorde du Magnificat (Le 1,466.47) metait en avant la qualité
‘ump reconnue & Dieu®. Etant donné que ce premier titre donné & Dieu ne
plus uslisé ailleurs dans la narration lucanienne, sinon pour qualifier & (oj
reprises Jésus (Le 2,11 ;Ac 531 ; 13,23), on est certainement en doit de sin
roger sur la portée de son application cafactérse-til uniquement I'agi en faveu:
de Marie ou connote-til, de fagon plus extensive, l'ensemble de initiative divine
rapportée en Luc-Actes ? De fail, trois arguments plaident en faveur de
deuxitme solution. Tout d’abord, il est &relever que le Magnificat lui-méme intr,
prtte le regard posé sur Marie comme les prémices de l'aide apportée paz Dita
Israél en général (Le 1,54-55). Ensuite, on notera que les trois autres hymn
embrayent encore sur cette tonalité sotériologique du projet de Dieu, le
Benedictus faisant un tiple usage du substantif owrnpta (Le 1,69.71.77), ten
relayé en Le 2,14 par celui d’elptun™ et en Le 2,30 par celui de ourpioy. Eni,
Vreffet eréé par la distribution en Luc-Actes des trois seules occureaces
‘nurrfp.ov vient confirmer Vamphnade du « nom de r6le + donné & Diet
1,47. Car V'inclusion significative établie entre Le 3,6 et Ac 28,28 a I
expression 78 gurripiov To co, précisément préparée par le cantique de
Syméon, laisse suffisamment entendre quel est lobjet principal de la narrtic
lucanienne. A Pévidence donc, Luc aura voutu souligner, non seulement pat.
Magnificat, mais par les trois autes hymes encore, la dimension priostiemest
salvifigue du dessein de Dieu manifesté par 'avénement de Jésus, ce qu'il ai
de cesse de rappeler tout au long de son récit.
22.Un programme de lecture pour l'ensemble du récit
Qu'il nous soit a nouveau permis dilustrer par quelques observations seule-
ment Comment le Magnificat, le Benedicus, le Gloria et le Nunc dimittis cher-
E cheat & préparer la lecture de I'euvre a Théophile en livant certains aspects de la
Bsatcpicd’écriture de Lac.
19. Stephen Fass, The Hymns of Luke's Infancy Narratives (aote 2) . 181: «lke
‘reasonable to suppose tha the evangelist place them [a savoir le Magrifea, le Benedict ele Na
lis) ste head of his work because thoy const themes which would reappear ltr in is my
‘ings... Two such themes or mons ate preminest i the hymn andi Lake-Acts st 2 wie. Th
‘ae 1, promise and fulment and 2 the restoration of sae » 8 aoter la etque juste de Uli
Mira Ricnear, Magniftas und Beneditus (not 2), p. 238, 0.30: «Trot iret AUST
fattuschen [..] Faris’ AusfUlmungen ur” Redewtung ‘der Hyminen im Kort
Tukasevangetocs
20, Ains Joo! B. Gasen, The Gospel of Le (ete 8) p22.
21. En ce context précis, iim a une conctationsotésologique,
22, expression est de Ja Devon, DBS X1, cal 31
GB Robert C. Tasunmu, The Narrative Unity of Luke-Acts (ate 15). 30, selBve les passages
f lvani : Le 620.26 ;924.46-48; 1021 5 12,1-3 5 1325-30 ; 14,711.16 24 16 14-15.19.31 ; 189-
14; 2046-47 :2224-27 of. Lake Towson, The Gasp of Luke (Sacra Pegina Serie 3), Caloge-
Fle, Limrgieal ress, 1991, . 44
28, Avec Ralner KAaguNG, « Gepieson se der Her der Got Ioaes. Zur Theatre Yoo Lc I=
2x, das : Thomas SOONG, é., Der lehendige Goer Studion tur Theologie des Newen Testaments
Retuchrt fur’ Thusting ium 7S. Gebursieg, Munster, Ascbeadorl, 1996, p. 189-179
‘Magnificat, Benedicrus und Ne dimizs sind an bervoragendzr Sele der Handlang pazere Det
est di, das Gescbehene hommenterend, afin de erzlien Zeit Zakunfiges verweisea und dese
inerpesicead vorbciten, We de Kindblsposcicheen insgesa haben seein wich Funktion
‘ire Leung der Rezeption der Laser » (p.158).
368 DISCOURS ETRECIT EN LUC-ACTES (QUATRE HYMNES EN RESEAU 365
ache, outre d’accentuer la signification décisive de la venue au monde de Jés
Jignent chacun & leur facon et de maniére complémentaire la finalité sotériolo-
de mettre en place certains signaux en vue de guider 'acte de lecture. ='i8 ee se 1430:
Eique de la venue de Jésus (ef. Le 1.47.69 ;2,14,30 3,16 ;4,18-19.21 :Ac2,22b ;
26; 4.12 530-31 ; 7.52 ; 10.36.38 ; 13,23-26). Aussi estl possible de consi-
Eze que le Magnifcay, le Benedictus, le Gloria etle Nunc dimittis posent dans la
jamation les premiers jalons devant permettre au lecteur de repérer Ia logique
‘i FHP serative des événements successits rappomés en Luc-Actes. En pointat ds le
ue loo! Masia Benes, Gloria le Nanci peo ME emnencenent durex Ttporiane Coo Ge a nastane 8 See, c=
ar Tens pour de seus omemenis du réit en son déearage, que nous 16MM cniqus contibuent c= fsa la mise en perspective de la narration dv minis
Freeney ciation calcalés dens I «consnencement nara» de Tv AME republic de ess ct da tmoignge i end, ete fenstion ¢oietaton da
‘Reem gant aman de wear LT berate fo ge MMM etre ant rele ls Lin ats icons bus Jean-Baptiste Le 3.16
Aletti, peuvent ici étre reprises avec profi, larguerat et Jean-Noal 44), A Iésus (Le 4.21b23-27), a Pienre (Ac 2,14b-36.38b-39 ; 3,12b-26 ; 4,9-12 5
"SABE 5290-32 ; 10340-43), a Etienne (Ac 7,2-53) ou Paul (AC 13,16b-1).
3.Les hymnes et la technique de composition de Lue
21 Lami en place ners oma de conrae nit eacsees A o sanenn oeapente
Alors qu’il s*appliquait 4 établir ’homogénéité des dew i s :
: x emis cat
do winrar i es de rons pb
tenu par Hans Conzelmann®, Paul S. Minear avangait entre autres argument
celui d'une fonction relativement apparentée des cantiques de Le 1-2, des dig
on Lok pense tr de Jean et de Jésus en Le 3-4 et des discours des Actes!
Sar gd comic de Sie en ae ae eran Ace
difficile de contester que ces éléments spécifiques du récit Tucanfen veulent os
sw teen po Se cones ean ou ase ee of
exposé par Luc tout au long de sem eenvre™. En particulier, et ”eot 1a le dénomi
E Le fut qu’en lear contexte étroit les quatre hymnes posent une parole inter-
grave apcts Faction rapportéerévéledentrée un autre procédé de composition
fe Luc, & savoir lenchatnement acte/parole. Celu-ci est ainsi analysé par Daniel
/Marguerat : « Les familiers de I’ euvre & Théophile se rappelleront la succession,
‘ontumitre sous 1a plume de Iauteur, de Taction et du discours : Pévénement
B vicat d’abord, puis la parole qui en élucide le sens [...] Passer de l'implicite &
FTexplicite, de 'évenement & la parole qui en fait lever le sens, de Vambiguté de
F Thistoire 8 la parole qui nomume Dieu, n’est-ce pas le scénario anquel invite Ia nar-
ateur commun qui nous paait e plus prégnant ene tous ces textes singuli ke gage ston lucanienne ? Ty 2, dans ce mouvement du xéct qui revient sor Iui-meme
REERE pour nommer ce qu'il vient de montrer, un engendrement de la parole
théologique »™.
Dis le « commencement narrati’> donc, par les hymnes qui, comme novs
F Vavons relevé, nomment explicitement Dieu en tant qu’inititeur et maitre de
action, Luc aura voulu proposer 8 son lecteur un itinérare balisé dont il soignera
-femarquage pour que soit maintenue en éveil cette conscience vive du Diew qui
F cave. I manifestait ainsi d'enteée un sovei d’ofrr, par des textes saillants, les
F ements nécessaires & Pinterprétation des fats rapportés pour que ne soit pas
F perdu de vue le dessein uniiant et conducteur de Die.
29, Hans CONZELMANN, Die Mitte der Zelt. Studien zur Thealogic des Lukas (Beitrige an i
‘tischea Theologie 17), Tubingen, Mobi, 1977, p. 109 et 160, : . sh
30, PaaS. Maven « Die Funsion der Kndbiseichietn Werk es Lula» das: Ge
BrauMmann, 6d., Das Lukas-Evangelium. Die redaktions- und kompositionsgezchichtliche For “tt
Dams Wisenechaitiche Ductarclicha, 197, paOtees Se lt sch ee Bee
egrets Vorwealeca cnc den Lobgesdazen in den beiden Anfangskapitein, den programm
tschen “Anstieden™ des Tafers ud Joss in Lk 3 sowie den Raden Ger Rpaelpece
feststellen » (p. 211). eae hy
31-Ct Daniel Mascuatat,«ne-Aces ne wit consi» dans: JouetVexreoes,
‘The Unity of Luke-Acts (BETHL 142), Leuven, University Press, 1999, p. 57-81 “
52. C4 Reker. C, Hower, The Narrative Un of Lite cs (ot 5). 2: «Like Ace
los patil poits te nat of Gas purpose wich este earth We wl nt eB
Towing marl prclary help in sept the angelic mmouteees ad popete bys
the birth naratne dhe qutaion fom Isiah i Lake 34-6 and 218-19 L] Sen nie
‘Seouncements ad announcements of is iaminetexaleion (Lk 20472-52269); ad es
"ei of eet a rv fang eve nak 24 Tec dts reno
fers in ng ling the central elements of the plot and in intespreting them as part :
‘Purpose of God ». 7 plot and in interpreting, the part of the:
G23. Daniel Manconnar, «Le Dieu dos Actes », dans: La promiére histoire du cristianiome Les
‘Actes des apres) (Lect divina 180), ParivGenbve, CeitfLabor et Fides, 2005p. 131. A ce sujet,
fevoos tvec Latent Por, La rhtoriqe dans UAntqute(Livte de poche 533), Pas, Librairie
K Gentale Francaise, 2000, p. 37 «Si Talterance enue seit ct scours cit teitionnele pais
\egopé, Thucydides e premier & far du discours un instument analyse historic, [Le ds
tous est pour ui non seslement un fit de saci et une forme itera 2 prague, mais, bien plus,
te ole dea vert
MNES EAU 307
366 DISCOURS ET RECIT EN LUC-ACTES ‘QUATRE HYMNES EN RES
fos, celui de 'ajout d’un hymne dans le récit (Ex 15 ; Dt32;Jg 551822822;
Jon 2)". Bt ceci avec un art maftrisé,
ee
é entre le Magnificat, le Benedictus, le Gtoria et le Nune dimittis, Luc ct es
oe ee ee
F cation sotériologique, qu’a préparer la lecture de son ceuvre en son ensemble,
si et de leur contena, les quatre hymanes
Si done, da point de vue de leur forme et de leur cont <
Imaniens emnent un place 2 part dan sit Théopil, curl plan de le
fein, is relevent d'une echniga de composition qs reroave dans ati
sation des éiseours, En cela ils imitent un mode d'expositon ob une place aon
sétligeable est faite des pauses intrprétatives wahissant le souei d'une juste
comprehension de I'événement particulier suc 'ariere-plan étendu du dessein de
Dieo. eat
, ‘we de Teur fonction,
Aussi concluons-nous, qu’approchés du point de vue 4
F Magnificat le Benedictus, le Gloria et le Nunc dimittis apportent assurément une
© part non négligeable @ la découverte dela strategie &’écriture de Lue.
3.3 Le choix d'imerpretes spécifiques
Enfin, on notera qu’en prétant & Marie, a Zacharic, & I'armée céleste put
} Syméon ces réactions louangeuses, c'est 4 des Voix qui se tairont ensuite qié i
Lue confiait linterprétation du faire de Dieu en son commencement. Coit
le signale Jean-Noél Aletti®, ce réle qui consiste & déterminer le sens des 6vé
ements sera ensuite dévolu a Jésus, ce qu’annonce d'ailleurs déjb Vépisode
intermédiaire de Jésus au Temple & I'age de douze ans (Le 2,42-51), Plus ig
dans la narration, c'est encore a d’autres témoins privilégiés qu'il reviendia
ce commenter les faits,& Pierre, 4 Etienne ov & Paul. Aussi constate--on qi
Pour chaque période de histoire racontée, Luc concevait non seuleneat
Grautres vokx interprétatives autorisées, mais encore d'autres formes dexpres:
4.Bilan
jenquéte que nous nous sommes proposé de mener n'a pas été conduits
Join sen fan, & on terme, Bien des éléments restent encore & verifies, d'autes 2
Pistes sont a sonder. Les premiers résultats, sous réserve de leur pertinents
‘ncouragent toutefois & poursuivre I'exploration, Car il semble bien que lise
tion du Magnificat, du Benedictus, du Gloria et du Nune dimittis& ta place gut
est la leur dans Ia narration lucenicone ne doive rien au hasard. tout lanse ny
Contraire penser qu’unc intention réfléchie a décidé de leur enchassement dans
Je « commencement narratif » de Veeuvye & Théophile, 2 ite individu et ol
lect
En cherchant 2 imprimer aux deux chapitres introductifS de son wuvre le
caractére de I'Ecriture dont il entendait vraisemblablement rédiger une suite™
Luc ne s'est done pas contenté miter un siyle™, mais il s'est encore inspite an
DProcédé vétérotestamentaire, certes peu courant, mais suffisarament attesté toute
34 JeaneNeel Aus, Quand Lac raconte (note 26), p. 24: « [Lee] prophtes cess sou
fore de voix, de visions ov de congss sont rassimes ea Ls, qvilescanlonne a sels Gpsotcna 3
Us 4a nsisance de Jean-Baptiste et de Kets (Le 15-2.14). Dts le moment oa Jésus eens or
Iiniore pre le clas de> voix angligus: cei i ~ et i seul gu angouce los cern
cen determine Ie sens»
35. Nous avons exposé noe avis dans: Daniel Genaex, «Lic 15-25 la pourwite d'un tg
vaokbve » nate 23),
36, Limitation du grec dole Septaneen Le 1-2 a souvent rele cpa exemple Fewsus
©. Fesacitat, «The Imitation ofthe Septuauin ia Luke's Infancy Navatnee's PIBt 1S oop
PSe78,
? cians
meron dis pols cones long dae Ane ements.
Fou, Commer ie tert bbl Une rmastonpratee sire Rosen Dy
Besa Lesion 9 p95,
Vous aimerez peut-être aussi
- STEINMETZ D'une Table À L'autre - La Liturgie de La Parole Dans Une Dynamique EucharistiqueDocument9 pagesSTEINMETZ D'une Table À L'autre - La Liturgie de La Parole Dans Une Dynamique EucharistiqueDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- MARGUERAT 2017 Luc Historien de Dieu Histoire Et Theologie Dans Les ActesRB1-2 - 2017 - PP - 007-038 - MargueratDocument33 pagesMARGUERAT 2017 Luc Historien de Dieu Histoire Et Theologie Dans Les ActesRB1-2 - 2017 - PP - 007-038 - MargueratDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Husser Pages 190 Et 212Document2 pagesHusser Pages 190 Et 212Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- L'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 8Document16 pagesL'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 8Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- L'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 5Document17 pagesL'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 5Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- L'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 2Document14 pagesL'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 2Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- C2 - Saisir Sa Comptabilité Dans LoGeAsDocument78 pagesC2 - Saisir Sa Comptabilité Dans LoGeAsDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- L'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 3Document15 pagesL'herméneutique - Cairn - Info Chapitre 3Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Bibliographie TDNTDocument2 pagesBibliographie TDNTDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Enzo Bianque Qu'est-Ce Que Le Dimanche RSR - 051 - 0027Document26 pagesEnzo Bianque Qu'est-Ce Que Le Dimanche RSR - 051 - 0027Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Annales 2022Document23 pagesAnnales 2022Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Chelcea RodicaDocument509 pagesChelcea RodicaLucia UrsuPas encore d'évaluation
- Biographie de Luther Brentano 2 de 4Document14 pagesBiographie de Luther Brentano 2 de 4Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- L'herméneutique - Cairn - Info Cha 01 CouvertureDocument2 pagesL'herméneutique - Cairn - Info Cha 01 CouvertureDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Traditionis Custodes 16 Juillet 2021Document8 pagesTraditionis Custodes 16 Juillet 2021Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Boef Le RiteDocument30 pagesBoef Le RiteDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Documentation ScienceshumainesDocument2 pagesDocumentation ScienceshumainesDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Biographie de Luther Brentano 3 de 4Document18 pagesBiographie de Luther Brentano 3 de 4Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- BibliothequeDocument6 pagesBibliothequeDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Biographie de Luther Brentano 4 de 4Document12 pagesBiographie de Luther Brentano 4 de 4Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Plan Jérusalm 4ème SiècleDocument1 pagePlan Jérusalm 4ème SiècleDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Inventaire État Détaillé Mobilier-DefDocument10 pagesInventaire État Détaillé Mobilier-DefDaniel CARLANA100% (1)
- 05 Reduction Et CartesianismeDocument26 pages05 Reduction Et CartesianismeDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- 08 Je Pur Et Rein de PlusDocument32 pages08 Je Pur Et Rein de PlusDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Sciences ReligieusesDocument6 pagesSciences ReligieusesDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- 12 Bibliographie GénéraleDocument16 pages12 Bibliographie GénéraleDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- LUC-ACTES EAD Fascicule 2019-2020 t2Document110 pagesLUC-ACTES EAD Fascicule 2019-2020 t2Daniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Initiation À La Poésie LatineDocument3 pagesInitiation À La Poésie LatineDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- Liste de Lectures Coplémentaires Philippe PélicierDocument1 pageListe de Lectures Coplémentaires Philippe PélicierDaniel CARLANAPas encore d'évaluation
- 10 Statut Et Signification de La Affectivite Et La ValeurDocument36 pages10 Statut Et Signification de La Affectivite Et La ValeurDaniel CARLANAPas encore d'évaluation