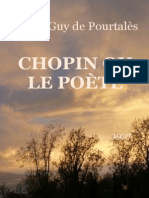Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Sarraute Digraphe
Transféré par
Jean-Marie Suc0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
85 vues35 pagesNathalie Sarraute - Dans la revue Digraphe
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentNathalie Sarraute - Dans la revue Digraphe
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
85 vues35 pagesSarraute Digraphe
Transféré par
Jean-Marie SucNathalie Sarraute - Dans la revue Digraphe
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 35
-DIGRAPHE.
AUJOURD’HUI
NATHALIE SARRAUTE
AUJOURD’HUI NATHALIE SARRAUTE
Introduction ch
Conversation avec Nathalie Sarraute 9
Nathalie Sarraute : Paul Valéry et l'enfant d’déphant 20
(texte intégral de 1946)
Nathalie Satraute : Le gant retourné (1973) 52
Nathalie Sarraute : Le bonheur de l'homme (1970) 59
Hector Bianciowti : Nathalie Sarraute 66
Monique Wittig : Le Hew de faction 70
Marianne Alphanc : Nous #’éerivoms pas encore 77
John Sturrock : England ? L'Angleterre ? Hein ? 86
Maurice Nadeau : L’évolution du roman (1956) 93
Post-scriptum 1983 98
Matthieu Galey : Sofstaire dans sa recherche... 99
Gerda Zeltner: Quelqgues remarques sur «l'art
dramatique » 103
Pierre Soulages : Encres inédites (hors texte)
Un discours autour (enttetien) 110
Repéres biographiques 129
Bibliographie des ceuvres de Nathalie Sarraute
Quelques ouvrages sur Nathalie Sarraute
Ce numéro a été dirigé par Serge Fauchereau
Aujourd’ hui, Nathalie Sarraute
Ce numéro est consacré @ Nathalie Sarraute qui, avec Francis
Ponge, Jacques Derrida et quelques autres écrivains, est un de ces
ainés auxquels Digraphe a toujours été attentif, sans pour autant
oublier sa vocation de tribune pour les recherches des plus jeunes.
Bien entendu, la littérature n’a pas d'age et les questions posées
par Ia romancitre ne nous Cloignent pas de cet objectif. Premier
numéro d’une revue francaise entiérement dédié &@ Nathalie Sar-
raute, il ne s’agit pas ici d’un hommage mais d'une réfleaon sur
une oeuvre, une pratique.
Nos remerciements vont aux romanciers, aux critiques francais
et étrangers qui nous ont aidé d le composer, @ l'auteur des des-
sins, Pierre Soulages dont il a par ailleurs semblé intéressant de
reproduire, hors texte en quelque sorte, les réflexions sur ce que
représentait, du point de vue d'un peintre, le commentaire ajouté
a une cwuvre plastique, littéraire ou antre.
Notre gratitude va & Nathalie Sarraute qui nous a fait con-
france et nous @ laissé reproduire des textes rares jamais repris en
volume. « Réflexion sur le bonheur» est inédit en francais et
« Paul Valéry et l'enfant d'éléphant » n’avait paru qu'une fois, en
version abrégée, il y a prés de quarante ans ; il est bon de relire,
restitué ict @ son intégnité & partir du manuscrit original retrouvé,
cet essai qui avait causé un certain émoi en son temps, comme
une legon toujours valable contre les canonisations incondition-
nelles et intempestives de la critique.
Quant au dernier mot, il appartient évidemment au lecteur.
S.F
"Aen, da, Au ert oes Avchd 4m, <
mal tliat“ $e PA gr
Le ! ~ Shree
. A Bet BIG,
- ta, . . “Baek , tak trernok 4, ~la”
2 -. a pera a
Yeh, har Ahesh le Avekhy” “Brn, Hy
de frrver Per GRY ts parol, pre,
hear Ol haha frie gm G Aes
a Art gue effatee... 10 te te, K yo.
Pn Pte ode Mo ane feure He
fee dete “HEE 2, po A aseg
Gh elon Akh, ad ure Phe form
ob noes pet hge on g Eetertey net ante,
Be regres —erkar—2P—gtn fe Lire: A100,
7 : ta feu
On ou oe ant er a # Ae
9 re tg
SERGE FAUCHEREAU — JEAN RISTAT
Conversation avec Nathalie Sarraute
S. Fauchereau — On répete volontiers que tropismes, c'est syno-
nyme de Nathalie Sarraute. Je me demande si ce n’est pas une vision
simplificatrice. Il est vrai que c'est trés lié 4 votre travail depuis le
début. Je crois que c’est dans le texte liminaire de L’Ere du soupgon
que, tevenant sur ce terme, vous expliquez que vous avez ressenti ce
type de relation dés |’enfance ; et il m’a semblé voir dans le livre
Enfance une sorte d’attention 4 cela. Comment expliquer que cela ait
pu étre ressenti dés l’enfance ?
N. Sarraute — Plus tard, en y repensant, je me suis dit qu'au fond
je sentais ces choses-l4 assez fortement depuis l’enfance. Mais évidem-
ment, quand j’étais enfant, je n’en avais pas conscience. Je ctoyais que
je Vavais pensé beaucoup plus tard, en écrivant Enfance, en voulant
écrite Enfance, et vous me dites que je l’avais déja écrit dans cette pré-
face. Done j’ai dd me dire en l’éctivant : mais au fait, j’ai toujours été
sensible 4 ces sortes de sropismes, ils font pastie de l’univers ott j’ai tou-
jours vécu. Ce terme, tropisme, était un pis-aller. Je cherchais pour mon
premier livre, un titre qui puisse évoquer tant bien que mal toutes ces
sensations indéfinissables et, 4 |’époque, sropisme était dans l’air. Je
Ppensais qu’il pourrait s’appliquer 4 ces sortes de mouvements instinctifs
qui sont indépendants de notre volonté, qui sont provoqués par des
excitations venant de l’extérieur. Ce mot est rest€ attaché 4 tout ce que
j’éctis ; je ne m’en plains pas parce que, finalement, dés qu’on !’oublie,
comme c'est attivé a des critiques, on commence 4 chercher dans mes
ouvrages quelque chose que je n'ai pas essayé d’y mettre. On voudrait y
déceler, par exemple, une peinnure de caractéres, une intrigue, une suite
d’événements ; et moi, je n'ai cherché qu’a rendre ces mouvements. Je
n'ai choisi dans Exfence que des souvenirs dans lesquels existaient ces
mouvements. J’ai encore, par exemple, des souvenirs tts précis de la
campagne. Mes parents allaicnt toujours en Beauce, dans une ferme o0
ils louaient des chambres ; nous prenions nos repas avec les fermiers. Je
devais étre agée d’une dizaine d’années. J’y allais avec ma belle-mére
pour de courtes vacances, au prinremps, pour les congés de Paques, de
la Pemtecéte. C’était quelque chose de merveilleux. J’ai essayé de l’évo-
quer. Je n’y artivais pas ; toutes les images ressemblaient 4 des images
d’Epinal : la ferme, les canards, les lapins, la cressonniére... Tout cela
éveillait chez moi, au point de vue du travail litéraire, un ennui, une
impression d’impuissance... J’ai di renoncer. Mais lorsque j’ai voulu
faire revivre mes vacances en Iséte, les images se sont animées ; il y avait
42 une sorte de mouvement, de vie, qui permettait 2 la forme de
bouger. J'ai ainsi di laisser de cété quelques souvenirs auxquels je
tenais. Je n’éctivais pas une autobiographie dans laquelle je devais
Faconter tout ce qui m’ était arrivé. Une forme n’est pas « travaillable »
pour moi si elle manque de mouvements intérieurs. Les descriptions
extérieures ne m’intéressent que si un mouvement, une vibration, les
parcourt, qui peut passer dans I’ écriture.
S. EF. — Puisque j’en suis 4 évoquer des choses qu’on rappelle tou-
jours 2 votre propos, liées au tropisme, il y a cette image du film raleati
que vous avez vous-méme utilisée pour expliquer certaines choses. Or,
justement, votre lecteur n’a pas du tout cette impression de film ralenti
Jorsqu’il vous fit. Alors, est-ce qu’il n’y a pas 12 quelque chose oli, par-
fois, on fait un contresens ?
NN. S. — C'est possible. Je cherche 4 montrer, en le développant, ce
qui se passe en nous en quelques secondes. J’ai parlé davantage de mon
travail que de |’effet qu’il produit sur le lecteur. Je suis obligée, quand
je travaille, de regatder comme on tegarde un film au ralenti et de
trouver des images qui pourtaient évoquer les différentes phases du
mouvement qui est en train de se développer. Dans 1a réalité, tout se
passe en quelques secondes. Je prends un exemple dans mon demicr
livre : aprés avoir contemplé une poupée de coiffeur, je dis 3. ma mére :
« Elle est plus belle que toi, je touve qu’elle est plus belle que toi » ;
ma méte me répond : « Un enfant qui aime sa mére trouve que pet-
sonne n'est plus beau qu’elle. » Tout s’est passé trés vite : le temps de
le dite. Je suis obligée d’ouvrir ce moment pour voir comment nait et se
développe en moi le malaise que cette réponse a provoqué. Je suis
obligée de le décomposer, exactement comme on décompose, par
exemple, fe mouvement d’un cheval dans un film au ralenti. Dans mon
travail, je cherche & revivte les différentes phases de tous ces drames.
Mais chacune d’elles est évoquée par des phrases qui, elles, devraient
étre rapides, fluides, bouillonnantes comme ces mouvements qui se suc-
cédent trés rapidement ct méme se produisent en nous en méme temps.
S. F — Ce que je voulais dire, c’est que V’effet de ralenti est au
niveau du romancier et non pas du lecteur.
N. S. — Le lecteur, je l’espére, a Villusion, qui ne correspond pas 2
Ja vie « réelle », de ressentir, 4 mesure qu’ils se déploient, ces mouve-
ments que, dans la vie dite « réelle >, 1 sent globalement. Hl faut faire
fessentir au lecteur ce qui s’est passé en quelques secondes. Je suis
obligée de le revoir comme au ralenti et au mictoscopc, de trouver des
images qui donnent des équivalents de ces sensations. Mais dans Ia vie
courante, il aurait semblé qu’ il s'est passé peu de chose, 4 peu prés rien.
On ne décompose pas les mouvements dans la réalité ; on n’en a pas le
temps. Mais, quand on me lit, j’espére qu’on a |'impression que ce
drame qui est en twain de se dérouler, ce gui se passe, est téel. Mais la
vie « courante », ce réel, on ne le voit pas. On n’a pas le temps de le
voit.
S. & — On n’en est pas conscient... ?
N. S$. — On le sent vaguement, globalement. Ul faut un énomme
travail pour arriver 2 le retrouver.
S. F. — Justement, ces mouvements, que vous venez d’évoquer : la
poupée de coiffeur... Lorsqu’on se reporte 4 d'autres de vos romans,
Martereau tourne autour d’une discussion pour |’achat d’une propriété,
dans Le Planétarium, il s’agit d'une poignée de porte de la tante
Berthe ; dans Les fruits d'or, on discute d’un livre dont le contenu
importe peu ; dans Vows les entendex ? on parle d'une statuette dont
on se demande méme si elle a un rapport avec le sire des enfants qu’on
entend... Donc, il s’agit presque toujours de quelque chose d’apparem-
ment, au moins, anodin, et je me posais cette question : il s’agit donc
volontairement de choses banales, quotidienncs, mesquines au sens pre-
micr, mais imaginerait-on la méme chose avec |’étude, par exemple,
d'un général ou d’un chef d’Etat qui aurait 4 déclencher ou non une
guerre ? C’est-A-dire une chose peut-étre ués grave. Du déclenchement
d'une guerre 4 une poignée de porte.
N. $. — Ce qui m’intéresse, c'est l’apparence banale, anodine, le
cété invisible. Personne ne le voit et j'ai envie de dire : mais regardez,
regardez, ouvrons-le, cet instant, et voyons ce qu’il révéle. Ce qui se
passe sur un champ de bataille, tout le monde pourrait le voit ; pour
Pappréhender, on n’a pas besoin de mes instruments qui essayent de
plonger un peu sous le visible ; 14, le visible et la réalité collent Pun a
autre. Lorsqu’on décrit la bataille d’Austerlitz, on n’a pas besoin, a ce
moment-la, de voir tous ces mouvements intérieurs qui, d’ailleurs, me
semble-t-il, ne peuvent pas se ptoduire quand on est en pleine action.
5. F. — Je ne pensais pas 4 la bataille elle-méme. Je pensais 4 ce
qui se passe avant la bataille. Doit-on, ou non, déclencher la guerre ?
N. S. — On se trouve 13 au niveau de ce qui est déja trés bien
connu, qui est de l’ordre de ce qui a été trés bien décrit. Moi, j'ai tou-
jours Villusion que ce que je m’efforce de montrer, c'est ce qu’on ne
voit pas. Ce qui ne se voit pas et qu’on ne peut faire voir, justement,
qu’au prix de ce travail ; je ne me propose pas de faire une découverte
psychologique mais de trouver une forme qui ne peut devenir vivante
que si qu’elle est poussée pat quelque chose qui n’a pas encote été pris
dans une forme préexistante. Les grandes actions, les grands mouve-
ments psychologiques ont déja été admirablement pris dans une écriture
par les grands écrivains du passé. Mon écriture ne peut vivre que si elle
est poussée, traversée par quelque chose de fluide, d’encote intact, qui
se chetche, qui tremblote... c’est cela qui m’intéresse, ce qui peut com-
muniquer 4 ma forme cette vibration qui la rende vivante. Lorsque je
voulais décrite la campagne, c’était mort. Une sorte de copie d’enfant :
la forme était plate, morte...
S. F — C'est cela: il n’y a pas d’importance, finalement, qu'il
s'agisse... d’une poignée de porte...
N.S. — ... Ga n’a aucune importance. L’achat d’une maison, par
exemple, dans Martereau, n’est qu'une sorte d’inttigue extérieure. Ce
qui m’intéresse en réalité sous cette apparence extérieure, la recherche
d’une maison ou ce personnage traditionnel, Marfteteau, ce sont ces
mouvements intétieurs que j’appelais tropismes et qui peu & peu enva-
hissent aussi Martereau. A la fin, le personnage se désintégre.
S. F. — Cela rejoint alors le souci que vous avez presque toujours,
de ne pas donner aux petsonnages des noms ou, dans certains cas, des
noms tout 4 fait ordinaires. ..
N.S. — Seul Martereau avait un nom, comme Dumontet dans Por-
trait d'un inconnu, patce qu'il était « le personnage » vu du dehors.
Sans Marteteau, le neveu, qui était en somme celui qui cherchait ces tro-
pismes, voyait d’abord Martereau comme un petsonnage de roman tra-
ditionnel, comme nous voyons les gens autour de nous. Nous en faisons
des personnages. Mais, pour moi, cette construction ne répond pas 4 une
réalité. Dans Le Planétarium, les noms existent quand les gens parlent
Jes uns des autres ; mais ces noms ne s’introduisent jamais dans cette
partie de nous-mémes, dans cette vie intérieure of nous ne prononcons,
il me semble, jamais de noms. Quand je veux évoquer quelqu’un, ce
n’est pas un nom que je prononce. Je fais surgir une image. Elle est
généralement déterminée par l’impression que je veux avoir de celui qui
l’évoque, l’impression qu’il me fait sur le moment. Jamais je ne pro-
nonce son nom ; c’est lorsque je parle de lui a un interlocuteur que je
prononce son nom. Autrement, je le vois apparaitre sous un aspect tres
schématique et je crois qu'il en est ainsi pour chacun de nous. L’autre
m’apparait et je ne le nomme pas. Si je pense 4 quelqu’un, 4 un de mes
proches, par exemple, ce que je vois tout 4 coup est difficile 4 décrire.
Comme souvent dans les réves, je sais que c’est lui. Le nom n’est pro-
noncé que lorsqu’on parle Jes uns des autres. C’est ce que j’ai fait dans
te Planétarium of chacun voit l’autre comme un personnage, et parle de
autre en tui donnant un nom. Si je donne un nom a un personnage, je
me place 4 I’écart de lui : je le nomme du dehors. Or, je suis 4 l’inté-
tieut de sa conscience et j’essaye de me mouvoit comme lui, d’étre prise
avec Jui dans ses mouvements, portée par eux. A ce moment-li, peu
m’importe of je suis.
S. F — Wétade de ces tropismes, ces mouvements, c'est le
contraire de la ctéation de types tel qu’on aimait 4 le faire autrefois...
N. S. — C'est le contraire. En écrivant Portrait d’un inconnu, j'ai
voulu reprendre une situation balzacienne un peu semblable 4 celle
d’Eugénie Grandet ct essayer de trouver ce que recouvrent ces mots :
¢’est un avare. Pour un ocil modeme, qu’y a-t-il derriére le portrait d’un
avare ? Ce qu'il y a est d'une complexité telle qu’a la fin, celui qui
cherche est obligé de Mcher prise. Alors s’introduit le personnage du
toman traditionnel, monsieur Dumontet, qui a un nom, une profession,
qui va épouser la fille, etc. Les tropismes disparaissent. On retombe dans
le d&a connu.
S. F — Justement, j’en teviens 4 une réflexion que vous faites dans
L’Ere du soupgon ; yous dites en substance que le vieux roman ne peut
plus contenir la réalité psychique actuelle. Est-ce a dire que cette réalité
psychique a changé ou bien que c’est notre appréhension... ?
N. S. — Je crvis que c’est notre appréhension de cette réalité qui
s'est transfonmée. Il est absurde de dite que Dostoievski ou Balzac ne
voyaient pas l’extraordinaire complexité de la vie intérieurc. Mais clic
a’entrait pas dans leur forme ; ils avaient besoin d’une autre forme,
comme les peinttes d’autrefois, dans laquelle ils enfermaient leur vision
du monde. Cette forme était alors neuve et vivante. Sa simplicité méme
Jui donnait une grande force. Le pére Grandet, le pére Goriot sont des
formes créées pat Balzac pour montret le réel. L’intrigue servait 4 les
modeler, 4 les faire chatoyer. Cette forme et cette vision étaient celles de
Balzac. Elles n’étaient qu’a lui. A notre époque si on veut les copier, on
fegarde 4 travers les lunettes de Balzac. Mais, depuis, nous avons appris
a voir une réalité plus complexe... La littérarure a subi de grands boule-
versements, nous avons ttavetsé |’analyse proustienne, le monologue
intérieur...
S. F. — I me semble qu’on a peu remarqué comme vous aviez sou-
vent recouts au vocabulaire plastique lorsque vous parlez ; vous venez de
parler de peinture tout 2 ["heure et avec insistance, de formes. Ce
recours 2 la peinture revient plusieurs fois dans L’Ere du soupgon, en
particulier dans le dernier texte, « Ce que voient les oiseaux ». Vous
dites que la peinture a cu un mouvement analogue 4 celui du roman.
N. S$. — On ne peut plus copier Brueghel maintenant, n’est-ce
pas ? Si nous voulons montrer (comme je le disais, je crois, dans L’Ere
dz soxpcor) la couleur jaune nous n’avons plus besoin de la fixer sur un
citron ou un objet quelconque. Ce qui intéressait, d’ailleurs, les pein-
tres, autrefois, n’érait pas de montrer un citron, mais avant tout de faire
jouer une ceraine forme, des lignes, la couleur. Alors, au licu d’un
citron, pourquoi ne pas montret la couleur pure, puisque c'est elle qui
doit attiret toute l’attention du vétitable amateur de peinture, éveiller sa
jouissance, et non pas lui donnet envie de presser le citron, de le
découper en tranches. Il me semble qu’il en est de méme pour la littéra-
ture. Pourquoi construire madame Bovaty ou le pére Karamazov puis-
qu’en fin de compte, ce qu’on y ressent est ce que |’auteur et te lecteur
ont en commun. Je voudrais aititer l’attention du lecteur sur des mouve-
ments qui existent chez n’importe qui. Il m’a toujours semblé que le
roman suit de trés loin la peinture car, malheureusement, le roman n'est
pas encore tout 4 fait un ast, il doit servix 4 toutes sortes de fins qui
n’ont tien 4 voir avec l'art. Flaubert était us modeme quand il son-
geait, au départ, A montrer, au licu de la Bovary, les séveries d’une
vieille demoiselle solitaite. Ca l’ennuyait déja de construire un person-
nage. Or, au moment oi il |’ écrivait, c’était encore une forme vivante.
Mais le roman devrait tout de méme essayer d’aller au plus prés de la
source, de ce lieu of les formes prennent naissance, ne pas se contenter
de reprendre des formes anciennes. On me dit parfois : vous détestez
Balzac. J’aime beaucoup Balzac, je trouve que c’est un grand ctéateur.
Mais essayer, maintenant, de voir, 4 travers des formes balzaciennes, une
réalité qui se défait, s’€pand de tous cétés, me parait impossible.
S. F. — Je le pense absolument. Vous parlez, 4 propos de peinture,
de quelque chose d’extrémement intéressant, d’extrémement actuel, me
semble-t-il, bien que vous l’ayez écrit il y 2 presque trente ans, du réa-
fisme. Vy a une longue discussion 4 la fin de L'Bre du soupgon sur le
réalisme et j’aimerais bien que vous en parliez pour notre aujourd’bui.
N.S. — J'ai pensé que tout éctivain cherche toujours 4 accrottre le
monde dans lequel nous vivons. Il cherche ce qui n'a pas encore été
intégré a la réaliré connue. C’est 18 le mouvement de la littérature. Vou-
loir faire une peinture réaliste de la société, avec les instruments d’un
aristocrate russe au XIX: siécle, comme Tolstoi, par exemple, revient a
montrer une image de la réalité au niveau of il la voyait, lui, mais pas
au niveau de notre vision actuelle de la réalité ; on reprend alors une
forme qui ne peut plus servit aujourd’hui. Elle ne peut pas conduire
plus loin, en profondeur, que Tolstoi n’est allé en écrivant Anna Karé-
nine. Méme si on se sett de cette forme pour montrer une société
actuelle.
Jean Ristat — Qu’appelez-vous donc réalisme ?
N. S. — Le séalisme se déplace. Ce que j’appelle réalisme, c’est
toujours du réel gui n’est pas encore pris dans des formes convenues. Il
est nécessaire que les formes se déplacent continuellement. On ne peut
plus reprendre les formes anciennes sans retrouver une substance roma-
nesque ancienne, elle aussi connue. A une époque, tous les jeunes écti-
vains imitaient Kafka ; cela ne donnait rien. Pour moi, c’est trés réaliste,
Kafka. Ce qu’il montre, c’est Ia réalité ; maintenant nous employons le
mot Aafkaien pour désigner un aspect réel (d’ailleurs moins vaste que
celui que Kafka nous a apporté). Avant lui, on sentait vaguement cet
aspect. Aujourd’hui, on le voit aussitét. Cette réalité s’est intégrée au
monde que nous connaissons. Mais comme la forme de Tolstoi, celle de
Kafka ne peut, plus étre reprise pour montrer une part de réalité encore
inconnue. Comme toute copie, cette forme est académique, inerte.
S. F — Donc, dans la mesure of cette réalité telle que nous
’appréhendons change, le réalisme est alors 4 repenser constamment ?
N. S. — Pour moi, chaque ceuvte est une ceuvre oi il faut retrouver
un autre réalisme. Si quelqu’un dit : ¢a ’a aucune importance, comme
Sartre, quand il a pris la forme de Dos Passos dans Le Sursis... Com-
ment, ¢a n’a pas d’importance ? Mais c’est tout ce qu’il y a de plus
important. Il s’agit de trouver une forme qui arrive 4 capter cette réalité-
la encore inconnue, qui n’a pas encore de forme. C’est cela, pour moi,
le véritable réalisme ; essayer d’atteindre une réaliré encore intacte et
Pintégret la réalité connue.
S. FE. — Ily avait dans la formulation méme de la question que j’ai
esquissée devant vous, une ambiguité sur le terme de réalisme, parce
qu’au fond, quand nous parlons de réalisme aujourd’hui, la plupare du
temps nous pensons simultanément a la querelle du réalisme qui a cu
lieu & partir des années trenté et qui était liée 4 une autte question, celle
de la littétarure engagée.
N. S. — J’étais contre la littérature engagée patce qu’elle ne se
ptéoccupait pas de cette recherche d’une forme et donc d’un fond
neufs. Et aussi parce qu’elle était imposée, démonstrative, Educative.
Mais si l’engagement est sponiané, s'il se manifeste dans des oeuvres
vivantes, alors tant mieux! Le Divine comédie est une ceuvre engagéc
admirable. Brecht était engagé, mais ce qu'il montrait était ce qu'il
découvrait dans la réalité. Or quand on a commencé 4 nous dite : le
devoit d’un €crivain consiste 4 contribuer 4 changer la société, peu
importe avec quelles formes, écrire des ceuvres didactiques, pédagogi-
ques, en démontrant quelque chose; alors, pour moi, on n’était plus
dans le domaine de !’art.
J. R. — Ce que vous dites de la forme est trés important et, cepen-
dant, j’aimerais que vous précisiez l’usage qu’il est possible de faire de
la « tradition ».
N.S. — C'est une question ttés pertinente, parce que c’est justement
le fait de ne pas pouvoir en faire usage qui a déterminé tous mes efforts.
D’ailleurs, quand j'ai commencé écrire, je pensais que ce n’était pas
publiable. Cette recherche d’une réalité qui n’est pas directement visible,
eh bien, il peut lui arriver deux choses : ou cette réalité n’arrivera pas a
s’intégrer 41’ univers dans lequel nous vivons, elle restera informe, elle sera
sans force, alors elle disparattra ; ou elle arrivera 4 ajouter une parcelle ou
bien un grand pan de réalité au monde que nous connaissons. Cela, il est
impossible de le savoir par avance. Mais si elle réussit, elle ne sera plus
copiable et utilisable. Il était possible que ce que j’appelle tropisme meure
simplement pat manque de force et ne pénétre pas dans la conscience des
futurs lecteurs. Mais si ces tropismes ont pu étre reconnus...
S. F — Comme étant la réalité....
N. 5S. — Comme étant une parcelle d’une réalité commune
tous... Je ne prétends pas recouvrir toute la réalité ; mais une partie,
un certain niveau, de la réalité,
wor py
J. R. — Je vous ai posé cette question en me faisant lavocat du
diable. Mais c'est peut-étre plus une question de potte — en effet, je
m’intetroge, pour ma part, sur le travail qu’on peut faire sur le vers ct
comment on peut, 4 l’intérieur de formes qui sont tour de méme
réduites, travailler pour les changer.
N. S. — Pour moi, le roman se rapproche, essaye de se rapprocher
de la poésie ; il tend, comme la poésie, 4 saisir au plus prés de leur
source, des sensations, quelque chose de ressenti. Les romans devraient
devenir de grands poémes. Et de méme certaines ceuvtes poétiques sont
créées dans des formes qui jusqu’ici étaient considérées comme apparte-
nant 4 la prose.
Cette conversation est extraite d'un travail en cours.
NATHALIE SARRAUTE
Paul Valéry et l’Enfant d'Eléphant
L’Enfant d’Eléphant n’avait pas agi plus imprudemment, cet
Enfant d’Eléphant des Histoires comme ga de Kipling, « tout neuf et
plein d’une insatiable curiosité », qui posait toujours des questions et
qui se faisait partout rabrouer — quand, un beau matin, il avait fait
cette belle question: « Qu’est-ce que le crocodile mange pour
diner ? »... et li-dessus tout le monde Iui avait dit « Chut ! 4 haute et
terrible voix et s'était mis 2 le cogner sans petdre une minute, ni
s’arréter pendant longtemps » ; comme cet incorrigible Enfant d’Elé-
phant, j’avais beau savoir qu’il valait mieux me retenir, c’ était plus fort
que moi, je ne pouvais pas m’en empécher, il me fallait absolument,
quoi qu’il dit m’en coftter, en avoir le coeur net, et je ne manquais
jamais de demander en toute occasion : « Mais est-ce donc bien yrai,
étes-vous vraiment bien certain, trouvez-vous vraiment sinctrement que
Paul Valéty soit un grand poéte ? » Et aussitét, comme si j'avais pro-
noncé des paroles sacriléges, tout le monde me faisait signe de me taire
ef se fetournant pour voit si on avait entendu ma question. Et les uns
s’en allaient en haussant les épaules sans daigner me répondre, et les
auttes, le premier choc passé, me regardaient avec pitié et m’assuraient
qu’ils ne le répéteraient 4 personne et s’efforceraient méme de l’oublier,
si je leur promettais de ne jamais recommencer ; certains m’ont
demandé en souriant si j’avais jamais rien compris aux grands classiques
francais, ou aux grands classiques tout court, et pourquoi, pendant que
iy €tais, je ne posais pas la méme question au sujet de Racine, ou bien
de Virgile, de Lucréce ou de Platon 2 qui Paul Valéry a été 4 juste titre
comparé ; quelques-uns m’ont conseillé, puisque j’étais incapable de
sentit par moi-méme ce qu’ était la véritable poésie, de m’en rapporter
au jugement des plus grands parmi les contemporains de Paul Valéry, 2
celui de Rilke, notamment, que, disaient-ils, je prétendais admirer, et
qui avait fait de Ini des éloges Jes plus flatteurs qu’un poéte ait jamais
décernés 4 un autre poéte de son temps ; d’autres se sont mis en colére
et m’ont parlé avec ume grande véhémence de « gloire nationale >,
d’« admiration unanime 4 !’étranger », et de poésie 4 laquelle les mots
«pure», <«patfaite», «classique», « étonnante », « merveilleuse »,
«< accomplie », « rare », « prestigieuse », « inoule », étaient, comme c’est
T'usage, dés qu’il s’agit de Paul Valéty, immanquablement accouplés ;
un seul, patmi tous ceux que j'ai ainsi imprudemment provoqués, qui
avait rougi et détourné les yeux et que j’avais pressé de questions dans
un coin sans youloir le lacher, finit par me dire tout bas, comme 4
contre-cocur et d’un ait agacé : « Mais vous ne savez donc pas que nous
avons toujours cu besoin d’un abbé Delille ? » Mais je ne m’étais pas
encore remise de mon étonnement qu'il avait disparu, et il a toujours
évité soigneusement depuis de se retrouver en téte 4 téte avec moi. Et
une autre fois encore, quelqu’un que j’avais longtemps harcelé, me
glissa dans un souffle et les yeux un peu égarés: « Mallarmé rayon
calicot »... Mais c’était si inattendu, si extraordinaire, que je me suis
toujours demandé si j’avais bien entendu.
Il paraissait évident que petsonne ne me serait d’aucun secours et
qu’il ne me restait qu’a essayer de me tirer d’affaire par mes propres
moyens. A premiere vue, cela pouvait ne pas sembler trop difficile. Je
n’avais qu’a m’enfermer dans ma chambre ; fermer ma porte 4 tous les
bruits du dehors ; et, seule en face de l’ceuvre de Paul Valéry, m’aban-
donner 4 moi-méme. Je serais alors en face d’elle ce lecteur anonyme
que toute ceuvre littéraire, si ancienne et si bien établie que soit sa
renommée, ne cesse 4 aucun moment de son existence d’affronter. Elle
serait pour moi ce que toute ccuvre d’art, comme le dit si bien Thierry
Maulnier, « peut étre 4 chaque moment et pour tout lecteur qui se place
en face d’elle, un événement neuf et un commencement absolu ». Et
alors la téponse que je me ferais 8 moi-méme ne vaudrait pas pour moi
scule. Elle serait peut-étre aussi la réponse timide de quelques-uns de
ces lecteurs inconnus qui, isolés les uns des autres, enfermés dans leurs
chambres solitaires, en face de cette ceuvre s'interrogent avec inquiétude
et s’étonnent.
Rien de plus simple 4 premiére vue que ce qu’il me fallait tenter —
ni de plus naturel. Mais en réalité, rien de plus difficile. Envisager
V’ceuvre de Paul Valéry comme un événement neuf ! L’aborder avec une
sensibilité intacte et un regard impartial ! Pour parvenir a cela, que ne
fallait-il pas détruire, chasser 4 tout instant de son esprit, extirper de sa
mémoire ? Quelle couche chaque jour plus épaisse de vernis protecteur
ne fallait-il pas gratter, quelle gangue solide et dure, chaque jour plus
solide et plus dure, de paroles louangeuses et de commentaires enthou-
siastes ne fallait-il pas briser autour de chaque ligne, de chaque strophe,
de chaque vers, pour les faire apparattre 4 la lumitre! Ceci, par
exemple, et je choisis au hasard, qu’il fallait s’efforcer d’oublier, cette
« Initiation 4 1a poésie de Paul Valéry », dont l’auteur veut nous faire
admirer tout d’abord «le portique qui nous ouvrira un si royal
domaine », « portique, nous dit-il, qui appuie son atche d’accueil sur
ces deux magnifiques colonnes, /’Ame et /a Danse et Eupalinos ou
VArchitecte, qui égalent Valéry aux plus grands essayistes de tous les
temps... Dans /’Ame et la Danse, nous dit-il encore, Paul Valéty a
connu la plus merveilleuse réussite, et cela non parce qu’il rénove le
gente, mais au contraire, patce que, se soumettant 4 l’Ame méme du
dialogue platonicien dont il rettouve la poésie et la sereine simplicité, il
fejoint presque, avec une sdreté joyeuse, le philosophe et l’artiste qui
donna des ailes 4 la pensée de Socrate et reste fe maitre parfait dans l'art
de converser ». Il fallait écarter cela d’abord, briser d’abord cette gangue
pour faire apparaitre au grand jour et examiner « comme un événement
neuf », ceci, qui s’y trouvait enrobé, ces paroles par lesquelles |’auteur
de cette « Initiation » n’hésite pas 4 nous faire pénétrer dans « le royal
domaine », et que Paul Valéry a placées dans la bouche de Phédre :
«Je respire, comme une odeur .muscate et composée, ce
mélange de filles charmeresses ; et ma présence s’égare dans ce
dédale de graces o& chacune se perd avec une compagne et se
retrouve avec une autre. »
Et cela encore, 4 quoi il ne fallait plus penser et que j’avais apercu
g Pi que J iperg
dans un article para récemment (je prends encore au hasard) :
«L’intime orchestte de Mallarmé qui dépasse rarement la demi-voix,
Valéry l’épaissit d’éléments plus sonnants qui sauront chanter, tout
chauds de puissance animale, I’invasion sauvage de linspiration... A la
plane mélodie de son maitre, il donne les contrastes et le relief de la
symphonic... Oui, Valéry s’est fait le plus accompli des musiciens...
dans chacun de ses poémes, il offre 4 |’ouie les plus fines variations : le
vers sec, subit et nerveux qui succéde a la suavité, puis la moue amollie
du dégoat, ie rythme ou plus vif ou plus lent toujours retenu par Ja
mesure ; le forte piano accusant la césure, opposant par sa coupe, &
Pinstar de Rubens, la brune ardeur de homme au doux blanc
féminin... » Ces somptueux atouts dont il fallait dépouiller, pour I’exa-
miner dans sa nudité native... ce vers, le seul que l’auteur de !’article ait
jugé bon de citer a |’appui de ses commentaires :
« L’amant brdlant et dur ceindre la blanche amante. »
Oublier ceci encore — mais on n’en finirait jamais de citer — cette
présentation du fameux « Cantique des Colonnes >: « La poésie... art
complet qui a permis 4 Paul Valéry de construire avec des mots rigou-
reusement choisis, groupés avec une ptécision mathématique et dont
ensemble est composé dans le pur style ionique, ce temple grec, doré
de soleil, qu’est le « Cantique des Colonnes », potme des lignes, des
formes pures... €difice qui chante, harmonieux 4 la fois pour les oreilles
et pour les yeux », etc. Oublier tout cela et s’abandonner sans vergogne
4 l'impression que produisent sur tout lecteur 4 V’esprit non prévenu et a
la sensibilité encore intacte les vers que voici (cités par cet autre enthou-
siaste commentateur) :
Si froides et dorées
Nous faimes de nos lits
Par le ciseau tirées,
Pour devenir ces lys !
De nos lits de cristal
Nous faimes éveillées,
Des griffes de métal
Nous ont apparcillées,
Pour affronter la lune,
la lune et le soleil,
On nous polit chacune
Comme !’ongle de 1’orteil !
Il fallait, en ouvrant le recueil des poémes, oublier que ce sont « les
plus purs de la langue francaise, les plus sensuels, les plus denses et les
plus parfaits... que Paul Valéry a amené 3 son achévement la tradition du
vers racinien... Nulle faille ! Nulle lacune ! Le voila, le vrai classicisme !
Quelle lecon de rigueur et de sévérité envers soi-méme ! Quelle lecon de
style aussi !... Aventure extraordinaire, cette merveilleuse poésie s’est
imposée par de tout autres moyens que les moyens habituels : nul recouts
aux grands effets, nulle excentricité, mais au contraire une maniére trés
simple et les charmes les plus disctets »... Oublier que « Valéty est notre
Luctéce, neuf, serré, éclatant, sauvage »... et que « Le Jeune Parque est
un de ces chefs-d’ceuvre grice auquel les littératures, et, par consé-
quence, les langues, peuvent en quelque sorte se survivre »...
Non, ce n’était pas 14 une entreprise facile. On a beau s’armer de
courage, une pareille unanimité, un tel ton impressionnent. En ouvrant
le livre au poéme intitulé Le Jeune Parque, je ne pouvais m’empécher
d’éprouver un sentiment de sévérence et de crainte. Ici il convenait de
ne pénétrer que chapeau bas et de n’avancer qu’en silence et sur la
pointe des pieds, tout prét 4 s’agenouiller. Mais, tandis que je feuilletais
d’un doigt timide, voila qui tout de suite m’a rendu un peu d’assu-
tance. Je venais de reconnaitre cette vieille odeur aigrelette de chiffon
humide et de craie, cette vieille odeur rassurante et familitre d’encre et
de poussiére qui flotce autour des souvenirs d’exercices et d’ efforts sco-
laires...
J’avais tu ces vers :
Viens, mon sang, viens rougir la pale circonstance
Qu’ennoblissait !’azur de la sainte distance,
n’a été si universellement admiré. Ce poéte n’a pas eu jusqu’a présent
un seul contradicteur et sa réputation n’a méme pas les taches du
soleil ». (Flaubert, Correspondance, t.1V, p. 107), depuis Béranger
aucun poete francais n’a été aussi « grand homme » que Valéry.
Gide qui, en 1927, pouvait encore éctire dans son journal avec
quelque lucidité, 4 propos de /z Jeune Parque : « Malgré quelques mou-
verments adorables que le seul artifice ne saurait inventer... je ne puis
préférer ce long poéme 4 certains autres plus récents ct plus courts de
Charmes... Pas encore assez détaché de Mallarmé ; piétinement sur
place ; abus du retour sur soi ; du repli... » Gide devait subir 4 son
tour, son amitié pour Valéry y aidant sans doute, Jes effets de cette hal-
lucination collective et, en 1938, 4 son tour il écrit... « Je lis les admira-
bles pages de Valéty (dans /z Revue de Paris). Valéry n’a peut-étre rien
crit qui me ravisse davantage. {J’ai souvent cette impression avec lui.)
« Et, en 1942... ‘‘Mais le plus admirable, c'est que son esprit, sans rien
quitter de sa rigueur, a su garder toute sa valeur poétique... Cette
rigueur méme qu’on efit pu croire néfaste a l'art et qui fait au contraire
de l’art de Valéry une merveille si accomplie...’’ »
Son inconscient, pourtant, par moments, se rebiffait encore, 4 en
juger par ce réve « (qu’il a noté dans son Journa/), ot il s'est vu écrivant
sous la dictée de Valéty des phrases incompréhensibles. Celle-ci notam-
ment, que, dit-il, s’étant téveillé, il Eprouve te besoin de noter aussitét :
«Encore un AH de temps, nous étions des pendules littéraires... Je
Pavais interrompu, raconte Gide, ne comprenant pas bien, et, n’osant
lui demander ce que cela signifiait, je trouvai plus expédient de
demander comment if fallait écrire : AH... Quant 4 la suite, dit-il, je
Véctivais de confiance doutant s’il avait dit pendule, ou pendu, ou
perdu... Cela restait, de toute manitre, admirable... »
Mais la vague qui devait tout emporter I’entraine et, songeant avec
temords 4 cettaines de ses tésistances passées — et pour s’en laver 4 ses
propres yeux, sans doute — il s’accuse : «Je me souviens, écrit-il,
d’avoir désapprouvé naguére le “‘lait plat’’ d’un des plus beaux po&mes
de Valéty. » ... « L’épithéte, dit-il, me paraissait trop volontaire et tirer
trop 4 soi l’attention... » Ah ! combien aujourd'hui il le déplote... Elle
(tui) parait, écrit-il, « merveilleuse >... et « il fallait cout le génie de
Valéry pour l’inventer... II fallait, pour la mériter, l'aspect si particulier
du fait dans la jatte... son opacité... sa matité... sa blancheur, etc. Un
épithéte qui ne convenait 4 aucun autre liquide” »...
Ec sur ce méme « lait plat », plusieurs années plus tard et tout
récemment encore, Cocteau, 4 son tour s’extasie. Ce n’est pas méme
tant d’avoit « trouvé le lait plat» qu’il admite Valéry, que, !’ayant
« trouvé >, d’avoir su découvrir « l’angle sous lequel s’éclairera le mieux
sa trouvaille »™...
Un ange met sur ma table
Le pain tendre, le lait plat ;
Et comme ce « lait plat »... « de ce ‘‘lait plat’’ aussi mon coeur est
amoureux... Je suis de votre avis, le « lait plat » est heuteux... Je vou-
drais l’avoir fait... Il vaut toute une piéce... Mais en comprend-on bien
comme moi la finesse ?... Oh! Oh'!... Il est vrai qu’il dit plus de
choses qu’il n'est gtos »... comme ce « lait plat » éveille irrésistiblement
en nous des réminiscences littéraires ! Et comment, devant ce « lait
plat », se retenir d’évoquer ces réunions de la rue de Villejust ot ses
fidéles, imitant 4 |’instar du Maitre les grands classiques, devaient repro-
duite des scénes que n’efit pas désavouées Moliére !
Mais peut-étre cet esprit désabusé et qui devait savoir mieux que
quiconque « de quoi il en retourne », ne considérait-il pas sans une cer-
taine inquiétude une pareille unanimité, un tel ton dans la louange. On
sait quel sentiment douloureux de faiblesse recouvre le plus souvent un
pareil orgueil.
Peut-étre efit-il été moins que tout autre choqué ou surpris de mon
insolence et se fat-il montré, plus que tout autre, indulgent.
Et n’aurait-il pas dfi en tout cas, le premier, m’absoudre, lui qui a
donné l’exemple d’un si grand irrespect ?
On se souvient en quels termes, en effet, il s'est permis de parler de
Pascal: « Ces: efftoi, efftayé, effroyable ; silence éternel ; univers
muet... (le) font songer invinciblement 4 cet aboi insupportable
qu’adressent les chiens 4 la lune... » Il ne peut d’ailleurs s’empécher de
13. Journal, p. 1158.
14, Fontaine, &é 1945, p. 541.
penser qu’il y a du systéme et du travail dans cette attitude parfaitement
triste et dans cet absolu de dégodt... Une phrase bien accordée exclut la
tenonciation totale. ... Jl n’aime pas voir un écrivain chercher A ce
« qu'on prenne son industrie pour son émotion »... Et, pour tout dire, il
« voit trop », dans tout cela, « la main de Pascal »... Et comme on serait
tent€, ici, de parler de paille et de poutre, s’il était possible de déceler
dans les Pensées de Pascal le plus léger fétu !
« On a rant écrit sur lui, s’écrie encore Valéry avec exaspération, on
V’a tant imaginé et si passionnément, qu’ il en est devenu un personnage
de tragédie... une manitre d’Hamlet francais et janséniste, qui soupése
son propre crane, crane de grand géométre ; et qui frissonne et songe,
sur une tettasse opposée 2 I’Univers... »
«Il a tité de soi-méme le silence éternel que ni les hommes vérita-
biement religieux, ni les hommes véritablement profonds n’ont jamais
observé dans [’univers. »
Aussi Valéry trouve-t-il bon de lui apprendre ce qu’il convient rai-
sonnablement de sentir devant le ciel étoilé... « C’est vers le ciel que les
mains se tendent ; en Ini que les yeux se réfugient ou se perdent ; c’est
lui que montre le doigt d’un prophéte ou d’un consolateur... »
Et sans doute, en rédigeant ces vers pompeux et plats de /a Jeune
Parque :
Tout-puissants étrangers, inévitables astres
Qui daignez faire luire au lointain tempore!
Je ne sais quoi de put et de surnaturel...
Paul Valéry €prouvait-il la satisfaction de bien « river son clou » &
Pascal.
(Les Temps modetnes, janvier 1947, avaient publié ce texte avec plu-
Steurs coupures ; pour la premiere fois, il est restauré ici @ son intégrité,
@'aprés le manuscrit original retrouvé.)
NATHALIE SARRAUTE
LE GANT RETOURNE
Pendant ts longtemps j’ai pensé qu’il ne me serait pas possible
d’éctire pour le thé4tre.
Ce n’est pas que le théatre n’ait pas exercé sur moi, dés ma jeunesse,
une profonde influence. Je me souviendrai toujours du choc qu’a pro-
duit sur moi la piéce de Pirandello Six personnages en quéte d'auteur,
jouée par les Pitoéff en 1924, je crois, devant une salle 4 peu prés vide.
Et aussi, mise en scéne et jouée pat Jean Vilar, Le Danse de mort de
Strindberg.
Mais il me semblait que le dialogue de théatre était incompatible
avec ce que je cherchais 4 montrer, avec ce que je me suis toujours
efforcée de montrer dans mes romans et dans mon premier recueil de
textes brefs, intitulé Tropismes, c’est-i-dire des mouvements intérieurs
ténus, qui glissent wés rapidement au seuil de notre conscience, des
mouvements qui ne sont pas (contrairement 4 ce qu’on a dit) tels qu’ils
apparaissent 4 l’origine : de mous déroulements, de vagues grouille-
ments, mais tels que je les montre dans mes livres : des mouvements
précis, des petits drames qui se développent suivant un certain rythme,
un mécanisme minutieusement agencé of tous les rouages s’emboirent
les uns dans les autres. Ces actions dramatiques intérieures aboutissent,
au-dehors, au dialogue.
Le dialogue en est I'affleurement. Un dialogue volontairement
banal, d’apparence anodine, porte ces mouvements au-dehors, mais en
les masquant. II en est comme la pointe mouchetéc.
Le dialogue seul, sans cette préparation que constitue un pré-dia-
logue, était pour moi impossible, impensable.
Car il ne s’agit jamais dans mes romans d’un de ces dialogues sug-
gestifs qui doit faire deviner au lecteur ce qui n’est pas dit. Le pré-dia-
logue, la sous-conversation, qui pousse le dialogue, le produit, montre
au contraite au lecteur ¢ou¢ ce qu’il m'est possible de lui montter. Ce
qu’il doit y apporter en plus, c’est ce que je n’ai pas pu ou pas su y
mettre.
Comment, dans ces conditions, écrire des piéces de théAtre ov il n’y
a tien d’autre que le dialogue ? Il doit 4 lui seul tout faire sentir. Ec
quant 4 l’action extérieure, si importante au théatre, elle est 8 peu prés
absente de mes livres. Cette action extéricure, c’est le dialogue qui
généralement la constitue.
Mais il s’est trouvé qu’un jour j’ai regu la visite d’un jeune Alle-
mand, Werner Spies, chargé par Ja Radio de Stuttgart de demander a
des auteurs francais d’éctite pour elle des textes radiophoniques. J'ai
commencé par tefuser. Werner Spies est revenu plusieurs fois 4 la
charge, m’affirmant que je pourrais faire ce que je voudrais, dans une
forme si insolite soit-elle.
Lidée m’est venue, quelque temps aprés, sans que je sache bien ce
qui pourrait en sortir, d’un certain silence. Un de ces silences dont on
dit qu’ils sont « pesants ». Je mentirais si je vous rapportais comment de
ce silence un texte a jailli, comme le ruban du chapeau du prestidigita-
teur ou, pour employer une comparaison plus modeste, comme le ruban
de la fente d’un téléscripteur.
Mon travail a toujouts des commencements trés spontanés et pas trés
conscients. C’est aprés que les éléments, venus de toutes parts, s’organi-
sent.
Toujours est-il que tiré par ce silence un dialogue a surgi, suscité,
excité par ce silence. Ca s’est mis 2 parler, 4 s’agiter, 4 se démener, 4 se
débattre... et je me suis dit : voila donc quelque chose qui pourrait étre
écouré 4 Ja tadio.
Ce qui dans mes romans aurait constitué l’action dramatique de la
sous-conversation, du pré-dialogue, oi les sensations, les impressions, le
« fessenti » sont communiqués au lecteur 4 l'aide d’images et de
rythmes, ici se déployait dans le dialogue lui-méme. La sous-conversa-
tion devenait la conversation. Ainsi le dedans devenait le dehors et un
critique, plus tard, a pu a juste titre, pour qualifier ce passage du roman
a la piéce, parler de « gant retourné ».
Les personnages se sont mis 4 dire ce que d’ordinaire on ne dit pas.
Le dialogue a quitté la surface, est descendu et s’est développé au
niveau des mouvements intérieurs qui sont Ia substance de mes tomans.
Il s’est installé d’emblée au niveau du pré-dialogue.
Mais ce dialogue conserve, malgré sa plongée dans les zones inter-
dites et obscures oti il se déploic, la forme du dialogue ordinaire, celle
dont on se sert dans la vie dite « courante ». Pourquoi ? Parce qu’il
s’agit ici de communiquer aux autres et de vivre sous leurs yeux, avec
eux, ces mouvements intérieurs, de les convaincre, de les appeler 4
l'aide, et pour cela il faut se servir du seul langage qu’ils puissent aus-
sitét comprendre, le langage quotidien. Ensuite parce qu’il faut que le
spectateut, ou l’auditeur, comme les personnages, participe immédiate-
ment A cette expétience, qu’il s’y retrouve chez lui.
Il faut que dans ces fonds ou, si l'on veut, ces bas-fonds, on se sente
le plus possible comme un poisson dans l’eau. Il faut que l’insolite
prenne un air d’évidence, qu'il ait la force de conviction d’une expé-
rience quotidiennement vécue par chacun et dont tend compte le lan-
gage quotidien.
Si la forme employée était insolite, le spectateur ne pourtait pas
revivre aussitét ces drames qui, dans la vie réelle, sont confusément et
globalement pressentis. Il faut que la sensation, le ressenti, passe vite,
ait une force d’impact immédiate, porté par des mots familiers.
Il en est de méme dans mes romans ot des images claires, banales,
immédiatement évocatrices doivent faire passer des sensations indéfinis-
sables.
De plus il me semble que, pour les spectateurs auxquels je
m/’adresse, ce contraste entre le fond insolite et la forme familitre donne
& ces mouvements, d’ordinaire cachés, un caractére plus dramatique,
plus violent. Et aussi, parfois, il produit un effet comique, un effet
d’humour. L’insolite, enrobé dans du connu, du familier, fait rire.
Jaime rire parfois moi-méme en éctivant.
Mais cette forme de dialogue courant, comme dans mes livres, a
prété 4 confusion. Beaucoup de spectateurs, et parmi eux des critiques,
écoutent les mots sans chercher 4 en pénétrer le sens et, entendant des
mots du langage courant, échangés par exemple entre amis réunis aprés
le diner, ne voient dans ces dialogues, pourtant inhabituels, que des
« conversations de salon ». Ainsi ceux qui se sont bornés 8 lire les dialo-
gues, et non les pré-dialogues, des Fruits d'Or, y ont vu des bavardages
de cocktails littéraires !
Cette expérience intérieure qui est pour certains petsonnages (et vrai-
ment, plus que des personnages, il s’agit ici de porteurs de mouyements
que, je l’avoue, j’ai parfois distribués au petit bonheur), cette expé-
tience qui est pour certains personnages quelque chose de naturel,
d'irrésistible, d’évident, est pour d’autres insupportable. Ils veulent 2
tout prix se maintenir a Ja surface, parmi leurs paysages familiers, sur la
terre ferme depuis longtemps connuc et prospectée o@ ils ont |’habitude
de vivre. Si on les entraine vers le fond, ils se débattent, c’est pour eux
une descente aux enfers de l’anomalie, de fa folie, ils veulent remontet a
la surface. D’ot le constant mouvement dans mes piéces, de haut en bas
et de bas en haut.
En haut, se trouvent les formes habituelles, sécurisantes, des défini-
tions, des catégories de la psychologie traditionnelle, de la morale, qui
emptisonnent et neutralisent cet indéfinissable, cet innommable qui vit
dans les profondeurs (des profondeurs d’ailleurs toutes relatives). Mais
c’est en haut, a la surface, que ceux qui se meuvent au niveau des tro-
pismes ne peuvent se maintenit. Hs se sentent sans cesse entrainés et 4
tout moment ils descendent, en s’efforcant d’entrainer les autres. Quant
au sujet, il est chaque fois ce qui s’appelle « rien », qui est le second
titre d’une de mes pitces.
Pourquoi « tien » ? Parce qu’il faut que la carapace du connu et du
visible soit percée sur un point infime, que la craquelure soit la plus fine
possible pour que l’innommé, l’invisible soit 4 la place d’honneur, pour
qu’il soit plus difficile pour les spectateurs, comme pour ceux qui vivent
au niveau des tropismes, de se laisser distraire par ce qui se passe a la
surface. A la surface il n’y a rien, 2 peu pres rien.
Plus Ja craquelure de la surface est infime, inapparente, plus les
drames qui se déploient sous cette surface et que la ctaquelure révéle
sont amples, plus le travail m’intéresse. C’est au déroulement, sous ce
qui est familier, sans importance — ce qui s’appelle « rien » — de ces
drames mictoscopiques insoupconnés, qui 4 chaque instant se jouent en
nous, que je m’attache. Il stimule mon effort. Il permet de découvrir
sous la carapace de l’apparence rassurante, tout un monde d’actions
cachées, une agitation qui est pour moi la trame invisible de notre vie.
C’est un peu un travail de sourcier.
Prenons un exemple: Le mensonge. C’est le titre d’une de mes
pitces. Si j’avais montré uh gtos mensonge, un de ceux qui mettent en
cause des rapports affectifs connus, qui blessent des sentiments connus,
qui abiment ces rappotts, il n’était pas possible de quitter la surface, les
vastes espaces ptospectés dans tous les coins, exploités jusqu’a épuise-
ment — du visible.
Il fallait un mensonge pour ainsi dire 4 l'état pur, le mensonge en
soi, un mensonge abstrait, qui n’affecte en rien notte vie. Une contre-
vérité dite pat quelqu’un qui nous est indifférent.
La fine craquelure qu'elle produit est juste une sensation désa-
gréable. De celles que chacun a pu sentir glisser en soi quand il a cu
impression qu’en sa présence — et sans que cela le touche directement
— quelqu’un ment. Une sensation vague qui glisse en nous et passe
sans que nous nous y afrétions : un nuage qui passe.
Il en est ainsi dans le silence. Un de ces silences dont on dit qu’ils
sont « lourds », mais qu’on préfére ne pas remarquer, 4 quoi bon ? pour
quoi faire ? et queile importance ?
Mais dans ma piéce intirulée Le Silence, il agit comme un catalyseur,
comme un réactif puissant. Sous l’effet de ce silence les gens s’agitent,
interrogent, souffrent, supplient, se galvaudent, mettent en cause ce
qu’ils ont de plus cher, de plus précieux — puis, épuisés, remontent a
la surface : que s’est-il passé ? Mais cien. Ce monsieur 2 gatdé quelques
instants le silence. Vous l’avez temarqué ? Non, 4 vrai dire, je n'y ai pas
fait attention.
Ainsi dans la priére intitulée Isa ot la ctaquelure est encore plus
infime, vraiment un point 4 peine visible. Il s’agit non pas méme de la
facon de prononcer des phrases, pas méme des mots, mais de la fagon de
prononcer la derniére syllabe — en « isme » — de certains mots. Rien de
plus. Pour que ceux de la surface, ceux qui vivent dans |’apparence,
puissent dire aux autres, aux sourciers, aux voyants, aux hypersensibles,
aux délirants, aux déments : mais qu’est-ce qui vous a pris ?
Pour que lorsque ces fous — et je crois, que nous en soyons ou non
conscients, nous le sommes tous — pour que lorsque ces fous se mettent
a s'agiter, 4 faire part du désarroi, de fa souffrance que provoquent en
eux ceux qui prononcent ainsi, les gens dits « normaux » puissent les
rappcler a l’ordre et les tirer par la peau du cou a l’air pur des surfaces,
od ce qu’ils étaient en train de faire est poursuivi sous le nom de
« dénigrement ». Et pour que les fous, replongeant sans cesse dans ces
zones obscures, montrent comment cette simple syllabe, prononcée
d’une certaine facon, est comme un caillou qui fait des cercles de plus
en plus grands, comment I’avetsion inexplicable que produit cette pto-
nonciation, iszza au lieu de isme, est la source, les ptemiéres gouttelettes
qui, en chacun de nous, peuvent grossir jusqu’aux pires excts du
facisme.
Dans toutes mes piéces, l’action est absente, remplacée par le flux et
le reflux du langage. L’emphase sur le role du langage en littérature est
aujourd’hui telle, il est a ce point considéré comme I’unique substance
de toute ceuvre littéraire, son point de départ et son « générateur », il
est 4 ce point devenu la « tarte 4 la créme » de Ja critique littéraire que
j/hésite 4 en montrer |'importance dans mes piéces. Cependant il est
vrai que ces pices ne contiennent aucune action extérieure. Il est vrai
que le langage y joue le réle de détonateur. II est vrai que c'est par
lemploi de certains mots qu’il se révéle qu’un certain personnage —
comme dans C'est beau — est passé d’un milieu 3 un autre, a abdiqué
ce que lui a appris sa culture et a cherché secours auprés de ces rebou-
teux que sont les gens simples aux prises avec les réalités quotidiennes.
Ul est vrai que deux mots « C’est beau » qu’on ne peut prononcer devant
son enfant — un fils bien aimé — remettent en cause tous les rapports
de ses parents avec lui, et entre eux et par-del3, font se heurter des
ordres de valeur inconciliables, s’affronter deux univers.
C'est parce que la substance de ces piéces n’est rien d’autre que du
langage qu’il m’avait semblé qu’on ne pouvait que les écouter. Cepen-
dant, aprés que Le Mensonge eut paru dans les Cahiers Renaud-Bar-
rautt, J.-L. Barrault, conseillé par Simone Benmussa, a décidé de le
mettre en scéne avec Le Silence. Il m’avait semblé que c’était 1a une
entreprise itréalisable.
Il a su pourtant, avec ses dons de mime, son imagination qui lui
permet d’animer l’espace scénique, il a su montrer des personnages se
mouvant sur la scéne, exécutant méme toutes sottes de miouvements
assez amples et yariés. Je dois dire que ces mouvements m’ont fascinée.
Je voyais ce texte, ainsi intégré 4 des mouvements scéniques, porté et
amplifié par des gestes, avec étonnement.
Claude Régy, non sans un certain courage, a mis en sctne Iseza. Lui
a, au contraire, conservé au texte le premier réle. Méme pas le premier
role : le rdle unique. Dans sa mise en scéne, tien ne vient en distraire.
Les acteuts s’y soumettent 4 Ja lettre, en suivant, en isolant toutes ses
nuances, en amplifiant 4 peine son rythme. Assis céte 4 céte sur la
scéne, face au public, ils bougent peu, se lévent, se rassoient, quand le
mouvement du texte les fait se lever, puis se rasseoir. Ils ne se lévent
tous et ne font cercle qu'une seule fois, quand |’un d’entre eux quitte la
scéne, pour donner l’impression de le chasser — comme le texte pouvait
le suggérer. Toutes les répétitions étaient le décortiquage minutieux et
trés sensible de chaque vibration du langage. Claude Régy a fait voir
chaque pli, chaque froissement, tous les grains de la peau du gant
retourné.
Et, dans les deux cas, avec Jean-Louis Barrault comme avec Claude
Régy, la sensibilité des acteurs, leur effort créateur, ont permis 4 des
auditeurs réceptifs de percevoir ce qu’avec les seuls moyens de |’ écriture
je n’aurais pas pu ou pas su leur montret.
Conférence prononcée & Vuniversité de Madison (U.S.A.) (1974) dans le cadre du
séminaire sur l'avant-garde au théatre et au cinéma, publiée dans les Cahiers Renaud-
Barrault.
NATHALIE SARRAUTE
Le bonheur de l'homme
On dit en France qu’une chose « brille par son absence ». I] me
semble que cette expression un peu vulgaire s'applique assez bien au
bonheur. En effet, je n’appelle pas bonheur des instants de joie, de
séténité. Je pense que par le mot bonheur, on entend un sentiment
durable et sans mélange qui s’étendrait sur de vastes périodes de la vie
et, dans Jes meilleurs cas, sur la vie tout entiére.
C’est ce bonheur-la qui étincelle partout, qui éblouit tous les yeux et
qui pourtant ne se trouve nulle part.
Il ne peut étre, en effet, qu'un mirage, un réve — incompatible
avec tout ce que nous connaissons de la réalité de notre vie psychique et
de ses lois. Cette vie, on le sait bien, n’est que fluidité, mouvance,
écoulement inintetrompu de sensations agréables ou pénibles venues de
toutes parts, et qui colorent différemment chacun de nos instants. Elle
est composée de mouvements complexes, subtils, indéfinissables, infini-
ment fragiles, souvent contradictoires, s’engendrant les uns les autres
un mouvement appelant souvent son contraire — et tous ces mouve-
ments innombrables, le plus souvent insaisissables ne peuvent qu'au
prix d’une mutilation étre fondus, confondus, pour étre coulés dans un
moule qui pourrait sans tricherie, comme s’il était empli d’une subs-
tance homogéne, porter une étiquette sur laquelle on inscrirait le mot
« bonheur ».
Mais si chaque instant, observé avec sincérité et clairvoyance, nous
montre combien la trame de notre vie quotidienne se préte peu 4 ces
constructions globales, notre vie, considérée dans son ensemble, s’y
préte encore moins. Quand il nous arrive parfois — cela se produit sur-
tout aux petites heures du matin —- de commettre l’imprudence de jeter
suf notte vie toute entiére un coup d’ceil 4 vol d’oiseau et d’en prendre
une vue panoramique, le paysage qui se présente 4 nos yeux — entouré
de ténébres, sans cesse menacé de toutes parts, o8 tout est évanescent et
oi il n’y a de stable, de solide qu’une seule certitude, celle du dépéris-
sement inéluctable, de la souffrance et de la mort — ce paysage, il faut
le reconnaitre ne pourtait que par dérision se parer du mot « bonheur ».
Mais nous voulons absolument — et qui peut oser nous jeter la
piette ? — nous cherchons de toutes nos forces 4 masquer cette réalité
insoutenable et, envers et contre tout, 4 nous persuader de |’ existence de
ce grand bloc compact et lisse ; le bonheur. Nous savons bien, dans
notre for intérieur, qu’il ne s’agit que d’une illusion, mais si grand est
notte désir, dans cet écoulement, cette fuite incessante, au milieu des
dangers et en face des cettitudes tragiques, de nous cramponner 4
quelque chose de stable, de durable, d’une solidité 4 toute épreuve, que
nous finissons par nous persuader que cette félicité doit exister quelque
part. Ii suffic de bien la chetcher, on la trouvera.
Et pour nous aider 4 1a trouver, que de conseils, que de recettes !
Nous n’avons que l’embarras du choix. Chacun doit déployer tous ses
efforts pour obtenir ce qu’a chaque instant on lui propose : les résultats
sont assurés. Les camelots du bonheur se partagent la clienttle. Les
appels, depuis des siécles, n’ont cessé de s’élever de toutes parts, chaque
société, chaque groupe social vantant la supériorité de ses offres : le bon-
heur, c’était l’oisiveté, la vie de cour et ses prestiges... le bonheur, c’est
le travail, c’est l’activité fébrile... c’est la contemplation... le bonheur,
c’est la famille, les enfants, le mariage... le bonheur, c’est le détache-
ment d’une vie solitaire... le bonheur, c’est la possession des richesses et
de la puissance... le bonheur, etc., etc.
On nous propose des modeéles de toutes sortes, bien congus, édifiés
selon des régles éprouvées ; il suffica de savoir choisir et d’étre préts a
payer le prix — car rien, bien sir, ne nous est donné gratuitement —
pour s’installer 4 demeure dans |’une de ces constructions confortables et
harmonieuses. II suffira de chercher refuge dans ces licux d’asile pour
gotiter cette sécurité et cette pérennité des joies qui est la condition sine
qua non du bonheur.
Et quoi d’étonnant que nous acceptions ces offres — ne connaissant,
et pour de bonnes raisons, que par oui-dire ces lieux ot le bonheur nous
attend. Quoi d’étonnant que nous courions pleins de bonne volonté et
d’espoir vers ces havres, ces refuges, préts & tous les efforts pour étre
dignes d’y pénétrer. Préts 4 laisser 4 la porte des joies, des désirs incom-
patibles avec notre choix, et 4 engager, pour nous y maintenir, toute
notre bonne volonté, toutes nos forces.
Nous nous doutons bien, 4 vrai dire — car il ne faut pas nous croire
si naifs — qu’il y a peut-étre IA un jeu de dupes. Mais on nous presse de
toutes parts, et notre désir est si grand, et pourquoi, aprés cout, puis-
qu'il n'y a pas d’autre alternative, ne pas tenter le pari ? Donc nous
jouons le jeu, nous cherchons le bonheur.
Mais il se passe alors quelque chose d’étrange : cette techerche du
bonheur posséde la particularité de s’éloigner de son but a mesure
qu'elle s’effotce de l’atteindre. Car nous sommes ainsi faits qu’en
dehors de certains moments, rates et passagers de joie, d’exaltation,
nous n’€prouvons pas le sentiment du bonheur. Les états qu’il peut
nous aftiver d’atteindre en certaines périodes plus ou moins prolongées
de notre vie, et qui s’approchent le plus de l’idée que nous nous faisons
du bonheur sont, généralement de ces états neutres dont on peut seule-
ment dire que la soufftance en est absente.
Et s'il est évident qu’il est nécessaire, urgent de lutter pour débar-
rasser les hommes des souffrances matérielles et morales, en construisant
des sociétés aussi libres, €quitables et prospéres que possible, il ne fant
pas s’y tromper : ce qu’on obtiendra ainsi sera un état qui ne compor-
tera pas cettaines souffrances, non un état ressenti comme étant « le
bonheur ».
Cette absence de soufftance devient rapidement — ce que d’ailleurs
elle est — toute naturelle. Aussi naturelle que le fait d’exister, aussi
indispensable et invisible que |’air qu’on respite.
On a souvent constaté que tous nos biens, 4 peine acquis, nous
paraissent aller de soi, et le bonheur, qui ne s’y trouve pas, ne peut s’y
trouver, aussitét se déplace, s’éloigne, de nouveau poursuivi, de nou-
veau hors d’atteinte.
Et il se passe encore ceci de cutieux : il suffir que nous nous disions
que nous tenons le bonheur pour qu’il soit certain qu’il nous échappe.
Car les pétiodes de notre vie qui pourraient sembler étre des périodes
heureuses sont celles ot la vie devient plus intense et plus pleine, ot
tout notre étre est engagé dans quelque chose qui le dépasse au point de
nous faire perdre conscience de nous-mémes. Si nous disons alors :
« C’est ga le bonheur > c’est que nous nous sommes retrouvés. Nous
voici revenus 4 nous et nous contemplant 4 distance, jetant sur ces
moments intacts et innocents un regard de Méduse qui les fige. Un
regatd qui les vide de leur substance, qui en fait une forme vide et sans
vie.
On dirait que ce mot de bonheur est un mot ensorcelé. Si nous
poussons I’aveuglement et le conformisme jusqu’’ affirmer en toute
bonne foi que nous possédons le bonheur, jusqu’a chercher 4 |’exhiber
fierement aux yeux d’autrui, nous voyons les ames délicates se détourner
avec géne devant l’indécence d’un tel étalage — au milieu de toutes les
souffrances et les miséres qui nous entourent — devant une telle preuve
d’égoisme et d’insensibilité. Er si nous sommes de mauvaise foi, si cette
affirmation est de notre part une tromperie délibérée, elle ne peut signi-
fier que le désir de nous valoriser 4 bon compte, de prendre sur les
autres une supériorité facile et trompeuse, de manquer 4 toutes les régles
de la pudeur, de nous laisser aller 4 un exhibitionnisme destin€ 4 faire
naitre la nostalgie et l’envie. Toutes tentatives qui révélent chez leurs
auteurs moins la présence du bonheur que le sentiment douloureux de
son absence et le besoin de le masquer.
Les pancartes sur lesquelles ce mot s’étale, que nous voyons pattout
dressées, il me semble gu’elles nous conduisent immanquablement dans
ces régions ot régnent les sentiments préfabriqués, les idées regues, les
conventions, les préjugés. Quand nous y pénétrons, nous nous trouvons
aussitét enfermés 4 |’étroit entre des parois rigides ct closes auxquelles
nous nous cognons durement, d’ot il est trés difficile, sinon impossible
de s’€évader.
Mais si nous parvenions 4 oublier jusqu’a ce mot dangereux de bon-
heur, 4 ne pas nous laisser prendre aux apparences, nous pourtions peut-
étre, au prix d’un effort souvent douloureux, atteindre quelque chose au
fond de nous-mémes qui est comme la source vive de notre existence, et
enter en contact avec une réalité profonde, encore intacte, qui ne porte
aucune étiquette et ne se laisse enfermer dans aucun moule. Ce contact
nous donne la force de résister aux contraintes toujours renouvelées et
accrues qu’impose la civilisation et sa course au « bonheur », et, du
méme coup, il nous permet de tirer parti sans dommage des possibilités
que le progrés nous offre, en nous délivrant de certains maux et de cer-
tains avilissements, en ouvrant des domaines toujours plus lointains et
plus vastes 3 nos accomplissements, 4 nos investigations, au bienfaisant
oubli de soi.
Ainst débarrassés de la hantise de cette image illusoire et débilitante
du bonheur, pourrions-nous arriver 4 travers les souffrances assumées et
les sactifices, les ttistesses et les joies, 4 vivre une vie digne de ce nom,
(Texte inédit en francais, publié dans le journal japonais Mainichi en juin 1970.)
Vous aimerez peut-être aussi
- Chopin Ou Le Poète PDFDocument202 pagesChopin Ou Le Poète PDFandreBishop100% (1)
- VOLTAIRE Article Dans LireDocument12 pagesVOLTAIRE Article Dans LireJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- SUC Jean-PierreDocument18 pagesSUC Jean-PierreJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- BACH L'homme Qui Tutoyait DieuDocument87 pagesBACH L'homme Qui Tutoyait DieuJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Revue Geo N° 171 Grèce, Sur Les Traces D'homèreDocument34 pagesRevue Geo N° 171 Grèce, Sur Les Traces D'homèreJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Clara Et Robert SchumannDocument11 pagesClara Et Robert SchumannJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- BorodineDocument77 pagesBorodineJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Schumann ArticlesDocument17 pagesSchumann ArticlesJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- BREL Paroles Et MusiqueDocument20 pagesBREL Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Raoul Duguay Paroles Et MusiqueDocument7 pagesRaoul Duguay Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- BREL Paroles Et Musique Suite Et FinDocument18 pagesBREL Paroles Et Musique Suite Et FinJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Xenakis Iannis PsapphaDocument9 pagesXenakis Iannis PsapphaPaolo Marcello BattiantePas encore d'évaluation
- Jacques Debronckart Paroles Et MusiqueDocument13 pagesJacques Debronckart Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Alexandre Révérend Paroles Et MusiqueDocument2 pagesAlexandre Révérend Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Melaine FAVENNEC Paroles Et MusiqueDocument4 pagesMelaine FAVENNEC Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Antoine Tomé Paroles Et MusiqueDocument4 pagesAntoine Tomé Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Mérédith MONK Article Dans La Revue Art PressDocument3 pagesMérédith MONK Article Dans La Revue Art PressJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Bob ASHLEY Article Dans La Revue Art PressDocument2 pagesBob ASHLEY Article Dans La Revue Art PressJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Philippe MURAY La Dernière Joie de Charles BaudelaireDocument3 pagesPhilippe MURAY La Dernière Joie de Charles BaudelaireJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Raymond Devos Extra MurosDocument38 pagesRaymond Devos Extra MurosJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Jehan Jonas Paroles Et MusiqueDocument3 pagesJehan Jonas Paroles Et MusiqueJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Bernard Henri Lévy Entretien Avec Guy Scarpetta Dans Art PressDocument3 pagesBernard Henri Lévy Entretien Avec Guy Scarpetta Dans Art PressJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Milan Kundera Entretien Avec Guy Scarpetta Revue Art PressDocument4 pagesMilan Kundera Entretien Avec Guy Scarpetta Revue Art PressJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Laurie Anderson Dans Art Press Novembre 1982Document1 pageLaurie Anderson Dans Art Press Novembre 1982Jean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Denise Tual Au Coeur Du Temps Photos Du Livre 04Document20 pagesDenise Tual Au Coeur Du Temps Photos Du Livre 04Jean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Munier Roger Le Visiteur Qui Jamais Ne VientDocument37 pagesMunier Roger Le Visiteur Qui Jamais Ne VientJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Guy Scarpetta Article Dans La Revue Art PressDocument4 pagesGuy Scarpetta Article Dans La Revue Art PressJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Danilo Kis Articles Et Entretien Avec Guy Scarpetta Revue Art PressDocument6 pagesDanilo Kis Articles Et Entretien Avec Guy Scarpetta Revue Art PressJean-Marie SucPas encore d'évaluation
- Denise Tual Au Coeur Du Temps Photos Du Livre 05Document20 pagesDenise Tual Au Coeur Du Temps Photos Du Livre 05Jean-Marie SucPas encore d'évaluation