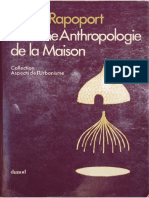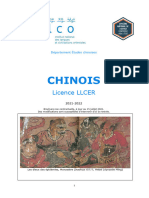Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Instructions Sommaires Pour Les Collecteurs D'objets Ethnographiques
Instructions Sommaires Pour Les Collecteurs D'objets Ethnographiques
Transféré par
Yann ZeligTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Instructions Sommaires Pour Les Collecteurs D'objets Ethnographiques
Instructions Sommaires Pour Les Collecteurs D'objets Ethnographiques
Transféré par
Yann ZeligDroits d'auteur :
Formats disponibles
1 S 17
7034
INSTRUCTIONS SOMMAIRES
POUR LES
COLLECTEURS D'OBJETS
ETFINOGRAPHIQUES
D'ETHNOGRAPHIE
(MUSEUM NATIONAL V'IUSTOIRll NATURELLB)
ET
MISSION SCIENTIFIQUE DAKAR-DJIBOUTI
PARIS, PALAIS DU
MAI 1931
HOMM6E !!'lU MUSE rl'ETHNOGR.i\PHIl::
DU TROCADRO, PARts (,l ti',)
INSTR'UCTI()NS SOMMAIRES
POUR LES
C()LLEC1'1EURS D'OBJETS
ETI-INC)GRAPHIQUES
',,:'
MUSE D'ETHNOGRAPHIE
NATIONAL D'WSTOIRE NATURELLE)
ET
MISSION SCIENTIFIQUE DAKAR-DJIBOUTI
PARIS, PALAIS DU TROCADRO
MAI 1931
.... , ~
... " \ ,.i "' .. , ,.c
10-, ' ~ .
Les prsentes instructions ont t rdiges d'aprs les cours
professs l'Institut d'Ethnologie.
Les frais de leur publication ont t prlevs SUI' le Fonds
Al Brown-Khaetl-Lumiansky (Bnfice du Gala de Boxe organis
par ( Paris-Ring le 15 avril 1931 au Cirque d'Hiver, au profit
,de la Mission scientifique Dakar-Djibouti).
INSTHUCTIONS SOM\lAlHES
POliR LES COLLECTEL'HS D'OBJETS
ETHNOGHAPII U)lIES
PRLIMINAIRES
Qu'est-ce que l'ethnographie?
L'ethnographie fait partie ues sl:iens dont l'ensemble
constitue l'ethnologie, e'est--dire des sciences qui ont pour but
l'tude des races, des civilisations et des langues clu monde.
Elle a pour objet essenlell'Lucle de la civilisation matrielle:
alimentation et habitation, habillement et parure, armes et
instruments, ehasse, pche, l:ulture et industrie, moyens de
transport ct cl' l:hange, a tLribu ts crmoniels, j eux, productions
artistiq ues, etc ...
, Mais l'ethnographe ne se contente pas de la rcolte sche des
objets; son enqute s'tend au rle que jouent ecux-l:i dans la
vie sociale on individuelle, aux coutumes qui s'y ratLachent, aux
croyances qu'ils voquent. Bref, l'ethnographe l'clic l:onstam-
llll?nt son enqute aux enqutes anthropologiques, sociologiques,
folkloristiques, linguistiques.
Une civilisation Sera toujours dans ses rapports
avec la race qui la met en uvre, avec l'ensemble des conceptions
sociales ou religieuses dont elle n'est que la reprsentation mat-
rielle, avec la langue qui lui sert de vhicule.
Utilit de l'ethnographie.
L'ethnographie conue rend l'ethnologie des services
considrables. C'est elle qui nOlis permet de mesurer les progrs
normes accomplis par l'humanit dans le domaine de la tech-
nique. C'est elle encore qui, en nous faisant connatre certains
types spciaux d'instruments maintenant assez rpaild"us, nous
met frquemment sur la trace cie migrations ou de relations jus-
qu'alors insouponnes.
Non seulement l'ethnographie l'st preieupl' l'tude de
l'homme prhistorique, dont elle restitue le milieu, ct de l'homme
moderne, elle apporte aux mthodes de colonisation une con-
tribution indispensable, en rvlant au lgislateur, au fonction-
naire et au colon les usages, eroyances, lois et techniques des
populations indignes, rendant possible avec ccs dernires une
5
collaboration plus fconde et plus humaine, et conduisant ainsi.
l une exploitation plus rationnelle des richesses naturelles.
L'Institut d'Ethnologie et le Muse d'Ethnographie.
C'est pour des raisons aussi diverses que, depuis un demi-
sicle, ont t fonds par les nations trangres de vastes ta-
blissements tels que le Muse du Congo Belge Bruxelies-Ter-
vueren, l'Institut Colonial Amsterdam, la Smithsonian Ins-
titution Washington, etc ...
En France, il existe deux organismes de ce genre, dont la
liaison naturelle est encore renforce par une direction com-
mune : l'Institut d'Ethnologie de l'Universit de Paris et le Labo-
ratoire d'Anthropologie d Musum National d' Histoire Natu-
relle, auquel est rattach le Muse d'Ethnographie du 'Trocadro.
L'Institut d'Ethnologie de l'Universit6 de Paris (191, rue
Saint-Jacques, Paris, V
e
) est un organe d'enseignement et de
recherche, fond en 1925 et subventionn par nos colonies. Son
but est non seulement de former des ethnographes spcialiss,
mais encore de dispenser de futurs fonctionnaires les connais-
sances ethnologiques dont ils auront besoin aux colonies, d'or-
ganiser et d'appuyer les i n i ~ , s i o n s d'tude, et de centraliser les
enqutes et les travaux.
Le Muse d'Ethnographie (Palais du Trocadro, :paris, XVIe),
cr ds 1878 et actuellement en voie de complte rorganisa-
tion, a pour but de conserver et d'exposer mthodiquement les
objets ethnographiques, en particulier ceux qui proviennent
des colonies franaises.
Il est urgent de constituer des collections d'objets.
Du fait du contact chaque jour plus intime des indignes et
des europens, et de l'application croissante des mthodes poli-
tiques et conomiques modernes, les institutions, les' langages,
les mtirs indignes se transforment ou disparaissent et l'on
peut prvoir le temps dj prochain o seront abolis jamais
des faits et des objets dont la connaissance aurait t trs im-
portante pour l'histoire d rhumanit.
Presque tous les phnomnes de la vie collective sont sus-
ceptibles de se traduire par des objets donns, cause de ce
besoin qui a toujours pouss les homms imprimer la ma-
tire la trace de leur activit. Une collection d'objets systma-
tiquement recueillis est donc un riche recueil de pices con-
6
viction n, dont la runion forme des archives plus rvlatrices
et plus sres que les archives crites, parce qu'il s'agit ici d'ob-
jets authentiques et autonomes, qui n'oIlt pu tre fabriqus
pour les besoins de la cause et caractrisent mieux que quoi
que ce soit les types de civilisation.
Avant qu'il ne soit trop tard, il importe de combler les lacunes
qui dparent notre Muse et d'augmenter par de nouvelles acqui-
sitions les richesses inestimables qu'il possde dj pour cer-
taines contres.
But des prsentes instructions.
Pour restituer notre Muse d'Ethnographie la place qui
lui nwienl parmi les grands muses du monde, il suffit que ceux
qui vivent ou circulent loin de la mtropole, fonctionnaires,
voyageurs, louristes ou colons, veuillent bien nous aider cons-
tituer des collections.
En rapports directs et journaliers avec les habitants des
rgions qu'ils traversenL ou dans lesquelles Hs vivent, ils sont
les mieux placs pour recueillir, en mme temps que d e ~ objets.
tous les dtails qui s'y rapportent et rassembler ainsi - par des
informations orales ou crites, par le dessin ou la photographie -
une mine de documents qui multiplieront l'intrt scientifique
des objets rcolts.
Orienter les recherches des collecteurs, leur fournir une m-
thode de travail, leur donner des directives rationnelles d'aprs
des disciplines prouves, tel est le but des prsentes instruc-
tions.
7
l
DIRECTIVES GENERALES POUR FORMER
UNE COLLECTION
CHOIX DE L'OBJET
Une collection d'objets ethnographiques n'est ni ulle col-
lection de curiosits, ni une collection d'uvres d'art. L'objet
n'est pas autre chose qu'un tmoin, qui doit tre envisag en
fonction des renseignements qu'il apporte sur une civilisation
donne, et non d'aprs sa valeur esthtique,
Il faut donc s'habituer recueillir toutes espces d'objet!!
et se dfaire en premier lieu de deux prjugs, celui de la puret
du style et celui de la raret.
1
0
Prjug de la puret du style.
La premire chose qu'il y ait dire de la puret du style )J,
c'est qu'elle n'existe pas. Tout est mlange, produit d'influences
disparates, rsultat de facteurs multiples. La Vnus de I1Iilo
elle-mme n'est pas pure: ce chef-d'uvre de la statuaire grecque
reprsente une femme qui a le type nordique.
Il ne faut donc en aucun cas rejeter un objet sous prtexte
qu'il est impur . Mme marqu par l'influence europenue,
un objet indigne doit tre rcolt. (Exemple: les bambous gra-
vs de la Nouvelle-Caldonie, o sont reprsents des person-
nages europens). Bien plus, beaucoup d'objets dont l'origine
est entirement europenne sont trs intressants. (Exemple :
les objets d'importation que beaucoup d'indignes portent en
colliers ou 'en pendants; les clisses de chemin de fer dont les
. Somalis se servent pour fabriquer cles pointes de flches).
20 Prjug de la raret ..
Les objets les plus communs sont <-"'eux qui en 'apprennent
le plus sur une civilisation. Une bote de conserves, par exemple,
caractrise mieux nos socits que le bijou le plus somptueux
ou que le timbre le plus rare.
Il ne faut donc pas craindre de recueillir les choses mme
les plus humbles et les plus mprises. Un objet peut ne rien
valoir nos yeux non plus qu'aux yeux de l'indigne et tre
une inpuisable source de renseignements. (Exemple: les usten-
siles de mnage, les cordes noues pour un usage quelconque).
Les objets les plus rares et les plus beaux sont gnralement
.8
deR objets d'apparat. Or les objets d'usage courant sont d'un
intrt au moins gal celui des objets d'apparat.
Il est ncessaire que le collecteur se dbarrasse de sa menta-
lit europenne et s'habitue apprcier l'intrt des objets au-
trement qu'en collectionneur qui ne recherche que la curio-
sit . En fouillant un tas d'ordures, on peut reconstituer toute
la vie d'une socit; beaucoup mieux, le plus souvent, qu'en
s'attachant aux objets rares ou riches.
TUDE DE L'OBJET
11 ne suffit pas de collectionner tout (d'tre complet en lar-
geur), il faut analyser chaque objet (tre complet en profondeur).
C'est l que se rvlera la qualit du collecteur, qui pourra mon-
trer en quoi il n'est pas un simple ramasseur mais, pour l'eth-
nographe, le plus prcieux des collabOl'ateurs.
Collectionner d'abord, pour un mme objet, des spcimens
le montrant clans tous les stades de sa fabrication et dans toutes
ses utilisations. Par exemple, pour une poterie, on recueillera
la matire premire (argile, terre ... ), la poterie avant et aprs
la cuisson et, s'il y a lieu, avant et aprs sa dcoration. On es-
sayera de s'en procurer un spcimen us ct d'un spcimen
neuf, un spcimen rpar ct d'un spcimen intact, de ma-
nire qu'il soit possible de la suivre partir de sa naissance
jllsqn' sa destruction.
Collectionner aussi les variantes, tous les chantillons pos-
sibles d'un mme objet (en dimensions, formes, etc ... ). Ne. pas
craindre les doubles, ni mme les triples, qui sont touj ours utiles
dans un muse, soit qu'ils servent faire entrer l'objet dans
di\'ers modes de classement (Exemple: une vannerie, qui pourra
figurer en mme temps aux techniques de fabrication, au mobi-
lier domestique, la la religion), soit qu'on les
emploie comme matriel d'change avec d'autres muses.
En mme temps qu'on suivra chaque objet travers sa
formation, on se renseignera sur les recettes, les tours de main,
les On cherchera comment en est explique l'inven-
tion. Au moyen de nombreuses photographies ou de croquis
sommaires, on montrera non seulement sa fabrication, mais ses
varis. On dterminer2, pour chaque objet sa localisation
prcise (lieu o le spcimen a t rcolt) et l'aire de diffusion
(cc type d'objets sc reneontre-t-il dans un village seulement ou
clans d'autres villages, clans d'autres rgions'? Si oui, dans quels
9
2
villages? dans quelles rgions? Est-il l'apanage exclusif d'une
famille, d'une classe de la socit? ou bien est-il commun
. toutes les familles? toutes .les classes? Est-il susceptible de
variantes, selon le village? la classe? la famille? Qui le fabrique?
Qui a le droit de s'en servir? L'aire de fabrication et l'aire d'usage
sont-elles distinctes? etc ... ).
A chaque objet est lie une multiplicit d'ides, qu'il s'agit
galement d'tudier. C'est dans cette partie du travail surtout
que le collecteur, s'il en a le loisir, pourra manifester sa capacit.
En dehors de son utilit technique, l'objet a-t-il une valeur
magique ou religieuse? Quels sont les mythes qui s'y trouvent
rattachs? Dans quelles conditions ceux qui s'en servent peuvent-
ils le fabriquer, l'acheter ou, d'une manire gnrale, se le pro-
curer? Une lgende se rapporte-t-elle sa dcouverte? sa
rvlation? Bref, on s'occupera ici, non plus de l'objet pris en
lui-mme, mais de tout ce qu'il y a autour, en somme de toutes
les antennes qui le relient l'ensemble de la socit.
C'est en entourant l'objet d'une masse de renseignements,
techniques ou autres, et de toute une documentation (photos,
dessins, observations) qu'on parviendra viter qu'une fois
dans le muse il se transforme en objet mort, abstrait de son
milieu et incapable de servir de base la moindre reconsti-
hftion.
Une collection d'objets ethnographiques est avant tout une
'collection de choses vivantes. C'est en cela qu'elle se distingue
des autres genres de collection. Il faut donc conserver l'objet
ce qui lui donne la vie et rduire autant que possible les incon-
vnients de la transplantation. Telle sera l'utilit des documents
et des notes que le collecteur devra s'efforcer de nous faire par-
venir en mme temps que les objets qu'il aura rcolts.
10
II
CLASSEMENT PRATIQUE
DES OBJETS ETHNOGRAPHIQUES
Ces objets rE}ntrent dans les cadres des catgories suivantes:
I. - Technomorphologie.
II.- Technologie proprement dite.
III. - Esthtique.
IV. - Monuments de l'activit sociale.
V. - Dmographie.
Les objets qui entrent dans "ces diverses catgories ne sont
pas tous susceptibles d'tre recueillis. Certains (tels les maisons,
les palais) sont d'un volume ou d'une nature telle qu'il ne peut
tre question de les dplacer. D'autres restent mal dfinis, tels
ceux qui pourraient correspondre la dmographie.
Dans le premier cas (Monuments intransportables), le col-
lecteur pourra fournir des photographies, des modles rduits
ou au moins, s'il y a lieu, reprer et signaler les monuments en
question, de manire que puissent tre prises les mesures propres
assurer leur conservation. Le mme reprage devra tre effec-'
tu, dans le cas d'objets plus petits, mais que le collecteur n;a
pas les moyens de faire immdiatement transporter.
Dans le deuxime cas (Activits se traduisant par des objets
mal dfinis), il sera toujours possible de trouver, dfaut d'lm
objet proprement parler, quelque trace matrielle de l'acti-
vit en question, quelque signe visible et, sinon recueillable, du
moins phot ogra phi able, car il n'est pas une activit humaine
qui ne soit, par un certain ct, matrielle, puisque c'est un
besoin humain que de tout matrialiser.
Exemple: un arbre gnalogique, figur d'une manire quel-
conque par un indigne=matrialisation de la dmographie.
-1. - TECHNOMORPHOLOGIE .
Adaptation d'un peuple son sol. Transformation du sol
par l'homme.
On rendra compte au moyen de cartes en couleUTE', en relief,
plans, photographies, modles rduits (de prfrence faits pr
les indignes), des routes, rivires, ponts, pturages, steppes,
forts, assolements, plantations, dboisement, dfrichement,
jachres, irrigation, villes, villages, maisons, fermes, palais,
champs, puits, points d'eau, fortifications, marchs, dpla-
ments, travail de la tribu, de la famille, etc., etc.
II. - TECHNOLOGIE PROPREMENT DITE
Tous les arts de ]a production matrielle non esthtique.
1 Le Feu.
Instruments servant fabriquer le feu (par frottement, par
percussion, par compression ... ), chantillons des divers combus-
tibles.
11
a) Conservation: tisons, brandons, torches, etr ...
Rcipients servant ft transporter le fell.
b) Allumage: btons, arcs, scies, planches il trous, vil-
brequins, moulins, toupies, pistons, etc .. .
c) M aniemenl: soufflets, ventails, forges, etc .. .
d) Utilisation: fours, pots, tessons, instruments cIe flexion,
de torsion, etc ...
(Industries drives du tell:
A) 1"\1 lalhzrgie. - Echantillons de minerais et de m-
taux, fourneaux, creusets, enclumes, limes, ciseaux,
etc ...
B) Travail du bois. - Durcissement (pieux), creu-
sement (canots, tambours), etc ... Pyrogravure.
C) Divers : Poterie, Cuisine, etc ... )
e) Destruction :engins ct moyens d'extinction du fcu et de
protection contre le feu.
20 Instruments mcaniques gnraux.
a) de poids et de choc: coups de poing, masses, marteaux,
coins, presses, meules, cailloux moudre, etc ...
b) de choc perant: lances, houes, aiguilles, poinons,
digging-sticks, pieux, etc ...
c) de rsistance: enclumes, polissoirs, clous, tenons,
mortaises, chevilles, pices d'ajustage, cordes, colles,
rsines, etc ...
d) ci lil tranchant et contondant: couteaux, haches, her-
minettes, ciseaux, grattoirs, rpes, rabots, etc ...
Recueillir en mme temps que ces objets tous les documents
relatifs leur propre fahrication et tous les documents relatifs
la faon d<? s'en servir.
3 Machinerie.
Piges (trappes, trbuchets, nasses, etc ... ), ncwigation, pour
la pehe ou le transport (pices de bois, outres, radeaux, canots,
pirogues (avec ou sans balancier), kayaks, rames, gaffes, perches,
pagaies, mts, voiles, cordages, gouvernails, proues, instru-
ments d'orientation, etc ... ), charpente (treuils, leviers, palans,
vilbrequins, forets, ,vrilles, pump-drills, etc ... ), tours de polier,
mtiers tisser, il filer (bobines, navettes, fuseaux, quenouilles,
rouets, etc ... ), arcs, frondes, etc ...
12
4 Travail de la pierre, du bois, etc.
(Cf. cc Instruments mcaniques , c( Armes , (c Habitation ,
(c Arts plastiques, etc ... )
Photos montrant les techniques pour travailler la pierre,
le bois, etc... Echantillons de matires premires, de pierres
ou autres matriaux demi travaills, etc... Instruments et
matires diverses employes dans la fabrication.
5 Poterie.
Echantillons de matires premires. Instruments et procds
de' fabrication (moules, tours, fours, etc ... ). Vernis, peintures,
maux, dcoration.
Pots, jarres, vases, coupes, etc ...
Poteries faites par les femmes et poteries faites par les
hommes.
Faences, porcelaines ...
6 Vannerie.
Echantillons de matires premires (cheveux, poils, j alles,
lianes, fibres, etc ... ). Vanneries au commencement et la fin
du travail. Instruments cie fabrication (rares en yannerie, car
d'ordinaire les doigts sont seuls utiliss). Apprts. Peintures.
Revtements.
Vans, nattes, claies, clayons, paniers (simpls, doubles,
impermables), etc ...
Vannerie fi poterie (moules), fourreaux de sabre, engins
de transport, bandes cie tte, ponts de lianes, etc ...
Vanneries roules (coiled baskets).
Sculptures en vannerie.
70 Corderie et sparterie.
Cordes cie cheveux, cie poils, de lanires, de fibres, cIe
l'osea UX, etc ...
Tissus de corde, filets, mannes.
Engins fjler (bobines, navettes, fuseaux, tambours,
roues, etc ... ).
Attaches d'arcs et de flches, nucIs aux filets, lu van-
nerie, a l'lX charpentes.
Collection de nuds fails par les indignes.
13
80 Tissage et filage.
Echantillons de matires premires, de laines, de cotons, etc ...
Echantillons de tous les Lssus.
Fuseaux, quenouilles, bobines, rouets, peignes, cardes,
mtiers horizontaux ou verticaux, navettes, cordons, nattes, etc.
Tissus moiti faits. Mtiers portant le tissu commenc.
Photographies montrant les techniques.
90 Arlues.
a) aJ'mes de choc, - de poids: massuef., casse-ttes, btons,
flaux, marteaux, etc ... - fil: haches, couteaux,
dagues, sabres, machettes, ctc.
b) armes de jet: btons lancer, pierres lancer, billes
en os, balles, flches, pointes de flches (sagittaires
ou lancoles), javelots, lances, couteaux de jet, boo:-
merangs, harpons, flches-harpons.
Arcs (simples ou composs), arbaltes, sarbacanes,
propulseurs, frondes, bolas, man-catchers, armes
feu, etc ...
c) armes de protection: bracelets, casques (rares), hausse-
cols, cuirasses (de mailles, de plaquettes), armures
de fibre, de cuir, de vanneric, de mtal, de corde,
boucliers de bois, de peau, de cuir, de feuilles, de
roseaux, boucliers tresss, etc ...
Btons de parade.
Il y aura lieu de distinguer entre les armes de chasse, de
pche, de guerre, de mme qu'entre les armes d'usage et les armes
d'apparat.
10 Consommation.
a) Cuisine:
Echantillons de denres alimentaires, de beurres, de graisses,
d'huiles, d'pices, d'ingrdients divers. Terres comestibles.
Foyers, marmites, vaisselle, instruments (broches, pinces,
grils, meules, mortiers, pilons, rpes, moulins, hachoirs, pres-
soirs, passoires, cuillers, fourchettes, etc ... )
14
Huches, greniers.
b) Boissons:
Echantillons de matires premires.
Bires, vins, hydromels, th, mat, etc ...
Rcipients : feuilles de palmier, noix de coco, bamhous,
outres, gourdes, calebasses, conques, rcipients de peau, d'corce,
de corne, de bois, de pierre, de verre. Poteries, vanneries.
c) Narcotiques et intoxiquants.
Tabac, opium, btel, haschisch, kava, etc ...
Echantillons et instruments (pipes, calumets, narghils,
tubes priser, tabatires d'oreille, etc ... )
11
0
Acquisition.
A. Rassemblement:
a) Cueillette: instruments pour cueillir, grimper, fouiller,
dbroussailler. Cires, gommes, camphre, insectes,
coquillages. Outillage d'apiculture.
b) Chasse: armes, piges, filets, palissades chicane,
appeaux, dguisements.
Sous-produits du gibier : os, fourrures, peaux,
boyaux.
c) Pche: moyens de transport (Cf. cc Navigation ) ;
armes (lances, harpons, flches-harpons, tridents,
fourches, crochets il poisson, lignes, hameons);
piges dormants, mobiles, mcaniques; filets mobiles,
fixes, paniers renversement ou automatiques, nasses,
barrages, appts, poisons, etc ... '
B. Production.
a) Elevage et domestication: instruments pour la traite,
la tonte, la mise mort, l'art vtrinaire.
Dformation des cornes, des dents, des dfenses
(recueillir des crnes).
Marques de proprit, instruments pour marquer.
Cages, longes, entraves, feri', traits, attelages, etc.
Attirail du berger.
Sous-produits de l'levage, industries laitires,
boyaux, cuirs, peaux, etc ...
b) Agriculture: chantillons d'espces vgtales,
d'engrais.
Houes, charrues, bches, btons creuser, plan-
toirs, dplantoirs, herminettes, faux, faucilles, pierres
aiguiser, etc.
Instruments et produits de la sylviculture, de l'arbo-
riculture, de l'horticulture.
ta
120 Protection et confort.
a ) Vtement:
Vtements d'herbes, de feuilles, de peau (tannerie, broderie
sur cuir, maroquinerie, cordonnerie), d'corce (tapas), de roseaux,
de paille, de sparterie, de plumes, de tissu, de feutre, etc ...
Etude des industries textiles (Cf. Tissage ) et Filage).
Teintures (matires : vgtales, animales, terres,
sang, etc ... ). Broderies. Motifs de dcoration.
Pagnes, sarongs, touffes d'herbes, cache-sexes, tuis pniens,
capsules, jambires, chaussures, sandales, chapeaux, fibules,
bijoux, etc ...
Photographies montrant la manire de porter le
b) H abifalion.
Photographies, modles rduits montrant les divers types
d'habitations: naturelles (cavernes, arbres), temporaires (tentes,
huttes-abris), dfinitives (maisons, cases, abris, btiments acces-
soires, tables, lieux d'aisance, silos, greniers, etc ... ).
Rapport de la maison aux cultures et au village (Cf. Techno-
morphologie ).
'
Matriaux: bois, roc, argile, pierre taille, terre sche, brique,
pltre, pis, chaume, paille, roseaux, nattes, tressis, etc ...
Fondations (pilotis, tertres, plates-formes, etc ... ).
Toits de feutre (Asie Centrale), de tuiles, de bois, de paille,
de pierre, de cuir (Asie Centrale et Afrique), etc ...
Instruments de construction, charpcnte, assemblage (mca-
nique ou par nuds), poteaux, poutres fatires, de corniche,
linteaux, vantaux, seuils, portes, fermetures, serrures, foyer, etc ...
Mobilier, siges (fixes et mobiles), banquettes, bancs, dos-
siers, accoudoirs, appuie-ttes, nattes, tapis, oreillers, hamacs,
couvertures, magasins de tissus, botiers, ete ...
Vaisselles, armes, clous d'accrochage; ustensiles de cuisine,
de mnage et d'clairage, etc ...
Dcoration de la maison et des objcts, motifs gomtriques
symboliques ou d'ornementation. (Cf. Esthtique des objets ll.)
13 Transport.
Instruments de portage (cordes, btons, courroies, charpcs,
bretelles, outres, bambous creux, pots, etc.). Photos montrant
les tours de main, les tours cIe corps. Nuds pour le portage et
le btage.
16
Engins de navigation (Cf. Machinerie ), skis, patins, r a ~
quettes, vhicules (travois, brouettes, traneaux, palanquins,
pousse-pousse, litires, voitures), bts, jougs, attelages, selles,
mors, triers, fers, illres, caparaons, etc ...
Etude cartographique des voies de communication (Cf.
Technomorphologie ).
14 Techniques pures.
a) Techniques du corps.
Photographies montrant les postures de travail, de marche,
de course, de repos, de sommeil, etc ...
Instruments pour le repos et le sommeil, instruments et
techniques d'hygine (Ex. : substances pour le lavage), etc ...
(Cf. Protection et confort .)
Reproduction:
Instruments de portage de l'enfant, berceaux, amulettes,
soins de l'enfant, allaitement. Vtements spciaux des accou-
ches, etc ...
~ ouets, instruments servant l'ducation.
Documents (photographiques ou autres) se rapportant
la vie sexuelle des indignes.
Sports (Cf. Jeux ) :
Attitudes athltiques. Natation. Saut. Ascension aux arbres,
etc., etc ...
Photos, films, dessins.
b) 111 decine ci chirurgie:
Ethnobotanique et ethnozoologie, simples, thriaques, venins,
poisons, antidotes, onguents, narcotiques, terres comestibles,
astringents, fbrifuges, toniques, purgatifs, vomitifs, etc ...
Instruments mdicaux (bandeaux de tte, ceintures, bra-
celets, instruments de support, attelles), instruments de chirur-
gie (couteaux de circoncision, outils pour la trpanation, l'am-
putation, la cautrisation, pointes ct aiguilles de tatouage,
moyens d'viter les exsanguinations, nuds, rouets, emploi du
feu, des colles, dcs cendres, des toiles d'araignes, ctc ... )
Attirail de l'homme mdecine (Cf. Techniques magiqucs ).
c) Techniqlles magiques:
Gurison des malades (Cf. ({ Mdecine )" envottement,
dscnvotement, extase, double vue, initiation magique, etc ...
Objets el photographies.
17
d) Sciences:
Instruments mnmoniques, nuds, cordes nuds, qip-
pus, btons-messages, btons encoches, filets, tresses, etc ...
Marques de proprit, pictogrammes, sceaux, etc ...
Instruments d'criture, parchemins, manuscrits, stylets,
pinceaux, etc ...
Instruments pour les comptes, tailles,entailles, mesures
de longueur, poids, balances, pesons, chapelets de perles ou de
coquillages, etc ...
Calendriers, gnomons, poteaux solaires, cartes gographi-
ques, etc ...
III. - ESTHTIQUE.
Recueillir tous les objets possibles, usuels ou non. Tous
les objets sont esthtiques un certain degr. Il n'y a pas de
diffrence relle entre le potier quand il fabrique et le potier
quand il dcore. L'assiette dont je me sers, je l'ai choisie.
1
0
Jeux.
Jeux de ficelles. Leur importance au point de vue de la go-
mtrie et du symbolisme. Les tudier minutieusement, au moyen
de photographies et de dessins montrant toutes les phases du
jeu et les positions diverses des mains par rapport la ficelle.
Noter les ch.ants, paroles, formules, etc., qui accompagnent ces
jeux. Jeu de la scie, cat's cradle, etc ..
Poupes, claquettes, crcelles, petites armes, instruments
survivants (tel l'arc dans nos socits).
Balles, guiches (canettes), cailloux.
Toupies, cibles, rhumbs, diables (bull-roarers).
Btonnets, osselets, chiquiers, ds, dominos, patiences.
Mts de Cocagne, balanoires, cerfs-volants, roues, pices
d'artifice.
Etc., etc ...
2
0
Arts plastiques.
a) Esthtique du corps.
Teintures, apprts, colles, fards, poudres, cosmtiques,
colorants.
Tous les ustensiles de toilette (rasoirs, fers, pingles che-
veux, peignes, grattoirs, brosses, etc ... ).
18
Instruments de scarification, de tatouage, de
d'amputation, etc ...
Pour les tatouages, prendre des photos ou des empreintes ..
Rechercher les crnes anciens dforms.
b) Esthtique du vlement et de la parure,'. (Cf. ({ Vtement ) .
Ornements des orifices (il, nez, bouche, pnis), des points
critiques du corps; ornements de la tte, du tronc et des membres.
Tissus, broderies, pendants, bijoux, attaches, broches, b-
tonnets, anneaux, nuds, bracelets, bandeaux de front, col-
liers, ceintures, cuirasses, boucliers, labrets, dents d'animaux,
dents humaines, dents de bronze, corail de bronze, poils, plumes,
etc., etc ...
Sacs mdecines, amulettes, figurines, talismans.
Masques, dguisements, etc. Poupes masques.
c) Esthtique des objets,'
(Cf. ({ Technologie )) et Monuments de l'activit sociale )).)
Peaux, bois, poteries, cuivres, fers, vanneries, outils, armes,
instruments de musique, etc ...
Objets d'usage et objets d'apparat (haches ostensoirs).
Motifs zoomorphes, phytomorphes, skiomorphes, anthro:'
pomorphes.
Architecture .. (Cf. Tchnomorphologie )) et ( Habitation )).)
d) Art idal,'
(Cf. Monuments de l'activit sociale .)
SC.l.llptures, modelages, ptroglyphes, gravures sur roc, sur
arbres, etc ...
Peintures, dessins, graffiti, caricatures, constructions d'argile
ou de sable, etc ...
Instruments pour la sculpture, le dessin, la peinture, etc ....
3
0
Arts musicaux.
a) Danse,'
Masques, costumes, ornements, accessoires, instruments de
la mimique, etc ...
Instruments sonores ports par les danseurs ou par les spec-
tateurs : jupes clochette8, claquettes, castagnettes, crcelles,.
sonnailles de fruits (calebasses, courges), etc ...
(Cf. Musique .)
19
,b) Musique:
En rgle gnrale, ramasser tous les instruments, Rechercher
aussi les procds sonores n'impliquant qu'un minimum de
matriel appropri, instruments improviss ou dtourns de
leur premier usage (Ex.: fragments de vgtaux, ossements,
bois, pierres, coquillages, objets de toutes sortes, mme d'ori-
gine europenne, etc.), percussion directe de la terre, de l'air,
etc., simple mouvement ou frappement du corps humain.
Avant de recueillir un instrument de musique, noter tou-
jours son chelle. Ne pas oublier de recueillir tous les dispositifs
- servant amplifier ou attnuer le son (gants pOUl' amplifier le
bruit des mains frappes, rf>Olucurs, sourdines).
Instruments de percussion (claquettes, castagnettes, tam-
bours de bois ou membrane, tambourins, troncs d'arhres vids,
gongs, cymbales, clochettes, xylophones, mtallophones, orches-
tres de pots, de verres, etc.), cordes (arcs musicaux, harpes,
lyres, guitares, violons, etc.), vent (trompes, trompettes,
cornes, os, conques, sifflets ou fltes, flageolets, fltes de Pan,
harmonicas, appeaux de chasse, ctc.). crcelles, zanzas,
etc., etc ...
Photographies et dessins montrant la faon de se servir
.de l'instrument.
c) Posie et prose:
(Cf. Phnomnes linguistiques ).
ct) Drame:
Costumes, masques, dcors.
Marionnettes, poupes.
Btons de rythme, orchestre, tambours, etc ...
IV. - MONUMENTS DE L'ACTIVIT SOCIALE.
Les phnomnes techniques ne sont pas les seuls se repr-
senter pur des objets. Il existe des monuments plus ou moins
prissables de loules les activits sociales.
1
0
Phnomnes religieux.
a) Objets rituels.
Mobilier sacr, matriel du culte (calchasses, pots, jarres,
corbeilles offrandes, mts, hnnclerolles, nattes, autels, couteaux
de sacrifice; matriel pour le l'en, pour l'cau du sacrifice).
20
Emblmes et poteaux totmiques, churingas, bull-roarers,
linteaux, portes sculptes, blasons, etc ...
Signalisation du tabou.
funraire, bires, sarcophages, cercueils, urnes,
bchers, offrandes, plate-formes et constructions pour l'exposi-
ti0n des cadavres; momies, ttes momifies, reliques, ossements,
botes de crnes, etc. Matriel se rapportant au sacrifice de la
veuve, celui des serviteurs, etc. Vtements et signes de deuil.
Amulettes, talismans, attirail du magicien, charmes, phil-
tres, poupes et objets d'envotement, clous, plantes magiques,
etc. (Cf. ( Techniques magiques n).
Vtements, dcorations, coiffures, masques, etc.
b) Reprsenllion des puissances sar.res:
Idoles, figures sexuelles, reprsentations des forces naturelles,
ma'iques et marques totmiques, reprsentations de l'me des
morts (sculptures, bustes, statues, dents, crnes enfoncs dans
des masques, etc ... ).
Constituer un panthon n en faisant dessiner par les indi-
gnes les figures et aspects de leurs dieux.
2 Phnomnes juridiques.
A) Droit civil.
a) Public:
Insignes de dignits, trnes, mobiliers. Btons de commande-
ment, nuds et btons de messagers. Palladia, parasols, uni-
formes, sabres, lances; attributs, ornements, trophes, etc ...
Objets communaux, objets historiques.
V tements, insignes de castes. Marques et costumes des
esclaves, instruments spciaux pour les convois (fourchettes);
cases d'esclaves; mobilier.
Totems, marques totmiques, poteaux, linteaux, lares,
pnates, etc ...
Objets propres au clan, la famille. Maison des hommes,
maison des femmes. Objets spciaux aux femmes; maison des
filles pubres, des femmes menstrues, des accouches; etc ...
l\Iatriel cles rites d'adoption. Dcoration de la marie.
Etc., etc ...
b) Proprement dit:
Marques de proprit (sur les objets immobiliers, les objets
21
mohiliers, les animaux); marques personnelles, de famille,
de clan, de village, de tribu. Blasonnement.
Matriel des contrats, objets significatifs et mnmotechniques
des contrats.
Objels de mesure, de comput, d'change.
Objets du commerce, matriel de compte, instruments, etc ...
B) Droit pnal:
Matriel pour la procdure, pour les ordalies
et poisons d'preuves, etc.), pour convoquer, amener les dlin-
quants.
Insignes de ceux qui jugent. Matriel pour l'inflictlOn des
peines (fouets, sabres, cangues, chanes), etc ...
3
0
Phnomnes conomiques.
a) Production:
(Cf. (( Technologie .)
b) Transports:
(Cf. ( Technologie .)
c) Cirwlalion des richesses:
Monnaies (ca mis, perles, coquillages, manilles, anneaux,
armes, outils,Iiligrancs, plaquettes de laiton, monnaies de pierre,
de plume, de sel, monnaies europennes remanies, etc ... ).
:Vlesnres (personnelles, de famille, de clan, impersonnelles).
Gages, titres de dettes, elc ...
cl) Rgime de consommation:
Magasins, dpts, silos, greniers, etc ...
4
0
Phnomnes linguistiques.
Objets d'ordre littraire concrtisant un mythe, un conte,
un rcit.
Objets pour marquer les rythmes.
Ecritures, signes, statues, masques, etc ...
Insignes des bardes, des potes.
'Etc., etc ...
(N. B. -' Pour l'enqute linguistique propremenl dite,
voir les Instructions d'enqute linguistique de l'Institut
d'Ethnologie) .
22
V. - DMOGRAPHIE.
Recensements, mouvements de population (Cf. Technomor-
phologie ))).
Statistique des mariages, des naissances, . de la mortalit,
des maladies, etc., etc ...
Tableaux, diagrammes, etc ...
Arbres gnalogiques.
III
ETIQUETAGE ET DOCUMENTATION
Un objet mal identifi est sans valeur au point de vue scien-
"Ufique. Certaines prcautions doivent donc tre prises afin que
chaque pice soit dment repre et qu'il ne risque pas de se
produire de confusion quant aux documents qui s'y rapportent:
1
0
Etiquetage. - Marquer l'objet en plusieurs endroits,
de plusieurs manires, sans le dtriorer.
Etiquettes mtalliques, linges cousus, petits chiffres peints
sur l' obj et lui-mme pourront tre employs, sparment ou
concurremment, selon la nature de l'objet. Dans tous les cas, le
numro attribu l'objet devra renvoyer un inventaire fait
par le collecteur au fur et mesure de la rcolte.
Si le collecteur tient un journal ou un carnet de route, l'in-
ventaire devra rfrer lui-mm ce journal ou ce carnet de
route. Il y a intrt multiplier les recoupements. C'est le seul
moyen d'viter les erreurs, toujours possibles en de pareilles
matires.
2
0
Fiche descriptive. - A chaque objet, indpendamment
des documents divers ou notes que le collecteur pourra commu-
niquer, devra tre annexe une fiche descriptive, tablie en deux
exemplaires. On se servira pour cela d'un carnet dit manifold
ou d'un bloc-notes ordinaire (nous recommandons comme for-
mat particulirement commode 13 cm. 5)< 19 cm. 5) entre deux
feuillets duquel on glisse, avant d'crire au crayon, une feuille
de papier carbone. L'un de ces exemplaires sera dtach du
bloc-notes et expdi par poste au Muse d'Ethnographie, l'autre
restera dans les archives du collecteur.
23
La fiche descriptive devra tre conue sur le modle suivant:
En liant, il allllelle :
numro correspondant
an reaistre d' inuentaire
1. Lieu d'origine.
2. Dnomination et nom.
3. Description.
4. Notes complmentaires.
5. Renseignements ethniques.
6. Pur qui et quand l'objet a t recueilli.
7. Conditions d'envoi au Muse ( remplir par le
Muse).
8. Rfrences iconographiques.
9. Bibliographie.
1) Lieu cl' origine:
Pays politique, subdivisions, localit.
Pour chacune de ces rubriques :
a) nom en langue franaise;
b) nom en langue indigne (Cf. Orthographe phon-
tique ))).
2) Dnomination et nom:
Dnomination :
a) en langue franaise;
b) en langue indigne (avec traduction littrale, si cette
traduction ajoute la dnomination franaise.)
S'il Y a lieu, nom propre de l'tre reprsent, en langue fran-
aise et en langue indigne.
Mots locaux dsignant chaque partie.
3) Description:
Matires (noms scientifiques, noms franais, noms indignes).
Technique de fabrication.
Forme.
Dcor.
4) Noies complmentaires (Cf. cc Formation d'nne collection ).
Renseignements, aussi prcis et nombreux que possible,
sur la fabrication, l'aire de fabrication, l'usage, l'aire d'usage,
les ides et coutumes rattaches l'objet, etc ...
24
5) Renseignements ethniques:
Peuple, tribu, sous-tribu, phratrie, clan d'o provient l'ob-
jet. Nom propre de l'individu qui en a fait usage. (Cf. Formation
d'une collection ).
Pour chacune de ces rubriques, nom franais et nom incli-
gne.
6) Pal' qui cl quand l'objet a t recueilli:
Nom du collecteur. Date laquelle l'objet a t recueilli.
Nom de la mission. Dates de la mission.
7) Conditions d'envoi au Muse (Paragraphe remplir par le
Muse) :
Don, achat, change, prt ou dpt.
Porter la mention utile, suivie du nom propre complet de
l'agent de transmission et la date d'entre au Muse.
8) Rfrences iconographiques:
Numros renvoyant, s'il y a lieu, aux photographies ou des-
sins montrant la fabrication, l'usage, l'objet lui-mme aux dif-
frents stades de sa fabrication.
Lorsque c'est possible, faire excuter des dessins par les
indignes.
9) B{bliographie:
Rfrences au carnet de route ou aux notes du collecteur.
Le collecteur a-t-il l'intention de faire une publication?
Une monographie de l'objet?
3
0
Bordereau. - Pour tout envoi de documents ou d'ob-
jets, bordereau en double exemplaire : un accompagnant les
documents ou les objets, un expdi sparment par poste.
REMARQUES COMPLMENTAIRES.
1
0
Il est rappel aux collecteurs que tous les renseignements
qu'ils pourront fournir, mme s'ils ne se rapportent pas direc-
tement l'objet envisag, sont susceptibles de nous intresser.
2
0
Si le collecteur n'a pas le temps ou la possibilit de four-
nir tous les renseignements requis par le type de fiche que nous
proposons ici, qu'il se borne mentionner les principaux. A
dfaut d'tre complet, qu'il soit du moins exact, et l'objet
recueilli aura une valeur scientifique.
3 Pour la transcription des noms indignes, il y a intrt
employer l'orthographe phontique. (Cf. cc Appendice II .)
25
IV
EMBALLAGE ET PRESERVATION DES SPECIMENS
Les dangers que courent les specimens durant leur transport
de la colonie la mtropole sont de deux sortes : les uns tien..,
nent aux chocs auxquels ils se trouvent exposs pendant le
voyage, les autres des facteurs tels que l'action des insectes,
celle de l'humidit ambiante, etc ...
On parera aux premiers l'aide d'un emballage soigneux,.
en employant, selon les cas et selon les possibilits, du papier,
des copeaux, de la paille, des matires textiles; etc ... La sciure de
bois est excellente pour les objets ne craignant pas la poussire.
Dans tous les eas, il faut soigneusement tasser la matire em-
ploye comme calage.
Dans le cas des poteries, il sera bon de les garnir intrieure-
ment de papier ou de paille, de manire que si l'une d'elles vient
se briser, l'espace qu'elle occupait ne reste pas vide, ce qui pour-
rait amener le. bris des autres specimens.
Dans le cas o des specimens fragiles sont emballs dans
la mme caisse que de plus lourds et de plus rsistants, il est
recommand de fixer solidement les plus lourds et les plus rsis-
tants aux parois de la caisse, de faon viter qu'en se dplaant
ils ne brisent les plus fragiles. .
.
Les dangers d'autres sortes pourront tre carts grce
des prcautions trs diverses, variables selon la ou les matires
dont est constitu le specimen. Les objets de mtal, par exemple,
devront tre graisss pour viter la rouille. Ceux qui com-
. portent des poils, de la fourrure ou de la plume devront tre
emballs avec de la naphtaline, de la poudre de pyrthre ou
autres substances analogues. Dans tous les cas, il conviendra
qu'un specimen quelconque, avant d'tre emball, ait t pra-
lablement dbarrass de tous les insectes ou parasites qu'il peut
porter et tenu bien au sec.
Nous laisserons la charge du collecteur le soin d'apprcier,
pour chaque cas particulier, les moyens de prservation et
d'emballage adquats, qui dpendront, d'une part, du genre de
dtrioration qu'il s'agit d'viter, d'autre part, ~ e ce dont le
collecteur dispose, vu les ressources plus ou moins tendues de
son lieu de rsidence.
26
APPENDICES l, II, III, IV
J. INSTRUCTIONS POUR LA PHOTOGRAPHIE_
Les points principaux retenir sont les suivants :
1 Reprer et noter exactement les conditions (lieu, jour,
orientation, heure, etc.) dans lesquelles a t prise la photo-
graphie.
2 S'il s'agit d'un objet, placer ct de lui, au moment
de le photographier, un mtre grosses graduations ou tout
au moins un autre objet de dimensions connues, de manire
donner son chelle. Au minimum, indiquer la distance qui
spare l'objet de l'appareil en prenant soin d'indiquer galement
la distance focale de l'objectif.
Avant de recueillir un objet, le photographier toujours dans
son cadre originel.
3 Dvelopper de prfrence immdiatement, ce qui assure
une meilleure conservation, et constitue un contrle dans le cas
o les photographies seraient mdiocres ou manques.
40 Numroter chaque clich, ct glatine, l'aide d'une
pointe. Reporter ce numro sur un registre o seront consigns
la description de la photographie et tous renseignements utiles.
En rgle gnrale, faire le moins d'apprts possible, ne pas
rechercher les effets artistiques, rendre compte le plus exac-
tement possible de la ralit.
II. - ORTHOGRAPHE PHONTIQUE.
(Cf. Instructions pOUl' les voyageurs. Instnzctions d'enqute
linguistique et Instructions pour les voyageurs. Queslionnal'e
linguistique. Paris, Institut d'Ethnologie, 1928.)
En ce qui concerne la notation des termes indignes, il est
trs souhaitable que tout collecteur s'astreigne un systme
constant, aussi clair que possible. Celui que nous proposons
repose sur les principes suivants :
1 On n'crit que ce qui est prononc.
20 On prononce tout caractre crit.
30 On adopte toujours le mme signe pour un son dtermin.
27
4
0
On note chaque son distinct par un seul caractre, qui
peut tre une lettre simple ou une lettre munie de signes addi-
tionnels au-dessus et au-dessous.
50 On crit au-dessus de la ligne les sons prononcs faible-
ment.
6
0
On crit entre parenthses les sons prononcs faculta-
tivement.
N. B. - Au cas o le collecteur emploierait un systme
autre que celui que nous prconisons, il devrait indiquer quel
est ce systme.
Tableau des signes essentiels du systme recommand:
28
Signe Prononciation
a comme en franais.
b comme en franais.
d comme en franais.
f comme en franais.
g toujours comme clans gare , jamais comme dans
l
j
k
1
m
n
0
p
r
s
t
v
z
nage .
comme en franais.
comme en franais.
comme en franais (gale aussi q dans eoq , qu
dqns qui , c clans calme )).
comme en franais.
comme en franais.
comme en franais.
comme en franais;
comme en franais.
comme en franais.
toujours comme 'clans signe , jamais comme dans
asile . Egale c clans' faon , c dans espace .
comme en franais.
comme en franais.
comme en franais.
Signes spciaux
l?
a franais de pas )l.
a a franais de parler
c
a (e renvers)
e muet franais (comme dans prenons ).
fi
franais.
f;
ou franais.
eu franais.
9
o franais de pot n.
l)
o franais de Il or n.
U ou franais.
u franais.
, i, , an, in, on, un franais.
h h anglais.
fi gn franais.
S ch franais.
v
J ich franais.
y y franais de yeux Il.
W IV anglais.
Pour les principales consonnes n'existant pas en
adopter les 'signes suivants :
.Les consonnes prononces avec aspiration sont su.ivies d'un ( .
Ex. : t' t aspir.
Les consonnes mouilles sont suivies d'un apex (').
Ex. : V l mouill.
Les consonnes prononces avec emphase comme certaines
consonnes smitiques sont notes avec un point au-dessous.
Ex. : comme la consonne initiale du nom du Coran
en arabe.
Les dentales prononces avec la pointe de la langue releve
sont notes avec deux points en-dessous.
. Ex. : t comme. en anglais.'
Entre les dents on prononce deux spirantes, toutes deux
notes en anglais par th.
On notera la sourde (th de fi thank you ))) par t (1 double
barre), la s0l1ore (th d ({ the Il) par (d barr).
En arrire de la bou che, on prononce divers sons:
K (k barr) ch allemand dans l( ach n.
h courte mission de voix chuchote.
j' (c renvers) occlusion glottale (petit hoquet).
( (epsilonne) sorte de rclement sonore de la gorge .
Cie l'arabe .. ' .
'III. -- OBSERVATION IMPORTANTE.
Les prsentes instructions ne visent pas tre un expos,
mme trs rsum, des principes gnraux des sciences ethnolo-
giques. Elles ont t rdiges dans un but exclusivement pratique
et tendent simplement donner quelques directives essentielles
ceux que solliciterait cette tche urgente entre toutes: recueillir
mthodiquement des objets ethnographiques.
Chaque fois que le collecteur se heurtera une difficult
-chaque fois qu'il dsirera un complment d'inforn:tation, il
est pri de s'adresser l'
INSTITUT D'ETHNOLOGIE
191, rue Saint-Jacques, Paris-Ve
'u au
MUSEE D'ETHNOGRAPHIE
Palais de Trocadro, Paris-XVIe
Toutes les questions et communications y seront accueillies
avec reconnaissance.
Les travaux ou notes intressants seront soumis aux comits
-de rdaction des publications suivantes :
1
0
Pour l'ethnologie en gnral: Travaux el !vI moires
.de l'Institut d'Ethnologie, publis sous la direction de L. Lvy-
Bruhl, Marcel Mauss et Paul Rivet.
2
0
Pour l'Afrique: Journal des A Iriccmistes (Secrtaire
.gnral : P. Lester).
3
0
Pour les Antilles franaises et la Guyane : Journal
des Amricanistes (Secrtaire gnral: Paul Rivet).
Les collections seront recueillies par le 1\IIuse d'Etlznographie r
(Directeur: Paul Rivet, professeur au Museum; sous-directeur :
Georges Henri Rivire). Le Bulletin du Muse d'Ethnographie
accueille les monographies consacres aux collections ethno-
graphiques que le .Muse possde ou qui lui sont destines.
30
IV. - BIBLIOGRAPHIE.
Quelques ouvrages seront utiles ceux qui acqu-
rir une connaissance un peu plus ample de ces questions :
En franais:
Il n'existe pas actuellement de bon ouvrage sur l'ensemble
de la question.
En prparation l'Institut d'Ethnologie ; Instructions pour
les voyageurs. Instructions d'enqute ethnographique.
En anglais:
A.L. Kroeber: Anthropology, New-York, Harcourt, Brace
and Co, 1923.
Notes and Queries on Anihropology, Fifth edition, London,
The Royal Anthropological Institute, 1929.
En allemand:
Georg Buschan: Illustrierte V olkerkunde, Stuttgart, Strecker
und Schrder, 1922-1926, 3 vol.
TABLE DES MATIRES
PrliIllinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. [)
Qu'est-ce que l'ethnographie? - Utilit de l'ethnographie.
- L'Institut d'Ethnologie et le Muse d'Ethnographie. - Il est
urgent de constituer des collections d'objets. - But des prsentes
instructions.
1. Directives gnrales pour fonner une . . .. 8
Choix <le l'objet: prjug de la puret. du style, prjug de
la raret.. - Etude de l'objet.
II. Classement pratique des objets ethnographiques. . . 10
1. Technomorphologie. - II. Technologie proprement dite
(Le feu. Instruments mcaniques gnraux. Machinerie. Tra-
vail de la pierre, du bois, etc ... Poterie. Vannerie. Corderie et
Sparterie. Tissage ct Filage. Armes. Consommation. Acquisition).
Protection et Confort. Transport. Techniques pures). - III. Es-
thtique (Jeux. Arts plastiques. Arts musicaux). - IV. Monu-
ments de l'activit sociale (Phnomnes religieux. Phnomnes
juridiques. Phnomnes conomiques. Phnomnes linguis-
tiques). - V. Dmographie.
III. Etiquetage et documentation.
Etiquetage. Fiche descriptive. Bordereau. Remarques com-
plmentaires.
IV. Exnballage et prservation des specimens.
Appendices l, II, III, IV .......... .
Instructions ponr la photographie: Orthographe phontique.
Observation importante. Bibliographie.
23
26
27
Vous aimerez peut-être aussi
- Augé - Non-Lieux. Introduction À Une Anthropologie de La SurmodernitéDocument3 pagesAugé - Non-Lieux. Introduction À Une Anthropologie de La SurmodernitéClaraMerinoMonteroPas encore d'évaluation
- Thérapie Par PolaritéDocument328 pagesThérapie Par Polaritédeedgi0% (1)
- Ngono FeliciaDocument5 pagesNgono FeliciaEdlove VINGAPas encore d'évaluation
- Claude Levi-Strauss Le Masque Et Le MytheDocument15 pagesClaude Levi-Strauss Le Masque Et Le MytheRyadStarXWPas encore d'évaluation
- Stéphane Vibert: Imaginaire Et Culture - Castoriadis Lecteur de L'anthropologie SocialeDocument12 pagesStéphane Vibert: Imaginaire Et Culture - Castoriadis Lecteur de L'anthropologie SocialeDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Le Recit de Voyage Des Voyageuse FrancaisesDocument28 pagesLe Recit de Voyage Des Voyageuse Francaisesbouchra zaidPas encore d'évaluation
- Pour Une Anthropologie de La Maison (Amos Rapoport)Document111 pagesPour Une Anthropologie de La Maison (Amos Rapoport)Ibrahim Marcel KonatePas encore d'évaluation
- AnthropoDocument10 pagesAnthropojohn AkaPas encore d'évaluation
- 01.2023-24 TD Introduction À L'observationDocument4 pages01.2023-24 TD Introduction À L'observationdeded72899Pas encore d'évaluation
- AcculturationDocument5 pagesAcculturationArno PatyPas encore d'évaluation
- La Logique de L'écritureDocument232 pagesLa Logique de L'écritureSebastienGarnierPas encore d'évaluation
- COPINS, Jean. Aux Origines de L'Anhropologie FrançaiseDocument295 pagesCOPINS, Jean. Aux Origines de L'Anhropologie FrançaisesegataufrnPas encore d'évaluation
- Traduire Ou La Rencontre Entre Les CulturesDocument5 pagesTraduire Ou La Rencontre Entre Les CulturesMariaIsabelValenciaObandoPas encore d'évaluation
- CEMCADocument116 pagesCEMCAJuan Ramón Rodríguez Torres50% (2)
- 2 BechacqDocument45 pages2 BechacqNahum SaintolPas encore d'évaluation
- La Scène Et La Terre. Questions D'ethnoscénologieDocument99 pagesLa Scène Et La Terre. Questions D'ethnoscénologieXavier ChabouPas encore d'évaluation
- Ben Salem Lilia - Intérêt Des Analyses en Termes de SegmentaritéDocument24 pagesBen Salem Lilia - Intérêt Des Analyses en Termes de SegmentaritétolguyPas encore d'évaluation
- Formation Chinois Licence Llcer 2021-2022 v2021-07-16Document47 pagesFormation Chinois Licence Llcer 2021-2022 v2021-07-16GAMING BOYPas encore d'évaluation
- Cours de MissiologieDocument18 pagesCours de Missiologiepropheteholy7Pas encore d'évaluation
- Cahier D'anthropologie Sociale N°17: Images VisionnairesDocument14 pagesCahier D'anthropologie Sociale N°17: Images VisionnairesHerne EditionsPas encore d'évaluation