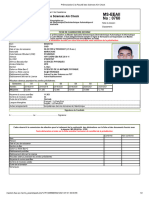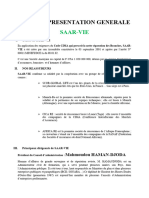Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Classes D'objets - Article - Lgge - 0458-726x - 1998 - Num - 32 - 131 - 2164
Classes D'objets - Article - Lgge - 0458-726x - 1998 - Num - 32 - 131 - 2164
Transféré par
Dhaf TradTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Classes D'objets - Article - Lgge - 0458-726x - 1998 - Num - 32 - 131 - 2164
Classes D'objets - Article - Lgge - 0458-726x - 1998 - Num - 32 - 131 - 2164
Transféré par
Dhaf TradDroits d'auteur :
Formats disponibles
M.
Denis Le Pesant Michel Mathieu-Colas
Introduction aux classes d'objets
In: Langages, 32e anne, n131, 1998. pp. 6-33.
Abstract The authors address the general question of object classes. They present the theoretical bases , stressing the role of "appropriate predicates" , and describe the method to construct classes, including predicate classes. This approach throws new light polysemy. Several applications of object classes to linguistic analysis and processing are suggested and the article ends on associated semantic considerations.
Citer ce document / Cite this document : Le Pesant Denis, Mathieu-Colas Michel. Introduction aux classes d'objets. In: Langages, 32e anne, n131, 1998. pp. 6-33. doi : 10.3406/lgge.1998.2164 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1998_num_32_131_2164
Denis Le Pesant LLI et Universit d'Evry Michel Mathieu-Colas LLI, Universit Paris 13
INTRODUCTION AUX CLASSES D'OBJETS
Ds lors qu'on se fixe comme objectif de faire une description globale de la langue, on constate qu'il n'est pas suffisant de formuler des rgles gnrales. Il faut dcrire toutes les proprits linguistiques de chaque mot, pour tre capable de reconnatre et de gnrer l'ensemble des emplois. A cela s'ajoutent les exigences propres au trait ement automatique des langues (traduction, indexation et documentation, etc.) : aucune application n'est possible si l'on ne rsout pas, au pralable, les problmes lis au figement et la polysmie. Telle est l'orientation qui guide, depuis le dbut, les travaux du LLI. Comme il faut dcrire tous les emplois, la grammaire a besoin d'tre formate en lexique, d'o l'importance accorde l'laboration de dictionnaires lectroniques. Etant donn d'autre part que les emplois ne peuvent tre dfinis (et distingus les uns des autres en cas de polysmie) qu'au niveau de la phrase, ces dictionnaires comportent, dans leur conception mme, une dimension syntaxique. Situe au point de rencontre du lexique et de la grammaire, la notion de classe d'objets se trouve au centre de ce dispositif. Il s'agit, pour l'essentiel, de classes smantiques construites partir de critres syntaxiques , chaque classe tant dfinie partir des prdicats qui slectionnent de faon approprie les units qui la composent. Les classes lexicales ainsi construites se caractrisent par leur fort pouvoir de prdic tion pour un grand nombre de proprits linguistiques. En outre, le modle s'avre directement opratoire pour le traitement automatique, compte tenu de l'attention porte l'analyse des contextes et la dsambigusation des units polysmiques. Nous voudrions, dans les pages qui suivent, rappeler les fondements de la notion de classes d'objets et exposer ses prolongements.
1. Grammaire et lexique Les units lexicales ne peuvent tre apprhendes comme des entits isoles, closes sur elles-mmes, elles doivent au contraire tre dfinies en termes d'emplois dans le cadre des phrases o elles apparaissent. Dj, sur le plan logique, Frege mettait en avant le principe de contextualit : Rechercher la signification des mots non pas isolment mais seulement dans le contexte d'une proposition ; c'est uniquement
dans un contexte que les mots ont leur signification l. Cela vaut aussi bien pour l'analyse de la langue : Le sens d'une unit linguistique se dfinit comme sa capacit d'intgrer une unit de niveau suprieur (Benveniste 1966 : 127). 1.1. Structure de la phrase lmentaire La structure prdicat/ arguments semble plus opratoire que les dcoupages binai res classiques (sujet/prdicat). On la retrouve, avec des variantes, chez Tesnire (notions d'actant et de valence), Fillmore (modle casuel) ou Harris (notion 'opra teur)2. Selon cette perspective, toute phrase simple s'articule autour d'un noyau prdicatif, expression insature (Frege) que viennent complter un ou plusieurs arguments nominaux. C'est le prdicat qui dtermine le nombre de positions constitu tives de la phrase : P(x) P(x,y) P(x,y,z) DORMIR REGARDER DONNER x dort x regarde y x donne y z
Harris innove par un autre principe : ce noyau ne s'identifie pas une seule catgorie morphologique, il est au contraire susceptible de ralisations multiples non seulement sous forme de verbes, mais aussi sous forme d'adjectifs 3 : MORTEL (x) CONTENT (x,y) x est mortel x est content de y
ou de substantifs prdicatifs, que ceux-ci soient associs des verbes (rver I rve) ou des adjectifs (bon I bont), ou qu'ils soient autonomes {aversion) : RVE (x) BONT (x) AVERSION (x,y) fait un rve x est d'un grande bont x a de l'aversion pour y (= x rve) (= x est trs bon)
Encore faut-il, pour qu'il y ait phrase, que le prdicat soit actualis. Si le verbe porte en lui-mme ses propres marques (temps, personne, aspect), l'adjectif et le nom, l'inverse, doivent tre accompagns d'un actualisateur externe : c'est le rle de tre dans les constructions adjectivales (x EST mortel) et celui des verbes supports pour 1. Frege 1884, Introduction et 62. Le mme principe est reformul par H. Putnam, un sicle de distance : Les mots n'ont ni signification ni rfrence en dehors du contexte de l'nonc o ils figurent. Autrement dit, la signification d'un nonc n'est pas la somme des significations des mots qui le composent. C'est le contraire : un mot tire son sens de l'nonc dans lequel il se trouve (Interview publie dans Le Monde, 22-23 oct. 1995). 2 . On remarquera l'analogie avec l'innovation de Frege en logique (analyse de la proposition en termes de fonction et arguments). On pourrait s'interroger sur les causes de cette convergence ; il nous semble qu'elle s'explique moins par une forme d'umversalisme logique que par la convergence de deux disciplines diffrentes dans leur effort pour se librer de la thorie aristotlicienne du jugement (forme binaire sujet/prdicat), qui inspire tant la logique classique que la grammaire traditionnelle. 3. Nous ne parlons ici que des adjectifs prdicatifs . Ils se distinguent structurellement des adjectifs relationnels, qui reprsentent un argument et non un prdicat : voyage {prsident) = le prsident (fait un) voyage, le voyage du prsident, le \oy age prsidentiel.
les prdicats nominaux (faire, avoir, tre permettent de conjuguer respectivement, dans nos exemples, les prdicats rve, aversion et bont) ; cf. Gross et Vives 1986. A la limite, un mme contenu prdicatif est susceptible de dvelopper les trois formes simultanment, sans que la structure smantique ni le schma d'arguments soient modifis : = = = = Luc Luc Luc Luc ADMIR- (Luc, le courage de La) ADMIRE le courage de La est ADMIRATIF (pour + devant) le courage de La a de V ADMIRATION pour le courage de La est en ADMIRATION devant le courage de La
1.2. Le lexique-grammaire Z. S. Harris a eu le souci de proposer une conception de la grammaire entirement explicite et axiomatise. Il part d'une dfinition assez abstraite de la phrase et dcrit toutes les oprations linguistiques (transformations ou effacements) susceptibles de caractriser un emploi donn d'un prdicat. Ces oprations sont dcrites avec une prcision permettant des procdures quasi mcaniques. La cohrence des analyses rend possible une description reproductible du fonctionnement d'une langue. Toutefois, l'accent mis sur la cohrence des rgles ne s'accompagne pas d'une application systmatique au lexique ; les mots illustrent les principes, mais ne font pas l'objet d'une description exhaustive. La mise au point des seules rgles combinatoires ne permet pas encore le traitement automatique. C'est ce qui a conduit Maurice Gross donner la grammaire la forme d'un lexique (le lexique-grammaire ; cf. M. Gross 1975 et 1981). Avec son quipe du LADL, il s'est attach dcrire l'extension lexicale des rgles, c'est--dire regrouper les prdicats qui ont des proprits syntaxiques communes. Ce travail mthodique a montr qu' ct des suites qui peuvent tre gnres par des rgles, il existe une part importante d'idiosyncrasies et de phnomnes massifs comme le figement, que l'on ne peut passer sous silence si l'on veut traiter la langue avec des moyens informatiques. Cet immense travail de structu ration a mis en vidence une vue plus claire du fonctionnement des langues et de leur complexit. 1.3. Ncessit de la smantique La smantique n'est pas absente des travaux du LADL, comme en tmoignent, entre autres, les tudes sur la mtonymie, les phnomnes aspectuels, les noms classifieurs, ainsi que la construction de grammaires locales 4. Toutefois, dans plusieurs 4. Voir en particulier, sur le traitement des phnomnes de mtonymie : Guillet et Leclre 1981 (reconstruction de noms appropris) ; sur les auxiliaires aspectuels : Vives 1984a, 1984b ; sur les noms classineurs : Giry- Schneider 1978 et Guillet 1986. Certaines classes de noms abstraits ont t tudies : noms de maladies (Labelle 1986), de sentiments (Balibar-Mrabti 1993), activits sportives et intellectuelles (Pivaut 1989), termes de dates (Maurel 1989), noms de grandeur et d'unit (Giry-Schneider 1991). Pour l'apport smantique, voir aussi Guillet 1990, Guillet et Leclre 1992 et M. Gross 1997. Sur les grammaires 8
domaines importants, sa place demeure limite. En particulier, les classes de prdicats sont souvent htrognes du point de vue du sens, et la smantique des substantifs non prdicatifs reste minimale (utilisation de quelques traits lmentaires). La ncessit de placer la smantique au centre de la description grammaticale est clairement illustre par l'uvre d'Igor Mel'cuk : le Dictionnaire explicatif et combinatoire (Mel'cuk 1984-1992) dveloppe une description du lexique dans laquelle chaque lexeme (entendu au sens d'une acception de mot) reoit une analyse aussi complte que possible, l'intersection de la syntaxe et de la smantique. Le point de vue explicatif , qui s'exprime sous forme de dfinitions systmatiques et rigoureus es, est doublement complt, sur le plan combinatoire , par la prsentation des constructions syntaxiques (tableaux reprsentant les schmas de rgime ) et l'i ntroduction tout fait novatrice des fonctions lexicales , qui permettent de relier des sens ou des rles smantiques gnraux l'expression particulire propre chaque lexeme (voir par exemple les fonctions Oper, Func ou Labor). L'tude des coocurrences lexicales se trouve ainsi promue au premier plan de la description. Dans le mme sens, une analyse plus fine des restrictions de slection nous conduit rhabiliter la place de la smantique dans la description de la phrase. 2. Les restrictions de slection Un prdicat tant donn, il ne suffit pas toujours, pour que la phrase soit interpr table, d'indiquer le nombre et la construction des arguments. Des restrictions de slection de nature smantique doivent tre introduites dans l'analyse, pour rendre compte de la compatibilit entre les termes cooccurrents. Plus prcisment, on pourra distinguer trois types de situations. 2.1. Absence de contrainte sur les arguments Certains prdicats n'imposent aucune restriction sur le smantisme de leurs argu ments, ou tout au moins de certains d'entre eux. TV, dans les exemples suivants, peut tre ralis par n'importe quel nom (groupe nominal) : Je pense N. Je me souviens de N. J'ai rv de N. Cette remarque concerne N. N me plat. N est important. N n'a aucun intrt. Ces prdicats, le plus souvent monosmiques, ne posent aucun problme de gnration ni de reconnaissance. 2.2. Les traits smantiques Cependant, la plupart des prdicats exigent une spcification smantique de leurs arguments. Prenons le schma syntaxique du verbe tlphoner : No tlphone NT. Formul de la sorte, sans autre prcision sur la nature des arguments, il autorise tout aussi bien des phrases acceptables : locales et la reprsentation par automates finis, voir entre autres Silberztein 1993.
Luc tlphone La
L 'enfant tlphone ses parents
que des phrases aberrantes : *L'explosion tlphone La *L 'enfant tlphone son assiette *Le stylo tlphone au feu d'artifice Du moins ces dernires phrases sont-elles inacceptables dans le discours standard ; des discours dviants sont toujours possibles discours potique, discours onirique, discours dlirant... , mais leur dviance mme (la perception de cette dviance) ne fait que mettre en vidence les rgles transgresses (cf. Prandi 1987 et 1992). La solution consiste caractriser les arguments en termes de traits smantiques 5, relis au prdicat par des contraintes de slection (cf. entre autres Chomsky 1965), tels que humain/non humain, anim/inanim, concret/abstrait, etc. : N0:hum TLPHONERA TS^-.hum Cette caractrisation permet de discriminer un certain nombre d'emplois, en cas de polysmie. On opposera ainsi, selon la nature du sujet, les deux sens de se casser : se briser, se rompre (avec sujet inanim concret) et s'en aller (avec sujet humain, familirement) : (La branche, la table, le stylo...) s'est cass (Pierre, le conducteur, le gamin...) s'est cass Ce systme peut toutefois tre amlior sur plusieurs plans : a) Le couple humain/inanim doit tre complt pour rendre compte de la struc ture de verbes comme mettre bas, dresser (sujet ou objet animal ) ou comme pousser, planter (sujet ou objet vgtal ) ; b) Des prdicats tels que aller , venir de, passer par... slectionnent des argu ments locatifs ; durer, remonter , dater de... exigent comme complments des noms de temps ; c) La catgorie de nom abstrait nous semble problmatique 6. Elle dsigne plutt des noms prdicatifs (ayant donc, ce titre, leurs propres arguments). Pour viter cette ambigut, on peut distinguer provisoirement les actions , les tats et les vnements . Ajoutons que certains humains ont une valeur predicative (par exemple les relationnels : tre l'ami de ou avoir pour ami...). Ainsi redfinie, notre description comporte 10 traits : 6 traits d'arguments (hu main non prdicatif, animal, vgtal, inanim concret, locatif, nom de temps) et 4 traits de prdicats (humain prdicatif, action, tat, vnement). 5. Noue passerons ici sur la question de savoir s'il faut parler de traits smantiques ou syntaxiques : les problmes de frontires entre syntaxe et smantique sont connue depuis longtemps (voir les dbats qui ont accompagn l'essor de la grammaire generative). Notons seulement que, si l'on veut bien donner au terme syntaxe son sens premier, les traits contextuels sont la fois, indissociablement, syntaxiques et smanti ques. 6. Voir l'inverse la position de Balibar-Mrabti 1997. 10
2.3. Des traita aux classes Pourtant, cela ne suffit pas dterminer les diffrents emplois de tous les prdicats. Nombre d'entre eux exigent une analyse plus fine. Certes, il est possible de caractriser le verbe manger en termes de traits : MANGER (No humain+animal, NT inanim concret) J'ai mang deux croissants vs * J 'ai mang deux sentiments tout comme l'adjectif bourratif : BOURRATIF No inanim concret Ce croissant est bourratif vs *Ce camionneur est bourratif
Mais peut-on vraiment dire que l'on mange un concret ou qu'un concret est bourratif ? Cela n'vite en rien les phrases aberrantes : * J 'ai mang deux armoires *Ce pantalon est bourratif Pour obtenir une description adquate, il faut caractriser les termes avec plus de rigueur : dire, pour un prdicat (ou un ensemble de prdicats) donn, quel type prcis de nom peut se trouver en position d'argument 7. Un lexicographe comme Richelet, au XVIIe sicle, ne disait pas manger un OBJET CONCRET mais manger QUELQUE ALIMENT : du pain, de la viande, etc. (Diction naire franais, 1690, s.v. manger). Le Nouveau Petit Robert ne fait pas autrement, lorsqu'il dfinit ainsi un des emplois de boutonner : fermer, attacher (UN VTEMENT) au moyen de boutons , ce qui est sans doute la seule manire d'expliquer la diffrence d'acceptabilit des phrases : La boutonne sa robe vs *La boutonne son vlo Nous nous rapprochons ici, du point de vue thorique, de la notion de substantif classifieur , propose par Gir y- Schneider 1978 et reprise par Guillet 1986 pour reprsenter certaines distributions dans un lexique-grammaire : le recours des classes smantiques est indispensable pour caractriser certains emplois de verbes 7. Cette question n'est pas nouvelle : on la trouvait dj pose dans le contexte de la philosophie analytique (cf. Roesil989). 'est par exemple Carnap (1928, 1932) qui met en cause des noncs tels que : Csar est un nombre premier. Contrairement aux noncs vrais (7 est un nombre premier) et aux noncs faux (16 est un nombre premier), la phrase en cause est dpourvue de signification. Bien que conforme aux rgles minimales de la syntaxe grammaticale, elle viole les rgles smantiques (il y a confusion de sphres ) : d'o la ncessit d'laborer des catgories qui tiennent compte du type d'objet chose, nombre, etc. , tche que Carnap assigne la syntaxe logique . La smantique formelle dveloppera une formalisation logique propre viter ce type de difficult. Etant donn une fonction propositionnelle F(x), on restreindra le domaine de valeurs de la variable (le champ qu'elle parcourt) afin d'exclure les noncs dnus de sens. Pour reprendre l'exemple du prdicat tre un nombre premier , seules les valeurs qui donnent un sens l'nonc seront admises : 3, 7, 8, 16..., mais non Csar ou la Lune, ce qui revient dfinir un domaine d'objets appropri au prdicat. Dans une perspective moine exclusivement logique et plus proche de la problmatique du langage ordinaire , un philosophe comme Ryle (1949) s'attache dnoncer les confusions conceptuelles rsultant des erreurs de catgorie (category-mistakes). Chaque catgorie doit tre diffrencie en tenant compte des propositions dans lesquelles elle s'insre, et on ne peut appliquer des prdicats des objets qui ne leur conviennent pas. 11
comme contracter (UNE MALADIE : un rhume, la grippe...) ou enfiler (UN CHEMIN : une rue, un couloir...). Il s'agit l d'une notion clairement grammaticale et non pas d'un critre de classement du rel 8. Ce principe, condition d'tre tendu et systmatis, permet de rsoudre de manire conomique la plupart des ambiguts dues la polysmie. Pour distinguer les emplois d'un verbe comme prendre (prendre un train I prendre une route I prendre un steak, etc.) et les intgrer dans un traitement automatique, le moyen le plus direct et le plus efficace est de procder un typage des arguments : on pourra dire, en l'occurrence, que chaque emploi se caractrise par la catgorie smantique du com plment (noms dsignant respectivement des moyens de transport, des voies de com munication, des aliments...). Ce sont ces descripteurs la fois syntaxiques et smantiques que nous avons propos de systmatiser sous l'appellation de classes d'objets (G. Gross 1992 et 1994, Mathieu-Colas 1994). Nous nous cartons, ce faisant, de l'interprtation usuelle que reoit cette expression en logique, en liaison avec l'analyse des concepts ( Le concept dfini en comprhension correspond en extension une classe d'objets , Grand Robert 1985, s.v. concept 9), pour la redfinir selon deux paramtres : nous dsignons par l non des ensembles d'entits ou d'lments extralinguis tiques mais des classes lexicales (des ensembles de mots smantiquement apparents) ; nous tenons compte, pour le regroupement de ces mots, de leurs proprits syntagmatiques : une pertinence relationnelle (pour reprendre une expression de M. Prandi) vient se substituer la pertinence classificatoire traditionnelle, fonde sur des critres inhrents, tout en produisant elle-mme un nouveau type de classification. 3. Les prdicats appropris 3.1. La dfinition des classes Les classes d'objets, considres en tant que classes d'arguments, se dfinissent par relation avec les prdicats qui leur sont spcifiques. Dans le meilleurs des cas, un seul prdicat suffit, de par sa spcificit, dlimiter une classe entire, comme dans les exemples suivants : rdiger <TEXTE> peler <MOT> ressemeler <CHAUSSURE> Chacun de ces verbes offre un critre distinctif ncessaire et suffisant pour fonder une dfinition en comprhension de la classe. Pour nous limiter au premier exemple, nous classerons parmi les <textes> toutes les units lexicales et seulement elles qui peuvent apparatre comme complments du verbe rdiger : lettre, roman, essai, article, etc. 8. Guillet 1986 : 102. Voir aussi, dans Dubois 1997, l'intgration de paradigmes lexicaux dans le scheme syntaxique de certains verbes (e.g. gurir de + nom de maladie ). 9. Les concepts, selon la tradition, sont des notions gnrales dfinissant des classes d'objets donnes ou construites, et convenant d'une manire identique et totale chacun des individus formant ces classes, qu'on puisse ou non les en isoler. Par exemple le concept de vertbr, le concept de plaisir, etc. (Lalande 1938). C'est nous qui soulignons. 12
Cependant, la polysmie des prdicats exclut le plus souvent cette possibilit. Il faut alors, pour dlimiter une classe d'objets, recourir la conjonction de plusieurs critres (comme on le fait pour les phonmes) : deux ou trois verbes suffisent souvent pour constituer une sorte de gerbe ou de faisceau dfinitionnel. Prenons l'exemple des noms de vtements : Fred A MIS (son jean, son blouson, sa cravate, ses pantoufles...) Fred TAIT EN (jean, blouson, cravate, pantoufles...) (Ce jean, ce blouson, cette cravate. . .) lui VA BIEN Aucun des verbes en prsence, lui seul, n'est spcifique de la classe : Fred A MIS le chauffage. Fred A MIS la tl. Fred A MIS deux heures pour. . . Fred TAIT EN forme. Fred TAIT EN vacances. Fred TAIT EN Angleterre. Les cheveux courts lui VONT BIEN. La colre lui VA BIEN. Cette dcision lui VABIEN. Mais la runion des trois prdicats permet de dlimiter, de manire cohrente et sans aucune ambigut, une classe des noms de <vtements> I0 : METTRE (humain, vtement) TRE EN (humain, vtement) ALLER BIEN (vtement, humain) Ds lors celle-ci se trouve fonde, non plus, comme il est d'usage, sur des traits dfmitionnels inhrents ( objets servant couvrir le corps humain ), mais sur des critres syntaxiques. Certes, d'autres choix seraient possibles pour assurer cette fonction de discrimi nation : on pourrait songer d'autres verbes (par ex. porter), des adjectifs (tre seyant) ou des noms prdicatifs (confection, essayage). L'essentiel, dans tous les cas, est que le faisceau dfinitionnel soit la fois conomique et pertinent. Nous ne nous autorisons ouvrir une nouvelle classe que lorsque nous pouvons lui associer une dfinition syntaxique minimale. 3.2. La description des prdicats appropris II convient de distinguer cette dfinition en comprhension des classes qui implique la recherche de critres minimaux et leur description en extension. Ce deuxime aspect n'est pas moins important, ne serait-ce que du point de vue du traitement automatique : la reconnaissance et la gnration de l'ensemble des phrases ncessite, pour chaque classe, le recensement de tous les prdicats qui leur sont appropris ll. 10. Dane le voieinage de la classe se situent certains objets personnels comme les lunettes, les bijoux, les montres, etc. On peut les mettre (ou les porter) comme des vtements, ils peuvent aller plus ou moins bien (tre plus ou moins seyants), mais ils ne rpondent pas au critre tre en (*tre en bague, *tre en lunettes...). 11. On trouve dj des lments de description semblables dans Dubois 1979 : le Dictionnaire du franais langue trangre se caractrise la fois par une catgorisation des noms en termes de classes et par la dfinition, pour chaque classe, de quelques proprits syntaxiques (voir l' Annexe grammaticale ). Mais le recensement ne vise pas l'exhaustivit. 13
Cela s'applique naturellement aux verbes : les noms d'<aliments> et de <boissons> ont un rapport direct avec les variantes de manger et de boire (absorber, avaler, bouffer, consommer, ingurgiter, dguster, siroter, etc.) ; on essaye un vtement, on en change ou on Vote ; un instrument de mesure indique ou affiche une valeur ; on monte bord d'un avion, on le pilote. . . Les mmes considrations valent pour les adjectifs prdicatifs : tout objet pris dans la classe des noms de <vtements> est susceptible d'tre slectionn par la mode ou dmod, bien ou mal assorti, seyant, us, voyant... ; un instrument de mesure peut tre prcis, juste, fidle, faux, drgl, gradu... ; un aliment sera qualifi, selon les cas, d'apptissant, succulent ou bourratif, indigeste, (plus ou moins) nourrissant ou riche en calories.. . Les lments de chaque classe peuvent encore apparatre comme arguments (sujets ou complments) de noms prdicatifs. On parlera de la confection ou de l' essayage d'un vtement, du rglage d'un instrument de mesure, de Y accord d'un instrument de musique, de la fracheur ou du got d'un aliment. Les noms d'<avions>, en tant que tels, entretiennent une relation privilgie avec des prdicats comme dcollage, atter rissage, pilotage. Cette mise en valeur du rle des prdicats nous diffrencie des dictionnaires analogiques et des thsaurus. Il est vrai que les dictionnaires analogiques offrent de nombreuses nomenclatures, cependant que le Thsaurus Larousse (1991) adopte un classement mthodique inspir de son modle anglais (le Thsaurus de Roget, dont la premire dition remonte 1852) 12. Mais ces ouvrages, quelle que soit leur vidente richesse lexicale, ne se proccupent pas de syntaxe. D'une part, les prdicats demeur ent l'arrire-plan et ne font pas l'objet d'un recensement systmatique (on a peine trouver, pour les vtements, les verbes enlever, ter, dfaire, tre en. . .). D'autre part, aucun lien organique n'est tabli entre les quelques prdicats mentionns et les listes de noms : on trouve ple-mle, ici et l, habiller, vtir, aller bien ou mal, sans diffren ciation du sujet et de l'objet, ce qui rend les inventaires inadapts au traitement automatique. On conoit, par contraste, la spcificit de notre dmarche. 3.3. La hirarchie des classes Cela nous conduit un rexamen de la relation hyperonymie/hyponymie (cf. Mortureux, d., 1990). Elle est souvent dcrite, d'un point de vue notionnel, partir de la relation tre un (Les siamois sont des chats, les chats sont des animaux), tant entendu que cette relation est transitive : Les siamois sont des animaux. partir de ce principe, il est possible d'laborer des rseaux lexicaux de type hirarchique. L'un des meilleurs exemples et l'un des plus actuels en est incontestablement WordNet (Miller et al., 1993). Cette base de donnes lexicale en 12. Tous les termes y sont prsents dans le cadre d'une arborescence qui mle les classes et les domaines. On trouve l de nombreuses listes : 3 pages entires sont consacres aux noms de peuples ou d'ethnies, 3 pages aux noms d'oiseaux (dont plus de 130 dsignations pour les seuls passereaux...), 2 pages aux noms de vtements, avec un paragraphe pour les vestes, un autre pour les robes, un pour les pantalons, jusqu'aux tenues de sport, aux habits de crmonie et aux uniformes. S'y ajoutent quelques prdicats, notamment des verbes (porter, avoir sur soi, revtir...). 14
ligne est fonde sur une description rigoureuse des relations smantiques entre mots (synonymie, antonymie) et entre signifis (mronymie, hyponymie). Les relations d'hyponyme hyperonyme y occupent une place privilgie et permettent de dvelop per une structure smantique hirarchise, notamment pour les noms. partir de 25 classes poses comme primitives (action, animal, artefact, etc.), l'ensemble des substantifs se trouve rparti entre autant de sous-classes qu'il est ncessaire (p. ex. organisme > plante > arbre > chne). Un systme de pointeurs permet de parcourir la hirarchie dans les deux sens et d'obtenir immdiatement, pour un terme donn (ou plus prcisment pour un ensemble synonymique ), tous les hyperonymes et hyponymes prsents dans la base. Toutefois, l'approche de WordNet demeure intrinsquement paradigmatique. L'ide apparat bien, chez ses concepteurs, de relier les adjectifs et les verbes leurs arguments nominaux par un systme de pointeurs (Fellbaum, Gross and Miller, 1993 : 31-32 ; Fellbaum, 1993 : 41). Mais le codage n'est pas (encore) disponible : le lexique, pour l'essentiel, y reste dissoci de la grammaire. Cela est encore plus vrai des arbres smantiques . Qu'ils prennent comme point de dpart un systme logique conu a priori ou une classification naturelle du monde, ils n'ont pas de proccupation grammaticale 13. A l'inverse, telles que nous les concevons, les classes d'objets ne doivent leur validit qu'aux proprits linguistiques qui leur sont associes : d'o une nouvelle lecture de l'hyperonymie. Paralllement aux dfinitions notionnelles (l'Airbus est un avion, l'avion est un moyen de transport...), nous proposons de prendre en compte le comportement des prdicats. Le verbe prendre ou plus prcisment un de ses emplois tant appropri la classe des moyens de transport (prendre un train, un bateau, un avion), il y a transmission du verbe, par hritage , tous les hyponymee : PRENDRE (moyen de transport) > (avion) (Airbus) Ce qui caractrise linguistiquement l'Airbus comme moyen de transport, c'est qu'on puisse le prendre, y monter, en descendre, aller ou voyager en Airbus, etc. ; ce qui le qualifie comme avion, c'est qu'il dcolle, qu'il atterrisse, qu'on le pilote... De la mme faon, les hyponymes hritent des adjectifs et des prdicats nominaux attribus leurs hyperonymes : aux adjectifs spcifiques de la classe des <fruits> (par ex. mr) s'ajoutent les qualits appropries l'ensemble des <aliments> (dlicieux, bourratif...) ; on peut parler de la cueillette des fruits (substantif appropri), mais aussi de leur consommation. Plus gnralement, notre reprsentation de l'inclusion des classes diffre de l'i nterprtation logique par l'attention porte aux facteurs linguistiques ce qui pourrait se traduire par une double reformulation des notions ^extension et de comprhens ion : une classe A (e.g. les noms de <moyens de transport>) inclut, en extension, une 13. Voir par exemple le codage des Semcat dans le systme de traduction automatique dvelopp par Systran : les quelque 500 classes qui le composent s'inscrivent dans une arborescence stricte et contrai gnante (au point qu'elle ncessite, pour bloquer des hritages indsirables, la prsence de stoppeurs ). 15
autre classe (e.g. les noms d'<avions>) si les units lexicales de reprsentent un sous-ensemble des units de A ; les prdicats appropris A sont l'inverse inclus, du point de vue de la comprhension, dans l'ensemble des prdicats caractristiques de (parmi les prdicats applicables aux noms d'avions figurent ceux qu'ils hritent des noms de moyens de transport). L o la logique dfinit la comprhension par des proprits notionnelles intrinsques, nous proposons de la rinterprter, sur le plan linguistique, par des proprits contextuelles. Ces considrations nous conduisent carter tout modle d'arborescence trop schmatique, qui supposerait que les hyponymes ne puissent tre subordonns qu' un seul hyperonyme. La prise en compte des prdicats dans la dfinition des classes oblige une rvision de la modlisation. Considrons par exemple les noms de boissons : ct de leurs oprateurs spcifiques (boire, siroter, imbuvable...), ils peuvent hriter conjointement des prdicats appropris l'ensemble des aliments (prendre, avaler, indigeste. . .) et de ceux qui s'appliquent aux liquides (couler, renverser. . .). De la mme faon, des mots comme tanker, ptrolier, etc. partagent la syntaxe des bateaux et celle des contenants. Cette ncessit de prendre en compte les hritages multiples complique assurment la reprsentation des rapports hirarchiques, mais elle est indispensable pour une description adquate de la langue 14. 4. Les classes de prdicats Notre description ne se limite pas aux classes d'arguments lmentaires. Nous avons entrepris, selon les mmes principes, une classification smantique des prdi cats. De nombreux adjectifs ont la proprit de pouvoir figurer en position d'pithtes de noms qui leur sont appropris (cf. Laporte 1997). Ces noms sont effaables sous certaines conditions : Max a un COMPORTEMENT agressif = Max est agressif Cette table est de FORME ovale = Cette table est ovale Cette relation peut servir de base la constitution de classes d'adjectifs : adjectifs de <couleur>, de <forme> (pointu, rond, carr, oblong. . .), de <comportement> (agressif, affectueux, poli. ..), etc. l5 Pour construire les classes de prdicats nominaux, nous prenons en compte la forme de leurs verbes supports ; c'est ainsi que les noms de <dlits> se caractrisent par des supports comme commettre, se rendre coupable de, etc. En outre, les verbes et les noms prdicatifs tant susceptibles d'tre enchsss en position d'arguments dans la phrase complexe, leurs classes peuvent tre dfinies partir des prdicats appropris de niveau suprieur ; pour reprendre l'exemple des prdicats de <dlits>, ils sont slectionns par des verbes tels que condamner qqnpour. 14. La notion d' hritage multiple se retrouve en informatique, dans la programmation objets. 15. Voir par comparaison la catgorisation propose dans WordNet (Fellbaum, Grose et Miller 1993). Les classes d'adjectifs y sont gnralement articules autour d'une paire d'antonymes (par ex. lourd/lger, sec/humide, actif/ 'passif), chacun des ples pouvant tre li, par une relation de similarit , plusieurs adjectifs (ou mme plusieurs sries eynonymiques). 16
Nous dvelopperons ici plus particulirement les deux derniers points. 4.1. Un critre de classement des prdicats nominaux : la forme des verbes supports II existe des verbes supports gnraux, qui servent la dfinition des traits tat, action et vnement -.faire est le verbe support gnral pour les actions, avoir ou tre Prp pour les tats, et il y a pour les vnements (faire un voyage, tre en colre, il y a un orage) . Mais la gnralit de ces verbes aboutit souvent, dans le dtail, des phrases d'une grammaticalit plus qu'approximative : ?Le chirurgien a fait une opration de l'appendicite *Pierre a fait un cri ?Luc a fait un crime Cela rend ncessaire l'utilisation de variantes plus spcifiques, les verbes supports appropris (G. Gross 1996) : Le chirurgien a pratiqu une opration de l'appendicite Pierre a pouss un cri Luc a (commis, perptr) un crime De telles observations nous permettent d'envisager la construction d'un certain nombre de classes d'objets de prdicats nominaux partir de la forme de leurs verbes supports appropris. On pourra ainsi subdiviser les actions en diverses classes : <oprations chirurgicales> (pratiquer), <bruits vocaux> (mettre, pousser), <dlits> (commettre, se rendre coupable de) et <dlits-crimes> (perptrer), <coups> (assner, donner), <oprations techniquee> (effectuer, procder ), etc. La mme mthode s'applique aux prdicats nominaux d'tat et d'vnement (voir, pour ces derniers, G. Gross et F. Kiefer 1995). Les verbes supports appropris connaissent eux-mmes des variantes. Prenons l'exemple des noms de sentiments ; ct du support gnral avoir et du support appropri prouver (Jack avait ou prouvait de l'enthousiasme pour le thtre), il existe des variantes aspectuelles et intensives : Jack s'est laiss (gagner, envahir) par (l'enthousiasme, la panique) Jack dbordait (d'enthousiasme, de joie) Jack brlait (d'enthousiasme, d'impatience) Se laisser gagner par et se laisser envahir par sont des inchoatifs ; dborder de et brler de ont une valeur intensive. 4.2. Dfinition des classes de prdicats par leurs prdicats appropris de niveau suprieur Les prdicats sont susceptibles, dans la phrase complexe, d'tre en position d'ar guments. Des classes de prdicats peuvent alors tre dfinies par les prdicats de niveau suprieur qui les slectionnent de faon approprie (cf. Harris 1976). 17
4.2.1. Prdicats nominaux Etant donn la simplicit syntaxique du mode d'enchssement des prdicats nomi naux, l'identification des prdicats qui les slectionnent ne pose pas de problmes importants. On peut vrifier par exemple que l'adjectif communicatif est un des prdicats appropris des prdicats de sentiments en utilisant la construction : Jack a (de l'amour, du dgot, de l'enthousiasme...) pour le thtre. Prdicats nominaux deux arguments actualise par le verbe support avoir. [(L'amour, le dgot, l'enthousiasme...) que Jack a pour le thtre] est communic atif. Le prdicat adjectival communicatif a. un argument-sujet d'origine phrastique. Les noms de sentiments, dans cet exemple, gardent leur statut de prdicats (comme l'atteste la prsence de leurs arguments : Jack, pour le thtre), tout en devenant les arguments d'une structure au second degr. 4.2.2. Verbes Lorsque le prdicat est un verbe, on se trouve devant des situations plus difficiles : il faut considrer le prdicat tantt l'intrieur d'une compltive de forme le fait que P, tantt l'intrieur d'un groupe nominal construction relative (ce qu-P ; la manire dont P), tantt l'intrieur d'une interrogative indirecte, comme dans : estimer (combien cote, combien revient) un appartement Estimer est appropri aux verbes coter et revenir , tout comme au substantif prix dans la paraphrase estimer le PRIX d'un appartement. Cela revient dire que la classe des complments de estimer ne se Kmite pas aux substantifs (prix, valeur, cot), mais doit tre largie une classe d'objets verbaux (coter, valoir, revenir ...). On peut galement utiliser les phnomnes d'anaphore pour construire des classes de prdicats verbaux. Les hyperonymes d'une classe ont la proprit de pouvoir figurer en position d'anaphore infidle de tout lment de la classe. Sachant que le prdicat nominal crime est l'hyperonyme de la classe de prdicats nominaux ayant perptrer comme verbe support appropri, on en dduit par extrapolation que tout verbe anaphoris par le nom crime est un verbe de la classe des prdicats de <crime>. Cette mthode est cruciale dans le cas des verbes qui n'ont pas de variante dverbale permettant de dcouvrir le verbe support appropri. Un exemple illustrera ce cas de figure : Ces gens ont t tus, trangls, gorgs ; le crime ne devra pas rester impuni 4.2.3. Les prdicats causatifs ct des verbes causatifs gnraux, chaque classe predicative est susceptible d'avoir des formes causatives appropries, par exemple, pour les noms de <sentiments> : remplir qqn (d'enthousiasme, de joie, de tristesse) susciter (l'enthousiasme, la jalousie, la colre) de qqn 18
Ces formes ont elles-mmes des variantes grce auxquelles il est possible de souscatgoriser les prdicats de la classe. Dans les exemples qui suivent, les astrisques mettent en vidence, par contraste, les restrictions de slection entre verbes causatifs et noms prdicatif s : exciter l'amour-propre de qqn plonger qqn dans la tristesse transporter qqn d'allgresse rfrner la colre de qqn vs vs vs vs *dchaner l'amour-propre de qqn *plonger qqn dans l 'allgresse ^transporter qqn de tristesse *rfrner la tristesse de qqn
Les prdicats causatifs sont susceptibles, comme les verbes supports, d'avoir des variantes intensives {exciter, dchaner, transporter) ou restrictives (rfrner). 4.2.4. Les proprits aspectuelles Les prdicats aspectuels (tels que aboutissement, durer, tre en train de, fin, recommencer, etc.), offrent un autre moyen d'affiner l'analyse des classes de prdicats. Il en va de mme avec la prise en compte des locutions adverbiales de temps (e.g. pendant un jour, en un jour, pour un jour...). L'ide est d'appliquer les tests non quelques units mais des classes entires pour enrichir les classifications traditionn elles (voir notamment, dans Vendler 1967, la distinction entre tats, activits, accomp lissements et achvements). Pour les prdicats d'<vnements>, cf. Gross et Kiefer 1995 et, ici mme, l'article de F. Kiefer. 4.3. Problmes de hirarchisation Les prdicats peuvent se prter aussi une hirarchisation. On peut ainsi montrer que les prdicats d'<ordre> (injonction, ordre, ordonner, commander...), qui ont des prdicats appropris tels que excuter, obir, etc., hritent des prdicats appropris aux mots de <parole> (bafouiller, hurler. ..) et d'<crits> (rdiger, raturer. . .), lesquels hritent leur tour de certains prdicats d'<actes> (lche, courageux, barbare. . .), ce qui donne, par transitivit, la hirarchie : <acte> (<parole> ou <crit>) <ordre> Ce type de raisonnement devrait aussi permettre d'aborder le phnomne de la troponymie (cf. WordNet et plus particulirement Fellbaum 1993 : 47-49). Pre nons l'exemple des verbes de mouvement : se dplacer > marcher, courir, nager... i marcher boiter, dambuler, presser le pas... i boitei > boitiller Les verbes hyponymiques reprsentent ici des modalits de leurs hyperonymes : marcher, c'est se dplacer d'une certaine manire ; on peut se mouvoir plus rapidement (courir), dans plusieurs directions (avancer, reculer, monter, descendre), dans les airs ou dans l'eau (voler, nager), etc. ; la marche elle-mme peut s'effectuer de 19
plusieurs faons, sans compter les nuances aspectuelles : marcher/ 'se mettre en marc he, boiter/boitiller Les mmes relations s'observent pour les noms prdicatifs : dplacement > marche, course, nage... marche > boitement (claudication), dambulation... 4.4. Articulation, entre classes d'arguments et classes de prdicats II reste tablir le type de relation qui unit les classes de prdicats (qu'elles soient ou non hirarchises) et les classes d'arguments. On notera ainsi que l'ensemble des adjectifs relatifs au got (amer, sucr, sal, etc.) entretient un rapport privilgi avec l'ensemble des noms d'aliments et de boissons. A l'intrieur de cette association gnrique, des relations plus spcifiques se dessinent, se juxtaposent ou s'entrecroisent en un rseau complexe d'affinits. Que l'on songe seulement aux qualifications appropries la classe des vins : bouquet, capiteux, gnreux, moelleux, gouleyant... (on ne parlerait pas ainsi du caf ni du lait, ni mme de la bire ou du cidre) ; mais fruit se dit aussi des huiles et des alcools de fruits, cependant que velout peut qualifier des crmes ou des sauces. Reprenons le cas des verbes de mouvement. Un certain nombre d'entre eux s 'appliquent plus particulirement aux tres anims : marcher, courir, sauter se disent des humains et des quadrupdes, trotter et galoper n'ont pas le mme sens selon qu'on parle d'un cheval ou d'un homme, prendre son envol, battre des ailes, se poser (quelque part) est le propre des oiseaux et des insectes, s'agenouiller est plus spcif iquement humain, etc. Si correspondances il y a, elles n'ont rien de systmatique et demandent, dans chaque cas, une analyse de dtail. A cela s'ajoute le fait que, au fur et mesure qu'on descend dans la hirarchie des prdicats, le nombre de mots susceptibles de figurer en position d'arguments dcrot (cf. Fellbaum 1993 : 49). Plus gnralement, on observe des croisements entre les deux types de classes : les prdicats appropris une mme classe d'arguments peuvent, en tant que prdicats, relever de plusieurs classes, cependant qu' l'inverse les prdicats d'une classe donne peuvent tre distribus entre plusieurs classes d'arguments.
5. Traitement de la polysmie II n'est pas tonnant que les classes d'objets s'avrent clairantes pour le trait ement de la polysmie puisque, nous l'avons dit ds le dpart, elles ont t en partie conues dans ce but. Encore faut-il apprhender le phnomne dans toute sa comp lexit et ne pas se limiter, comme on le fait trop souvent, une opposition binaire et schmatique entre polysmie et homonymie . Il existe, de notre point de vue, au moins deux types de polysmie : l'une relie, par divers glissements de sens, des emplois clairement dlimits et lexicaliss (chaque emploi fonctionne comme un lexeme dis tinct) ; l'autre autorise, pour un mme lexeme, des effets de sens plus ou moins 20
productifs et lis au contexte (polysmie dite rgulire ou systmatique 6). Or, dans un cas comme dans l'autre, la notion de classes est pertinente.
5.1. Les polysmies lexicalises Quand il s'agit de polysmies lexicalises, les classes, combines avec les traits, permettent dans une trs large mesure de diffrencier les emplois. Considrons par exemple quelques emplois du mot crapaud : MOT CRAPAUD #1 CRAPAUD #2 CRAPAUD #3 CRAPAUD #4 CRAPAUD #5 etc. TRAIT animal abstrait concret concret concret CLASSE batracien maladie animale instr. de musique sige dispositif DOMAINE zoologie md. vtr. musique ameublement ch. de fer ANGLAIS toad greasy heel baby grand tub easy-chair sleeper clip
Chaque indication de classe correspond des ensembles de constructions caractris tiques : les coassements d'un crapaud (batracien), souffrir d'un crapaud (maladie), jouer sur un crapaud (instrument), s'asseoir dans un crapaud (sige), etc. De manire complmentaire, les termes prdicatifs peuvent tre caractriss par les classes d'arguments propres chacun de leurs emplois. Voici, titre d'exemple, un extrait de la description des mots conduire et lourd : , :hum/N2:locatif N0:hum/N1 :moyen de transport N0:concret No: aliment N0:terrain No: odeur Pat conduit son petit frre l'cole Pat conduit une dcapotable Ce sentier conduit la mer cet objet est lourd cette sauce est lourde la piste est lourde ce parfum est trop lourd
Chaque emploi se trouve ainsi dcrit de manire approprie ce qui justifie, s'il en tait besoin, le principe du dgroupement. Cela ne signifie pas que l'on ne puisse tablir des liens historiques ou structurels entre les diffrentes acceptions (mcanisme des tropes : mtaphore, mtonymie, etc.) ; mais l'identification des liens prsuppose une claire diffrenciation des emplois. Du point de vue mme de la reprsentation des 16. Apresjan 1973 parle de polysmie rgulire , Nunberg et Zaenen 1997 utilisent la dnomination polysmie systmatique . On trouvera dans la note 2 de l'article de Nunberg et Zaenen une liste de huit autres dnominations, avec les rfrences de ceux qui les utilisent. On aura not qu'en adoptant la dichotomie polysmie rgulire/polysmie lexicalise, noue nous situons dans une perspective nettement moins continuiste que celle de Victorri et Fuchs 1997. 21
relations polysmiques, le dgroupement des entres offre le meilleur format de description (pour une analyse plus dtaille, voir Mathieu-Colas 1996a). 5.2. Les polysmies rgulires Les polysmies rgulires, quant elles, fonctionnent diffremment : il n'est plus question de choix univoque entre des classes disjointes, mais plutt de cumul d'emplois au sein d'une mme classe. C'est le contexte, et plus particulirement la nature des prdicats, qui se charge d' activer tel ou tel emploi. Soit par exemple le mot fentre : La fentre a t repeinte (objet physique) La s'est glisse travers la fentre (ouverture) Le verbe repeindre slectionne l'emploi concret, alors que glisser ( travers) exige un complment locatif. Il est remarquer qu'il ne s'agit pas d'une analyse ad hoc, puisque cette proprit caractrise tous les lments de la classe des <ouvertures-fermetures> (fentre, porte, etc.) ; c'est la classe elle-mme qui est polysmique. Considrons maintenant les noms de <pays>. En tant que locatifs, ils ont pour prdicats appropris rsider (Prp), s 'expatrier (de), etc. , et ils hritent les prdicats gnraux des locatifs (par exemple les <dimensions>). Dans un autre emploi, ils fonctionnent comme des humains collectifs, avec pour oprateurs appropris des prdicats d' activit civique : voter, basculer droite, insurrection, etc., et ils admettent par hritage un grand nombre de prdicats humains (accueillant, musicien, courageux, etc.). cette proprit d'hritage multiple s'ajoute une proprit manifes te dans le discours ; la possibilit pour les diffrents emplois d'tre concatns et anaphoriss (effet de syllepse) : J'ai parcouru cet immense tat, il est en pleine rvolution. Alors que le pronom personnel est employ dans le sens humain collectif, son antcdent l'est dans le sens locatif (anaphore divergente ). De faon gnrale, la polysmie rgulire peut tre traite au moyen de la notion d'hritage multiple et en prenant en compte la relation discursive de syllepse. Ce sont les classes d'objets qui offrent le meilleur cadre d'analyse (e.g. polysmie des classes de noms de livres, de journaux, d'entreprises et institutions, classes articules sur la relation nom de contenant/nom de contenu, etc.).
6. Dveloppements et applications Le type de catgorisation que nous proposons permet d'aborder la description de nombreux phnomnes linguistiques ; nous en donnons ici quelques exemples. (La pertinence des classes d'objets pour d'autres paramtres de l'analyse la dtermi nation, l'aspect, les anaphores, les connecteurs, la synonymie, etc. fait galement l'objet de recherches spcifiques au LLI.) 22
6.1. Proprits transformationnelles Les dictionnaires lectroniques, tels que nous les concevons, enregistrent les pro prits transformationnelles de chaque prdicat l7. Nous mettons ici l'accent sur celles d'entre elles qui mettent en jeu les classes d'objets. Certaines nominalisations sont conditionnes par le type smantique des arguments. Par exemple, le verbe prendre est nominalisable en prise quand il slectionne en position de complment d'objet des noms de <mdicaments> ou de <drogues> ; la nominalisation est en revanche impossi ble quand le complment appartient la classe des <aliments> ou celle des <voies> : prendre (un antibiotique, de la cocane, de la salade, une route nationale) prise (d'un antibiotique, de cocane) vs *prise (de salade, d'une route nationale) Par ailleurs, il arrive que tous les mots d'une classe smantique aient des proprits transformationnelles communes. On peut alors parler de proprits transformationn elles d'une classe d'objets . C'est le cas par exemple des quelque 80 prdicats d'<incitation>, sous-catgo rises en prdicats de <demande>, de <conseil>, de <proposition> et d'<ordre>, qui entrent dans la structure illustre par Paul demande, propose, conseille, ordonne Marie^ (qu'elle^ parte, de 0^ partir) l8. Alain Guillet crivait en 1990 que les relations entre smantique lexicale et syntaxe sont encore mal connues, peut-tre du fait que les recherches dans ces deux domaines ont presque toujours t menes indpendamment (Guillet 1990 : 77). Le relev extensif que nous pratiquons des proprits transformationnelles des classes de prdicats nous permet de progresser dans la connaissance des relations entre proprits smantiques et proprits syntaxiques.
6.2. Drivation L'tude de la drivation, pour peu qu'elle prenne en compte les facteurs smanti ques, rencontre ncessairement les classes que nous dcrivons. Il suffit de rappeler quelques exemples simples et bien connus : certains mots suffixes en -ier correspondent des groupes bien dfinis : noms de professions {charpentier), noms d'arbres (pru nier), noms de contenants (saladier)... ; les mots en -euse recouvrent, pour une part non ngligeable, les noms de machines ; beaucoup de noms en -ite dsignent des maladies inflammatoires, etc. La relation entre affixes et classes n'est certes pas 17. comportent des informations sur les transformations ordinaires (passivation, extraposition, etc.). enregistrent un certain nombre de donnes importantes qui ont t tablies par le LADL. Par exemple, ils mettent en relation de paraphrase transformationnelle des structures de phrases qui diffrent par le nombre des arguments (c'est le cas de prdicats comme recouvrir, dans un de ses emploie : On avait recouvert la table d'une jolie nappe vs Une jolie nappe recouvrait la table ; cf. Guillet et Leclre 1992) ou par l'ordre des argumente (comme dans : Des insectes grouillent dans le jardin vs Le jardin grouille d'insectes ; cf. Salkoff 1983). Ils relvent galement les diffrents types de relations de restructuration (cf. Guillet et Leclre 1981). 18. La classe des prdicats de <grandeurs> se caractrise aussi par une communaut de proprits transformationnelles (e.g. Cet objet a une longueur de 10 cm = Cet objet a 10 cm de longueur = La longueur de cet objet est de 10 cm) ; cf. Le Pesant 1996a. 23
systmatique, mais la corrlation est suffisamment nette, dans un nombre avr de cas , pour tre prise en compte dans l'analyse l9. 6.3. Slection des prpositions Rien de plus grammatical que les prpositions, et pourtant rien de plus smantique, si l'on considre les noms qu'elles rgissent. C'est ainsi que les emplois de en se laissent distribuer, pour une bonne part, en fonction des classes d'objets : en + N de matire : en + N de vtement : en + N de transport : en + N de langue : en + N de pays : etc. en bois, enfer en chemise, en short en avion, en bateau en anglais, en chinois en France, en Russie
Il est vrai que la relation entre prpositions et classes comporte des irrgularits : on dit EN hiver, mais AU printemps, EN Angleterre mais AU Prou, EN voiture mais bicyclette... Toutefois, les corrlations sont beaucoup plus fortes qu'il n'y parat premire vue 20. Reprenons, de ce point de vue, un des exemples d'Apresjan (1966) en faveur de l'analyse distributionnelle des significations . Il montre comment, en anglais, la distribution d'un mot comme good (au sens de habile : He is good at arithmetic) peut tre reprsente par la formule suivante : P + to be + good + at + o P symbolise les noms de personne et les noms abstraits. Comment le traduire en franais ? Nous disons : bon EN arithmtique mais bon AUX checs, bon EN anglais, mais bon AU bridge. . . Et ce qui est vrai de bon l'est aussi de tous les adjectifs qui lui sont substituables dans ce contexte (et qui forment ensemble une classe cohrente : fort, excellent, gnial, mdiocre, mauvais, minable, nul, etc.). y regarder de prs, on observe que la slection de la prposition (le choix entre en et ) dpend troitement de la nature du substantif rgi : les disciplines intellectuelles (et les matires scolaires) sont introduites par en (EN physique, EN droit, EN linguisti que, EN histoire-go...), tandis que les noms de jeux sont plutt lis la prposition (AUX checs, la ptanque, la belote...) 21. Sans pouvoir nous prononcer sur l'origine prcise de cette rpartition, nous pouvons du moins comprendre ce qui 19. La question de l'interprtation smantique des affixes apparat clairement dans certaines tudes sur la drivation. Voir entre autres D. et P. Corbin 1991, Dal 1997, Lecomte 1997. Pour une utilisation de la notion de classe d'objets, v. Buvet 1997. 20. Sur la prposition en, et plus gnralement sur les possibilits d'association de certaine types de noms avec une prposition donne, voir notamment les travaux de Danielle Leeman (Leeman 1998). 2 1 . La situation est plus complexe pour les noms de sports : EN athltisme , EN natation, mais AU tennis , AU volley... 24
favorise le dveloppement de telles corrlations. L'analogie aidant, les units d'une mme classe tendent se conformer un mme construction. 6.4. Mronymie Les mronymee (noms de parties d'un tout) nous intressent du point de vue des classes d'objets. Nous ne cherchons pas numrer simplement les mronymes de telle ou telle classe de noms, en crivant par exemple que les mronymes des noms de <btiments> sont cave, fentre, mur, pice, porte, toit, etc., mais construire des classes de mronymes, en considrant leurs proprits linguistiques , notamment leur prdicats appropris. On tablira par cette mthode que les classes de mronymes des noms de btiments sont les <pices>, les <murs>, les <ouvertures>, etc. Pour reconnatre les mronymes , nous prenons en compte leur proprit constante de figurer dans la construction N<mronyme> de N (e.g. les combles d'un btiment), mais cette caractristique n'est videmment pas discriminatoire, parce que la cons truction N de N implique un vaste ensemble de phnomnes htrognes. La proprit des mronymes de figurer en position d'anaphores associatives (e.g. Regarde cet arbre, le tronc est tout craquel) est galement un critre important de reconnaissance des classes de mronymes. Les mronymes de noms anims (<humains>, <animaux>) ne sont toutefois pas concerns par ce phnomne (cf. entre autres Fradin 1984 : 328) ; mais nous disposons d'autres critres syntaxiques pour les traiter ; on prendra par exemple en compte les prdicats appropris des <parties du corps> souffrir de, avoir mal , etc. Les proprits les plus spcifiques des classes de mronymes sont donc leurs prdicats appropris. Mais on considrera aussi la proprit qu'elles ont quelquefois de lguer mtonymiquement certains de leurs prdicats appropris ou hrits leurs holonymee (c'est--dire les classes d'objets auxquelles elles sont relies au sein de la structure iV de N). On sait par exemple que les prdicats de <couleurs de peau>, qui sont appropris une sous-classe des noms de <parties du corps>, sont lgus mtonymiquement, mais avec des exceptions, aux noms <humains> ( enfant dont la peau est bronze = un enfant bronz). Autre exemple : certains prdicats d'oprations techniques appropris la classe de mronymes <murs>, comme ravaler, crpir, sont lgus mtonymiquement leurs classes d'holonymes (e.g. ravaler <mur> d'un bti ment = ravaler un btiment). On a l une srie de classes d'quivalences transformationnellee, dont certaines ont t tudies par le LADL (Guillet et Leclre 1981). Les travaux de G. Kleiber ont montr l'htrognit et la diversit des proprits linguistiques des mronymes (voir entre autres Kleiber 1997a, 1997b). Mais il n'existe pas encore de critres suffisants qui permettent d'obtenir une taxinomie incontestable des diffrents types de mronymies (partie/tout d'un concret, partie/tout d'un process us, partie/tout d'un espace, lment d'une collection/collection, matire/forme, exemplaire/type, contenu /rcipient, etc. L'tude extensive de la mronymie que nous menons en utilisant les classes d'objets devrait nous permettre de faire des progrs dans la connaissance de ce phnomne. 25
6.5. Figement Les recherches que nous avons entreprises sur le figement mots composs et locutions 22 ont attir notre attention sur l'importance des formations intermd iaires, en d'autres termes les expressions qui ne sont ni compltement libres ni totalement figes. Elles offrent en gnral une structure mixte, combinant des lments fixes (invariants) et une ou plusieurs positions ouvertes (variables). Mais cette varia tion, loin d'tre illimite, ne peut s'effectuer qu' l'intrieur d'un paradigme plus ou moins restreint, analogue aux domaines de valeurs dont nous parlions plus haut. Le Nouveau Petit Robert dcrit ainsi la locution avoir mal : AVOIR MAL : souffrir. Avoir mal partout. O as-tu mal ? - J'ai mal la tte. Avoir mal au cur : avoir des nauses. FAM. Avoir mal aux cheveux. Abstraction faite des deux expressions totalement figes avoir mal au cur et avoir mal aux cheveux (au sens de avoir la gueule de bois ) , cette description ne rend pas compte du degr de variabilit de la locution. L'espace de variation est la fois ouvert (avoir mal la tte, mais aussi aux yeux, aux oreilles, aux dents, au cou, au bras, au doigt, aux reins, etc.) et fortement contraint : les complments appartiennent tous la mme classe d'objets (ce qui limite singulirement, dans ce contexte, la porte de l'adverbe dans avoir mal partout). L'expression peut tre ainsi reformule : avoir mal [Dterminant + NOM DE PARTIE DU CORPS] Comment ne pas tenir compte aussi des classes pour analyser des sries telles que : le tout-Paris, le tout-Nice, le tout-Londres, le tout-Montparnasse. .. ? Elles entrent dans le cadre de la formule le ou-[TOPONYME] . On en dirait autant pour de nombreus es suites binominales telles que : aiee-[NOM DE PROFESSION] : aide-ambulancier, aide-anesthsiste, aideastronome, aide-bibliothcaire, aide-carreleur, aide-charpentier... bb-[NOM D'ANIMAL] : bb-chat, bb-chien, bb-lphant, bb-gazelle, bbgirafe, bb-lion, bb-loup, bb-phoque, bb-tigre... Dans ces exemples, comme dans bien d'autres, le champ de la variation se trouve dlimit par une classe d'objets. 6.6. Description des langues spcialises Traditionnellement, la description des langues spcialises se limite la termi nologie entendue au sens strict d'o une prdominance de l'approche notionnelle qui se traduit linguistiquement par la priorit accorde aux substantifs. Or, comme l'observe Lerat (1995 : 21), une langue spcialise ne se rduit pas une terminolog ie : elle utilise des dnominations spcialises (les termes) [...] dans des noncs mobilisant les ressources ordinaires d'une langue donne . Dans cette perspective, 22. Cf. entre autres G. Grose 1996, Mathieu-Colas 1994 et 1996b. Sur la notion de degr de figement , voir plue particulirement G. Gross 1988. Parmi les travaux rcents sur le figement, voirMejri 1997. 26
l'laboration de classes d'objets propres aux textes techniques devrait avoir pour consquence un rquilibrage de la mthode de description, en dplaant l'attention sur l'articulation entre arguments et prdicats, autrement dit sur l'insertion des termes dans des phrases 23. Le renouvellement peut se situer deux niveaux compl mentaires : d'une part, pour l'ensemble des nome, une prise en compte systmatique des prdicats appropris, ce qui permet de rintroduire dans la description des langues spcialises les verbes et les adjectifs qui en avaient t exclus (une loi digne de ce nom doit tre vote et promulgue) ; d'autre part, pour les substantifs prdicatifs, une description plus fine de leurs contraintes d'arguments. C'est ainsi que, s'agissant d'un terme comme promulgation, les informations utiles [...] concernent les arguments requis par ce prdicat : le prsident de la Rpublique comme unique acteur autoris, la loi comme objet obliga toire( l'exclusion des dcrets et arrts, par exemple), et le Journal officiel comme support ncessaire de publication (Lerat 1990 : 84). L'introduction des classes d'objets dans l'analyse des langues spcialises n'en est encore qu' ses dbuts 24. 6. 7. Traitement automatique Les classes d'objets sont directement opratoires pour le traitement automatique des langues naturelles (TALN). Elles prsentent l'avantage de dcomposer les probl mes en sous-parties facilement identifiables et comprhensibles, rejoignant en cela les proccupations d'encapsulation et de modularit des modles orients objets aujourd'hui incontournables dans le domaine des applications informatiques (Booch 1994). Les proprits de rutilisation se retrouvent dans les deux types de modles travers la notion d'hritage, tout comme la distinction au sein d'une classe entre oprateurs et donnes. La mthodologie, ici et l, permet de formaliser des descriptions en grandeur relle inenvisageables autrement. Les donnes produites peuvent se prter diffrents niveaux d'utilisation selon l'investissement des dveloppeurs. En exploitant les relations qu'entretiennent les classes entre elles, des applications plus cibles peuvent s'appuyer sur des descriptions fines pour filtrer la masse croissante d'informations textuelles htrognes aujourd'hui plthoriques sous forme lectronique. Par exemple, sur la base des 23. Pour une conception plue syntaxique des dictionnaires spcialiss, voir aussi les remarques de Humbley 1993 sur le Vocabulaire combinatoire de la CFAO mcanique de Cl. Laine, le Lexique de coccurrents : bourse - conomie de B. Cohen et le Dictionnaire contextuel de franais pour la gologie de l'quipe du CREDIF. 24. Un Dictionnaire des assurances conu selon ces principes est en cours d'laboration au LLI, sous la direction de D. Bourigault, auteur de Lexter (logiciel d'extraction terminologique, cf. Bourigault 1994). Voir aussi Kubler et Foucou 1998, propos du domaine informatique : les classes aident dcrire les emplois spcifiques de verbes usuels (to run a command, to run on PC.) et facilitent l'apprentissage des langues techniques (production d'exercices partir d'extractions de phrases pertinentes dans des corpus spcialiss). 27
<textes>, des <voies de communication> et des <moyens de transport>, la drivation d'une classe <hypertexte> permet d'exploiter la structure documentaire d'informat ions collectes sur le Web (Foucou 1997). La traduction automatique constitue un autre champ d'application pour les classes d'objets 25. Nous avons pu l'exprimenter, de manire plue prcise, sur le systme SYSTRAN. Quoique largement sous-exploite, la puissance du systme repose sur l'association de dictionnaires lectroniques pourvus de champs syntaxiques et sman tiques (SEMCAT) et de rgles de traduction contextuelles (CLS). S'agissant des prdicats, l'ambigut lie leur polysmie peut tre rsolue par l'analyse des classes d'arguments. Supposons qu'on veuille traduire en anglais Elle portait un chapeau (She was WEARING a hat, et non She was CARRYING a ha). L'opration, pour tre mene bien, implique seulement deux conditions : codage du nom chapeau en tant que nom de vtement ; introduction d'une rgle contextuelle selon laquelle, quand le verbe porter a pour complment un nom de vtement, il se traduit par to -wear, et non par to carry. A l'inverse, des noms polysmiques en fonction d'arguments peuvent tre dsambiguss par le jeu des prdicats appropris : Cette baguette est bourrative Ce bolro est triqu Les adjectifs, ici, suffisent slectionner les emplois pertinents (bourratif se dit d'un <aliment>, non d'un bton ; triqu s'applique aux noms de <vtements> et non aux danses). Il n'est pas jusqu'aux ambiguts syntaxiques qui ne puissent, dans de nombreux cas, se rsoudre en termes de classes. Reprenons l'exemple classique du gnitif subjectif/objectif. Le fait de savoir que dcollage slectionne des avions comme arguments-sujets, alors que pilotage les autorise seulement en position d'objets, permet de diffrencier automatiquement, si Boeing est cod comme nom d'<avion> : le dcollage du Boeing I le pilotage du Boeing. 7. Questions de smantique 7.1. Exemple de description d'un emploi Connatre le(s) sens d'un mot, c'est disposer de son mode d'emploi , c'est--dire savoir avec quels mots il faut le combiner pour produire des discours syntaxiquement et smantiquement bien forms. Par exemple, connatre tous les sens du verbe remplir, c'est entre autres savoir qu'il a, parmi ses nombreux emplois, celui qui correspond la description suivante (nous ne donnons ici qu'un extrait des proprits pertinentes 26) : 25. Cf. G. Gross 1995 et, dans ce numro, l'article de Franz Guenthner ; pour des propositions d'application, voir Pak 1997 et Seelbach 1997. 26. Pour une mthode de description des emplois, voir dans ce numro l'article de G. Gross (2e partie). 28
Schma d'arguments : No <humain, automate> REMPLIR 1 <formulaire> (ex. : Les tudiants ont rempli leurs fiches d'inscription) La classe des <formulaires> comprend environ 50 noms, distribus en plusieurs sous-classes : noms de feuilles (imprim, coupon...), de billets (chque, formule de mandat...), etc. L'examen des prdicats hrits par cette classe montre qu'elle est subordonne aux <documents imprims> (qui constituent eux-mmes une sousclasse des <supports-papier de l'criture>, rattachs leur tour la catgorie des noms concrets) 27. Synonyme : complter. Antonymes : laisser en blanc, laisser vierge. Traduction en anglais : to fill in, to fill out. Systme aspectuel : dans cet emploi, remplir admet difficilement pendant N<temps> et prfre en N<temps> (c'est donc un verbe d'accomplissement) ; en tant que verbe duratif, il admet la classe de prdicats aspectuels commencer , finir de... et des adverbes tels que longuement ou rapidement ; il existe une forme adjectivale du prsent passif perfectif (ce formulaire n'est pas rempli) ; etc. Transformations : le complment d'objet n'est pas effaable (*J'ai rempli) ; la phrase admet la transformation passive ; il n'existe pas de variante dverbale (*le remplissage d'un formulaire). Domaine d'utilisation : langue gnrale ; niveau de langue : standard.
7.2. Faire la description smantique d'un mot, c'est numrer ses conditions d 'emploi L'aperu qui vient d'tre donn de la description d'un emploi particulier du mot remplir montre que, dans une certaine mesure, notre conception du sens s'apparente celle de la lexicographie traditionnelle : pour dcrire le(s) sens d'un mot, il faut spcifier les conditions de son emploi. Il existe cependant une diffrence fondamentale entre notre projet et les travaux lexicographiques plus anciens. Les dictionnaires traditionnels, pour tre utilisables dans la vie courante, doivent laisser implicite une partie de l'information (cf. Le Pesant 1996b) ; les dictionnaires lectroniques du LLI visent au contraire tre fortement explicites. Indpendamment des applications auxquelles on les destine dans le domaine du traitement automatique, ils tendent reprsenter la comptence linguistique des locuteurs, jusques et y compris leur apti tude produire les inferences qui dpendent du systme lexical. Harris crit souvent que la langue a une structure informative et que les mots convoient (carry) du sens et de l'information (cf. par exemple le titre de la section 3.2. de Harris 1988 : Words Carry Meaning). Ds lors, comme l'crit Danielle Leeman 1998 : 85, ce quoi s'attache la grammaire, c'est la situation mme du mot dans le systme, dfinie par ses proprits syntaxiques et distributionnelles (dcrites respec tivement en termes de dpendances et de vraisemblance d'occurrence), autrement dit 27. On trouvera une description plus dtaille des noms de <support8 de l'criture> dans Le Pesant 1996. 29
l'information . Le sens dpend d'un ensemble de distributions lexico-syntaxiques ; il dpend de la forme mme du lexique et du discours 28. C'est pourquoi il faut commencer par dcrire le systme des formes pour en infrer le sens selon la langue (Leeman 1998 : 63). Il s'agit donc pour nous de dfinir les conditions dans lesquelles un mot est sa place dans la hirarchie des restrictions de slection. Lorsque nous faisons la descrip tion linguistique d'un mot, nous disons peu prs : pour que ce mot fasse partie d'un discours smantiquement bien form, il doit avoir telle distribution, il doit tre commutable avec tel et tel mot, tre effac dans tel ou tel cas, etc. En somme, nous numrons les conditions que ce mot doit remplir pour faire sens avec les autres mots qui l'environnent dans le discours. En dcrivant le(s) emploi(s) d'un mot, nous faisons du mme coup sa description smantique. Voil une conception du sens qui a un incontestable air de famille avec celle du deuxime Wittgenstein, dont la devise tait : Do not ask for the meaning, ask for the use. Une telle smantique laisse videmment ouverte la question des relations entre la structure informative de la langue, et les formes et processus cognitifs. Ce constat n'implique aucune sorte de critique l'gard de ceux qui tudient les reprsentations mentales, les processus cognitifs et le monde des ides. Ces objets nous intressent au plus haut point, et nous nous sentons concerns, tout autant que quiconque, par le problme des relations entre la langue et la pense, mais nous croyons qu'il relve d'autres disciplines que la ntre. Cela tant, nous esprons que nos travaux pourront servir aux autres sciences qui ont l'homme pour objet, parce qu'ils visent dcrire la langue telle qu'elle est, c'est--dire comme un systme d'une extraordinaire comp lexit. Pour la connatre mieux, il est ncessaire de la considrer extensivement, en grandeur relle. On ne peut rien dire de gnral tant qu'on n'a pas tout regard.
Rfrences APRESJAN J., 1966. Analyse distributionnelle des significations et champs smantiques structu rs , Langages 1, Larousse, Paris. APRESJAN J., 1973. Regular Polysemy , Linguistics 142. BALIBAR-MRABTI A., 1993. Grammaire des sentiments : tude de distributions nominales , Rapport technique n 42, LADL, Institut Biaise Pascal, Paris. BALIBAR-MRABTI A-, 1997. Synonymie concrte et synonymie abstraite en syntaxe , Langages 128, Larousse, Paris. BENVENISTE E., 1966. Problmes de linguistique gnrale, Gallimard, Paris. BOOCH G., 1994. Object-Oriented Analysis and Design with Applications , The Benjamin/Cummings Publishing Co. Inc., Redwood City, California. l' oprateur 28. Harris multiply 1988 quand : 62 relve s on argument par exemple est un que nom l'oprateur de cellule . divide a le virtuellement remarque Ryle ckman mme1990 sens : que 28 , toute restriction sur les combinaisons contenues dans la grammaire doit correspondre ou tre corrle avec une diffrence d'information, une diffrence reconnue par les locuteurs de la langue . L'article de Ryckman fait partie d'un numro de Langages consacr aux grammaires de Harris (Daladier 1990). Sur Harris et la smantique, voir aussi Leeman 1996. 30
BOURIGAULT D., 1994. LEXTER, un logiciel d'EXtraction de TERminologie. PhD thesis, cole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. BUVET P. -A., 1997. Les noms de machine en -euse , Cahiers de Lexicologie, Hommage Yves Gentilhomme, Didier Erudition, Paris. CARNAP R. , 1928. Der Logische Aufbau der Welt, Berlin. CARNAP R., 1934. Logische Syntax der Sprache, Julius Springer, Wien. CHOMSKY N., 1965. Aspects of the Theory of Syntax, The MIT Press, Cambridge USA. CORBIN D. et CORBIN P., 1991. Un traitement unifi du suffixe -er(e) , Lexique 10, Lille. CORBIN D., FRADIN ., HABERT ., KERLEROUX F. et PLNAT M. (sld), 1997. Mots possibles et mots existants. Actes du colloque de Villeneuve d'Ascq (avril 1997). Publication de l'URA 382, CNRS et Universit de Lille 3, Villeneuve d'Ascq. DAL G., 1997. Grammaire du suffixe -et(te), Didier Erudition, Paris. DalADIER A., d., 1990. Les grammaires de Harris et leurs problmes, Langages 99, Larousse, Paris. DUBOIS J. et al., 1979. Dictionnaire du franais langue trangre, niveau 2, Larousse, Paris. DUBOIS J. et DUBOIS-ChARLIER F., 1997. Synonymie syntaxique et classification des verbes franais , Langages 128, Larousse, Paris. FELLBAUM C, 1993. English Verbs in WordNet , ftp ://f tp . cogsci. princeton . edu/pub/wordnet/5paper s . ps FELLBAUM C, GROSS D. and MILLER K., 1993. Adjectives in WordNet , ftp ://ftp . cogsci. princeton. edu/pub/wordnet/5papers .ps FOUCOU P.-Y. , 1997. Une classe d'objets <hypertexte> pour l'exploration automatique du Web , BULAG, numro spcial Linguistique et Informatique. Actes du colloque international FRAC TAL 97, Universit de Franche-Comt, Besanon. FRADIN ., 1984. Anaphorisation et strotypes nominaux , Lingua, Elsevier Science Pub lishers, North-Holland. FRECE G., 1884. Les fondements de l'arithmtique, traduction franaise : 1970, Le Seuil, Paris. GlRY-SCIINEIDER J., 1978. Les nominalisations en franais, Droz, Genve. GlRY-SCHNEIDER J., 1991. Noms de grandeur en avoir et noms d'unit , Cahiers de grammaire, n 16, Universit de Toulouse Le Mirail. GROSS G., 1988. Degr de figement des noms composs , Langages 90, Larousse, Paris. GROSS G., 1992. Forme d'un dictionnaire lectronique , in Clas A., Safar H., L'environnement traductionnel, Presses de l'Universit du Qubec, Sillery (Canada). GROSS G., 1994. Classes d'objets et description des verbes , Langages 115, Larousse, Paris. GROSS G. , 1995. Une smantique nouvelle pour la traduction automatique : les classes d'objets , La tribune des industries de la langue et de l'information lectronique, 17-18-19, Paris. GROSS G., 1996a. Les expressions figes en franais : noms composs et autres locutions, Ophrys, Gap-Paris. GROSS G., 19966. Prdicats nominaux et compatibilit aspectuelle , Langages 121, Larousse, Paris. GROSS G. et KlEFER F., 1995. La structure vnementielle des substantifs , Folia Linguistica, XXX/1-2, Mouton de Gruyter, Berlin. GROSS G. et VIVES R., 1986. Les constructions nominales et l'laboration d'un lexiquegrammaire , Langue franaise 69, Larousse, Paris. GROSS M., 1975. Mthodes en syntaxe, Hermann, Paris. GROSS M., 1981. Les bases empiriques de la notion de prdicat smantique , Langages 63, Larousse, Paris. GROSS M., 1997. Synonymie, morphologie drivationnelle et transformations , Langages 128, Larousse, Paris. GUILLET A., 1986. Reprsentation des distributions dans un lexique-grammaire , Langue fran aise 69, Larousse, Paris. GUILLET A., 1990. Fondements formels des classes smantiques dans un lexique-grammaire , Langages 63, Larousse, Paris. GUILLET A., LECLRE C, 1981. Restructuration du groupe nominal , Langages 63, Larousse, Paris. 31
HARRIS Z., 1976. Notes du cours de syntaxe, Le Seuil, Paris. HARRIS Z., 1988. Language and Information, Columbia University Press, New York. HUMBLEY J., 1993. Exploitation d'un vocabulaire combinatoire : syntaxe, phrasologie, analyse conceptuelle , Terminologies nouvelles 10, Hint, Bruxelles. KleBER G., 1997a. Les anaphores associatives actancielles , Scolia, Publications de l'Universit des sciences humaines, Strasbourg. KLEIBER G., 1997b. Des anaphores associatives mronymiques aux anaphores associatives loca tives , Verbum XIX, 1-2, Presses Universitaires de Nancy, Nancy. KBLER N. et FOUOU P.-Y. , 1998. Classes d'objets du domaine informatique pour l'apprentissage de l'anglais technique langue seconde , Rapport interne, Universit Paris 13, Vuletaneuse. LABELLE J., 1986. Grammaire des noms de maladies , Langue franaise 69, Larousse, Paris. LALANDE A., 1938. Vocabulaire technique et critique de la philosophie , Alcan, Paris. LAPORTE E., 1997. L'analyse de phrases adjectivales par rtablissement de noms appropris , Langages 126, Larousse, Paris. LECOMTE E., 1997. Tous les mots possibles en -ure existent-ils ? , in Corbin D. et al. (1997). LeemaN D., 1996. Le sens et l' information chez Harris , Du dire au discours, numro spcial de Linx, Universit Paris 10, Nanterre. LEEMAN D., 1998. Les circonstants en question(s), Editions Kim, Paris. LE PESANT D., 1994. Les complments nominaux du verbe lire , Langages 115, Larousse, Paris. LE PESANT D., 1996a. Vocabulaire des prdicats de grandeurs et des noms d'units de mesure , Cahiers de grammaire 21, Universit de Toulouse Le Mirail, Toulouse. LE PESANT D., 1996b. Principes d'organisation des donnes lexicales dans un dictionnaire lectronique , Smiotiques 11, Didier rudition, Paris. LEHAT P. , 1990. L'hyperonymie dans la structuration des terminologies , Langages 98, Larousse, Paris. LERAT P., 1995. Les langues spcialises, P.U.F., Paris. MATHIEU-COLAS M., 1994. Les mots trait d'union, Problmes de lexicographie informatique, Didier rudition, Paris. MATHIEU-COLAS M., 1996a. Reprsentation de la polysmie dans un dictionnaire lectronique , Actes du colloque de Lyon Lexicomatique et dictmnairiques (1995), Aupelf-Uref, Montral. MATHIEU-COLAS M., 1996b. Essai de typologie des noms composs franais , Cahiers de Lexico logie 69, 1996-11, Didier rudition, Paris. MAUREL D., 1989. Reconnaissance de squences de mots par automates. Adverbes de dates du franais, Thse de doctorat, Universit Paris 7. MEJRI S., 1997. Lefigement lexical, Publications de la Facult des Lettres de la Manouba, Tunis. MeL'CUK I. et al., 1984-1992. Dictionnaire explicatif et combinatoire du franais contemporain : Recherches lexico-smantiques, 3 vol., Presses de l'Universit de Montral. Miller G., Beckwith R., Fellbaum C, Gross D., Miller K., 1993. WordNet : An On-line Lexical Database , ftp ://f tp . cogsci. princeton . edu/pub/wordnet/5paper s . ps MORTUREUX M.-F., d., 1990. L'hyponymie et l'hyperonymie. Langages 98, Larousse, Paris. NUNBERG G. et ZAENEN A., 1997. La polysmie systmatique dans la description lexicale , Langue franaise 113, Larousse, Paris. PAK M. -G. , 1997. Traduction automatique et classes d'objets : le problme dporter un vtement en franais et en coren , Meta, XLII, 1, Presses de l'Universit de Montral. PrVAUTL. , 1989. Verbes supports et vocabulaire technique. Sport, musique, activits intellectuelles, Thse de doctorat, Universit Paris 7. PRANDI M. 1987. La smantique du contresens, d. de Minuit, Paris. PRANDI M., 1992. Grammaire philosophique des tropes, d. de Minuit, Paris. ROSSI J.G., 1989. La philosophie analytique, P.U.F., Paris. RYCKMAN T., 1990. De la structure d'une langue aux structures de l'information dans le discours et dans les sous-langages scientifiques , Langages 99, Larousse, Paris. RYLE G., 1949. The Concept of Mind, rd. 1990, Penguin Books, London. 32
SEELBACH D. , 1997. Classes d'objets et typologie compare des formes de prdicats. Application la langue du football dans les mdias , BULAG, Actes du colloque international FRACTAL 97, Universit de Franche-Comt, Besanon. SlLBERZTEIN M., 1993. Dictionnaires lectroniques et analyse automatique de textes. Le systme INTEX, Masson, Paris. VENDLER Z., 1967. Linguistics in Philosophy, Cornell University Press, Ithaca. VlCTORRI . et FUCHS , 1996. La polysmie, Herms, Paris. VIVES R., 1984a. Perdre, extension aspectuelle du verbe support avoir , Revue qubcoise de linguistique, 13 : 2, Montral. VIVES R., 1984b. L'aspect dans les constructions nominales predicatives : avoir, prendre, verbe support et extension aspectuelle , Lingvisticae Investigationes , VII : 1, John Benjamins B.V. , Amsterdam.
33
Vous aimerez peut-être aussi
- TEF Format NewDocument94 pagesTEF Format NewSwapna Vasudevan Anand80% (5)
- Chapitre 1 - Eléments de Physique NucléaireDocument69 pagesChapitre 1 - Eléments de Physique NucléaireMohamed El Hadi Redjaimia100% (1)
- EXP-MN-SE060-FR-R0 - La Génération D'électricitée PDFDocument127 pagesEXP-MN-SE060-FR-R0 - La Génération D'électricitée PDFanis louam100% (1)
- Analyse Du DiscoursDocument24 pagesAnalyse Du DiscoursDhaf TradPas encore d'évaluation
- Office de La Formation Professionnelle Et de La Promotion Du TravailDocument5 pagesOffice de La Formation Professionnelle Et de La Promotion Du TravailMohamed ChrifPas encore d'évaluation
- Linguistique Enonciative PDFDocument102 pagesLinguistique Enonciative PDFDhaf Trad94% (31)
- Rapport Gesip 2011 01Document115 pagesRapport Gesip 2011 01Hedi Ben Mohamed100% (1)
- Caracteres ASCII ClavierDocument10 pagesCaracteres ASCII ClavierDhaf TradPas encore d'évaluation
- Caracteres ASCII ClavierDocument10 pagesCaracteres ASCII ClavierDhaf TradPas encore d'évaluation
- Note de Lecture CDF Sur Le Grand Meaulnes 15.03.06 V1Document20 pagesNote de Lecture CDF Sur Le Grand Meaulnes 15.03.06 V1Dhaf TradPas encore d'évaluation
- Espaces LinguistiquesDocument16 pagesEspaces LinguistiquesDhaf TradPas encore d'évaluation
- Tournier - Double ÉcritureDocument453 pagesTournier - Double ÉcritureDhaf Trad100% (1)
- Politique Integree de Promotion de La Langue FrancaiseDocument9 pagesPolitique Integree de Promotion de La Langue FrancaiseDhaf TradPas encore d'évaluation
- FICHE Eleve ParureDocument2 pagesFICHE Eleve ParureSoudosuPas encore d'évaluation
- Cours 1Document25 pagesCours 1ilies ould menouerPas encore d'évaluation
- Préinscription À La Faculté Des Sciences Aïn Chock NDocument2 pagesPréinscription À La Faculté Des Sciences Aïn Chock Nphysiquesmp33Pas encore d'évaluation
- Bassirou Ibo NourouDocument114 pagesBassirou Ibo NourouFatima Ezzahra KtaibPas encore d'évaluation
- Etude Et Conception Dune Serre Agricole AutonomeDocument54 pagesEtude Et Conception Dune Serre Agricole AutonomeFati RetPas encore d'évaluation
- Course V1oniris159001session03 - Semaine1 Biologie Des AbeillesDocument26 pagesCourse V1oniris159001session03 - Semaine1 Biologie Des AbeillesMeadanPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Objectifs Et Cadre de La CAEDocument4 pagesChapitre 1 - Objectifs Et Cadre de La CAEthibaut darmagnacPas encore d'évaluation
- Arthur AronDocument2 pagesArthur ArontchekedadayaPas encore d'évaluation
- Nouvelle-Calédonie: Militaire D'activeDocument6 pagesNouvelle-Calédonie: Militaire D'activeThomas Kirov AlbertPas encore d'évaluation
- IB Molènes Thalie De. François Et La Petite Tahitienne 1956Document179 pagesIB Molènes Thalie De. François Et La Petite Tahitienne 1956SaurinYanickPas encore d'évaluation
- Ecn-2060 A18 91298Document11 pagesEcn-2060 A18 91298Chris FloricPas encore d'évaluation
- PROCEDURE CAS en Milieu Professionnel Extra Milieu de Soins Version Validée ConvertiDocument5 pagesPROCEDURE CAS en Milieu Professionnel Extra Milieu de Soins Version Validée ConvertiFhimi JdidiPas encore d'évaluation
- TP N 4 - Réseaux Sans FilsDocument6 pagesTP N 4 - Réseaux Sans FilsFadhilaCelinePas encore d'évaluation
- SF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009Document102 pagesSF2H Recommandations Hygiene Des Mains 2009zeugma2010Pas encore d'évaluation
- TalendOpenStudio DI GettingStarted FR 7.1.1Document39 pagesTalendOpenStudio DI GettingStarted FR 7.1.1Yacine MaastrichtPas encore d'évaluation
- Inspection CompacteurDocument4 pagesInspection Compacteurluc fodonpPas encore d'évaluation
- Cuota Mensual Tasa Duración PrincipalDocument6 pagesCuota Mensual Tasa Duración PrincipalCarlo MurguiaPas encore d'évaluation
- Tp16 Concent Solute Effective Eleves A Distance CorrectionDocument4 pagesTp16 Concent Solute Effective Eleves A Distance CorrectionAthenais ManguelePas encore d'évaluation
- Usage Des FeuxDocument4 pagesUsage Des Feuxbenjamin duletPas encore d'évaluation
- 137Document2 pages137Oecox Cah DjadoelPas encore d'évaluation
- Rc3a9vision Dynamique Des Solides Indc3a9formablesDocument68 pagesRc3a9vision Dynamique Des Solides Indc3a9formablesyassinedabboussi42Pas encore d'évaluation
- Presentation GeneraleDocument4 pagesPresentation GeneraleebodesedricPas encore d'évaluation
- Fcts Trigo RecDocument4 pagesFcts Trigo RecWalid TliliPas encore d'évaluation
- 02-Propriétés de Base Du Sol Et de La Phase Liquide PDFDocument29 pages02-Propriétés de Base Du Sol Et de La Phase Liquide PDFAbdou HababaPas encore d'évaluation