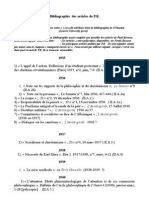Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dosse
Dosse
Transféré par
Toño VázquezCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dosse
Dosse
Transféré par
Toño VázquezDroits d'auteur :
Formats disponibles
rudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif compos de l'Universit de Montral, l'Universit Laval et l'Universit du Qubec
Montral. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. rudit offre des services d'dition numrique de documents
scientifiques depuis 1998.
Pour communiquer avec les responsables d'rudit : erudit@umontreal.ca
Article
Franois Dosse
Cahiers de recherche sociologique , n 26, 1996, p. 138-169.
Pour citer cet article, utiliser l'information suivante :
URI: http://id.erudit.org/iderudit/1002346ar
DOI: 10.7202/1002346ar
Note : les rgles d'criture des rfrences bibliographiques peuvent varier selon les diffrents domaines du savoir.
Ce document est protg par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'rudit (y compris la reproduction) est assujettie sa politique
d'utilisation que vous pouvez consulter l'URI http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html
Document tlcharg le 25 octobre 2014 03:02
Paul Ricoeur et lcriture de lhistoire ou comment Paul Ricoeur rvolutionne lhistoire
138 La sociologie saisie par la littrature
Franois Dosse
Historien de formation, Franois Dosse est matre de confrence en
histoire l'IUFM de Versailles; de plus, il enseigne l'Universit
Paris X-Nanterre et l'IEP de Paris. Franois Dosse s'intresse aux
problmes pistmologiques et thoriques de la discipline historique en
particulier, et des sciences humaines plus largement. Il a notamment
publi une tude critique remarquable sur l'orientation des tudes
historiques adopte par l'cole des Annales (L'histoire en miettes, La
Dcouverte, 1987) et s'est intress, dans le cadre d'une autre tude,
l'approfondissement d'une critique du courant structuraliste travers
l'ensemble de son dveloppement (Histoire du structuralisme: Le
champ du signe, Paris, La Dcouverte, 1991 et Le champ du cygne,
Paris, La Dcouverte, 1992). Il a poursuivi son travail d'exploration
critique et d'laboration d'une approche reflexive en sciences
humaines travers d'autres ouvrages (L'instant clat. Entretiens avec
Pierre Chaunu, Aubier, 1994, et L'empire du sens. L'humanisation des
sciences humaines, La Dcouverte, 1995). Il travaille en ce moment la
mise en perspective de l'apport de la pense de la phnomnologie
hermneutique de Paul Ricur au progrs des sciences humaines.
Franois Dosse est galement animateur de la revue EspacesTemps et
membre du Conseil scientifique de la revue Sciences humaines. Il peut
tre considr juste titre comme un eminent reprsentant de cette
nouvelle gnration d'intellectuels qui ont entrepris la relecture critique
des traditions rcentes de la pense franaise en sciences humaines.
Cahiers de recherche sociologique, no 26, 1996
Paul Ricur et l'criture de l'histoire
ou comment Paul Ricur
rvolutionne l'histoire
1
Perspectives thoriques
Franois DOSSE
Le dialogue entre philosophie et histoire est particulirement
difficile en France. Le moment d'interrogations, de doutes que
connaissent les historiens aujourd'hui peut tre fcond s'il permet de
jeter les bases d'une vritable interrogation propos des concepts qu'ils
utilisent. ce titre, la prise en considration de la rflexion de Paul
Ricur sur le temps historique est un dtour ncessaire afin que
l'historien comprenne mieux ce que signifie sa pratique disciplinaire.
Elle atteste de l'ouverture d'un nouveau moment de l'opration
historiographique: son entre dans l'ge interprtatif.
la logique des grandes coupures, des ruptures fondatrices, bien
connue des historiens puisque chaque gnration chassant la prcdente
se prsente comme porteuse d'une nouvelle rvolution copernico-
galilenne, Paul Ricur a toujours su opposer une position mdiane qui
tienne compte de la double polarit de la pratique historienne, prise
entre l'tude des conditions du pensable et le contenu lui-mme de ce
pensable, entre l'expliquer et le comprendre, entre la subjectivit et
l'objectivit, entre la narrativit et son rfrent, entre une archologie du
savoir et une tlologie historique, entre une idiographie et une
nomothetic
Privilgiant les mdiations imparfaites, Paul Ricur nous propose le
long dtour hermneutique comme chemin indispensable de la
comprhension historique. Cette voix/voie ne fut pas vraiment entendue
et suivie, car elle relve d'un choix exigeant qui rcuse les raccourcis
1
Ce titre entend voquer le titre formul par Paul Veyne propos de Michel Foucault:
Foucault rvolutionne l'histoire, mais il ne signifie en rien la rupture, la
discontinuit que mettait en vidence Paul Veyne dans l'uvre de Foucault. Au contraire,
il renverrait davantage la conception d'Hannah Arendt de la rvolution: celle d'un
retour ..., d'un dpli sur le pass partir du prsent.
140 La sociologie saisie par la littrature
faciles et les faux dilemmes. Paul Ricur est intervenu dans le domaine
de l'pistmologie historique ds 1955
2
. Les annes cinquante et
soixante assurent alors le succs d'une thse physicaliste, objectiviste,
avec le triomphe progressif du structuralisme
3
qui a profondment
transform la discipline historique dans le sens d'une attention des
socles de plus en plus immobiles, d'un dcentrement de l'homme,
d'une valorisation de ce qui chappe la part explicite de l'action
humaine. Le climat intellectuel tait alors peu favorable la rception
des thses de Ricur sur l'histoire. Le dclin des grands paradigmes
unifiants, marxisme et structuralisme, et le changement de paradigme
qui en rsulte
4
permettent enfin de prendre en considration l'apport de
Ricur, dcisif pour l'historien. Notre propos n'a pas ici pour ambition
d'embrasser l'uvre immense de Paul Ricur, ne serait-ce que dans
son rapport la temporalit, mais de mettre en lumire ce qui peut tre
suggestif du ct du hors-philosophique, du ct de la discipline
historique. En somme, il s'agit de ressaisir la vitalit potentielle des
orientations de Paul Ricur pour les historiens de mtier et de tracer les
voies d'une possible appropriation de celles-ci l'intrieur d'une
configuration marque par un plus vif souci interprtatif.
L'bauche d'un dbat
La publication de la trilogie Temps et rcit entre 1983 et 1985 ne
pouvait laisser indiffrente longtemps une corporation historienne
pourtant installe l'poque dans l'autosatisfaction et le confort du
triomphe public de l'cole des Annales, rebaptise nouvelle histoire,
et dont la tendance naturelle tait au rejet de tout dialogue, au nom
mme du mtier historien, avec la philosophie. Le premier discuter
des thses de Ricur fut ce franc-tireur tonnant, ce passeur de
frontires disciplinaires qu'tait Michel de Certeau. Ds la parution du
premier tome de Temps et rcit, il participe une table ronde avec J ean
Greisch, Pierre-J ean Labarrire et Paul Ricur lui-mme. Michel de
Certeau interroge Ricur sur quatre points: la question du discours
historique comme production d'un lieu institutionnalis, situ; le
problme de l'clips de l'vnement et de sa corrlation avec des
registres par nature diffrents; les rapports entre rcit et processus
explicatif; et l'intentionnalit historique. Michel de Certeau met
l'accent sur la multiplicit des rcits dans lesquels le processus
explicatif intervient comme rosion, dplacement, modification dans le
2
P. Ricur, Histoire et vrit, Paris, Seuil, 1955.
3
F. Dosse, Histoire du structuralisme, t. 1 et 2, Paris, La Dcouverte, 1991, 1992.
4
M. Gauchet, Changement de paradigme en sciences sociales?, Le Dbat, no 50,
mai-aot 1988, p. 165-170.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 141
champ du rcit social
5
. Bien que l'un et l'autre soient en accord sur
l'importance du rcit, la diffrence de sensibilit est perceptible au
chapitre de l'chelle des rcits possibles entre Paul Ricur qui insiste
sur le retour des grands rcits alors que Michel de Certeau se flicite de
la multiplication de rcits atomiss. Ricur avait d'ailleurs largement
voqu l'uvre de Certeau sur l'criture historique
6
, en signifiant son
dsaccord sur l'assimilation faite entre ralit historique et altrit
radicale, mais en reprenant son compte la notion de dette
7
.
Ce dbat sur l'opration historiographique n'a pas eu beaucoup
d'chos. Seuls quelques historiens ont assez vite pris la mesure de
l'importance de l'intervention de Ricur dans le champ de l'histoire et
ont discut ses thses. ric Vigne et Roger Chartier ont ainsi particip
activement aux journes consacres Paul Ricur en juin 1987 dont les
travaux ont t publis dans un numro spcial d'Esprit consacr lui
8
.
ric Vigne prend acte de la place de mdiation centrale occupe par
l'intrigue entre l'vnement et l'histoire chez Ricur. La potique du
rcit labore un tiers-temps, le temps historique, lui-mme mdiateur
entre temps vcu et temps cosmique: L'histoire, en ce sens, appartient
bien l'hermneutique de l'exprience humaine dans sa dimension
temporelle
9
. Il reconnat chez Ricur un renouvellement des termes du
dbat entre l'expliquer et le comprendre soulev depuis le XIXe sicle
en termes alternatifs. Ricur se met distance en effet de l'illusion
nominaliste d'une comprhension immdiate entre deux subjectivits,
mais aussi de l'illusion rationaliste d'une explication du texte par le
seul jeu de sa combinatoire interne. ric Vigne se dmarque cependant
d'un point de vue hermneutique qui se situe sur le plan de la
gnralisation philosophique alors que la pratique historienne est
fondamentalement plurielle par la construction de ses objets et la
rencontre avec ses lectorats: L'histoire mise en intrigue n'est qu'une
rponse possible une qute identitaire qui l'anticipe, l'excde et
jamais ne s'y arrte. Au jeu de l'appropriation, l'hermneutique peut-
elle ds lors persister ne vouloir s'en tenir qu' l'intrigue du texte
10
?
Quant Roger Chartier, s'il tient dire sa distance, Ttranget qu'il
ressent en tant qu'historien, il n'en considre pas moins le livre de
Ricur, Temps et rcit, comme le plus important publi sur l'histoire
5
M. de Certeau, Dbat autour du livre de Paul Ricur Temps et Rcit,
Confrontations, Cahiers Recherches-Dbats, 1984, p. 24.
6
M. de Certeau, L'absent de l'histoire, Paris, Marne, 1973; L'criture de l'histoire,
Paris, Gallimard, 1975.
7
O. Mongin, Paul Ricur, Paris, Seuil, 1994, p. 133.
8
Esprit, numro spcial consacr Paul Ricur, nos 7-8, juillet-aot 1988.
9
. Vigne, L'intrigue mode d'emploi, Esprit, nos 7-8, juillet-aot 1988, p. 253.
10
Ibid., p. 256.
142 La sociologie saisie par la littrature
au cours des dix dernires annes
11
. Le premier mrite de Ricur,
selon Roger Chartier, est de rompre avec cette tradition des historiens
franais qui consiste rcuser les interventions de philosophies de
l'histoire, trangres la pratique historique: Il prend bras-le-corps
un certain nombre d'uvres historiques [...] pour les intgrer dans une
rflexion philosophique sur l'histoire
12
. Ricur, au contraire des
interventions habituelles des philosophes sur le terrain de l'histoire, a
travers les uvres historiques, celles de Braudel, de Duby, de Furet,
pour ne citer que ceux-l, et il est ce titre un des rares philosophes
ne pas se contenter des mta-rcits sur l'histoire. Il assimile ainsi le
vritable travail d'enqute historique. Autre mrite, aux yeux de Roger
Chartier, Ricur dmontre que le discours historien appartient la
classe des rcits et, ce titre, il se situe d'une part dans une relation de
proximit particulire avec la fiction et d'autre part dans l'impossibilit,
contrairement ce qu'ont longtemps cru les Annales, de rompre avec le
rcit pour construire un discours purement formalisable, nomologique.
Si l'histoire est rcit, elle n'est pourtant pas n'importe quel type de
rcit. Ricur discute en effet, sans les adopter, les thses des narrativistes
amricains qui ont, pour certains, tent d'abolir toute distinction entre
criture de l'histoire et criture de fiction. Ricur maintient la tension
interne l'criture historique qui partage avec la fiction les mmes
figures rhtoriques, mais qui se veut aussi et surtout un discours de
vrit, de reprsentation d'un rel, d'un rfrent pass. ce titre,
Ricur aura, je crois, dit Chartier, un espace pour toutes les tentatives
qui visent articuler l'explication historique sur la comprhension
narrative
13
. Roger Chartier, comme les sociologues, est aussi trs
intress par un second point de rencontre avec Ricur qui est la
centralit de la lecture. rige en paradigme, cette thorie de la lecture
est au cur du projet hermneutique de Ricur, dvelopp notamment
dans Du texte l'action. Le concept qu'il tient pour central: celui
d'appropriation
14
peut tre la source d'une inspiration dcisive pour
les historiens afin de saisir comment peut se refigurer l'exprience du
temps. Avec la lecture, on touche aux conditions d'une hermneutique
de la conscience historique. C'est sur ce point que Roger Chartier prend
un autre chemin que Ricur. Ce monde des textes, Roger Chartier, en
historien, considre qu'il ne se rfre pas assez des formes d'ins-
cription, des supports producteurs de sens. Par ailleurs, le lecteur est
historiciser et non prsenter comme l'incarnation d'un universel
abstrait, d'un invariant anhistorique. Il y a dans ce domaine toute une
dmarche de diffrenciation sociologique et historique des lecteurs
qu'il convient d'accomplir pour cerner leurs comptences et conven-
11
R. Chartier, Dbat sur l'histoire, Esprit, nos 7-8, juillet-aot 1988, p. 258.
12
Ibid, p. 258-259.
13
Ibid., p. 261.
14
Ibid., p. 262.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 143
tions diffrentes. Mais sa critique finale propos de l'absence d'histori-
cisation chez Ricur n'est pas vraiment fonde dans la mesure o
Ricur n'a pas eu pour prtention de se substituer l'historien de
mtier, mais d'tudier, en philosophe, les diverses configurations du
rcit historique comme autant de lieux d'effectuation de l'identit
narrative, source mdie de la connaissance de soi.
Un autre dbat, organis par Franois Hartog, s'est tenu en juin
1988 au Centre de recherches historiques, avec la participation de Roger
Chartier et J acques Revel, autour de Paul Ricur, rpondant aux
questions des historiens. Le dbat en est rest l, un point trs confi-
dentiel et sans traces crites...
Une objectivit incomplte
Paul Ricur a montr, l'occasion d'une communication aux
J ournes pdagogiques de coordination entre l'enseignement de la
philosophie et celui de l'histoire, en 1952, que l'histoire relve d'une
pistmologie mixte, d'un entrelacement d'objectivit et de subjectivit,
d'explication et de comprhension. Dialectique du mme et de l'autre
loign dans le temps, confrontation entre le langage contemporain et
une situation rvolue, le langage historique est ncessairement
equivoque
15
. Considrant la ncessaire prise en compte de l'v-
nementiel, du contingent ainsi que du structural, des permanences, Paul
Ricur dfinit la fonction de l'historien, la justification de son
entreprise comme tant celle de l'exploration de ce qui relve de
l'humanit:
Ce rappel sonne quelquefois comme un rveil quand l'historien est tent
de renier son intention fondamentale et de cder la fascination d'une
fausse objectivit: celle d'une histoire o il n'y aurait plus que des
structures, des forces, des institutions et non plus des hommes et des
valeurs humaines
16
.
Paul Ricur intervient donc trs tt sur le chantier de l'historien
pour montrer quel point celui-ci se situe en tension entre l'objectivit
ncessaire de son objet et sa subjectivit propre. Bien avant que J acques
Rancire n'en appelle la rconciliation de l'historien avec son objet
en l'invitant ne pas cder aux sirnes qui l'incitent rgulirement
l'euthanasie
17
, Ricur ne disait pas autre chose. Les rgles mmes qui
15
P. Ricur, Objectivit et subjectivit en histoire, dcembre 1952, repris dans
Histoire et vrit, ouvr. cit, p. 30.
16
Ibid., p. 43.
17
J. Rancire, Les noms de l'histoire, Paris, Seuil, 1992.
144 La sociologie saisie par la littrature
rgissent le mtier d'historien tayent sa dmonstration qui prend
d'ailleurs appui, pour l'essentiel, sur la dfinition qu'en donne Marc
Bloch: Mtier d'historien: tout le monde sait que ce titre est celui que
Marc Bloch adjoignit son Apologie pour l histoire. Ce livre, hlas
inachev, contient nanmoins tout ce qu'il faut pour poser les premires
assises de notre rflexion
18
. Ricur rcuse la fausse alternative, qui va
devenir de plus en plus prgnante dans l'opration historiographique,
entre l'horizon d'objectivation, avec son ambition scientiste, et la
perspective subjectiviste, avec sa croyance en une exprience de
l'immdiatet quant la capacit procder la rsurrection du pass.
L'objet est de montrer que la pratique historienne est une pratique en
tension constante entre une objectivit jamais incomplte et la
subjectivit d'un regard mthodique qui doit se dprendre d'une partie
de soi-mme en se clivant en une bonne subjectivit, le moi de
recherche, et une mauvaise, le moi pathtique. Tout l'effort de
Ricur, dans ce domaine comme dans d'autres, est de dmontrer que
les voies de passage de la recherche de vrit sont celles de dtours
ncessaires et rigoureux. L'histoire procde par rectifications qui
relvent d'un mme esprit que la rectification que reprsente la science
physique par rapport au premier arrangement des apparences dans la
perception et dans les cosmologies qui lui restent tributaires
19
.
L'historien est tout la fois en position d'extriorit par rapport son
objet, en fonction de la distance temporelle qui l'en loigne, et en
situation d'intriorit par le jeu de son intentionnalit de connaissance.
Ricur rappelle les rgles qui rgissent ce contrat de vrit qui, depuis
Thucydide et Hrodote, guide toute investigation historienne et fonde sa
mthodologie. Celle-ci constitue la premire strate du travail d'la-
boration, celle de la tentative d'explication. ce premier niveau, la
subjectivit de rflexion se trouve engage dans la construction mme
des schmas d'intelligibilit. Lucien Febvre avait dj revendiqu
l'histoire comme tant du ct du cr, du construit, dans sa leon
inaugurale au Collge de France ds le dbut des annes trente. Ricur
fait cet gard preuve d'une lucidit remarquable, montrant qu'il n'est
pas dupe de la diabolisation de l'cole mthodique contre laquelle s'est
constitue l'cole des Annales, lorsqu'il revendique l'ascse objectiviste
comme un stade ncessaire: C'est prcisment cela l'objectivit: une
uvre de l'activit mthodique. C'est pourquoi cette activit porte le
beau nom de "critique
20
". On ne peut pas ne pas penser ici la
fameuse introduction aux tudes historiques de Langlois et Seignobos
dont les deux matres-mots sont ceux de critique interne et de critique
externe des sources. l'oppos du point de vue de Michelet sur la
ncessaire rsurrection d'un pass qui passerait par une vritable
1 8
P. Ricur, Histoire et vrit, ouvr. cit, p. 25.
19
Ibid.
9
p. 24.
20
bid., p. 26.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 145
rincarnation dans l'Autre, par une immdiatet de l'motionnel,
Ricur privilgie le souci analytique de dcomposition du pass en
catgories d'intelligibilit, en sries distinctes, en qute de relations
causales, en dductions logiques partant de la thorie. La perspective est
cet gard complmentaire entre explication et comprhension: La
comprhension n'est donc pas l'oppos de l'explication, elle en est au
plus le complment et la contrepartie
21
. On mesure ainsi quel point
tous ceux qui prsentent la position hermneutique de Ricur comme
l'expression d'une subjectivit sauvage sont au mieux dans l'erreur, au
pire dans la mauvaise foi.
L'incompltude de l'objectivit historienne rend ncessaire une
participation forte de la subjectivit plusieurs niveaux. En premier
lieu, elle intervient par la notion mme de choix, explicite ou implicite,
mais en tout tat de cause invitable, de l'historien quant son ou ses
objets d'analyse. L'historien pose un jugement d'importance
22
qui
prside la slection des vnements et de leurs facteurs. La thorie en
amont de l'observation prvaut dans la slection opre. La subjectivit
historienne intervient donc tout au long de sa qute au chapitre des
schmas interprtatifs qui vont servir de grille de lecture. En deuxime
lieu, l'historien s'investit en tant que subjectivit par les liens de
causalit qu'il met en relief et sur ce plan la pratique historienne est le
plus souvent nave. Ricur s'appuie cet gard sur l'effort mtho-
dologique de Fernand Braudel pour dissocier des causalits de divers
ordres, mais il dveloppera surtout ce thme plus tard dans Temps et
rcit, grce une attention particulire quant la manire dont se
dploie le rcit historique en tant que narration porteuse de schemes
d'explications. En troisime lieu, la subjectivit historienne s'insre
dans la distance historique qui oppose le mme l'autre. L'historien a
ici pour tche de traduire, de nommer ce qui n'est plus, ce qui fut autre,
en des termes contemporains. Il se heurte l une impossible
adquation parfaite entre sa langue et son objet, et cela le contraint un
effort d'imagination pour assurer le transfert ncessaire dans un autre
prsent que le sien et faire en sorte qu'il soit lisible par ses
contemporains. L'imagination historique intervient donc comme un
moyen heuristique de comprhension, et cette dimension est au-
jourd'hui revendique par de nombreux historiens de mtier, comme
c'est le cas particulirement pour Georges Duby
23
. La subjectivit se
trouve alors tre le passeur ncessaire pour accder l'objectivit.
Enfin, une quatrime dimension rend la subjectivit incontournable,
c'est l'aspect humain de l'objet historique: Ce que l'histoire veut
21
ibid.
22
Ibid., p. 28.
23
G. Duby, L'histoire continue, Paris, Odile J acob, 1991.
146 La sociologie saisie par la littrature
expliquer et comprendre en dernier ressort, ce sont les hommes
24
.
Autant que par une volont d'explication, Fhistorien est m par une
volont de rencontre. Ce qui anime son souci de vridicit n'est pas tant
de partager la foi de ceux dont il relate l'histoire, mais d'effectuer ce
travail sur le pass, au sens quasi psychanalytique de mise au travail,
pour partir en qute de l'autre dans un transfert temporel qui est aussi
un transport dans une autre subjectivit
25
.
La constitution de l'objectivit historienne pour mieux re-saisir
l'outillage mental et le comportement des hommes du pass est donc le
corrlat de la subjectivit historienne. Elle dbouche sur une inter-
subjectivit toujours ouverte de nouvelles interprtations, de nou-
velles lectures. L'incompltude de l'objectivit historienne permet de
laisser le dbat sur l'hritage historique aux gnrations futures, dans
une qute indfinie du sens. Elle ne permet pourtant pas n'importe
quoi, en raison de la dissociation opre par Ricur entre le moi de
recherche exalter et le moi pathtique dont il faut se dprendre.
L'objectivit historienne passe alors de ses illusions logiques sa
ncessaire dimension thique.
L'histoire est une hermneutique
Cette lucidit prcoce dans un moment fertile en rifications de
toutes sortes et en illusions scientistes sur un discours historique qui
aurait capacit suivre la voie des sciences de la nature a t possible,
car Ricur s'est fermement situ l'intrieur d'une solide filiation
hermneutique. Depuis Schleiermacher, l'hermneutique est sortie de
son horizon rgional, religieux, pour se doter d'un programme gnral
d'laboration des rgles universelles valides, afin de rendre proche ce
qui est lointain, de dpasser la distance culturelle et donc de faire
progresser la comprhension de l'autre. Mais c'est surtout par Dilthey
que se ralise le projet de Schleiermacher sur le plan d'une
interrogation proprement historique. Au moment o Ranke et Droysen
regardent du ct des sciences de la nature pour donner l'histoire une
dimension scientifique, Dilthey leur oppose l'horizon de la com-
prhension et distingue deux pistmologies: celle qui est propre au
monde physique et celle qui relve du monde psychique. Dilthey
cherche fonder l'histoire comme connaissance scientifique, dpassant
la simple intuition, partir de l'hypothse selon laquelle la vie produit
des formes dans son jaillissement qui se stabilisent en diverses confi-
gurations, en des normes qui s'apparentent ce que plus tard Norbert
Elias dcrira sous le terme de configuration et Max Weber sous celui
24
P. Ricur, Histoire et vrit, ouvr. cit, p. 31.
25
Ibid., p. 32.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 147
d'idal-type. L'hermneutique ne relve donc aucunement dans ce sens
de quelque psychologisme sauvage, comme il est trop souvent d'usage
de le croire, mais d'un souci de ressaisir la couche objective de la
comprhension. Elle relve d'une rflexion sur l'historique, sur ses
propres conditions d'tre. Mme si Dilthey aboutit une aporie pour
avoir par trop subordonn le problme hermneutique au problme
psychologique, il n'en a pas moins peru le nud central du
problme: savoir que la vie ne saisit la vie que par la mdiation des
units de sens qui s'lvent au-dessus du flux historique
26
.
Cette rflexion sur l'historique sera reprise plus tard par Husserl,
notamment le dernier Husserl, celui de la Kris is. Le programme
phnomnologique de Husserl, inflchi dans ces annes trente par le
cours tragique de l'histoire allemande, se tourne vers l'histoire comme
moment privilgi de comprhension de nous-mmes. Or le sens
ressaisir est tout intrieur, point d'aboutissement d'une qute eidtique,
d'un temps immanent la conscience elle-mme: Parce que l'histoire
est notre histoire, le sens de l'histoire est notre sens
27
. La mise en
rapport partir de la notion d'intentionnalit historique d'un double
processus de rtention et de protention permet Husserl de montrer que
le prsent ne se rduit pas un instant ponctuel mais comporte une
intentionnalit longitudinale qui assure la continuit mme de la dure
et prserve le mme dans l'autre
28
. Les remaniements successifs et les
diffrences sont alors inclus dans la continuit temporelle et le prsent
est la fois ce que nous vivons et ce que ralisent les anticipations d'un
pass remmor: En ce sens, le prsent est 1'effectuation du futur
remmor
29
. On ne peut donc penser la discontinuit que sur un fond
de continuit qui est le temps lui-mme. Cette appropriation a t
fortement souligne par Gadamer dont l'hermneutique historique
rejette les coupures abstraites entre tradition et sciences historiques,
entre le cours de l'histoire et le savoir sur l'histoire. La comprhension
ne relve pas de quelque subjectivit en position de matrise, mais de
1'insertion dans le procs de la transmission o se mdiatisent
constamment le pass et le prsent
30
. Le projet hermneutique se
donne pour mission d'investir cet entre-deux entre familiarit et
tranget que constitue la tradition. La discontinuit qui oppose notre
prsent au pass devient alors un atout pour dployer une nouvelle
conscience historiographique: La distance temporelle n'est donc pas
un obstacle surmonter [...]. Il importe en ralit de voir dans la
distance temporelle une possibilit positive et productive donne la
26
P. Ricur, Du texte l'action, Paris, Seuil, 1986, p. 87.
27
P. Ricur, l'cole de la phnomnologie, Paris, Vrin, 1986, p. 34.
28
P. Ricur, Temps et rcit, Paris, Points-Seuil, 1991, t. 3, p. 53-54.
29
Ibid., p. 68.
30
H. G. Gadamer, Vrit et mthode, Paris, Seuil, 1976, p. 130.
148 La sociologie saisie par la littrature
comprhension
31
. C'est cette exigence de penser l'intrieur de la
tension entre extriorit et intriorit, pense du dehors et du dedans,
qui a incit Ricur chercher dpasser les diverses apories de la
dmarche purement spculative de la temporalit ainsi que de
l'approche rifiante de celle-ci.
Penser l'articulation du clivage entre un temps qui doit apparatre
et un temps qui est conu comme condition des phnomnes est l'objet
de l'ouvrage qu'il publie sur l'histoire au milieu des annes quatre-
vingt
32
. Paul Ricur reprend, en l'largissant, sa rflexion sur les
rgimes d'historicit conus comme tiers-temps, tiers-discours pris en
tension entre la conception purement cosmologique du mouvement
temporel et une approche intime, intrieure du temps. Aristote oppose
l'assimilation platonicienne du temps avec les rvolutions des corps
clestes une dissociation entre, d'une part, la sphre des changements,
localisable, propre au monde sublunaire et, d'autre part, un temps
immuable, uniforme, simultanment le mme partout. L'univers
aristotlicien est donc ainsi soustrait au temps. Seulement Aristote se
heurte au paradoxe d'un temps qui n'est pas le mouvement et dont le
mouvement est une des conditions: Il est donc clair que le temps n'est
ni le mouvement, ni sans le mouvement
33
. Aristote ne parvient pas
tablir de connexion entre le temps mesur par le Ciel la manire
d'une horloge naturelle et le constat que les choses et les hommes
subissent l'action du temps. Il reprend d'ailleurs son compte le dicton
qui dit que le temps consume, que tout vieillit sous l'action du
temps
34
. ce versant cosmologique du temps s'oppose le versant
psychologique, intime, selon Saint-Augustin qui pose frontalement la
question: Qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le
sais; mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais
plus
35
. Il part du paradoxe selon lequel si le pass n'est plus et le futur
pas encore, comment saisir ce que peut tre le temps? Saint-Augustin
rpond en se tournant vers le prsent, un prsent tendu une
temporalit large qui englobe la mmoire des choses passes et l'attente
des choses futures: Le prsent du pass, c'est la mmoire, le prsent du
prsent, c'est la vision, le prsent du futur, c'est l'attente
36
. Il n'y a
donc pour Saint-Augustin de futur et de pass que par le prsent. Cette
antinomie entre temps cosmologique et temps intime n'est pas rsolue
31
Ibid., p. 137.
32
P. Ricur, Temps et rcit, Paris, Seuil, 3 t., 1983-1985.
33
Aristote, Physique IV, (219 a 2), cit par Paul Ricur, Temps et rcit, ouvr. cit, t. 3,
p. 26.
34
Ibid., (221 a 30-221 b 2), p. 33.
35
Saint-Augustin, Les confessions, Livre XI, chap, xiv, Paris, Garnier-Flammarion,
1964, p. 264.
36
Ibid., chap, xx, p. 269.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 149
par la spculation philosophique, comme le montre Paul Ricur
propos de la reprise de la confrontation qui oppose cette fois les thses
de Kant celles de Husserl, et aboutit une aporie comparable:
Phnomnologie et critique n'empruntent l'une l'autre que sous la
condition de s'exclure l'une l'autre
37
.
Entre le temps cosmique et le temps intime se situe le temps racont
de l'historien. Il permet de reconfigurer le temps au moyen de
connecteurs particuliers. Paul Ricur place donc le discours historique
dans une tension qui lui est propre entre identit narrative et ambition
de vrit. La potique du rcit apparat comme la manire de dpasser
les apories de l'apprhension philosophique du temps. Ricur prfre
cet gard la notion de refiguration celle de rfrence, car il est
question de redfinir la notion mme de ralit historique partir des
connecteurs propres au tiers-temps historique, le plus souvent utiliss
par les historiens de mtier sans problmatisation. Parmi ces
connecteurs, on retrouve en effet des catgories familires l'historien:
celui de temps calendaire est le premier pont jet par la pratique
historienne entre le temps vcu et le temps cosmique
38
. Il se rapproche
du temps physique en ce qu'il est mesurable et il emprunte au temps
vcu. Le temps calendaire cosmologise le temps vcu et humanise le
temps cosmique
39
. La notion de gnration, devenue une catgorie
d'analyse essentielle aujourd'hui, depuis les travaux de J ean-Franois
Sirinelli, est considre par Ricur comme une mdiation majeure de la
pratique historienne qui permet aussi, comme l'a montr Dilthey,
d'incarner cette connexion entre temps public et temps priv. La notion
de gnration permet d'attester la dette, au-del de la finitude de
l'existence, par-del la mort qui spare les anctres des contemporains.
Il y a enfin la notion de trace qui a pris une telle ampleur aujourd'hui
que Carlo Ginzburg conoit un nouveau paradigme diffrent du
paradigme galilen et qu'il dfinit comme celui de la trace indiciaire
40
.
Objet usuel de l'historien, la notion de trace, matrialise par les
documents, les archives, n'en est pas moins nigmatique et essentielle
pour la reconfiguration du temps. Ricur emprunte l'expression de
signifiance de la trace Emmanuel Levinas
41
en tant que drangement
d'un ordre, signifiant sans faire apparatre. Mais il inscrit aussi la notion
de trace dans son lieu historique. Cette notion est utilise dans la
tradition historique depuis dj longtemps puisqu'on la retrouve chez
37
P. Ricur, Temps et rcit, ouvr. cit, t. 3, p. 106.
38
Ibid., p. 190.
39
Ibid,, p. 197.
40
C. Ginzburg, Traces, racines d'un paradigme indiciaire, dans Mythes, emblmes,
traces, Paris, Flammarion, 1989, p. 139-180.
41
E. Levinas, La trace, dans Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata
Morgana, 1972, p. 57-63.
150 La sociologie saisie par la littrature
Seignobos tout comme chez Marc Bloch. Cette conception d'une
science historique par traces correspond son pendant rfrentiel dans
une ambivalence qui rsiste la clture du sens, car le vestige est plong
dans le prsent en mme temps qu'il est le support d'une signification
qui n'est plus l.
Cette notion de trace, tout la fois idelle et matrielle, est
aujourd'hui le ressort essentiel de la grande fresque dirige par Pierre
Nora, celle des Lieux de mmoire. Elle est ce lien indicible qui relie le
pass un prsent devenu catgorie lourde dans la reconfiguration du
temps par l'intermdiaire de ses traces mmorielles. Pierre Nora y voit
une nouvelle discontinuit dans l'criture de l'histoire qu'on ne peut
appeler autrement qu' historio graphique*
2
. Cette rupture inflchit le
regard et engage la communaut des historiens revisiter autrement les
mmes objets au regard des traces laisses dans la mmoire collective
par les faits, les hommes, les symboles, les emblmes du pass. Cette
dprise/reprise de toute la tradition historique par ce moment mmoriel
que nous vivons ouvre la voie une tout autre histoire:
Non plus les dterminants, mais leurs effets; non plus les actions
mmorises ni mme commmores, mais la trace de ces actions et le jeu
de ces commmorations; pas les vnements pour eux-mmes, mais leur
construction dans le temps, l'effacement et la rsurgence de leurs
significations; non le pass tel qu'il s'est pass, mais ses remplois
permanents, ses usages et ses msusages, sa prgnance sur les prsents
successifs; pas la tradition, mais la manire dont elle s'est constitue et
transmise
43
.
Ce vaste chantier ouvert sur l'histoire des mtamorphoses de la
mmoire, sur une ralit symbolique la fois palpable et inassignable,
permet par sa double problmatisation de la notion d'historicit et de
celle de la mmoire d'exemplifier ce tiers-temps dfini par Ricur
comme pont entre temps vcu et temps cosmique. Il constitue le champ
d'investigation de ce que Reinhart Koselleck appelle notre espace
d'expri ence, soit ce pass rendu prsent. Il permet d'expl orer
l'nigme de la passit, car l'objet mmoriel en son lieu matriel ou
idel ne se dcrit pas en tant que simples reprsentations, mais, comme
le dfinit Ricur, en tant que reprsentance ou [...] lieutenance,
signifiant par l que les constructions de l'histoire ont l'ambition d'tre
des reconstructions rpondant la requte d'un vis--vis**. Ricur
signifie, et le projet de Pierre Nora n'est pas loin, que la passit d'une
42
P. Nora, Les lieux de mmoire, Paris, Gallimard, 1993, t. 3, vol. 1, p. 26.
43
Ibid., p. 24.
44
P. Ricur, Temps et rcit, ouvr. cit, t. 3, p. 228, cit par O. Mongin, Paul Ricur,
Paris, Seuil, 1994, p. 157.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 1 5 1
observation n'est pas par elle-mme observable, mais seulement
mmorable. Il pose frontalement la question de ce qui fait mmoire.
Insistant sur le rle des vnements fondateurs et sur leur liaison avec le
rcit comme identit narrative, Ricur ouvre la perspective historio-
graphique actuelle dans laquelle l'entreprise de Pierre Nora s'inscrit
comme monument de notre poque.
La tentative des Annales dans les annes soixante-dix de rompre
avec le rcit a t, selon Ricur, illusoire et contradictoire avec le projet
historien. Certes, l'cole des Annales, tout en admettant que l'historien
construit, problmatise et projette sa subjectivit sur son objet de
recherche, semblait a priori se rapprocher de la position de Ricur.
Mais en fait ce n'tait pas pour adopter le point de vue hermneutique
de l'explication comprehensive. Les Annales avaient pour cible
essentielle l'cole mthodique. Il tait donc question au contraire de
s'loigner du sujet pour briser le rcit historisant et faire prvaloir la
scientificit d'un discours historique renouvel par les sciences sociales.
Pour mieux faire apparatre la coupure pistmologique opre par les
Annales, ses instigateurs et disciples ont prtendu tordre le cou ce qui
tait dsign sous la forme pjorative d'histoire historisante: l'v-
nement et son rcit. Il y a bien eu des dplacements d'objets, une
rvaluation des phnomnes conomiques dans les annes trente, puis
une valorisation des logiques spatiales dans les annes cinquante.
Fernand Braudel a dnonc le temps court renvoy l'illusoire par
rapport aux permanences des grands socles de la go-histoire, la
longue dure. Cependant, et Paul Ricur l'a bien montr, les rgles de
l'criture historienne l'ont empch de basculer dans la sociologie, car
la longue dure reste dure. Braudel, en tant qu'historien, demeurait
tributaire de formes rhtoriques propres la discipline historique.
Contrairement ses proclamations tonitruantes, il poursuivait lui aussi
dans sa thse la ralisation d'un rcit: La notion mme d'histoire de
longue dure drive de l'vnement dramatique [...] c'est--dire de
l'vnement-mis-en-intrigue
45
. Certes, l'intrigue qui n'a plus pour
sujet Philippe II, mais la mer Mditerrane, est d'un autre type, mais elle
n'en reste pas moins une intrigue. La Mditerrane figure un quasi-
personnage qui connat sa dernire heure de gloire au XVIe sicle avant
que l'on assiste un basculement vers l'Atlantique et l'Amrique,
moment au cours duquel la Mditerrane en mme temps sort de la
grande histoire
46
. La mise en intrigue s'impose donc tout historien,
mme celui qui prend le plus de distance par rapport au rcitatif
classique de l'vnementiel politico-diplomatique. La narration
constitue ainsi la mdiation indispensable pour faire uvre historique et
lier l'espace d'exprience et l'horizon d'attente dont parle Koselleck:
45
P. Ricur, Temps et rcit, ouvr. t. 3, cit, p. 289.
46
Ibid., p. 297.
152 La sociologie saisie par la littrature
Notre hypothse de travail revient ainsi tenir le rcit pour le gardien
du temps, dans la mesure o il ne serait de temps pens que racont
47
.
La configuration du temps passe par la narration de l'historien. La
configuration historienne ainsi envisage se dplace entre un espace
d'exprience qui voque la multiplicit des parcours possibles et un
horizon d'attente qui dfinit un futur rendu prsent, non rductible
une simple drive de l'exprience prsente: Ainsi espace d'exp-
rience et horizon d'attente font mieux que de s'opposer polairement, ils
se conditionnent mutuellement
48
. La construction de cette hermneu-
tique du temps historique offre un horizon qui n'est plus tiss par la
seule finalit scientifique, mais tendu vers un faire humain, un dialogue
instituer entre les gnrations, un agir sur le prsent. C'est dans cette
perspective qu'il convient de rouvrir le pass, de revisiter ses poten-
tialits. En rcusant le rapport purement antiquaire l'histoire,
l'hermneutique historique vise rendre nos attentes plus dtermines
et notre exprience plus indtermine
49
. Le prsent rinvestit le pass
partir d'un horizon historique dtach de lui. Il transforme la distance
temporelle morte en transmission gnratrice de sens
50
. Le vecteur de
la reconstitution historique se trouve alors au cur de l'agir, du rendre-
prsent qui dfinit l'identit narrative sous sa double forme de la
mmet (Idem) et de soi-mme (Ipsit). La centralit du rcit relativise
la capacit de l'histoire enfermer son discours dans une explication
close sur des mcanismes de causalit. Elle ne permet ni de revenir la
prtention du sujet constituant matriser le sens
51
, ni de renoncer
l'ide d'une globalit de l'histoire selon ses implications thiques et
politiques
52
.
L'attention aux procdures textuelles, narratives, syntaxiques par
lesquelles l'histoire nonce son rgime de vrit conduit se
rapproprier les acquis des travaux de toute la filiation narratologiste
particulirement dveloppe dans le monde anglo-saxon et connue en
France grce Paul Ricur
53
. Le dveloppement des thses narrativistes
s'est en effet nourri du linguistic turn, de la critique du modle
nomologique et de la prise en considration du rcit comme gisement
de savoir, comme dploiement de ressources d'intelligibilit. Les
narrativistes ont ainsi permis de montrer la manire dont le mode de
rcit a valeur explicative, ne serait-ce que par l'emploi constant de la
conjonction de subordination parce que, qui recouvre et confond
47
Ibid.,
P-
435.
48
Ibid.,
P-
377.
49
Ibid.,
P-
390.
50
Ibid.,
P-
399.
51
Ibid.,
P-
488.
52
Ibid.,
P-
489.
53
P Ri ^npi i r To
P. Ricur, Temps et rcit, ouvr. cit, t. 1, p. 173-246.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 153
deux fonctions distinctes, la consecution et la consquence. Les liens
chronologiques et les liens logiques sont ainsi affirms sans tre
problmatiss. Or il convient de dsimbriquer ce mot de passe, le parce
que l'usage disparate. C'est ce travail sur les capacits explicatives
propres au rcit qu'a men le courant narrativiste. William Dray a ainsi
montr, ds les annes cinquante, que l'ide de cause doit tre disjointe
de l'ide de loi
54
. Il a dfendu un systme causal irrductible un
systme de lois, critiquant la fois ceux qui pratiquent cette rduction et
ceux qui excluent toute forme d'explication. Un peu plus tard, Georg
Henrik von Wright prconisait un modle mixte fond sur une
explication dite quasi causale
55
considre comme la plus approprie
l'histoire et aux sciences humaines en gnral. Les relations causales
sont, selon lui, troitement relatives leur contexte et l'action qui s'y
joue. S'inspirant des travaux d'Elisabeth Anscombe, il privilgie les
relations intrinsques entre les raisons de l'action et l'action elle-mme.
Von Wright oppose alors la connexion causale non logique, purement
externe, portant sur les tats de systme, et la connexion logique
rapporte aux intentions et prenant une forme tlologique. Le lien
entre ces deux niveaux htrognes se situe dans les traits configurants
du rcit: Le fil conducteur, selon moi, c'est l'intrigue, en tant que
synthse de l'htrogne
56
. Arthur Danto dcle de son ct les
diverses temporalits l'intrieur du rcit historique et remet en
question l'illusion d'un pass comme entit fixe par rapport laquelle
le regard de l'historien seul serait mobile. Il distingue au contraire trois
positions temporelles inhrentes la narration
57
. Le domaine de
l'nonc implique dj deux positions diffrentes: celle de l'vnement
dcrit et celle de l'vnement en fonction duquel il est dcrit. Il faut
encore ajouter le plan de renonciation qui se situe une autre position
temporelle, celle du narrateur. La consquence pistmologique d'une
telle diffrenciation temporelle fait figure de paradoxe de la causalit
puisqu'un vnement ultrieur peut faire apparatre un vnement
antrieur en situation causale. Par ailleurs, la dmonstration de Danto
revient considrer comme indistinctes explication et description,
l'histoire tant d'un seul tenant, selon son expression. Certains sont
alls encore plus loin, comme Hayden White
58
, dans la perspective de
construction d'une potique de l'histoire, en prsupposant que le
registre de l'historien n'est pas fondamentalement diffrent de celui de
54
W. Dray, Laws and Explanation in History, Oxford, Oxford University Press, 1957.
55
G. H. von Wright, Explanation and Understanding, Londres, Routledge and Kegan
Paul, 1971.
56
P. Ricur, Temps et rcit, ouvr. cit, t. 1, p. 202.
57
A. Danto, Analytical Philosophy of History, Cambridge, Cambridge University
Press, 1965.
58
H. White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe,
Baltimore et Londres, The J ohns Hopkins University Press, 1973.
154 La sociologie saisie par la littrature
la fiction au chapitre de sa structure narrative. L'histoire serait donc
d'abord criture, artifice littraire. Hay den White situe la transition entre
le rcit et l'argumentation dans la notion de mise en intrigue.
Paul Ricur est donc trs proche de ces thses. Il salue d'ailleurs
chez les narrativistes deux acquis majeurs. En premier lieu, ils font la
dmonstration que raconter, c'est dj expliquer [...]. Le "l'un par
l'autre" qui, selon Aristote, fait la connexion logique de l'intrigue, est
dsormais le point de dpart oblig de toute discussion sur la narration
historique
59
. En second lieu, la diversification et hirarchisation des
modles explicatifs les narrativistes ont oppos la richesse des lments
explicatifs internes au rcit,, Cependant, et malgr ces deux avances
dans la comprhension de ce qu'est un discours historien, Paul Ricur
ne suit pas les thses les plus radicales des narrativistes lorsqu'elles
postulent l'indistinction entre histoire et fiction. Malgr leur proximit,
il subsiste une coupure pistmologique qui est fonde sur le rgime de
vridicit propre au contrat de l'historien par rapport au pass. Il
partage sur ce point la position de Roger Chartier lorsqu'il affirme:
L'historien a pour tche de donner une connaissance approprie, contrle,
de cette population des morts personnages, mentalits, prix qui est son
objet. Abandonner cette prtention, peut-tre dmesure mais fondatrice,
serait laisser le champ libre toutes les falsifications, tous les
faussaires
60
.
Ce rappel du contrat de vrit qui lie l'historien son objet depuis
Hrodote et Thucydide est de premire importance pour qui s'oppose
toutes les formes de falsification et de manipulation du pass. Il n'est
pas contradictoire avec le fait d'tre attentif l'histoire comme criture,
comme pratique discursive.
L'attention aux rgimes de discours implique de rentrer dans cette
zone d'indtermination afin de ressaisir la faon dont se fabriquent les
rgimes de vrit et le statut de l'erreur, le caractre incommensurable
ou non des diverses assertions qui se donnent comme scientifiques.
Ricur ne suit donc pas la tentative dconstructrice de Michel Foucault
et de Paul Veyne qui s'inspire de Nietzsche et prne une simple
gnalogie des interprtations qui recouvrirait les faits historiques.
Rcusant tout la fois la tentation positiviste et la tentation gna-
logique, Ricur leur oppose une analyse de la ralit historique qu'il
place sous le signe de la "reprsentance" pour souligner son double
59
P. Ricur, Temps et rcit, ouvr. cit, t. 1, p. 251.
60
R. Chartier, Le Monde, 18 mars 1993.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 155
statut de ralit et de fiction: une fonction vicaire de lieutenance
61
.
Ricur ne s'enferme donc pas l'intrieur d'un discours clos sur lui-
mme. la formule provocatrice de Roland Barthes selon laquelle le
fait n'a jamais qu'une existence linguistique il oppose ce qu'il qualifie
de quadrilatre du discours; le locuteur qui prend la parole singulire
comme vnement; l'interlocuteur qui renvoie au caractre dialogique
du discours; le sens qui est le thme du discours, et enfin la rfrence
qui renvoie ce dont on parle, une extriorit du discours.
L'vnement et son sens
Entre sa dissolution et son exaltation, l'vnement, selon Paul
Ricur, subit une mtamorphose qui tient sa reprise hermneutique.
Rconciliant l'approche continuiste et discontinuiste, Paul Ricur
propose de distinguer trois niveaux d'approche de l'vnement:
1. vnement infra-significatif; 2. Ordre et rgne du sens, la limite
non-vnementiel; 3. Emergence d'vnements supra-significatifs, sur-
signifiants
62
. Le premier emploi correspond simplement au descriptif
de ce qui arrive et voque la surprise, le nouveau rapport l'institu.
Il correspond d'ailleurs aux orientations de l'cole mthodique de
Langlois et Seignobos, celui de l'tablissement critique des sources.
Deuximement, l'vnement est pris l'intrieur de schemes explicatifs
qui le mettent en corrlation avec des rgularits, des lois. Ce deuxime
moment tend subsumer la singularit de l'vnement sous le registre
de la loi dont il relve, au point d'tre aux limites de la ngation de
l'vnement. On peut y reconnatre l'orientation de l'cole des
Annales. ce deuxime stade de l'analyse doit succder un troisime
moment, interprtatif, de reprise de l'vnement comme mergence,
mais cette fois sursignifie. L'vnement est alors partie intgrante
d'une construction narrative constitutive d'identit fondatrice (la prise
de la Bastille) ou ngative (Auschwitz). L'vnement qui est de retour
n'est donc pas le mme que celui qui a t rduit par le sens explicatif,
ni celui infra-signifi qui tait extrieur au discours. Il engendre lui-
mme le sens: Cette salutaire reprise de Y vnement sursignifi ne
prospre qu'aux limites du sens, au point o il choue par excs et par
dfaut: par excs d'arrogance et par dfaut de capture
63
.
Les vnements ne sont dcelables qu' partir de leurs traces,
discursives ou non. Sans rduire le rel historique sa dimension
61
P. Ricur, Histoire et rhtorique, Diogne, no 168, octobre-dcembre 1994,
p. 25.
62
P. Ricur, Evnement et sens, L'vnement en perspectuive, Raisons pratiques,
no 2, 1991, p. 51-52.
63
Ibid., p. 55.
156 La sociologie saisie par la littrature
langagire, la fixation de l'vnement, sa cristallisation s'effectue
partir de sa nomination. C'est ce que montrent, dans une perspective
non essentialiste, les recherches de Grard Noiriel sur la construction de
l'identit nationale. Il constate, propos de l'immigration, que des
phnomnes sociaux peuvent exister sans avoir pour autant atteint une
visibilit. Durant le Second Empire, il y avait dj plus d'un million
d'immigrs qui, selon les enqutes de Le Play, s'assimilaient sans
problme dans les rgions franaises sans tre perus comme immigrs.
Ce n'est que dans les annes 1880 que le mot immigr connat une
vritable fortune, se fixe et fait vnement, lourd de consquences
ultrieures. Il se constitue donc une relation tout fait essentielle entre
langage et vnement qui est aujourd'hui largement accapare et
problmatise par les courants de l'ethnomthodologie, de l'interac-
tionnisme et, bien sr, par l'approche hermneutique. Tous ces courants
contribuent jeter les bases d'une smantique historique. Celle-ci prend
en considration la sphre de l'agir et rompt avec les conceptions
physicalistes et causalistes. La constitution de l'vnement est tributaire
de sa mise en intrigue. Elle est la mdiation qui assure la matrialisation
du sens de l'exprience humaine du temps aux trois niveaux de sa
prfiguration pratique, de sa configuration pistmique et de sa
reconfiguration hermneutique
64
. La mise en intrigue joue le rle
d'oprateur, de mise en relation d'vnements htrognes. Elle se
substitue la relation causale de l'explication physicaliste. L'herm-
neutique de la conscience historique situe l'vnement dans une tension
interne entre deux catgories mta-historiques que repre Koselleck,
celle d'espace d'exprience et celle d'horizon d'attente. Ces deux
catgories permettent une thmatisation du temps historique qui se
donne lire dans l'exprience concrte, avec des dplacements
significatifs comme celui de la dissociation progressive entre exprience
et attente dans le monde moderne occidental. Le sens de l'vnement,
selon Koselleck, est donc constitutif d'une structure anthropologique de
l'exprience temporelle et de formes symboliques historiquement
institues. Koselleck dveloppe donc une problmatique de 'indivi-
duation des vnements qui place leur identit sous les auspices de la
temporalisation, de l'action et de l'individualit dynamique
65
. Il vise
donc un niveau plus profond que celui de la simple description en
s'attachant aux conditions de possibilit de l'vnementialit. Son
approche a le mrite de montrer le caractre oprationnel des concepts
historiques, leur capacit structurante et tout la fois structure par des
situations singulires. Ces concepts, porteurs d'exprience et d'attente,
ne sont pas de simples piphnomnes langagiers opposer l'histoire
64
J. L. Petit, La constitution de l'vnement social, L'vnement en perspective,
Raisons pratiques, no 2, 1991, p. 15.
65
L. Qur, vnement et temps de l'histoire, L'vnement en perspective, Raisons
pratiques, no 2, 1991, p. 267.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 157
vraie; ils ont un rapport spcifique au langage partir duquel ils
influent sur chaque situation et vnement ou y ragissent
66
. Les
concepts ne sont ni rductibles quelque figure rhtorique, ni simple
outillage propre classer dans des catgories. Ils sont ancrs dans le
champ d'exprience d'o ils sont ns pour subsumer une multiplicit
de significations. Peut-on affirmer alors que ces concepts russissent
saturer le sens de l'histoire jusqu' permettre une fusion totale entre
histoire et langage? Comme Paul Ricur, Reinhart Koselleck ne va pas
jusque-l et considre au contraire que les processus historiques ne se
limitent pas leur dimension discursive: L'histoire ne concide jamais
parfaitement avec la faon dont le langage la saisit et l'exprience la
formule
67
. C'est, comme le pense Paul Ricur, le champ pratique qui
est l'enracinement dernier de l'activit de temporalisation.
Ce dplacement de l'vnementialit vers sa trace et ses hritiers a
donn lieu un vritable retour de la discipline historique sur elle-
mme, l'intrieur de ce que l'on pourrait qualifier de cercle herm-
neutique ou de tournant historiographique. Ce nouveau moment invite
suivre les mtamorphoses du sens dans les mutations et glissements
successifs de l'criture historienne entre l'vnement lui-mme et la
position prsente. L'historien s'interroge alors sur les diverses
modalits de la fabrication et de la perception de l'vnement partir
de sa trame textuelle. Ce mouvement qui porte visiter le pass par
l'criture historienne accompagne l'exhumation de la mmoire
nationale et conforte encore le moment mmoriel actuel. Par le
renouveau historiographique et mmoriel, les historiens assument le
travail de deuil d'un pass en soi et apportent leur contribution
l'effort rflexif et interprtatif actuel dans les sciences humaines.
Le prsent en position de surplomb
Livr la mondialisation des informations, l'acclration de leur
rythme, le monde contemporain connat une extraordinaire dilatation
de l'histoire, une pousse d'un sentiment historique de fond
68
. Cette
prsentification a eu pour effet une exprimentation moderne de
l'historicit. Elle impliquait une redfinition de l'vnementialit
comme approche d'une multiplicit de possibles, de situations virtuelles,
potentielles, et non plus comme l'accompli dans sa fixit. Le
mouvement s'est empar du temps prsent jusqu' modifier le rapport
66
R. Koselleck, Le futur pass, contribution la smantique des temps historiques,
Paris, EHESS, 1990, p. 264.
67
Ibid., p. 195.
68
P. Nora, De l'histoire contemporaine au prsent historique, dans crire l'histoire
du temps prsent, Paris, IHTP, 1993, p. 45.
158 La sociologie saisie par la littrature
moderne au pass. La lecture historique de l'vnement n'est plus
rductible l'vnement tudi, mais envisage dans sa trace, situe
dans une chane vnementielle. Tout discours sur un vnement
vhicule, connote une srie d'vnements antrieurs, ce qui donne toute
son importance la trame discursive qui les relie dans une mise en
intrigue. Comme on peut le mesurer, l'histoire du temps prsent
n'engage pas seulement l'ouverture d'une priode nouvelle, le trs
proche s'ouvrant au regard de l'historien. Elle est aussi une histoire
diffrente, participant aux orientations nouvelles d'un paradigme qui se
cherche dans la rupture avec le temps unique et linaire, et pluralisant
les modes de rationalit.
On a oppos l'histoire du temps prsent des arguments compor-
tant un certain nombre d'obstacles insurmontables. En premier lieu, le
handicap de la proximit ne permettrait pas de hirarchiser selon un
ordre d'importance relatif dans la masse des sources disponibles. On ne
peut, selon cette critique, dfinir ce qui relve de l'historique et ce qui
tient de l'piphnomne. En second lieu, on lui reproche d'utiliser un
temps tronqu de son futur. L'historien ne connat pas la destine
temporelle des faits tudis alors que le plus souvent le sens ne se rvle
que dans l'aprs-coup. ce propos, Paul Ricur, qui inscrit son
intervention dans le cadre d'une dfense de la lgitimit de l'histoire du
temps prsent, attire l'attention sur les difficults d'une configuration
inscrite dans la perspective d'une distance temporelle courte. Il
prconise de distinguer dans le pass rcent: d'une part, le temps
inachev, le devenir en cours lorsque l'on en parle au milieu du gu,
ce qui constitue un handicap pour cette historiographie, c'est la place
considrable des prvisions et des anticipations dans la comprhension
de l'histoire en cours
69
, et, d'autre part, le temps cltur, celui de la
Seconde Guerre mondiale, de la dcolonisation, de la fin du
communisme... et cet gard la date de 1989 devient une date int-
ressante de clture qui permet de configurer des ensembles intelligibles
une fois un certain cycle achev. ces handicaps s'ajoute la loi des
trente ans qui ne permet pas d'avoir accs dans l'immdiat aux
archives. Il faut encore ajouter le manque de recul critique qui spcifie
la dmarche historienne.
Mais l'histoire du temps prsent a aussi la capacit de transformer
plusieurs de ces inconvnients en avantages, comme le dmontre Robert
Frank, le successeur de Franois Bdarida la direction de l'Institut des
69
P. Ricur, Remarques d'un philosophe, dans crire l'histoire du temps prsent,
ouvr. cit, p. 38.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 159
hauts travaux pratiques (IHTP) jusqu'en 1994
70
. Le travail d'inves-
tigation sur de l'inachev contribue dfataliser l'histoire, relati-
viser les chanes causales qui constituaient les grilles de lecture, le prt-
-porter de l'historien. L'histoire du temps prsent est cet gard un
bon laboratoire pour briser le fatalisme causal. D'un autre ct, mme
si son maniement pose des problmes mthodologiques srieux,
l'historien a la chance de pouvoir travailler sous contrle des tmoins
des vnements qu'il analyse. Il dispose de sources orales qui sont un
atout certain, mme si celles-ci sont manier avec prudence et avec une
distance critique, car elles sont une source sur un temps pass et non
pas, comme de nombreuses sources crites, contemporaine de
l'vnement
71
. Cette interactivit, qui sollicite l'historien confront
son enqute de terrain, la manire du sociologue, place celui-l en
bonne position pour faire une histoire objective de la subjectivit
72
.
Cette histoire du temps prsent aura contribu renverser le rapport
histoire/mmoire. L'opposition traditionnelle entre une histoire critique
situe du ct de la science et une mmoire relevant de sources
fluctuantes et en partie fantasmatiques est en voie de transformation.
Alors que l'histoire perd une part de sa scientificit, la problmatisation
de la mmoire conduit accorder une part critique l'approche de la
notion de mmoire. Les deux notions se sont rapproches et la part des
sources orales dans l'criture du temps prsent rend possible une
histoire de la mmoire: On rige la mmoire elle-mme en objet
historique
73
. Ce renversement a une valeur heuristique, car il permet de
mieux comprendre le caractre indtermin des possibles ouverts pour
des acteurs d'un pass qui fut leur prsent. L'histoire du temps prsent
modifie donc le rapport au pass, sa vision et son tude. L'historien du
temps prsent inscrit l'opration historiographique dans la dure. Il ne
limite pas son objet l'instant. Il doit faire prvaloir une pratique
consciente d'elle-mme, ce qui interdit les navets frquentes devant
l'opration historique.
Inscrit dans le temps comme discontinuit, le prsent est travaill par
celui qui doit l'historiciser par un effort pour apprhender sa prsence
comme absence, la manire dont Michel de Certeau dfinissait
l'opration historiographique
74
. Cette dialectique est d'autant plus
70
R. Frank, Einjeux pistmologiques de l'enseignement de l'histoire du temps
prsent, dans L'histoire entre pistmologie et demande sociale, Paris, actes de
l'universit d't de Blois, septembre 1993, 1994, p. 161-169.
71
Ibid., p. 165.
72
Ibid., p. 166.
73
P. Ricur, Remarques d'un philosophe, dans Ecrire l'histoire du temps prsent,
ouvr. cit, p. 37.
74
M. de Certeau, L'absent de l'histoire, ouvr. cit.
160 La sociologie saisie par la littrature
difficile raliser qu'il faut procder une dsintrication volontariste
pour l'histoire du temps prsent, plus naturelle lorsqu'il est question
d'un temps rvolu: La question est de savoir si, pour tre historique,
l'histoire du temps prsent ne prsuppose pas un mouvement semblable
de chute dans l'absence, du fond duquel le pass nous interpellerait
avec la force d'un pass qui fut nagure prsent
75
. On saisit ici quel
point l'histoire du temps prsent est anime par des motivations plus
profondes que celles d'un simple accs du plus contemporain. C'est
la qute de sens qui guide ses recherches autant que le refus de
l 'phmre. Un sens qui n'est plus un telos, une continuit pr-
construi te, mais une raction l 'a-chroni e contemporai ne
76
.
L'hi stoi re du temps prsent se diffrencie donc radicalement de
l'histoire classiquement contemporaine. Elle est en qute d'paisseur
temporelle et cherche ancrer un prsent trop souvent vcu dans une
sorte d'apesanteur temporelle. Par sa volont rconciliatrice, au cur du
vcu, du discontinu et des continuits, l'histoire du prsent comme
tlescopage constant entre pass et prsent permet un vibrato de
l'inachev qui colore brusquement tout un pass, un prsent peu peu
dlivr de son autisme
77
.
La reconfiguration du temps par l'agir
La clarification des jeux de langage, tche que Wittgenstein assignait
la philosophie, permet Ricur d'lucider et de relativiser la notion
commune des schemes explicatifs de l'historien, la notion de cause.
Ricur adhre pleinement la formule de Charles Taylor selon laquelle
l'homme est un self-interpreting animal
18
. Ce dtour par l'autre dans
le travail interprtatif sur soi est l'axe mme du parcours hermneutique
de Paul Ricur, au cur de l'action, de la pratique: Notre concept du
soi sort grandement enrichi de ce rapport entre interprtation du texte
de l'action et auto-interprtation
79
. Cette position implique la mme
distinction pistmologique dfendue par Charles Taylor et Paul
Ricur: Cela signifie que la recherche d'adquation entre nos idaux
de vie et nos dcisions, elles-mmes vitales, n'est pas susceptible de la
sorte de vrification que l'on peut attendre des sciences fondes sur
75
P. Ricur, Remarques d'un philosophe, dans crire l'histoire du temps prsent,
ouvr. cit, p. 39.
76
J .-P. Rioux, Peut-on faire une histoire du temps prsent?, dans Questions
Vhistoire des temps prsents, Bruxelles, Complexe, 1992, p. 50.
77
Ibid., p. 54.
78
C. Taylor, Philosophical Papers, Cambridge, Cambridge University Press, 2 vol.,
1985, vol. 1, Human Agency and Language, p. 45.
79
P. Ricur, Soi-mme comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 211.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 161
l'observation
80
. La corrlation tablie entre l'intentionnalit et les lois
narratives est commune Charles Taylor et Paul Ricur qui lui
reprend l'ide d'aprs laquelle classer une action comme intentionnelle,
c'est dcider quel type de loi elle doit son explication: La condition
d'apparition d'un vnement est que se ralise un tat de choses tel
qu'il amnera la fin en question, ou tel que cet vnement est requis
pour cette fin
81
. La smantique de l'action doit alors tablir le lien
entre la forme de loi interne l'explication tlologique et les traits
descriptifs de l'action. Cet aspect, propre au discours historique, a t
largement analys par Paul Ricur dans le tome 1 de Temps et rcit.
L'intentionnalit se rvle dans le langage de l'action, soit l o se
dit l'action dans les rcits, les descriptions, les explications, les
justifications. Ces notions de motivations, de raisons d'agir, d'objectifs,
ncessitent donc un dtour par la textualit, propre l'approche
hermneutique. Il convient d'viter deux cueils quant aux relations
entre le langage de l'action et l'action elle-mme. D'une part, on a
tendance attribuer une qualit de reprsentation au langage de
l'action, postulant ainsi une indpendance des processus rels par
rapport leur mise en discours. Cette position se traduit par ce que
Ricur appelle le souci de la description vraie ou encore de la mise en
correspondance des propositions avec l'tat rel du monde
82
. Le
second cueil consiste pratiquer la clture du langage de l'action sur
lui-mme et considrer que la structure intentionnelle est entirement
dcelable l'intrieur mme de la structure grammaticale. Mais il y a
une troisime position possible qui est de reconnatre la fonction de
structuration du champ pratique par le langage de l'action. L'expli-
citation discursive reste alors ouverte sur le plan de sa temporalit et
clarifie quelque chose qui a t configur et rendu possible: Elle lui
confre "les traits de sa propre dterminit" (Gadamer
83
). Or le lieu
naturel de l'intentionnalit est l'espace public dans lequel s'accomplit
l'action concrte. Charles Taylor insiste particulirement sur
l'importance de cette incarnation de l'action dans l'espace public, lieu
d'expression privilgi de l'intersubjectivit pratique. Une telle
conception s'oppose l'approche dualiste dans la mesure o l'action
n'est pas l'extriorisation d'une intriorit dj l qu'il suffirait de
mettre en forme. L'intriorit se constitue par rappropriation, par
internalisation de l'expression publique. Une telle conception introduit
de ncessaires mdiations afin que soit pratique une reprise
80
Ibid., p. 211.
81
C. Taylor, The Explanation of Behaviour, Londres, Routledge and Kegan, 1954, cit
par P. Ricur, Soi-mme comme un autre, ouvr. cit, p. 98.
82
L. Qur, Agir dans l'espace public, Raisons pratiques, no 1, EHESS, 1990, p. 90.
83
Ibid., p. 90.
162 La sociologie saisie par la littrature
interprtative, alors que l'on avait coutume de dcrire le procs de
subjectivation dans une transparence postule.
L'incidence majeure pour l'pistmologie de l'histoire est de
pouvoir dpasser les apories d'une thorie pure de la comprhension
(Verstehen) en introduisant le moment critique l'intrieur d'une
approche fonde sur la communication immdiate avec la diffrence,
d'introduire la mdiation dans la relation immdiate d'intropathie
84
.
Certains ont choisi la voie de la construction de l'histoire sur le modle
des sciences de la nature, partant du postulat d'une pistmologie
commune. C'est le cas de la thorie de Cari Hempel sur les lois de
l'histoire
85
. Entre ces deux orientations prsentes comme alternatives,
celle de la comprhension et celle de l'explication, Ricur permet de
rconcilier ces deux exigences en mettant en avant la comptence
spcifique qui est celle de suivre une histoire. Elle revient compren-
dre une succession d'actions, de penses, de sentiments prsentant la
fois une certaine direction mais aussi des surprises (concidences,
reconnaissances, rvlations., etc.). Ds lors, la conclusion de l'histoire
n'est jamais dductible et prdictible
86
. Cette perspective conduit
l'historien faire ce que Bruno Latour ralise dans le domaine de
l'anthropologie des sciences avec son principe de symtrie gnralise,
une cure d'amaigrissement des explications
87
. La discipline historique
combine les deux exigences thoriques de l'tude de la textualit et de
l'action et se donne donc pour ambition de construire une thorie du
rcit vrai des actions des hommes du pass
88
.
Du ct de la philosophie analytique, on note aussi une attention
particulire au discours de l'action, une internalisation des rapports
entre intention et action. C'est le cas de la thse du philosophe
analytique Donald Davidson. Au centre de ses interrogations se trouve
la question de l'agir, de son interprtation, leste chez lui de sa
dimension thique. Il repre une dissociation faire entre les raisons
des actes des individus telles qu'ils se les reprsentent et les causes qui
les font agir et demeurent, elles, dans l'opacit
89
. Cette dualit propre
toute action rend impossible toute entreprise rductionniste qui
rabattrait les processus psychiques sur des phnomnes neuronaux.
Fondant sa thorie de la signification sur une thorie du tenir-
pour-vrai du discours de l'acteur, Davidson a valoris l'tude du
84
P. Ricur, Du texte l'action, Paris, Seuil, 1986, p. 177.
85
C. Hempel, The function of general laws in history, The Journal of Philosophy,
no 39, 1942, p. 35-48.
86
P. Ricur, Du texte Vaction, ouvr. cit, p. 179.
87
B. Latour, Nous n'avons jamais t modernes, Paris, La Dcouverte, 1991.
88
P. Ricur, Du texte Vaction, ouvr. cit, p. 181.
89
D. Davidson, Actions et vnements, trad, par P. Engel, Paris, PUF, 1983.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 163
fonctionnement du processus interprtatif, rcusant le partage entre
esprit et matire. Pour Davidson l'interprtation reste fondamen-
talement indtermine, mais cependant encadre par les contraintes de
rationalit normative: C'est pourquoi on peut appeler sa conception de
l'interprtation "rationalisante
90
" quant la question majeure
laquelle la philosophie de l'esprit, de tradition analytique, tente de
rpondre, et qui est de savoir quelles sont les conditions de vrit des
attributions de contenus mentaux? Davidson dfend donc une
interprtation qu'il qualifie lui-mme de radicale et situe sa position
comme proche de celle de Gadamer dont l'approche hermneutique
du langage s'apparente son traitement de l'interprtation "radi-
cale
91
".
La filiation des travaux de Davidson comme de ceux de Denett est
davantage rapprocher de la tradition analytique qui a permis de
nourrir la rflexion des sciences cognitives sur l'action, par un retour
aux choses mmes. Entre l'interprtation de l'action telle que
l'entend Paul Ricur et l'interprtation radicale de Davidson, il y a
plus que des nuances, mais bien des diffrences importantes de
perspective. Paul Ricur, dans son dialogue constant et prcoce avec les
positions de la philosophie analytique, a fortement discut les thses de
Davidson
92
. Il salue tout d'abord la rigueur remarquable
93
avec
laquelle Davidson ralise une double rduction logique et ontologique
qui l'amne voir dans l'action une sous-classe d'vnements
dpendants d'une ontologie de l'vnement impersonnel
94
. L'expli-
cation causale a donc pour fonction d'intgrer les actions dans une
ontologie qui rige la notion d'vnement au mme niveau que celle de
substance. La dmonstration de Davidson de 1963
95
consiste montrer
que l'explication invoquant des raisons s'apparente une explication
causale, ce qui ne renvoie pas ncessairement une conception
nomologique. Ce rapport interne description/explication rgissant les
vnements singuliers rejoint d'ailleurs les positions de Ricur
dveloppes clans le premier tome de Temps et rcit. Mais Davidson
manque la dimension phnomnologique de l'orientation consciente
par un agent capable de se vivre comme responsable de ses actes. Il
attnue la fois le caractre temporel de l'intentionnalit et la rfrence
l'agent. C'est la critique majeure que Ricur formule par rapport la
P. Engel, Introduction la philosophie de Vesprit, Paris, La Dcouverte, 1994,
92
P. Ricur, Soi-mme comme un autre, ouvr. cit, p. 93-108.
93
Ibid., p. 93.
94
D. Davidson, ouvr. cit.
95
D. Davidson, Actions, reasons and causes, dans Essays on Actions and Events,
ouvr. cit, p. 3-19.
164 La sociologie saisie par la littrature
position de Davidson, celle d'occulter l'attribution de l'action son
agent, dans la mesure o il n'est pas pertinent pour la notion
d'vnement qu'il soit suscit, amen par des personnes ou par des
choses
96
. Dans la rectification conduite par Davidson lui-mme quinze
ans plus tard, en 1978, dans son nouvel essai sur l'action
97
, il reconnat
avoir dlaiss des dimensions essentielles de l'intentionnalit: celle de
l'orientation vers le futur, du dlai d'accomplissement et de la
participation de l'agent. Cependant, il ne rvise pas pour autant sa
conception de l'explication causale. La notion de personne reste tout
autant impertinente: Ni 1'ascription, ni son attestation ne pouvaient
trouver place dans une smantique de l'action que sa stratgie
condamne demeurer smantique de l'action sans agent
98
.
La smantique de l'action ncessite un agent situ historiquement,
car, pour Ricur, le vcu et le concept sont inextricablement lis.
Rcusant la double invitation au repli sur une ontologie fondamentale,
la manire heideggrienne, ainsi que la fermeture sur un discours
purement pistmologique, Ricur met en scne des mdiations
imparfaites, sources d'laboration d'une dialectique inacheve.
C'est l'intrieur de cet espace intermdiaire entre doxa et pistm
que se situe le domaine du doxazein qui correspond justement chez
Aristote la "dialectique" et exprime la sphre de l'opinion droite,
celle qui ne se confond ni avec la doxa ni avec Y pistm, mais avec le
probable et le vraisemblable
99
. L'utilisation de mdiations imparfaites
convient d'autant mieux l'opration historiographique que celle-ci
doit rester ouverte de nouvelles lectures, de nouvelles appropriations
pour les gnrations venir. Pris dans une dialectique de Y arche et du
tlos, le rgime d'historicit est tout entier travers par la tension entre
espace d'exprience et horizon d'attente. Ricur rcuse donc le
renfermement du discours historien que l'on voit se dployer
aujourd'hui dans un rapport purement mmoriel de reprise du pass,
coup d'un avenir devenu soudainement forclos. Pierre Nora convient
d'ailleurs que notre prsent mmoriel n'est peut-tre qu'un moment,
une conjoncture intellectuelle, lorsque dans sa phrase conclusive des
sept volumes des Lieux de mmoire il prcise que cette tyrannie de la
mmoire ne durera peut-tre qu'un temps, mais c'tait le ntre
100
.
Au-del de la conjoncture mmorielle actuelle, symptomatique de la
crise d'une des deux catgories mta-historiques, l'horizon d'attente,
96
P. Ricur, Soi-mme comme un autre, ouvr. cit, p. 101.
97
D. Davidson, Intending, dans Essays on Action and Events, ouvr. cit,
p. 83-102.
98
P. Ricur, Soi-mme comme un autre, ouvr. cit, p. 108.
99
O. Mongin, ouvr. cit, p. 27.
oo p j\f
ora?
L
es
ii
eU
x de mmoire, ouvr. cit, t. 3, vol. 3, p. 1012.
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 165
l'absence de projet de notre socit moderne, Ricur rappelle la
fonction de l'agir, de la dette thique de l'histoire l'endroit du pass.
Le rgime d'historicit, toujours ouvert vers le devenir, n'est certes plus
la projection d'un projet pleinement pens, ferm sur lui-mme.
v
La
logique mme de l'action maintient ouvert le champ des possibles. ce
titre, Ricur dfend la notion d'utopie, non quand elle est l'assise
d'une logique folle, mais comme fonction libratrice qui empche
l'horizon d'attente de fusionner avec le champ d'exprience. C'est ce
qui maintient l'cart entre l'esprance et la tradition
101
. Il dfend avec
la mme fermet le devoir, la dette des gnrations prsentes l'endroit
du pass, source de l'thique de responsabilit. La fonction de l'histoire
reste donc vive. L'histoire n'est pas orpheline, comme on le croit,
condition de rpondre aux exigences de l'agir. Ainsi, le deuil des
visions tlologiques peut devenir une chance pour revisiter partir du
pass les multiples possibles du prsent afin de penser le monde de
demain.
Franois DOSSE
Professeur
Universit Paris X-Nanterre
Rsum
L'auteur se donne comme objet de discuter de la valeur
philosophique et scientifique de la contribution de Paul Ricur quant
l'criture de l'histoire, plus particulirement au regard du rapport entre
l'objectivit et la subjectivit et du rle de l'intentionnalit dans
l'historicit et le devenir. Pour ce faire, il organise son analyse autour
des trois tomes de Temps et rcit (1983-1985) o Ricur oppose
l'autosatisfaction triomphaliste de l'cole des Annales sa proposition de
dialogue entre la philosophie et l'histoire. L'auteur passe en revue un
certain nombre de ractions aux propos de Ricur (entre autres de
Certeau, Chartier, Rancire, Duby) et compare sa position celle
d'autres historiens et philosophes anglophones (entre autres celle de
Dray, von Wright, Danto, White, Taylor). Ces discussions lui permettent
d'explorer systmatiquement la pense du philosophe-historien. On est
ainsi amen constater que, pour Ricur, la pratique historienne est en
tension constante entre l'objectivit, jamais incomplte, et la
subjectivit du regard mthodique qui doit se dprendre d'une partie de
soi-mme. Cette tension, prcise Ricur, rgit le contrat de vrit qui
guide l'investigation historienne et fonde sa mthode et o la
subjectivit de rflexion se trouve engage dans la construction mme
des schmas d'intelligibilit. Il n'est donc pas tonnant alors que
P. Ricur, Du texte l'action, ouvr. cit, p. 391.
166 La sociologie saisie par la littrature
l'objet de Temps et rcit soit de penser l'articulation du temps qui doit
apparatre avec le temps qui est conu comme condition des
phnomnes. C'est ce qui fonde le projet hermneutique de Ricur,
c'est--dire rouvrir le pass,, revisiter ses potentialits la lumire de
l'intentionnalit du locuteur analysant. Ce projet ne pouvait que mener
Ricur s'interroger sur l'vnement et son sens. ce propos, l'auteur
souligne ici l'importance de la contribution du philosophe au moment
o la mondialisation de l'information fait que la totalit sociale connat
une extraordinaire dilatation de l'histoire, ce qui constitue une prsen-
tification conduisant une exprimentation nouvelle de l'historicit, o
l'vnementialit est redfinie comme approche d'une multiplicit de
possibles et o la lecture historienne de l'vnement n'est plus
rductible l'vnement tudi, mais envisage dans sa trace situe dans
une chane vnementielle, donc l'intrieur d'un processus. Sur cette
base, on comprend alors toute l'importance de la contribution de
Ricur l'histoire du temps prsent et l'incidence de ses travaux sur le
rapport entre histoire et mmoire, dans lesquels cette dernire est elle-
mme rige en objet historique. L'auteur souligne que ce renver-
sement a une valeur heuristique, car il permet de mieux comprendre
l'indtermination des possibles ouverts pour les acteurs, indtermination
o l'intentionnalit subjective des acteurs prend tout son importance
dans la dtermination du rgime d'historicit, ce dernier tant travers
par la tension entre l'espace d'exprience et l'horizon des attentes.
C'est ce qui fait que le rgime d'historicit est toujours ouvert vers le
devenir et ne peut tre la simple projection d'un projet social pens et
ferm sur lui-mme, la logique d'action maintenant toujours ouvert le
champ des possibles.
Mots-cls: Ricur, objectivit, subjectivit, intentionnalit, historicit,
devenir, philosophe-historien, vnement, prsentification,
attentes.
Summary
The author discusses the philosophical and scientific value of Paul
Ricoeur's contribution to the writing of history. In particular, he
focuses on the relationship between objectivity and subjectivity and the
role of intentionality in historicity and destiny. To do so, the analysis is
organized around the Temps et rcit in three volumes (1983-1985), in
which Ricoeur opposes his proposition concerning the dialogue
between philosophy and history to the self-satisfied triumphalism of the
Annales School. The author reviews a variety of reactions to Ricoeur
(among others: de Certeau, Chartier, Rancire, Duby) and compares his
position to those of Anglophone historians and philosophers (among
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 167
others: Dray, von Wright, Danto, White, Taylor). These discussions
permit a systematic exploration of the thought of the philosopher-
historian. This leads to the realization that, for Ricoeur, the historian's
practice is in constant tension between an always incomplete objectivity
and the subjectivity of the methodological gaze which must always
depend on a part of itself. This tension, argues Ricoeur, regulates the
"truth contract" which guides historical investigation and grounds its
method in which the subjectivity of thought is engaged in the very
construction of frameworks of intelligibility. It is therefore not
surprising that Temps et rcit is devoted to thinking through the
articulation of time which must appear with the notion of time
conceived as a condition of historical phenomena. It is precisely this
which is the basis for Ricoeur's hermeneutic project, i.e. reopening the
past, revisiting its potentialities in light of the intentionality of the
analyst. This project could only lead Ricoeur to reflect upon events and
their meanings. In this regard, the author emphasizes the importance of
philosophy's contribution at a time when the globalization of
information has led to a conjuncture in which the social totality is
experiencing a dilation of history. This has produced a presentification
leading to a new experience of historicity, in which historical facticity is
redefined as an approach involving a multiplicity of possibilities and the
historian's reading of events, no longer reducible to the event in
question, is viewed rather as a trace situated in a chain of events and
therefore within a process. On this basis it is possible to understand the
importance of Ricoeur's contribution to the history of the present, as
well as the impact of his work on the history-memory relationship,
which is itself presented as an historical object. This reversal has an
historical value because it allows for a better understanding of the
indeterminate character of the possibilities open to actors, an
indeterminacy in which the subjective intentionality of actors assumes
an importance in the determination of the regime of historicity,
inasmuch as the latter is traversed by the tension between the space of
experience and the horizon of expectation. As such, the regime of
historicity is always open towards the future and cannot be a mere
projection of a social project closed upon itself, the logic of action
always keeps open the field of possibility.
Key-words: Ricoeur, objectivity, subjectivity, intentionality, destiny,
philosopher-historian, event, presentification, expectations.
168 La sociologie saisie par la littrature
Resumen
El autor se propone discutir el valor filosfico y cientfico de la
contribucin de Paul Ricur al tema de la escritura de la historia,
particularmente a la relacin entre la objetividad y la subjetividad, y el
rol de la intencionalidad en la historicidad y el devenir. Para eso
organiza su anlisis sobre la base de Temps et rcit, tres libros (1983-
1985) donde Ricur opone a la autosatisfaccin triunfalista de la
escuela de los Annales su proposicin de dilogo entre la filosofa y la
historia. El autor examina algunas de las reacciones a los dichos de
Ricur (entre otras las de Certeau, Chartier, Ranciare, Duby) y compara
su posicin con las de otros historiadores y filsofos de habla inglesa
(entre otros: Dray, von Wright, Danto, White, Taylor). Estas discusiones
le permiten explorar sistemticamente el pensamiento del filsofo-
historiador. Se constata de esta manera que, para Ricur, la prctica
historiadora se halla en tensin permanente entre la objetividad, siempre
incompleta, y la subjetividad de la mirada metdica que debe
deshacerse de una parte de si misma. Esta tensin, aclara Ricur, rige el
contrato de verdad que gua la investigacin histrica y funda su
mtodo; y donde, adems, la subjetividad de la reflexin se halla
comprometida en la construccin misma de los esquemas de
intelegibilidad. No debe sorprender entonces que el objeto de Temps et
rcit sea pensar la articulacin del tiempo que debe aparecer con el
tiempo concebido como condicin de los fenmenos. Eso es lo que
funda el proyecto hermenutico de Ricur, es decir reabrir el pasado,
volver a sus potencialidades a la luz de la intencionalidad del que
analiza. Este proyecto debia conducirle a interrogarse acerca del evento
y su sentido. En relacin a esto, el autor recalca la importancia de la
contribucin del filsofo cuando la mundializacin de la informacin
hace que la totalidad social conozca una extraordinaria dilatacin de la
historia, lo que constituye un hacer presente que conduce a una nueva
experiencia de la historicidad; donde la cualidad de evento es redefinida
como aproximacin a una multiplicidad de posibles y donde la lectura
histrica del evento no es ms rductible al evento estudiado, sino que
es encarada desde la huella que deja en una cadena de eventos, dentro
de un proceso. Asi se comprende toda la importancia de la contribucin
de Ricur a la historia del tiempo presente y la incidencia de sus
trabajos sobre la relacin historia-memoria, en los cuales esta ltima es
ella misma erigida como objeto histrico. El autor subraya que este giro
tiene un valor heurstico dado que permite comprender mejor el
carcter indeterminado de las posibilidades abiertas para los actores;
pero se trata de una indeterminacin donde la intencionalidad subjetiva
de los actores adquiere toda su importancia para la determinacin del
rgimen de historicidad, siendo este ltimo atravezado por la tensin
entre el espacio de experiencia y el horizonte de la expectativas. Esto es
lo que hace, subraya Ricur, que el rgimen de historicidad sea siempre
Paul Ricur et l'criture de l'histoire 169
abierto al devenir y no pueda ser la simple proyeccin de un proyecto
social pensado y cerrado en si mismo, dado que la lgica de accin
mantiene siempre abierto el campo de las posibilidades.
Palabras claves: Ricur, objetividad, subjetividad, intencionalidad,
historicidad, devenir, filsofo-historiador, evento,
presentizacin, expectativas.
Vous aimerez peut-être aussi
- Merleau Ponty, Le Tournant de L'expérience, BarbarasDocument287 pagesMerleau Ponty, Le Tournant de L'expérience, BarbarasGros Caca Liquide100% (2)
- Michel Clouscard - Lëtre Et Le Code - Le Procès de Production D'un Ensemble Précapitaliste. (1972, La Haye, Mouton) PDFDocument629 pagesMichel Clouscard - Lëtre Et Le Code - Le Procès de Production D'un Ensemble Précapitaliste. (1972, La Haye, Mouton) PDFyohanes100% (2)
- Ricoeur - Histoire de La Philosophie AllemandeDocument43 pagesRicoeur - Histoire de La Philosophie AllemandeJennifer GrayPas encore d'évaluation
- Pierre Montebello - Deleuze Philosophie Et CinemaDocument130 pagesPierre Montebello - Deleuze Philosophie Et CinemaFelipe Larrea100% (1)
- Dastur, Fran+žoise - D+ęconstruction Et Ph+ęnom+ęnologieDocument245 pagesDastur, Fran+žoise - D+ęconstruction Et Ph+ęnom+ęnologiefelipekaiserf100% (2)
- Giova 2017 PDFDocument145 pagesGiova 2017 PDFJosé Carlos Cardoso100% (1)
- RegnaultDocument9 pagesRegnaultThomas Van RumstPas encore d'évaluation
- Levinas Séjour de Jeunesse Auprès de Husserl 1928-1929Document7 pagesLevinas Séjour de Jeunesse Auprès de Husserl 1928-1929Giallo MalaugurioPas encore d'évaluation
- 01 Antonia Soulez - Page 3 À 6 Présentation - Négation Verneinung PDFDocument5 pages01 Antonia Soulez - Page 3 À 6 Présentation - Négation Verneinung PDFStéphane VinoloPas encore d'évaluation
- L'essence Du Phénomène. La Pensée de Marc Richir Face À La Tradition PhénoménologiqueDocument162 pagesL'essence Du Phénomène. La Pensée de Marc Richir Face À La Tradition PhénoménologiqueGKF1789Pas encore d'évaluation
- Jan PatockaDocument5 pagesJan PatockakappamakikappaPas encore d'évaluation
- L'herméneutique de Paul Ricoeur - Une Autre PhénoménologieDocument36 pagesL'herméneutique de Paul Ricoeur - Une Autre PhénoménologieLandry SEKIPas encore d'évaluation
- (Vincent de Coorebyter) Sartre Avant La PhénoménologieDocument330 pages(Vincent de Coorebyter) Sartre Avant La PhénoménologieEs Muss Sein: Filosofía como debe serPas encore d'évaluation
- De La Révolution Phénoménologique Quelques Esquisses PDFDocument10 pagesDe La Révolution Phénoménologique Quelques Esquisses PDFpolix1Pas encore d'évaluation
- L'existentialisme de SartreDocument6 pagesL'existentialisme de SartreAnonymous 43dlFt86Pas encore d'évaluation
- Conscience de Soi Et Objet Chez Hegel Et HusserlDocument13 pagesConscience de Soi Et Objet Chez Hegel Et HusserlLandry SEKIPas encore d'évaluation
- Linstitution de Lidéalité Du Savoir Selon FichteDocument5 pagesLinstitution de Lidéalité Du Savoir Selon FichteAlavi AurélienPas encore d'évaluation
- Bibliografia Artigos Paul RicoeurDocument41 pagesBibliografia Artigos Paul RicoeurWillMoerbeckPas encore d'évaluation
- Logique Formelle Et Logique Transcendantale 2nbsped CompressDocument456 pagesLogique Formelle Et Logique Transcendantale 2nbsped CompressHAEGELI Lucas100% (2)
- Présentation Du Master Histoire de La Philosophie - 22-23Document61 pagesPrésentation Du Master Histoire de La Philosophie - 22-23Edgar Santos NunesPas encore d'évaluation
- La Transpassibilite Et L Evenement Essai Sur La Philosophie de Maldiney BibliographieDocument13 pagesLa Transpassibilite Et L Evenement Essai Sur La Philosophie de Maldiney Bibliographieandressuareza88Pas encore d'évaluation
- Trần Đức ThảoDocument390 pagesTrần Đức Thảovanoct07100% (1)
- Ciocan 2011 ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE. TROIS PARADIGMES DE L'IMAGE CHEZ JEAN-LUC MARIONDocument14 pagesCiocan 2011 ENTRE VISIBLE ET INVISIBLE. TROIS PARADIGMES DE L'IMAGE CHEZ JEAN-LUC MARIONPheno NewPas encore d'évaluation
- Les Chemins de L'intersubjectivitéDocument75 pagesLes Chemins de L'intersubjectivité42005544Pas encore d'évaluation
- Metaphysique Et SchizophrenieDocument24 pagesMetaphysique Et SchizophreniechristellechillyPas encore d'évaluation
- Philo Memento Master Philo 2014 2015 PDFDocument30 pagesPhilo Memento Master Philo 2014 2015 PDFChasa ZigoPas encore d'évaluation
- Ponty, Merleau - Phenomenologie de La PerceptionDocument278 pagesPonty, Merleau - Phenomenologie de La PerceptionAni Yamamoto AkibaPas encore d'évaluation
- Fiche HeideggerDocument2 pagesFiche HeideggerRicardo CasillasPas encore d'évaluation
- AutruiDocument7 pagesAutruiMbenid100% (1)
- La Discrétion - La Réserve - Est Le Lieu de La LittératureDocument562 pagesLa Discrétion - La Réserve - Est Le Lieu de La LittératurePeter BankiPas encore d'évaluation