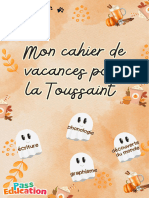Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
FUT52
FUT52
Transféré par
afweCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
FUT52
FUT52
Transféré par
afweDroits d'auteur :
Formats disponibles
Futurs
Olivier MECKES/EYE OF SCIENCE/COSMOS
Des avances mdicales qui changeront peut-tre un jour votre pratique
Cancer du clon
(au microscope lectronique).
La surface du colon (en brun) est
irrgulire, avec une apparence
bossele anormale due la
croissance cellulaire chaotique.
Les scrtions muqueuses apparaissent en bleu, les hmaties
en rouge, et les bactries de la
flore colique en vert. Les PPAR
sont invisibles cette chelle
Le rcepteur PPAR impliqu
dans le cancer du clon
Les PPAR (Peroxisome Proliferator Activated Receptor) font partie de
la super-famille des rcepteurs nuclaires. Le PPAR (quil ne faut pas
confondre avec son cousin PPAR,
stimulable par les fibrates, et galement en vedette cet t voir cicontre) joue un rle essentiel dans le
dveloppement du tissu adipeux, o
il est abondamment exprim. Pour tre
fonctionnel, il doit tre activ par un
ligand, tel que les acides gras polyinsaturs de lalimentation ou diverses
prostaglandines. Par ailleurs, certains
antidiabtiques oraux, les thiazolidinediones (commercialiss aux EtatsUnis), sont capables dactiver le
PPAR.
Le PPAR est galement prsent
en grande quantit dans le clon.
Les prostaglandines et les acides gras
poly-insaturs ayant un rle avr
dans le dveloppement du cancer du
clon, lquipe de Johan Auwerx (Institut Pasteur de Lille, U. Inserm 325,
dirige par le Pr J.-C. Fruchart) a tent
dtablir lexistence dun lien possible entre ce type de cancer et le
PPAR. Les chercheurs ont utilis un
modle animal, la souris Min, dont les
caractristiques sont proches de
celles des patients atteints de polypose adnomateuse familiale, car elle
dveloppe peu aprs la naissance des
tumeurs tout au long du tube digestif. De telles souris ont t traites
pendant deux mois avec un antidiabtique activateur de PPAR.
Au terme de ce traitement, on a
observ davantage de tumeurs
dans la rgion du clon o sont localiss les PPAR. Paralllement, les
chercheurs ont not une lvation
dans le clon de la quantit de -ca-
N 52 1998 A.I.M.
tnine, protine implique dans le
processus de cancrisation des polypes. Ces rsultats ont t reproduits
in vitro sur des cellules de ligne
dadnocarcinome de clon, montrant leffet direct des PPAR sur les
cellules cancreuses.
Le mcanisme de lintervention de
ce rcepteur dans la cancrogense
est loin dtre connu, mais cette tude
soulve le problme de lutilisation
long terme des thiazolidine-diones chez
des sujets prsentant un terrain gntique favorable au cancer du clon.
Plus important peut-tre terme,
soulignent les auteurs de ltude : ces
donnes sur le PPAR pourraient expliquer pourquoi une alimentation
riche en graisse parat jouer un rle
dans laugmentation des cancers du
clon observe dans les pays industrialiss.
Nature Medicine,
1998 ; 4 (9) : 1004-1005.
Fibrates :
un effet anti-inflammatoire
sur la plaque dathrome
Des tudes scandinaves ont rcemment mis en vidence
les effets bnfiques des fibrates sur la formation de la
plaque dathrome, mais sans pouvoir les rattacher un mcanisme daction prcis. Grce aux travaux dquipes de lInserm, on peut dsormais apporter une explication.
Il semble que les fibrates agissent au niveau de la paroi vasculaire, o ils jouent un rle anti-inflammatoire.
On savait dj que ces molcules exercent leurs effets
hypolipidmiants en se liant un rcepteur, le PPAR, prsent dans les cellules mtabolisant les acides gras. Ce rcepteur ainsi activ joue un rle clef dans lexpression des
principaux gnes impliqus dans le mtabolisme lipidique.
Les chercheurs de lInserm ont dcouvert que ces rcepteurs
existent galement au sein des cellules musculaires lisses
vasculaires, impliques dans la formation des plaques dathrome et dans les phnomnes de restnose post-angioplastie. Les fibrates, en activant le PPAR, inhibent in vitro la
production de cytokines inflammatoires, comme linterleukine 6 et les prostaglandines, par les cellules musculaires
de laorte. Ils inhibent galement linduction dun marqueur
de linflammation des cellules vasculaires, la cyclo-oxygnase Cox-2 (voir AIM 34).
Ces effets sont rgis par le mcanisme molculaire suivant : le PPAR activ par les fibrates empche laction
dun autre facteur de transcription, le NFB, qui joue un
rle majeur dans les processus inflammatoires (voir ci-contre).
Il en rsulte une diminution trs significative de la production des principaux mdiateurs de linflammation.
In vivo, ces effets se sont traduits par une baisse importante de lIL6, de la CRP (C-Reactive Protein), deux marqueurs de linflammation vasculaire, et du fibrinogne, marqueur de lathrosclrose. Ces marqueurs de linflammation
vasculaire seffondraient rapidement aprs quatre semaines
de traitement par fnofibrate, pour rapparatre larrt du
traitement. Les effets taient dautant plus marqus que le patient prsentait une athrosclrose coronaire svre.
Les activateurs des rcepteurs PPAR apparaissent donc
comme des thrapeutiques actives sur linflammation vasculaire, ce qui ouvre des perspectives intressantes dans le
traitement des maladies coronariennes, lies ou non une
dyslipidmie.
Travaux de B. Staels (U. Inserm 325, dirige par J.C. Fruchart, Universit de Lille 2 et Institut Pasteur de Lille), raliss
en collaboration avec les quipes de J. Maclouf (U. Inserm
348) et dA. Tedgui (U. Inserm 141), et publis dans Nature
1998, 393, 790-793.
Insuffisance cardiaque : le rle du NFB
La production de cyclo-oxygnase-2 (Cox2), enzyme responsable de la libration de prostaglandines, ncessite lactivation du facteur nuclaire B (NFB). Des chercheurs canadiens ont
rcemment ralis un travail visant tudier lexpression de Cox-2 et lactivation de NFB dans linsuffisance cardiaque. Les rsultats obtenus montrent une augmentation de lexpression de Cox-2
ainsi quune activation du NFB suggrant que
lexpression de Cox-2 et la production accrue de
prostaglandines jouent un rle dans la physiopathognie de linsuffisance cardiaque.
Il se confirme donc que linsuffisance cardiaque
saccompagne de la production de mdiateurs
inflammatoires, dont les prostaglandines, qui pourraient tre nocives pour les cellules musculaires
myocardiques.
Lutilisation dinhibiteurs spcifiques de Cox-2
dans des modles animaux dinsuffisance cardiaque
devrait permettre de dterminer le rle exact de
cette enzyme dans cette pathologie grave et denvisager des dbouchs cliniques, puisque nous disposons de mdicaments actifs sur la Cox-2.
Circulation 1998 ; 98 (2) : 100-3.
AVC : des lunettes de rducation
Grce lutilisation de lunettes
prismes de Fresnel, une quipe de lInserm de Bron (U. 94, dirige par C. Prablanc) a russi, en collaboration avec
des cliniciens des Hospices Civils de
Lyon, rduquer des patients souffrant dhmingligence spatiale. Ce
dsordre neurologique, souvent rencontr aprs un accident vasculaire crbral, se traduit par un dficit de la perception et de lattention dans la partie
gauche de lespace en cas de lsions
de la partie droite du cerveau. A ce jour,
on ne dispose pas de traitement efficace.
Dviation visuelle engendre par le prisme
port entre les deux tests
Sujet contrle
Doigt point droit devant
-8 -4
Aprs le
port des
lunettes
Avant le
port des
lunettes
Patient hmingligent
Doigt point droit devant
-8 -4
Le patient hmingligent, les yeux
bands, pointe le doigt droite si on lui
demande de le pointer devant lui. Les
chercheurs ont fait porter 16 patients
hmingligents des lunettes spciales
comportant un prisme dviant le
champ visuel vers la droite : le sujet
croit voir les objets plus droite quils
ne sont. Les patients ont d viser une
cible du doigt en portant ces lunettes.
Aprs 3 minutes dexercice, le cerveau
sadaptant la dviation visuelle, et les
sujets ont pu viser la cible. Une fois les
lunettes tes, les patients, les yeux bands, pointaient le doigt devant eux. Cette
amlioration de leur hmingligence
concernait aussi des tches cognitives
plus labores. Ladaptation du cerveau
au port des prismes avait rduqu les
rapports entre il et main.
Nature 1998 ; 395 : 166-169.
Aprs le
port des
lunettes
Avant le
port des
lunettes
Lsion
Si on demande des sujets de pointer, les yeux
bands, le doigt droit devant eux, les sujets hmingligents pointent le doigt vers la droite en
raison du dficit visuel gauche. Aprs le port
de lunettes prismes, lexprience est renouvele : la dviation initiale est corrige.
Maladie de Huntington :
premier essai
chez lhomme
dune greffe
de neurones ftaux
Lquipe du biologiste franais P. Hantraye (Hpital
F. Joliot, Orsay) a tudi sur un modle animal (le macaque) reproduisant les lsions de la chore de Huntington humaine, les effets dune greffe de cellules neuronales prleves sur trois ftus de macaques. Les
rsultats ont t remarquables puisque les chercheurs ont
observ, 2 5 mois aprs lintervention, une rcupration
des fonctions motrices ainsi que des fonctions cognitives, auparavant trs perturbes.
A la suite de ce succs, le Pr Peschanski et ses collaborateurs de lhpital Henri Mondor (Crteil) ont ralis un
essai sur lhomme. Ils ont greff 5 patients atteints de
chore de Huntington des neurones de ftus humains prlevs dans la zone du cerveau concerne par cette affection : le striatum.
Les rsultats devraient tre connus dans 18 mois.
Si ils se rvlent aussi favorables que ceux obtenus chez
le macaque, la greffe de neurones ftaux constituera une
nouvelle avance dans lapproche thrapeutique de certaines maladies neurologiques. Au premier rang, la maladie de Huntington, affection gntique rare, mais aussi la
maladie de Parkinson, trs frquente.
Nature Medicine 1998 ; 4 (8) : 963-966.
Une nouvelle maladie infectieuse : la lithiase rnale ! ?
Lanne dernire, un nouveau type de bactrie tait dcouvert la fois chez lhomme et le
bovin : la nanobactrie, plus petite des bactries connues, est dote dune paroi, limage
des espces Brucella et Bartonella. Comme elles,
cette bactrie est la fois extra et intra-cellulaire.
Mise en culture, elle peut produire une substance capable de prcipiter des cristaux
dapatite identiques ceux retrouvs au cur
de certains calculs rnaux. Or, elle a en effet la
possibilit datteindre les voies urinaires : des travaux exprimentaux chez lanimal ont montr que
Le Professeur
Barazu
des nanobactries introduites dans le sang taient
excrtes dans les urines.
Lquipe finlandaise qui a dcouvert la nanobactrie a examin 30 calculs rnaux. Lutilisation de deux anticorps monoclonaux diffrents a
dmontr que la bactrie tait prsente dans
la totalit de ces calculs. Lexamen au microscope lectronique a mis en vidence, dans tous
les calculs, une bactrie morphologiquement
identique la nanobactrie. Enfin, la bactrie sest
dveloppe au sein de cultures ralises partir de ces calculs.
Mme si on sait depuis longtemps que la lithiase rnale phospho-ammoniaco-magnsienne est associe des infections bactriennes, la dcouverte dun agent infectieux qui
serait lorigine de la plupart des lithiases rnales est surprenante. In vitro, la nanobactrie
est sensible aux aminoglycosides : un tel traitement pourrait-il prvenir les rcidives de lithiase rnale ?
Kajander E.O., Ciftcioglu N.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
1998 ; 95 : 8274-9.
par Got et Lewis
Avec laimable autorisation de Synthlabo
N 52 1998 A.I.M.
Vous aimerez peut-être aussi
- Magoe Cours Electrotech 2015Document53 pagesMagoe Cours Electrotech 2015mykherinossaoromouPas encore d'évaluation
- Rapport Final PER Volume1 - Octobre 2009Document166 pagesRapport Final PER Volume1 - Octobre 2009Arnaud RAOUMBAPas encore d'évaluation
- Les Idées Qu'exprime La Nourrice en Ce Qui Concerne Les FillesDocument2 pagesLes Idées Qu'exprime La Nourrice en Ce Qui Concerne Les FillesSouhaila Nagib100% (2)
- 1990 - Jeammaud A. - La Règle de Droit Comme Modèle PDFDocument18 pages1990 - Jeammaud A. - La Règle de Droit Comme Modèle PDFGuyMoquette100% (1)
- Cours 1 Anapath - Mode de CompatibilitéDocument46 pagesCours 1 Anapath - Mode de Compatibilitémanalyoubi00Pas encore d'évaluation
- Autocad Structure 2011 PDFDocument1 pageAutocad Structure 2011 PDFAlseni SoumahPas encore d'évaluation
- 1981 Rahan (Divers) - Bibliothèque de Travail (BT) : Naissance D'une Bande Dessinée: RahanDocument2 pages1981 Rahan (Divers) - Bibliothèque de Travail (BT) : Naissance D'une Bande Dessinée: RahanFrédéric GonetPas encore d'évaluation
- Dossier Professionnel Arnaud VinckeDocument25 pagesDossier Professionnel Arnaud Vinckeanthony.grassiproPas encore d'évaluation
- Ethique Et Deontologie ProfessionnelleDocument6 pagesEthique Et Deontologie ProfessionnelleEmmanuel BombulaPas encore d'évaluation
- Zootechnie - SP - Ciale - Docx Filename - UTF-8''zootechnie SpécialeDocument52 pagesZootechnie - SP - Ciale - Docx Filename - UTF-8''zootechnie SpécialeAhmed MessabihPas encore d'évaluation
- Biochimie-Révélateurs SynthèseDocument18 pagesBiochimie-Révélateurs SynthèseAntonios MpasinasPas encore d'évaluation
- Article de L'expérience À La Théorie Esthétique PDFDocument47 pagesArticle de L'expérience À La Théorie Esthétique PDFLassaad Jamoussi100% (1)
- 25 Objectifs Per Ted Gunderson PDFDocument12 pages25 Objectifs Per Ted Gunderson PDFFabrice BectPas encore d'évaluation
- TdcisailDocument1 pageTdcisailMohamedBejjaPas encore d'évaluation
- Sujets Entrainement SixiemeDocument12 pagesSujets Entrainement SixiemeAntonio DanielsPas encore d'évaluation
- ANIMAUX D'ELEVAGE Au Cameroun PDFDocument109 pagesANIMAUX D'ELEVAGE Au Cameroun PDFkroPas encore d'évaluation
- Oeuvres de Napoléon Bonaparte IV-VDocument35 pagesOeuvres de Napoléon Bonaparte IV-VRaúl Ignacio GaraycocheaPas encore d'évaluation
- Carte TassinDocument8 pagesCarte TassinAntoukanhotmail.frPas encore d'évaluation
- Moteur CCDocument10 pagesMoteur CCMohamed MouchrifPas encore d'évaluation
- Porte Metallique Techniques Catalogue PDFDocument210 pagesPorte Metallique Techniques Catalogue PDFClay Rios100% (1)
- DS PV3543 FR FR 76436Document6 pagesDS PV3543 FR FR 76436Sabi BORDJIHANEPas encore d'évaluation
- Toussaint Cahier de Vacances Gratuit GS MaternelleDocument13 pagesToussaint Cahier de Vacances Gratuit GS Maternelleroums65Pas encore d'évaluation
- Sapa Dépliant Candelabres en AluminiumDocument2 pagesSapa Dépliant Candelabres en AluminiumPole Products (formerly Sapa)Pas encore d'évaluation
- Monétique CamiDocument6 pagesMonétique CamiCam EliaPas encore d'évaluation
- Ab Al-Ksim Ibn Sadrah. Grammaire D'arabe Régulier, Morphologie, Syntaxe, Metrique. 1898.Document548 pagesAb Al-Ksim Ibn Sadrah. Grammaire D'arabe Régulier, Morphologie, Syntaxe, Metrique. 1898.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Sujet Principal - BTS - BAT - 2017Document2 pagesSujet Principal - BTS - BAT - 2017Hasnae Ben khaldounPas encore d'évaluation
- Introduction Aux AlgorigrammesDocument37 pagesIntroduction Aux AlgorigrammesIsabelle54Pas encore d'évaluation
- Séance 3-Jeu Let's BioDocument4 pagesSéance 3-Jeu Let's BioYosr charekPas encore d'évaluation
- Cours - Math Etude de Fonction - Bac Toutes Sections (2013-2014) MR Khammour KhalilDocument2 pagesCours - Math Etude de Fonction - Bac Toutes Sections (2013-2014) MR Khammour KhalilibxxxPas encore d'évaluation
- Cycle de Vie Dune VoitureDocument75 pagesCycle de Vie Dune VoitureIheb BelhsanPas encore d'évaluation