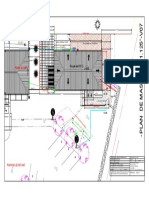Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ADEME Guide1 GrosOeuvre
ADEME Guide1 GrosOeuvre
Transféré par
Ayoub MoutaaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
ADEME Guide1 GrosOeuvre
ADEME Guide1 GrosOeuvre
Transféré par
Ayoub MoutaaDroits d'auteur :
Formats disponibles
HAUTE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
ET EFFICACIT NERGTIQUE
ADEME HN
Le Gros GUIDE
uvre N1
Bonnes pratiques Points de vigilance
Zooms techniques Retours dexpriences
S:
DE 7 GUIDE
COMPOSE
N
IO
T
C
E
L
L
SVERSAL
UNE CO
UIDE TRAN
TIER
6 GUIDES M
uvre
1 / Gros
n extrieure
io
at
2 / Isol
plaquiste
3 / Pltrier- hauffagiste
-c
er
bi
m
lo
4/P
en
5 / lectrici
er
6 / Menuisi
1G
n
et valorisatio
* / Gestion
r
tie
an
ch
de
s
des dchet
tion
de construc
Cette srie sadresse aux :
Entreprises et artisans du BTP
Responsables dentreprises,
chefs dquipe, conducteurs de travaux
Centres de formations
Lyces professionnels,
CFA-BTP, formations professionnelles,
journes techniques, encadrants
Ce guide a t ralis partir de lanalyse des tmoignages
et des retours dexprience de professionnels intervenant sur
des oprations de lappel projets rgional HQE du 276.
Impacts du Gros uvre
sur laspect environnemental
dune opration.
LAPPEL PROJETS HQE DU 276
Lanc en 2007 par le partenariat du 276 (Rgion HauteNormandie, Dpartements 27 et 76), lappel projets rgional
pour une Haute Qualit Environnementale dans les logements
sociaux neufs regroupe dix oprations laurates rparties en
Haute-Normandie. Celles-ci sinscrivent dans une dmarche
HQE, tout en affichant des performances nergtiques trs
pousses, puisque la majorit des oprations respectent les
exigences du label BBC.
Liste des oprations laurates
Bailleur
Opration
Foyer Stphanais
Felling
Habitat 76
Cit Grenet
Immobilire Basse Seine (Goupe 3f)
ZAC du Grand Hameau
Quevilly Habitat
Ilt 133 Quartier Matisse
Secomile
Place de la Rpublique
Secomile
Cur de village
Seine Habitat
Marcel Paul
Siloge
La Croix Eco-village
Siloge
co-village ZAC des Nos (Tranche 1)
Sodineuf
co-quartier du Val dArquet
GUIDE
N1
SOMMAIRE
CIBLE 2 / Matriaux et procds
p.
+ Zoom Technique
p.
04
06
CIBLE 3 / Chantier faibles nuisances
p.
08
CIBLE 4 / Gestion de lnergie
p.
+ Zoom Technique
p.
13
16
GESTION GLOBALE DES CHANTIERS
p.
18
LA CHECK LIST
des bonnes pratiques
Avant lintervention
o valuer limpact environnemental des matriaux et procds
de maonnerie.
LA DMARCHE HQE, QUEST-CE QUE CEST ?
La Haute Qualit Environnementale - HQE - est une dmarche
qui vise traiter le btiment dans sa globalit pour rduire son
impact environnemental tout en assurant un confort de vie des
usagers. Elle se dcline selon les 14 cibles suivantes :
Intgration dans lenvironnement
Matriaux et procds
Chantier faibles nuisances
Gestion de lnergie
Gestion de leau
Gestion des dchets
Entretien et maintenance
o Communiquer avec les autres corps dtat sur les points
sensibles (dimensions des rservations, procds de traitement
de ltanchit lair et des ponts thermiques, passage des
rseaux, coffres de volets roulants).
o Coordonner les interventions entre corps dtat.
Pendant lintervention
Confort hygrothermique
Confort acoustique
Confort visuel
Confort olfactif
Conditions sanitaires
Qualit de lair
Qualit de leau
Plus dinformations auprs de lassociation HQE :
www.assohqe.org
o Privilgier les procds gnrant le moins de nuisances,
notamment pour la ralisation des fondations.
o Rduire et trier les dchets de chantier, notamment les dchets
spcifiques et dangereux.
o Rduire les pollutions et les nuisances sonores sur le chantier.
o Traiter avec soin les points particuliers de lintervention afin
de limiter les ponts thermiques et les dfauts dtanchit :
plancher intermdiaire, balcons, passage des rseaux
o Respecter scrupuleusement les rgles de lart, particulirement
pour les maonneries en terre cuite et/ou Monomur. Dans ce
cas spcifique, proposer lajout dun enduit intrieur.
Dans le choix du systme constructif, le Gros uvre peut
orienter les dcideurs vers des matriaux qui garantissent
la qualit environnementale du projet, possdent les
performances requises et un impact rduit sur lenvironnement.
Sur une opration hautes performances environnementales, de
nouveaux critres complmentaires doivent tre pris en compte
dans ce choix des matriaux :
(conductivit thermique)
Performances
thermiques
R (rsistance thermique)
Inertie (capacit thermique)
Confort dt (diffusivit thermique)
Traitement des ponts thermiques
Matriel de pose
Procdures
de pose
Pnibilit de mise en uvre
paisseur ncessaire
Dchets de chantier gnrs
Impact
environnemental
Ressource renouvelable
Recyclage et valorisation
missions de COV
Impact
sanitaire
Risques de moisissures
et de dgradations
Performances
acoustiques
Stabilit
nergie grise & ACV
Affaiblissement acoustique
Durabilit / Dure de vie
Facilit dentretien
Ces critres environnementaux doivent
complter (et non occulter) les critres de
choix classiques : performances techniques,
qualit architecturale et cots.
La mise en uvre des fondations ncessite une vigilance
particulire ds lamont du projet. Elle est souvent source de
difficults, malgr la ralisation systmatique dtudes pralables.
Sur plusieurs oprations de lappel projets, des changements
de procdures ont d tre mis en place pour faire face aux
difficults, gnrant des retards et des surcots parfois
importants.
RETOUR DEXPRIENCE
Louviers, 39 logements
SOLUTION INITIALEMENT PRVUE
Voile dinfrastructure en prfabriqu.
PROBLMES RENCONTRS
Terrain non naturel et trop remani : stabilit et cohsion
insuffisantes.
Proximit des proprits voisines et des voiries interdisant
de prendre des mesures comprenant le moindre risque
daffaissement.
CIBLE 2
Critres de choix des matriaux
Fondations
Matriaux et procds
CIBLE 2
Matriaux et procds
CIBLE 2 - MATRIAUX ET PROCDS
SOLUTIONS ENVISAGES
Les solutions suivantes ont t envisages puis rejetes
par lentreprise cause de limportance des nuisances
environnementales et des surcots gnrs.
Fondation sur pieux bton
> Inconvnients : ncessite lintervention dengins lourds
et bruyants (50 t, 120-130 dB de moyenne) et lutilisation de
boue bentonique devant tre retraite avant rutilisation.
Comporte des risques importants dinfiltrations de rsidus
de bton dans le sol environnant.
Compactage du terrain
> Inconvnients : ncessite lapport de plus de 3000 m3 de
tout-venant et lintervention dun compacteur trs bruyant
(120 dB).
Fondation par bton projet
> Inconvnients : solution trs bruyante ncessitant une
intervention en continu, le bton sec prpar le matin
devant tre utilis dans la journe.
SOLUTION RETENUE
Prsentant le compromis surcot et impact environnemental
le moins ngatif, la solution finalement retenue fut la
fondation par bton projet. Ralise par tranche de 1 m de
profondeur, cette procdure a permis de contourner le
problme de cohsion du terrain.
> Inconvnients : Solution elle aussi trs bruyante. De plus,
le bton sec prpar le matin devait tre utilis dans la
journe, ce qui a entran plusieurs dpassements dhoraires
et un mcontentement gnral des riverains.
Ds que lon sloigne des procds initialement prvus,
il devient trs difficile de trouver des solutions
environnementalement et financirement acceptables.
04
05
Les systmes constructifs en bton et en terre cuite ont
t majoritairement utiliss sur cet appel projets. La
comparaison environnementale des procds constructifs
devient aujourd'hui une source majeure d'interrogations.
Ci-aprs sont rfrencs les profils environnementaux
(FDES - base INIES) de quelques procds de construction.
Les valeurs indiques correspondent 1 m pos du
matriau, sur toute sa dure de vie estime (100 ans).
Brique de terre cuite
25 cm
36,5 cm
2.56 m.K/W
3.63 m.K/W
Rw(C;Ctr)
48 (-1:-4) dB
50 (-2:-6) dB
nergie grise*
456 MJ
667 MJ
Eau consomme
267.2 l
389.3 l
Impact climatique 40.4 kgeqCO2
59.2 kgeqCO2
Pollution de lair
2230 m3
3300 m3
Pollution de leau
56.4 m
83.0 m3
Remarque
Importantes consommations deau.
Bloc bton / Bton autoplaant (BAP)
20 cm
20 cm haute performance
20 cm + PSE Th38
BAP + PSE Ultra ThA
0.6-1.0 m.K/W
1.3 m.K/W
2.37 m.K/W
2.63 m.K/W
Rw(C;Ctr)
39 (-1:-3) dB
40 (0:-2) dB
Rw(C;Ctr)
52 (-2:-8) dB
65 (-3:-5) dB
nergie grise*
270-340 MJ
340 MJ
nergie grise*
445.5 MJ
910 MJ
Eau consomme
325-40 l
44 l
Eau consomme
144.34 l
358 l
Impact climatique 18-26 kgeqCO2
23 kgeqCO2
Impact climatique 30.46 kgeqCO2
77.2 kgeqCO2
Pollution de lair
1200-2800 m3
1700 m3
Pollution de lair
3650 m3
6377 m3
Pollution de leau
4-5 m3
12 m3
Pollution de leau
22.5 m3
28.6 m3
Remarque
Aucune donne disponible sur la base INIES
quant un complexe brique + isolant.
Remarque
Excellentes performances acoustiques.
Le bton banch permet datteindre facilement
une trs bonne tanchit lair.
Importantes consommations deau.
Vu sur lAppel
Projets
Brique 20 cm + IT-E 17 cm en EPS graphit.
Brique de terre cuite isolation rpartie (Monomur)
30 cm
37,5 cm
2.5-2.6 m.K/W
3.0-3.3 m.K/W
Rw(C;Ctr)
41 (0:-2) dB
43 (0:-2) dB
nergie grise*
450-700 MJ
600-700 MJ
Eau consomme
70 l
60-100 l
Impact climatique 30-40 kgeqCO2
34-44 kgeqCO2
Pollution de lair
2600-2900 m3
2600-5800 m3
Pollution de leau
11-12 m
10-11 m3
Remarque
Cot nergtique la fabrication important,
compens par une bonne inertie (sauf en cas
de complment disolation par lintrieur)
carts importants dans les FDES de plusieurs
produits similaires, notamment en terme de
pollution de lair.
Monomur 30 cm
+ IT-I en EPS 12 cm
Vu sur lAppel
Projets
Monomur 30 cm
+ IT-I en EPS 8 cm
Faible inertie
Monomur 37.5 cm seul
Inertie forte
Ossature bois
Aucune FDES disponible sur la base INIES.
Remarque
06
Bton cellulaire
Matriau renouvelable.
Vu sur lAppel
Projets
CIBLE 2
Comparatif environnemental
des matriaux de maonnerie
Matriaux et procds - Zoom Technique
CIBLE 2
Matriaux et procds - Zoom Technique
ZOOM TECHNIQUE 1
BAP + IT-E en laine de roche (R=3.75 m.K/W)
BAP + IT-E en polyurthane 12 cm
BAP + IT-E en EPS graphit
inertie importante pour les 3 systmes.
La comparaison environnementale entre diffrents
procds de construction doit tre ralise pour
des performances thermiques (R) quivalentes.
LIMITES ET CONCLUSIONS
Actuellement, peu de Fiches de Dclarations
Environnementales et Sanitaires (FDES) sont disponibles
et ne permettent des conclusions dfinitives.
Ainsi, aucun systme constructif ne se dmarque
clairement sur lensemble des critres
environnementaux. Nanmoins, il reste prioritaire de
comparer les matriaux sur ce type dopration.
Glossaire :
IT-I : Isolation par lintrieur.
IT-E : Isolation par lextrieur.
EPS : Polystyrne expans.
Rw : Affaiblissement acoustique.
* nergie grise : nergie primaire non renouvelable consomme.
07
Estimer les types et quantits de dchets
qui seront produits.
Sensibiliser les acteurs et les compagnons.
En cours
de chantier
Le brlage et lenfouissement sur site sont
totalement prohibs.
Utiliser et respecter le tri collectif des
dchets de chantier.
Rcuprer les dchets spcifiques ne
pouvant tre valoriss par le tri commun.
Chantier faibles nuisances
Les oprations sinscrivant dans une dmarche hautes
performances environnementales doivent respecter des
exigences de chantier faibles nuisances. Elles se traduisent
par une gestion efficace des dchets et une limitation des
pollutions (olfactives, sonores, visuelles, environnementales)
sur site.
En amont
de chantier
CIBLE 3
CONSEILS POUR BIEN TRIER
LES DCHETS DE CHANTIER
ADEME HN
Premier intervenant sur le chantier, le Gros uvre
doit tre irrprochable dans sa gestion des dchets
de chantier et de la propret.
Il montre ainsi lexemple et sensibilise
les futurs intervenants.
Gestion du tri des dchets*
Jacques LE GOFF / ADEME
CIBLE 3
Chantier faibles nuisances
CIBLE 3 - CHANTIER FAIBLES NUISANCES
Principaux dchets produits par le corps dtat
Dchets inertes
Gravats
divers
Dchet principal du corps dtat, devant faire
lobjet dun tri spcifique.
Veiller bien sparer les autres dchets, et
notamment le pltre, des dchets inertes.
Des gravats inertes (briques, bton)
mlangs plus de 2% de pltre ne peuvent
plus tre valoriss.
Rduction des pollutions et des nuisances de chantier
Le renforcement des exigences de chantier propre impose
aussi aux professionnels de limiter les pollutions et les
nuisances gnres lors de lopration.
Dchets non dangereux
Emballages
divers
Le tri des emballages est rglement et
obligatoire pour une production suprieure
1100L/semaine.
Polystyrne
Le recyclage du polystyrne est bien
matris.
Mtaux
(Fixations, armatures, grillages, ferraille).
La valorisation des dchets mtalliques est
tout fait oprationnelle de nos jours.
Diffrencier les mtaux ferreux des autres
types de mtaux.
Dchets dangereux
08
Mme si le Gros uvre ne produit gnralement que peu de
dchets dangereux, ceux-ci se doivent dtre tris dans une
benne spare et tanche, en vue dun envoi group dans des
centres de traitement adapts.
CONSEILS ET POINTS DE VIGILANCE
Utiliser, voire investir, dans le matriel adapt chaque
matriau.
Porter attention aux dversements intempestifs de
laitance bton.
Ne pas installer les btonnires sur sol naturel. Assurer
la protection du sol contre les infiltrations de bton.
Respecter les plages horaires dfinies en amont de
chantier pour la ralisation des tches les plus bruyantes.
Le surfaage des planchers doit tre ralis rapidement
aprs le coulage de la dalle, notamment en hiver. Il
convient dorganiser les coulages en tout dbut de
journe afin dviter une ralisation du surfaage,
opration trs bruyante, en soire.
* Pour en savoir plus, voir le guide :
Gestion et valorisation des dchets de chantier de construction .
09
Les fuites deau sur chantier sont trs courantes et impactent
fortement sur la consommation deau totale de lopration.
En coordination avec le plombier, le Gros uvre doit sassurer
de la mise en uvre correcte de lapprovisionnement en eau
du chantier. Le contrle et lentretien de ces rseaux
temporaires sont dune importance capitale pour rduire les
consommations de chantier.
Le raccordement au rseau lectrique est indispensable
pour des chantiers de grande taille. Sur ce type doprations,
l'utilisation de groupes lectrognes est rserver uniquement
aux procdures de secours
RETOUR DEXPRIENCE
Dlai de raccordement au rseau
Tous les chantiers des oprations de lappel projets
ayant dbut ou termin la phase ralisation ont opt
pour un raccordement du chantier au rseau lectrique.
Cette procdure, pouvant prendre jusqu 3 mois, doit tre
traite trs tt en amont afin de ne pas retarder le dmarrage du
chantier.
RETOUR DEXPRIENCE
Comparaison des consommations
deau sur 3 chantiers
Les consommations journalires deau des chantiers de
Sotteville-Ls-Rouen, Louviers et Grand-Quevilly ont t
compares afin dvaluer limpact des diffrents choix
constructifs sur la consommation totale et sur son volution en
fonction de lavance du chantier.
Lune des oprations prsente logiquement une consommation
moyenne bien suprieure aux autres en dbut de chantier du fait
du systme constructif adopt : ralisation de la paroi de
soutnement en bton projet et maonneries en briques
Monomur. Le contrle doit tre redoubl sur ces oprations trs
gourmandes en eau afin dviter tout gaspillage.
Les deux autres oprations, en bton banch, prsentent une
consommation trs stable de 0.88 m3/jour et 1.03 m3/jour en
moyenne. Labsence de variations importantes traduit limportance
apporte la gestion de leau sur le chantier, la limitation des
fuites et la bonne tenue du rseau dapprovisionnement sur toute
la dure de lopration.
Sil est responsable de linstallation lectrique de chantier, le
Gros uvre devrait impliquer llectricien afin dassurer une
installation de qualit et scurise. Celle-ci ne doit prsenter
aucun danger pour lensemble des corps dtat et des
personnes amenes travailler sur le site tout au long du
chantier.
CIBLE 3
Gestion de llectricit sur le chantier
Chantier faibles nuisances
CIBLE 3
Chantier faibles nuisances
Gestion de leau sur le chantier
RETOUR DEXPRIENCE
Dgradation des cbles
Sur une opration, la vigilance quotidienne de llectricien a
permis de dceler une dgradation des gaines de protection
des cbles extrieurs dalimentation lectrique. Ces cbles
prsentaient des risques majeurs dlectrocution pour toute
personne intervenant sur le site.
5,0
CONSEILS ET SOLUTIONS
Consommation journalire deau sur le chantier
(m3/jour)
4,0
Sensibiliser ses propres compagnons et les autres
corps dtat sur les bons gestes tenir sur le chantier
et sur la base de vie.
3,0
2,0
Sensibiliser les conducteurs de travaux et les dcideurs
limportance des conomies dlectricit sur un
chantier et sur les mesures prendre.
1,0
Munir lclairage des zones de vie de dtecteurs de
prsence et/ou de minuteurs.
0,0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Avancement du chantier
Une attention toute particulire doit tre porte durant la mise en
eau des logements en fin de chantier.
10
Veiller bien couper llectricit de chantier
quotidiennement.
Ne pas programmer en plein hiver des interventions
ncessitant des tempratures ambiantes tempres.
( voir avec le conducteur de travaux.)
11
Sur le graphique ci-dessous, on remarque bien ce pic trs important,
compar aux deux autres oprations.
tanchit lair & ponts thermiques
La gestion nergtique du btiment passe par une ralisation
sans dfaut et une implication de tous les corps dtat, chacun
devant notamment assurer la bonne tanchit lair et la
rduction des ponts thermiques dans son intervention.
Quelles que soient les solutions adoptes en phase
conception, garantir une enveloppe tanche et peu dperditive
constitue un dfi majeur pour le Gros uvre.
RETOUR DEXPRIENCE
tanchit des rseaux
1,5
Sur lopration de Saint-tienne-du-Rouvray (31 logements),
le test dtanchit lair en phase travaux a permis de mettre
en vidence limportance des fuites au niveau des
pntrations extrieures. Un calfeutrement systmatique
la mousse polyurthane a alors t ralis.
CIBLE 4
Sur une des trois oprations compares prcdemment,
la pose du linolum sest droule en plein hiver et a
ncessit lutilisation de ventilo-convecteurs trs gourmands
en lectricit. Sous rserve de laccord du conducteur des
travaux et du respect des dlais de livraison, un simple dcalage de
1 2 mois de cette opration aurait pu rduire considrablement les
consommations lectriques sans impliquer un retard trop important.
CIBLE 4 - GESTION DE LNERGIE
Gestion de lnergie
Planification des interventions
Consommation lectrique (MWh/jour)
CIBLE 3
Chantier faibles nuisances
RETOUR DEXPRIENCE
> Inconvnients : Mme si les mousses expanses garantissent
gnralement une efficacit et une prennit certaines, elles
risquent de gner la bonne accessibilit aux rseaux et de
complexifier les futures oprations de maintenance.
0,5
Passage des rseaux
m
ar
s
av
ril
m
ai
ju
in
ju
ill
et
ao
t
se
pt
.
oc
t.
no
v.
d
ja c.
nv
.+
f 1
v
m . +1
ar
s
av +1
ril
+
m 1
ai
+
ju 1
in
j u +1
ill
et
ao +1
t
+1
Promouvoir auprs de la Matrise duvre le passage des
gaines et des rseaux en locaux chauffs plutt quen extrieur.
> Intrts : limiter les dperditions thermiques et rduire
le nombre de pntrations extrieures.
Dissocier les rseaux pour mieux les tancher et utiliser les
produits dtanchit adapts (membranes EPDM).
Il est trs difficile de comparer les
consommations en eau et en lectricit
de diffrents chantiers.
De nombreux paramtres entrent en compte :
conditions mtorologiques, taille de lopration,
effectifs, systme de structure, enduits
Ne pas recommander le passage des rseaux en doublage.
> Inconvnients : Nombreux ponts thermiques et fuites
dair, rduction des performances des complexes de
doublage, dcoupes importantes.
Envisager la conception de faux plafonds.
> Avantages : Passage horizontal des rseaux sans pont
thermique et dfaut dtanchit lair. Performance
coupe-feu. Confort acoustique suprieur.
> Inconvnients : Surcot financier et hauteur des btiments
plus importante. Surpoids.
Privilgier lencastrement des rseaux dans les dalles et
la maonnerie.
> Avantages : Rduction des dfauts dtanchit lair.
Intgrit des complexes disolation-doublage.
> Inconvnients : Rduction des performances acoustiques des
chapes.
Privilgier le passage des rseaux
dans les maonneries intrieures.
12
13
La ralisation de balcons dsolidariss prsente le meilleur
compromis pour assurer la continuit de lisolation et la
rduction des ponts thermiques tout en respectant les
contraintes daccessibilit et la rglementation incendie.
Gestion de lnergie
Plancher intermdiaire
Quel que soit le systme constructif, le plancher intermdiaire
prsente souvent un pont thermique linaire trs important.
En cas disolation intrieure ou rpartie, utiliser les planelles /
abouts adapts, complts au besoin par une paisseur
disolant. Des complexes de rupteurs de pont thermique
existent aussi et peuvent tre adopts.
Une isolation extrieure permet de saffranchir efficacement
de ce pont thermique.
Auvents
Bien que rare sur des oprations de ce type, la prsence
dauvents prouve que la performance nergtique ne rime
pas avec architecture simpliste.
RETOUR DEXPRIENCE
Auvents rducteurs de ponts
thermiques
Sur lopration de Saint-tienne-du-Rouvray (31 logements), des
auvents bois ont t fixs sur une armature de supports en bois
de forte paisseur (17 cm). Cette dernire, fixe directement sur
la maonnerie, est encadre par lisolation extrieure.
La maonnerie nest ainsi pas traverse, ne crant pas de ponts
thermiques ni de fuites dair potentielles. De plus, la mise en
uvre de lauvent et de lisolant est facilite.
NB. : La performance thermique du bois est juge suffisante pour
limiter le pont thermique au niveau de lappui.
CIBLE 4
Vrifier lutilisation de fixations adaptes et non traversantes
pour les complexes disolation.
Gestion de lnergie
Balcons
RETOUR DEXPRIENCE
Balcons dsolidariss
Sur cette opration de Grand-Quevilly (43
logements), des balcons dsolidariss
ont t fixs mcaniquement par
querres mtalliques en respectant un
joint de 13 cm pour assurer le passage de
lisolant extrieur entre le balcon et la
faade.
Un appui-seuil spcifique a ensuite t
pos en appui glissant pour respecter les
contraintes daccessibilit et assurer le
ruissellement de leau.
ADEME HN
CIBLE 4
Isolation
> Inconvnients : Prsence dun pont
thermique important sur tout le
linaire de fixation, traiter sur de
futures oprations.
Difficults importantes de mise en uvre des fixations mtalliques
dues des tolrances de lordre du millimtre.
Les balcons rupteur thermique ne sont pas ncessairement
privilgier. Mme sils constituent une solution efficace, ils
sont encore difficiles mettre en uvre et prsentent des
contraintes structurelles importantes.
RETOUR DEXPRIENCE
Balcons rupteurs thermiques
ADEME HN
Sur lopration de Sotteville-Ls-Rouen (40 logements),
le fournisseur ne proposait pas de solution pour la mise
en uvre de balcons couls rupteur. Le Gros uvre a
alors choisi de couler ses balcons la verticale, avec une
disposition du rupteur en partie haute. Toutes les faces ont alors
pu tre coffres et offrent un rendu tout fait satisfaisant.
Coffres de volets roulants
Les fournisseurs proposent des solutions adaptes chaque
type de maonnerie (coffrages mtalliques spcifiques,
linteaux-coffres adapts) pour encastrer les volets roulants.
La solution des coffres rapports en intrieur peut aussi
tre envisage sur des oprations comportant une isolation
extrieure, mais pose alors des soucis desthtique.
14
Sur lappel projets,
les meilleurs rsultats dtanchit lair
ont pour linstant t obtenus
pour les projets en bton banch
et isolation extrieure.
15
Linvestissement dans du matriel de dcoupe adapt (scie alligator,
scie eau sur table) est trs rapidement rentabilis.
La brique Monomur est de plus en plus courante sur les
chantiers BBC, notamment pour les btiments individuels.
Cependant, sa mise en uvre sur des btiments collectifs
plus imposants, tels que ceux rencontrs sur lappel
projets, constitue un certain dfi. Plusieurs oprations de
lappel projets ont dailleurs expriment ce procd de
construction. Les intervenants ont d faire face plusieurs
difficults pour atteindre, finalement, des rsultats
dtanchit lair satisfaisants.
Chaque brique possde des zones entre alvoles o la dcoupe est facilite.
Attention : proscrire toute mthode de dcoupe par chocs.
Comparatif des procds de joints horizontaux
Joints classiques (mortier 10 mm)
Peu utilis pour ce type de briques.
Joints minces rouls (1 mm)
Rduire : Rduction de 97 % des quantits de mortier utilises.
Rgles de lart & points de vigilance
Daprs les expriences de lappel projets et la rencontre avec un
fournisseur.
Ralisation de larase
Rduire : Mise en uvre 33 % plus rapide que la mthode classique.
Propret de chantier : Moins de dchets de mortier et demballages.
Consommations deau rduites.
Esthtique : absence de joints visibles.
Le mortier darase doit tre nivel grce un metteur laser et liss
avec soin.
Joints par mousse-colle (<1 mm)
La pose du premier rang de briques doit tre ralise lorsque la
couche darase est encore frache et dbuter par la pose des angles.
Le joint est ralis par injection par pistolet dun liant mono composant
synthtique.
Attention : une arase mal ralise est la principale cause des
mauvais alignements de briques, mme en partie haute.
Rduire : Mise en uvre 50 % plus rapide que la mthode classique.
Propret de chantier : Peu de dchets, mis part les cartouches
usages devant tre tries avec soin. Aucune consommation deau.
Alignement vertical
La tolrance fournisseur pour les faces horizontales est < 0.5mm.
Lhorizontalit de chaque niveau peut ainsi tre parfaitement assure.
Cependant, les tolrances fournisseur des autres faces ne sont
pas si prcises, impliquant souvent des carts de dimension pour les
faces latrales. Ce sont ces carts qui peuvent entraner, notamment
en parties hautes, des dcalages importants.
CIBLE 4
Limiter les dchets de dcoupe
Mise en uvre
des briques Monomur
Gestion de lnergie - Zoom Technique
CIBLE 4
Gestion de lnergie - Zoom Technique
ZOOM TECHNIQUE 2
Gel : Utilisable mme pour des tempratures ngatives (-5C)
Prcision : Le joint final mesure moins de 1 mm, ce qui rduit
considrablement le droit lerreur lors de la ralisation des murs.
Attention : Il est absolument dconseill dutiliser diffrents
procds de ralisation des joints horizontaux sur un
mme chantier.
La pose au fil plomb sur la faade extrieure est obligatoire.
Intervention du fournisseur
ADEME HN
Enduit extrieur
Les fournisseurs proposent des
briques adaptes aux diffrents
points particuliers des faades :
briques-linteaux, arases, planelles
et
abouts
pour
planchers
intermdiaires, briques multiangles, tableaux-feuillure
Lajout dun enduit intrieur sous doublage est trs fortement
conseill sur ce type de maonnerie, au vu des expriences vcues
sur certaines oprations de lappel projets. Les rsultats lors des
tests dtanchit lair en ont t considrablement amliors.
Le fournisseur propose souvent un
accompagnement la pose,
notamment pour la ralisation de
larase et du premier rang.
Joints verticaux
> Se renseigner auprs de son
fournisseur sur les prestations
proposes.
La ralisation dun enduit pais extrieur
doit tre systmatique pour colmater les
fuites dair et compenser les carts de
dimensionnement des briques.
Enduit intrieur
Habituellement rserve aux constructions en zones sismiques, la
ralisation des joints verticaux peut tre envisage sur des oprations
classiques en guise de roue de secours pour sassurer dune
bonne tanchit lair.
Surcot estim : 5 /m + temps de mise en uvre allong.
16
17
La communication entre corps dtat se
doit dtre renforce et exemplaire sur
des oprations hautes performances
environnementales et nergtiques. Elle
constitue en effet le premier facteur de
russite pour de tels projets. Elle permet
de limiter les difficults en phase
ralisation et les erreurs dceles lors de
tests finaux.
Linvestissement dans du matriel dautocontrle est
aujourdhui intressant et peut tre envisag par tout corps
dtat intervenant sur des oprations hautes exigences
dtanchit lair et de performances thermiques.
Avantages du matriel dautocontrle
Amliore la qualit du travail et rend possible lautocontrle en
cours de ralisation.
Facilite la sensibilisation des employs et la formation des nouveaux
compagnons.
Apporte une exemplarit environnementale trs recherche par les clients.
LE GROS UVRE ET ...
Le Matre
douvrage,
le Matre
duvre
Promouvoir lutilisation de matriaux et
procds environnementalement performants.
Proposer des solutions de traitement des
ponts thermiques.
Le Poseur
disolation
Dtailler et proposer des procds de fixation
adapts la structure porteuse.
Llectricien
Le Pltrier
Cloison
Doublage
Porte et fentre soufflantes & Gnrateur de fume
Harmoniser les tolrances en amont de
chantier.
Vrifier la compatibilit des fixations de doublage
avec la maonnerie mise en uvre.
Contrler la fin de lintervention le bon
querrage et la planit des faades et murs de
refend, pour reprise ventuelle.
Ltancheur
Dtailler ensemble le traitement des points
spcifiques, tels que les acrotres, les
casquettes en attique
Dfinir les rservations et percements
ncessaires pour lintervention du corps dtat
et anticiper les carts de tolrances entre corps
dtat.
Vrifier la compatibilit du mode de pose avec
les dalles ralises.
tre un modle en terme de tri des dchets de
chantier.
Respecter la propret de chantier pour garantir
la scurit et un cadre de travail confortable
pour les autres corps dtat.
Tester ltanchit lair dun btiment dans sa
globalit.
Raliser des tests dtanchit en cours de
travaux pour dceler les fuites au niveau des
maonneries et prendre les mesures correctives adquates (enduit,
calfeutrements).
CAPEB
Dfinir les rservations ncessaires pour la pose
des coffrets et pour les pntrations des rseaux.
Anticiper les carts de tolrances entre corps
dtat.
Contrler la fin de lintervention le bon
querrage et les dimensions des rservations
pour reprise ventuelle.
Dfinir les dimensions des tableaux de
menuiseries et anticiper les carts de tolrances
entre corps dtat.
LEnsemble
des Corps
dtat
Facilite le travail sur lexistant (localisation des rseaux, contrle
non destructif et non intrusif).
Utilisations pour le Gros uvre
Le Menuisier
Le Carreleur
Permet louverture du domaine dactivit au conseil client.
Prix moyen (TTC)
De 1500 5000 (individuel) / de 5000 6000 (grands volumes).
< 100 (poire fume) / de 500 1000 (gnrateur de fume).
Camra thermique
Utilisations pour le Gros uvre
Reprer les problmes dhumidit et les infiltrations
deau.
Contrler le bon traitement des ponts thermiques :
plancher intermdiaire, pntrations extrieures,
botiers lectriques.
SOCOTEC
Le Plombier
Chauffagiste
18
GESTION GLOBALE DES CHANTIERS
MATRIEL DAUTOCONTRLE
Jacques LE GOFF / ADEME
GESTION GLOBALE DES CHANTIERS
INTERACTIONS ENTRE CORPS DTAT
Contrler la bonne pose des briques de maonnerie.
Prix moyen (TTC)
De 900 (entre de gamme) 5000 .
Prcautions
Un cart de 10 C entre les tempratures extrieures et intrieures est un
minimum pour garantir la prcision des mesures. Pour des tests en locaux
non chauffs, privilgier la ralisation des mesures en dbut de journe afin
dassurer un gradient de temprature suffisant.
CONSEILS
Suivre une formation pour une meilleure exploitation des rsultats.
(Dure moyenne : 1 2 journes
Cot moyen : de 700 1000 HT / jour / personne).
Sorienter vers la location du matriel ou vers son organisme
professionnel lorsque linvestissement est jug trop important.
19
Le dispositif FEEBat (Formation aux conomies
dnergie dans le Btiment) permet aux professionnels
du btiment de se former une rnovation conome en
nergie des btiments. Grce ces formations, les
professionnels du btiment acquirent des comptences
et une approche globale. Ils sont ainsi immdiatement
oprationnels sur des chantiers de rnovation
nergtique.
La rnovation nergtique des btiments,
a ne se fait pas comme par magie, a sapprend !
Plus dinformations sur www.feebat.org
VALORISER SON ENGAGEMENT
ANNUAIRE DES PROFESSIONNELS DU BTIMENT DURABLE ET BBC
Faites-vous connatre !
Inscrivez-vous pour :
Afficher votre engagement.
Valoriser vos formations, qualifications et expriences.
Constituer des quipes pluridisciplinaires avec des
professionnels qui partagent vos engagements.
Lannuaire de tous les corps de mtiers
Conception de projets : architectes, bureaux dtudes.
Ralisation de travaux : entreprises du btiment,
constructeurs de maisons individuelles, ...
Lannuaire des professionnels du btiment durable
et des btiments basse consommation (BBC)
www.batimentdurable-hn.fr
Remerciements :
ORGANISMES & ASSOCIATIONS
ARE-BTP, CAPEB Haute-Normandie, FFB Haute-Normandie
7551
ENTREPRISES & PROFESSIONNELS
Aux Btisseurs Rgionaux - Blin - Cabinet B. Bonhaume - Cabinet
Echos - CBA Architecture - Dekra Conseil HSE - Dsormeaux E.R.C. - L.T.B. - Millery - Monteiro Ravalement - Osselienne de
peinture - Porraz - Prestapose - Prevention Consultants - Procopio
Isolation - Quille - Savec - Space Environnement - Wilmotte et
Associs.
ADEME - DR HN I dition 04/2012 I Conception : B.D.S.A. Le Havre I Autres crdits photographiques : istockphoto.com : Electric_Crayon - Fotolia.com : lamax / Friax74 / Roman Milert / 2jenn / Chlorophylle I
Imprim sur du papier 100% PEFC/10-31-1387 QUAL/08-330 I encres vgtales I Imprimeur Imprimvert.
SE FORMER
ADEME DIRECTION RGIONALE HAUTE-NORMANDIE
30 Rue Henri Gadeau de Kerville | 76100 Rouen
Courriel : ademe.haute-normandie@ademe.fr
tl. standard : 02 35 62 24 42 | fax : 02 32 81 93 13
www.ademe.fr
Vous aimerez peut-être aussi
- Programmer Pour Les Nuls, 3e Édition (French Edition) by Nuls, Pour Les (Nuls, Pour Les)Document561 pagesProgrammer Pour Les Nuls, 3e Édition (French Edition) by Nuls, Pour Les (Nuls, Pour Les)Amadou Oury DieyePas encore d'évaluation
- Interface B1 B2 Le Francais Des AffairesDocument183 pagesInterface B1 B2 Le Francais Des Affairesargoutis100% (1)
- Abel Et Bellina Ont Vu de Vilaines Choses - Eric Querelle Aka OdysseusDocument12 pagesAbel Et Bellina Ont Vu de Vilaines Choses - Eric Querelle Aka OdysseusdanaPas encore d'évaluation
- Organisation de La Prevention HseDocument38 pagesOrganisation de La Prevention Hseegsamir1075100% (1)
- Rebobinage Dahlander 4 - 8 Pôles PDFDocument32 pagesRebobinage Dahlander 4 - 8 Pôles PDFgfgf100% (1)
- GPEC & Risqua Quantitatif FINALDocument44 pagesGPEC & Risqua Quantitatif FINALSanae Elkhoumsi100% (1)
- Valorisation Énergi (Biogaz) Huile Usagée Codigestion Avec Diff Déchets AgroalimentDocument68 pagesValorisation Énergi (Biogaz) Huile Usagée Codigestion Avec Diff Déchets Agroalimentegsamir1075100% (1)
- ZXUR 9000 GSM (V6.50.00) Hardware DescriptionDocument118 pagesZXUR 9000 GSM (V6.50.00) Hardware DescriptionJar Jarwadi100% (4)
- User Manual PDFDocument209 pagesUser Manual PDFPedroPas encore d'évaluation
- Etude D Impact Environnemental Et Social (Eies) Sommaire de Construction D Une Station-Service Confex-Oil Dans La Ville de MeigangaDocument16 pagesEtude D Impact Environnemental Et Social (Eies) Sommaire de Construction D Une Station-Service Confex-Oil Dans La Ville de Meigangaegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Etude D - Impact Sur L - EnvironnementDocument7 pagesEtude D - Impact Sur L - Environnementegsamir1075Pas encore d'évaluation
- TRAIN FR GuideFormateurDocument77 pagesTRAIN FR GuideFormateuregsamir1075Pas encore d'évaluation
- Notice D - Impact Sur L - EnvironnementDocument7 pagesNotice D - Impact Sur L - Environnementegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Formation Environnement1Document45 pagesFormation Environnement1egsamir1075Pas encore d'évaluation
- Plateforme IndividuelleDocument2 pagesPlateforme Individuelleegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Cours TC 07aDocument35 pagesCours TC 07aegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Memoire YbDocument204 pagesMemoire Ybegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Formation EUROCODE 8Document2 pagesFormation EUROCODE 8egsamir1075Pas encore d'évaluation
- Loi - N°28-00 - Gestion - Des - DechetsDocument17 pagesLoi - N°28-00 - Gestion - Des - Dechetsegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Organisation Et Acteurs de La PréventionDocument5 pagesOrganisation Et Acteurs de La Préventionegsamir1075Pas encore d'évaluation
- Article Rassam Traitement Des Eaux Usees D OujdaDocument9 pagesArticle Rassam Traitement Des Eaux Usees D Oujdaegsamir1075Pas encore d'évaluation
- VibrationsDocument3 pagesVibrationsegsamir1075100% (1)
- Les Intercepteurs - ESISA PDFDocument11 pagesLes Intercepteurs - ESISA PDFMohamed El MourabitPas encore d'évaluation
- Série DS-72xx - Guide - Installation - V 1.2.2Document23 pagesSérie DS-72xx - Guide - Installation - V 1.2.2nourrahbricengandoulouPas encore d'évaluation
- 0127 Formation Architecture OrdinateursDocument110 pages0127 Formation Architecture OrdinateursSalah AllouchiPas encore d'évaluation
- CE REGLES ABSOLUES AML SAR - 22 Apr 2017Document8 pagesCE REGLES ABSOLUES AML SAR - 22 Apr 2017Miguel Jean Baptiste Mbayo100% (1)
- XML If Ch1234Document205 pagesXML If Ch1234Abdoulahi GueyePas encore d'évaluation
- Delagrave Gestion-Finance-Chapitre4Document13 pagesDelagrave Gestion-Finance-Chapitre4PRIPas encore d'évaluation
- 1915 Em18012016 PDFDocument15 pages1915 Em18012016 PDFelmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Epotek FixDocument2 pagesEpotek FixSalem Mohand Ben MohamedPas encore d'évaluation
- Referentiel Bep ElectrotechniqueDocument49 pagesReferentiel Bep ElectrotechniqueDavid “Ingénieur,” BaPas encore d'évaluation
- Planification Et Dimensionnement Du Reseau Wimax Dans La Ville de GarouaDocument73 pagesPlanification Et Dimensionnement Du Reseau Wimax Dans La Ville de GarouaMoussa AhodjoPas encore d'évaluation
- 2fiche Technico Comercial MD Bipolaire BmsDocument1 page2fiche Technico Comercial MD Bipolaire BmsFay OulebPas encore d'évaluation
- PSLA Comment-Ca-MarcheDocument6 pagesPSLA Comment-Ca-MarcheBelirh KaddedPas encore d'évaluation
- CcnaDocument8 pagesCcnaomar ayissaPas encore d'évaluation
- Comment Configurer SARDocument5 pagesComment Configurer SARaurorion_adminPas encore d'évaluation
- Etudiant L3 Isg Matin 2024Document11 pagesEtudiant L3 Isg Matin 2024Plamedi Kalema corneillePas encore d'évaluation
- Relation de L'empire de Maroc (... ) Pidou de Bpt6k104547vDocument261 pagesRelation de L'empire de Maroc (... ) Pidou de Bpt6k104547vsaladino666Pas encore d'évaluation
- Lutte Corruption Et TranspDocument28 pagesLutte Corruption Et TranspNathan FowlerPas encore d'évaluation
- PC PaieDocument10 pagesPC PaieAnay ImourPas encore d'évaluation
- Facture Ouedraogo 10-2019Document5 pagesFacture Ouedraogo 10-2019Joel YamenPas encore d'évaluation
- Loi N° 96-41 Du 10 Juin 1996 BoueDocument5 pagesLoi N° 96-41 Du 10 Juin 1996 BoueEmna RahaliPas encore d'évaluation
- Darty Airpods Pro 2 6eeeDocument2 pagesDarty Airpods Pro 2 6eeelstrading008Pas encore d'évaluation
- 483 - Plan de Masse Rpe Malves-A3-1.100°Document1 page483 - Plan de Masse Rpe Malves-A3-1.100°Maxence PuertoPas encore d'évaluation
- Proforma Da A14112022-Prix Special Du 14 11 2022Document1 pageProforma Da A14112022-Prix Special Du 14 11 2022Imex NegocePas encore d'évaluation