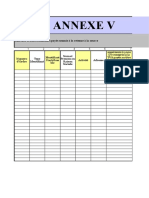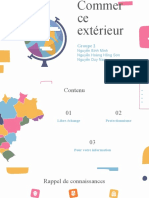Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Aan 1996 35 - 36 PDF
Aan 1996 35 - 36 PDF
Transféré par
Ami CoeurTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Aan 1996 35 - 36 PDF
Aan 1996 35 - 36 PDF
Transféré par
Ami CoeurDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI
DU LIBRE-CHANGE: ENJEUX, RLE
DES ACTEURS ET CONTRAINTE DE FINANCEMENT
Larabi JADI* et Fouad ZAM**
Il Y un an, avec la conclusion du nouvel accord d'association, les relations
entre le Maroc et l'Union Europenne ont abord un nouveau tournant. Peru
comme un moyen d'adapter la coopration aux mutations de l'environnement et
d'arrimer l'conomie nationale la dynamique europenne, l'accord a finalement recueilli l'adhsion des partenaires conomiques et sociaux en dpit des
interrogations qu'il a souleves quant ses retombes sur le tissu productif
national.
Uouverture croissante de l'conomie nationale va promouvoir la comptitivit au rang d'objectif central, entranant une modification des politiques
conomiques et sectorielles. Si la reconnaissance du rle fondamental de
l'entreprise et du processus concurrentiel implique une attnuation du poids
des politiques industrielles interventionnistes, il est tout aussi largement
reconnu que le rle de l'tat dans l'mergence de nouveaux avantages
comparatifs et dans la formation de la comptitivit est fondamental. D'o la
ncessit de mobiliser des ressources financires suffisantes pour favoriser la
restructuration des entreprises.
Dynamisme industriel et perspectives de libre-change
Uaccord est avant toute chose un cadre institutionnel qui prsente des
opportunits et pose surtout des dfis considrables aux entreprises industrielles marocaines en termes de diversification des marchs, de comptitivit
et de qualit des produits. L'exploitation du potentiel de gains qu'il recle
dpend moins de la leve des frontires aux changes que de la pertinence de la
politique de mise niveau qui doit adapter les entreprises marocaines la
dimension et aux exigences d'un grand march dsormais ouvert tous les
concurrents.
Quelles sont pour l'industrie marocaine les opportunits et les contraintes
de l'tablissement d'une zone de libre-change? Quelles sont les forces et les
faiblesses de l'industrie nationale face ce dfi? Quelles apprciations peut-on
porter sur les politiques d'accompagnement prvues?
* Professeur d'conomie l'Universit Mohamed V.
*', Professeur d'conomie l'Universit Hassan II de
Casablanca. Coordinateur de l'Annuaire
de la Mditerrane du Groupement d'tudes et de Recherches Sur la Mditerrane (GERM).
Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXV, 1996, CNRS DITIONS
70
LARAB! JADI ET FOUAD ZAM
Opportunits et contraintes de l'accord pour l'industrie marocaine
La mise en place de la zone de libre-change inscrite dans le nouvel accord
d'association UE-Maroc signifie essentiellement le passage progressif d'un
rgime prfrentiel fond sur des concessions commerciales unilatrales et
asymtriques octroyes par rUE aux exportations manufactures marocaines
un accord d'association de la nouvelle gnration devant dboucher sur la mise
en uvre de concessions commerciales rciproques. Une telle rciprocit - en
l'absence d'une libralisation plus significative des changes des produits
agricoles, reporte au dbut du sicle prochain - ne signifie en dfinitive rien
d'autre que l'ouverture programme, sur une douzaine d'annes, du march
marocain aux productions industrielles en provenance de l'Union europenne.
Le Maroc s'engage supprimer progressivement, entre le 1er janvier 1997
et le 1er janvier 2009, tous les droits et taxes d'effet quivalent pour la totalit
des marchandises industrielles en provenance de l'UE. Le dmantlement
tarifaire s'effectuera ainsi sur une priode de douze ans, sur la base de trois
listes de produits (1). La liste des catgories de produits et le rythme de
rductions tarifaires l'intrieur des calendriers ont t dfinis en fonction de
la sensibilit des branches industrielles (2). En outre, des mesures tarifaires
particulires pourront tre prises, sous certaines conditions, par le Maroc, pour
protger des industries naissantes ou des secteurs confronts des difficults
sociales ou autres. L'impact de cet accord sur la cration de nouveaux flux de
commerce entre le Maroc et rUE dpendra - toutes choses tant gales par
ailleurs - du comportement de l'lasticit des importations des partenaires en
relation avec la croissance de leur PIB.
Le march europen reprsente en moyenne 65 % des exportations
marocaines. Le taux de couverture des produits se situe 43,7 'ic. En dpit du
ralentissement rcent, pendant la priode 1990-1995, le Maroc a enregistr une
lgre augmentation de sa part du march de l'UE pour ses exportations de
produits manufacturs. La performance de l'exportation est lie positivement
l'volution favorable des prix l'exportation et la dprciation du taux de
change. Une dcomposition de la contribution la croissance de l'exportation
des deux facteurs d'offre et de demande a montr que la demande internationale ajou un rle important dans l'volution des exportations (3).
(11 Cf. article 11 de raccord euro-mditerranen tablissant une association entre les communauts europennes ('i leurs Etats membres, d'une part et le Royaume du lVlaroc d'autre part.
Dlgation de la Communaut europenne. Rabat.
121 Une premire liste de produits pour lesquels les droits de douane et taxes d'effet quivalent
~ont supprirns ds l'entre en vigueur de l'accord (pour l'essentie1 des biens d'quipement 1: une
deuxime liste de produits pour lesquels le dmantlement se fera progressivement sur une priode de
:1 an~ il un taux linaire (il s'agit ici essentiellement de matires premires industrielles 11(ln produite,..,
!ocaiL'ml'nt et des pices de rechange); une troisime liste de produits enfin, en l'occurrenc(' ln liste des
produits industriels les plus ',sensibles .. parce que fabriqus localement. pour lesqupj,; Il' d,;mantl'I,,mpnt interviendra aprs un dlai de grce de :3 ans, et qui suhiront ri partir du 1(') janvipr 2(){)(). UIIl'
r{'dudion linaire des droits dl' douane ct taxes d'effet {iquivalent de- 10 (/~ par an jusqu'il (qiminatioll
totale le 1" janvin 2009.
{:1) Cf. Ro.ynume du Alaroc -Republique de '/llni,,,'ie. Crois,<,'([f/('(' de l'exportatio/l, detcl'll);l/onls et
/''l'S/Wel;l'''. Happort de la Banque Mondiale, mai 1994. p. 19.
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
71
La part de march du Maroc dans l'UE sur quinze principaux points forts
l'exportation ne dpasse 10 % que dans les secteurs de l'habillement De fait,
sa part de march n'est relativement forte que sur les secteurs faible
intgration de valeur ajoute. Dans les secteurs de la construction mcanique et
lectrique, de l'automobile, du bois et de la chimie, il n'occupe ce stade qu'une
place trs faible, loin derrire les concurrents asiatiques. Dans le secteur de
l'habillement, la progression des parts de march du Maroc n'affecte pas la
position des pays asiatiques, qui demeurent les principaux fournisseurs.
Les effets de l'accord sur la dynamique des exportations marocaines
diffreront substantiellement selon les types de produits exports. La croissance du march europen sera plus favorable aux exportations lasticit de
la demande leve. La concurrence sur le march europen reste vive. Les
principaux concurrents de l'industrie marocaine demeurent dans le court terme
les partenaires mditerranens de la Communaut. Il s'agit de la Thnisie
(textiles et engrais) et de la Thrquie (articles de bonneterie, vtements
confectionns). Mais, moyen terme, le champ de la concurrence s'largira. La
disparition du rgime prfrentiel nivellera les condition d'entre des concurrents. Il s'en suivra une redistribution des parts de march en faveur des pays
les plus agressifs.
Le premier volet de l'intensification de la concurrence provient de la plus
large ouverture du march europen aux entreprises des pays de l'Est et de
l'Asie. L'UE s'est engage, dans le cadre des accords d'association avec les
premiers et de l'OMC dans les seconds, ouvrir son march aux concurrents des
PSEM. Dans plusieurs secteurs sensibles, les pays du Maghreb subissent un
effet de ciseau entre les pays d'Asie et les pays d'Europe centrale et orientale
(PECO), qui voient chacun progresser leurs parts de march. L'volution par
pays des principaux groupes de produits sujets dlocalisation dmontre la
forte progression des parts de march des PEC~, et en particulier des pays de
Visegard sur les secteurs porteurs pour le Maroc et plus gnralement pour le
Maghreb, notamment les vtements et les appareils lectriques (4).
Sous un autre aspect, la concurrence sera encore accentue par les efforts
dploys par les entreprises europennes pour dfendre leurs parts de march.
A l'avenir, ces entreprises dstabilises misent non seulement sur l'innovation
et la qualification de la main d'uvre mais aussi sur les restructurations et
rapprochements pour rsister une concurrence de plus en plus vive sur les
prix. Les stratgies adoptes par les entreprises europennes consistent
(4) Cf. Les conditions d'un partenariat industriel entre la France et les pays du Maghreb, la
France et les pays d'Europe Centrale et Orientale. Rapport de Willy Dimeglio, mars 1994. La forte
progression relative des PECO par rapport au Maghreb sur le march de l'UE rsulte des nombreux
avantages comparatifs des PECO par rapport aux pays du Maghreb (qualification de la main d'uvre,
proximit gographique, disponibilit de services d'accompagnement). Le maintien de la spcialisation
actuelle des pays du Maghreb aurait des consquences particulirement ngatives sur leur conomie,
encore accentues par la concurrence accrue de nouveaux acteurs en transition (Chine, ex-URSS en
particulier sur le textile et les biens de consommation courante).
72
LARABI ,IAD! ET FOUAD 7:AiM
soutenir leur croissance externe, par le biais de coopration entre rivaux dans
des domaines d'intrt commun, de fusions et d'absorptions (5).
Par ailleurs, le Maroc envisage d'ouvrir progressivement le march local
aux produits industriels europens sur la base de la rciprocit. Le niveau
actuel de couverture de la demande nationale en produits manufacturs
imports est de 35 'It. Les produits en provenance de la communaut reprsentent 74 rlr de ces importations. L'tablissement d'une zone de libre-change
augmentera le potentiel de pntration des produits trangers dans le march
intrieur. Cet largissement concernera plus srieusement les secteurs o la
part des importations est encore limite, o le taux de protection tarifaire est
lev et dont le niveau tendra se rduire et o le degr de comptitivit des
industries nationales est faible.
Quand on examine le niveau de pntration des produits trangers dans
le march national, on constate qu'il dpasse les 50 tic pour cinq secteurs
(machines de bureau, matriel d'quipement, industrie mtallique de base,
matriel de transport et produits d'autres industries manufacturires). Il se
situe entre la moiti et le tiers de la demande nationale pour trois secteurs
(textiles et bonneterie, bois et articles en bois, matriel lectrique et lectronique) et couvre moins du tiers de la demande nationale pour dix secteurs.
Les effets de la zone de libre-change sur le tissu industriel et ses
avantages nets pour l'conomie marocaine varient en fonction des secteurs, de
leur degr d'ouverture pralable et de leur niveau de comptitivit (6). Mais on
peut considrer que la libralisation du commerce extrieur, entame depuis le
milieu de la dcennie quatre-vingt, prdispose l'conomie marocaine voluer
progressivement vers une zone de libre-change avec l'Europe (7). En effet, la
libralisation du commerce a consist abaisser le montant maximum des
droits d'importation (de 400 % en 1983 35 % en 1993), simplifier la structure
tarifaire (de 26 9 catgories), rduire la proportion de la production
manufacturire protge par des restrictions quantitatives (de 60 % en 1983
11 % en 1994). L'accord prvoit la suppression du recours aux mesures
quantitatives l'entre des produits europens. Actuellement, la protection par
contingentement est limite quelques activits (chaussures, vtements et
textiles, produits alimentaires).
(5) Les annes rcentes ont connu un accroissement des nombres d'accords interentreprises.
Une vague de fusions et d'absorptions (1 800 oprations entre 1986 et 1994) a impliqu des entreprises
nationales, communautaires et internationales de tailles diffrentes. L'objectif tant de renforcer la
concentration en vue de peser sur les cots, d'lever des barrires contre de nouveaux acteurs
susceptibles de pntrer sur le march, de contrler les produits qui pourraient se prsenter comme des
substituts, d'anticiper le changement par de nouvelles combinaisons produits-marchs.
(6) Selon les donnes disponibles, la moyenne des taux de protection tarifaire de" seclcurs
industriels varie de 107< 45 'le selon les activits: de 35 % 45 Ck pour les produits alimentaires, 41 cl
45 'le pour les textiles et l'habillement, 387<. pour les articles en plastique, 24'7r pour les produits
chimiques, 40 'f, pour la fonderie et la quincaillerie. La protection tarifaire est plus leve que la
moyenne nationale dans l'agro-alimentaire o certains produits sont protgs par des restrictions
quantitatives (farines, sucre). Les produits textiles se caractrisent aussi par une protection tarilire
plus leve que la moyenne (notamment pour le fil et le tissu en coton). Dans la chimie et la parachimie.
la protection est en gnral modre. Quant aux industries mtalliques, mtallurgiques, lectriques pt
lectroniques, la protection leve est limite quelques produits.
(7) Cf JAIllI (L.), La zone de libre change Union Europenne-Maroc: impact du pmjet sur
l'conomie marocaine, Cahiers du GEMDEV (22), octobre 1994.
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
73
La progressivit de mise en application de ce projet et les dispositions
gnrales et particulires qui accompagneront sa mise en uvre permettent
d'envisager une ouverture sans heurts, la condition videmment que les
politiques d'accompagnement soient mises en place et que les choix oprs
s'inscrivent dans la perspective d'une stratgie industrielle moyen terme, Le
systme productif national actuellement atomis en petites units spcialises
dans les sries courtes ou de rassortissement, ne dispose pas d'une capacit
comptitive leve face l'intensification de la concurrence interne et externe,
Cette perspective appelle une restructuration des entreprises dont l'avantage
est d'acclrer l'entre sur de nouveaux marchs ou de nouvelles productions
moindre cot, De plus, la mise en commun de ressources peut fournir des
financements des conditions plus favorables; elle peut galement rpartir les
cots fixes levs et amliorer le savoir-faire technologique.
L'industrie marocaine: contraste des performances, vulnrabilit des
structures et exigences d'une rvision des stratgies des entreprises
Face aux dispositions de l'accord d'association, les branches industrielles
marocaines vont ragir diversement en fonction de leurs atouts et de leurs
faiblesses, de leur capacit s'insrer dans la dynamique des exportations ou
dfendre leurs positions sur le march national. L'observation du comportement
rcent des variables de performances et de l'tat des structures renseigne sur
l'effort qui doit tre ralis par les entreprises manufacturires dans la
perspective de rsister au choc de l'ouverture et de consolider leur prsence sur
les marchs extrieurs.
En 1995 l'industrie exporte le quart de sa production (25 %) au lieu de 15 % dix ans
auparavant, tandis que le march intrieur est toujours aliment au tiers par des
importations (33 %). La plupart des branches significatives sont fortement ouvertes sur
l'extrieur mme si le degr d'ouverture global n'a pas connu de profonds changements
(12 % en dix ans). Les exportations industrielles ont augment de 15 % par an entre 1983
et 1995. Cette performance confirme une plus grande contribution des marchs extrieurs
l'volution de la production industrielle dont la croissance nominale s'est situe 11,4 %
par an, Le taux d'exportation a progress dans la totalit des branches, l'exception d'une
seule,
Si la croissance des importations a t leve (12 % par an), elle est reste au mme
niveau d'volution que la demande intrieure et n'a pas caus une baisse des ventes de
produits nationaux sur le march domestique. Aussi, le taux de pntration du march
intrieur ne s'est lev que pour onze branches. Dans l'ensemble, l'industrie a dgag, en
1995, un taux de couverture de 45 % au lieu de 35 % en 1983, Le plus fort excdent est celui
de l'habillement. Viennent ensuite les industries alimentaires avec notamment les
activits de la conserve ani male et vgtale. Dans la hirarchie des branches excdentaires,
suivent diverses autres industries comme le cuir et articles en cuir, les engrais.
A l'oppos, parmi les branches les plus dficitaires, figurent videmment les
machines et matriels d'quipement, et plusieurs groupes de produits intermdiaires
(ouvrages en mtaux, pices mcaniques). Le Maroc est mal plac pour ces productions,
qui ncessitent une disponibilit en matires premires, une matrise technologique et un
march suffisamment large pour faire jouer les conomies d'chelle (8),
(8) Ainsi, de lourds dficits sont encore enregistrs dans plusieurs activits, Les unes sont des
industries jeunes et confrontes une demande en augmentation: matriel de bureau, matriel
lectronique de consommation, Les autres sont plus traditionnelles et dans lesquelles le Maroc cherche
dvelopper son potentiel (fibres textiles, papier, matriaux de construction, articles en plastique, etc,).
74
LARABI JADI ET FOUAD ZAM
La croissance de la production industrielle a t de l'ordre de 4,2 '7r par an entre
1982 et 1995. La dispersion des taux de croissance sectoriels s'est accentue, et la
hirarchie des branches s'est sensiblement transforme. Mais, dans l'ensemble, les
mutations de l'industrie marocaine restent timides. L'volution dcennale est marque par
une relative stagnation du poids relatif des activits manufacturires dans les structures
de l'conomie nationale (de 16,5 % 18,3'7r du PIE). En tmoigne la stagnation de la
contribution de l'industrie aux richesses hors agriculture (de 20,8 '7c en 1984 20,7 % en
1995). L'conomie marocaine est encore ancre dans une" ruralisation" et une" tertiarisation" qui freinent sa comptitivit globale.
En termes de renouvellement du tissu, la situation est paradoxale. Le tissu
industriel national fait preuve d'une forte vitalit, puisque le flux annuel de crations
d'industries nouvelles est lev. Durant la dcennie quatre-vingt-dix, il est entr plus
d'entreprises dans l'industrie de transformation qu'il n'en est sorti. Toutefois, cela se
traduit par une faible survivance puisque le taux de sinistralit reste important. Par
ailleurs, si le nombre de nouvelles entreprises crot rgulirement, cette progression
s'accompagne de la baisse de la taille moyenne des entreprises. Cette situation dnote les
difficults de l'conomie rgnrer en profondeur son tissu industriel. Du fait des limites
de la taille, ces entreprises mnent moins d'actions dans les domaines essentiels de la
comptitivit: formation, organisation, technologie.
La croissance de l'industrie nationale demeure faible productivit. Celle-ci n'a
augment que de 4,3 o/c par an entre 1983 et 1993 (9). Une des causes en estle vieillissement
de l'appareil productif dans certaines branches. La deuxime raison est le sureffectif dans
certaines branches et entreprises publiques. Enfin le bas niveau des salaires ne stimule
pas le rendement.
Les performances passes des pays en dveloppement suggrent que les pays qui
ont su le mieux profiter de la dimension du march europen sont ceux qui ont entam et
russi des rformes de l'environnement de leurs entreprises. Paralllement la ncessaire
amlioration de l'environnement national, tche qui interpelle plus fondamentalement les
pouvoirs publics, l'entreprise nationale est aussi appele assimiler que les avantages
comparatifs, les structures du march et les comportements ne peuvent tre considrs
comme des donnes. C'est au contraire un jeu squentiel rsultant d'une srie d'interactions entre des acteurs actifs. Un jeu dans lequel la mise en uvre des nouvelIes formes
d'organisation, l'ouverture de nouveaux marchs et l'introduction de nouveaux produits et
procds mettent continuellement en cause les positions acquises et modifient les rgles
dujeu.
La concentration de nos dbouchs sur quelques pays europens pourrait devenir
un handicap. Les entreprises marocaines ne devraient pas rester passives face la
dimension" europenne" de l'UE, que ce soit par une plus grande pntration de nos
produits dans des marchs de grande taille (Allemagne, Angleterre, Italie) ou par une plus
grande insertion dans des marchs de moindre envergure mais fortement porteurs. Le
remodelage de la carte de consommation europenne, dj entam, sera certainement
accentu par l'largissement de l'UE. Les entreprises marocaines devraient saisir les
opportunits qu'offrent les perspectives de croissance de ces marchs fort contenu en
importations.
Peu de biens nouveaux ont intgr le panier d'exportation durant ces dernires
annes. C'est l aussi une autre source de vulnrabilit des entreprises nationales. Les
produits manufacturs exports restent domins par la confection, la bonneterie, les
articles chaussants et les engrais.
Il est gnralement admis que l'impact favorable de l'accord sur le solde commercial
ne se produira qu' long terme, lorsque des investissements europens auront permis de
renforcer les structures productives de l'conomie marocaine. Les dlocalisations vers le
(91 La productivit relle a mme subi une tendance la baisse. Bien plus. les indices
d'volution de la productivit relle dans l'industrie nationale montrent une rgression dans onzp
branches sur quinze entre 1983 et 1993. Il s'avre que les secteurs traditionnellement exportateurs ne
sont pas preuve d'innovation dans l'organisation du travail et enregistrent des pertes de productivit.
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
75
Maroc ne reprsentent actuellement, selon toute vraisemblance, qu'une part limite des
d localisations europennes vers l'ensemble du monde. Uencouragement de la dlocalisation appelle une identification des conditions et des secteurs dans lesquels pourraient se
dvelopper moyen terme des partenariats industriels plus troits avec le Maroc,
permettant aux entreprises europennes de demeurer comptitives par rapport leurs
homologues occidentales, et aux entreprises marocaines de conqurir des parts de march
dans ces pays et de matriser ainsi une situation concurrentielle de plus en plus marque.
La nouvelle politique industrielle: la stratgie des grappes
et le nouveau rle des acteurs
Sur le long terme, la stabilit et la durabilit de la croissance au Maroc
reposent sur la consolidation des bases de l'industrie. Le dynamisme de
l'industrie est seul mme de permettre la rgularisation de la croissance en la
soustrayant aux effets cycliques de la nature. Une industrie efficiente implique
que l'initiative et la responsabilit soient, en premier lieu, du ressort des
entreprises. Mais la durabilit de la comptitivit d'un pays dpend de
l'aptitude de ses pouvoirs publics dfinir une stratgie de croissance long
terme, crer un environnement qui encourage les entreprises et les industries
chercher, innover, et amliorer leur efficacit.
Le couple spcialisation/comptitivit se situe aujourd'hui au cur des
politiques industrielles du monde entier. Tous les pays, grands et petits,
s'interrogent sur les conditions de conqute et prservation des positions sur le
march mondial (10). Le Maroc n'chappe pas cette interrogation fondamentale et aux sries de questions drives que se posent les dcideurs des
politiques industrielles dans le monde: comment construire les fondements
d'une croissance industrielle durable? Autrement dit, comment se crer un
avantage concurrentiel dans quelques activits particulires? Quelles sont les
caractristiques du Maroc qui vont dterminer sa capacit crer et conserver
un avantage concurrentiel? Quels sont les secteurs o il peut disposer d'un
avantage relatif sur ses concurrents? (ll) Quelle politique publique conduire
pour que les entreprises nationales soient performantes dans telle activit ou
telle autre?
L'analyse de l'environnement concurrentiel auquel sont confronts les
producteurs aujourd'hui a permis de dterminer les forces et les faiblesses des
diffrents secteurs d'activit et d'identifier les" grappes d'activit sur lesquels
le Maroc est le plus susceptible de pouvoir se positionner et/ou d'augmenter sa
part des marchs mondiaux. Les grappes sont des" groupes sectoriels intgrs,
c'est dire forms par des firmes et des industries qui se renforcent mutuellement grce des cooprations technologiques, des relations clients-fournisseurs
troites et des liens solides avec l'infrastructure conomique (12).
(101 Cf. PORTER (M.El, L'avantage concurrentiel des nations, InterEditions, 1993.
(1) Vu sous un angle dynamique, le schma de spcialisation de l'conomie marocaine a subi
des changements durant cette dernire dcennie. En 1980, les avantages du Maroc taient concentrs
dans les produits d'origine agricole comme les fruits et lgumes et ceux d'origine minire comme les
engrais. Dix ans plus tard. le Maroc prsentait une spcialisation plus diversifie avec l'hahillement et
les poissons comme secteurs attractifs.
(12) La stratgie des grappes est inspire de l'analyse de M.K PORTER. Cf. Le Maroc
comptitif: Rapport prpar par les hureaux d'tudes DRI.FOCS, Crargie Maroc, volume 1, septemhre
1995.
76
LARABI JADI ET FOUAD ZAM
La stratgie des grappes se prsente comme un choix intermdiaire entre la
stratgie des filires et celle des crneaux. Tenant compte de la mondialisation croissante
des conomies et des obligations de plus en plus pressantes d'un positionnement
concurrentiel, la "filire de production ne constitue plus une rfrence pour la dfinition
d'une politique industrielle au niveau d'une nation. La porte du phnomne d'intgration
national d'une suite d'oprations s'enchanant logiquement, depuis le traitement de la
matire premire jusqu'au produit semi-fini, puis jusqu'au produit fini, a perdu de son
attrait devant l'efficience d'une insertion dans un rseau mondial. Par ailleurs, en
s'efforant de promouvoir les firmes champions les mieux places, la stratgie des
crneaux est suspecte de faire clater les structures industrielles qui deviennent de
"vritables tamis et d'empcher ainsi les firmes de tirer parti de tous les effets de synergie
et de complmentarit qu'elles pourraient tablir entre elles.
La stratgie de grappe permet d'opposer une vision du systme industnel, conu
comme une juxtaposition de firmes isoles, la vision d'un systme industriel conu comme
un ensemble structur dont le dveloppement est dtermin par des politiques globales
visant renforcer la cohrence de l'ensemble. Il ne s'agit pas pour autant de dvelopper
des filires mais de choisir les activits o le pays dispose d'un avantage comparatif ou
d'un potentiel d'avantages valoriser par une politique publique adquate. Elle permet
de relier des entreprises entre elles par des changes multiples dans un environnement
ouvert. Elle repose sur une conception prcise: la performance globale d'un systme
industriel provient moins de la prsence de quelques" firmes stars que de la qualit des
relations qui s'tablissent entre tous les lments qui le constituent.
Dix grappes industrielles cls ont ainsi t identifies. Sept d'entre elles jouent
actuellemEmt un rle moteur dans l'conomie industrielle: chimie et parachimie
l'exclusion de la pharmacie, pharmacie, conserves fruits et lgumes, produits de la pche,
autres industries alimentaires, textiles et bonneterie, habillement, cuir et chaussures (13).
A ct des ces sept grappes opreront trois grappes mergentes et une srie d'industries
de support: matriel lectrique et lectronique, matriel de transport, services informatiques.
Trois critres se sont imposs pour la slection des grappes: l'attrait du march
mesur par la taille et le taux de croissance du march potentiel l'exportation, par le
degr d'intensit de l'environnement concurrentiel au niveau mondial, ainsi que par les
effets induits de la croissance de la grappe; les facteurs d'atouts qui dpendent la fois de
l'existence de capacits de production suffisantes, de l'adquation des infrastructures
conomiques de base et du positionnement relatif du Maroc par rapport certains facteurs
cls de succs; les gains attendus de la formation de la grappe, ces gains dpendant d'une
part du degr d'organisation actuel des entreprises au sein de la grappe, qui dtermine la
capacit qu'a celle-ci dmarrer rapidement, dvelopper des initiatives, puis mettre
en place des plans d'action concerts. Le choix de ces critres reflte trois proccupations:
la capacit attirer les investissements trangers, le besoin de se concentrer en priorit
sur les grappes ayant un rel potentiel l'exportation et la ncessit de maximiser les
effets induits sur le reste de l'conomie (14).
Certaines des grappes slectionnes sont dj relativement structures et prtes
dmarrer rapidement, tandis que la plupart ne sont encore que des pr-grappes, compte
tenu des liens diffus qui unissent les entreprises entre elles, d'une part, et de
l'infrastructure de base, d'autre part. Par ailleurs, certaines grappes considres sont
composes essentiellement de leur composante exportatrice, et n'ont que peu de liens en
aval et en amont au sein de l'conomie. Seules les grappes de textile et de l'habillement,
de la chimie et parachimie semblent dj prsenter une structure interne cohrente. La
grappe des produits de la mer, quoique jouant un rle important au Maroc, est encore trs
peu structure, les rseaux de distribution tant archaques et les transports coteux. C'est
(1:1) Ensemble, ces sept grappes reprsentent plus de 50 r;, de la valeur ajoute totale des
industries dl' transformation, 737r de l'emploi et 90 '7r, des exportations totales des industries de
transformation.
(14) Cf. Happort Le Maroc comptitif, op. cit.
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
77
galement le cas de la grappe cuir, ainsi que de la grappe automobile et des industries
lectriques et lectroniques.
Pour mettre en uvre la stratgie des grappes ", la politique industrielle nationale
se trouve confronte un dfi majeur: favoriser la comptitivit des facteurs de production
nationaux et plus ncessairement des entreprises nationales. Alors que la mondialisation
progresse, il apparat que la formation de la comptitivit repose encore sur des politiques
nationales spcifiques. D'o la ncessit d'agir sur les spcificits nationales qui favorisent
la formation de la comptitivit.
La cration d'un environnement favorable aux entreprises implique d'assurer que
les rglementations tatillonnes et superflues soient vites. L'environnement de l'entreprise marocaine connat actuellement une mutation en profondeur par la rnovation de
nombreux textes de lois. Un nouveau cadre incitatif l'investissement s'est substitu
huit textes spcifiques. Il est fond sur des principes de gnralisation, d'harmonisation,
d'automaticit et de simplification des avantages accords l'investisseur (15). Ces critres
devraient tre prciss dans les dcrets d'application de la nouvelle charte. L'effort
entrepris pour promouvoir l'investissement resterait vain, si n'tait paralllement abord
le problme de la refonte des procdures de ralisation des projets. L'imprcision et la
complexit de ces procdures sont telles qu'elles reprsentent encore un vritable goulot
d'tranglement susceptible de rendre inefficace le nouveau dispositif rglementaire.
La loi sur la charte de l'investissement prvoit la cration d'une Agence
d'Accueil et d'Assistance aux investisseurs. L'objectif vis par la cration de
cette institution est la recherche de plus de cohrence et d'efficacit dans
l'action de l'tat en la matire. Les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou
trangers, se sont toujours plaints de l'absence d'un interlocuteur unique dans
leur dmarche de choix et de ralisation d'un projet. La pluralit de lieux de
rception et d'orientation se transformait en un parcours tortueux et peu
incitatif. La mise en place de cette structure est destine mettre fin cette
dispersion. Ueffet positif attendu dpendra de l'importance et de la clart de ses
missions ainsi que de l'unicit de ses prrogatives (16). Sera-t-elle l'quivalent
d'un guichet unique}} ou se limitera-t-elle informer et orienter l'investisseur vers les administrations comptentes?
De nouvelles lois ont t adoptes en vue de crer un environnement
favorable aux affaires. Cette mise jour vise moderniser et rapprocher les
lgislations nationales avec les standards europens et internationaux en
matire d'environnement juridique de l'entreprise. Il en est ainsi de la
normalisation comptable, de la rvision du code de commerce, de la refonte
actuelle du droit des socits commerciales et industrielles. D'autres lois
doivent suivre (code du travail, loi sur la concurrence, protection du consommateur). Des domaines sont encore non couverts par des textes officiels (droits de
la faillite, des cartes bancaires, de protection des logiciels, etc.). Leur adoption
compltera la mise jour du dispositif juridique. Mais cela risque de ne pas
suffire pour lever tous les obstacles la fluidit, la transparence des relations
entre les diffrents acteurs de la vie conomique et sociale. Du moins tant que
la rforme de la justice et la modernisation de l'administration n'ont pas t
ralises.
(15) Cf. Loi-cadre formant charte de l'investissement, Bulletin officiel nO 4336 du 6-12-1995.
(16) Cf. L'acte d'investissement: Missions et prrogatives de l'Agence. Lettre du Centre
Marocain de Conjoncture, nO 60, janv.-fv. 1997.
78
LARABI JAim ET FOUAD ZAM
Dans un autre registre, l'innovation technologique, les changements dans
l'organisation de la production et l'volution des comptences sont indispensables l'amlioration de la comptitivit des entreprises. Ils sont par ailleurs
fortement interdpendants. Si les changements technologiques sont plutt
motivs par l'impratif de modernisation et par des politiques de difl"renciation
des produits, les changements d'organisation s'imposent par la recherche de la
qualit.
.
Une enqute rcente a rvl que la structure fonctionnelle au sein de l'entreprise
prive prsente d'importantes insuffisances. L'essentiel des employs de l'industrie (84 'Ir J
sont utiliss dans la production et en moyenne sur 100 emplois, peine 5 s'occupent de la
fonction d'encadrement et 6 de la fonction de matrise. Ainsi, il s'avre qu'en moyenne
gnrale "les deux fonctions d'encadrement et de matrise, chanons essentiels de la
matrise et de la transmission du savoir-faire technique et professionnel sont relativement
peu prsentes" (17). La formation, en tant qu'activit structure au sein de l'entreprise
demeure rsiduelle (seules 3,7 'lc des entreprises disposent d'une structure spcialise de
formation).
Actuellement, le niveau et la qualit des investissements dans le dveloppement,
racquisition ct la diffusion de la technologie par les entreprises manufacturires au Maroc
sont relativement faibles par rapport la concurrence et ne sont pas la hauteur des
ambitions de comptitivit qu'affiche le Maroc sur le march mondial. Les dpenses totales
du Maroc en matire de technologie sont values moins de 0,3 'k du PIB, ce qui est
nettement infrieur la part d'autres pays comme l'Inde (1 ~k), la Core (2 'Ir J, le Brsil
(0,8 'Ir J et de la moyenne des pays industrialiss (3 'J{.). Les investissements technologiques
ralis par les entreprises industrielles consistent essentiellement acqurir la technologie trangre. La recherche-dveloppement intervient dans quelques grandes entreprises essentiellement du secteur public, dans les centres de recherche publi cs et les
universits, mais un faible niveau (18).
Le dveloppement industriel ncessite aussi que soient disponibles les services
d'infrastructure en quantit et qualit suffisantes. Des besoins importants s'expriment
dans ce domaine, notamment en terrains et parcs industriels. Un programme national de
zones industrielles a justement pour objectif de mettre la disposition des promoteurs
industriels des terrains prsentant le niveau d'quipements requis. L'amnagement des
zones prvues souffre de retards, dont la question du financement de travaux hors sites
est la cause fondamentale.
L'accord de libre-change avec l'Union europenne cre un nouveau
contexte pour les politiques sectorielles nationales. La progression vers l'horizon 2010 exige une acclration du rythme d'adaptation. Tous les secteurs n'ont
pas les mmes possibilits face cette ncessaire acclration (19).
Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a soumis
l'apprciation des oprateurs conomiques un plan de mise en uvre des
mesures d'accompagnement d'ordre gnral et spcifique. L'enveloppe globale
des mesures d'ordre gnral ncessiterait la mobilisation de prs de 45
milliards de dirhams rpartir en plusieurs catgories d'actions (20). Cet effort
117,1 Cf. En(/w)fe nation([le sllr l'encndrernl'nt de l'entreprise prir'e marocaine, (:Cm~pil.:-.Jati()nal
d" la Jeune"" pt d" l'AvI'nir, 1995.
(ISi Cf. Rapport sur le dl'e!oppeJJlcllf de {'industrie priL'f!C au I\'!oro(' de ln Banque .1!()II(!;o/e,
"O!tIIn" 1, annexe '!. septpInbr" 19~n.
1191 ('f. Elude du minisli're du Commerce de rIndu,trie et de l'Artisanal. Sim!I'g;1' de
dITe/oppe//lel/! //loyen ferme. 1.9.96-2000, mars 1996.
1201 Cf. Etude u ministre du Commerce de l"Industrie et de l'Artisanat, Ac("()rr! :Hume-L'V
AfesllI'()S d'(J('('OIll!)(lP,IICfi/('lIt. Volet industriel, 1996.
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
79
financier ne va pas revtir une dimension macro-conomique dcisive, mais en
termes de politique de soutien, il sera un appui significatif par rapport aux
engagements de l'tat.
Neuf domaines d'action seraient retenus. Les plus importants, en termes
de programmation financire sont le renforcement de l'infrastructure de base,
notamment en ce qui concerne la disponibilit et l'quipement de terrains
industriels (18 milliards), le Fonds de mise niveau (18 milliards) et la
promotion de l'investissement europen au Maroc, principalement par une
ligne de financement de projets conjoints et par l'institution d'un fonds de
garantie (7 milliards). Le dveloppement de l'infrastructure technologique
(laboratoires et centres techniques industriels), la politique de la normalisation
(promotion des normes, certification, accrditation etc.) et la prservation de
l'environnement (programme de mise en place de stations de traitement des
rejets) devraient mobiliser des ressources apprciables. Les autres volets du
plan d'action mettent l'accent sur l'assistance la promotion de la PMI, le
financement d'activits artisanales et commerciales, le renforcement des
associations professionnelles.
Les interventions du Fonds de mise niveau doivent soutenir l'objectif de
redressement des entreprises viables. Les prestations du Fonds seraient
canalises vers des prestations de service lies la mise niveau sur le plan
organisationnel et le financement des investissements physiques lis la
modernisation des quipements. Ce qui se dgage de la programmation prvue
est que la mise en uvre des interventions du Fonds devrait marquer une
rupture par rapport au pass et promouvoir une approche nouvelle base la
fois sur une meilleure identification des besoins par les pouvoirs publics,
l'introduction d'une vision moyen terme et le recours la technique de la
programmation pluriannuelle (21).
Au-del du simple transfert financier, sous l'effet des procdures de
programmation concerte, la mise en uvre des actions devrait se traduire sur
le terrain par une plus grande concertation entre les acteurs de la politique
industrielle. Ce partenariat devrait porter sur la prparation, le financement, le
suivi et l'valuation des actions. Une application efficace de ce principe
demande que les tches respectives des diverses administrations et instances
concernes soient clairement dfinies, et que des mthodes et outils appropris
pour la concertation soient mis en uvre. Pour ce qui est des instances prives,
la possibilit de les associer la dfinition des objectifs, la prparation des
programmes et la mise en uvre de l'intervention permet de faire merger
plus fortement la dimension de mobilisation des acteurs et d'tablir, dans la
mesure o les structures des organisations professionnelles le permettent, un
dialogue direct et continu avec les pouvoirs publics.
(21) Cf. Le fonds de mise niveau. Un instrument d'appui aux stratgies sectorielles. Lettre du
Centre Marocain de Conjoncture, nO 50, fvrier 1996.
80
LARABI ,JAID! ET FOUAD ZAII\I
La mise niveau de l'industrie marocaine, un enjeu financier
Quelques semaines aprs l'entre en vigueur de l'Accord d'association
UE-Maroc (effective depuis le 1er janvier 1997), la mise niveau du tissu
productif marocain et la restructuration industrielle en tant que telle sont
l'ordre du jour. Celle-ci n'est pas seulement une question de financement; elle
est aussi une affaire de stratgie industrielle, de ressources humaines, de
matrise technologique et de structures d'appui la mise niveau. Cependant,
l'ensemble demeure, un titre ou un autre, conditionn par le financement,
qui est sans doute la question cl.
Les financements externes: le Programme MEDA et l'investissement
tranger
L'accompagnement financier de l'ouverture: le Programme MEDA
Le Sommet europen de Cannes avait, en juin 1995, arrt l'enveloppe
financire destine aux" partenaires mditerranens : 4 685 milliards d'cus,
sur la priode 1995-1999. L'enveloppe de Cannes est le produit d'un montage
financier comprenant: 3425 milliards pour le programme MEDA, puiss sur
les fonds budgtaires de la Communaut> plus 1 260 milliards de reliquat des
quatrimes protocoles. A cette enveloppe est cens s'ajouter, au cours de la
mme priode, un montant quivalent de prts de la Banque europenne
d'investissement (BEI), sur les ressources propres de la Banque.
Une telle enveloppe financire est apparue au dbut comme substantielle.
La Mditerrane se voyait ainsi octroyer 16,8'7c des sommes alloues aux
actions extrieures de l'UE programmes pour 1995-1999, contre environ 10 '7r
au dbut des annes quatre-vingt-dix. Par ailleurs, les crdits taient doubls
par habitant: 2 cus par an et par habitant au dbut des annes quatre-vingtdix, 4,1 cus pour la priode 1995-1999.
Une telle aide allait rapidement s'avrer, y voir de prs, trs limite.
Elle quivaut 0,4 % du PIE des pays de la Mditerrane Est et Sud (22) (l'aide
reue par le Portugal, titre d'exemple, a reprsent 4 (70 de son PIB et a couvert
jusqu'au quart des dpenses publiques). Elle reprsente, pour une population
Est et Sud mditerranenne estime prs de 227 millions d'habitants, une
aide par an et par habitant trois fois moins importante que celle destine aux
Pays d'Europe Centrale et Orientale (12,2 dollars par an et par habitant).
Il apparaissait d'emble que l'enveloppe financire europenne ne pouvait
avoir qu'une fonction rsiduelle d'accompagnement par rapport des besoins en
financements autrement plus consquents que requiert la mise niveau des
tissus productifs des Pays du Sud et de l'Est de la Mditerrane. La programmation ME DA pour le Maroc, au regard de l'estimation du ministre marocain
du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat en besoins de financements pour
l'industrie, allait confirmer un tel constat.
1221 BExsmOl'N ilsabellel et
Paris, Economica, 1996, p. 12fi.
CHE\:~LLIER
(Agns), Europe-Mditerrane le pari de l'ouverture.
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
81
Les besoins en financements de la restructuration industrielle ont t estims, dbut
1996, par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, quelque 45 milliards
de dirhams (environ 25 milliards de FF), mobiliser sur une priode de cinq ans.
L'estimation ne concerne, il faut le prciser, que les besoins directement lies au secteur
industrieL L'essentiel de ces fonds serait destin financer, scIon le MelA: l'infrastructure
de base ncessaire au dveloppement industriel (40 %) (achat et amnagement de terrains
industriels, construction de locaux); l'instauration d'un fonds de mise niveau (40 'l) ; et
la promotion de l'investissement europen au Maroc (15,6 'le). Le reste allant des actions
telles que: l'assistance de la PMI, le dveloppement de l'infrastructure technologique
(laboratoires d'essais et de contrle, centres techniques industriels, systme d'information ... ), le dveloppement de la certification, normalisation, accrditation et mtrologie.
Eu gard cette estimation des besoins en financements de restructuration, que
reprsente l'apport europen? Le programme MEDA-Maroc a t arrt en avril 1996,
suite la visite au Maroc de Manuel Marin, vice-prsident de la Commission europenne.
Le Maroc bnficiera ainsi d'une enveloppe totale de 450 millions d'cus sur trois annes
(1996-1998), soit environ 5 milliards de dirhams, sous forme de subventions du budget de
la Communaut. Cette enveloppe devrait servir au financement du dveloppement du
secteur priv hauteur de 185 millions d'cus (41 'le); un appui l'ajustement structurel
de l'ordre de 120 millions d'cus (26,7 %) ; enfin un meilleur quilibre socio-conomique
(infrastructure sociale, ducation, dveloppement rural...) pour environ 155 millions d'cus
(34,4'7r J. A une telle enveloppe devraient s'ajouter 300 millions d'cus sous forme de prts
de la Banque europenne d'investissement (23). L'enveloppe ME DA-Maroc peut apparatre
comme consquente par rapport aux quatrimes protocoles (278 millions d'cus sur la
priode 1992-96). A quelques nuances prs:
- Les protocoles financiers (qui n'expirent que fin octobre 1996) coexistent en
1995-1996 avec le programme MEDA; autrement dit les 450 millions d'cus prvus pour
la priode 1996-1998 incorporent en fait un reliquat non consomm des quatrimes
protocoles, qui a t utilis en 1996 pour lancer le centre de services Euro-Maroc
entreprises, en attendant le dblocage des fonds ME DA retard, dbut 1996, par un veto
grec et l'affaire de la vache folle.
- Les dpenses inscrites dans le Programme MEDA, la diffrence des protocoles
financiers - dont les dpenses taient obligatoires (DO) et non soumises la rgle de
l'annualit budgtaire (les fonds restaient disponibles pendant cinq ans jusqu' puisement des engagements) - sont des dpenses non obligatoires (DNOJ; autrement dit, tout
crdit non engag la fin de l'anne budgtaire, soit avant le 15 dcembre, est annul. Le
caractre de dpenses non obligatoires des engagements du programme MEDA peut tre
considr comme un recul par rapport aux mcanismes des anciens protocoles financiers.
- Le Programme MEDA n'ayant t lanc que le 23 juillet, l'anne 1996 a de fait
t une anne blanche (24).
- Mais surtout, les procdures et rglements de la ligne budgtaire MEDAsont des
plus complexes, elles sont encore mconnues, leur gestion est minemment bureaucratique
et les dlais de dcaissement des fonds excessivement longs.
Ainsi, sur les 450 millions d'cus prvus par ME DA-Maroc sur la priode 1996-1998,
le programme d'appui au secteur priv, approuv fin dcembre 1996, prvoit un
financement de l'ordre de 185 millions d'cus. Le programme est ainsi ventil: 23 millions
d'cus (12,4 o/c) pour le centre de services Euro-Maroc entreprises; 45 millions d'cus
(24,3 %) pour le capital-risque; 38 millions d'cus (20,5 %) pour la formation technique et
professionnelle; enfin 71 millions d'cus (39 %') pour la rubrique autres ", comprenant une
(23) Le financement MEDApour le Maroc, objectifs et moyens, in Lettre du Centre Marocain de
Conjoncture, nO 58, dcembre 1996, p. 11-14, et Communiqu de presse de la Dlgation de la
Commission Europenne au Maroc du 5 avril 1996.
(24) Rglement (CE) nO 1488/96 du Conseil du 23 juillet 1996 relatif des mesures d'accompagnement financires et techniques (MEDA) la rforme des structures conomiques et sociales dans le
cadre du partenariat euro-mditerranen.
82
LARABI JADI ET FOUAD ZAM
srie d'actions (normalisation-qualit, appui technique la promotion des exportations,
la privatisation, soutien aux PME et aux micro-entreprises). Le crdit ,. CharnaI fait l'objet
d'un financement part: 7 millions d'cus (soit 3,9 91.).
Les fonds MEDA apparaissent ds lors comme ce qu'ils sont en ralit: une goutte
d'eau dans un ocan de besoins. L'appui europen au secteur priv (2 milliards de dirhams)
correspond moins de 5 % des besoins de financements en restructuration tels qu'estims
par le ministre marocain du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. A supposer qu'un
montant additionnel soit adjoint pour 1999 et que les fonds soient absorbs dans leur
intgralit, l'apport europen ne saurait en aucune manire dpasser 7 10 % des besoins.
L'UE n'est par ailleurs pas dispose financer au Maroc, et en gnral dans le cadre du
programme MEDA, un quelconque "fonds d'appui la restructuration industrielle",
considrant qu'une aide directe la restructuration de certaines activits industrielles
constituerait une entorse la concurrence. L'essentiel des fonds europens destins
appuyer le secteur priv (72 % des fonds allous) servira par consquent financer des
actions caractre horizontal touchant l'ensemble des entreprises, dans le cadre d'une
" stratgie-programmes (soutien la qualit, la normalisation, la formation, appui
technique la promotion des exportations et des investissements, la privatisation, la
rforme du service public et au diagnostic). En dfinitive, le Programme ME DA laisse
quasiment entire la problmatique du financement de la mise niveau de l'industrie
marocaine.
L'investissement tranger, quel apport la mise niveau industrielle?
L'investissement priv tranger, notamment sous la forme d'investissement direct, lorsqu'il est massif et qualitativement cibl , peut participer la
modernisation d'un tissu industriel et contribuer sa mise niveau. Il peut,
certaines conditions, notamment lorsqu'il est orient vers des branches il valeur
ajoute leve, exercer des effets d'entranement positifs en matire d'organisation de la production, de transfert de savoir-faire technique, de participation
l'quilibre de la balance commerciale, etc.
Le Maroc a drain, depuis le milieu des annes quatre-vingt, un flux
d'investissements trangers croissant. Une telle croissance est concomitante
des rformes entreprises dans le cadre de la politique d'ajustement structurel
(PAS). La programme de privatisations effectif depuis le dbut des annes
quatre-vingt-dix y a sans doute galement contribu. Ce flux provient pour
l'essentiel - entre les deux-tiers et les quatre-cinquimes selon les annes - de
pays membres de l'Union europenne.
Le flux d'investissements trangers privs s'inscrit, au Maroc, dans une fourchette
moyenne annuelle allant de 400 500 millions de dollars (la Malaisie reoit de 4 5
milliards de dollars selon les annes). Il ne dpasse que trs rarement ce niveau. Aprs
avoir atteint un pic de 600 millions de dollars en 1994, le flux semble mme s'essouffler
au cours des deux dernires annes (1995-1996), pour se situer aux alentours de :350 400
millions de dollars. Les investissements trangers privs (IPE) ne reprsentent par ailleurs
qu'une faible part de l'investissement direct global (la FBCF) : une part qui a pu atteindre
prs de 10'!r environ en 1993, mais qui tourne en gnral autour d'une moyenne de 7 'Ir.
Rapports au PIB, les IPE reprsentent trs peu: 2,2 % en 1993, 1,8 '7,. en 1994 et 1,4 '1, en
1995. C'est dire le faible effet d'entranement qu'exerce l'investissement tranger dans un
pays comme le Maroc.
Le Maroc ne se trouve manifestement pas dans une zone - la Mditerrane Sud globalement attractive aux IDE. L'essentiel des flux croissants d'IDE destination des PED
s'oriente en direction de l'Asie en dveloppement et dans une moindre mesure vers
l'Amrique latine. Le Maroc ne fait pas partie de la dizaine de pays composant la short list
des pays les plus attractifs aux IDE (Chine, Singapour, Mexique, Malaisie, Brsil, les
Bermudes, Hong-Kong, Argentine, Thalande et gypte).
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
83
En dfinitive, la contribution europenne, qu'elle soit directe (Programme
MEDA) ou indirecte (sous forme d'investissements), ne saurait tre que
rsiduelle. Au del du fonds MEDA, des prts BEI, et de tous autres apports
extrieurs, sans doute ncessaires, la mise niveau est d'abord une affaire de
mobilisation des sources de financement internes. Le systme bancaire et
financier marocain est, qu'on le veuille ou non, en premire ligne dans une telle
tche. Dans quelle mesure peut-il l'assumer?
La mobilisation des ressources financires internes: le systme
financier marocain l'preuve de la mise niveau
Un systme financier en gestation
Depuis le dbut des annes 90,
vritablement en chantier. Une srie de
concerne la foi le systme bancaire, le
capitaux. La dernire en date a mis
domestique.
le systme financier marocain est
rformes a t mise en uvre, qui
march montaire et le march des
en place un march des changes
- La loi bancaire de juillet 1993 s'est donn comme objectifs de dcloisonner le
systme bancaire (longtemps compartiment entre banques commerciales et organismes
financiers spcialiss) par une unification du cadre juridique (universalisme), d'introduire
la concurrence dans le secteur, d'instaurer des normes prudentielles et de mettre en place
un cadre de concertation de la politique montaire et financire (le Conseil national de la
monnaie et de l'pargne).
- La loi sur le march boursier de septembre 1993 a permis de mettre progressivement en place les quatre intervenants du march des valeurs mobilires: le Conseil
dontologique des valeurs mobilires (CDVM, quivalent en France de la Commission des
Oprations de Bourse, COB), responsable de la rglementation, de l'organisation du march
et de la dfense des intrts des investisseurs; la Socit de bourse des valeurs de
Casablanca (SBVM), socit prive charge de grer la bourse de Casablanca, appartenant,
parts gales, l'ensemble des socits de bourse; les Socits de bourse, intermdiaires
agrs bnficiant du monopole de ngociation des valeurs mobilires, spcialises dans
l'intermdiation, la gestion de portefeuille et la conservation des valeurs mobilires; enfin
les organismes de placement collectifs des valeurs mobilires (OPVCM) ayant la forme de
SICAV ou de FCP.
- La rforme du march montaire, c'est--dire celle du march des capitaux court
et moyen termes (march interbancaire, march de titres de crances ngociables) est la
moins avance.
- La trs rcente rforme du march des changes a permis la cration d'un march
interbancaire des changes domestiques qui a dmarr le 1cr juin 1996.
Les objectifs assigns la rforme du systme financier (mobiliser l'pargne
domestique, dynamiser les systmes d'intermdiation financire et attirer les capitaux
trangers) ont-ils t atteints?
Il est sans doute trop tt pour rpondre de manire catgorique une telle question.
Le recul dans le temps n'est pas suffisant. La plupart des rformes mises en chantier n'ont
pas encore eu vritablement le temps de gnrer leurs premiers effets. Il est temps
cependant de procder une premire valuation.
Un mmorandum conomique de la Banque Mondiale, dat de juin 1996, sur le
Maroc tablissait le diagnostic suivant sur le systme financier marocain: Les tudes
internationales ont dmontr qu'il existe de fortes corrlations entre la croissance et le
dveloppement du secteur financier. .. Au Maroc, bien que les rformes effectues dans le
pass aient abouti un assouplissement des contrles du prix du crdit et de son allocation,
l'tablissement d'un cadre rglementaire solide pour le secteur bancaire et la promotion
84
LARABI JADI ET FOUAD ZAIM
d'unf' bourse de valeurs, laquelle les privatisations ont imprim un lan, il reste encore
beaucoup faire. Le secteur financier du Maroc ne prte pas encore les services ncessaires
dans la mesure qu'exige une croissance plus forte et durable (25).
L'implication du systme bancaire dans le financement de la mise niveau
industrielle
La restructuration industrielle suppose la mobilisation de capitaux
importants qui mettent le secteur bancaire en position d'acteur majeur. A
l'heure de la mise niveau, les entreprises ont d'abord besoin de financement.
Une enqute rcente auprs d'un panel d'entreprises ralise par l'Observatoire
de la comptitivit de l'conomie marocaine a rvl que l'accs au crdit et le
cot du crdit apparaissent comme la principale entrave la croissance des
entreprises, en particulier les PMEIPMI.
En effet, quelques annes aprs la promulgation de la nouvelle loi bancaire, la
concurrence entre les banques sur les taux d'intrt dbiteurs n'est pas effective. En fait,
tout se passe comme si les banques" concoctaient", travers leur groupement un taux
d'intrt dbiteur" officieux" uniforme, le GPEM fonctionnant en effet comme un vritable
cartel de banques" organisant la concurrence" sur la base de "recommandations en
matire de niveau des taux d'intrts dbiteurs. Les banques regroupes dans le GPEM
justifient un tel tat de fait par: la n~ntabilit de leurs fonds propres qui serait en de de
la norme internationale, autour de 100/,.; le cot de leurs ressources autour de 7,6'/r; la
faiblesse de la marge d'intermdiation (2,5 3,2 '!c); les pressions qu'exercent les rserves
montaires sur le cot de l'intermdiation; le niveau de l'inflation (5 60/, en moyenne) et
la ncessit de rmunrer correctement l'pargne; le niveau des taux du trsor et l'effet
d'viction; le poids de leurs crances litigieuses (les dotations pour crances en souffrances.
rapportes au produit net bancaire, sont 19,5 '!c); enfin le taux exceptionnel de l'impt
sur les socits qu'elles payent (39,6 'Ir:).
En fait, la libralisation ne s'est pas traduite par une vritable concurrence sur les
taux d'intrt dbiteurs. Les taux d'intrt ont rarement t aussi rigides que depuis qu'ils
ont t lib(~raliss. Le niveau des taux d'intrt dbiteurs, en moyenne autour de 11-12 'Ir
(ils atteignent 13,5'7r pour les crdits aux PME) est trop lev; mme avec une inflation
de 5 6'k en moyenne annuellement, les taux d'intrt rels (de 5 il 6 7r) sont excessifs;
une conCUlTence saine les ferait baisser immanquablement. Les profits des banques de
dpt marocaines par rapport aux fonds propres sont nettement plus levs que dans les
pays de l'OCDE. Les cots de gestion (de 2,5 o/c 3,9 % du total des emplois) sont lgrement
suprieurs il la norme internationale. La marge entre le taux de rmunration des dpts
et celui des crdits (qui atteint cinq points) est souvent abusive. Les commissions bancaires
sont souvent excessives et peu transparentes. Enfin les garanties exiges par les banques
sont de plus en plus lonines. En dfmitive, la nouvelle loi bancaire n'a pas encore induit
la concurrence escompte sur les taux d'intrt dbiteurs. L'accs au crdit et le cot de
celui-ci demeurent des entraves il la restructuration industrielle.
March des capitaux et mise niveau industrielle
La diversification des sources de financement de l'entreprise est sans
doute un des enjeux majeurs des annes venir. Une telle diversification passe
par le dveloppement du march des valeurs mobilires. Le march boursier
peut-il devenir une alternative l'intermdiation bancaire, quelles conditions?
(251 Une croissance plus farte, des opportunits d'emploi, Les choix f'oire pOlir le Marne.
Mmorandum conomique, Division des oprations gographiques l, Dpartement Maghn'b et Iran,
Document de la Banque Mondiale.
85
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
La bourse de Casablanca connat un rel essor. Depuis la rforme de 1993, l'activit
boursire enregistre une croissance remarquable. Les nouvelles structures (CDVM, SBVM,
Socits de bourse) se sont mises en place. Les OPCVM ont atteint le nombre de 33 en
1996. La capitalisation boursire a t multiplie par quatre depuis 1992, pour atteindre
prs de 75 milliards de dirhams (9 milliards de dollars) (26) ; elle reprsentait en 1991, 6 %
du PIB, elle en reprsente 26 % en 1996. Le volume des transactions est pass de 1,05
milliard en 1992 plus de 20,6 milliards en moyenne en 1995-96. La transparence de la
part des entreprises cotes devient la rgle: 98 % des entreprises cotes ont publi leurs
informations financires au titre du premier semestre 1996. Un systme de cotation
lectronique vient de se substituer au march la crie (" la corbeille). Enfin la bourse
de Casablanca a t introduite l'indice IFC des pays mergents.
Evolution des principaux indicateurs de la bourse des valeurs de Casablanca
Indicateur
__
~2
._~
1
1
1993
1994
---
1995
1996
47
68
65
61
44
Capitalisation boursire au 31 dc.
en millions de DR
17510
25993
39825
50401
Capitalisation boursire en %. PIB
7,3
10,5
1052
4870
Nombre de socits cotes
[VolUme d" 'CliU,"CUOO'
Indice gnral ~e
i-----
75582
201.88
259.78
1: bourse des valeurs'-+----+
Masse des dividendes distribus
en millions DR
715
878
Source: Socit de la bourse des valeurs de Casablanca, Statistiques 1996.
Une telle croissance ne doit pas cependant voiler les nombreuses faiblesses:
Le nombre d'entreprises cotes demeure trs bas: 47 entreprises la fin dcembre
1996, Un mouvement d'assainissement entrepris en 1995 s'est sold par la radiation de 18
socits pour non-respect des obligations d'information; le march a gagn en transparence
mais le nombre des socits cotes est pass de 61 44 en 1995, Quatre nouvelles
entreprises ont intgr la BVC en 1996, trois privatises (Samir, Fertima, Sonasid) et une
socit prive (Crdor), tandis qu'une entreprise a t radie de la cote, portant le nombre
d'entreprises cotes 47 fin dcembre 1996.
Le march boursier souffre d'un manque structurel d'offre de titres et de la fluidit
des titres. La bourse est ainsi dope essentiellement par les entreprises privatises: deux
entreprises prives peine (Crdor en 1996 et Maroc Leasing en 1997), depuis la rforme
du march des capitaux en 1993, ont t cotes; le dynamisme de la bourse risque de
s'essouffier mesure que s'puiseront les opportunits de privatisations.
La structure sectorielle de la cote rvle de surcrot la prdominance des
tablissements bancaires (37 % de la capitalisation boursire) et des socits de portefeuille
(22 %). La bourse des valeurs est domine par les banques et les institutions financires,
d'investissement et de portefeuille; mme les socits de bourse sont pour la plupart des
filiales de banques. Avec une vingtaine de socits et 13,5 % du volume d'affaires sur les
actions cotes, le secteur industriel est peu reprsent (0,3 % de l'effectif et 7 % de la valeur
ajoute des entreprises prsentes dans les 18 branches de l'industrie manufacturire),
Cette structure est par ailleurs fortement concentre dans l'agro-alimentaire (12 % de la
capitalisation boursire) et les cimenteries (8 %).
(26) Socit de la bourse des valeurs de Casablanca, Statistique, 1996.
86
LARABl JADI ET FOUAD ZAM
L'entreprise non financire demeure en gnral frileuse vis--vis du march des
valeurs mobilires: les entreprises dsirent certes avoir des crdits moindre prix, mais
en demeurant fermes. La crainte des actionnaires fondateurs de perdre le contrle de leur
entreprise, les obligations qui dcoulent de la cotation (transparence de la gestion et des
comptes, augmentation du capital, soumission au contrle des autorits du marche ... )
expliquent une telle timidit.
En dfinitive, tout se passe comme si les acteurs principaux du systme
financier - l'tat, les banques, les entreprises - avaient quelques difficults
s'adapter aux nouvelles rgles du jeu, jouer vritablement le jeu de la
libralisation et de la concurrence. L'tat, en butte ses dficits, continue par le
biais du Trsor de ponctionner de manire encore significative l'pargne,
contribuant au maintien de taux d'intrt levs. Il a nanmoins fait quelques
efforts rcemment en diminuant deux reprises les taux des bons du trsor. Les
Banques, qui se font peut tre difficilement l'arrive d'un nouvel acteur, la
bourse, qui rompt une relation traditionnelle banques-entreprises longtemps
"balise ", donnent l'impression de ne pas jouer vritablement le jeu de la
concurrence et de "s'entendre sur les taux d'intrt. Enfin les entreprises, qui
souvent vilipendent les banques et le niveau des taux d'intrt, mais rechignent
encore, en gnral, jouer le jeu de la transparence et ouvrir leur capital.
En conclusion, la question du financement reste sans doute, un moment
o s'amorce le processus de dsarmement tarifaire conscutif au nouvel accord
d'association UE-Maroc, le point d'achoppement principal de la problmatique
de la mise niveau de l'industrie marocaine. Les financements externes n'ont
pas la dimension suffisante pour faire des apports significatifs au processus de
restructuration industrielle. L'enveloppe MEDA-Maroc est certes non ngligeable, fondamentalement ncessaire, mais sans doute rsiduelle au regard des
besoins considrables en financement de restructuration; l'accessibilit aux
financements MEDA n'est pas toujours vidente; enfin le programme MEDAMaroc privilgie, dans le cadre d'une stratgie-programmes, des actions
caractre horizontal au dtriment d'un soutien plus cibl et plus direct la
restructuration industrielle. Les investissements trangers n'arrivent pas
encore, dans une rgion du monde globalement peu attractive aux IDE,
atteindre la "masse critique mme de leur permettre de contribuer la
modernisation du tissu productif industriel et d'exercer des effets d'entranement perceptibles sur la croissance.
La mise niveau de l'industrie marocaine passe donc principalement par
la mobilisation des sources de financement internes. Le systme financier
marocain est amen tre l'acteur principal d'une telle entreprise. Il est pour
l'instant, et depuis le dbut des annes quatre-vingt-dix, en chantier: nouvelle
loi bancaire, rforme du march montaire, rforme du march des capitaux,
libralisation du march des changes. Mais les retombes de telles rformes ne
sont pas toujours la hauteur des rsultats escompts. La nouvelle loi bancaire
n'a pas induit la concurrence attendue sur les taux d'intrt dbiteurs; l'accs
au crdit et le cot de celui-ci demeurent des entraves il la restructuration
industrielle. La bourse des valeurs a certes connu de son ct, au cours des trois
dernires annes, un essor remarquable, stimule qu'elle a t par la mise en
place d'un nouveau cadre institutionnel et de nouvelles rgles du march
boursier; mais elle demeure pour l'essentiel anime par le programme de
privatisations. Rares sont les entreprises prives qui se dcident franchir le
L'INDUSTRIE MAROCAINE FACE AU DFI DU LIBRE-CHANGE
87
pas de la cotation, Les entreprises, sous-capitalises, surendettes, sous-encadres, caractre souvent familial, rechignent encore emprunter la voie de la
transparence en matire de comptes et de gestion en ouvrant leur capitaL Le
march des capitaux ne constitue pas encore une alternative srieuse
l'intermdiation bancaire.
BIBLIOGRAPHIE
DIlvIEGLIO (W.), 1994. - Les conditions d'un partenariat industriel entre la France et les
pays du Maghreb, la France et les pays d'Europe Centrale et Orientale. Rapport
Dimeglio, mars 1994.
Banque Mondiale, 1993. - Rapport sur le dveloppement de l'industrie prive au Maroc.
Volume 1, Annexe 4, (septembre 1993).
Banque Mondiale, 1994. - Royaume du Maroc. Rpublique de Tunisie. Rapport sur la
croissance de l'exportation. Dterminants et perspective, mai 1994.
L'acte d'investissement: Missions et prrogatives de l'Agence. Lettre du Centre Marocain
de Conjoncture (60), janv.-fv. 1997.
Le fonds de mise niveau: un instrument d'appui aux stratgies sectorielles. Lettre du
Centre Marocain de Conjoncture (50), fvrier 1996.
Enqute nationale sur l'encadrement de l'entreprise prive marocaine. Conseil National de
la Jeunesse et de l'Avenir, 1995.
Accord euro mditerranen tablissant une association entre les Communauts europennes et leurs tats membres, d'une part et le Royaume du ,'vIaroc d'autre part.
Dlgation de la Communaut europenne. Rabat.
JAD! (L.), 1994. - La zone de libre-change Union Europenne-Maroc: impact du projet
sur l'conomie marocaine. Cahiers du GMDEV (22), octobre 1994.
JADI (L.) et ZAlvI (F.), 1996. - L'Union europenne et la Mditerrane, une nouvelle
gnration d'accords?, in : Annuaire de la Mditerrane, dition 1997, GERMlPublisud, p. 96-128.
Le Maroc comptitif. Rapport prpar par les bureaux d'tudes DRLFOCS.Crargie
Maroc. Volume 1, septembre 1995.
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, 1996. - Stratgie de dveloppement industriel moyen terme, 1996-2000, mars 1996.
Ministre du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat, 1996. - Accord MarocUE.
Mesures d'accompagnement, Volet industriel.
PORTER (M.E), 1993. - L'avantage concurrentiel des nations. InterEditions.
ZAllvI (F.) et JAlD! (L.), 1995. - La dynamique des investissements en Mditerrane, in R.
BISTOLFI, dir., Euro-Mditerrane, une rgion construire, Publisud, p. 289-331 et
tableaux.
Vous aimerez peut-être aussi
- Chapitre 2 E&S CorrectionDocument8 pagesChapitre 2 E&S Correctionbertrandbertrand2121Pas encore d'évaluation
- Cours Complet Tci 1ere Annee 2023Document60 pagesCours Complet Tci 1ere Annee 2023Innocent BIA100% (2)
- Corrige Des Exercices MarketingDocument9 pagesCorrige Des Exercices MarketingAmi Coeur100% (5)
- Diagnostic de RabatDocument114 pagesDiagnostic de RabatChaimaa KattiPas encore d'évaluation
- Cours Marketing CompletDocument77 pagesCours Marketing ComplethyrrohPas encore d'évaluation
- La Bourse Et Le Financement Des EntreprisesDocument1 pageLa Bourse Et Le Financement Des EntreprisesAmi CoeurPas encore d'évaluation
- M17 Marketing Strategique AGC TSGEDocument88 pagesM17 Marketing Strategique AGC TSGEhassoube80% (5)
- Marketing International 2023Document76 pagesMarketing International 2023Farah elyounssy100% (1)
- Chapitre 2 - Le BilanDocument6 pagesChapitre 2 - Le Bilanopen0% (1)
- Annexe 5 DECLARATION D'EMPLOYEUR V2016Document3 pagesAnnexe 5 DECLARATION D'EMPLOYEUR V2016Imen TroudiPas encore d'évaluation
- Cadre Strategique National EntrepreneuriatDocument29 pagesCadre Strategique National EntrepreneuriatMichel DonvidePas encore d'évaluation
- Fiche de Cours 3Document4 pagesFiche de Cours 3fatyPas encore d'évaluation
- EuroclearDocument1 pageEurocleare7pagamentosPas encore d'évaluation
- Congo HDR SynthesisDocument129 pagesCongo HDR SynthesisAstan SmithPas encore d'évaluation
- Problèmes Économiques Et Sociaux Semestre 3Document27 pagesProblèmes Économiques Et Sociaux Semestre 3Oussama AoudiPas encore d'évaluation
- Coûts Préétablis TDDocument25 pagesCoûts Préétablis TDHamed BabaPas encore d'évaluation
- Fonction AchatDocument19 pagesFonction Achatsnpooo100% (2)
- Le Courant-Libérale ClassiqueDocument32 pagesLe Courant-Libérale Classiquehamza100% (1)
- Descriptif Technique Pelle Hydraulique Poids en Ordre de MarcheDocument12 pagesDescriptif Technique Pelle Hydraulique Poids en Ordre de MarcheLiebherrPas encore d'évaluation
- Annuaire Administratif Du Cameroun Mars 2011Document160 pagesAnnuaire Administratif Du Cameroun Mars 2011Eyock Pierre100% (4)
- Administrateur Charge de La Logistique NOA - 18 MarsDocument3 pagesAdministrateur Charge de La Logistique NOA - 18 MarsUNICEFGuineaPas encore d'évaluation
- EY Plaquette Recrutement 2015Document32 pagesEY Plaquette Recrutement 2015Dylan SlhtPas encore d'évaluation
- Xerfi La Restauration Collective Face À La CriseDocument326 pagesXerfi La Restauration Collective Face À La CrisemimaultPas encore d'évaluation
- Intelligence Économique 2Document23 pagesIntelligence Économique 2Islam El OusroutiPas encore d'évaluation
- Support D'exposéDocument17 pagesSupport D'exposéMourad El ArchiPas encore d'évaluation
- Les RecettesDocument3 pagesLes RecetteshamzanzenPas encore d'évaluation
- Choix Du Régime de Change Et Croissance ÉconomiqueDocument24 pagesChoix Du Régime de Change Et Croissance ÉconomiqueAbderrazak OualiPas encore d'évaluation
- Memoire CharlotteDocument97 pagesMemoire CharlotteSoumana Abdou100% (1)
- Les Accords de Libre-Échange Conclus Par Le MarocDocument13 pagesLes Accords de Libre-Échange Conclus Par Le MarocYoussef Hafdani63% (8)
- S6 - Circuit Économique (Commerce Extérieur)Document53 pagesS6 - Circuit Économique (Commerce Extérieur)Bình MinhPas encore d'évaluation
- Mercantilistes e TphysiocratesDocument3 pagesMercantilistes e TphysiocratesYousra ZrPas encore d'évaluation
- Marché MonétaireDocument52 pagesMarché Monétaireissam26Pas encore d'évaluation
- Serie 100 200 FRDocument21 pagesSerie 100 200 FRMohamed KhaldiPas encore d'évaluation
- Compte Rendu Projet ConceptionDocument7 pagesCompte Rendu Projet Conceptionyassine ELgharbiPas encore d'évaluation