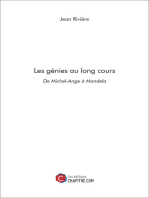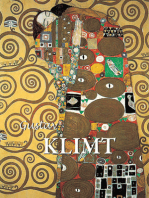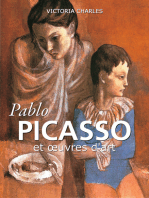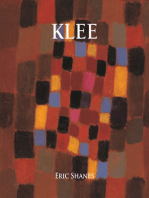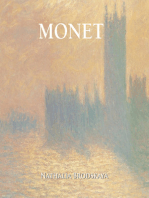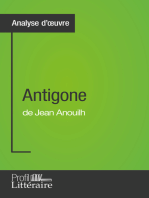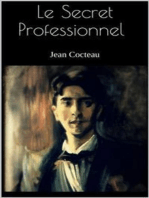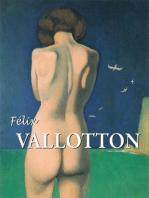Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Syllabus Histoire Approfondie C2B1 - 2018-2019 - 2e Partie PDF
Transféré par
PierreFontenelleTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Syllabus Histoire Approfondie C2B1 - 2018-2019 - 2e Partie PDF
Transféré par
PierreFontenelleDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Groupe des Six
Ayant grandi au milieu de la débâcle wagnérienne et commencé d’écrire parmi les ruines du debussysme, imiter
Debussy ne me paraît plus aujourd’hui que la pire forme de la nécrophagie. Depuis, nous avons eu le cirque, le
music-hall, les parades foraines et les orchestres américains. Comment oublier le Casino de Paris, ce petit cirque,
boulevard Saint-Jacques, ses trombones, ses tambours. Tout cela nous a réveillés.
C’est ainsi que le compositeur Georges Auric, dans le premier numéro de la revue Le Coq, allait exprimer la
nécessité d’un renouveau artistique au début des années 1920. Ce mouvement ne concerne pas que les seuls
musiciens. Tout un groupe d’écrivains, de peintres et d’intellectuels s’est déjà rallié autour du poète Jean Coc-
teau, le rassembleur. Touche-à-tout et avant-gardiste, Cocteau fréquente les Ballets russes dès 1910. Passionné
par l’œuvre de Stravinsky, il prend parti contre les détracteurs du Sacre du Printemps et, surtout, se lie avec Erik
Satie, dont l’originalité du style et l’engagement auront un impact profond sur ses idées. Car avant même que
les Six ne soient officiellement lancés par Cocteau et le critique musical Henri Collet, en janvier 1920, Satie
avait déjà révélé les signes de la nouvelle tendance, entre autres dans son ballet Parade, créé en 1917.
Avec Parade, le cirque cesse d’être seulement une attraction pour les enfants : il devient un symbole artistique.
♫ Satie, Parade
Six jeunes musiciens
En 1917, quand la plupart des salles de concert sont fermées à cause de la Première Guerre mondiale, le
peintre Émile Lejeune met son atelier à la disposition des mélomanes. Pour l’occasion, les murs sont décorés
avec des toiles de Picasso, Matisse, Léger, Modigliani, etc. Le programme est composé de pièces de Satie, Ho-
negger, Auric et Durey. C’est ce concert qui donne à Satie l’idée de réunir un groupe autour de lui, « Les Nou-
veaux jeunes », embryon du futur « Groupe des Six ».
À peine sortis du conservatoire, six jeunes compositeurs ont en effet coutume de se retrouver tous les same-
dis soirs dans un petit restaurant parisien. Mais Darius Milhaud (1892-1974), Francis Poulenc (1899-1963),
Arthur Honegger (1892-1955), Georges Auric (1899-1983), Louis Durey (1888-1979) et Germaine
Tailleferre (1892-1983) ne sont pas seuls. Les pianistes Marcelle Meyer et Juliette Meerovitch, le chanteur
russe Alexandre Koubitzky, les peintres Marie Laurencin, Irène Lagut et Valentine Gross-Hugo, sans oublier les
écrivains Lucien Daudet, Raymond Radiguet et, bien sûr, Jean Cocteau, y sont aussi.
Après le dîner, le groupe des « samedistes » se rend à la Foire du Trône ou va admirer les mimes des frères
Fratellini au cirque Médrano. Les soirées se terminent chez Darius Milhaud ou au bar Gaya pour écouter Jean
Wiéner jouer de la musique « nègre ». Cocteau lit ses derniers poèmes. Milhaud et Auric, rejoints par Arthur
Rubinstein, jouent Le Bœuf sur le toit à six mains. Cette pièce de Milhaud, créée en 1920 au Théâtre des
Champs-Élysées avec la présence sur scène des fameux frères Fratellini, va devenir le morceau à succès des
« samedistes ». Si bien que le propriétaire du fameux bar Gaya donne à son nouveau restaurant rue Boissy-
d’Anglas le nom de « Bœuf sur le toit ». Les autres œuvres phares du groupe à l’époque sont Adieu New York
de Georges Auric et Cocardes de Francis Poulenc.
Achevée le 21 décembre 1919, il s’agit à l’origine d’une pièce pour violon et piano intitulée Cinéma-fantaisie et
destinée à accompagner un film muet de Charlie Chaplin. Milhaud la transforme en ballet-pantomime sur la
suggestion de Jean Cocteau qui en écrit l’argument. Les décors et cartonnages sont créés par le peintre Raoul
Dufy. Le titre comme la musique sont inspirés d’une ancienne chanson brésilienne – pays que fréquenta le
compositeur – nommée « O boi no telhado ». Le refrain revient près de quatorze fois dans douze tonalités
différentes. « Farce » surréaliste, dans l’esprit des Mamelles de Tirésias, pièce de Guillaume Apollinaire (que
Poulenc mettra plus tard en musique) ou du ballet Parade de Satie, il n’y a pas à proprement parler d’histoire.
Le décor représente un bar qui voit défiler plusieurs personnages : un bookmaker, un nain, un boxeur, une
femme habillée en homme, des hommes habillés en femmes, un policier qui se fait décapiter par les pales d’un
ventilateur avant de ressusciter... La chorégraphie était volontairement très lente, en décalage avec le côté vif et
joyeux de l’accompagnement musical. Contrairement à un ballet traditionnel, les interprètes ne venaient donc
pas de la danse mais du cirque (frères Fratellini).
♫ Milhaud, Le Bœuf sur le toit op. 58
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 27
Satie le mentor, Cocteau le porte-voix
L’opposition à Wagner et à Debussy décrite par Georges Auric dans Le Coq puis par Cocteau dans Le Coq et
l’Arlequin n’est pas nouvelle à l’époque. Satie a déjà composé Les Gymnopédies, des pièces ironiques, voire cy-
niques, empreintes d’une grande volonté de dépouillement. Trop de notes tue les notes. Il faut dire l’essentiel
en un coup de crayon. Cocteau résume ainsi l’art de Satie :
Après la franchise bariolée de Stravinsky, autre franchise toute blanche.
Satie invente une simplicité neuve. L’air transparent déshabille les lignes. La douleur ne grimace pas.
♫ Satie, Trois Gymnopédies
À la différence de ses jeunes confrères, Satie est un idéologue extrémiste. Il vit ses idées sans complaisance et
sans intransigeance, même s’il souffre de son isolement et de sa pauvreté. « Cette vie de mendigot me ré-
pugne », écrivait-il à Valentine Gross-Hugo.
Dès leur premier concert en 1917, les jeunes musiciens (qui ne sont pas encore « Groupe des Six ») invitent
Satie à jouer Parade à quatre mains avec Juliette Meerovitch. En 1918, avant un concert des « Nouveaux
Jeunes », Satie présente au public les talents de chacun des six musiciens. Mais Satie n’a pas l’aisance d’un Coc-
teau au milieu de la société parisienne.
Jean Cocteau (1889-1963), poète, écrivain, dramaturge, cinéaste, critique, dessinateur, n’a pas oublié de pla-
cer la musique parmi ses centres d’intérêt. Il collabore à d’importants spectacles musicaux, soutient les jeunes
compositeurs à partir de la Première Guerre mondiale, écrit de nombreux articles pour les défendre en même
temps qu’un art « spécifiquement français », mais il reste mélomane, pianote quelque peu sans avoir appris à
jouer. Dès l’enfance, il est impressionné par le quatuor d’amis réuni par son grand-père ; et lorsqu’il voit ses
parents partir à l’Opéra ou à la Comédie-Française, il construit un théâtre miniature grâce auquel il fait ses
premiers essais de mises en scène. Combiné à cet attrait pour le théâtre, la musique et la poésie, Cocteau
montre un intérêt tout particulier pour le monde du music-hall.
Jean Cocteau est l’archétype de l’intellectuel en ce début de siècle. Il brille d’un salon à un autre, lorsqu’il n’est
pas sur la Côte d’Azur pour mieux fuir la société parisienne qu’il hait mais dont il ne peut se passer. Il sait frap-
per aux bonnes portes pour trouver un mécène (Coco Chanel, par exemple) ou une figure importante du
paysage artistique (Serge de Diaghilev, par exemple) qui le soutiendra dans ses projets.
Après le choc qu’il subit lors de la première du Sacre du Printemps, en 1913, une autre rencontre capitale, qui
influencera profondément ses convictions sur l’avenir de la musique, aura lieu en 1915 : Erik Satie. Cocteau
trouve dans la musique de Satie ce qu’il attendait comme renouveau pour l’art musical : ils se lancent alors
ensemble dans l’aventure de Parade, rejoints par Picasso pour la réalisation des décors et des costumes.
Grâce à Satie, Cocteau rencontre les « Nouveaux Jeunes » et prend rapidement sa place, laissant à Satie le rôle
du « fétiche », du « modèle ».
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 28
Le Coq et l’Arlequin6
Les nouvelles amitiés et les conversations échangées avec la jeunesse musicale poussent Cocteau à rédiger les
aphorismes qui composent Le Coq et l’Arlequin (1918), dédié à Georges Auric :
Ce livre ne parle d’aucune école existante, mais d’une école que rien ne fait pressentir, sinon les prémices de
quelques jeunes, l’effort des peintres, et la fatigue de nos oreilles.
Dans ce livre, Cocteau présente Satie comme l’exemple d’une musique saine et juvénile, solide et droite, qui
permet d’échapper aux « pieuvres » Debussy et Stravinsky :
La profonde originalité d’un Satie donne aux jeunes musiciens un enseignement qui n’implique pas l’abandon de
leur originalité propre. Wagner, Stravinsky et même Debussy, sont de belles pieuvres. Qui s’approche d’eux a du
mal pour se dépêtrer de leurs tentacules ; Satie montre une route blanche où chacun marque libre-
ment ses empreintes.
Satie enseigne la plus grande audace à notre époque, être simple. …
Il reproche à Debussy d’avoir écrit une œuvre « wagnérienne à la française », sans force, « impressionniste » :
Debussy a dévié, parce que de l’embûche allemande, il est tombé dans le piège russe. De nouveau, la pédale
fond le rythme, crée une sorte de climat flou, propice aux oreilles myopes. Satie reste intact. Écoutez les Gym-
nopédies d’une ligne et d’une mélancolie si nettes. Debussy les orchestre, les brouille, enveloppe d’un nuage
l’architecture exquise. De plus en plus, Debussy s’écarte du point de départ posé par Satie et entraîne tout le
monde à sa suite. La grosse brume trouée d’éclairs de Bayreuth devient le léger brouillard neigeux taché du soleil
impressionniste. Satie parle d’Ingres ; Debussy transpose Claude Monet à la russe.
Debussy a joué en français, mais il a mis la pédale russe.
Il invite à se méfier de Stravinsky, après l’avoir adoré :
Le théâtre corrompt tout et même un Stravinsky. Je voudrais que ce paragraphe n’atteignît en rien notre amitié
fidèle ... Je considère le Sacre du printemps comme un chef-d’œuvre mais je découvre dans l’atmosphère créée
par son exécution, une complicité religieuse entre adeptes, cet hypnotisme de Bayreuth. Wagner a voulu le
théâtre ; Stravinsky s’y trouve entraîné par les circonstances. Il y a une marge. Mais s’i1 compose malgré le
théâtre, le théâtre ne lui en donne pas moins des microbes. Stravinsky nous empoigne par d’autres moyens que
Wagner ; il ne nous fait pas de passes ; il ne nous plonge pas dans la pénombre ; il nous cogne en mesure sur la
tête et dans le cœur. Comment nous défendre ? Nous serrons les mâchoires. Nous ressentons les crampes d’un
arbre qui pousse par saccades avec toutes ses branches. …/ Wagner nous cuisine à la longue ; Stravinsky ne
nous laisse pas le temps de dire « ouf ! », mais l’un et l’autre agissent sur nos nerfs. Ce sont des musiques
d’entrailles ; des pieuvres qu’il faut fuir ou qui vous mangent.
Cocteau vise l’avenir, il prône une nouvelle musique dans un langage rempli de métaphores qui dénoncent les
œuvres dangereuses, à ne pas imiter. Il défend « le coq français au chant pur » contre « l’arlequin des musiques
bariolées d’influences germano-slaves », et définit ainsi la musique qu’il voudrait voir naître, simple, claire, à
l’opposé des ouvrages wagnériens ou debussystes. Le poète demande d’éviter l’éclectisme qui permettrait
d’apprécier simultanément Wagner et Satie.
Je ne me dresse pas contre la musique moderne allemande. Schoenberg est un maître ; tous nos musiciens et
Stravinsky lui doivent quelque chose, mais Schoenberg est surtout un musicien de tableau noir.
C’est donc chez Satie qu’il trouve les qualités qui permettront à la musique de redevenir spécifiquement fran-
çaise : le dépouillement général, la sobriété et la simplicité tant au niveau de la technique que de l’expression :
UN POÈTE A TOUJOURS TROP DE MOTS DANS SON VOCABULAIRE, UN PEINTRE TROP DE COULEURS
SUR SA PALETTE, UN MUSICIEN TROP DE NOTES SUR SON CLAVIER.
Dans cet ordre d’idées, il demande d’employer des petits orchestres faits de solistes dont on peut identifier les
timbres, de citer des mélodies populaires, de s’inspirer du music-hall, du café-concert ou du cirque, et de cer-
ner chaque mélodie de contours nets :
Le café-concert est souvent pur, le théâtre toujours corrompu.
6
Texte intégral sur https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Coq_et_l%E2%80%99Arlequin
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 29
Il faut que le musicien guérisse la musique de ses enlacements, de ses ruses, de ses tours de cartes, qu’il l’oblige
le plus possible à rester en face de l’auditeur.
Assez de nuages, de vagues, d’aquariums, d’ondines et de parfums la nuit ; il nous faut une musique sur la
terre, une musique de tous les jours.
Ni la musique dans quoi on nage, ni la musique sur qui on danse : DE LA MUSIQUE SUR LAQUELLE ON
MARCHE.
Cocteau réclame donc du jazz, du Satie et du François Couperin à la place de Beethoven, Wagner et Debussy.
Ce recueil exprime les aspirations de toute une jeunesse lasse des excès de l’impressionnisme, groupée autour
de Satie.
Le Coq et l’Arlequin n’est pas un traité philosophique, ni le « manifeste » du Groupe des Six. Il s’agit avant tout
des idées personnelles de Cocteau sur la musique, qu’il s’était forgées au contact de la nouvelle génération de
compositeurs à la fin de la guerre. Certains jeunes, dont Poulenc et Auric, tenteront d’appliquer quelques prin-
cipes édictés et suivront l’exemple de Satie.
La création du groupe
Le 8 janvier 1920, Darius Milhaud, récemment rentré du Brésil, où il a été le secrétaire particulier de
l’Ambassadeur Paul Claudel, reçoit chez lui des critiques musicaux en vue de leur faire connaître quelques-uns
de ses jeunes collègues les plus talentueux. Cinq répondent à l’appel : Durey, Auric, Tailleferre, Poulenc et
Honegger. On fait connaissance, on bavarde, on fait de la musique. L’un de ces critiques, Henri Collet, ami de
Cocteau, également compositeur et grand expert en musique espagnole, est particulièrement impressionné.
Une semaine plus tard, le 16 janvier, il fait paraître dans la revue Comœdia un article intitulé : « Un ouvrage de
Rimsky et un ouvrage de... Cocteau : les Cinq Russes, les Six Français ». Quelques jours plus tard un second
article suit : « Les Six Français ».
Voilà donc réunis à leur insu six personnalités censées partager un même état d’esprit : une syntaxe musicale
épurée, à la fois éloignée de Wagner et de l’impressionnisme, lorgnant du côté des classiques (Bach avant tout)
comme du côté du music-hall et du jazz. Mais chacun des compositeurs développera son esthétique propre, le
groupe restant ce qu’il se voulait à l’origine : un groupe d’amis prenant plaisir à créer leurs œuvres dans les
mêmes concerts.
Cocteau se chargera de lui créer sa légende à laquelle les Six participent d’abord volontiers. Ils produisent
collectivement un recueil pour le piano, Album des Six (1920) et surtout le ballet Les Mariés de la Tour Eiffel
(1921, argument de Cocteau), qui provoque un beau tumulte. Mais Durey quitte le groupe en 1923 suite à un
désaccord à propos de Maurice Ravel.
Les Mariés de la Tour Eiffel tirent leur origine de la foire et plus particulièrement du jeu de massacre : le titre
initialement prévu était d’ailleurs La Noce massacrée. Il s’agit d’une combinaison de danse, de pantomime,
d’acrobatie, de féerie, de drame, de satire, d’orchestre et de parole, d’une farce, qui, pour la première fois, se
moque de tout ce qui semblait respectable en 1900. Cocteau veut réaliser de la poésie de théâtre et non de la
poésie au théâtre, et il trouve en chacun des musiciens une réponse à ses attentes.
Une pièce de théâtre devrait être écrite, décorée, costumée, accompagnée de musique, jouée, dansée par un seul
homme. Cet athlète complet n’existe pas. Il importe donc de remplacer l’individu par ce qui ressemble le plus à
un individu : un groupe amical. (Cocteau)
La musique des Mariés se compose de :
Ouverture ‘le 14 juillet’ (Auric)
Marche nuptiale (Milhaud)
Discours du Général et La Baigneuse de Trouville (Poulenc)
Fugue du massacre (Milhaud)
Valse des dépêches (Tailleferre)
Marche funèbre sur la mort du Général (Honegger)
Quadrille (Tailleferre)
Trois ritournelles (Auric)
Sortie de la Noce (Milhaud)
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 30
L’œuvre est créée le 18 juin 1921 au Théâtre des Champs-Élysées, par les Ballets suédois de Rolf de Maré, dans
une chorégraphie de Jean Borlin, avec des décors d’Irène Lagut et des costumes de Jean Hugo. Cette tragi-
comédie en un acte, dont l’action se passe le 14 juillet dans un restaurant sur la Tour Eiffel, déclencha un scan-
dale qui assimila les cinq compositeurs à des « disciples » de Jean Cocteau.
♫ Les Mariés de la Tour Eiffel
https://www.youtube.com/watch?v=7zc2FirtReE&list=PLlEubK-K8U8deoupUf2SvgNtM-itaj79-&index=72
https://www.youtube.com/watch?v=skMfuIG4POo&list=PLlEubK-K8U8deoupUf2SvgNtM-itaj79-&index=77
Les « Six » se retrouveront tous les dix ans au moins, pour le traditionnel anniversaire, prétexte à diverses
manifestations musicales. Malgré leurs différences, leur amitié ne faiblira jamais. Satie constatera qu’il n’y a pas
de « Groupe des Six » mais, plutôt, six musiciens. En 1923, il affirmait déjà : « Les Six sont Auric, Milhaud et
Poulenc. » Cette même année, Satie inspire un autre mouvement appelé « École d’Arcueil » : Henri Sauguet,
Maxime Jacob, Henri Cliquet-Pleyel et Roger Desormières semblent prendre la relève, mais faute d’un réel
meneur, ce second groupe sera encore plus éphémère que celui des Six.
Cocardes. Chansons populaires sur des poëmes de Jean Cocteau, de
Francis Poulenc : œuvre « fétiche » du Groupe des Six
En avril 1919, Poulenc, alors mobilisé à Pont-sur-Seine, entame la composition de son deuxième cycle de mélo-
dies. Il vient en effet de terminer les 12 pièces du Bestiaire ou Cortège d’Orphée, sur des textes d’Apollinaire. Il se
tourne à présent vers Jean Cocteau, comme il le fera encore à plusieurs reprises dans sa carrière : Le Gendarme
incompris (comédie-bouffe, 1921), La Voix humaine (tragédie lyrique, 1958), Renaud et Armide (musique de scène,
1962), La Dame de Monte-Carlo (monologue pour soprano et orchestre, 1961).
Poulenc écrit, à propos des Cocardes :
Ces chansons ont cela de particulier, à savoir que paroles et musique ont été écrites simultanément, d’où bonne
entente ; nous n’allons pas chacun dans notre sens. … C’est avant tout très Paris, atmosphère retour de courses.
Les titres vous diront tout : I. Miel de Narbonne, II. Bonne d’enfant, III. Enfant de troupe.
Ces trois chansons se situent au début de la carrière de Poulenc et, déjà, à la suite de Satie, il prône ici une
musique spécifiquement française, dépouillée de tout chromatisme wagnérien ou d’estompes sonores propres
aux impressionnistes. La simplicité et la clarté de la ligne mélodique, l’épuration harmonique et l’absence de
développements amplifiés sont les slogans de ces « nouveaux jeunes ». Ces caractéristiques se retrouvent dans
Cocardes, qui semblent bien être influencées par l’inspiration nourrie de music-hall chère à Satie. Les textes de
Cocteau s’adaptent parfaitement à cette atmosphère particulière, par l’assemblage des mots à la manière d’un
puzzle. L’instrumentation répond également au style forain suggéré par les paroles.
Le musicologue belge Paul Collaer écrira, en mai 1921 :
Les Cocardes disent tout de la mélancolie de la banlieue parisienne. Les orgues de Barbarie, les marchands am-
bulants, les terrasses des petits cafés. Toute cette misère au milieu de la poussière des routes. Cette œuvre, où se
lit la mélancolie et même le désespoir, choque souvent les auditeurs. Les Cocardes sont pourtant très claires et
logiques : elles répondent parfaitement à la question qu’elles posent.
L’œuvre est écrite pour une voix d’homme, un violon, un cornet à piston, un trombone à coulisse, une grosse
caisse et un triangle. Poulenc en réalisa également une version pour voix et piano. La création eut lieu le 21
février 1920 : Cocteau avait conçu un « spectacle-concert » avec la participation musicale de Poulenc, Auric et
Satie. Ce spectacle d’avant-garde fut donné au Théâtre des Champs-Élysées en même temps que la première
audition du Bœuf sur le toit de Milhaud.
Le vocabulaire utilisé par Cocteau dans ses poèmes se situe dans le domaine du cirque, du cabaret et du ciné-
ma. Pour ses trois textes, Cocteau utilise le même principe de composition, caractérisé par la présence de
rimes annexées (qui reprend la syllabe de rime au début du vers suivant) ; et l’ultime syllabe d’un texte renvoie
à la première syllabe du poème.
♫ Poulenc, Cocardes. Chansons populaires sur des poèmes de Jean Cocteau FP16
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 31
Francis Poulenc (1899-1963)
Francis Poulenc est né à Paris, le 7 janvier 1899, et toujours il affirma ses racines
parisiennes. Son père aime la musique, surtout celle de Beethoven, de Berlioz et
de Franck. Sa mère joue du piano, aime Mozart, Chopin, Schubert, Schumann
mais aussi Grieg et Rubinstein. La famille maternelle communique à Francis sa
passion pour tous les arts : enfant, il lit des pièces de théâtre et récite de la poé-
sie ; ses parents l’emmènent au concert. Mais Poulenc est également attiré par les
bals musettes et les guinguettes de Nogent-sur-Marne où il passe ses vacances
dans la maison familiale. Il pianote dès l’âge de cinq ans, et, trois ans plus tard, il
suit quelques cours avant d’être confié à Ricardo Viñes. Son père ne l’autorise
cependant pas à entrer au Conservatoire et Poulenc doit donc poursuivre ses
études au Lycée Condorcet, tout en apprenant par lui-même son métier de musi-
cien et de compositeur. Debussy, Schubert et Stravinsky sont les premières
amours et les influences musicales subies par Poulenc, jusqu’à sa rencontre avec
Satie, par l’intermédiaire de Viñes.
Grâce à son maître, Poulenc fait aussi la connaissance de Georges Auric, qui deviendra son complice, son
« frère jumeau ». Les deux compositeurs participent ensemble aux réunions d’artistes et défendent avec achar-
nement la musique de Stravinsky et de Satie. Avec Auric, Poulenc fréquente la librairie d’Adrienne Monnier,
« Aux amis des livres », où des écrivains comme Léon-Paul Fargue, Valéry Larbaud, André Gide, James Joyce
partagent leur amour commun de la poésie. Poulenc y fera également la connaissance de Breton, Éluard et
Aragon – futurs surréalistes. Poulenc affirmera souvent ce qu’il doit aux poètes :
Les musiciens m’apprennent la technique, ce sont les écrivains et les artistes qui me fournissent les idées [...]. J’ai
l’esprit poétique, je suis un visuel, un concret, et jamais un abstrait.
Poulenc fréquentera d’autres lieux de rassemblement d’artistes, et se retrouve alors souvent auprès des
mêmes compositeurs qui admirent Satie et Stravinsky, et qui collaborent avec Jean Cocteau, Pablo Picasso, le
chorégraphe Serge de Diaghilev et d’autres peintres et poètes. Des passerelles sont ainsi tendues entre les
différents arts grâce à la création de spectacles ou de ballets. C’est ainsi que Poulenc creuse sa place dans le
milieu parisien, en participant à ces manifestations culturelles. Diaghilev lui commande d’ailleurs la partition du
ballet Les Biches. Après le succès des Mariés de la Tour Eiffel (18 juin 1921) – qui témoigne de l’amitié entre les
compositeurs du Groupe des Six, Poulenc se décide à travailler son métier de compositeur et s’adresse pour
cela à Charles Kœchlin. Mais il complétera surtout sa formation par lui-même, en se plongeant dans les traités
et les partitions des anciens maîtres :
J’ai travaillé mon piano avec Viñes et la composition presque uniquement dans les livres parce que je redoutais
l’influence du maître. J’ai lu énormément de musique et beaucoup médité sur l’esthétique musicale. Ainsi j’ai ai-
mé de plus en plus certains auteurs et détesté d’autres. Mes quatre auteurs préférés, mes seuls maîtres sont
Bach, Mozart, Satie et Stravinsky. [...] Maintenant, point capital, je ne suis pas un musicien Cubiste, encore
moins Futuriste, et bien entendu pas Impressionniste. Je suis un musicien, sans étiquette.
Très tôt, Poulenc a donc la possibilité de travailler avec d’illustres poètes, peintres ou chorégraphes, ce qui lui
permet de se forger un langage personnel empreint de ses découvertes dans les différents arts. Dans le do-
maine pictural par exemple, il a su exploiter ce qui servait la musique ; il n’a d’ailleurs jamais cessé de rappeler
l’importance qu’il accordait à la peinture et aux artistes dont il suivait les recherches :
La peinture est, avec la musique, l’art qui me touche le plus. Ainsi, Renoir et Debussy, porte à porte, ont embelli
maintes journées où je rentrais du lycée morose et anxieux de moi-même.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 32
Poulenc, amoureux de la voix
La musique de Francis Poulenc demeure plus que toute autre attachée à la voix et au mot. Passionné de littéra-
ture, il sait choisir les auteurs les plus remarquables, souvent parmi ses contemporains, comme Cocteau, Apol-
linaire, Max Jacob, Éluard, ou Bernanos. Son objectif principal est de servir les textes de ces poètes en une
prosodie musicale fidèle, et il le fera dans les genres musicaux les plus divers, du monologue à l’opéra, de la
mélodie au chœur profane.
Poulenc, sensible à la peinture, l’était tout autant à la poésie. Le compositeur, qui travaillait très lentement, ne
pouvait réaliser une partition que s’il se sentait capable d’aborder un texte. Ses premières œuvres religieuses
par exemple n’auraient pas pu voir le jour avant qu’il n’ait été touché par son pèlerinage à Rocamadour, en
1936, où il retrouve la foi de son enfance.
Au cours de ses voyages en Europe, aux États-Unis ou dans le Nord de l’Afrique, Poulenc reçoit des com-
mandes de riches mécènes, pour des pièces instrumentales ou vocales. Dans chaque cas, il n’accepte qu’après
être sûr de pouvoir accorder les exigences de ses commanditaires à ses goûts personnels.
Dans le domaine vocal, Poulenc a composé près de 150 mélodies pour chant et piano, une bonne vingtaine
pour voix et orchestre de chambre, et une dizaine avec accompagnement de grand orchestre. À côté des mé-
lodies, il a laissé trois grands ouvrages lyriques, une comédie-bouffe (Le Gendarme incompris), un ballet avec
chant (Les Biches), et de nombreuses œuvres chorales, profanes ou religieuses, de tous les genres : chansons à
boire, chansons populaires françaises, messe a cappella, Stabat Mater, cantates, motets, prières, etc.
La mise en musique d’un texte chez Poulenc n’est jamais le fruit du hasard. Il s’est longuement expliqué à ce
sujet dans un de ses entretiens avec Claude Rostand :
Je n’ai jamais rien entrepris par préméditation esthétique […]. La transposition musicale d’un poème doit être
un acte d’amour, et jamais un mariage de raison. J’ai mis en musique Apollinaire et Max Jacob parce que j’aime
leur poésie. Voilà tout. Je n’ai jamais pu me passer de poésie […]. Ce souci [de la prosodie] vient de mon res-
pect pour les vers (réguliers ou libres). Lorsque j’ai élu un poème, dont je ne réalise parfois la transposition musi-
cale que des mois plus tard, je l’examine sous toutes ses faces. […] Je me récite souvent le poème. Je l’écoute, je
cherche les pièges, je souligne parfois, d’un trait rouge, le texte aux endroits difficiles. Je note les respirations,
j’essaye de découvrir le rythme interne par un vers qui n’est pas forcément le premier. Ensuite, j’essaye la mise
en musique en tenant compte des densités différentes de l’accompagnement pianistique. Lorsque je bute sur un
détail de prosodie, je ne m’acharne pas. J’attends parfois des jours, j’essaye d’oublier le mot jusqu’à ce que je le
voie comme un mot nouveau.
Les plus beaux témoins de sa réussite dans le domaine de la prosodie sont des hommages prononcés par deux
grands poètes :
Francis je ne m’écoutais pas, Francis je te dois de m’entendre. (Paul Éluard)
Tu as fixé une fois pour toutes la façon de dire mon texte. (Jean Cocteau)
Les relations qu’il entretint avec des poètes exigeants lui permirent d’acquérir le sens d’une prosodie nuancée
et précise. Ce respect de la prosodie le préoccupait aussi bien lors de la composition de ses mélodies que dans
ses trois grandes œuvres lyriques : Les Mamelles de Tirésias (Apollinaire, 1944), Dialogues des Carmélites (Berna-
nos, 1953-1956) et La Voix humaine (Cocteau, 1958). Poulenc choisit minutieusement les textes qu’il désire
illustrer et s’arrange pour mettre en évidence leur qualité littéraire.
Pour mon opéra Dialogues des Carmélites, j’ai créé un cahier d’essais de prosodie. La prosodie étant pour moi
le grand secret de cette aventure, je veux qu’elle soit si juste, si probante, qu’elle ne puisse être interchangeable.
J’essaye de trouver le ton sur lequel un parfait acteur, Fresnay, par exemple, lirait dans sa plus grande perfection
l’admirable texte de Bernanos.
C’est follement vocal. Je surveille chaque note, fais attention aux bonnes voyelles sur les sons aigus ; quant à la
prosodie n’en parlons pas, je crois qu’on comprendra tout. Les phrases essentielles sont presque sans orchestre.
À plusieurs reprises dans sa correspondance, Poulenc se confie à des interprètes ou des écrivains afin de leur
demander conseil dans un souci de fidélité au texte. Il abordera également ce sujet dans divers cours ou confé-
rences. Poulenc n’utilise jamais la voix comme un instrument en soi, mails il la considère toujours comme
l’agent de transmission d’un message littéraire ou poétique. C’est pourquoi il exige également de l’interprète
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 33
qu’il soit profondément pénétré du sens du texte. En mettant un texte
en musique, le dessein de Poulenc est d’en éclairer le contenu et la
signification.
Au cours de l’élaboration de ses œuvres vocales, Poulenc
pense souvent à un interprète particulier à qui il destinera la
composition. Cela le guide dans le choix de la tessiture, du
type d’accompagnement et des instruments à combiner. Ainsi,
la plupart des poèmes d’Éluard sont mis en musique pour
Pierre Bernac ; La Voix humaine et les Dialogues des Carmélites pour Denise Duval. Le compositeur est
d’ailleurs extrêmement exigeant en ce qui concerne l’interprétation de ses œuvres. De son vivant, il
n’a pas toujours apprécié les exécutions qu’il entendait et veillait autant que possible à faire savoir ce
qu’il attendait des interprètes :
Avant tout, je demande à mes interprètes de chanter, de chanter toujours, de chanter vraiment, comme s’il
s’agissait d’un lied de Schumann ou d’une mélodie de Gounod. J’aime le chant pour le chant ; c’est pourquoi je
déteste ce qu’on appelle, par un généreux euphémisme, les chanteuses intelligentes…, généralement privées de
voix. Peu m’importe la prétendue compréhension jusqu’à l’extrême des mots, si le chanteur ou la chanteuse sont
dépourvus de legato et si des insuffisances techniques brisent la ligne musicale.
Dans ses partitions, de très nombreuses indications agogiques peuvent guider les interprètes, qui doivent s’y
plier s’ils veulent rejoindre l’esprit du compositeur. Mais surtout, il préconise la lecture attentive du texte avant
l’étude d’une œuvre vocale. Le Journal de mes Mélodies est, à ce niveau, un outil précieux offert par le musicien,
pour tous ceux qui désirent respecter son art de mélodiste. Il regorge de conseils d’interprétation et de mau-
vais exemples à éviter :
J’entreprends ce Journal dans l’espoir de servir de guide aux interprètes qui auraient quelque souci de ma pauvre
musique. Je devrais écrire misérable car, telle, elle m’est apparue, chantée ainsi. […] La plupart du temps ces
dames et ces messieurs ne comprennent pas un mot de ce qu’ils chantent. […] Je suis incapable de citer actuel-
lement une seule bonne chanteuse française de mélodies. […] L’« accompagnement » d’un lied est aussi impor-
tant que la partie de piano d’une sonate pour piano et violon 7.
Les Dialogues des Carmélites
Alors que Poulenc a toujours choisi lui-même ses textes, l’idée de mettre en musique les Dialogues des Carmé-
lites de Bernanos lui viendra de l’extérieur. En mars 1953, à l’occasion d’une tournée en Italie, Poulenc ren-
contre le directeur des Éditions Ricordi, qui lui a passé commande d’un ballet pour La Scala de Milan. Ce projet
n’enthousiasme guère Poulenc qui l’avoue à Guido Valcaranghi, tout en lui signalant qu’il serait en revanche ravi
de trouver un livret pour un opéra. L’éditeur lui propose alors de travailler sur une pièce de Bernanos, et c’est
la révélation pour Poulenc, qui se réjouit du projet. Il commence la partition en août 1953 et l’achève en sep-
tembre 1955. Il en termine l’orchestration en juin 1956.
L’opéra fut créé le 26 janvier 1957 à la Scala de Milan dans une version italienne de Flavio Testi. La première en
version française eut lieu à l’Opéra de Paris, le 21 juin de la même année. L’œuvre reste un cas à part dans la
production lyrique d’après 1950, le seul opéra à figurer constamment, depuis sa création, au répertoire des
théâtres du monde entier.
Désireux de composer une œuvre lyrique, Poulenc attache une importance extrême au choix du livret, qu’il
arrangera lui-même d’après le texte de Bernanos. Il ne s’agit pas de commenter un texte mais de l’éclairer
musicalement, de le mettre en valeur et de le faire entendre. Il renoue ainsi avec la tradition de Monteverdi ou
de Debussy dans Pelléas et Mélisande.
La dédicace des Dialogues est à ce sujet éloquente :
À la mémoire de ma mère qui m’a révélé la musique, de Debussy qui m’a donné le goût d’en écrire, de Monte-
verdi, de Verdi et de Moussorgsky qui m’ont servi ici de maîtres.
Dans les Dialogues, ce n’est que l’esprit de Monteverdi et de Moussorgsky qui me guide et non leur musique,
bien sûr ! […] je ne peux songer à étouffer les mots si chargés de sens de Bernanos sous une avalanche orches-
7F. Poulenc, Journal de mes Mélodies. Édition intégrale et notes établies par Renaud Machart, Paris, Cicero éditeurs, 1993,
pp. 13-14.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 34
trale. C’est pourquoi je pense sans cesse à Monteverdi, qu’une grande avalanche instrumentale n’empêche pas
d’être lyrique au maximum.
La précision de la prosodie puise son modèle dans L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi et le Pelléas et Méli-
sande de Debussy. L’orchestration est riche mais reste utilisée avec parcimonie et raffinement, comme toujours
chez Poulenc. Les tessitures sont calquées sur les grands rôles d’opéra de la tradition de Mozart, Verdi, Wa-
gner, Massenet.
Poulenc fait en sorte que chaque mot du texte soit compris – à condition, bien entendu, que les chanteurs
articulent. L’écriture vocale n’est jamais couverte par l’orchestre. La ligne de chant est très nette, très pure.
Poulenc ne cherche pas à impressionner l’auditeur par des artifices ou des nouveautés sonores. Paroles et
musique forment un tout, que l’on ne peut dissocier. Tout est au service de l’action, le plus souvent intérieure,
avec un grand respect pour l’élévation et la beauté littéraire du sujet. La forme musicale de chaque scène re-
pose entièrement sur le mouvement dramatique et psychologique des dialogues, sous-tendus par une vingtaine
de motifs musicaux, souvent de caractère harmoniques et confiés à l’orchestre de manière très discrète. D’un
syllabisme strict, le débit ne tend vers l’air que dans la tirade de la Nouvelle prieure (Acte III, scène 3) et reste
ordinairement proche des intonations parlées.
♫ Poulenc, Dialogues des Carmélites : Mes filles, voilà que s’achève notre première nuit de prison (Acte III, Scène 3, n° 49)
Tout est nuance dans cet orchestre « normal », avec les vents par 3 (plus 4 cors et un tuba), 2 harpes, un pia-
no, une percussion assez importante mais employée très discrètement, et une légère prédominance des bois,
qui colorent doucement l’ensemble. Tout en laissant la priorité aux voix, cet orchestre ne les accompagne pas
servilement et ne se contente pas de se faire oublier. Sur un autre plan, sa partie est aussi importante que la
partie vocale, qu’elle enveloppe ou commente, en ajoutant une dimension à ce qui se passe sur la scène. C’est
l’orchestre, notamment, qui énonce les leitmotive qui donnent de l’unité et de la continuité à l’ensemble. Il ne
s’agit pas ici de leitmotive à la manière dont Wagner s’en servait – et l’on sait que Poulenc n’aimait guère Wa-
gner ! – mais bien de motifs musicaux qui ont pour rôle de renforcer l’émotion, sous la forme de persuasions
secrètes, puisqu’on ne les reconnaît pas toujours à la première audition. On peut ainsi distinguer les motifs de
la peur, de l’anxiété, de la crainte, ou les motifs associés à certains personnages comme le Marquis ou Blanche.
Argument
L’action se situe à Paris et au couvent des Carmélites à Compiègne. Elle commence en avril 1789, au début de
la Révolution française. Blanche de la Force, jeune aristocrate, annonce à son père son intention d’entrer au
Carmel. La mère supérieure du couvent de Compiègne la reçoit et lui demande d’exposer les raisons qui la
poussent à rejoindre cet ordre religieux. Devenue novice, Blanche va vivre les derniers jours de la congrégation
mise à mal par la Révolution française. La troupe envahit le couvent, mais Blanche réussit à s’échapper. Les
ordres religieux sont supprimés et les religieuses sont condamnées à mort. Elles montent à l’échafaud en chan-
tant le Salve Regina. Après bien des hésitations, des doutes sur sa raison d’être, Blanche les rejoint.
L’opéra est découpé en trois actes et douze tableaux, liés par des intermèdes orchestraux que Poulenc a ajou-
tés après les premières représentations parisiennes de manière à laisser plus de temps aux changements de
décors.
Dès le début, nous sommes plongés dans cette atmosphère d’inquiétude, d’angoisse diffuse et mystérieuse, de
malaise même qui explique le caractère de Blanche. L’opéra commence brusquement, sans ouverture ni pré-
lude qui permettrait de deviner ce qui va suivre. Le spectateur, l’auditeur, se trouve soudain plongé, sans pré-
paration, dans une scène de famille somme toute anodine : un fils parle à son père, et sa sœur apparaît. Toutes
ces personnes vont se retrouver, à l’instar des autres protagonistes, prises dans un tourbillon qui va les trans-
former, bien malgré elles, à cause de la Révolution française.
L’opéra peut être lu comme une évocation profonde et bouleversante du martyre, et une dénonciation de la
terreur. Ce sont deux conceptions du monde qui s’opposent, « celui qui croyait au Ciel et celui qui n’y croyait
pas », mais aussi et surtout, comme un drame personnel vécu par Blanche. Son choix d’entrer au Carmel n’est
pas dicté par une foi inébranlable. Son père lui assène « on ne quitte pas le monde par dépit ». Si elle choisit au
dernier moment de rejoindre ses compagnes pour mourir, elle a longtemps hésité, assaillie par un doute quasi-
récurrent, sur sa foi, et, principalement, sur son devenir terrestre.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 35
Acte I
Effrayée par les prémices de la Révolution, Blanche de La Force, issue d’une famille d’aristocrates, décide
d’entrer dans un couvent de Carmélites, où elle espère vaincre sa peur. Devenue novice, elle assiste aux der-
niers instants de la prieure qui lui porte beaucoup d’affection et qui, avant de mourir, la recommande à la sous-
prieure, Mère Marie de l’Incarnation.
2e Tableau = dialogue au parloir entre Blanche et la Prieure, vieille femme fort malade.
Cette scène pathétique était l’une des préférées de Poulenc, qui la trouvait « étonnante de calme, de sévérité,
de paix et de violence, avec des moments de grande dureté et une grande noblesse ». Il est vrai qu’elle est tout
en contrastes, qui nous font lire dans l’âme tourmentée de la vieille Prieure, partagée entre les rigueurs de la
règle (propres à décourager la jeune postulante si sa vocation n’est pas certaine) et la sympathie apitoyée que
lui inspire Blanche. La Prieure sursaute quand elle apprend que Blanche a choisi le nom de Sœur Blanche de
l’Agonie du Christ, nom qui aurait dû jadis être le sien et qu’elle n’a pas osé prendre. Il y a donc un lien prééta-
bli entre ces deux femmes si différentes d’apparence, lien qui permettra plus tard une sorte d’échange entre
leurs destinées, entre leurs morts.
♫ Poulenc, Dialogues des Carmélites : Je vois que les sévérités & Vous pleurez ? (Acte I, Scène 2, n° 9 & 11)
4e Tableau = agonie de la Prieure.
Scène la plus pathétique et la plus belle, selon Poulenc, qui disait : « vous verrez, à l’orchestre elle sera saisis-
sante. » C’est une scène d’épouvante, proprement macabre, à la limite du supportable, et qui n’a aucun équiva-
lent dans toute l’œuvre de Poulenc. Mais ce résultat surprenant est obtenu par les moyens les plus nobles,
toujours artistiques. On sait que Poulenc lui-même a payé durement de sa santé l’angoisse qui commence ici :
atteint d’une grosse dépression, il finira par passer trois semaines en clinique, pour y retrouver équilibre et
sommeil. Il s’est comme identifié à la Prieure, dont l’agonie atroce l’a bouleversé, mais qui lui a fait écrire une
de ses plus belles pages : « le rythme de la mort de la Prieure sera le même que celui du dernier tableau mais
alors serein et céleste. C’est toute la pièce. »
Acte II
Après la nomination de la nouvelle prieure, Mère Marie de Saint Augustin, le chevalier de La Force, frère de
Blanche, vient la chercher pour la conduire hors de France, où elle échapperait à la Terreur. Alors qu’elle
s’oppose à ce projet, un commissaire arrive pour expulser les sœurs du couvent.
3e Tableau = entretien entre Blanche et son frère.
Poulenc en était satisfait : « J’ai trouvé le climat exact du duo du frère et de la sœur. Un mélange d’anxiété et
de tendresse. » Et il est bien ici question de douleur : douleur du Chevalier qui n’arrive pas à persuader sa
sœur de se mettre à l’abri, et douleur de Blanche, qui éclate à l’orchestre, même quand elle prétend être heu-
reuse au couvent. Blanche ne lutte pas contre son frère mais contre elle-même, et le Chevalier le sait. Mais il
trouve qu’elle devrait assumer sa peur (et sa peur de la peur – Blanche ne serait pas plus heureuse dans la vie
laïque), la risquer : ce serait ça, le vrai courage, et non pas de nier cette peur.
♫ Poulenc, Dialogues des Carmélites : Dans des temps comme ceux-ci (Acte II, Scène 3, n° 33)
Acte III
Les Carmélites font vœu de martyre pour sauver leur ordre. Mais elles sont arrêtées et emmenées à la Bastille.
Seule Blanche a pu s’échapper. Le jour de l’exécution, elle assiste à la mort de ses sœurs en religion, puis, fidèle
à son serment, elle sort de la foule et suit la dernière des victimes sur l’échafaud.
4e Tableau = Place de la Révolution, les Carmélites s’avancent vers l’échafaud.
Marche au supplice, présence de la mort sur fond sonore de la foule. Chez Bernanos, la foule est silencieuse
dans cette dernière scène. Poulenc la fait chanter en chœur, mais sans paroles, comme une toile de fond qui
renforce l’harmonie sans participer à l’action. L’orchestre, presque uniquement en accords, impose comme un
ostinato le motif de la mort. Les religieuses chantent le Salve Regina en un diminuendo scandé par la guillotine,
au bruit lourd et sifflant, difficilement supportable, les voix s’arrêtant net l’une après l’autre tandis que les
autres continuent à chanter. Quand il ne reste plus que Sœur Constance, le thème lumineux de Blanche, qui
apparaît à travers la foule, rayonne un instant aux cordes. Poulenc dit avoir trouvé ce passage final « dans un
extraordinaire moment d’émotion et de bouleversement ». Il a compris que le sujet essentiel de l’œuvre est
moins la peur que la grâce et le transfert de la grâce. D’où le calme et la confiance extraordinaire des Carmé-
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 36
lites à l’échafaud. Poulenc remarquait : « La confiance et le calme ne sont-ils pas à la base de toute expérience
mystique ».
♫ Poulenc, Dialogues des Carmélites (scène finale et Salve Regina)
Quel est le paysage musical en France en ces années d’après-guerre ? Il est totalement dominé par l’École de
Darmstadt, sous l’égide de René Leibowitz et Pierre Boulez (qui vient d’achever Le Marteau sans maître), et l’on
ignore superbement l’art lyrique, trop directement relié à la tradition combattue, honnie même. Seul Milhaud
compose des opéras, mais sans grand succès (Bolivar, David). Le genre se porte mieux en dehors de la France.
Ces années cinquante voient ainsi les créations de Il Prigionero de Dallapiccola, The Pilgrim’s Progress (Vaughan
Williams), The Rake’s Progress (Stravinsky), Billy Budd et The Turn of the screw (Britten), Boulevard Solitude
(Henze). L’année même de la première des Dialogues à la Scala de Milan virent le jour Moses und Aaron de
Schoenberg et Die Harmonie der Welt d’Hindemith, deux œuvres graves.
Après les périodes de surréalisme, de « retour à », de dodécaphonisme pur et dur, l’opéra de Poulenc était
véritablement nouveau, par l’apport d’un souffle spirituel aussi intense que dramatique, incarné par des person-
nages profondément humains. Personne n’est pas resté insensible à la souffrance, et à la description, si concrète
et présente, de cette torturante mais révélatrice angoisse spirituelle. C’est cela, allié à la clarté de la perfection
formelle tout en étant coulée dans le moule traditionnel du genre opéra, qui allait donner cette stature unique,
et, partant, classique, aux Dialogues des Carmélites. L’œuvre transcende l’aspect purement français, historique et
catholique, et parvient à l’universalité de par cette spécificité même. Dépassant toute question de langage, Pou-
lenc a su parler vrai au cœur des hommes, dans une langue très classique, parfaitement claire, résolument to-
nale ou modale, le plus souvent diatonique.
Pour aller plus loin…
Cette œuvre profondément humaine met en scène une galerie de personnages complexes, dont le plus com-
plexe est sans nul doute Blanche de la Force. Vers elle convergent tous les thèmes de l’ouvrage. Elle représente
les caractéristiques individuelles des différents personnages. Elle a l’angoisse et la grandeur de Madame de
Croissy (la première prieure), l’honneur et la fierté de Mère Marie, la jeunesse et la spontanéité de Constance,
l’humilité et le bon sens de Madame Lidoine (la nouvelle prieure). Blanche est marquée, dès son départ dans la
vie, par les circonstances exceptionnelles de sa naissance, qui, sur le plan humain, expliquent le caractère psy-
chopathologique de sa peur. Celle-ci, transcendée, lui fera accomplir le chemin qui va de l’angoisse à la gloire.
Souffrant toujours de cette angoisse, source d’humiliation permanente, Blanche, désarmée devant chaque accès
de frayeur, voit dans les épreuves successives qu’elle rencontre, la marque de sa vocation religieuse.
À ces thèmes de la lucidité dans l’épreuve et de la prise de conscience d’une vocation dans la souffrance
s’ajoute celui de l’honneur et du courage, valeur liée autant au caractère de Blanche qu’à sa classe sociale, et
reflétant en cette caractéristique les croyances mêmes de Bernanos. Proie de la peur, mais en même temps
grandie par elle, Blanche travaille sans le savoir au salut de l’humanité. Son sentiment de solitude est intense. Il
va jusqu’à l’impression d’être totalement abandonnée. La qualité de l’isolement de Blanche devient plus aiguë
d’un tableau à l’autre. Tour à tour séparée de son père, du monde de l’enfance, de Madame de Croissy auprès
de laquelle elle espérait trouver une protection, de son frère, et des autres religieuses du Carmel, c’est tout à
la fois le monde profane et le monde religieux qui se dérobent à elle. L’une après l’autre, toutes les formes de
l’isolement la laissent démunie, cernée par la peur. Et cette peur a deux dimensions, l’une humaine, irraisonnée,
qui la pousse à la fuite, l’autre métaphysique, à laquelle elle est prédestinée et qui est la marque de Dieu sur
elle, ces stigmates qu’elle essaie confusément d’accepter. À travers tous ces thèmes essentiels, Blanche est
profondément humaine et vivante, toute en contrastes, faible et résolue, pitoyable et agressive, elle est
l’expression même de la dualité qui existe en tout être.
Tout l’Opéra sera la traversée, le chemin de croix de Blanche, avec toute l’angoisse, le désespoir, les reculs
d’une âme humaine confrontée à une dimension qui la dépasse, terrorisée non pas devant la mort elle-même
mais devant l’acte de mourir, le passage, ce passage éperdument recherché par les grandes héroïnes de la litté-
rature comme du théâtre. Blanche se bat contre le destin qu’elle a choisi en régressant, en se recroquevillant,
en se délabrant, mais consciemment ou non, elle sait qu’il lui est impossible de rebrousser chemin et qu’elle
devra toujours aller de l’avant, à la rencontre éperdue de Dieu. Rester humbles, disponibles, réceptifs, c’est ce
que Dieu a toujours imposé à ses Saints. C’est ce que la Prieure demande à Blanche. Celle-ci, malgré la cons-
cience qu’elle a de son destin, a du mal à entrer dans le moule qu’elle s’est choisi elle-même car, comme le lui
dira Madame de Croissy, ce n’est pas la « Règle » qui nous garde, c’est nous qui gardons la « Règle ».
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 37
Musique de chambre
La plupart des compositeurs commencent leur carrière par la musique de chambre, ou des pièces pour piano.
C’est le cas pour Poulenc, qui, lorsqu’il suit les leçons d’harmonie et de composition avec Charles Koechlin, dès
l’âge de 22 ans, se met à écrire des pièces pour bois seuls (Sonate pour deux clarinettes, Sonate pour clarinette et
basson, Sonate pour cor, trompette et trombone). Il écrira ensuite des pièces pour bois accompagnés au clavier,
dont le sommet est le Trio pour hautbois, basson et piano de 1926.
Une autre période de composition de musique de chambre débutera bien plus tard, en 1957, avec la Sonate
pour flûte et piano, puis l’Élégie pour cor et piano. Ces œuvres seront étroitement liées aux interprètes à qui elles
sont dédiées, Jean-Pierre Rampal et le corniste Dennis Brain. Il écrira encore une Sonate pour basson et piano
(1957), une Sonate pour clarinette et piano (1962) et une Sonate pour hautbois et piano (1962), qui sera sa dernière
œuvre.
Cette liste montre sa préférence absolue pour les vents. Il n’écrira en effet que très peu pour les cordes (plu-
sieurs projets de Sonates pour violon et piano sont abandonnés ou détruits). Néanmoins l’amitié et l’admiration
envers deux interprètes magistraux et mythiques le décideront à composer une Sonate pour violon et piano pour
Ginette Neveu, en 1943, et une Sonate pour violoncelle et piano pour Pierre Fournier, en 1948. La sonate pour
Ginette Neveu était la quatrième qu’il entreprenait pour violon et piano.
Pour toutes les créations de ses sonates avec piano, Poulenc tient lui-même le piano et remporte des succès
étonnants.
Sonate pour clarinette et basson FP32
Poulenc se souvient des leçons de contrepoint que lui donne encore Kœchlin, ce qui confère à cette œuvre
une allure et des coloris fort originaux. Il lui écrit en septembre 1922 :
Ma sonate est finie. J’en suis content. Le contrepoint en est parfois distrayant. J’achève aussi celle pour cor, trom-
pette et trombone.
Comme ce sera souvent le cas pour ses œuvres de jeunesse, Poulenc entreprendra une révision de cette so-
nate, en 1945.
Allegro, très rythmé : Il s’agit d’un exercice de composition sur l’indépendance des voix et en même temps un
exercice de contrepoint dans le genre d’une invention à deux voix. L’instrumentation annonce toutes sortes de
jeux de poursuite, de parcours parallèles décalés, de rencontres inattendues. La coda espiègle laisse d’abord
courir seul le basson tandis que la clarinette essaie par quatre arpèges ascendants de le ramener à la raison. Les
deux s’effondrent, la clarinette plonge de deux octaves : pirouette évasive caractéristique dont Poulenc fera par
la suite un grand usage.
Romance, andante, très doux : Presque tout le matériau est énoncé dès la première mesure : une longue ligne
de gamme descendante sur un accompagnement sage du basson qui se contente d’aligner des groupes de deux
notes assure ainsi l’habillage harmonique subtil et gonfle la complicité des instruments. La clarinette s’évade
parfois de son ambitus resserré. Stefania Franceschini y voit la marque d’un néoclassicisme, qui est à la mode
dans ces années-là, où les bonnes manières de Haydn viennent à la rencontre de l’élégance piquante de Mozart
Final, très animé, très rythmé : Ici, toutes les cocasseries sont permises. La volonté constante d’être piquant,
inattendu, irrévérencieux renvoie à une sorte de parade de cirque. C’est un simple jeu d’échos sur un motif
rudimentaire, enjoué, narquois, un peu mal élevé. Le basson resté seul pendant un moment invite ensuite la
clarinette à un bref contrepoint qui entraîne un caquetage de redites accélérées. Suit un moment d’hésitation
qui ouvre la porte à un intermède qui réinstalle l’atmosphère de la romance sans la citer textuellement. Après
la reprise, Poulenc pousse son goût du contrepoint à écrire une véritable strette où le matériau rythmique est
bousculé, compressé et éjecté. Il s’amuse à un paradoxe qu’il désigne à son professeur Kœchlin comme un
contrepoint « divertissant ».
♫ Poulenc, Sonate pour clarinette et basson
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 38
Trio pour hautbois, basson et piano FP43
Depuis les trois sonates pour vents seuls de 1919 et 1922, Poulenc a pu travailler l’orchestre grâce au ballet Les
Biches de 1923, qui est son premier vrai grand succès public. Après trois œuvres quasi expérimentales pour
bois sans accompagnement, le piano entre ici en maître dans la musique de chambre ; il n’en sortira plus. Le
Trio pour hautbois, basson et piano expérimente des mélanges de timbres astucieux. Entre le Trio (qui date de
1926) et le Sextuor (1932), il s’intéressera au concerto pour clavier : 1928, Concert champêtre pour clavecin et
grand orchestre (FP 49) ; 1928, Aubade, « concerto chorégraphique » pour piano et onze instruments (FP 51) ; 1932,
Concerto pour deux pianos et orchestre (FP 61). C’est sans doute la raison pour laquelle le Sextuor pour piano, flûte,
hautbois, clarinette, basson et cor, nettement plus ambitieux dans son projet esthétique que le Trio, marquera par
sa maîtrise des combinaisons de timbres une sorte d’aboutissement : c’est déjà un concerto en miniature.
Pour achever son Trio, Poulenc se « met en loge », loin des amis et de Paris, dans une chambre de grand hôtel,
à Cannes. L’idée de trio est vite adoptée, mais l’instrumentation des projets successifs varie encore. En avril
1924, il a éliminé tout instrument à cordes. En mai, il choisit : piano, hautbois et basson. En septembre, il se
demande ce que va en penser Darius Milhaud :
Je n’en suis pas mécontent. Longueur à peu près d’un trio de Haydn, Mozart, mais pas du tout dans ce style.
Musique plus « objective », comme dirait ce niais de Prunières. En tout cas, c’est bien travaillé.
Le Trio est dédié à Manuel de Falla, qui l’apprécie tout particulièrement. Il écrit d’ailleurs à Poulenc, le 26 sep-
tembre 1929 :
Je l’aime tellement que, aussitôt qu’il me sera possible, nous en donnerons une audition à Séville (gardant pour
moi, bien entendu, le piano). […] Merci, merci, cher ami, de la joie que je dois à votre musique et de votre dédi-
cace du Trio dont je suis noblement fier.
Grand succès en Amérique et en France, parfois même dans des conditions douteuses : par exemple le 23 avril
1959, Pierre Bernac annonce à Poulenc qu’il a entendu enregistrer à la radio
une curieuse exécution du Trio, pour harpe, flûte et basson. Hum… Avez-vous autorisé cela ? Si oui, pourquoi ?
Cela passe sur les ondes le 3 de 20 h15 à 21 h15, mais peut-être vaudrait-il mieux que vous n’écoutiez pas.
Lorsqu’en 1954, le musicologue Claude Rostand évoque l’œuvre parmi les compositions de jeunesse, Poulenc
répond :
J’aime assez mon Trio parce qu’il sonne clairement, et qu’il est bien équilibré. Pour ceux qui me croient insou-
ciant de la forme, je n’hésiterai pas à dévoiler ici mes secrets. Le premier mouvement suit le plan d’un allegro de
Haydn. Et le rondo final, la coupe du scherzo du Deuxième Concerto pour piano et orchestre de Saint-Saëns. Ra-
vel m’a toujours conseillé ce genre de méthode qu’il a suivi lui-même, souvent.
♫ Poulenc, Trio pour hautbois, basson et piano
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 39
Seconde École de Vienne
Vienne au début du 20e siècle
Au début du 20e siècle, Vienne est encore la capitale d’un immense empire de peuples divers et écartelés. Mais
elle est déjà assujettie à l’Allemagne suite à sa défaite de Sadowa (1866). L’Autriche-Hongrie craque de
l’intérieur, mais nul ne veut entendre ces signaux de fin du monde. Et le bruit des valses couvre tout. Vienne est
à la fois le bastion du conservatisme et le creuset de la modernité. Elle est, en 1909, une ville de plus de deux
millions d’habitants et rayonne encore sur le monde.
À cette époque, l’atmosphère à Vienne est particulièrement riche : musiciens, peintres, sculpteurs, architectes
vivent ensemble dans une même émulation. Ce climat de création formidable est à l’image de ce que sera la
carrière d’Arnold Schoenberg : compositeur, théoricien, enseignant, poète, chef de file de l’École de Vienne,
inventeur du dodécaphonisme et peintre !
Quelques ingrédients essentiels de cette effervescence culturelle :
- le règne de dix ans de Gustav Mahler, que Schoenberg appelait « le saint », de 1897 à 1907, et qui bou-
leversera les vieilles traditions ;
- le courant de la « Sécession viennoise », rattaché à l’Art nouveau et au « Jugendstil », avec des artistes
comme Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Otto Wagner, Josef Hoffmann, Koloman Mo-
ser, Arthur Roller, Mucha, … ;
- les écrivains « psychologiques » comme Arthur Schnitzler, Stefan Zweig… et les poètes comme Stefan
George, Georg Heym ;
- le mouvement freudien avec la parution en 1900 de la « Science des rêves » de Sigmund Freud ;
- la philosophie avec Wittgenstein.
Au niveau musical, au tournant du siècle, Vienne n’a pas encore fait le deuil de Brahms et de Bruckner. La mu-
sique germanique, dans son ensemble, est largement dominée par le courant post-romantique et un wagné-
risme que seul tempère Brahms. L’œuvre charnière de Mahler (1861-1911) en porte toutes les caractéris-
tiques : chromatisme exacerbé, présence d’un programme déclaré ou en filigrane, étirement des formes, gigan-
tisme des moyens. Tel est le double héritage, Wagner d’un côté, Brahms de l’autre, qu’assumera d’ailleurs en-
core Schoenberg dans ses premières œuvres tonales.
Révolution musicale ?
L’abandon de la tonalité comme du thème avec par voie de conséquence l’emploi de petites formes, une nou-
velle distribution des timbres, et à partir de 1923 l’utilisation de la série, telles sont les principales raisons qui
attachent l’épithète de révolutionnaire à la Seconde École de Vienne. Celle-ci constitue une entité à partir de
1908, date des premiers opus de Webern (1883-1945) et de Berg (1885-1935), élèves depuis 1904 de Schoen-
berg (1874-1951). Ce dernier, qui en reste le chef de file, a contesté le terme même de révolution, à mettre,
selon lui, au compte de la méconnaissance : ces changements, si profonds soient-ils, s’inscrivent dans l’histoire
et résultent d’une évolution.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 40
Arnold Schoenberg (1874-1951)
Né à Vienne le 13 septembre 1874 et mort à Los Angeles le 13 juillet 1951 (natura-
lisé américain), Schoenberg a toujours considéré sa musique comme l’héritière
authentique de la tradition classique et romantique allemande. Celui qui procla-
mait : « il y a encore beaucoup de bonnes musiques à écrire en do majeur » fut
pourtant l’initiateur d’une révolution atonale sans précédent.
Arnold Schoenberg, aîné de trois enfants, quitte le collège à l’âge de seize ans, à la
mort de son père, pour s’engager dans la vie active. D’abord apprenti dans une
banque jusqu’en 1895, il assumera ensuite diverses tâches lui permettant de se
consacrer quasi exclusivement à la musique.
Hormis quelques leçons de contrepoint qu’il prend, à partir de 1894, avec Alexan-
der von Zemlinsky, il apprend et comprend l’essentiel de l’écriture musicale en
autodidacte, par la lecture des grandes œuvres du passé et dans l’interprétation
d’un très vaste répertoire de musique de chambre, essentiellement comme violo-
niste mais aussi comme violoncelliste. Cette expérience, qui irriguera toute son
œuvre, alimentera ainsi de nombreuses démonstrations dans ses grands traités
(harmonie, composition, esthétique).
Alexander von Zemlinsky (1871-1942)
Né à Vienne, mort à New York, chef d’orchestre puis directeur musical du Volksoper de Vienne, Zemlinsky dirige ensuite le
Neues Deutsches Theater de Prague, où il créé notamment sa Symphonie lyrique. Appelé à Berlin, il enseigne à la Musikhoch-
schule. Inquiet de la montée du nazisme, il retourne à Vienne, puis émigre aux États-Unis, où il meurt pauvre et oublié.
Marginal, jugé trop moderne par les anciens, pas assez par les nouveaux, Zemlinsky est redécouvert à travers ses opéras, sa
musique de chambre et ses 120 Lieder qui occupent une place importante dans l’histoire du genre. Parti de Brahms pour
aboutir à une conception de la « tonalité élargie », son langage ne franchira jamais le pas de l’atonalité.
Fasciné par la musique de Wagner et de Brahms, Schoenberg compose des œuvres de jeunesse dans la tradi-
tion romantique allemande. De cette époque, il laisse notamment l’une de ses pièces maîtresses, la Nuit transfi-
gurée (Verklärte Nacht), composée en 1899. Il s’agit d’un sextuor écrit pour Mathilde Zemlinsky – que Schoen-
berg épousera en 19018 – basé sur la lecture d’un texte du poète mystique allemand Richard Dehmel, forte-
ment marqué par la philosophie de Nietzsche : le texte décrit une promenade nocturne d’un couple amoureux
dont la femme avoue qu’elle attend un enfant d’un autre. Son amant insiste sur l’importance de sa maternité et
lui assure qu’il est disposé à faire sien cet enfant. Ils marchent heureux, sous la lune, dans cette nuit transfigu-
rée. Schoenberg écrit une partition qui reste assez « classique », divisée en cinq sections suivies d’une longue
coda, véritable hymne à la nature et à l’amour.
♫ Schoenberg, La Nuit transfigurée op. 4
Ses premières œuvres ne reçoivent qu’un accueil mitigé, ce qui ne le décourage pas. Peu à peu, partant d’une
analyse logique de l’évolution de l’harmonie à la fin du romantisme, il se permet des dissonances de plus en plus
audacieuses... jusqu’à l’abandon total de la tonalité. Notons qu’au même moment, et aussi à Vienne, Vassily
Kandinsky risque le grand saut dans l’abstraction : Schoenberg, qui était aussi un peintre expressionniste, ne
pouvait l’ignorer.
La spécificité de son écriture s’affirme néanmoins dès les premiers Lieder op. 1 et op. 2 (1900) par le rapport
complexe entre une phraséologie tonale (articulations, points d’appui, polarités fortes) et une invention mélo-
dique riche par la nature même des intervalles ; si Wolf (dont les derniers Lieder remontent à 1897) et même
Brahms avaient déjà largement engagé la modernité sur cette voie, Schoenberg accentue la disjonction par des
parcours harmoniques très incertains (résolutions harmoniques ambiguës).
8Un an après la disparition de Mathilde Zemlinsky (la sœur du compositeur) dont il aura deux enfants, il épouse en 1924,
Gertrud Kolisch qui restera à ses côtés jusqu’à la fin de sa vie. Trois enfants naîtront dont l’aînée, Nuria, épousera Luigi
Nono en 1955.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 41
♫ Schoenberg, Der Wanderer > 8 Lieder op. 6 (texte de Nietzsche, 1903-1905)
Dès 1903, il enseigne l’harmonie et le contrepoint à Vienne (école privée d’Eugénie Schwarzwald) ; l’activité de
professeur restera au cœur de toute son existence, de Berlin (1926) à Los Angeles (jusqu’en 1944) et se pro-
longera à travers des cours privés. Longtemps après les premiers élèves Anton Webern et Alban Berg (1904),
avec lesquels se forme ce que l’histoire retiendra sous le nom de « Seconde École de Vienne », de nombreux
autres créateurs suivront ses cours, dont Hanns Eisler et John Cage.
Premiers pas vers l’atonalité (1908-1916/23)
En 1903, Schoenberg rencontre Mahler à Vienne ; après avoir, dans un premier temps, émis des réserves sur
son œuvre, Schoenberg lui voue une admiration indéfectible dès qu’il entend la Troisième Symphonie. Le départ
de Mahler pour les États-Unis, en 1907, coïncide curieusement avec les premiers pas dans la grande traversée
des années 1907-1909 où la musique tonale basculera alors vers l’atonalité : Deuxième quatuor à cordes, Pièces
pour piano op. 11, 15 mélodies d’après le Livre des Jardins suspendus op. 15, Fünf Orchesterstücke op. 16, mono-
drame Erwartung op. 17, Die glückliche Hand (La Main heureuse) op. 18…
L’abandon de la tonalité et le rejet des moyens d’articulation qui l’accompagnent engendrent une musique
athématique et favorisent, par un refus du développement et de tout épanchement sentimental, l’emploi de
petites formes (cf. les Six bagatelles de Webern).
Les œuvres athématiques sont aussi marquées par une nouvelle élaboration du timbre. La troisième des 5
Pièces pour orchestre op. 16 est emblématique de cette mutation qui voit naître la technique de la mélodie de
timbres (Klangfarbenmelodie) : non plus une mélodie – différents sons consécutifs – mais un seul son (ou
groupe de sons) joué successivement par différents instruments. Webern relayera assez vite cette pratique,
dans laquelle la primauté du timbre produit des textures inouïes focalisées sur ces innombrables « taches so-
nores » (Adorno), par exemple dans ses 5 Pièces pour orchestre de l’opus 10 (1911-1913).
♫ Webern, Fünf Orchesterstücke op. 10
Parallèlement aux recherches sur le timbre émerge une autre conception de l’orchestre et de sa sonorité :
écriture solistique, intégration d’instruments inusités dans ce cadre (mandoline, guitare, harmonium, clarinette
basse), nouveaux modes de jeu, …
Les 5 Pièces pour orchestre de l’op. 16 de Schoenberg approfondissent la notion de « chromatisme total ». Écrite
dans une période de crise personnelle et artistique pour Schoenberg, cette œuvre semble en refléter les ten-
sions et la violence extrême. Esthétiquement, cette musique entre en parallèle avec le mouvement expression-
niste de la même époque, en particulier dans son intérêt pour l’inconscient et la folie naissante.
♫ Schoenberg, 3. Farben > Fünf Orchesterstücke op. 16
Lors de son premier séjour à Berlin (1901), Schoenberg rencontre Richard Strauss dont l’influence marque le
poème symphonique Pelléas et Mélisande op. 5. Il y croisera aussi Ferruccio Busoni – défenseur de la nouvelle
musique avec qui les rapports sont plutôt bons – mais c’est avec le peintre Kandinsky (rencontré à Munich)
qu’il échangera une longue et précieuse correspondance (1911-1936). Une autre facette de sa personnalité
créatrice, le montre en tant que peintre : dès 1908, Schoenberg se prend en effet de passion pour la peinture
et réalise de nombreux portraits et autoportraits. Il peint également des visions hallucinées qu’il appelle des
Regards.
Même si son langage musical devient atonal dès les années 1906-1907, il faudra attendre 1921-1924 pour voir
apparaître le plus strict dodécaphonisme (à la même époque environ que Webern). La révolution dodécapho-
nique ne s’est donc pas faite en un jour mais est plutôt le fruit d’une recherche menée en collaboration avec
Berg et Webern.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 42
Le grand saut (Pierrot Lunaire) – Atonalisme libre
Une fois franchi le tournant décisif vers l’atonalité, Arnold Schoenberg entame une période de création intense
où il amène l’émancipation de la dissonance à son paroxysme. C’est dans cette période dite d’« atonalisme
libre » que s’inscrivent Erwartung (1909, op. 17)9 et Pierrot Lunaire (1912).
Erwartung, monodrame en un seul acte, pour une seule voix et orchestre, est dense comme la forêt inquiétante.
Il s’agit d’un monologue intérieur, celui d’une femme seule dans la nuit ; femme attendant son amant, et qui
d’ailleurs l’a sans doute tué elle-même par jalousie, femme entre peurs, panique et délire. Toute l’action se
passe entre la nuit et l’aube. Action rêvée, projetée ? Un fort substrat psychiatrique sous-tend ce texte et cor-
respond à l’air viennois ambiant des années 1900. Et comme l’opéra Elektra de Richard Strauss, strictement
contemporain, une forme d’hystérie en musique est à l’œuvre, mais là où l’orchestre opulent de Strauss exa-
cerbe le postromantisme finissant, Schoenberg ouvre de nouvelles voies à l’histoire de la musique en posant les
bases de l’atonalité et de l’athématisme (plus de thèmes identifiables).
Cette plongée dans l’inconscient est aussi une délivrance des chaînes de la musique tonale, et l’aube naissante
d’un autre temps. On y trouve les objets référents de l’expressionnisme (ombres, lune rouge, forêt, ca-
davre…). Cet expressionnisme (terme né en 1914) trouvera plus tard vers 1910, ses chantres avec Georg
Trakl, la revue berlinoise Die Sturm, Murnau, Lang, Kandinsky…
On peut imaginer qu’Erwartung est le premier drame expressionniste, mais aussi la première mise en musique
non voulue des théories freudiennes, voire musique de fin de monde. Pierrot Lunaire ou Wozzeck d’Alban Berg
seront également des ouvrages typiques du courant expressionniste. Dans leur regard sur la destinée humaine,
tendresse, dérision, angoisse, tragique et morbidité alternent dans une atmosphère tendue aux limites du rêve
et de la réalité.
♫ Schoenberg, Erwartung
Le point culminant de ses recherches à l’époque est bien entendu son Pierrot Lunaire10, suite de 21 mélodrames
organisés en trois cycles, pour soprano et huit instruments solistes, sur des textes d’Albert Giraud (dans une
version allemande d’Otto Erich Hartleben). Œuvre pour petite formation, donc, en réaction totale contre les
grandes fresques de Bruckner, Mahler, Wagner ou Strauss. Par ailleurs, chaque pièce possède une instrumenta-
tion différente : certaines se contentent du piccolo et piano, de l’alto et violoncelle, la dernière étant un tutti.
La voix devient un instrument parmi les autres.
Dans cette œuvre, Schoenberg rompt totalement avec la tonalité, traitant même la partie vocale en « parlé-
chanté » ou Sprechgesang. Prémices de la nouvelle vocalité, le Sprechgesang rend compte des angoisses et des
phantasmes du protagoniste comme le faisait la voix de la femme dans Erwartung.
Apparenté au récitatif, le Sprechgesang est un parlé-chanté à mi-chemin entre une récitation parlée très empha-
tique et un chant véritable. Inventé par Engelbert Humberdinck (1854-1921) dans son opéra Les enfants royaux,
le procédé est d’abord repris par Schoenberg dans ses Gurre-Lieder (1900-1912) avec la partie finale du récitant,
avant d’être développé dans le Pierrot Lunaire, où il veut dépasser l’opposition classique entre parties récitées et
parties chantées. Il montre aussi l’influence de la culture du cabaret et s’inscrit dans le prolongement du Pelléas
et Mélisande de Debussy qui s’opposait également aux voix de diva que l’on célébrait encore chez Wagner.
Dans le prologue accompagnant la partition du Pierrot Lunaire, Schoenberg indique que l’interprète doit trans-
former les notes indiquées sur la portée en une « mélodie parlée » tout en veillant scrupuleusement à « res-
pecter les hauteurs de ton indiquées ». L’intérêt pour le compositeur était que la voix soit chargée d’une ten-
sion dialectique permanente entre l’interprétation théâtrale des poèmes, et l’interprétation chantée dialoguant
avec les instruments. Mais, si explicites que soient les intentions de Schoenberg, de gros problèmes
d’interprétation se posent. Pierre Boulez écrira en 1963 : « La question se pose de savoir s’il est réellement
possible de parler selon une notation conçue pour le chant. C’était le vrai problème à la racine de toutes les
controverses. Les propres remarques de Schoenberg sur le sujet ne sont pas claires... »
♫ Schoenberg, Pierrot Lunaire
9 http://www.espritsnomades.com/siteclassique/schoenbergerwartung/schoenbergerwartung.html
10 http://www.espritsnomades.com/siteclassique/schoenbergpierrotlunaire/schoenbergpierrotlunaire.html
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 43
C’est sans doute cette ambiguïté des limites entre le parlé et le chanté qui explique que la technique sera fort
peu reprise ensuite, ou alors à des occasions précises. Berg l’utilisera dans son opéra Wozzeck et Schoenberg
lui-même s’en servira dans son opéra inachevé Moses und Aron (1932) : pour traduire musicalement l’opposition
entre les deux frères, il fait s’exprimer Moïse en Sprechgesang, alors qu’Aaron recourt au chant lyrique.
Le Pierrot Lunaire fait une forte impression sur le monde musical et établit définitivement Schoenberg en tête
des compositeurs les plus influents de son temps. Stravinsky s’en inspirera par exemple dans ses Trois Poésies de
la lyrique japonaise (1913). L’Europe musicale se divise en « atonalistes » et « anti-atonalistes », ces derniers
n’hésitant pas à perturber des concerts et à demander le renvoi de Schoenberg de sa chaire de professeur.
Après les turbulences du Pierrot Lunaire, la période 1915-1923 voit un certain repli de l’invention dans une pé-
riode de grand silence, au profit de multiples transcriptions mais surtout – et en même temps que la réflexion
sur la future composition avec douze sons – l’essor d’une profonde pensée religieuse qui marquera la création
à venir depuis l’immense oratorio inachevé L’Échelle de Jacob (1916) jusqu’aux Psaumes des dernières années, en
passant par Moses und Aron (1932) et Kol Nidre (1938).
Dodécaphonisme et Sérialisme
Cette remise en cause profonde des fondements de la musique occidentale effraye Schoenberg lui-même, qui
vient de traverser une période de doutes et de réflexion. Ce n’est qu’après huit années de repli qu’il reprend la
composition sur de nouvelles bases, empruntées au système rigide de son contemporain Josef Matthias Hauer
(1883-1959), qu’il assouplit et rend plus expressif.
« Dodécaphonisme » est le nom donné par René Leibowitz, un ancien élève de Schoenberg et Webern, à la
méthode de composition fondée sur douze sons en rapport les uns avec les autres. Cette appellation est utili-
sée aujourd’hui pour désigner cette première forme de sérialité.
Josef Matthias Hauer a développé un système de composition à douze sons (dodécaphonisme) qu’il a abon-
damment théorisé par la suite. Ses compositions, très nombreuses et pour la plupart extrêmement courtes
(moins de cinq minutes), sont généralement destinées à de petits ensembles ou à des instruments solistes. Pour
Hauer, le rôle du compositeur n’était plus de susciter de l’émotion ou de véhiculer un sens, un contenu, un
message : il s’agissait à ses yeux, littéralement, uniquement de produire des sons, une succession de notes et de
sons interchangeables. Sa musique vise la neutralité, l’inexpressivité, l’effacement total de la personnalité de
l’artiste, aussi bien du créateur que de l’interprète. Cette vision radicale n’a été pleinement comprise qu’avec
l’apparition du courant minimaliste.
Faisant apparaître dans un ordre quelconque chacun des douze sons de l’échelle chromatique (aucune répéti-
tion n’est possible à ce stage de l’élaboration), Schoenberg obtient une série de douze sons, constituant un
véritable « ensemble ».
Cette série est présentable
dans sa forme originelle (Grundgestalt) appelée aussi forme droite
en récurrence (la série est prise par la fin) appelée aussi forme rétrograde
en renversement (tous les intervalles sont imités en mouvement contraire, c’est-à-dire qu’un intervalle
descendant devient ascendant et vice-versa) appelée aussi forme miroir
en récurrence du renversement appelée aussi forme miroir du rétrograde
La série originale, dans ses quatre formes, est elle-même transposable sur les onze autres degrés de l’échelle
chromatique. Son énonciation est donc possible sous 48 formes différentes car la transposition n’altère en rien
les intervalles qui mettent en rapport les sons les uns avec les autres et constituent la série : celle-ci tire, en
effet, son identité des intervalles et des hauteurs de sons. En outre, la série peut être présentée en entier ou
par fragments, dans une succession horizontale ou dans une agrégation verticale, combinables à volonté : ce
double usage, mélodique et harmonique, différencie radicalement la série du thème.
Pour Schoenberg à l’époque, la série n’affecte que les hauteurs, les autres paramètres du son (durée, timbre,
dynamisme) continuant à être choisis comme auparavant. Le dodécaphonisme n’est donc qu’un premier état de
la musique sérielle. Webern exploitera avec rigueur les techniques du sérialisme proposées par Schoenberg à
partir de 1923, comme dans le Concerto pour neuf instruments op. 24. Il ira même jusqu’à appliquer la série non
plus seulement au hauteurs mais également aux durées.
♫ Webern, Konzert : 3. Sehr rasch op. 24 (1934)
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 44
Fondamentalement, Schoenberg est profondément conservateur : son souhait n’est pas de tout révolutionner
mais de fonder un nouveau classicisme. Pour substituer de nouveaux repères au traditionnel enchaînement
« tonique-dominante », il imagine la composition sérielle. L’adoption de la technique sérielle s’inscrit ainsi à la
fois dans la perspective d’un authentique classicisme et dans celle d’une vision proprement messianique du rôle
du créateur qui domine largement la pure question de la syntaxe à laquelle Schoenberg se verra si fréquem-
ment confiné.
Entre 1920 et 1923, Schoenberg compose la Suite pour piano op. 23. L’une des œuvres le plus audacieuses du
compositeur, elle marque une étape importante puisqu’il s’agit de la première œuvre où Schoenberg applique le
système sériel de façon stricte, principalement dans la cinquième partie, intitulée Walzer.
♫ Schoenberg, Valse > Suite pour piano op. 23
D’abord enivré par son procédé, il déclare : « Mon invention assurera la suprématie de la musique allemande
pour les cent ans à venir ». Mais par la suite il n’hésitera pas à prendre des libertés avec son propre système. Il
applique en tout cas la méthode de composition à douze sons dans la Sérénade op. 24 (1923) pour septuor à
vents et dans la Suite pour piano op. 25 (1924). Son emploi sera systématique jusqu’aux Variations pour orchestre
op. 31 et jusqu’à Von Heute auf Morgen (D’Aujourd’hui à demain, op. 32, 1929), opéra en un acte strictement
dodécaphonique.
En 1925, il devient professeur à l’Académie prussienne d’Art mais s’en voit éjecté, en 1933, avec l’arrivée
d’Hitler au pouvoir. Cette année 1933 est décisive : reconversion au judaïsme, à Paris, le 25 octobre (abandon-
né en 1898) et départ définitif pour les États-Unis (Boston puis, pour raisons de santé, la côte Ouest) ; s’il amé-
ricanise aussitôt l’orthographe de son nom (le ö devient oe) et écrit dorénavant directement en anglais, il ne
deviendra citoyen américain que le 11 avril 1941.
Jusqu’à la fin, ce sera le temps des relations fécondes, conflictuelles parfois, avec Alma Mahler-Werfel, Thomas
Mann, Berthold Brecht, Hans Eisler et Theodor W. Adorno.
Après un second repli de 1933 à 1935, succèdent les années d’épanouissement du style où ses puissantes
œuvres tardives affirment une parfaite maîtrise de la technique sérielle. C’est par exemple le cas du Concerto
pour violon op. 36 (1934/36) ou du Concerto pour piano op. 42 (1942), du Trio à cordes op. 45 (1946).
♫ Schoenberg, Concerto pour piano op. 42
Mais la période américaine est surtout marquée par la réintroduction d’éléments caractéristiques du langage
tonal (octaves, accords parfaits) comme dans la Deuxième Symphonie de chambre op. 38 (1939).
♫ Schoenberg, 2. Kammersinfonie : II. Con fuoco op. 38
Trop fatigué par de lourds et fréquents problèmes de santé, Schoenberg ne peut se rendre en 1949 à
Darmstadt où commence à s’élaborer la postérité du courant qu’il avait lui-même porté si haut. Il meurt à Los
Angeles, le 13 juillet 1951.
À écouter : Émission radiophonique sur France Culture :
« Une Vie, une Œuvre – Arnold Schoenberg (1874-1951) »
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/arnold-schoenberg-1874-1951
Le sérialisme intégral : impasse ou voie d’avenir ?
Après la Seconde Guerre mondiale, un groupe de jeunes compositeurs nés autour de 1925 constituent
« l’École de Darmstadt » : il s’agit essentiellement de Luigi Nono, Luciano Berio, Pierre Boulez et Karlheinz
Stockhausen. Chaque année (entre 1957 et 1961), ils se retrouvent dans cette ville pour échanger leurs expé-
riences basées sur un sérialisme « intégral » prolongeant le travail de Webern : la série est généralisée à tous
les paramètres du son : rythmes, durées, timbres, attaques... Boulez déclare alors : « Tout musicien qui n’a pas
ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est INUTILE. Car toute son œuvre se place en deçà des né-
cessités de son époque ».
♫ Boulez, Polyphonie X
Mais le résultat est une musique souvent cérébrale et hermétique pour l’auditeur moyen. Aussi chaque compo-
siteur ne tarde pas à abandonner un rigorisme trop strict pour s’engager, chacun à sa façon, dans des voies plus
personnelles.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 45
Alban Berg (1885-1935 Vienne)
Alban Berg naît au sein d’une famille viennoise aisée. Enfant, son inclinaison va davantage à la littérature qu’à la
musique ; c’est adolescent qu’il commence à composer des Lieder en autodidacte (le genre lui restera toujours
familier par la suite). Il devient l’élève de Schoenberg, en octobre 1904. Il étudie avec lui le contrepoint et
l’harmonie dans une perspective toujours historiciste. À 21 ans, il ne se consacre plus qu’à la musique et, un an
plus tard, commence à composer, cela directement dans l’esthétique révolutionnaire de Schoenberg : si les
Sieben frühe Lieder (Sept Lieder de jeunesse) gardent leurs fonctions tonales, la Sonate op. 1 les bousculent déjà
nettement.
♫ Berg, Sieben frühe Lieder : Nacht
Berg devient une figure ardente de la Vienne au crépuscule, pour reprendre le titre du roman d’Arthur Schnit-
zler publié en 1908. Il fréquente les compositeurs Alexander von Zemlinsky et Franz Schreker, le peintre Gus-
tav Klimt, le poète Peter Altenberg. Il rencontre Hélène Nahowski et, comme jadis Schumann confronté au
père de Clara, a quelques difficultés à l’épouser (en 1911). C’est l’incontournable Schoenberg qui dirige en 1913
l’orchestre des Cinq Lieder sur des textes de cartes postales de Peter Altenberg 11 lesquels déclenchent un terrible
chahut dans la salle : Berg est officiellement devenu un « compositeur radical ». L’œuvre choque moins encore
par son langage que par la démesure luxueuse de son orchestre, qui semble se gâcher dans des mélodies très
brèves.
Vient la guerre. D’abord patriote enthousiaste, Berg est vite déçu par sa vie de soldat (1915-1918). Cette expé-
rience influencera le livret de l’opéra Wozzeck, d’après la pièce Woyzeck (1837) de Büchner, qui raconte les
déboires d’un troufion psychologiquement instable. Ébauché durant cette période traumatisante, l’opéra s’écrit
lentement jusqu’en 1922. Le chef-d’œuvre, qui bénéficie d’un nombre de répétitions exceptionnel, est créé le
14 décembre 1925 à Berlin, sous la baguette assurée d’Erich Kleiber. Le succès est rapide et bientôt internatio-
nal. Berg semble avoir dépassé le maître Schoenberg, et d’un point de vue social, c’est alors un fait certain. Il
aura été le seul des trois Viennois à provoquer un engouement un tant soit peu populaire.
La Suite Lyrique, son second quatuor à cordes, sera la première œuvre réellement dodécaphonique de bout en
bout, après les essais du Concerto de chambre. Berg, malgré le succès, reste donc fidèle à l’exemple de Schoen-
berg. L’œuvre semble inspirée d’une relation mystérieuse avec Hanna Fuchs, femme mariée comme lui.
♫ Berg, Suite Lyrique
Après le succès de Wozzeck, le prochain grand projet sera le second opéra, qui deviendra Lulu, d’après deux
pièces du scandaleux dramaturge de Munich Frank Wedekind, mises en livret par Berg lui-même (L’Esprit de la
terre, 1895, et La Boîte de Pandore, 1902). Deux commandes s’immiscent dans la composition de ce second chef-
d’œuvre dramatique et engendrent Le Vin, d’après des poèmes de Baudelaire, et le célèbre Concerto pour violon
dit « à la mémoire d’un ange » (en hommage à Manon, fille d’Alma Mahler et de l’architecte Walter Gropius,
morte à 18 ans de la poliomyélite). Le concerto doit son succès, sans doute, à son retour relatif à un langage
sinon tonal, du moins plus ancré dans le répertoire connu du public, notamment par ses citations. Ce léger
retour imprègne également le langage de Lulu, qui contient aussi quelques éléments tonals. L’opéra retrace les
splendeurs et misères d’une courtisane amorale, réponse féminine logique à l’oppression masculine. L’opéra
restera cependant inachevé.
Berg meurt le 24 décembre 1935, tué par une simple piqûre d’insecte qui engendre un abcès au dos, bientôt
compliqué en septicémie (les antibiotiques seront inventés quatre années plus tard…). Il faudra attendre 1979
pour qu’on entende, à l’Opéra de Paris, dirigée par Boulez, une version de Lulu complétée par Friedrich Cerha.
♫ Berg, Concerto à la mémoire d’un ange
11Les Altenberg Lieder (titre exact : Fünf Orchesterlieder, nach Ansichtkarten-Texten von Peter Altenberg) op. 4 datent de 1911-
1912 et sont écrits pour mezzo-soprano et orchestre. Le contenu des textes dévoile les faces à la fois tourmentées et
belles de l’âme humaine, mais aussi une expression sensuelle de l’amour et du désir.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 46
Anton Webern (1883-1945 Vienne)
Vienne est restée le point d’ancrage principal de Webern qui y passera la majeure partie de sa vie. Né dans ce
foyer culturel exceptionnel, Webern participe à cette quête de renouvellement artistique au sein de « l’école
de Vienne » sous l’égide de Schoenberg dont il a été, l’un des plus remarquables élèves. Au-delà de cette rela-
tion pédagogique, Webern a voué à son maître une véritable vénération, le suivant, au sens propre comme au
figuré, dans ses aventures musicales. Le contexte politique des années trente, avec le départ forcé de Schoen-
berg en 1933, démis de ses fonctions parce que juif, et de nombre d’autres, séparera les deux hommes alors
que Webern ne songe pas à abandonner sa Vienne natale, ni la « grande Allemagne » en laquelle il croit farou-
chement, comme en témoignera son engagement en faveur du national-socialisme de Hitler. Il n’en continue
pas moins, dans un isolement quasi complet, à élaborer une œuvre qui, du fait de son incompatibilité avec les
canons esthétiques du IIIe Reich, reste essentiellement confidentielle durant ces années jusqu’à sa mort en
1945. L’après-guerre verra une reconnaissance inversement proportionnelle de sa musique par la jeune généra-
tion de compositeurs qui, avec Boulez et Stockhausen, le désignera comme la seule source digne d’être exploi-
tée et poursuivie.
Fils d’un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture, le jeune Webern suit son père dans les postes qu’il occupe
avant de revenir à Vienne. Parallèlement à ses études musicales en piano et en violoncelle apparaissent ses
toutes premières œuvres dès 1899, dans le domaine de la musique de chambre, et bientôt des Lieder qui se-
ront une constante de son œuvre de maturité. Ses premiers poètes, Ferdinand Avenarius, et surtout Richard
Dehmel et Stefan George, révèlent son goût pour les esthétiques impressionnistes et symbolistes qui le mar-
queront jusque dans ses premiers opus. Un voyage à Bayreuth en 1902, où il assiste notamment à une repré-
sentation de Parsifal, lui laisse une profonde impression, Wagner, puis Richard Strauss constituant ses pre-
mières références à cette époque.
La même année 1902, Webern s’inscrit à l’université de Vienne où il suit des cours de musicologie, d’harmonie,
et de contrepoint. Webern sera l’un des rares compositeurs à acquérir une solide formation de musicologue,
sanctionnée en 1906 par un doctorat (sous la direction d’Adler) consacré au compositeur Heinrich Isaac.
L’étude de ce polyphoniste de la Renaissance n’est pas sans relation avec les choix du jeune compositeur qui se
nourrira du contrepoint canonique d’Isaac dans les œuvres de sa première période avec la Passacaille op. 1 par
exemple, puis plus tard au moment de l’adoption de la série dodécaphonique (Symphonie op. 21).
♫ Webern, Passacaille pour orchestre op. 1
Cette même année 1904, le jeune Webern se rend à Berlin dans le but d’étudier avec Hans Pfitzner, mais en
reviendra déçu après les propos très dépréciatifs que ce dernier porte sur la musique de Strauss et de Mahler.
De retour à Vienne, et sous la forte impression de l’audition de Verklärte Nacht, il intègre les cours de Schoen-
berg, bientôt rejoint par Berg.
Lorsque Schoenberg quitte Vienne pour Berlin en 1911, Webern le suit et participe activement à la vie musicale
de son maître. Parallèlement, sa vie professionnelle se développe en tant que chef d’orchestre dans des
théâtres (Innsbruck en 1909, Bad Teplitz et Danzig en 1910, Prague en 1911, Stettin en 1912) où il reste fort
peu de temps à chaque fois, manifestant ainsi un malaise et une instabilité qui seront récurrentes par la suite.
Cette époque correspond à la période « atonale » de sa musique, marquée par un extrême souci de concentra-
tion. Marié à sa cousine Wilhelmine en 1911, Webern est mobilisé en 1915, puis habite Prague avant de re-
joindre Schoenberg à Mödling, dans la banlieue de Vienne, en 1917. Il abandonnera la particule « von » de son
nom en 1918.
Les années d’après-guerre sont surtout marquées par la « Société d’exécutions viennoises privées » (1918-
1922) imaginée par Schoenberg et dans laquelle ses élèves sont fortement mis à contribution (117 concerts
consacrés à la musique essentiellement contemporaine.) C’est également l’époque où Schoenberg met au point
sa « méthode de douze sons », immédiatement adoptée par Webern dès 1925 (à partir des Lieder op. 17 et
18), et qu’il utilisera de façon beaucoup plus rigoureuse que son maître.
Après plusieurs tentatives infructueuses, Webern tiendra finalement deux séries de conférences consacrées à la
musique de douze sons en 1932-1933, publiées après sa mort en 1960, d’après les notes de son élève Willy
Reich sous le titre de Chemin vers la nouvelle musique. L’activité de chef de chœur de Webern à partir de 1921,
puis de chef d’orchestre en 1927 lui apportent une certaine renommée, en particulier dans le répertoire des
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 47
symphonies de Mahler dont il est l’un des grands interprètes. Il mène, en tant que chef invité, une carrière qui
le conduira notamment à Londres jusqu’en 1936.
Après le départ de Schoenberg en 1933 et la mort de Berg en 1935, Webern est de plus en plus isolé et vit
dans des conditions précaires. Cette période voit néanmoins son engagement en faveur du national-socialisme,
alors que son nom figure sur la sinistre liste de « l’art dégénéré ». La guerre accentue sa solitude qu’il com-
pense par sa relation avec la poétesse Hildegard Jone à qui il empruntera plusieurs textes pour ses Lieder et
ses cantates. Son fils Peter, mobilisé, est tué en 1945, et la mort brutale du compositeur quelques mois après
met fin à une œuvre restée confidentielle pendant plus de dix ans. Les différentes versions données de sa mort
– le compositeur a été abattu par un soldat américain – ont voulu faire croire à une « erreur tragique » et à de
sombres histoires d’implication de ses gendres dans le marché noir. En réalité, ceux-ci, nazis engagés et actifs,
sont plus vraisemblablement à l’origine de cet événement, Webern ayant plus que probablement protégé leur
fuite en tentant de faire diversion.
Catherine Miller – IMEP Cours d’histoire approfondie de la musique C2B1 (2018-2019) 48
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Néoclassicisme GuéantDocument6 pagesCours Néoclassicisme Guéantmathildedambrine13Pas encore d'évaluation
- Erik SatieDocument14 pagesErik SatieKazakbrick MappingPas encore d'évaluation
- Livret HommageDocument2 pagesLivret HommageНадеждаPas encore d'évaluation
- Les comédies musicales: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLes comédies musicales: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- DP Les Caprices de MarianneDocument34 pagesDP Les Caprices de MarianneeugenieboivinPas encore d'évaluation
- La Machine infernale de Jean Cocteau (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)D'EverandLa Machine infernale de Jean Cocteau (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)Pas encore d'évaluation
- Booklet GainsbourgDocument18 pagesBooklet GainsbourgJean DurandPas encore d'évaluation
- Jazz SatieDocument26 pagesJazz SatieVincenzo Di GioiaPas encore d'évaluation
- Milhaud 2003Document86 pagesMilhaud 2003kronos_muc80% (5)
- Histoire de La Chanson FrançaiseDocument5 pagesHistoire de La Chanson FrançaiseChecho DonPas encore d'évaluation
- Repères - Le Classicisme - Retrouver L'idéal AntiqueDocument14 pagesRepères - Le Classicisme - Retrouver L'idéal Antiqueludovic.lheureuxPas encore d'évaluation
- Théodore de Banville, 1823Document8 pagesThéodore de Banville, 1823Shorena KhaduriPas encore d'évaluation
- Un Aperçu de La Musique de Chambre Française Au Xixe SiècleDocument10 pagesUn Aperçu de La Musique de Chambre Française Au Xixe SiècleBelén Ojeda RojasPas encore d'évaluation
- F3-4 Artistes Incompris IDF4Document4 pagesF3-4 Artistes Incompris IDF4cernu nnosPas encore d'évaluation
- Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLes Fleurs du mal de Charles Baudelaire: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L'Histoire de La Musique FrancaiseDocument18 pagesL'Histoire de La Musique FrancaiseDaiana IlcuPas encore d'évaluation
- DP La Belle de Cadix VYDocument23 pagesDP La Belle de Cadix VYeugenieboivinPas encore d'évaluation
- Alcools d'Apollinaire: Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandAlcools d'Apollinaire: Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Edith PiafDocument16 pagesEdith PiafDumitruCocebanPas encore d'évaluation
- Jean-Pierre Thibaudat Théâtre Français ContemporainDocument162 pagesJean-Pierre Thibaudat Théâtre Français ContemporainMarcio Alan AnjosPas encore d'évaluation
- berlioz, encore et pour toujours: actes du cycle hector berlioz, arras 2015D'Everandberlioz, encore et pour toujours: actes du cycle hector berlioz, arras 2015Pas encore d'évaluation
- SEVERAC Centenaire 2021Document445 pagesSEVERAC Centenaire 2021ANTONIO COLL DE LA PUERTA ORUSPas encore d'évaluation
- Berlioz - Fiche BiographiqueDocument4 pagesBerlioz - Fiche BiographiqueMickael VatinPas encore d'évaluation
- Antigone de Jean Anouilh (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frD'EverandAntigone de Jean Anouilh (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture des romans classiques et modernes avec Profil-Litteraire.frPas encore d'évaluation
- Un hollandais à Paris en 1891: Sensations de littérature et d'artD'EverandUn hollandais à Paris en 1891: Sensations de littérature et d'artPas encore d'évaluation
- Edith PiafDocument2 pagesEdith PiafEDINA ELENA EŞANUPas encore d'évaluation
- Saule Metinis (1) BBDocument26 pagesSaule Metinis (1) BBsaule valentinaviciutePas encore d'évaluation
- 2022 10 03 Hugo en Musique SavhDocument155 pages2022 10 03 Hugo en Musique SavhelisadehalleuxPas encore d'évaluation
- Le petit Renoir: Un livre d'art amusant et ludique pour toute la famille !D'EverandLe petit Renoir: Un livre d'art amusant et ludique pour toute la famille !Pas encore d'évaluation
- Paul Cézanne, précurseur du cubisme: Quand la couleur crée la formeD'EverandPaul Cézanne, précurseur du cubisme: Quand la couleur crée la formePas encore d'évaluation
- Rrock - Violoncello - VioloncelloDocument2 pagesRrock - Violoncello - VioloncelloPierreFontenellePas encore d'évaluation
- Ruvo Fuera - Partition ComplèteDocument7 pagesRuvo Fuera - Partition ComplètePierreFontenellePas encore d'évaluation
- Concerts Bon Barons Communiqué de PresseDocument1 pageConcerts Bon Barons Communiqué de PressePierreFontenellePas encore d'évaluation
- Kollmeier Poster V4Document1 pageKollmeier Poster V4PierreFontenellePas encore d'évaluation
- Kiasma Abbaye ProgrammeDocument2 pagesKiasma Abbaye ProgrammePierreFontenellePas encore d'évaluation
- Bach Leonhardt TranscriptionsDocument1 pageBach Leonhardt TranscriptionsPierreFontenellePas encore d'évaluation
- Reglt-EtudesMusicales 05 PDFDocument257 pagesReglt-EtudesMusicales 05 PDFPierreFontenellePas encore d'évaluation
- Répertoire Pour Chant Violoncelle Et PianoDocument1 pageRépertoire Pour Chant Violoncelle Et PianoPierreFontenelle100% (1)
- Zender WinterreiseDocument1 pageZender WinterreisePierreFontenellePas encore d'évaluation