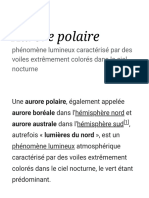Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Trois Cordes À Nos Arcs+vivre La Ville
Trois Cordes À Nos Arcs+vivre La Ville
Transféré par
Alice PirotealaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Trois Cordes À Nos Arcs+vivre La Ville
Trois Cordes À Nos Arcs+vivre La Ville
Transféré par
Alice PirotealaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Trois cordes à nos arcs.
La maîtrise de trois langues, à savoir de la langue d’origine et de deux langues étrangères en
plus, devrait permettre de préserver la diversité culturelle de l’Europe communautaire. Pourquoi
trois langues plutôt que deux qui semblent suffire à première vue ?
Si, en effet, l’Europe voulait se contenter d’une seule langue étrangère pour tous les Européens,
celle-ci serait nécessairement la même pour tous, et l’imagination devine que ce rôle
incomberait à l’anglais, du moins à la longue. Or l’anglophonie monolithique ne saurait satisfaire
à tous les besoins d’intercommunication en Europe, parce qu’elle porterait atteinte à la diversité
culturelle du Vieux Continent.
Il est vrai que l’anglais est aujourd’hui la langue la plus universellement acceptée dans le monde
et la plus employée dans les échanges inter linguistiques, parmi lesquels il y a lieu de
mentionner tout particulièrement les échanges scientifiques. C’est un fait historique.
Néanmoins, il faudra craindre que l’anglais, première langue étrangère, ne devienne très vite
l’unique langue étrangère du programme et que la culture linguistique de l’Europe ne se
transforme en monoculture, avec tous les risques que l’on peut deviner.
L’anglais occuperait cependant une très belle place comme deuxième langue étrangère au
programme. Cette position secondaire ne ferait guère de tort à une langue qui peut compter
dans le monde entier sur une très forte motivation extrinsèque accompagnant et renforçant
l’apprentissage scolaire.
Pour la position alors vacante de première langue étrangère au programme, la très riche culture
linguistique de l’Europe offre assez de candidats. Aucune des langues européennes ne sera
cependant privilégiée a priori.
Harald Weinrich, Trois cordes à nos arcs, « Le monde des débats »
Vivre la ville.
« Il faudrait construire les villes à la campagne. » Suggestion absurde au premier abord et
pourtant… C’est bien ce qui s’est passé en France, comme ailleurs, avec l’explosion de
l’urbanisation au XXe siècle. La ville a grignoté la campagne française et le pays compte
aujourd’hui trois fois plus de villes qu’il y a 150 ans. Cette concentration de la population était
inéluctable pour moderniser le pays, l’industrialiser, le « tertiairiser », le scolariser…
Mais, revers de cette urbanisation réussie, la crise des banlieues, extensions des villes, a éclaté
au début des années ‘80 et persiste aujourd’hui, plongeant les habitants et les municipalités
concernés dans un profound malaise. […] Violences et racisme sur fond de chômage, les
causes et les effets sont parfois trop vite confondus. Comment en est-on arrivé là ? Déjà en
1981, les événements de Minguettes, dans la banlieue lyonnaise, avaient soulevé pareille
question. Mais une fois les mesures d’urgence prises pour éviter un été « chaud », le problème
était retombé dans l’oubli. Il en ressort brusquement au début des années ‘90.
Aujourd’hui, un Français sur trois habite en banlieue. La banlieue, c’est Neuilly ou Écully –
espaces chics où se côtoient d’agréables villas agrémentées de jardins –, mais c’est aussi les
HLM1 dégradées en périphérie des grandes agglomérations. Ces grands ensembles ont été
construits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : la France manquait alors cruellement
de logements. La reconstruction, l’exode rural, et le babyboom des années ‘50 et ‘60 ont gonflé
la demande de logements urbains. Alors, on a construit des citésdortoirs qui pouvaient contenir
jusqu’à 10 000 logements. L’impératif était économique, mais la démarche répondait également
– contrairement à ce que l’on peut penser aujourd’hui – à un idéal social, voire architectural. Il
s’agissait de promouvoir, en une génération, une société plus juste, de fournir à tous un
logement salubre et confortable. Il s’agissait – utopie suprême – d’inventer un nouveau monde
social, dans lequel les différentes classes sociales pourraient se mêler, cohabiter au quotidien.
Christophe Sibiende, « Vivre la ville »
1 HLM : Habitation à loyer modéré
Vous aimerez peut-être aussi
- REFUND AMAZON Tech @LXREFUNDDocument5 pagesREFUND AMAZON Tech @LXREFUNDKyliann SimonPas encore d'évaluation
- Macroéconomie (Daron Acemoglu, David Laibson, John List)Document481 pagesMacroéconomie (Daron Acemoglu, David Laibson, John List)gix-92100% (2)
- Vendredi Ou La Vie Sauvage Michel TournierDocument57 pagesVendredi Ou La Vie Sauvage Michel TournierDiana Alexandra Groza50% (4)
- Unite 25 Manuel OpératoireDocument201 pagesUnite 25 Manuel OpératoireAbdessalem BougoffaPas encore d'évaluation
- Etude de Cas Kitea Td-1Document3 pagesEtude de Cas Kitea Td-1Hind AmhaouchPas encore d'évaluation
- M130030299 TFGHFDocument1 pageM130030299 TFGHFŠøû Fîäňé KaPas encore d'évaluation
- Cours 2 ISP Exploration BiologiqueDocument18 pagesCours 2 ISP Exploration Biologiqueouissam belPas encore d'évaluation
- Guide D'installation, D'utilisation Et de Maintenance: Pour Générateur Synchrone Man Port Gentil GabonDocument533 pagesGuide D'installation, D'utilisation Et de Maintenance: Pour Générateur Synchrone Man Port Gentil GabonArnaud Kevin Moussavou BivigouPas encore d'évaluation
- Base de Donnã©es Contacts RHDocument18 pagesBase de Donnã©es Contacts RHYoussef Ait OussaferPas encore d'évaluation
- Aurore Polaire - Wikipédia PDFDocument47 pagesAurore Polaire - Wikipédia PDFFati KONFEPas encore d'évaluation
- Fonction 4 - Eclairage, SignalisationDocument66 pagesFonction 4 - Eclairage, SignalisationAmina Samir100% (1)
- 2012.03.14.guide Technique CSTB Maitrise Legionelles ECSDocument81 pages2012.03.14.guide Technique CSTB Maitrise Legionelles ECSDja HdjaPas encore d'évaluation
- Polycopie Outil MS ProjectDocument31 pagesPolycopie Outil MS ProjectFaiq GmiraPas encore d'évaluation
- Université M'hamed Bougara: Boumerdes "Document6 pagesUniversité M'hamed Bougara: Boumerdes "Imad BounoughazPas encore d'évaluation
- G4S Morocco Contingency Plan Coronavirus 2019 Ncov EXTDocument20 pagesG4S Morocco Contingency Plan Coronavirus 2019 Ncov EXTRedaMezaouriPas encore d'évaluation
- Vérification Des Appareils de Levage Et de ManutentionDocument2 pagesVérification Des Appareils de Levage Et de Manutentionboussad1100% (1)
- Essais de Los Angeles: Résistance À L'usure Et Aux ChocsDocument6 pagesEssais de Los Angeles: Résistance À L'usure Et Aux ChocsYASSER ALLAOUAPas encore d'évaluation
- Leçon cm1Document6 pagesLeçon cm1Hayat TantanePas encore d'évaluation
- Découpage Et Programmation IFT AdulteDocument3 pagesDécoupage Et Programmation IFT Adulteazza benzartiPas encore d'évaluation
- Statistique Descriptive S4 PsychologieDocument18 pagesStatistique Descriptive S4 PsychologieHamidouu DliPas encore d'évaluation
- Secuencia Arqueologica Del Valle Del UpanoDocument40 pagesSecuencia Arqueologica Del Valle Del Upanomanolo ximenezPas encore d'évaluation
- Production Écrite Et Difficltés D - ApprentissageDocument12 pagesProduction Écrite Et Difficltés D - ApprentissageAhmed SaidPas encore d'évaluation
- Concepts, Etat Des Lieux Au Maroc Et Proposition D Une Démarche de Mise en Place Chez Les Industriels Et Les Prestataires Logistiques MarocainsDocument33 pagesConcepts, Etat Des Lieux Au Maroc Et Proposition D Une Démarche de Mise en Place Chez Les Industriels Et Les Prestataires Logistiques MarocainsKawtar IdemPas encore d'évaluation
- Synthese Sur Les ZeoliteDocument101 pagesSynthese Sur Les Zeolitehamada aminaPas encore d'évaluation
- Fiche Produit Onduleurs Eaton EX 700-1000-1500 VADocument2 pagesFiche Produit Onduleurs Eaton EX 700-1000-1500 VAformation.chezjerryPas encore d'évaluation
- Fiches Essais NoirDocument5 pagesFiches Essais NoirericnadPas encore d'évaluation
- Bonjour !: Paul GéraldyDocument12 pagesBonjour !: Paul Géraldyzorroche100% (1)
- Aldostérone Et VasopressineDocument5 pagesAldostérone Et Vasopressinecou couPas encore d'évaluation
- AZ-Envy FRDocument16 pagesAZ-Envy FRPI PICOPas encore d'évaluation
- 09 Puces NumerosDocument4 pages09 Puces NumerosAziz ZadriPas encore d'évaluation