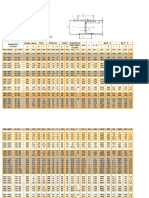Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Elh 659
Elh 659
Transféré par
clarinvalTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Elh 659
Elh 659
Transféré par
clarinvalDroits d'auteur :
Formats disponibles
Écrire l'histoire
Histoire, Littérature, Esthétique
15 | 2015
La fin de l’histoire
Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960,
un débat avec Lévi-Strauss et Foucault
Jean-Paul SARTRE, Critique de la raison dialectique (1960)
Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage (2008)
Michel FOUCAULT, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences
humaines (1966)
L’Arc, no 30, Sartre aujourd’hui (1966)
Sophie Wahnich
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/elh/659
DOI : 10.4000/elh.659
ISSN : 2492-7457
Éditeur
CNRS Éditions
Édition imprimée
Date de publication : 8 octobre 2015
Pagination : 208-212
ISBN : 978-2-271-08822-2
ISSN : 1967-7499
Référence électronique
Sophie Wahnich, « Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strauss et
Foucault », Écrire l'histoire [En ligne], 15 | 2015, mis en ligne le 08 octobre 2018, consulté le 23
septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/elh/659 ; DOI : https://doi.org/10.4000/elh.659
Ce document a été généré automatiquement le 23 septembre 2020.
Tous droits réservés
Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strau... 1
Sartre et la fin de l’histoire dans les
années 1960, un débat avec Lévi-
Strauss et Foucault
Jean-Paul SARTRE, Critique de la raison dialectique (1960)
Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage (2008)
Michel FOUCAULT, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences
humaines (1966)
L’Arc, no 30, Sartre aujourd’hui (1966)
Sophie Wahnich
RÉFÉRENCE
Jean-Paul SARTRE, Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard (Bibliothèque des
idées), 1960, 759 p.
Claude LÉVI-STRAUSS, La Pensée sauvage [Plon, 1962], dans Œuvres, Paris, Gallimard
(Bibliothèque de la Pléiade), 2008
Michel FOUCAULT, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard (Bibliothèque des sciences humaines), 1966, 400 p.
L’Arc, no 30, Sartre aujourd’hui, Aix-en-Provence, L’Arc, 1966, 101 p.
1 Dans un numéro de L’Arc consacré en 1966 à Jean-Paul Sartre, Bernard Pingaud prend la
mesure d’un monde qui a changé entre 1945 et 1960 en passant de l’existentialisme au
structuralisme, de la philosophie aux sciences humaines. Il fait lire ce volume à Jean-
Paul Sartre, dont la réponse, vive, est retranscrite dans le numéro. Elle met en fait au
centre de son propos non pas la mort de la philosophie, mais bien celle de l’histoire.
Sartre diagnostique un nouveau « refus de l’histoire » qui constituerait non pas
simplement la fin d’une séquence épistémologique au profit d’une autre, mais la fin de
la volonté de faire de l’histoire même. Au cœur de la tourmente, ceux qu’on a nommés
structuralistes. Car le volume est voué à prendre position sur le caractère dépassé ou
Écrire l'histoire, 15 | 2015
Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strau... 2
non de la philosophie sartrienne au regard du structuralisme. Parmi les auteurs de ce
numéro, Robert Castel intitule son article « Un beau risque » et revient sur les
questions posées par la Critique de la raison dialectique, parue en 1960. Pour Castel, il
s’agit en fait « de se déterminer par rapport à une option qui engage l’avenir de la
recherche1 ». Si l’on ne veut pas laisser s’éparpiller en savoirs multiples et hétérogènes
tous les savoirs positifs, il faut tenter de penser d’emblée la synthèse, et c’est bien là
que réside le « beau risque » théorisé par Sartre dans la Critique. Or chez Sartre ce
risque se nomme « Histoire comme Vérité de l’Homme ».
2 L’histoire serait le lieu de la synthèse des savoirs positifs sur l’homme. Ceux que l’on
nomme structuralistes reprochent alors à Sartre de faire de l’histoire une discipline
reine et de maintenir l’idée d’une « réciprocité des perspectives entre une vie
singulière et l’histoire humaine2 ». En fin de compte, ils lui reprochent de ne pas avoir
dissous le sujet humain doué de liberté et de responsabilités, d’avoir refusé le
décentrement total du sujet qui conduit à affirmer que l’homme ne parle pas mais qu’il
est parlé par un système de signes, de codes, de systèmes, que l’Histoire n’est pas celle
des hommes mais celle des structures qui agissent l’homme.
3 Il faut rappeler que dans la Critique, loin de maintenir un sujet libre à la manière
cartésienne, Sartre en fait un être dépendant de ce qu’il appelle le pratico-inerte,
l’ensemble de « la matière ouvrée » dans laquelle il inclut les choses pensées, qui sont
certes produites par les hommes mais font retour sur eux comme conditionnement. Or
justement ce conditionnement des hommes leur fait perdre leur liberté. Il y a donc qui
pro quo, car, de sujet libre transcendantal, il n’y en a plus dans la Critique, il n’y a que des
hommes conditionnés qui peuvent cependant faire quelque chose de ce qu’on a fait
d’eux, et c’est cet effort que Sartre appelle liberté, une liberté décentrée, entamée, mais
malgré tout une liberté. Or ce n’est pas comme simple individu que l’on peut
reconquérir cette liberté, mais dans de rares moments où un collectif d’hommes
sérialisés par l’inertie du pratico-inerte se transmue en un groupe dit en fusion,
longuement décrit dans la Critique à travers l’exemple de la prise de la Bastille et sous le
nom d’Apocalypse. Le terme de Malraux utilisé aussi par Sartre pour parler de la
Libération de Paris. La liberté ne se reconquiert que par l’acte collectif de se libérer.
C’est un effort, mais surtout une situation instable et, pour maintenir cette liberté,
l’effort doit l’aliéner dans un serment et produire un groupe assermenté, c’est-à-dire
institué par son Serment de rester libre.
4 Le groupe assermenté devient « exigence » par le Serment, donc pour Sartre par une
libre praxis et non par une action extérieure qui s’exercerait sur le groupe en fusion. La
praxis libre est alors maintenue sous condition de ce collectif où chacun vis-à-vis de
l’autre est le garant de la liberté, responsable ainsi historiquement de la possibilité de
se maintenir libre. La liberté ne serait que révolutionnaire. L’Histoire est alors le lieu de
ces sauts où des contradictions exacerbées puis résolues font advenir de nouvelles
formes de vie collectives instituées.
5 Lévi-Strauss, dans La Pensée sauvage, répond à Sartre tout au long de son livre, et plus
particulièrement dans son chapitre conclusif intitulé « Histoire et dialectique ». Il
déclare alors que Sartre fait de l’histoire « l’ultime refuge d’un humanisme
transcendantal : comme si, à la seule condition de renoncer à des moi par trop
dépourvus de consistance, les hommes pouvaient retrouver, sur le plan du nous,
l’illusion de la liberté3 ». Lévi-Strauss reproche surtout à Sartre de ne pas prendre en
compte dans son Histoire comme Vérité de l’Homme, l’histoire des hommes dits
Écrire l'histoire, 15 | 2015
Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strau... 3
sauvages. De fait, ces sociétés, selon Sartre, ne font pas de la rareté de la matière, des
biens économiques, un moteur historique, mais s’en accommodent pour vivre dans la
pure répétition. Selon Sartre, « il est vrai que beaucoup de groupes stabilisés dans la
répétition ont une histoire légendaire, mais cela ne prouve rien, car cette légende est
négation de l’Histoire et sa fonction est de réintroduire l’archétype aux moments sacrés
de la répétition4 ». C’est ainsi qu’il exclut de la « Vérité de l’Homme » l’histoire de ces
hommes-là.
6 Or Lévi-Strauss rappelle que ces hommes ont une histoire qui vise effectivement à
« être intemporelle5 ». Il renvoie à son chapitre précédent, « Le temps retrouvé », où il
explique comment cette histoire mythique ou légendaire articule synchronie et
diachronie dans des rituels complexes. Ainsi,
l’histoire mythique offre […] le paradoxe d’être simultanément disjointe et
conjointe par rapport au présent. Disjointe, puisque les premiers ancêtres étaient
d’une autre nature que les hommes contemporains : ceux-là furent des créateurs,
ceux-ci sont des copistes ; et conjointe puisque, depuis l’apparition des ancêtres, il
ne s’est rien passé.6
7 Il montre que les rites de contrôle opèrent du côté de la synchronie, quand les rites
historiques ou commémoratifs et de deuils opèrent du côté de la diachronie, les
premiers du passé vers le présent en confiant à des hommes vivants la charge de
personnifier de lointains ancêtres, les seconds du présent vers le passé en fabriquant
des figures héroïques. Ainsi change-t‑on le passé en présent, le présent en passé. Enfin,
dans l’histoire mythique le réel n’est pas vérité, il est l’évocation de la contingence qui
suscite des émotions.
8 Sont alors définies histoire chaude et histoire froide : celle de Sartre et de son groupe
en fusion est chaude, celle des sauvages et de la répétition, froide en opposition. Mais
pas plus les sauvages que les autres ne fabriquent une véritable coupure entre le passé
et le présent. Histoire chaude comme histoire froide fabriquent des manières de penser
ce lien et de le vivre. C’est pourquoi Lévi-Strauss affirme que la conception sartrienne
de l’histoire est proche de celle des primitifs exclus, et que le véritable problème posé
par la Critique de la raison dialectique est : « À quelle condition le mythe de la Révolution
française est-il possible7 ? » Lévi-Strauss, en marxiste, répond ainsi à Sartre qu’il ne
s’est guère éloigné des marxistes qu’il critique pour user de catégories fétichisées, et
qu’il produit lui aussi une histoire mythique – il faut entendre : une histoire qui n’a pas
de capacité à affirmer une vérité positive, ce qui pour Lévi-Strauss est le rôle de
l’homme de science.
9 Dans ce texte, l’anthropologue défend l’idée que l’histoire n’est pas une discipline qui
aurait un objet différent de l’anthropologie, mais qu’elle est une méthode, méthode où
les comparaisons et les classements se font par catégorie temporelle, ce qu’il nomme le
codage chronologique. Il distingue des classes de dates en fonction des intervalles de
temps qu’elles considèrent. Il conclut en affirmant : « L’histoire n’est pas liée à l’homme
ni à aucun objet particulier. Elle consiste entièrement dans sa méthode. […] L’histoire
mène à tout à condition d’en sortir8. » L’histoire est ainsi devenue dans la
démonstration de Lévi-Strauss une discipline scientifique auxiliaire de l’anthropologie
et de toutes les autres connaissances des sciences dites humaines.
10 Or ce sont cette méthode et la coupure qu’elle met en scène entre les différentes classes
de temps qui vont finalement être inaugurées par Michel Foucault dans Les Mots et les
Choses, et c’est avec lui que le débat le plus vif est engagé par Sartre dans le numéro de
Écrire l'histoire, 15 | 2015
Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strau... 4
L’Arc. Pour Sartre, Michel Foucault incarne ce qu’il appelle le « refus de l’histoire 9 ». Et
il entreprend de le démontrer.
Que trouvons-nous dans Les Mots et les Choses ? Non pas une « archéologie » des
sciences humaines. L’archéologue […] recherche les traces d’une civilisation
disparue pour essayer de la reconstruire. Il étudie un style qui a été conçu et mis en
œuvre par des hommes […], résultat d’une praxis dont l’archéologue retrace le
développement. Ce que Foucault nous présente, c’est […] une géologie. 10
11 Sartre entend par là que rien n’est dit sur la manière dont les hommes passent d’une
pensée à une autre, d’une couche épistémique à une autre, et que la véritable raison en
est que Foucault refuse de « faire intervenir la praxis, donc l’histoire 11 ». Sartre met
donc en équivalence histoire et praxis. Les hommes font leur histoire, car ils sont
habités de théories, d’épistèmês, de philosophies, peu importe le vocabulaire, qui les
conduisent à agir. Faire de l’histoire, c’est étudier cette action articulée au théorique, à
l’idéologique. Refuser d’étudier la praxis, c’est bien en finir avec l’Histoire.
12 Sartre déclare encore : « Certes, sa perspective reste historique. Il distingue des
époques, un avant et un après. Mais il remplace le cinéma par la lanterne magique, le
mouvement par une succession d’immobilités12. » Or cette pensée de l’histoire lanterne
magique est pour Sartre celle d’un savoir positif qui refuse le fameux « beau risque » de
Robert Castel, qui refuse la dialectique au profit de la certitude scientifique :
On dira que l’histoire est insaisissable en tant que telle, que toute théorie de
l’histoire est, par définition, « doxologique », pour reprendre le mot de Foucault.
Renonçant à justifier les passages, on opposera à l’histoire, domaine de
l’incertitude, l’analyse des structures qui, seule, permet la véritable investigation
scientifique.13
13 L’histoire mourrait de sa volonté d’être seulement scientifique, c’est-à-dire seulement
positive et analytique, en lieu et place d’être à la fois scientifique, idéologique et
politique, c’est-à-dire dialectique et synthétique. Pour Sartre, cette mort ne vise pas
l’histoire seulement, mais bien une philosophie qu’il déclare être la tâche du temps
présent : le marxisme. « Derrière l’histoire, bien entendu, c’est le marxisme qui est visé.
[…] Faute de pouvoir “dépasser” le marxisme, on va donc le supprimer 14. » Or, renoncer
au marxisme, pour Sartre, c’est « renoncer à comprendre le passage 15 ». Or c’est cette
notion qui rend le savoir historique incertain, car ce passage est continu et mouvant,
« toujours en train de désagréger en produisant, et de produire en désagrégeant ; […]
l’homme est perpétuellement déphasé par rapport aux structures qui le conditionnent,
parce qu’il est autre chose que ce qui le fait être ce qu’il est. Je ne comprends donc pas
qu’on s’arrête aux structures : c’est pour moi un scandale logique 16. »
14 La fin de l’histoire serait la réalisation de ce scandale.
NOTES
1. Robert CASTEL, « Un beau risque. Sartre et les sciences sociales », L’Arc, op. cit., p. 20‑26, ici p. 26.
2. Jean-Paul SARTRE, op. cit., p. 156, cité par Robert Castel, p. 26.
3. Claude LÉVI-STRAUSS, op. cit., p. 841.
Écrire l'histoire, 15 | 2015
Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strau... 5
4. Jean-Paul SARTRE, Critique de la raison dialectique, nouv. éd., texte établi et annoté par Arlette
Elkaïm-Sartre, Gallimard, 1985, p. 238.
5. Claude LÉVI-STRAUSS, op. cit., p. 841.
6. Ibid., p. 811.
7. Ibid., p. 832.
8. Ibid., p. 841.
9. Jean-Paul SARTRE, « Jean-Paul Sartre répond », L’Arc, op. cit., p. 87‑96, ici p. 87.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Ibid.
13. Ibid., p. 88.
14. Ibid.
15. Ibid., p. 95.
16. Ibid.
INDEX
oeuvrecitee Critique de la raison dialectique – (Jean-Paul Sartre‚ 1960), Pensée sauvage (La) –
(Claude Lévi-Strauss‚ 2008), Mots et les Choses (Les). Une archéologie des sciences humaines –
(Michel Foucault‚ 1966), Sartre aujourd’hui – (L’Arc‚ n° 30‚ 1966)
AUTEURS
SOPHIE WAHNICH
Sophie Wahnich est directrice de recherche au CNRS en histoire et science politique, au Tram/
IIAC de l’EHESS. Spécialiste de la période révolutionnaire, elle interroge depuis l’expérience
cosmopolitique du XVIIIe siècle les représentations actuelles de l’altérité, de la violence, de la
guerre, en mettant au cœur du questionnement le rôle d’une raison sensible à l’œuvre. Elle a
publié de nombreux ouvrages sur ces domaines de recherche : Les Émotions, la Révolution française
et le présent (CNRS Éd., 2009) ; L’Impossible Citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française
(A. Michel, 1997, 2010) ; La Longue Patience du peuple. 1792, naissance de la République (Payot, 2008) ;
La Liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme (La Fabrique, 2003).
Écrire l'histoire, 15 | 2015
Vous aimerez peut-être aussi
- Chinois A1 À B1Document4 pagesChinois A1 À B1Hanitsoa RatianariveloPas encore d'évaluation
- Le Monde Jacques Derrida Un HomageDocument10 pagesLe Monde Jacques Derrida Un HomageOlga NancyPas encore d'évaluation
- Pot de Citation Inspirante ImprimableDocument17 pagesPot de Citation Inspirante ImprimableScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Cours FrancaisDocument34 pagesCours FrancaisLéon NGOMSU ITEMBEPas encore d'évaluation
- Responsabilité Sociétale Ressources Humaines by Gouiran, Monique (Gouiran, Monique)Document234 pagesResponsabilité Sociétale Ressources Humaines by Gouiran, Monique (Gouiran, Monique)Rachid Maghniwi100% (2)
- Mœurs Et Histoire Des Peaux-Rouges PDFDocument302 pagesMœurs Et Histoire Des Peaux-Rouges PDFyahya333Pas encore d'évaluation
- Annie Ernaux Une Oeuvre de l'Entre-DeuxDocument8 pagesAnnie Ernaux Une Oeuvre de l'Entre-DeuxOlga NancyPas encore d'évaluation
- Qu Est Ce Qu Une EpoqueDocument20 pagesQu Est Ce Qu Une EpoqueOlga NancyPas encore d'évaluation
- La Logique Du PraticableDocument39 pagesLa Logique Du PraticableOlga NancyPas encore d'évaluation
- Les Perspectives Constructivistes Et Consturctionnistes de L'identitéDocument15 pagesLes Perspectives Constructivistes Et Consturctionnistes de L'identitéOlga NancyPas encore d'évaluation
- A Propos Des Enjeux Struturalisme ContemporaineDocument13 pagesA Propos Des Enjeux Struturalisme ContemporaineOlga NancyPas encore d'évaluation
- Eléments D'une Philosophie de L'espace Chez Ernest CassirerDocument8 pagesEléments D'une Philosophie de L'espace Chez Ernest CassirerOlga NancyPas encore d'évaluation
- Gaston Bachelard Conference À Brigitte BourdonDocument10 pagesGaston Bachelard Conference À Brigitte BourdonOlga NancyPas encore d'évaluation
- MDM SihemDocument14 pagesMDM SihemRim KoumiPas encore d'évaluation
- Cours Sociologie de La Communication L2 UCF2 YOPDocument41 pagesCours Sociologie de La Communication L2 UCF2 YOPyvansachiel100% (1)
- Avant-Propos Texte 1Document5 pagesAvant-Propos Texte 1solianefrancoisPas encore d'évaluation
- Une Danse AnalytiqueDocument4 pagesUne Danse AnalytiqueBill ClovenskyPas encore d'évaluation
- A1 PE DescripteursDocument1 pageA1 PE DescripteursMohamed Farouk Ahmed FRPas encore d'évaluation
- S'entrainer À Bien ÉcrireDocument3 pagesS'entrainer À Bien ÉcrireHajar TahaPas encore d'évaluation
- La Rue Des Enfants, Les Enfants Des Rues (Marie Morelle (Morelle Marie) ) (Z-Library)Document298 pagesLa Rue Des Enfants, Les Enfants Des Rues (Marie Morelle (Morelle Marie) ) (Z-Library)Zalissa NikiémaPas encore d'évaluation
- Les Nombres SurréelsDocument78 pagesLes Nombres SurréelsgouluPas encore d'évaluation
- Les Fragilites Lie Au Transformation SocialeDocument4 pagesLes Fragilites Lie Au Transformation Socialeririkaoura1Pas encore d'évaluation
- All PDFDocument5 pagesAll PDFAlexis قران كريمPas encore d'évaluation
- Concours GreffierDocument2 pagesConcours GreffierRodriguez RAZANADRAFENOPas encore d'évaluation
- Quelques Modalités D'attribution AnthroponymiquesDocument14 pagesQuelques Modalités D'attribution AnthroponymiquesNesher KoffiPas encore d'évaluation
- Maniere de Voir-186Document100 pagesManiere de Voir-186AMADOU CISSEPas encore d'évaluation
- Tabla Perfiles IRDocument6 pagesTabla Perfiles IRleonciomavarezPas encore d'évaluation
- Bonjour Et Bienvenue Dans Ce CoursDocument29 pagesBonjour Et Bienvenue Dans Ce CoursMame Sidy SeckPas encore d'évaluation
- Écriture Hiéroglyphique Égyptienne - WikipédiaDocument24 pagesÉcriture Hiéroglyphique Égyptienne - WikipédiaAbdoul Kader ouedraogoPas encore d'évaluation
- La Médina de TunisDocument19 pagesLa Médina de TunisDorra Masri LahmarPas encore d'évaluation
- La Philosophie Pour Enfants Et L'éducation Des Émotions Philosophie Pour Les Enfants À L'université LavalDocument8 pagesLa Philosophie Pour Enfants Et L'éducation Des Émotions Philosophie Pour Les Enfants À L'université LavalSOLEDAD HERNANDEZ BERMUDEZPas encore d'évaluation
- Les Connecteurs LogiquesDocument1 pageLes Connecteurs LogiquesMorsi Abir KNPas encore d'évaluation
- Le Métier de SociologueDocument360 pagesLe Métier de SociologuetomasfrereaPas encore d'évaluation
- 345 Citations PositivesDocument27 pages345 Citations Positivesch'art ArtPas encore d'évaluation
- Le Peuple Et La Langue (... ) Oppert Jules bpt6k6208272b PDFDocument322 pagesLe Peuple Et La Langue (... ) Oppert Jules bpt6k6208272b PDFSARA BARKHORDARPas encore d'évaluation
- Roland Jaccard - La Tentation NihilisteDocument7 pagesRoland Jaccard - La Tentation NihilisteRamon MercaderPas encore d'évaluation
- Les Modaux en AnglaisDocument16 pagesLes Modaux en AnglaisDébora YAOPas encore d'évaluation
- M1 Sociologie - Sociologie Politiques Sociales Territorialisées Et Développement Social UrbainDocument2 pagesM1 Sociologie - Sociologie Politiques Sociales Territorialisées Et Développement Social UrbainsamiPas encore d'évaluation
- Demo Critere 2Document4 pagesDemo Critere 2iullyanaelenaPas encore d'évaluation