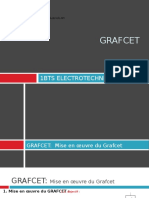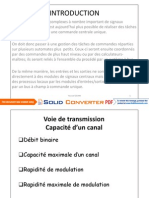Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Support de Cours - API - Chap1
Support de Cours - API - Chap1
Transféré par
JetsetasianboiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Support de Cours - API - Chap1
Support de Cours - API - Chap1
Transféré par
JetsetasianboiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mohamed Khider - Biskra
Faculté des Sciences et de la Technologie
Département de Génie Electrique
Support de cours
Automatismes Industriels
Niveau : 3ème année Licence
Génie Electrique
Préparé par : Dr. SAADOUNE Achour
Année Universitaire 2012/2013
Automatismes Industriels
Table des matières
Chapitre1 : Introduction aux systèmes automatisés
1.1 Définitions
1.2 Objectifs de l’automatisation
1.3 Structure des systèmes automatisés
1.4 Chaine fonctionnelle
1.5 Eléments de la Partie Opérative et de la Partie Commande
1.6 Organisation d’une chaine fonctionnelle
1.7 Cahier des charges :
Chapitre2 : Le GRAFCET
2.1 Définition
2.2 Eléments du grafcet
2.3 Règles d’évolution d’un GRAFCET
2.4 Structure de base d’un GRAFCET
2.5 Mise en équation du grafcet
2.6 Gestion des modes Marche/Arrêt et Arrêt d'Urgence
2.7 Technologies de réalisation
2.7.1 Réalisation par câblage
2.72 Conversions du GRAFCET en langage à contact (Ladder)
Bibliographies.
2 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
Chapitre1 : Introduction aux systèmes automatisés
1.1 Définitions
Une machine ou un système est dit automatisé lorsque le processus qui permet de passer d’une
situation initiale à une situation finale se fait sans intervention humaine et que ce comportement
est répétitif chaque fois que les états qui caractérisent la situation initiale sont remplis.
C’est un ensemble Organisé de moyens techniques interconnectés à des moyens de commande et
de contrôle qui assurent un fonctionnement reproductible plus ou moins indépendant des
interventions humaines.
1.2 Objectifs de l’automatisation
Un système automatisé doit dans une certaine mesure reconstituer tous les mouvements dont un
homme a besoin pour mener à bien un travail déterminé .On devra, dès sa conception, tenir
compte des contraintes de maintenance.
Dans l’industrie, les productions de grandes séries sont partiellement ou entièrement
automatisées. Le produit est donc fabriqué sur une succession de postes de travail robotisés et ne
demande qu’une intervention humaine limitée.
L’automatisation a pour but d’améliorer la compétitivité du produit face à la concurrence.
L’automatisation d’une chaîne de production permet :
La réduction des coûts de production quand l’investissement initial est amorti, l’augmentation
des cadences de production, L’amélioration de la qualité du produit lié à la précision des
actionneurs, Remplacer l’homme dans des travaux pénibles et dangereux. L’automatisme pourra
être :
Simple ;
Ou d’une complexité telle que l’enchaînement des mouvements élémentaires demandera une
intelligence et une étude beaucoup plus grande.
Il devra être pourvu de moyens analogues à ceux de l’homme dans la mise en œuvre de sa force
(moteurs, vérins) et de sa capacité à mesurer une grandeur (capteurs).
3 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
1.3 Structure des systèmes automatisés
Un système automatisé peut être décomposé en deux parties distinctes.
Une partie commande reçoit les informations de l’opérateur ou des capteurs et commande la
partie opérative qui doit exécuter les opérations demandées.
1.3.1 Partie Opérative : La partie opérative est l’ensemble des moyens techniques qui assurent
la production. On retrouve dans cette partie, les actionneurs, les pré-actionneurs les effecteurs et
les capteurs.
1.3.2 Partie Commande : Elle regroupe l’ensemble des constituants et des composants
permettant de traiter l’information et assurant le fonctionnement de la partie opérative.
La partie commande peut être réalisée par la logique câblée ou la logique programmée.
Les parties commandes des systèmes automatisés doivent :
Envoyer des informations vers la partie opérative : Ordres
Recevoir des informations sur l’état de la partie opérative ou de son environnement :
Comptes-rendus
Dialoguer avec l’opérateur par l’intermédiaire d’un pupitre : Consignes et messages.
Consignes Ordres
Opérateur Partie commande Partie opérative
Messages
Comptes-rendus
Ce mode de commande est dit mode de commande avec compte-rendu d'exécution (ou boucle
fermée).
Dans le mode de commande directe (ou boucle ouverte), la partie commande envoie des ordres à
la partie opérative, mais elle ne vérifie pas s'ils ont bien été effectués. (Exemple des feux de
croisement : le système ne vérifie pas si les feux se sont bien allumés).
Ordres
Partie commande Partie opérative
4 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
Le système de commande en boucle fermée est beaucoup plus fiable car ce système vérifie que
les ordres donnés ont bien été effectués. (Exemple d'un passage à niveau : la barrière ne se lève
que si le système est sûr que le train est bien passé).
1.4 Chaine fonctionnelle
Tout système automatisé, plus ou moins complexe, peut être décomposé en chaînes
fonctionnelles.
Une chaîne fonctionnelle est l'ensemble des constituants organisés en vue de l'obtention d'une
tâche opérative, c'est-à-dire d'une tâche qui agit directement sur la matière d'oeuvre.
Exemples : Serrer une pièce, percer une pièce, prendre un objet, déplacer une charge, etc.
1.5 Eléments de la Partie Opérative et de la Partie Commande
1.5.1 Actionneurs : Convertissent l’énergie qu’ils reçoivent des pré-actionneurs en une autre
énergie utilisée par les effecteurs. Ils peuvent être Pneumatiques, Hydrauliques ou Electriques.
Exemple :
Vérin pneumatique Moteur électrique
1.5.2 Pré-actionneurs : Distribuent l’énergie aux actionneurs à partir des ordres émis par la
parie commande.
Présence ordre
Energie stockée Energie distribuée
Distribuer l’énergie
PRE-ACTIONNEURS
5 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
Exemple :
Distributeur pneumatique Contacteur de puissance
(pour les vérins pneumatiques) (pour les moteurs électriques)
1.5.3 Capteurs : Renseignent la partie commande sur l’état de la partie opérative, Ils peuvent
détecter des positions, des pressions, des températures, des débits…
Les capteurs transforment la variation de grandeur physique liée au fonctionnement de
l’automatisme en informations compréhensibles par la partie commande.
Peuvent être électriques ou pneumatiques. Signaux du type TOR, Analogique ou Numérique.
Energie électrique ou pneumatique
Information physique Traduire une Information codée
information
CAPTEURS
Exemple:
Capteur de proximité Fin de course
6 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
1.5.4 Les effecteurs : les effecteurs ils utilisent l’énergie convertie par les actionneurs pour
produire un effet utile.
Dans une chaine d’action, l’effecteur est l’organe terminal qui agit directement sur le produit
traité par le système.
Exemple
Pince Ventouse
1.5.5 Traitements : Dans les systèmes modernes, l’API assure de plus en plus cette fonction.
Certains systèmes purement pneumatiques peuvent être contrôlés par des séquenceurs ou des
fonctions logiques.
Exemple :
Séquenceurs pneumatique
Automate programmable
1.5.6 Dialogue : L’unité de dialogue permet à l’opérateur d’envoyer des consignes à l’unité de
traitement et de recevoir de celle-ci des informations sur le déroulement du processus.
Exemple :
Pupitre de commande (dialogue Homme/Machine)
7 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
1.6 Organisation d’une chaine fonctionnelle
Les composants d’automatisation d’une chaine fonctionnelle sont organisés de la manière suivante :
Partie commande Partie opérative
Consignes Energie de puissance
Interface de sorties Pré-actionneurs Actionneurs Effecteurs
Pupitre
Convertir Agir sur le
Communiquer Transmettre les ordres Gérer l’énergie
l’énergie produit
et dialoguer
O Unité centrale
p Ordre Energie Energie
é distribuée mécanique Constituants
r Traiter les informations opératifs
a s
agissant sur le
t
e processus
Interface d’entrées Capteurs
u physique ou le
Adapter les informations Acquérir et transmettre
r produit
l’information
Information
Information compatible
Grandeur
visuelles
physique
Constituants de communication
Communiquer avec d’autres systèmes
8 Dr. SAADOUNE Achour
Automatismes Industriels
L’opérateur (personne qui va faire fonctionner le système) va donner des consignes à la partie
commande. Celle-ci va traduire ces consignés en Ordres qui vont être exécutes par la partie
Opérative.
Une fois les Ordres accomplis, la partie opérative va le signaler à la partie commande qui va à
son tour le signaler à l’opérateur. Ce dernier pourra donc dire que le travail à bien été réalisé.
1.7 Cahier des charges
Le cahier des charges est le descriptif fourni par l’utilisateur au concepteur de l’automatisme
pour lui indiquer les différents modes de marches et les sécurités que devra posséder
l’automatisme.
Ce cahier des charges décrit le comportement de la partie opérative par rapport à la partie
commande.
On utilise des outils de description :
Le GRAFCET, les organigrammes, les logigrammes, les chronogrammes,…pour décrire le
cahier des charges.
9 Pr. A.SAADOUNE
Vous aimerez peut-être aussi
- Materéalisation GRAFCET EleveDocument46 pagesMateréalisation GRAFCET Elevemoutched100% (1)
- SignalDocument130 pagesSignalSonia Eloued50% (2)
- Bit Set Mots System eDocument136 pagesBit Set Mots System eStef CPas encore d'évaluation
- Automate (API) 1Document10 pagesAutomate (API) 1Mohamed BoucharebPas encore d'évaluation
- Logique Floue MemoDocument108 pagesLogique Floue Memofahd ghabiPas encore d'évaluation
- Systemes AsservisDocument6 pagesSystemes AsservisJalil AkaabounePas encore d'évaluation
- Manuel Gainable - TAOfr FRDocument41 pagesManuel Gainable - TAOfr FRMANUPas encore d'évaluation
- Lab Cisco Mac AddressDocument9 pagesLab Cisco Mac AddressghaniPas encore d'évaluation
- TP 2 A 1Document10 pagesTP 2 A 1Samagassi SouleymanePas encore d'évaluation
- MicroProcesseurs Et ChipSetDocument44 pagesMicroProcesseurs Et ChipSetHachem Elyousfi0% (1)
- Cours UP Beguenane 1Document21 pagesCours UP Beguenane 1Souhaib Louda100% (1)
- Cours Microcontrôleur Microprocesseur 57 PDFDocument81 pagesCours Microcontrôleur Microprocesseur 57 PDFLaudens NzoningPas encore d'évaluation
- Utilisation de Pl7proDocument9 pagesUtilisation de Pl7promath62210Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - SDF - ConceptsDocument27 pagesChapitre 1 - SDF - ConceptsMohaman GonzaPas encore d'évaluation
- 01 IntroductionDocument24 pages01 IntroductionmounrPas encore d'évaluation
- 5042 Bts Cira U41 Instrumentation Et Regulation 2014Document22 pages5042 Bts Cira U41 Instrumentation Et Regulation 2014Gatan TchouteizoPas encore d'évaluation
- Fox PDFDocument12 pagesFox PDFAnes Laoufi100% (1)
- L'Instrumentation Et La Régulation Industrielle2Document85 pagesL'Instrumentation Et La Régulation Industrielle2Soufian RalfPas encore d'évaluation
- SNCC Et CapteursDocument75 pagesSNCC Et Capteursfaradi fatimaPas encore d'évaluation
- 20150410130452amdec Maintenance v11Document48 pages20150410130452amdec Maintenance v11Akram SahliPas encore d'évaluation
- Systemes de Controle-CommandeDocument51 pagesSystemes de Controle-Commandemed.chakib1990Pas encore d'évaluation
- FBr16 - Sécurité Fonctionnelle Des Systèmes Relatifs À La Sécurité PDFDocument8 pagesFBr16 - Sécurité Fonctionnelle Des Systèmes Relatifs À La Sécurité PDFalain goloPas encore d'évaluation
- Chapitre IV - Cours - TEAI - 4Document10 pagesChapitre IV - Cours - TEAI - 4Wã Lïd SãådätPas encore d'évaluation
- Capteurs Mes IndustrDocument115 pagesCapteurs Mes IndustrKhaled SpePas encore d'évaluation
- 301 A09 Lab1 Introduction Au ControlLogix Etape 1Document40 pages301 A09 Lab1 Introduction Au ControlLogix Etape 1Costel Carausu100% (7)
- AMDEC SiteDocument27 pagesAMDEC SiteOthmane ElmouatamidPas encore d'évaluation
- Chapitre 9 - Liaison Serie RS232Document77 pagesChapitre 9 - Liaison Serie RS232the.diable.tristrePas encore d'évaluation
- Support de Cours - API - Chap2 - Le GRAFCETDocument23 pagesSupport de Cours - API - Chap2 - Le GRAFCETJetsetasianboiPas encore d'évaluation
- Cours - Traitement Du Signal PDFDocument264 pagesCours - Traitement Du Signal PDFDhahri Yadhahri100% (1)
- Cours Elec Num 1Document17 pagesCours Elec Num 1vyasnaikoPas encore d'évaluation
- Architecture Système AutomatiséDocument2 pagesArchitecture Système AutomatiséterminatorfezPas encore d'évaluation
- Rapport de Formation Foxboro DCSDocument3 pagesRapport de Formation Foxboro DCSScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Instr Indus Slides2020 2021Document118 pagesInstr Indus Slides2020 2021Ahmed IdouPas encore d'évaluation
- 5 - Filtrage AnalogiqueDocument25 pages5 - Filtrage AnalogiqueAntipas Komi Mawuli AziawaPas encore d'évaluation
- Le GrafcetDocument59 pagesLe GrafcetSalah Eddine ChouikhPas encore d'évaluation
- CS 3000 en FrancaisDocument4 pagesCS 3000 en FrancaisHadjer zitPas encore d'évaluation
- Securite Par Automate Programmable Ns224Document0 pageSecurite Par Automate Programmable Ns224saospiePas encore d'évaluation
- Catalogue Formation ALGERIEDocument92 pagesCatalogue Formation ALGERIEMBT TechnologyPas encore d'évaluation
- Réseaux Locaux Industriels2Document88 pagesRéseaux Locaux Industriels2nachit01Pas encore d'évaluation
- ALG0003542 SDTM - Equipements Et Installations Techniques, Salle de ContrôleDocument50 pagesALG0003542 SDTM - Equipements Et Installations Techniques, Salle de ContrôleAyoub MagroudPas encore d'évaluation
- Faces Avant InstrumentsDocument19 pagesFaces Avant InstrumentsAnes LaoufiPas encore d'évaluation
- Automatismes IndustrielsDocument2 pagesAutomatismes IndustrielsbaptichosendyPas encore d'évaluation
- Matlab M FilesDocument36 pagesMatlab M FilesAziz AzyarPas encore d'évaluation
- Sed API PDFDocument61 pagesSed API PDFninaPas encore d'évaluation
- Automate Partie AnalogiqueDocument153 pagesAutomate Partie AnalogiqueMassin agnawaPas encore d'évaluation
- TD FiltrageDocument4 pagesTD FiltrageBassel Assaad100% (1)
- Contr Ô LeurDocument59 pagesContr Ô LeurJã Wād SnüPas encore d'évaluation
- 040 2 Centum VP Ingénierie ExpertDocument2 pages040 2 Centum VP Ingénierie ExpertRabah AmidiPas encore d'évaluation
- Démarreur ProgressifDocument78 pagesDémarreur ProgressifHamza ZianePas encore d'évaluation
- Instrumentation RégulationDocument3 pagesInstrumentation RégulationhamzaPas encore d'évaluation
- Archi PKSDocument13 pagesArchi PKSsalaheddinnePas encore d'évaluation
- Siemens LogoDocument3 pagesSiemens Logoمحمد رمضانPas encore d'évaluation
- Pumps (ACF)Document47 pagesPumps (ACF)Mohamed Moha60% (5)