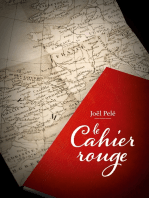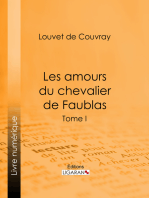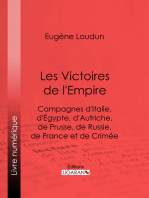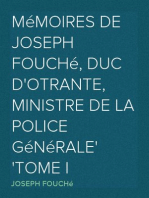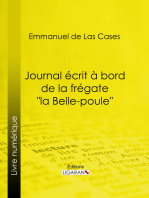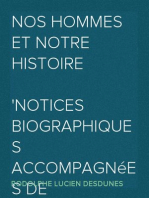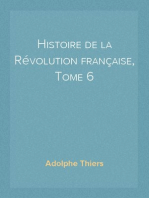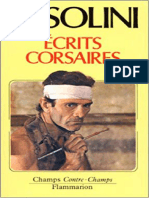Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Au Théâtre Avec Staline, Charles de Gaulle
Transféré par
Philippe GauthierTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Au Théâtre Avec Staline, Charles de Gaulle
Transféré par
Philippe GauthierDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mémoires de Guerre, Charles de Gaulle, tome 3 (extraits)
Staline était possédé de la volonté de puissance. Rompu par une vie de complots à
masquer ses traits et son âme, à se passer d'illusions, de pitié, de sincérité, à voir en
chaque homme un obstacle ou un danger, tout chez lui était manœuvre, méfiance et
obstination. La révolution, le parti, l'État, la guerre, lui avaient offert les occasions et les
moyens de dominer. Il y était parvenu, usant à fond des détours de l'exégèse marxiste et
des rigueurs totalitaires, mettant au jeu une audace et une astuce surhumaines, subjuguant
ou liquidant les autres.
Dès lors, seul en face de la Russie, Staline la vit mystérieuse, plus forte et plus
durable que toutes les théories et que tous les régimes. Il l'aima à sa manière. Elle-même
l'accepta comme un tsar pour le temps d'une période terrible et supporta le bolchevisme
pour s'en servir comme d'un instrument. Sa chance fut qu'il ait trouvé un peuple à ce
point vivant et patient que la pire servitude ne le paralysait pas, une terre pleine de telles
ressources que les plus affreux gaspillages ne pouvaient pas les tarir, des alliés sans
lesquels il n'eût pas vaincu l'adversaire mais qui, sans lui, ne l'eussent point abattu.
Pendant les quelque quinze heures que durèrent, au total, mes entretiens avec Staline,
j'aperçus sa politique, grandiose et dissimulée. Communiste habillé en maréchal, dictateur
tapi dans sa ruse, conquérant à l'air bonhomme, il s'appliquait à donner le change. Mais,
si âpre était sa passion qu'elle transparaissait souvent, non sans une sorte de charme
ténébreux. […]
Nous conversâmes longuement tous les deux. Aux compliments que je lui adressai
sur les succès de l'armée russe, dont le centre, commandé par Tolboukine, venait d'effectuer
une forte avance en Hongrie, il rétorqua : « Peuh ! quelques villes ! C'est à Berlin et à
Vienne qu'il nous faut aller. » Par moments, il se montrait détendu, voire plaisant. « Ce
doit être bien difficile, me dit-il, de gouverner un pays comme la France où tout le monde
est si remuant ! » — « Oui ! répondis- je. Et, pour le faire, je ne puis prendre exemple sur
vous, car vous êtes inimitable. » Il prononça le nom de Thorez, à qui le gouvernement
français avait permis de regagner Paris. Devant mon silence mécontent : « Ne vous fâchez
pas de mon indiscrétion ! » déclara le maréchal. « Je me permets seulement de vous dire
que je connais Thorez et, qu'à mon avis, il est un bon Français. Si j'étais à votre place, je
ne le mettrais pas en prison. » Il ajouta, avec un sourire : « Du moins, pas tout de
suite ! » — « Le gouvernement français, répondis- je, traite les Français d'après les services
qu'il attend d'eux. »
Je rappelai que, de tous temps, la France avait voulu et soutenu l'indépendance
polonaise. Après la première guerre mondiale, nous avions fortement contribué à la faire
renaître [...] je répétai qu'à nos yeux il fallait que la Pologne fût un État réellement
indépendant. C'est donc au peuple polonais qu'il appartenait de choisir son futur
gouvernement. Il ne pour- rait le faire qu'après la libération et par des élections libres.
Pour le moment, le gouvernement français était en relations avec le gouvernement polonais
de Londres, lequel n'avait jamais cessé de combattre les Allemands. S'il devait arriver qu'un
jour la France fût amenée à changer cela, elle ne le ferait que d'accord avec ses trois
alliés.
Prenant la parole à son tour, le maréchal Staline s'échauffa. A l'entendre, grondant,
mordant, éloquent, on sentait que l'affaire polonaise était l'objet principal de sa passion et
le centre de sa politique. Il déclara que la Russie avait pris « un grand tournant » vis-à-
vis de cette nation qui était son ennemie depuis des siècles et en laquelle, désormais, elle
voulait voir une amie. Mais il y avait des conditions. « La Pologne, dit-il, a toujours servi
de couloir aux Allemands pour attaquer la Russie. Ce couloir, il faut qu'il soit fermé, et
fermé par la Pologne elle-même. » Pour cela, le fait de placer sa frontière sur l'Oder et
sur la Neisse pourrait être décisif, dès lors que l'État polonais serait fort et «
démocratique ». Car, proclamait le maréchal, « il n'y a pas d'État fort qui ne soit
démocratique. »
Staline aborda, alors, la question du gouvernement à instaurer à Varsovie. Il le fit
avec brutalité, tenant des propos pleins de haine et de mépris à l'égard des « gens de
Londres », louant hautement le « Comité de Lublin », formé sous l'égide des Soviets, et
affirmant qu'en Pologne celui-ci était seul attendu et désiré. Il donnait à ce choix, qu'à l'en
croire aurait fait le peuple polonais, des raisons qui ne démontraient que son propre parti
pris. […]
On me rapporta que les tractations ultimes s'étaient déroulées, au Kremlin, dans une
pièce voisine de celles où continuaient d'aller et venir les invités de la soirée. Au cours de
ces heures difficiles, Staline se tenait constamment au courant de la négociation et
l'arbitrait, à mesure, du côté russe. Mais cela ne l'empêchait pas de parcourir les salons
pour causer et trinquer avec l'un ou avec l'autre. En particulier, le colonel Pouyade,
commandant le régiment « Normandie », fut l'objet de ses prévenances. Finalement, on vint
m'annoncer que tout était prêt pour la signature du pacte. Celle-ci aurait lieu dans le
bureau de M. Molotov. Je m'y rendis à 4 heures du matin.
La cérémonie revêtit une certaine solennité. Des photo- graphes russes opéraient,
muets et sans exigences. Les deux ministres des Affaires étrangères, entourés des deux
délégations, signèrent les exemplaires rédigés en français et en russe. Staline et moi nous
tenions derrière eux. « De cette façon, lui dis-je, voilà le traité ratifié. Sur ce point, je le
suppose, votre inquiétude est dissipée. » Puis, nous nous serrâmes la main. « Il faut fêter
cela ! » déclara le maréchal. En un instant, des tables furent dressées et l'on se mit à
souper.
Staline se montra beau joueur. D'une voix douce, il me fit son compliment : « Vous
avez tenu bon. A la bonne heure 1 J'aime avoir affaire à quelqu'un qui sache ce qu'il
veut, même s'il n'entre pas dans mes vues. » Par contraste avec la scène virulente qu'il
avait jouée quelques heures auparavant en portant des toasts à ses collaborateurs, il parlait
de tout, à présent, d'une façon détachée, comme s'il considérait les autres, la guerre,
l'Histoire, et se regardait lui-même, du haut d'une cime de sérénité. « Après tout, disait-il,
il n'y a que la mort qui gagne. » Il plaignait Hitler. « pauvre homme qui ne s'en tirera
pas. » A mon invite : « Viendriez-vous nous voir à Paris? » il répondit : « Comment le
faire? Je suis vieux. Je mourrai bientôt. »
Il leva son verre en l'honneur de la France, « qui avait maintenant des chefs
résolus, intraitables, et qu'il souhaitait grande et puissante parce qu'il fallait à la Russie un
allié grand et puissant. » Enfin, il but à. a Pologne, bien qu'il n'y eût aucun Polonais
présent et comme s'il tenait à me prendre à témoin de ses intentions. « Les tsars, dit-il,
faisaient une mauvaise politique en voulant dominer les autres peuples slaves. Nous avons,
nous, une politique nouvelle. Que les Slaves soient, partout, indépendants et libres ! C'est
ainsi qu'ils seront nos amis. Vive la Pologne, forte, indépendante, démocratique ! Vive
l'amitié de la France, de la Pologne et de la Russie ! » Il me regardait : « Qu'en pense
M. de Gaulle? » En écoutant Staline, je mesurais l'abîme qui, pour le monde soviétique,
sépare les paroles et les actes. Je ripostai : « Je suis d'accord avec ce que M. Staline a dit
de la Pologne ». et soulignai : « Oui, d'accord avec ce qu'il a dit. »
Les adieux prirent, de son fait, une allure d'effusion. « Comptez sur moi ! »
déclara-t-il. « Si vous, si la France, avez besoin de nous, nous partagerons avec vous
jusqu'à notre dernière soupe. » Soudain, avisant près de lui Podzerov, l'interprète russe qui
avait assisté à tous les entretiens et traduit tous les propos, le maréchal lui dit, l'air
sombre, la voix dure : « Tu en sais trop long, toi ! J'ai bien envie de t'envoyer en Sibérie.
» Avec les miens, je quittai la pièce. Me retournant sur le seuil, j'aperçus Staline assis,
seul, à table. Il s'était remis à manger.
Vous aimerez peut-être aussi
- Landsbury Ma Rencontre Avec Lénine 1920Document4 pagesLandsbury Ma Rencontre Avec Lénine 1920Ataulfo RieraPas encore d'évaluation
- Kiel Et Tanger MAURRAS Charles 1921 A4Document432 pagesKiel Et Tanger MAURRAS Charles 1921 A4BibliothequeNatioPas encore d'évaluation
- Graber Deux Souvenirs Sur Lénine en Suisse 1918Document6 pagesGraber Deux Souvenirs Sur Lénine en Suisse 1918Ataulfo RieraPas encore d'évaluation
- Le drame de Waterloo: Grande restitution historique, rectifications, justifications, réfutations, souvenirs, éclaircissements, rapprochements, enseignements, faits inédits et jugements nouveaux sur la campagne de 1815D'EverandLe drame de Waterloo: Grande restitution historique, rectifications, justifications, réfutations, souvenirs, éclaircissements, rapprochements, enseignements, faits inédits et jugements nouveaux sur la campagne de 1815Pas encore d'évaluation
- Communistes Contre Staline Massacre Dune Génération (Pierre Broué)Document439 pagesCommunistes Contre Staline Massacre Dune Génération (Pierre Broué)Rémi AdamPas encore d'évaluation
- SS wallons: Récits de la 28e division SS de grenadiers volontaires WallonieD'EverandSS wallons: Récits de la 28e division SS de grenadiers volontaires WalloniePas encore d'évaluation
- Sorel - Tolstoi HistorienDocument34 pagesSorel - Tolstoi Historiendaniel_stanciu248565Pas encore d'évaluation
- Degrelle Hitler Pour 1000 AnsDocument77 pagesDegrelle Hitler Pour 1000 AnsNkb LarbiPas encore d'évaluation
- Jean D'Ormesson - Je Dirai Malgré Tout Que Cette Vie Fut Belle 1001ebooks - ClubDocument432 pagesJean D'Ormesson - Je Dirai Malgré Tout Que Cette Vie Fut Belle 1001ebooks - ClubAmirouche AMALOUPas encore d'évaluation
- Leon Tolstoi Politique Et Religion - AlainDocument26 pagesLeon Tolstoi Politique Et Religion - AlainVincent GuezouPas encore d'évaluation
- Naïm Khader: Prophète foudroyé du peuple palestinien (1939-1981)D'EverandNaïm Khader: Prophète foudroyé du peuple palestinien (1939-1981)Pas encore d'évaluation
- 1940-1945 - "Ils m'ont volé mes plus belles années": Témoignages belges de la Seconde Guerre mondialeD'Everand1940-1945 - "Ils m'ont volé mes plus belles années": Témoignages belges de la Seconde Guerre mondialePas encore d'évaluation
- Memoires de Joseph Fouche, Duc D'otrante - InconnuDocument136 pagesMemoires de Joseph Fouche, Duc D'otrante - InconnuLaetitia CassignacPas encore d'évaluation
- Dieu ne lit pas de romans: Un voyage dans le monde de Salman RusdhieD'EverandDieu ne lit pas de romans: Un voyage dans le monde de Salman RusdhiePas encore d'évaluation
- Bunel, Pierre-Henri - Crimes de Guerre À l'OTANDocument244 pagesBunel, Pierre-Henri - Crimes de Guerre À l'OTANzorglub456Pas encore d'évaluation
- 1944 1945 Le Tiomphe de La LiberteDocument379 pages1944 1945 Le Tiomphe de La LiberteClea Mounette100% (1)
- La Cohue de 1940 - DEGRELLE Léon - A4Document253 pagesLa Cohue de 1940 - DEGRELLE Léon - A4BibliothequeNatioPas encore d'évaluation
- George Orwell Hommage A La CatalogneDocument166 pagesGeorge Orwell Hommage A La Catalogneant100% (1)
- Les Victoires de l'Empire: Campagnes d'Italie, d'Égypte, d'Autriche, de Prusse, de Russie, de France et de CriméeD'EverandLes Victoires de l'Empire: Campagnes d'Italie, d'Égypte, d'Autriche, de Prusse, de Russie, de France et de CriméePas encore d'évaluation
- Maurras, Charles - Lettres de PrisonDocument382 pagesMaurras, Charles - Lettres de Prisonzorglub45650% (2)
- Christophersen Thies - Le Mensonge D'auschwitzDocument47 pagesChristophersen Thies - Le Mensonge D'auschwitzchris ferraille100% (2)
- Jacques Vergès, Marquis de La RévolutionDocument12 pagesJacques Vergès, Marquis de La RévolutionuyidirPas encore d'évaluation
- Chestov - Qu'Est-ce Que Le BolchevismeDocument58 pagesChestov - Qu'Est-ce Que Le Bolchevismedaniel_stanciu244666100% (1)
- Mémoires de Joseph Fouché, Duc d'Otrante, Ministre de la Police Générale Tome ID'EverandMémoires de Joseph Fouché, Duc d'Otrante, Ministre de la Police Générale Tome IPas encore d'évaluation
- Pierre Jovanovic - Adolf Hitler Ou La Vengeance de La Planche À BilletsDocument451 pagesPierre Jovanovic - Adolf Hitler Ou La Vengeance de La Planche À BilletsVincent Deneys100% (3)
- Pro Armenia 25 April 1901Document8 pagesPro Armenia 25 April 1901MACENTOPas encore d'évaluation
- Albert Memmi - Portrait Du ColoniséDocument182 pagesAlbert Memmi - Portrait Du ColoniséNofullname9870100% (4)
- Jean Genet - Quatre Heures À ChatilaDocument13 pagesJean Genet - Quatre Heures À Chatilamark_sundryPas encore d'évaluation
- André Malraux. La Condition Humaine.Document35 pagesAndré Malraux. La Condition Humaine.AkselVanEyckPas encore d'évaluation
- Cazalot Georges - Le Complexe de NeronDocument30 pagesCazalot Georges - Le Complexe de NeronNunussePas encore d'évaluation
- Robert Dun - Le Grand SuicideDocument309 pagesRobert Dun - Le Grand SuicideHans Cany100% (1)
- Bas les armes !: Le désarmement des Juifs et des "ennemis intérieurs" du IIIe ReichD'EverandBas les armes !: Le désarmement des Juifs et des "ennemis intérieurs" du IIIe ReichPas encore d'évaluation
- Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu: La politique de Machiavel au XIXe Siècle par un contemporainD'EverandDialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu: La politique de Machiavel au XIXe Siècle par un contemporainPas encore d'évaluation
- Wadial Bac 2020-2Document32 pagesWadial Bac 2020-2Assane MboupPas encore d'évaluation
- Le Coup D Etat PermanentDocument97 pagesLe Coup D Etat PermanentslhostPas encore d'évaluation
- Verbatim I (1981-1986) by Jacques AttaliDocument1 675 pagesVerbatim I (1981-1986) by Jacques AttaliAbdias SauzaPas encore d'évaluation
- Journal de Cléry: Les confidences du valet de Louis XVI pendant la captivité du roi à la prison du Temple du 10 août 1792 au 21 janvier 1793D'EverandJournal de Cléry: Les confidences du valet de Louis XVI pendant la captivité du roi à la prison du Temple du 10 août 1792 au 21 janvier 1793Pas encore d'évaluation
- Nos Hommes et Notre Histoire Notices biographiques accompagnées de reflexions et de souvenirs personnelsD'EverandNos Hommes et Notre Histoire Notices biographiques accompagnées de reflexions et de souvenirs personnelsPas encore d'évaluation
- Aussaresses Paul - Services Speciaux Algerie 1955-1957Document322 pagesAussaresses Paul - Services Speciaux Algerie 1955-1957ImaristoAmigo100% (4)
- Vie de Tolstoi: une biographie critique de Léon Tolstoï écrite par Romain Rolland.D'EverandVie de Tolstoi: une biographie critique de Léon Tolstoï écrite par Romain Rolland.Pas encore d'évaluation
- Journal écrit à bord de la frégate "la Belle-poule"D'EverandJournal écrit à bord de la frégate "la Belle-poule"Pas encore d'évaluation
- Coston Henry - Le Livre Noir de L'épuration PDFDocument80 pagesCoston Henry - Le Livre Noir de L'épuration PDFCharles Wolf100% (2)
- Palestine, fin du mécanisme du rejet: Chroniques d'un militant pour un nouvel horizonD'EverandPalestine, fin du mécanisme du rejet: Chroniques d'un militant pour un nouvel horizonPas encore d'évaluation
- Entretiens de Svetlana AlexievitchDocument23 pagesEntretiens de Svetlana AlexievitchAmaury CosmePas encore d'évaluation
- Écrits Corsaires (Pier Paolo Pasolini)Document207 pagesÉcrits Corsaires (Pier Paolo Pasolini)ataougarge26cPas encore d'évaluation