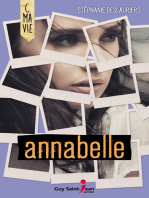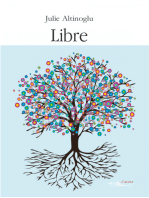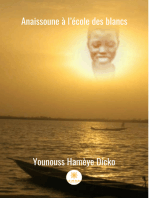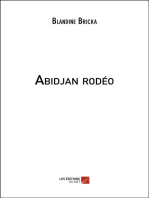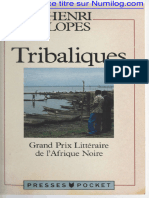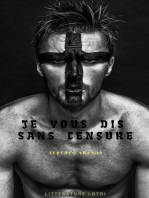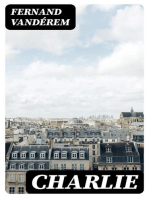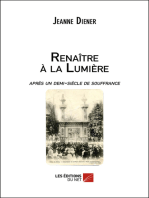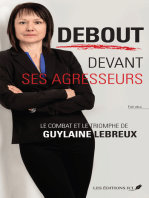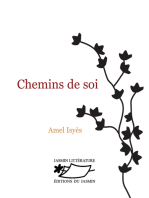Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Femmes Et Les Filles Du Peuple de Mon Père, L'arabe Imaginaire Leïla Sebbar
Transféré par
Fadoua AryanTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Femmes Et Les Filles Du Peuple de Mon Père, L'arabe Imaginaire Leïla Sebbar
Transféré par
Fadoua AryanDroits d'auteur :
Formats disponibles
Clio.
Femmes, Genre, Histoire
43 | 2016
Citoyennetés
Les femmes et les filles du peuple de mon père,
l’Arabe imaginaire
Leïla Sebbar
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/clio/13003
DOI : 10.4000/clio.13003
ISSN : 1777-5299
Éditeur
Belin
Édition imprimée
Date de publication : 1 juin 2016
Pagination : 217-222
ISBN : 978-2-7011-9852-1
ISSN : 1252-7017
Référence électronique
Leïla Sebbar, « Les femmes et les filles du peuple de mon père, l’Arabe imaginaire », Clio. Femmes,
Genre, Histoire [En ligne], 43 | 2016, mis en ligne le 01 juin 2019, consulté le 10 décembre 2020. URL :
http://journals.openedition.org/clio/13003 ; DOI : https://doi.org/10.4000/clio.13003
Tous droits réservés
Portrait
Le 20 novembre 2015, Clio FGH fêtait son vingtième anniversaire avec une pensée
émue pour les victimes de la semaine précédente. Après un récit à trois voix de l’histoire
de la revue, celles des directrices d’hier et d’aujourd’hui (Florence Rochefort, Françoise
Thébaud, Michelle Zancarini-Fournel), Laura Frader 1 a posé un regard chaleureux sur
l’ensemble des numéros parus et Francisca de Haan 2 a présenté la jeune revue Aspasia
qui introduit en histoire des femmes et du genre une perspective d’Europe centrale. Puis,
Leïla Sebbar, notre invitée d’honneur qui a participé avec bonheur aux débuts de
l’histoire des femmes au sein du journal Histoires d’elles (1977-1980), a lu le superbe
texte que nous publions aujourd’hui et dont nous la remercions chaleureusement. La bio-
bibliographie, présente en fin de volume sera, nous l’espérons, une invitation à découvrir
d’autres de ses écrits.
Les femmes et les filles du peuple de mon père,
l’Arabe imaginaire
Leïla SEBBAR
(Paris, octobre 2015)
Des femmes et des filles inconnues.
Les femmes et les filles du peuple de mon père. Je ne les connais
pas. Je ne vais pas dans leur maison.
Je les entrevois dans le quartier arabe où nous vivons à l’écart dans
l’école de mon père, clôturée, fermée par un grand portail.
1 Northeastern University, Boston, Chaire Genre/Égalité de l’Université
Sorbonne Paris Cité.
2 Central European University, Budapest.
218 Leïla Sebbar
Je les entrevois et je les entends derrière des linges, dans le patio,
depuis la rue.
Je les entrevois derrière le voile blanc, le haïk qui laisse un œil
découvert, parfois deux yeux au-dessus de la voilette.
Je les entrevois, assises en rond sur l’esplanade, terre rouge, où elles
pilent des piments rouges, dans les mots et les rires de la langue de
mon père. Elles portent des foulards serrés, noués sur le front. Pas
un cheveu ne dépasse.
Je vois, dans ce quartier arabe, pauvre, déshérité (le « Village nègre »)
leurs filles, pas encore voilées, pas encore nubiles. Parfois je joue avec
elles et mes sœurs dans la grande cour de l’école, interdite aux garçons
à cette heure-là. La marelle (la galline), les roseaux, les osselets. Nous
ne parlons pas (elles ne vont pas à l’école de filles au centre du village
« européen »), nous rions, nous crions dans la langue des enfants.
Nous ne parlons pas, mes sœurs et moi, la langue de leur mère, ni
elles, la langue de notre mère, la Roumia, la Française.
Et puis, il y a Safia, « Safia Gaule ». Une jeune orpheline,
abandonnée à la rue. Je la vois à travers le grillage, jouer au foot avec
les garçons du quartier. Elle crie et elle court plus vite qu’eux, d’un
bout à l’autre de l’esplanade, la jupe relevée sur les cuisses pour
mieux taper dans le ballon. Les garçons la respectent, les filles non.
Ni les femmes. Une fille de la rue… Je regarde Safia, fascinée,
muette. Elle ne me voit pas. Elle ne m’a jamais vue. Dans quelle
langue lui aurais-je parlé si elle avait fait quelques pas vers moi ?
Je retrouve Safia dans mes fictions, je parle d’elle. Elle, ne parle pas.
Personnage étrange, étranger, comme Isabelle Eberhardt, elle est là.
Obstinément.
J’entrevois aussi les mères des élèves de l’école de mon père,
« l’école de garçons indigènes », sous le préau, dans le bureau du
Directeur. Pourquoi suis-je là ? Je ne sais plus. Je les regarde, elles
n’enlèvent pas le haïk lorsqu’elles s’assoient en face de mon père.
Mon père parle avec elles, dans sa langue, leur langue, en arabe. Je
les entends, je suis les gestes de leurs mains brunes passées au
henné, tantôt lents et doux, tantôt coléreux contre les fils qui
n’écoutent pas le maître. Elles parlent beaucoup, longtemps, mon
père est patient, comme son nom le dit (SEBBAR). Parfois, il rit, et
Les femmes et les filles du peuple de mon père, l’Arabe imaginaire 219
les femmes rient aussi, elles cachent leur bouche avec la main, en
inclinant le visage, sur le côté, légèrement. Lorsqu’elles quittent le
bureau, elles saluent le Directeur. J’entends des paroles de respect, je
crois. Je ne peux pas demander à mon père ce qu’elles disaient.
Je vois, dans la maison d’école, les jeunes femmes qui aident ma
mère. Deux sœurs. D’abord Aïcha puis Fatima, lorsque Aïcha quitte
notre maison pour se marier. Elles enlèvent le haïk et la fouta (pièce
de coton à bandes jaune/rouge/noir), on en trouvait naguère dans
les boutiques arabes de Barbès, les téléphones et iPhones les ont
remplacés. Je les regarde, Aïcha et Fatima, ma curiosité ne les
surprend pas. Des gestes gracieux, précis, le matin et le soir. Aïcha
ni Fatima ne nous parlent dans leur langue, l’arabe. Mon père, dans
la maison, fait le traducteur, d’une langue à l’autre, de sa femme à
Aïcha et Fatima, des sœurs à sa femme, institutrice dans son école,
la journée entière devant 45 garçons dans la classe, garçons du
quartier indigène, fils d’ouvriers agricoles.
Ma mère, institutrice, du lever au coucher, avec ses enfants nés dans
sa langue, le français, ses élèves nés dans la langue de leur mère,
l’arabe, fera l’institutrice avec Aïcha et Fatima qui apprendront des
mots, des expressions de la langue étrangère. Elles ne nous parlent pas
en arabe.
Je vois, dans la maison de ma grand-mère maternelle, à Ténès, la
ville marine où mon père est né, des femmes.
Deux ou trois fois avant la guerre, nous irons rendre visite à la mère
de mon père, à ses sœurs cloîtrées, encore jeunes et déjà vieilles,
veuves je crois ou répudiées pour stérilité, l’une et l’autre. La jeune
fille muette serait la fille adoptive ou la fille de la sœur aînée ? (Je n’ai
jamais rien su de la filiation réelle de la jeune muette).
Ces femmes nous accueillent comme des hôtes attendus depuis
longtemps. Le frère préféré, le premier-né, le bien-aimé, sa jeune
femme, la Française, la Roumia de France, belle, élégante et leurs
quatre enfants, mon frère aîné, mes deux sœurs et moi,
endimanchés.
Nous sommes les bienvenus.
220 Leïla Sebbar
Baisers sonores, rires de bonheur, les sœurs de mon père nous
serrent contre les fleurs de leurs robes moelleuses, très fort, un peu
trop fort. Ma mère ne nous serre pas ainsi dans ses bras, et elle nous
embrasse avec délicatesse.
Nous sommes assis sur le tapis, autour de la table basse, nous les
enfants. Les sœurs tournent autour de nous, elles se parlent en
cuisinières accomplies, elles ne nous parlent pas dans la langue de
leur frère, elles parlent en mères nourricières à des enfants
gourmands et curieux.
Les sœurs parlent avec nous dans la langue du corps domestique,
cuisinier, les gestes d’une nourriture de fête pour les enfants du
frère, la langue du corps féminin, heureux du travail culinaire qui fait
plaisir, la langue des vêtements longs et légers, les plis soyeux des
robes et des sarouels, ces pantalons bouffants, exotiques, pour nous,
si différents des vêtements que porte ma mère, confectionnés les
jeudis de couture dans la véranda, d’après les modèles, les patrons
de Modes et Travaux et d’autres magazines qui viennent de France.
Avec la couturière juive de Tlemcen (pourquoi je sais qu’elle est
juive ?), ma mère parle, choisit, commente… avant le passage à
l’acte des grands ciseaux de couture. Elles parlent la langue de ma
mère et je comprends tout. Ma mère aime ce qui est sobre avec
« une pointe de fantaisie », dit-elle. Pas trop de couleurs…
Ma mère et la couturière ne parlent pas la langue des femmes du
peuple de mon père, la langue du corps arabe, féminin, que je
regarde se mouvoir, les gestes, les étoffes, les couleurs et les mots
que je ne comprends pas, mais les longues robes, les foulards
superposés, le voile blanc, la fouta qui enveloppe les reins, la taille,
les chevilles, le henné sur les mains qui parlent et dans la cour de
l’après-midi sous le figuier entre jasmin et citronnier, la conversation
se poursuit avec les mots étrangers de l’arabe et c’est comme si je
comprenais, parce que le corps ample et généreux des sœurs et de la
jeune muette parle, il parle avec nous de si loin, et si proche, que
j’entends tout. Mon père n’a pas besoin de traduire comme il le fait,
depuis le matin, de sa mère à sa femme, de sa femme à sa mère, le
manège semble laborieux, alors que la langue des sœurs et de la
jeune muette, qui circule d’un enfant à l’autre, est fluide et claire.
Les femmes et les filles du peuple de mon père, l’Arabe imaginaire 221
Ces femmes, ces filles du peuple de mon père, je les appelle « Mes
Sœurs étrangères » dans mes livres. Elles sont arrivées ainsi, après
une longue amnésie du pays natal, dans la turbulence de deux
révolutions culturelles, en France. Elles sont arrivées en Sœurs
étrangères et elles peuplent romans et nouvelles, elles occupent mon
nouveau territoire, elles colonisent, des deux côtés de la mer.
Dans la colonie, ces femmes et ces filles parlaient la langue de mon
père, la seule langue de leur vie, l’arabe, la langue inconnue, de mon
père, inconnu, lui l’Arabe imaginaire, l’étranger dans la maison où la
langue de sa mère n’est pas là, sinon par effraction, où l’histoire, les
histoires contes et légendes sont muets autant que dieu. Le père
arabe, inconnu, garde le silence sur les siens, il garde sa langue
secrète, il garde le mystère de l’autre corps, le corps arabe n’est pas
là, mon père ne transmet rien de ce corps et de cette âme-là, son
corps arabe et musulman, son âme arabe et musulmane.
Le corps de mon père est coupé en deux. Corps indigène, arabe et
musulman, le Coran est tout entier dans son cœur et dans sa tête,
corps colonisé français, instituteur dans la langue et la littérature et
l’histoire de la France révolutionnaire et républicaine.
Mon père nous a coupés en deux, nous ses enfants. Corps fantôme,
mutique, corps français bavard.
J’aurais pu, je le crois, crier, dans un asile, ma folie inarticulée.
Mes Sœurs étrangères, mes sœurs de fiction sont venues à moi,
entières hospitalières, bienveillantes dans une langue étrangère,
l’arabe de mon père. Les femmes de son peuple :
paysannes
femmes de ménage (« Les Fatmas » disait-on)
femmes au foyer
aristocrates
analphabètes
lettrées
prostituées
conteuses
nomades
222 Leïla Sebbar
prophétesses et sorcières
fugueuses
rebelles
bavardes
résistantes…
Odalisques… folles… amoureuses…
J’aime qu’elles soient étrangères comme mon père est étranger,
l’étranger bien-aimé.
Je ne les connais pas, mais je les connais.
Je ne veux pas les connaître, ni parler leur langue.
Je les écris, je les invente, je traduis la langue arabe et le corps des
femmes arabes de mon père, dans la langue de ma mère, langue de
ma naissance dans la colonie, l’Algérie de mon père, je les écris en
français (ma seule langue). Je leur offre le verbe, comme à mon père
(l’a-t-il compris ? Je n’ai pas parlé de mes livres avec lui, je sais qu’il
les a lus, Le silence des rives, juste avant sa mort).
Je leur fais le don d’une histoire, des histoires, sur l’autre rive dans
l’autre langue, d’Orient en Occident.
Tribu inédite de femmes et de filles qui passent la frontière, dans la
fiction. Je fabrique, parce que je ne sais rien ni des corps, ni de la
langue, ni de l’histoire de l’Algérie, un entre-deux, une histoire
nouvelle, une histoire frontière avec « l’homme-frontière », mon père, et
ses femmes et ses filles-frontières.
Mon père, l’Arabe imaginaire, reconnaîtrait ces femmes et ces filles
de fiction, comme siennes.
Elles sont mes Sœurs étrangères, je leur parle comme si je savais
l’arabe, j’invente pour elles, avec elles, des histoires comme si elles
les écrivaient. Elles, privées de la lettre.
Ainsi, je suis le scribe de mon père, de son pays, l’Algérie, de ses
femmes et de ses filles…
En colère et libres.
Mais tout cela n’est que fiction.
Vous aimerez peut-être aussi
- Allah Nest Pas Oblige PDFDocument106 pagesAllah Nest Pas Oblige PDFAbakarTahir100% (1)
- Diop ContesDocument187 pagesDiop Contesalaouet0% (1)
- Preparation Delf Prim HachetteDocument96 pagesPreparation Delf Prim HachetteBici OsoPas encore d'évaluation
- Amin Maalouf-Les Identites Meurtrieres PDFDocument26 pagesAmin Maalouf-Les Identites Meurtrieres PDFAmmar KulićPas encore d'évaluation
- Agota Kristof - L'AnalphabèteDocument2 pagesAgota Kristof - L'AnalphabèteJosé Francisco Cerda Cancino0% (1)
- Assia DjebarDocument391 pagesAssia DjebarsamyPas encore d'évaluation
- Allah Nest Pas ObligeDocument106 pagesAllah Nest Pas ObligeMATOPas encore d'évaluation
- L'Enfant noir de Camara Laye (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandL'Enfant noir de Camara Laye (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (2)
- Djebar, Assia - Nulle Part Dans La Maison de Mon Père PDFDocument299 pagesDjebar, Assia - Nulle Part Dans La Maison de Mon Père PDFKaph GhadPas encore d'évaluation
- BAM Preparation Etude de TexteDocument20 pagesBAM Preparation Etude de TexteAyman BenkhdimPas encore d'évaluation
- French Duolingo Vocab List - French Duolingo Vocab ListDocument45 pagesFrench Duolingo Vocab List - French Duolingo Vocab ListDean Winchester50% (2)
- Petit Éloge Des Fantômes (Appanah, Nathacha)Document66 pagesPetit Éloge Des Fantômes (Appanah, Nathacha)Gözde GÜLERPas encore d'évaluation
- Allah Nest Pas Oblige PDFDocument106 pagesAllah Nest Pas Oblige PDFSttyPas encore d'évaluation
- Aucun de Nous Ne Reviendra 1 Auschwitz Et Apres Charlotte DelboDocument113 pagesAucun de Nous Ne Reviendra 1 Auschwitz Et Apres Charlotte DelboKontua100% (1)
- Maisey Yates Une Folle Tentation PDFDocument104 pagesMaisey Yates Une Folle Tentation PDFsiba100% (1)
- Allah Est Grand La Republique A - Lydia GuirousDocument100 pagesAllah Est Grand La Republique A - Lydia Guirousaramisbirsan2132Pas encore d'évaluation
- Chair de Poule - 02 La Nuit Des PantinsDocument160 pagesChair de Poule - 02 La Nuit Des PantinsAlisonPas encore d'évaluation
- (Français) La Femme GeléeDocument84 pages(Français) La Femme GeléeFabiana CarvalhoPas encore d'évaluation
- Burdastyle Dress Copyshoppattern Original PDFDocument1 pageBurdastyle Dress Copyshoppattern Original PDFmxpxaxoPas encore d'évaluation
- The Rigo Uniform PlatesDocument11 pagesThe Rigo Uniform PlatesSkvoPas encore d'évaluation
- Memoire Complet FRDocument76 pagesMemoire Complet FRmeriem kebabzaPas encore d'évaluation
- Lere BelleDocument157 pagesLere BelleBylkablk DzPas encore d'évaluation
- LA PLACE, Annie Ernaux, 1983Document6 pagesLA PLACE, Annie Ernaux, 1983Damien VERRIERE100% (1)
- Adimi Kaouther Des Pierres Dans Ma Poche 2016 Seuil Libgen - LiDocument120 pagesAdimi Kaouther Des Pierres Dans Ma Poche 2016 Seuil Libgen - LiIsmahane SlimaniPas encore d'évaluation
- 9782266301343 (1)Document15 pages9782266301343 (1)kafandoi801Pas encore d'évaluation
- Bakhita - Veronique Olmi PDFDocument399 pagesBakhita - Veronique Olmi PDFKontuaPas encore d'évaluation
- Maa sopp Senegaal -: Afrique mon amourD'EverandMaa sopp Senegaal -: Afrique mon amourÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Assia Djebar Threne Pour Une ImmortelleDocument7 pagesAssia Djebar Threne Pour Une ImmortelleAnonymous saZrl4OBl4Pas encore d'évaluation
- La Guerre d'Algérie, de l'amitié et de l'amour aussiD'EverandLa Guerre d'Algérie, de l'amitié et de l'amour aussiPas encore d'évaluation
- Allah Nest Pas Oblige 1Document106 pagesAllah Nest Pas Oblige 1aboubacarbarry662Pas encore d'évaluation
- Rebelle - Matoub Lounes. - CopieDocument173 pagesRebelle - Matoub Lounes. - CopieNanouchemouloudPas encore d'évaluation
- Assia Djebar et Leila Sebbar: Une Approche PolyphoniqueD'EverandAssia Djebar et Leila Sebbar: Une Approche PolyphoniquePas encore d'évaluation
- Anatole FfranceDocument1 pageAnatole FfrancebousbousPas encore d'évaluation
- Pour L Amour Des MiensDocument30 pagesPour L Amour Des Mienskeenv78Pas encore d'évaluation
- Lait Et MielDocument16 pagesLait Et Mieleva.schied1002Pas encore d'évaluation
- Nous Sommes Nés Pour Vivre - Recueil de ViryDocument35 pagesNous Sommes Nés Pour Vivre - Recueil de Viryabderrahim nahiPas encore d'évaluation
- Sans Retour: Les Mémoires d'un Juif Egyptien 1930-1957D'EverandSans Retour: Les Mémoires d'un Juif Egyptien 1930-1957Pas encore d'évaluation
- French Week 9Document4 pagesFrench Week 9Айнур ГалламоваPas encore d'évaluation
- Comprehension Ecrite Semaine 1 Les Lettres ParisiennesDocument4 pagesComprehension Ecrite Semaine 1 Les Lettres ParisiennesTarik ZerouanePas encore d'évaluation
- TUPIK LabyrintheDocument1 pageTUPIK LabyrintheMădălina CiobanuPas encore d'évaluation
- CIC Sarl KenaniDocument19 pagesCIC Sarl KenaniWael JridiaPas encore d'évaluation
- Apostila Amigurumi Miniaturas PDFDocument24 pagesApostila Amigurumi Miniaturas PDFMariana Veronez BorriPas encore d'évaluation
- Mocassin Homme - Recherche GoogleDocument1 pageMocassin Homme - Recherche GoogleOuattaraPas encore d'évaluation
- Aurora CatalogueDocument80 pagesAurora CatalogueStéphan LibertPas encore d'évaluation
- Modèle 16-Politique SSTDocument12 pagesModèle 16-Politique SSTHouda Sidi AmmiPas encore d'évaluation
- Catalogue AMPM PDFDocument136 pagesCatalogue AMPM PDFNenadZRadovićPas encore d'évaluation
- 07 02 10dossier Sur La Description Et Le PortraitDocument27 pages07 02 10dossier Sur La Description Et Le Portraitattaoufik100% (1)
- ICIE Rev3 Final PDFDocument371 pagesICIE Rev3 Final PDFDražena KolobarićPas encore d'évaluation
- La Place de L'AdjectifDocument6 pagesLa Place de L'AdjectifHerman YURUTENPas encore d'évaluation
- Vocabulaires Faits DiversDocument18 pagesVocabulaires Faits Diversmahabentanfous2023Pas encore d'évaluation
- Winston Groom - Forrest GumpDocument335 pagesWinston Groom - Forrest GumpDora Popovici100% (1)
- Brochure EteDocument32 pagesBrochure Eteanouar topology100% (1)