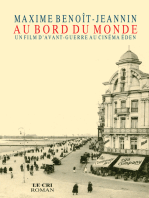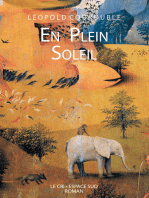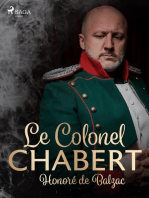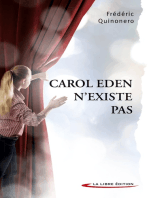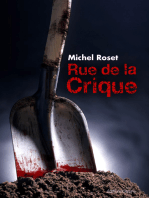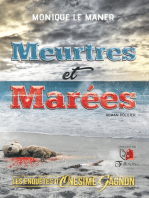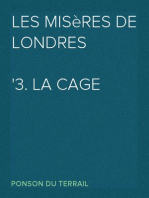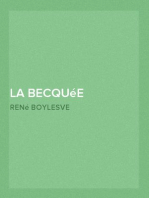Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
2 Chap Primo Levi
Transféré par
loic.rasolofoniaina0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
13 vues1 pageTitre original
2 chap primo levi
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
13 vues1 page2 Chap Primo Levi
Transféré par
loic.rasolofoniainaDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 1
2. LE FOND Le voyage ne dura qu’une vingtaine de minutes.
Puis le camion s’est arrêté et nous avons
vu apparaître une grande porte surmontée d’une inscription vivement éclairée (aujourd’hui encore,
son souvenir me poursuit en rêve) : ARBEIT MACHT FREI, le travail rend libre. Nous sommes
descendus, on nous a fait entrer dans une vaste pièce nue, à peine chauffée. Que nous avons soif ! Le
léger bruissement de l’eau dans les radiateurs nous rend fous : nous n’avons rien bu depuis quatre
jours. Il y a bien un robinet, mais un écriteau accroché au-dessus dit qu’il est interdit de boire parce
que l’eau est polluée. C’est de la blague, aucun doute possible, on veut se payer notre tête avec cet
écriteau : « ils » savent que nous mourons de soif, et ils nous mettent dans une chambre avec un
robinet, et Wassertrinken verboten. Je bois résolument et invite les autres à en faire autant ; mais il
me faut recracher, l’eau est tiède, douceâtre et nauséabonde. C’est cela, l’enfer. Aujourd’hui, dans le
monde actuel, l’enfer, ce doit être cela : une grande salle vide, et nous qui n’en pouvons plus d’être
debout, et il y a un robinet qui goutte avec de l’eau qu’on ne peut pas boire, et nous qui attendons
quelque chose qui ne peut être que terrible, et il ne se passe rien, il continue à ne rien se passer.
Comment penser ? On ne peut plus penser, c’est comme si on était déjà mort. Quelquesuns
s’assoient par terre. Le temps passe goutte à goutte. Nous ne sommes pas morts ; la porte s’ouvre, et
un SS entre, la cigarette à la bouche. Il nous examine sans se presser ; « Wer kann Deutsch ? »
demande-t-il ; l’un de nous se désigne ; quelqu’un que je n’ai jamais vu et qui s’appelle Flesch ; ce
sera lui notre interprète. Le SS fait un long discours d’une voix calme, et l’interprète traduit : il faut se
mettre en rang par cinq, à deux mètres l’un de l’autre, puis se déshabiller en faisant un paquet de ses
vêtements, mais d’une certaine façon : ce qui est en laine d’un côté, le reste de l’autre ; et enfin
enlever ses chaussures, mais en faisant bien attention à ne pas se les faire voler. Voler par qui ?
Pourquoi devrait-on nous voler nos chaussures ? Et nos papiers, nos montres, le peu que nous avons
en poche ? Nous nous tournons tous vers l’interprète. Et l’interprète interrogea l’Allemand, et
l’Allemand, qui fumait toujours, le traversa du regard comme s’il était transparent, comme si
personne n’avait parlé. Je n’avais jamais vu de vieil homme nu. M. Bergmann, qui portait un bandage
herniaire, demanda à l’interprète s’il devait l’enlever, et l’interprète hésita. Mais l’Allemand comprit,
et parla d’un ton grave à l’interprète en indiquant quelqu’un ; alors nous avons vu l’interprète avaler
sa salive, puis il a dit : « L’adjudant vous demande d’ôter votre bandage, on vous donnera celui de M.
Coen. » Ces mots-là avaient été prononcés d’un ton amer, c’était le genre d’humour qui plaisait à
l’Allemand. Arrive alors un autre Allemand, qui nous dit de mettre nos chaussures dans un coin ; et
nous obtempérons car désormais c’est fini, nous nous sentons hors du monde : il ne nous reste plus
qu’à obéir. Arrive un type avec un balai, qui pousse toutes les chaussures dehors, en tas. Il est fou, il
les mélange toutes, quatre-vingt-seize paires : elles vont être dépareillées. Un vent glacial entre par
la porte ouverte : nous sommes nus et nous nous couvrons le ventre de nos bras. Un coup de vent
referme la porte : l’Allemand la rouvre et reste là à regarder d’un air pénétré les contorsions que
nous faisons pour nous protéger du froid les uns derrière les autres. Puis il s’en va en refermant
derrière lui. Nous voici maintenant au deuxième acte. Quatre hommes armés de rasoirs, de blaireaux
et de tondeuses font irruption dans la pièce ; ils ont des pantalons et des vestes rayés, et un numéro
cousu sur la poitrine ;
Vous aimerez peut-être aussi
- Au bord du Monde: Un film d'avant-guere au cinéma ÉdenD'EverandAu bord du Monde: Un film d'avant-guere au cinéma ÉdenPas encore d'évaluation
- 014 61 Heures Child - 1Document439 pages014 61 Heures Child - 1Alexandre LopesPas encore d'évaluation
- Bac 2018 Pondichery Series Es-S Sujet FrancaisDocument9 pagesBac 2018 Pondichery Series Es-S Sujet FrancaisLETUDIANTPas encore d'évaluation
- Isabelle by André GideDocument64 pagesIsabelle by André Giderupaloca100Pas encore d'évaluation
- Journal des Goncourt (Premier Volume) Mémoires de la vie littéraireD'EverandJournal des Goncourt (Premier Volume) Mémoires de la vie littérairePas encore d'évaluation
- Instant Download Choices and Connections An Introduction To Communication 2nd Edition Mccornack Solutions Manual PDF Full ChapterDocument32 pagesInstant Download Choices and Connections An Introduction To Communication 2nd Edition Mccornack Solutions Manual PDF Full ChapterBrianHudsonoqer100% (9)
- La Cafetière Gautier-Pp.1-22Document22 pagesLa Cafetière Gautier-Pp.1-22déboraPas encore d'évaluation
- Annales 2011 Séries technologiques "Le théâtre : texte et représentation" (Bac de français): Réussir le bac de françaisD'EverandAnnales 2011 Séries technologiques "Le théâtre : texte et représentation" (Bac de français): Réussir le bac de françaisPas encore d'évaluation
- Poe Edgar Allan - La Barrique D AmontilladoDocument14 pagesPoe Edgar Allan - La Barrique D AmontilladoJudeline DorPas encore d'évaluation
- La Fabrique Des Mots - Erik OrsennaDocument106 pagesLa Fabrique Des Mots - Erik OrsennaFabiola Rodríguez Cházaro100% (1)
- Das absolut perfekte Verbrechen / Unverdächtig / Paris - Brest: Drei Romane in einem BandD'EverandDas absolut perfekte Verbrechen / Unverdächtig / Paris - Brest: Drei Romane in einem BandPas encore d'évaluation
- Devoir 1Document3 pagesDevoir 1ربيعه ربيعه عريشPas encore d'évaluation
- L’œuvre des pieux: Une enquête du commissaire Velcro - Tome 6D'EverandL’œuvre des pieux: Une enquête du commissaire Velcro - Tome 6Pas encore d'évaluation
- la_cafetière-texteDocument4 pagesla_cafetière-textestandefelixPas encore d'évaluation
- Un Clown Qui S'improvise RésistantDocument1 pageUn Clown Qui S'improvise Résistantatrebel974Pas encore d'évaluation
- Les Vacances Du Petit Nicolas - 11 - Courage !Document3 pagesLes Vacances Du Petit Nicolas - 11 - Courage !Samaneh AbdiPas encore d'évaluation
- Tourgueniev - L'Execution de TroppmannDocument38 pagesTourgueniev - L'Execution de Troppmannredvelvetmask2343Pas encore d'évaluation
- Spinoza - Lhomme Qui A Tué Dieu (José Rodrigues Dos Santos) (Z-Library)Document604 pagesSpinoza - Lhomme Qui A Tué Dieu (José Rodrigues Dos Santos) (Z-Library)douae azlPas encore d'évaluation
- L'hérésiarque Et Cie by Apollinaire, Guillaume, 1880-1918Document92 pagesL'hérésiarque Et Cie by Apollinaire, Guillaume, 1880-1918Gutenberg.org100% (1)
- L'auberge De L'alpiniste Mort: Meilleure science-fictionD'EverandL'auberge De L'alpiniste Mort: Meilleure science-fictionPas encore d'évaluation
- Version Bilingue - L'histoire de Cléopâtre (Français - Suédois)D'EverandVersion Bilingue - L'histoire de Cléopâtre (Français - Suédois)Pas encore d'évaluation
- Un Homme À La Mer°g. F. DEMPSTER°93Document93 pagesUn Homme À La Mer°g. F. DEMPSTER°93Manfred SudneyPas encore d'évaluation
- Gaboriau Emile - La Clique DoreeDocument514 pagesGaboriau Emile - La Clique DoreeinyasPas encore d'évaluation
- La Salle de Bain, ToussaintDocument68 pagesLa Salle de Bain, Toussaintkatie promePas encore d'évaluation
- Ebook Hugo Claus - Le Passe DecomposeDocument180 pagesEbook Hugo Claus - Le Passe DecomposegbestreesPas encore d'évaluation
- Robert Merle - La Mort Est Mon MétierDocument1 586 pagesRobert Merle - La Mort Est Mon MétierC@995983656080% (5)
- Version Bilingue - L’histoire de Cléopâtre (Français - Italien)D'EverandVersion Bilingue - L’histoire de Cléopâtre (Français - Italien)Pas encore d'évaluation
- Borges (Pseudo) - Wenn Ich Noch Einmal Leben KönnteDocument15 pagesBorges (Pseudo) - Wenn Ich Noch Einmal Leben KönnteGaspar CamerariusPas encore d'évaluation
- Ray La Présence HorrifianteDocument6 pagesRay La Présence HorrifianterebuPas encore d'évaluation
- Economie MiniereDocument246 pagesEconomie MiniereArnaud Asse100% (9)
- CouvGRH Guillot Ed9Document1 pageCouvGRH Guillot Ed9Abder Alami0% (1)
- Res 2ppe PDFDocument2 pagesRes 2ppe PDFlkdhfldhfPas encore d'évaluation
- Dossier 0 - Se Presenter-Nationalites-NombresDocument2 pagesDossier 0 - Se Presenter-Nationalites-NombresLaura CamachoPas encore d'évaluation
- 1700 Pecour Passepied - (BNF)Document18 pages1700 Pecour Passepied - (BNF)davini1234Pas encore d'évaluation
- LIS协议接口手册(中文)Document130 pagesLIS协议接口手册(中文)OTOTEPas encore d'évaluation
- Corrigé Exercice TvaDocument1 pageCorrigé Exercice Tvasalma.nordinePas encore d'évaluation
- Espaces ConfinésDocument28 pagesEspaces ConfinésbechylianPas encore d'évaluation
- EnzymologieDocument20 pagesEnzymologiejohn jeunePas encore d'évaluation
- Formulaire RDM Poutres Continues 2traveesDocument7 pagesFormulaire RDM Poutres Continues 2traveesAbdel Autoroute du KiffPas encore d'évaluation
- Elaboration Du PlombDocument30 pagesElaboration Du Plombbakkali ikramPas encore d'évaluation
- DM4 2bac Sma Of2023Document3 pagesDM4 2bac Sma Of2023Aymen Elassri2005Pas encore d'évaluation
- Entretien Locaux CPIASOc-NA 2017Document104 pagesEntretien Locaux CPIASOc-NA 2017Aghilas IzemPas encore d'évaluation
- SANBIOLDocument1 pageSANBIOLMassouh AssouiPas encore d'évaluation
- BookDocument6 pagesBookAnonymous OXuBdloKdPas encore d'évaluation
- 5 Note Sur Larc Dit de Trajan À TimgadDocument5 pages5 Note Sur Larc Dit de Trajan À TimgadBabaPas encore d'évaluation
- Le Torchis Mode D'eDocument6 pagesLe Torchis Mode D'eSiham EllaylPas encore d'évaluation
- The Legend of Zelda A Link To The Past - Kakariko VillageDocument2 pagesThe Legend of Zelda A Link To The Past - Kakariko VillageSilvia PadrónPas encore d'évaluation
- Installation Et Entretien de Systemes Dalarme Et de SignalisationDocument99 pagesInstallation Et Entretien de Systemes Dalarme Et de SignalisationSkimoghjPas encore d'évaluation
- 10 Conclusion GeneralDocument2 pages10 Conclusion Generalramda.mys7111Pas encore d'évaluation
- Entrainement Physique-Chimie Ts PDFDocument2 pagesEntrainement Physique-Chimie Ts PDFEl Hadje CoulibalyPas encore d'évaluation
- L'informationDocument30 pagesL'informationSanae AliliPas encore d'évaluation
- ROSSINI CATALOGUE 10 Décembre 2019Document27 pagesROSSINI CATALOGUE 10 Décembre 2019infoPas encore d'évaluation
- CP Acpr SfamDocument1 pageCP Acpr SfamEmmanuel ChampalePas encore d'évaluation
- <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <TITLE>ERREUR : L'URL demandée n'a pu être chargée</TITLE> <STYLE type="text/css"><!--BODY{background-color:#ffffff;font-family:verdana,sans-serif}PRE{font-family:sans-serif}--></STYLE> </HEAD><BODY> <H1>ERREUR</H1> <H2>L'URL demandée n'a pu être chargée</H2> <HR noshade size="1px"> <P> En essayant de traiter la requête : <PRE> TEXT http://www.scribd.com/titlecleaner?title=Activit%C3%A9s+du+Club+Sportif+-+saison+2013_2014.pdf HTTP/1.1 Host: www.scribd.com Proxy-Connection: keep-alive Accept: */* Origin: http://www.scribd.com X-CSRF-Token: fcb6b77fce0e4be1ca3091a829170ad34096081a X-Requested-With: XMLHttpRequest User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.3Document60 pages<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <HTML><HEAD><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"> <TITLE>ERREUR : L'URL demandée n'a pu être chargée</TITLE> <STYLE type="text/css"><!--BODY{background-color:#ffffff;font-family:verdana,sans-serif}PRE{font-family:sans-serif}--></STYLE> </HEAD><BODY> <H1>ERREUR</H1> <H2>L'URL demandée n'a pu être chargée</H2> <HR noshade size="1px"> <P> En essayant de traiter la requête : <PRE> TEXT http://www.scribd.com/titlecleaner?title=Activit%C3%A9s+du+Club+Sportif+-+saison+2013_2014.pdf HTTP/1.1 Host: www.scribd.com Proxy-Connection: keep-alive Accept: */* Origin: http://www.scribd.com X-CSRF-Token: fcb6b77fce0e4be1ca3091a829170ad34096081a X-Requested-With: XMLHttpRequest User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.69 Safari/537.3Gaurav DharPas encore d'évaluation
- Exercice N°1Document2 pagesExercice N°1naoual baghliPas encore d'évaluation
- Traitement Thermique Des Aciers 2Document14 pagesTraitement Thermique Des Aciers 2Bertrand LaugaPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Des Affaires 1 L3 FinanceDocument76 pagesCours de Droit Des Affaires 1 L3 FinanceArnaud KouamePas encore d'évaluation
- Ch05 Sous Programmes PDFDocument81 pagesCh05 Sous Programmes PDFCheikh ManéPas encore d'évaluation
- Note 2425 20062018Document6 pagesNote 2425 20062018afadigaPas encore d'évaluation