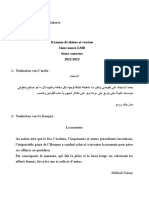Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
APPROCHES
APPROCHES
Transféré par
ken ZaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
APPROCHES
APPROCHES
Transféré par
ken ZaDroits d'auteur :
Formats disponibles
En didactique, les termes « approche », « discipline » et « méthodologie » prennent
des significations spécifiques liées à l'enseignement et à l'apprentissage. Voici
comment ces termes sont généralement compris dans le contexte de la didactique :
1. Approche didactique :
En didactique, l'approche se réfère à la manière dont l'enseignement et
l'apprentissage sont conçus et organisés. Cela inclut les choix pédagogiques, les
perspectives éducatives et les méthodes utilisées pour transmettre des connaissances
aux apprenants. Par exemple, une approche communicative en langues étrangères
mettra l'accent sur la communication orale dans des situations réelles.
2. Discipline didactique :
La discipline didactique fait référence à la manière dont une matière spécifique est
enseignée. Elle se concentre sur les méthodes et les stratégies spécifiques utilisées
pour enseigner une discipline particulière. Par exemple, la didactique des
mathématiques se pencherait sur la meilleure façon d'enseigner les mathématiques
de manière efficace.
3. Méthodologie didactique :
La méthodologie didactique concerne les méthodes et les techniques spécifiques
utilisées pour organiser, présenter et évaluer l'apprentissage des étudiants dans une
discipline particulière. Cela englobe la planification de cours, la conception de
séquences pédagogiques, les évaluations, etc. Par exemple, une méthodologie active
pourrait impliquer l'utilisation d'activités interactives pour favoriser l'engagement des
élèves.
En résumé, en didactique, l'approche se rapporte à la conception générale de
l'enseignement, la discipline didactique se concentre sur la manière d'enseigner une
matière spécifique, et la méthodologie didactique englobe les méthodes spécifiques
utilisées pour faciliter l'apprentissage dans le cadre de cette discipline particulière. Ces
concepts sont interconnectés et contribuent à la création d'un environnement
d'apprentissage efficace.
La distinction entre un concept, un terme et une notion peut parfois être subtile, mais
voici une explication plus claire de ces termes :
1. Concept :
Un concept est une idée abstraite ou générale qui représente quelque chose dans
l'esprit des individus. Il peut être un modèle mental, une abstraction ou une
généralisation. Par exemple, le concept d'"égalité" peut être une idée abstraite qui
représente l'idée que toutes les personnes devraient avoir des droits et des
opportunités équivalentes.
2. Terme :
Un terme est le mot ou l'expression utilisée pour désigner un concept, un objet ou
une idée. Il s'agit du moyen linguistique par lequel nous faisons référence à un
concept particulier. Par exemple, le terme « biodiversité » est utilisé pour décrire la
variété des formes de vie sur Terre.
3. Notion :
Une notion est une idée générale, souvent plus large et plus flexible que le concept.
Elle peut englober plusieurs concepts et idées liés. Les notions sont parfois moins
précises et peuvent couvrir un champ plus vaste de compréhension. Par exemple, la
notion de « durabilité » pourrait englober des concepts tels que la conservation des
ressources, l'équité sociale et la viabilité économique.
En résumé, un concept est une idée abstraite, un terme est le mot ou l'expression
utilisée pour représenter ce concept, et une notion est une idée générale qui peut
inclure plusieurs concepts liés. Ces termes sont souvent utilisés de manière
interchangeable, mais ils capturent différentes facettes de la manière dont nous
comprenons et utilisent le langage pour représenter notre compréhension du monde.
Les termes « attitude », « aptitudes » et « compétences » sont utilisés pour décrire
différentes caractéristiques liées au comportement, aux capacités et aux
connaissances d'une personne. Voici comment on peut généralement les distinguer :
1. Attitude :
L'attitude se réfère à l'orientation mentale ou émotionnelle d'une personne envers
quelque chose. C'est la manière dont une personne s’envoie ou réagit face à une
situation, un objet, une personne ou un concept. Par exemple, une attitude
positive envers le travail d'équipe implique d'avoir une disposition favorable et
coopérative en travaillant avec d'autres.
2. Aptitudes :
Les aptitudes sont les capacités innées ou développées qui permettent à une
personne d'accomplir des tâches spécifiques. Ce sont des compétences naturelles
ou acquises qui peuvent être développées avec le temps. Par exemple, avoir des
aptitudes en communication signifie être capable de transmettre des idées de
manière claire et efficace.
3. Compétences :
Les compétences sont des capacités spécifiques acquises par l'expérience,
l'éducation ou la formation. Elles sont généralement mesurables et démontrables.
Les compétences sont souvent associées à la capacité d'appliquer des
connaissances et des aptitudes dans des contextes pratiques. Par exemple, la
compétence en programmation informatique implique la capacité de coder et de
résoudre des problèmes informatiques.
En résumé, l'attitude concerne l'orientation mentale ou émotionnelle, les aptitudes
sont les capacités innées ou développées, et les compétences sont des capacités
spécifiques acquises par l'expérience ou la formation. Ces éléments interagissent
souvent ensemble dans le développement professionnel et personnel d'une personne.
Une attitude positive peut influencer le développement des aptitudes, qui à leur tour
peuvent contribuer au développement des compétences.
Le terme « lexique » et le terme « vocabulaire » sont souvent utilisés de manière
interchangeable, mais ils peuvent avoir des nuances de sens selon le contexte.
Cependant, dans de nombreux cas, ils sont similaires. Voici une distinction générale :
1. Vocabulaire :
Le vocabulaire se réfère à l'ensemble des mots qu'une personne
connaît dans une langue donnée. C'est l'ensemble des termes qu'une
personne peut comprendre, utiliser et reconnaître. Le vocabulaire peut
être large et comprendre des mots de divers domaines ou plus
restreint, se concentrer sur un domaine spécifique. Par exemple, le
vocabulaire d'un étudiant en biologie inclurait des termes spécifiques à
ce domaine.
2. Lexique :
Le lexique est également lié aux mots et à leur signification, mais il
peut avoir une connotation plus technique ou spécialisée. Le lexique
peut faire référence à un ensemble de termes spécifiques à un
domaine particulier, à un glossaire de termes techniques, ou à la
terminologie propre à une discipline. Par exemple, on peut parler du
lexique de la médecine pour désigner le vocabulaire spécifique à ce
domaine.
En pratique, les deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable pour
décrire l'ensemble des mots d'une langue ou d'un domaine particulier. Cependant, le
terme « lexique » peut parfois mettre l'accent sur un aspect plus technique ou
spécialisé du vocabulaire, tandis que « vocabulaire » est un terme plus général qui
englobe tous les mots d'une langue ou d'un individu.
Le raisonnement déductif et le raisonnement inductif sont deux approches différentes
pour tirer des conclusions à partir de l'information disponible. Voici comment ils se
distinguent :
1. Raisonnement déductif :
Le raisonnement déductif fait partie de propositions générales pour
arriver à une conclusion spécifique. Il suit une structure logique où les
prémisses mènent nécessairement à la conclusion. En d'autres termes,
si les prémisses sont vraies, la conclusion doit également être vraie. Un
exemple classique de raisonnement déductif est le syllogisme, où deux
prémisses conduisent à une conclusion. Par exemple :
Prémisse 1 : Tous les hommes sont mortels.
Prémisse 2 : Socrate est un homme.
Conclusion : Par conséquent, Socrate est mortel.
2. Raisonnement inductif :
Le raisonnement inductif part d'observations spécifiques pour tirer des
conclusions générales. Il n'offre pas la même certitude que le
raisonnement déductif, car les conclusions ne sont pas nécessairement
vraies même si les prémisses le sont. Les raisonnements inductifs sont
souvent basés sur la probabilité et la généralisation à partir
d'exemples. Par exemple :
Observation 1 : Chaque corbeau observé est noir.
Observation 2 : Un autre corbeau est noir.
Conclusion inductive : Tous les corbeaux sont probablement
noirs.
En résumé, le raisonnement déductif partie du général au particulier, garantissant que
la conclusion est vraie si les prémisses le sont. Le raisonnement inductif part du
particulier pour atteindre une conclusion générale, mais cette conclusion est probable
plutôt que certaine. Ces deux types de raisonnement sont utilisés dans la pensée
logique et la résolution de problèmes, chacun ayant ses propres forces et limitations.
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Types D'empruntDocument3 pagesLes Types D'empruntken ZaPas encore d'évaluation
- Cours 4 SuiteDocument2 pagesCours 4 Suiteken ZaPas encore d'évaluation
- L'entretien LibreDocument1 pageL'entretien Libreken ZaPas encore d'évaluation
- Pratiques CommunicationnellesDocument10 pagesPratiques Communicationnellesken ZaPas encore d'évaluation
- PsychologieDocument5 pagesPsychologieken ZaPas encore d'évaluation
- Pluraliyé LinguistiqueDocument5 pagesPluraliyé Linguistiqueken ZaPas encore d'évaluation
- Cours 2 PsyDocument2 pagesCours 2 Psyken ZaPas encore d'évaluation
- Corrigé Des Exercices Recherche BiblioDocument9 pagesCorrigé Des Exercices Recherche Biblioken ZaPas encore d'évaluation
- CCL CCDocument1 pageCCL CCken ZaPas encore d'évaluation
- RefDocument1 pageRefken ZaPas encore d'évaluation
- Une Hypothèse Heuristique Est Une Hypothèse Choisie Provisoirement Comme Idée Directrice Indépendamment de Sa Vérité AbsolueDocument1 pageUne Hypothèse Heuristique Est Une Hypothèse Choisie Provisoirement Comme Idée Directrice Indépendamment de Sa Vérité Absolueken ZaPas encore d'évaluation
- Didactique Du Francais PDFDocument33 pagesDidactique Du Francais PDFken ZaPas encore d'évaluation
- La Bibliographie de La Littérature MaghrébineDocument2 pagesLa Bibliographie de La Littérature Maghrébineken ZaPas encore d'évaluation
- La Bibliographie de La DidactiqueDocument8 pagesLa Bibliographie de La Didactiqueken ZaPas encore d'évaluation
- Traduc 6Document1 pageTraduc 6ken ZaPas encore d'évaluation
- ÉcritDocument2 pagesÉcritken ZaPas encore d'évaluation
- GrilleDocument4 pagesGrilleken ZaPas encore d'évaluation
- La Bibliographie de La Littérature MaghrébineDocument2 pagesLa Bibliographie de La Littérature Maghrébineken ZaPas encore d'évaluation