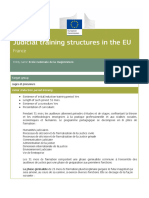Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Clini 0373-6261 1972 Num 27 1 1343
Clini 0373-6261 1972 Num 27 1 1343
Transféré par
skn.justiceTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Clini 0373-6261 1972 Num 27 1 1343
Clini 0373-6261 1972 Num 27 1 1343
Transféré par
skn.justiceDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bulletin de la Société française du
Rorschach et des méthodes
projectives
L'épreuve de choix et de rejet au TAT. Implications thématiques
A. Bolzinger
Résumé
Quand à l'issue du T.A.T., le sujet désigne deux planches qui lui plaisent et deux autres qui lui déplaisent, il se prête à une
expérience qui permet d'analyser dans ses effets la valeur spécifique de chaque planche. L'étude statistique des données ainsi
recueillies fait apparaître des groupes de « bonnes » et de « mauvaises » planches qui se répartissent en séquences critiques
dans la chronologie du test. La convergence des choix favorables ou défavorables appelle une interprétation, non pas comme
s'il s'agissait d'un choix projectif individuel mais en tant que réponse banale, c'est-à-dire fournie par une fraction importante d'un
échantillon donné. Mais comment interpréter une banalité ?
Citer ce document / Cite this document :
Bolzinger A. L'épreuve de choix et de rejet au TAT. Implications thématiques. In: Bulletin de la Société française du Rorschach
et des méthodes projectives, n°27, 1972. Les thèmes dans le Rorschach. pp. 77-84;
doi : https://doi.org/10.3406/clini.1972.1343
https://www.persee.fr/doc/clini_0373-6261_1972_num_27_1_1343
Fichier pdf généré le 17/05/2018
L'EPREUVE DE CHOIX ET DE REJET AU T.A.T.
IMPLICATIONS THEMATIQUES
par A. BOLZINGER
Nous avions commencé il y a trois ans (Symposium Rorschach 1968)
à étudier l'épreuve de choix et de rejet. Nous avions limité nos
investigations au test de Rorschach. Je les ai étendues par la suite au T.A.T. et ce
sont les premiers résultats de ce travail que je me propose d'exposer ici.
Que peut-on attendre de cette épreuve qui consiste à demander au
sujet, quand la prise du protocole est terminée, de choisir les deux
planches du test qu'il a le mieux aimées, et les deux qui lui ont le moins plu ?
Une telle démarche de choix et de rejet pourrait apporter un matériel
projectif complémentaire ou simplement éclairer l'interprétation du
protocole par les remarques et les commentaires du sujet. Mais l'objectif
principal de cette entreprise n'est pas tellement, me semble-t-il, de
conforter un diagnostic ou de compléter un dossier clinique. L'épreuve de
choix et de rejet constitue principalement un outil de recherche sur les
significations latentes qui sont attachées au matériel de test.
Au T.A.T. comme au Rorschach, le matériel du test est une donnée
constante et invariable de la situation projective. Tout se passe comme si,
en deçà d'une contribution personnelle du sujet pour structurer un
matériel équivoque, il existait une structure latente, assez peu prégnante pour
laisser place au travail projectif, mais assez prégnante cependant pour
déterminer des réponses banales, c'est-à-dire des réponses de fréquence
statistique particulière. Comment expliquer que, dans la situation
projective qui fait appel aux expressions les plus personnelles d'un sujet, un
grand nombre d'individus se rencontrent pour donner une réponse
identique ? Certains feront l'hypothèse d'un inconscient collectif ou
chercheront à évaluer l'influence des déterminations culturelles. Nous préférons
supposer que la fréquence de telle réponse devant tel matériel spécifique
est directement liée à certaines caractéristiques de ce matériel, sa
configuration, sa couleur, sa place dans la série ou toute autre raison qui fait
désigner cette planche-là et non pas une autre.
Dans cette perspective, l'épreuve de choix et de rejet permet de
comptabiliser planche par planche les réactions des sujets devant le matériel
78
de test. Elle définit une procédure simple et quasi expérimentale pour
étudier la spécificité de chaque planche.
**
*
Dans le cadre d'une consultation d orientation, j'ai recueilli 80
protocoles de T.A.T. Les sujets étaient âgés de 18 à 35 ans, hommes et
femmes en proportions égales, presque tous célibataires. Ce travail porte
donc sur 160 choix favorables et 160 choix défavorables ou rejets. Il n'y
a eu ni choix excédentaire, ni refus de choisir.
En raison des conditions d'examen, j'ai réduit le matériel du test à
douze planches, examinées par le sujet au cours d'un entretien unique.
Les planches étaient présentées dans l'ordre suivant : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 18. Il est évident que cette sélection exprime un choix du
testeur, préalable aux choix du sujet testé et que la portée de ce travail
est peut-être limitée par rapport à l'ensemble des vingt planches du
T.A.T. Les conclusions sont à référer au sous-ensemble de douze
planches qui constituent le champ de mes investigations.
Examinons successivement le bilan des choix favorables, celui des
choix défavorables ou rejets, enfin l'index de faveur qui apprécie la
différence entre la somme des choix favorables et la somme des choix
défavorables, affectée d'un signe positif ou négatif.
La fréquence des choix favorables va de 36 pour la planche 14
(presque un sujet sur deux) à 2 pour la planche 9 (un sujet sur quarante). Si
l'on classe les planches par fréquences décroissantes des choix
favorables, il se dégage un groupe de planches que l'on peut dire bien-
aimées ; les planches 14, 1 et 2 qui comptent ensemble plus de la moitié
des choix favorables. Les planches mal-aimées sont la planche 3, la
planche 6 et surtout les planches 13 et 9.
Les choix défavorables se répartissent sur un éventail de fréquences
à peu près identique. Il y a 33 choix défavorables pour la planche 13,
aucun choix défavorable pour la planche 16. Les planches le plus
souvent rejetées sont 13, 11 et 3 (50 %> des choix défavorables) tandis que
parmi les planches situées au bas du classement des fréquences
décroissantes, on trouve, outre la planche 16, les planches 1, 2, 17 et 14. On
remarque que ce classement est sensiblement l'inverse du précédent. Les
planches 1, 2 et 14 qui ont le plus souvent la faveur du choix sont aussi
le moins souvent rejetées. De même les planches 3 et 13 qui font
rarement l'objet d'un choix favorable totalisent le plus de choix défavorables.
J'ai appelé index de faveur le rapport entre les suffrages favorables
et les suffrages défavorables. Il s'exprime soit sous la forme d'une somme
algébrique où l'excédent de choix favorables se traduit par un solde
positif, l'excédent de choix défavorables par un solde négatif, soit par un
quotient qui indique par une valeur supérieure à l'unité le surplus de
choix favorables et par une valeur inférieure à l'unité le surplus de choix
— 79 —
défavorables. Ces opérations amènent à distinguer deux catégories de
planches, les « bonnes planches » (solde positif ou quotient supérieur
à l'unité) et les « mauvaises planches » (solde négatif ou quotient
inférieur à l'unité). Il convient toutefois de réserver une zone moyenne où
l'index de faveur peut être tenu pour incertain.
Les planches 1, 2 et 14 représentent les meilleures planches du test :
les sujets de notre échantillon leur attribuent quatre à cinq fois plus de
choix favorables que de choix défavorables. A ce tiercé majeur il faut
ajouter la planche 16 qui ne connaît que des choix favorables. Au
contraire les planches 3, 9 et 13 seraient les plus mauvaises planches du test ;
elles recueillent dans notre échantillon quatre à cinq fois plus de choix
défavorables que de choix favorables. Si l'on replace chacune des
« bonnes » et des « mauvaises » planches dans l'ordre de présentation
du matériel, il apparaît qu'elles sont groupées selon deux séquences, la
séquence 1, 2, 3 et la séquence 13, 14, 16. Ces séquences critiques se
détachent sur un fond de planches moyennes, ni franchement « bonnes »,
ni franchement « mauvaises ». Nous aurons à nous interroger sur le sens
de cette répartition.
**
*
Cet ensemble de données numériques décrit les divers aspects d'une
conduite sélective devant le matériel du T.A.T. et dans le cadre d'un
échantillon donné. Les résultats de la sélection témoignent à la fois des
intérêts des sélectionneurs et de la qualité du matériel sélectionné. Nous
avons, par hypothèse, neutralisé les particularités de l'échantillon afin
d'étudier les éléments significatifs se rapportant au matériel.
Avec les planches 1 et 2 le test s'engage d'emblée dans une séquence
critique. Chacune d'elle est reconnue comme une « bonne » planche,
choisie par un quart à un tiers des sujets, rejetée par moins de 5 %
d'entre eux. Une pareille faveur semble traduire une réaction
euphorique, paradoxalement liée au début du test. Le sujet aborde l'épreuve
avec une certaine appréhension. Or, la thématique proposée par les deux
premières planches (une tâche à accomplir, un environnement étranger)
lui offre une image en miroir où il se reconnaît, se rassure et se détend.
Il souhaitait réussir, réussir son test, et voici qu'il se prend à rêver que
c'est fait. La découverte du plaisir lié à l'expression projective et le
sentiment d'avoir bien répondu à la consigne du test font attribuer à ces deux
premières planches une valeur positive.
La planche 3 (nous utilisons seulement la version BM) serait une
mauvaise planche parce qu'elle rompt cette euphorie factice. Elle introduit
l'éventualité d'un échec, d'une réprimande, d'une sanction. Quand la
désillusion devient insupportable elle évoque une réaction de bouderie,
une crise dépressive ou une menace de suicide. Le rêve d'un test
complaisant et rassurant se dissipe. Tout se passe comme si, dans cette sé-
— 80 —
quence introductive, les thèmes évoqués par l'image entraient en
résonance avec la situation de test et sa problématique immédiate. Après la
crise des trois premières planches, le travail projectif semble plus dégagé
des contingences actuelles.
Pour la planche 4, les sélections sont nombreuses mais également
réparties entre les choix favorables et les choix défavorables. Deux sujets
sur cinq retiennent la planche 4, l'un parmi les « bonnes » planches,
l'autre parmi les « mauvaises ». Il s'agit en somme d'un matériel
ambivalent où la variété des récits projectifs et de leur tonalité affective
aboutissent à une distribution au hasard des choix favorables et défavorables.
En ce qui concerne les planches 6 et 9, l'interprétation des fréquences
de choix est délicate puisque nous avons utilisé deux images différentes
pour les hommes et pour les femmes, conformément aux indications de
Murray. Il apparaît toutefois que ces planches retiennent assez rarement
l'attention du sujet. La planche 6 se situe dans la zone moyenne où la
balance des choix favorables et des choix défavorables est relativement
équilibrée. La planche 9 appartient au groupe des « mauvaises »
planches ; elle est la seule à n'être pas intégrée à une séquence significative.
Ce rejet s'adresse-t-il de façon spécifique aux images représentant deux
personnages de même sexe ? Doit-on l'interpréter en fonction d'un
contexte culturel où l'expression de thèmes homosexuels est
généralement réprimée ? Il serait nécessaire d'étayer ces suppositions par
d'autres recherches cliniques.
La planche 11, avec un choix pour deux rejets, peut encore être
considérée comme une planche de la zone moyenne. Les choix négatifs sont
légèrement prédominants, peut-être à cause de l'absence de personnage
humain sur l'image. Les sujets, pendant le test, en font fréquemment la
remarque, qui traduit une solution de continuité dans les suggestions
thématiques. Il faut rappeler que Murray proposait cette planche, non
à la suite des dix précédentes mais au cours d'un second entretien,
comme première image d'une nouvelle série.
La planche 13 est particulièrement intéressante pour diverses raisons.
Elle est ressentie comme déplaisante par une forte majorité de sujets
(40 %>). Elle apparaît comme la plus mauvaise des « mauvaises »
planches. Enfin elle inaugure une série de trois planches où l'index de faveur
subit à nouveau de fortes variations après une période de valeurs
moyennes, depuis la planche 4 jusqu'à la planche 11. On remarque dans cette
séquence critique que la plus mauvaise des « mauvaises » planches est
immédiatement suivie par la meilleure des « bonnes » planches. Il n'est
pas douteux que des liens particuliers s'établissent par contiguïté entre
la planche 13 et la planche 14, des liens d'opposition et peut-être de
compensation.
L'esthétique de la planche 13 appartient au genre réaliste, avec la
grisaille équivoque d'un univers clos. L'esthétique de la planche 14 au
contraire repose sur le contraste de la lumière et des ténèbres dans un
— 81 —
cadre romantique. Le monde de Zola et celui de Lamartine en quelque
sorte. De plus la planche 13 met en scène deux personnages dans un
contexte de sexe ou de deuil tandis que la planche 14 compose une image
de rêverie solitaire. Ces éléments prennent d'autant plus de relief qu'ils
sont juxtaposés. Il semble même que la rêverie de la planche 14 se
propose de résoudre ou au moins d'escamoter les conflits de l'homme et de
la femme de la planche 13.
La planche 16 apporte mieux encore. C'est la planche idéale, la
planche sans figure imposée, la planche-à-votre-guise. Avec des récits
de bonheur banal ou de souvenirs marquants, le sujet exorcise à
nouveau ses angoisses de la planche 13. A la planche 16 tous les choix sont
favorables. On constate pourtant que ces choix sont relativement peu
nombreux comme si l'infléchissement de la consigne (il ne faut plus
interpréter mais inventer une image) provoquait un certain embarras.
Certains sujets semblent mettre la planche 16 à part, comme s'il ne pouvait
être question d'exprimer un choix à propos d'un matériel aussi
indifférencié. D'autres au contraire conservent une conduite percevante et
imageante à propos de la planche blanche et introduisent dans leur récit des
éléments tels que la neige, la lumière solaire ou au contraire l'obscurité
totale.
Cette séquence critique 13, 14, 16 met à jour deux séries de questions,
l'une à propos de la planche 13, l'autre sur l'antinomie des planches 14
et 16. Ces questions demeurent actuellement sans réponse : elles tracent
quelques orientations de recherche.
Nous avons supposé que le réalisme de la planche 13 était à l'origine
de la crise des planches 13, 14, 16. Ce point de vue descriptif ne suffit
pas à comprendre pourquoi la planche 13, avec les caractéristiques qui
sont les siennes, produit un tel impact défavorable dans notre bilan des
choix et des rejets. La même question se pose pour la planche 9, ainsi
que nous l'avons déjà mentionné. Quels sont les facteurs qui, pour ces
deux planches, conditionnent une attitude défavorable qu'on peut dire
banale, puisqu'elle se trouve dans un tiers des protocoles ?
Il est difficile de prétendre que cet assemblage statistique de choix
défavorables n'aurait aucune signification en dehors des projections
individuelles aux planches correspondantes, comme si une telle convergence
était l'effet du hasard. Ce prétendu hasard transformerait une réponse
individuelle en une banalité ; mais la liste des banalités n'est pas livrée
au hasard, elle est liée à la structure du matériel et à la situation de test.
Quels sont donc ces facteurs, dans le cas de la planche 13 par exemple,
qui conditionnent le choix défavorable d'un tiers des sujets ? Certains
diront : c'est la thématique sexuelle. Cependant à la planche 4, dont la
thématique est voisine, les choix favorables sont aussi nombreux que les
choix défavorables. Nous mesurons les effets de la valeur spécifique de
chaque planche, mais les éléments constitutifs de cette spécificité restent
encore dans l'ombre.
— 82 —
C'est avec la même perplexité que l'on observe que la planche 14 et
la planche 16 obtiennent l'index de faveur le plus élevé dans la série de
planches que nous avons étudiées. Or, la planche 14 et la planche 16
représentent deux pôles extrêmes et contradictoires dans la théorie du
T.A.T. et des tests projectifs. La planche 16 est un matériel-prétexte où
la qualité sensible est réduite à presque rien. On pourrait demander au
sujet un récit supplémentaire sans le support de ce carton blanc et le
protocole de test ne serait guère modifié. La planche 14 au contraire
provoque, nous l'avons vu, un jeu sensoriel d'interprétations
permutantes. La configuration formelle de l'image est à ce point prévalente
qu'il serait possible de substituer une analyse purement formelle à
l'interprétation thématique traditionnelle. La confrontation de ces deux
planches et de ces méthodes concurrentes se résoud curieusement par
un double satisfecit. Elaborer un récit sine materia ou interpréter les
ambiguïtés d'un matériel équivoque, ces deux tâches coexistent au sein
de l'épreuve nommée T.A.T. et cette coexistence ne semble pas troubler
le travail projectif.
Pour achever l'inventaire des choix et des rejets, planche par planche,
il reste à évoquer la planche 17 et la planche 18. J'ai utilisé l'image 17
BM sans sa variante GF. En revanche pour la planche 18, j'ai présenté
l'image BM aux hommes, l'image GF aux femmes. Ces planches n'ont
guère été retenues dans les sélections mais l'équilibre des choix
favorables et défavorables est relativement sauvegardé. Ces planches
appartiennent donc à la zone moyenne. Le travail projectif retrouve son
rythme moyen comme avant la séquence critique 13, 14, 16.
**
*
En analysant les résultats du tri et du choix (positif et négatif)
effectué à propos des planches du T.A.T., nous avons élaboré les données
numériques issues de notre échantillon tout en cernant progressivement
les éléments d'un problème herméneutique. La convergence des choix
favorables ou défavorables appelle une interprétation. Mais comment
interpréter une banalité ? Comment interpréter un ensemble de réponses
projectives dans sa signification statistique et non pas comme une
juxtaposition de réponses individuelles ? Deux types d'interprétations ont été
proposées. La première consiste en une interprétation actuelle, en
fonction d'une analyse phénoménologique de la situation de test. Telle
planche est située à son rang dans une séquence temporelle (le test) chargée
de significations valables pour tous les sujets. Nous avons proposé ce
type d'interprétation pour les planches 1, 2 et 3. Un deuxième type
d'interprétation prend en considération les caractères intrinsèques de chaque
planche, la configuration objective du matériel et ses rapports avec une
suggestion thématique sous-jacente. Nous avons situé dans cette
perspective le cas des planches 9 et 13.
— 83 —
L'approche épistémologique de ces deux modes interprétatifs ainsi
que l'étude de la spécificité de chaque planche mettent bien en évidence
à quoi peut servir cette modeste épreuve de choix et de rejet. Elle
ressemble à un dispositif de laboratoire. C'est un outil de travail pour
fondamentaliste mais le clinicien aussi peut y trouver son compte.
ANNEXE 1
Tableau des données numériques
Choix Choix* Total des Index de faveur
Planches favorables défavorables choix Différence Quotient
A B A + B A— B A:B
1 31 2 33 + 29 15,5
i
2 oo 4 26 + 18 5,5
i
3 5 22 27 — 17 0,2
|
4 17 16 33 + 1 1,0
1
6 4 11 15 —7 0,4
|
9 2 21 23 — 18 1 0,1
11 10 24 34 — 14 0,4
|
13 3 33 36 — 30 0,1
|
14 36 6 42 + 30 4,0
j
16 12 0 12 + 12
I
17 10 6 16 +4 1,4
1
18 8 15 23 —7 ' 0,5
ANNEXE 2
Classement des planches par fréquence décroissante
Choix Index de faveur
Choix Total des
favorables choix
défavorables Différence | Quotient
1 14* 13* 14* 14* 16*
!
2 1* 11* 13* 1* 1*
3 2* 3* 11* 9* 2*
4 4* 9* 1* 16* 14*
5 16* 4* 4* 17* 17*
6 17* 18* 3* 4* 4*
!|
7 11* 6* 2* 6* 18*
8 18* 14* 18* 18* 6*
9 3* 17* 9* U* 11*
'
10 6* 2* 17* 3* • 3*
!
11 14* 1* 6* 9* 9*
!
12 17* 16* 16* 13* 13*
j
N.B. — Les nombres suivis d'un astérisque représentent les planches désignées
par leur numéro.
— 84 —
RESUME
Quand à l'issue du T.A.T., le sujet désigne deux planches qui lui
plaisent et deux autres qui lui déplaisent, il se prête à une expérience qui
permet d'analyser dans ses effets la valeur spécifique de chaque planche.
L'étude statistique des données ainsi recueillies fait apparaître des
groupes de « bonnes » et de « mauvaises » planches qui se répartissent
en séquences critiques dans la chronologie du test. La convergence des
choix favorables ou défavorables appelle une interprétation, non pas
comme s'il s'agissait d'un choix projectif individuel mais en tant que
réponse banale, c'est-à-dire fournie par une fraction importante d'un
échantillon donné. Mais comment interpréter une banalité ?
Docteur A. BOLZINGER
34, avenue La Bruyère
38100 Grenoble-Villeneuve
Vous aimerez peut-être aussi
- Socco 1150-1944 1993 Num 13 1 1098Document26 pagesSocco 1150-1944 1993 Num 13 1 1098skn.justicePas encore d'évaluation
- Judicial Training in FR - ENM - EU - enDocument3 pagesJudicial Training in FR - ENM - EU - enskn.justicePas encore d'évaluation
- Clini 1265-5449 2000 Num 6 1 1155Document17 pagesClini 1265-5449 2000 Num 6 1 1155skn.justicePas encore d'évaluation
- Colan 0336-1500 1976 Num 29 1 4277Document14 pagesColan 0336-1500 1976 Num 29 1 4277skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 2001 Num 54 455 15059Document3 pagesBupsy 0007-4403 2001 Num 54 455 15059skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1994 Num 47 417 14360Document8 pagesBupsy 0007-4403 1994 Num 47 417 14360skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14170Document12 pagesBupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14170skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14174Document10 pagesBupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14174skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1961 Num 15 200 8611 t1 0289 0000 4Document3 pagesBupsy 0007-4403 1961 Num 15 200 8611 t1 0289 0000 4skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1999 Num 52 439 14797Document7 pagesBupsy 0007-4403 1999 Num 52 439 14797skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14178Document8 pagesBupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14178skn.justicePas encore d'évaluation
- Clini 0373-6261 1972 Num 27 1 1342Document8 pagesClini 0373-6261 1972 Num 27 1 1342skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14160Document8 pagesBupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14160skn.justicePas encore d'évaluation
- Clini 0373-6261 1970 Num 25 1 1323Document11 pagesClini 0373-6261 1970 Num 25 1 1323skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14179Document7 pagesBupsy 0007-4403 1992 Num 45 406 14179skn.justicePas encore d'évaluation
- Clini 0373-6261 1986 Num 33 1 1448Document8 pagesClini 0373-6261 1986 Num 33 1 1448skn.justicePas encore d'évaluation
- Clini 0373-6261 1991 Num 35 1 962-1Document12 pagesClini 0373-6261 1991 Num 35 1 962-1skn.justicePas encore d'évaluation
- Bupsy 0007-4403 1953 Num 6 7 6189Document8 pagesBupsy 0007-4403 1953 Num 6 7 6189skn.justicePas encore d'évaluation