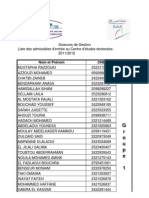Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Aaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaa
Transféré par
Hanane AzizTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Aaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaa
Transféré par
Hanane AzizDroits d'auteur :
Formats disponibles
LASRY Ghita Page 1
Plan :
Chapitre 1 : Etat des lieux sur le secteur de la logistique et motivations de la recherche
I.Importance de la logistique au Maroc
1. Les cots logistiques intgrs...
2. Niveau de maturit logistique.
3. Comptitivit productive versus comptitivit globale .
II. Llaboration du contrat programme.
1. Objectifs et impacts gnraux de la nouvelle stratgie
2. Axes de la stratgie...
III. Prestataires logistiques intgrs.
1.Dfinition
2. Les intervenants du march de la logistique au Maroc
2.1. Les oprateurs trangers..
2.2. Les oprateurs marocains.
3. Positionnement de quelques logisticiens
IV. Profil et caractristiques de la demande
1. Etat des lieux du march marocain de la logistique
2. Les clients des prestataires logistiques
3. Contraintes du secteur de la logistique au Maroc
V. Conclusion
Chapitre 2 : Prsentation gnrale de la Socit Nationale de Transport et de la Logistique
I. Historique..
1. Les premiers textes rglementant le transport.
2. Cration du Bureau Central des Transports (B.C.T)
3. Libralisation du Secteur des Transports Routier de Marchandise...
4. Transformation de lONT en SNTL.
5. Cration de la filiale SNTL Damco Logistics ..
6. Positionnement de la SNTL autant su Supply Chain Partner
II. Dtail des activits de la SNTL
1.Rseau de la SNTL..
LASRY Ghita Page 2
2. Le parc de la SNTL
3. Les clients de la SNTL ..
III. Les valeurs de la SNTL.
Chapitre 3 : Revue de littrature..
I.Lvolution des dfinitions de la logistique..
1. Dfinitions.
2. Les enjeux de la logistique..
II. Le concept de supply chain .
1. Gnralits et dfinitions
2. Les activits qui constituent les maillons de la supply chain..
3. Evaluation de la performance Supply Chain
4. Les indicateurs de performance : un langage commun..
III. La distribution, dernire tape de la chane logistique.
1. Introduction.
2. Canal, rseau et circuit de distribution..
3. Les types de canaux de distribution
4. Le circuit de distribution
5. Types de distribution.
5.1 Distribution Directe
5.2 Distribution de type Via Plate-Forme.
Chapitre IV : Cas Pratique
I. Contexte et problmatique de Colorado.
II. Etapes de collaboration.
1. Elaboration et validation de loffre
2. Ngociation et contractualisation
LASRY Ghita Page 3
Chapitre 1 : Etat des lieux sur le secteur de la logistique et motivations de la recherche
I. Importance de la logistique au Maroc :
1. Les cots logistiques intgrs :
Le secteur du transport et de la logistique est un secteur important pour l'conomie nationale
avec 100.000 emplois directs et son impact sur la comptitivit du tissu conomique aussi bien
en termes d'export que d'import.
Du fait de sa position gographique stratgique, ses milliers de km de ctes sur la Mer
Mditerrane et locan Atlantique dune part, ainsi que sa situation privilgie la croise des
deux continents Europe et Afrique, le Maroc a bien compris que lun de ses enjeux majeurs en
terme de comptitivit rside dans son positionnement comme plate-forme logistique
performante, efficace et cots rduits, permettant de jouer pleinement son rle de pont entre le
Nord et le Sud dans les changes commerciaux.
Cest un pays mergent, en fort dveloppement, o les cots logistiques totaux slvent
environ 20% du PIB. La figure ci-dessous donne le CLI (Cot Logistique Intgr) estim par la
banque mondiale.
Figure 1 : Estimation du cot logistique
Or, ce taux est bien suprieur celui d'autres pays mergents comme le Brsil, le Mexique et la
Chine o ce ratio varie entre 15% et 17%. Il est galement suprieur celui des pays de lUnion
Europenne y compris ceux qui lont rejoint en 2004 (dont le ratio se situe entre 10 et 16%). La
figure 2 illustre cette diffrence. Le Maroc possde ainsi un potentiel de gain de plusieurs points
de PIB qui proviendrait dune logistique plus performante.
LASRY Ghita Page 4
Figure 2 : Positionnement Maroc par rapport au Mexique, Brsil et La Chine et au pays en
voie de dveloppement
2. Niveau de maturit logistique
La logistique reprsente donc dune manire gnrale et en particulier au Maroc des enjeux
importants en termes de comptitivit conomique et de croissance, ainsi quau plan social et de
dveloppement durable, en termes de congestion urbaine, de pollution et de scurit routire. Or,
nous constatons quau Maroc, le cot de la logistique est prohibitif. Ce cot excessif est
corrobor par la faiblesse de lindice de performance de la logistique au Maroc.
Cet indice prend en compte la qualit du transport et de linfrastructure, laccessibilit et la
facilit dorganiser les flux de transport international, les comptences logistiques des acteurs
nationaux, la traabilit et le suivi, les cots logistiques domestiques, le respect des dlais et
lefficacit des procdures de ddouanement. (Voir Figure 3)
Sur la base de cet indicateur, la Banque mondiale qui a procd un benchmark a class le
Maroc au 94me rang, aprs plusieurs pays de la rgion tels que la Tunisie (60me), le Soudan
(64me) et la Mauritanie (67me). Cette position au 94
me
rang mondial, est un rsultat pas du
tout attendu par le Maroc compte tenu de sa proximit par rapport lEurope.
Les 3 dimensions sur lesquelles le Maroc accuse un retard marqu selon lindex de performance
logistique sont :
Comptences logistiques des acteurs nationaux :
Le faible dveloppement des prestataires logistiques et le manque de sensibilisation
limportance de la logistique parmi les entreprises marocaines ne contribuent pas lmergence
de ces services. Seulement une poigne dentreprises propose des services logistiques lis au
LASRY Ghita Page 5
transport. Loffre de conseil en logistique est quasiment inexistante. Rares sont les entreprises
marocaines qui ont intgr une logique 4PL (cf/ dfinition par la suite), considre comme un
facteur important de comptitivit.
Traabilit et suivi : Les entreprises doivent tres capables dassurer la conformit par
des systmes daudit, la mise en place de systmes de traabilit ou lobtention dune
certification. Toutes ces normes reprsentent aujourdhui un dfi de taille pour de trs
nombreuses PME au Maroc.
Cots logistiques domestiques : Ces cots ne concernent que le transport, lentreposage
et sont chers puisquil ya :
o Un dsquilibre des flux
o Un manque doptimisation
o Un taux de remplissage faible
o Des entrepts disperss
Lefficacit des procdures de ddouanement et le respect des dlais sont un stade
intermdiaire puisquil est reconnu que le dlai et procdures de ddouanement ont t
considrablement amliors au cours des dernires annes. Certes, la concurrence est aujourdhui
si importante quun retard de quelques heures dans larrive des produits peut conduire la perte
dun march.
Alors que laccessibilit et facilit dorganiser des expditions au niveau international ainsi que
la qualit du transport et des infrastructures sont dj des dimensions acquises pour le Maroc.
Figure 3 : Les dimensions de lIndice de performance logistique
LASRY Ghita Page 6
En effet, grce cet indice, lon peut dire que la performance du secteur logistique au Maroc
dans son ensemble reste un stade intermdiaire, caractristique des pays mergeants, mais
prsentant un fort potentiel de dveloppement par rapport aux pays daspiration, une offre de
service encore variable (cot, qualit, dlai), une demande en moyenne peu sophistique et un
manque dinfrastructures spcialises sur certains flux.
Sur un autre registre plus qualitatif et conceptuel, la figure 4 ci-dessous dfinie la maturit
logistique en trois niveaux:
une logistique naissante : O le focus est limit, voire faible en ce qui concerne des
infrastructures ainsi que les services logistiques efficaces. Cas de lInde, Indonsie et
Chine Rurale
une logistique intermdiaire : Dans ce cas la qualit des infrastructures est bonne sauf que
les services logistiques sont encore ngligs. Cest le cas du Maroc (voir Figure2)
une logistique avance : Le dveloppement des infrastructures et services est quilibr et
le secteur est orient vers le concept supply chain, comme Dubai, Singapour, et Hong
Kong.
Figure 4 : Le Maroc par rapport aux niveaux de maturit logistique
3. Comptitivit productive versus comptitivit globale
Par ailleurs, le Maroc sest engag ces derniers temps dans llaboration dune nouvelle
gnration de Plans sectoriels, qui ont pour objet d'accrotre la comptitivit de l'conomie
nationale et de la hisser aux meilleurs standards internationaux, en particulier pour les mtiers
mondiaux du Maroc. Voici le plan de dveloppement de chacune de ces stratgies sectorielles :
LASRY Ghita Page 7
Plan Maroc vert pour lagriculture : est la nouvelle stratgie agricole au Maroc labore
et ce, pour rendre lagriculture le principal moteur de croissance de lconomie nationale
dans les 10 15 prochaines annes. Cette nouvelle politique a pour finalit la mise en
valeur de lensemble du potentiel agricole du territoire afin de rpondre quatre objectifs
principaux constituant lheure actuelle un enjeux important pour lconomie national.
Ces objectifs sont:
o lamlioration des revenus des agriculteurs
o la garantie de la scurit alimentaire de 30 millions de marocains
o la protection des ressources naturelles des diffrentes rgions
o lintgration de lagriculture marocaine au march national et international
Pacte national pour lmergence industrielle :
Le contrat programme a pour but d'assigner au secteur les objectifs gnraux suivants sur la
priode 2009-2015 :
o La cration d'emplois industriels prennes et la rduction du chmage urbain dans les six
mtiers mondiaux du Maroc : Offshoring, Automobile, Aronautique, Electronique,
Textile et Cuir et Agroalimentaire ;
o L'augmentation du PIB industriel ;
o La rduction du dficit commercial ;
o L'appui l'investissement industriel, tant national qu'tranger ;
o La contribution la politique d'amnagement du territoire.
Plan halieutis pour le secteur de la pche :
Le Plan Halieutis est destin venir en aide aux pcheurs marocains par la cration de
nouvelles plateformes industrielles et la gestion plus professionnelle des ressources
halieutiques. Ce plan tait bas sur une stratgie sectorielle intgre s'articulant autour de
trois axes majeurs : l'exploitation durable des ressources halieutiques, le dveloppement
d'une pche performante et l'amlioration de la comptitivit afin de conqurir de nouvelles
parts de march.
Ce nouveau programme en faveur de la pche comporte seize projets, dont un vise la cration
de trois ples d'excellence bass Tanger, Agadir et Laayoune-Dakhla
Plan Rawaj pour le commerce intrieur :
Le plan daction 2008-2012 du plan Rawaj Vision 2020 est mis en place pour la
modernisation et la relance du commerce et de la distribution. Cette stratgie, est d'abord un
LASRY Ghita Page 8
ambitieux objectif retenir : faire passer la contribution du commerce intrieur dans le PIB
de 12,5% actuellement 17% en 2020.
Il a pour principaux objectifs :
o Lamlioration des conditions dapprovisionnement du citoyen marocain
o Lamlioration le niveau de vie des commerants
o Laugmentation de la contribution de la valeur ajoute du secteur au PIB national
o La cration des opportunits demplois
Plan du secteur de lnergie :
La stratgie nergtique du Maroc s'articule autour de quatre piliers fondamentaux savoir :
o la scurit nergtique,
o l'accs l'nergie tous et des prix comptitifs,
o la protection de l'environnement,
o l'intgration rgionale
Figure 5 : La comptitivit productive vs comptitivit globale
II. Llaboration du contrat programme :
1. Objectifs et impacts gnraux de la nouvelle stratgie :
Puisque les cots logistiques intgrs au Maroc slvent environ 20% du PIB, le niveau de
maturit est un stade intermdiaire et la comptitivit productive repose sur la comptitivit
logistique, la stratgie nationale a t mise en place pour le dveloppement ces lments prcits.
Elle a fait l'objet du contrat-programme 2010-2015, et prvoit de rduire les cots logistiques de
20 15 % du PIB. Portant notamment sur la ralisation de 70 plateformes logistiques
LASRY Ghita Page 9
interconnectes l'chelle nationale, sur environ 3300 ha dont 2080 lhorizon 2015 raliser
tout au long de ce programme, la nouvelle stratgie logistique du Royaume, ambitionne
d'acclrer la croissance conomique de 0,5 point de PIB par an, soit 5 points de PIB en 10 ans,
ce qui correspond une cration de richesse d'environ 20 milliards de dirhams en plus value
directe.
Cette nouvelle stratgie contribuera galement au dveloppement durable du pays, travers la
rduction des nuisances (baisse du nombre de tonnes/kilomtres de 30% lhorizon 2015,
rduction des missions CO2 de 35% lhorizon 2015, dcongestion des routes et des villes).
Cette tude a montr le potentiel damlioration de la comptitivit de lconomie du Maroc,
lexport et limport comme en interne, par le biais dune logistique performante rorganisant et
optimisant les diffrents flux de marchandises.
La stratgie ainsi dfinie est de nature apporter les rponses ncessaires au dveloppement du
secteur de la logistique et les solutions adquates aux problmes de gestion des flux de
marchandises et permet de rpondre aux besoins logistiques des diffrentes stratgies sectorielles
lances ou en cours de mise en uvre au niveau national (plan Maroc vert pour lagriculture,
pacte national pour lmergence industrielle, plan halieutes pour le secteur de la pche, plan
Rawaj pour le commerce intrieur, stratgie nergtique,).
Figure 6 : La nouvelle stratgie logistique entre les diffrentes stratgies sectorielles
LASRY Ghita Page 10
La Stratgie logistique doit permettre au Maroc de prenniser la mise en uvre de ses plans
sectoriels et daccrotre la comptitivit de lconomie nationale.
Ce nest pas un secret. Le secteur de la logistique est le systme nerveux de toute conomie
performante. La Stratgie nationale de dveloppement de la comptitivit logistique fait partie de
ces grands chantiers voulus par le Maroc de la nouvelle re. Le Royaume a ainsi ralis ces
dernires annes une vritable rupture dans le dveloppement des infrastructures de transport
(autoroutes, ports, chemins de fer) et a franchi dimportantes tapes dans le processus de
rformes. Libralisation oblige, lintroduction de la concurrence dans les diffrents modes de
transport et de lquipement sest impose devant une conomie marocaine qui se rveille.
Il est vrai que tout dveloppement des services logistiques ne peut se faire sans infrastructures
efficaces, ou sans llimination des entraves institutionnelles telles que les situations de
monopole ou de faible concurrence.
En plus de la poursuite de la politique des grands chantiers de transport et la multiplication du
volume de linvestissement y affrant durant les annes (le lancement de nouveaux projets
structurants tels que les lignes grande vitesse, les autoroutes, les ports Tanger Med II et Nador
West Med), il est ncessaire par consquent de donner une impulsion relle au secteur des
services logistiques [1].
2. Axes de la stratgie :
Pour atteindre les objectifs gnraux viss ci-dessus, la mise en oeuvre de la nouvelle stratgie
logistique du Maroc sarticule autour de cinq axes cls :
Axe 1 : Dveloppement et mise en uvre dun rseau national intgr de Zones
Logistiques Multi-Flux (ZLMF) :
On entend par zone logistique Multi-flux une zone dactivits ddie la logistique, comportant
un ou plusieurs types de plateformes diffrentes, avec une mutualisation des infrastructures
communes et des services gnraux sur site.
La co-localisation de plusieurs types de plateformes (des plateformes conteneurs, de distribution et
de sous-traitance logistique, dagro-commercialisation, de matriaux de construction, et des plateformes
cralires) dans une mme ZLMF et ltablissement de couloirs logistiques autour des grandes
mtropoles permet galement la mutualisation de la connectivit du site en infrastructures
routires, autoroutires et ferroviaires. Le schma national des zones logistiques Multi-Flux
(ZLMF) prvoit la mise en place, dans le Grand Casablanca, de huit ZLMF sur une superficie
totale de 978 ha dont 607 ha en 2015, et couvrant lensemble des cinq grands types de
plateformes logistiques. Ci-dessous une carte descriptive des huit ZLMF du Grand Casablanca
LASRY Ghita Page 11
Figure 7 : Carte des ZLMF du Grand Casablanca
Axe 2 :Optimisation et massification des flux de marchandises :
Le potentiel d'optimisation des flux de marchandises est ralis travers leur rorganisation
et leur massification en optant pour des plateformes logistiques, l'amlioration de la capacit
de stockage, l'utilisation du mode de transport le plus appropri et l'adoption du meilleur
rseau de circulation des diffrentes marchandises, ddies aussi bien l'exportation qu' la
distribution intrieure.
Axe 3 : Mise niveau et incitation lmergence dacteurs logistiques intgrs et
performants :
La mise niveau de la demande sur des prestations logistiques intgres travers
l'encouragement des entreprises recourir aux plateformes logistiques
Axe 4 : Dveloppement des comptences travers un plan national de formation dans les
mtiers de la logistique :
Le 4e axe accorde un intrt particulier aux ressources humaines en tant qu'lment essentiel
dans la russite de cette stratgie.
Axe 5 : Mise en place dun cadre de gouvernance du secteur et de mesures de rgulation
adaptes :
A travers la cration de l'Agence marocaine pour le dveloppement de la comptitivit
logistique pour la coordination sur le plan national entre les diffrents intervenants.
LASRY Ghita Page 12
III. Prestataires logistiques intgres
1. Dfinition
La logistique regroupe l'ensemble des activits qui permettent de grer les flux physiques et
d'information dans le but d'en minimiser les cots, et ce, de l'amont l'aval de la "chane
logistique" en respectant des conditions satisfaisantes en termes de dlais et de qualit.
Lexternalisation massive des activits logistiques a permis lessor dun nouveau type dacteur :
le prestataire de services logistiques. Acteur central, au cur des chanes logistiques toujours
plus complexes et tendues, le PSL doit dvelopper et consolider une double comptence lie
dune part sa capacit dorganisation mais aussi sa capacit dinnovation (Brulhart et
Claye-Puaux, 2009, p.66). Les recours massifs des prestataires externes ont ainsi accompagn
les mouvements de recentrage sur le cur de mtier des entreprises (Qulin, 2007).
Externalisations juges stratgiques, les donneurs dordres (chargeurs) cherchent des spcialistes
(prestataires) leur permettant, dune part, de rduire leurs cots (Barthlmy et Chalaye, 2004) et
dautre part datteindre leurs objectifs stratgiques, et de se rorganiser (Qulin, 2007 ;
Desreumaux, 1996).
Un prestataire logistique est un acteur logistique ralisant un certain nombre d'oprations
logistiques pour le compte de ses clients ; on peut distinguer trois types de prestataires :
Les oprateurs de base sont centrs sur les oprations quelles soient physiques
(transport, manutention, stockage) ou administratives (oprations dimport-export). Ils
gnrent une valeur ajoute faible, leurs marges sont crases voire ngatives :
o 1PL (First Party Logistics) traitent des oprations de transport uniquement
o 2PL (Second Party Logistics) correspond aux clients qui externalisent leurs
oprations de transport et de stockage
Les 3PL (Third Party Logistics) ou LSP (Logistics Service Providers) grent pour le
compte de leurs clients des oprations logistiques identiques au cas prcdent mais de
nature plus complexe car multi-sites, multi-pays et multicanaux de distribution.
Les 3PL se diffrencient par un large ventail de prestations logistiques assures. Il peut
aller de la gestion des fonctions de base (pick and pack, entreposage, distribution, etc.) au
contrle de la fonction logistique de leur client avec ralisation d'oprations fortes
valeurs ajoutes (traabilit, le packaging, le cross-docking, etc.)
Ils dveloppent des capacits concevoir des solutions appuyes par des modles
doptimisation et dgagent des rentabilits suprieurs aux oprateurs de base mais au
sein desquelles la dimension immobilire nest pas trangre;
LASRY Ghita Page 13
Les 4PL (Fourth Party Logistics), suggrent en sappuyant sur les nouvelles technologies
de linformation une r-intermdiation des chanes de valeur logistiques en prenant en
charge le pilotage de celles-ci pour le compte dun chargeur. Lide est quelles apportent
une expertise conomique et technique des marchs fournisseurs de briques
fonctionnelles (systmes dinformation transactionnels et dcisionnels sur les diffrents
champs fonctionnels de la Supply Chain) et oprationnelles (transport, stockage,) et
une valeur ajoute suprieure par la combinaison optimale de ses briques en mettant en
uvre de nouvelles sources de mutualisation. Les prestataires 4PL planifient et
coordonnent les flux d'informations entre les diffrents acteurs de la chane.
Les principaux avantages de l'utilisation d'un prestataire logistique sont :
de permettre l'entreprise cliente de se consacrer uniquement son activit de base et de
ne pas "s'parpiller" dans un domaine qu'elle ne matrise pas ou pour lequel elle ne
dispose pas des comptences ncessaires
de profiter de l'expertise du sous-traitant pour ce type d'oprations et de la "mutualisation
les clients".
2. Les intervenants du march de la logistique au Maroc
Dans les grandes entreprises industrielles, la majorit des oprations logistiques
s'effectuent en interne. Le transport et le stockage des marchandises (logistique sous traite)
reprsentent une part substantielle du march, mais le niveau des services de stockage est
relativement bas et les conditions techniques dans lesquelles il se droule sont infrieures aux
standards.
Le march marocain de la sous-traitance logistique de type 3PL (stockage, gestion des stocks,
prparation des commandes, organisation de la distribution physique, services dinformation et
valeur ajoute) est bipolaire : les demandes de prestations logistiques manent majoritairement
d'entreprises trangres ou dentreprises orientes vers le commerce international, alors que les
ressources des entreprises marocaines sont tout juste suffisantes pour le transport ou le simple
stockage.
Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie. Il nexiste aucune donne propos
du volume que reprsente le march de la sous-traitance logistique.
Le march se heurte la mme difficult que dans les pays europens lors de lapparition des
oprateurs logistiques : la rticence des clients confier des tiers des informations dtailles
concernant leurs processus et leurs clients, et l'ide que l'oprateur logistique peut se transformer
en distributeur commercial grce aux informations et aux contacts obtenus.
Le march est rparti entre trois types doprateurs :
LASRY Ghita Page 14
+ Les oprateurs trangers: DHL/Exel, Geodis, Maersk Logistics, Graveleau,
IDLogistics Maroc, M&M, MORY International.
+ Les oprateurs nationaux: La Voie Express, SNTL, SDTM, Marotrans-Logismar,
ONCF, TIMAR.
+ Et, des oprateurs louant leurs plateformes pour le compte de logisticiens ou de
clients. Ces oprateurs nexercent pas lactivit logistique proprement dite.
2.1 Les oprateurs trangers
Ces oprateurs sont installs principalement Casablanca et Tanger. Leurs clients oprent
notamment dans le secteur de la grande distribution (Acima,), et la grande consommation
(Nestl, LOral,).
Les prestations offertes par les oprateurs trangers sont:
Les implantations des oprateurs logistiques trangers au Maroc, leur superficie totale ainsi que
leurs clients sont regroups dans le tableau ci-dessous :
LASRY Ghita Page 15
2.2 Les oprateurs marocains :
Ces oprateurs sont installs dans les grandes villes: Casablanca, Tanger, Agadir, Fs et
Marrakech.
Leurs clients oprent notamment dans le secteur des mines (OCP,), les ciments, et
lagroalimentaire (McDonalds, Coca Cola,).
Les prestations offertes par les oprateurs marocains sont:
La SNTL, oprateur logistique marocain sera dtaill dans le chapitre suivant
Les implantations des oprateurs logistiques au Maroc, leur superficie totale ainsi que
leurs clients sont regroups dans le tableau ci-dessous :
LASRY Ghita Page 16
3. Positionnement de quelques logisticiens
La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des
services annexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march.
SDTM: son cur de mtier est la messagerie.
GEFCO: ce groupe se positionne dans la logistique intgre lchelle mondiale.
DACHSER GRAVELEAU: cette entreprise internationale se positionne dans la
logistique et le transport international, avec une plateforme logistique Mohammedia et
des MEAD Tanger et Casablanca.
Slide benouda
IV. Profil et caractristiques de la demande :
1. Etat des lieux du march marocain de la logistique
Le march de la logistique au Maroc est estim aujourdhui 200 MDH.
Caractristiques cls: Plates-formes logistiques encore sous-dveloppes malgr la prsence
dacteurs internationaux, tels : Maersk Logistics, Geodis, Exel / DHL,
Type de logistique: amont 50%, industrielle 20% et logistique en aval 30%.
Type de circuits de distribution: circuit long 65% / circuit court 35%.
Gestion des stocks des produits vendus: flux pousss 25% (stock t au maximum) / flux
tirs 75% (stockage des produits finis avant leur commercialisation). Les flux pousss
impliquent lutilisation dune logistique industrielle (personnalisation retarde).
Importance de la logistique dimportation: 85%. Limportation implique lutilisation
dentrepts.
Entreposage et transport vont de paire: soit les entreprises externalisent les deux, soit
elles grent les deux en propre.
Plus lentreprise est internationale, plus son taux de service est lev.
60% des entreprises font de la reverse logistique ou flux retours .
LASRY Ghita Page 17
2. Clients des prestataires logistiques
Le tissu industriel marocain est constitu de plus de 8 000 entreprises employant 445 000
personnes. Celles qui font appel au secteur logistique sont de diffrents types :
o Les entreprises orientes vers le commerce extrieur, qui ont t les premires
introduire des pratiques logistiques modernes comme la palettisation, la gestion des
stocks et les systmes de gestion et de suivi des oprations.
o Les industries orientes vers le march local, qui commencent ragir face la
concurrence des produits imports et aux pressions du secteur de la grande distribution
commerciale.
o Lagriculture, qui est encore la principale source demploi du pays et affiche le dualisme
typique du secteur industriel : dune part, une agriculture exportatrice exigeante en termes
de dlais de livraison et de cot logistique, qui a essentiellement recours au transport TIR,
et dautre part, une agriculture traditionnelle destine aux marchs locaux et aux tranches
de population les plus pauvres, dont lorganisation logistique est trs peu dveloppe et
qui a recours au transport informel.
3. Contraintes du secteur de la logistique au Maroc :
Le secteur de la logistique au Maroc est caractris par un ensemble de dysfonctionnements et de
contraintes qui l'empchent de bnficier pleinement de son principal avantage concurrentiel en
l'occurrence sa position gographique. Le dveloppement de la logistique au Maroc reste donc
tributaire de plusieurs facteurs o il y a lieu dimportantes amliorations. Parmi ces facteurs, il y
a lieu de citer:
Foncier indisponible, cher et inadapt;
Promotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates,
correctement dimensionnes et conformes aux normes;
Absence de rglementation;
Faible expertise marocaine en matire de construction conforme aux normes
internationales;
Externalisation de la chane logistique encore timide;
Multitudes dintervenants;
Insuffisance de la formation intermdiaire;
Plates-formes de faible envergure, en termes de superficie et de capacit
Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention;
Absence de normes de construction;
Absence de fiscalit spcifique;
Transport non professionnel
LASRY Ghita Page 18
Voici une synthse de ltat actuel du march en ce qui concerne loffre et la demande ainsi que
les attentes exprimes pour la logistique sachant quaujourdhui, la demande se focalise
davantage sur le prix que sur la qualit de loffre logistique propose :
LASRY Ghita Page 19
Conclusion :
Les efforts que le Maroc fournit aujourdhui pour le dveloppement du transport et de la
logistique sont considrables et visent faire de ce secteur vital, un atout de sa comptitivit et
un catalyseur de son arrimage conomique au march europen tous les niveaux.
Des investissements trs importants sont consacrs lextension et la modernisation des
rseaux dinfrastructures (routes, autoroutes, chemins de fer, ports, aroports, etc)
Sur un plan institutionnel et juridique, des rformes volontaristes des diffrents modes de
transport sont menes et portent sur la libralisation des marchs et donc une plus grande
implication des oprateurs privs, notamment europens.
Au-del de ces projets et ces rformes, le dveloppement des services logistiques au Maroc est
lun de nos soucis majeurs afin doptimiser lefficacit de tous les maillons de la chane.
Ainsi que le dveloppement d'un rseau national intgr de zones logistiques proximit des
grands bassins de consommation, des zones de production et des principaux points d'changes et
grandes infrastructures de transport a t prvu dans le contrat programme
Dans cette lance, la premire zone type est celle de Zenata. En effet, cette zone reprsente le
cur de lactivit logistique par la construction et le lancement de la premire plateforme
logistique aux normes internationales de la SNTL. La Socit Nationale des Transports et de la
Logistique complte son offre en proposant des prestations logistiques ses clients, ce qui
constitue le prolongement naturel de son activit transport, exerce depuis plus de 70 ans.
En effet, Les solutions apportes par la SNTL aux entreprises, qui souhaitent externaliser leur
logistique, permettront de rduire leurs cots et contribueront lamlioration de leur
comptitivit. La stratgie de dveloppement de la SNTL est dailleurs totalement en phase avec
lune des orientations majeures du contrat-programme visant encourager lmergence dacteurs
nationaux dans le domaine de la prestation de la logistique intgre.
LASRY Ghita Page 20
Figure 8 : Dveloppement de la logistique, priorit stratgique pour renforcer la
comptitivit conomique du Maroc
Ci-dessus est prsente la zone logistique multi-flux concerne o a t construite la premire
plateforme de la SNTL ainsi quun descriptif approfondi.
Voici donc lune des raisons qui a motiv le choix de mon stage au sein de la SNTL, une socit
en pleine mutation, premire et leader du transport et de la logistique sur le march.
Mon objet de recherche concerne la distribution dtaill dans le chapitre III, et plus prcisment
les outils et techniques dingnierie construire pour accompagner une industrie de peinture
dans son dveloppement ainsi que la mise en place des solutions logistiques, dans le cadre de
loptimisation de son rseau de distribution.
Chapitre 2 : Prsentation de la SNTL
I. Historique
Jusquen 1929, le Maroc a connu un accroissement trs important des moyens de transport,
ce dernier tait lui-mme le rsultat du dveloppement des infrastructures et des secteurs de
lconomie marocaine. Mais la crise mondiale allait avoir des rpercussions sur lconomie
marocaine en bouleversant lquilibre tabli.
LASRY Ghita Page 21
Elle se traduisit par une rduction brutale des volumes des transports, conscutive notamment au
ralentissement des grands travaux de dfrichement, des transports de phosphates et des transports
militaires.
1937
Cration du Bureau Central des Transports
Mission principale : organiser le secteur du transport routier de marchandises et
instaurer les rgles gnrales de gestion du secteur et des diffrents mtiers de
transport.
1963
Le BCT deviendra lOffice National des Transports (O.N.T)
Commissionnaire agr pour lexcution des oprations de transport pour compte.
1999
Libralisation du secteur du transport routier de marchandises
2007
ONT devient une socit anonyme dnomme SNTL Socit Nationale
des Transports et de la Logistique.
Diversification : gestion des gares routires voyageurs activit assurances
2009
Dveloppement du cur de mtier Transport et Logistique
Programme n1 de la Logistique.
250 000 m2 de surface en prparation
Lancement des travaux du Centre de Mohammedia
Programmes Essaimage Performance Partenaires Transport
Programmes Performance des Mtiers Gestion pour Compte
Pour des services grande valeurs ajoute
Programme Orientation Clients :
Une organisation et un management tournes satisfaction clients
1. Les premiers textes rglementant le transport :
Les premiers textes furent promulgus en 1933. Ils contingentrent les transports de
voyageurs et de marchandises sur la base des droits acquis. Une commission dite des transports
fut cre pour dlivrer les agrments.
Ces mesures stabilisrent relativement la situation, mais entranrent une spculation nfaste au
dveloppement du secteur. En effet, avec lagrment est cre une nouvelle proprit ou un bien
immatriel cessible. Les agrments ngociables prirent une valeur commerciale et servirent de
base de nouveaux crdits, entranant la prolifration des moyens de transport.
LASRY Ghita Page 22
2. Cration du Bureau Central des Transports (B.C.T) :
Linstauration de la coordination a eu pour consquence directe la cration du Bureau
Central des Transports (B.C.T).
En effet, dans le domaine des transports de marchandises, tous les bureaux de chargement
existants ont t ferms et remplacs par un tablissement tatique forme commerciale, le
B.C.T qui deviendra plus tard lOffice National des Transports (O.N.T), conformment au dahir
du 10 juin 1958.
Le rle de ce bureau tait le mme que celui qui a t assign lO.N.T. par le Dahir N1.63.260
du 12 novembre 1963.
3. Libralisation du Secteur des Transports Routier de Marchandises :
Toutefois, le statut de la rglementation du transport national routier des marchandises, le
dveloppement du secteur informel, le vieillissement du parc, la faible professionnalisation du
secteur, la gestion artisanale des entreprises, etc. ont constitu des entraves au dveloppement de
cette activit.
4. Transformation de lONT en SNTL :
En excution des termes de larticle 20 1er de la loi 16/99, le projet de loi n25-02 relatif
la cration de la Socit Nationale des Transports et de la Logistique (S.N.T.L) et portant
dissolution de l'Office National des Transports a t adopt par le Conseil du Gouvernement le
18 dcembre 2003 et approuv par le Conseil des Ministres le 16 avril 2004 ainsi que par la
Chambre des Reprsentants le 7 Juillet 2004 et par la Chambre des Conseillers le 19 Avril 2005.
Cette loi a t publie au bulletin Officiel n 5374 du 1er Dcembre 2005
5. Cration de la filiale SNTL Damco Logistics :
SNTL, la socit nationale de transport et de la logistique s'est alli DAMCO l'oprateur
logistique international et filiale du groupe AP Moller-Maersk.
LASRY Ghita Page 23
Ce partenariat est une joint venture entre le champion national de la logistique et du transport
routier en particulier: la SNTL, et un grand groupe et leader mondial des solutions logistiques
DAMCO. Il permettra travers la cration de "SNTL DAMCO Logistics" d'offrir au march
marocain une nouvelle offre logistique totalement intgre ainsi que des solutions
personnalises.
Cette offre qui concerne la partie Logistique Entreposage ainsi que le pilotage de flux et
s'appuiera notamment sur le rseau de plateformes logistiques spcialise travers le Maroc que
la SNTL compte implanter dans les villes de Tanger, Agadir, Mekns et Marrakech et dont la
surface totale utile atteindra 210.000 m2 pour un budget global de 1.2 milliards de Dh. Cette
offre s'inscrit dans le cadre du schma directeur de la SNTL qui entend contribuer activement au
dveloppement du secteur de la logistique au Maroc et offrir des services logistiques forte
valeur ajoute pour amliorer la comptitivit de lconomie nationale.
La SNTL sest mobilise pour accompagner la stratgie logistique lance par Sa Majest le Roi
Mohammed VI qui constitue un des chantiers phare pour le dveloppement conomique du
Royaume.
La plateforme logistique de Zenata a t inaugure par Sa Majest le Roi Mohamed VI courant
le mois dAvril. Le pari est russi, la plateforme est oprationnelle depuis fvrier 2011.
6. Positionnement de la SNTL autant que Supply Chain Partner :
Leader du transport et de la logistique, la multitude des solutions logistiques intgres
offertes par la SNTL va de la conception la mise en uvre.
La SNTL propose donc :
Excellence oprationnelle et optimisation dynamique tous les stades via les meilleurs
services adapts vos impratifs oprationnels, financiers et commerciaux;
LASRY Ghita Page 24
Visibilit ncessaire la gestion de votre supply chain, grce une expertise-mtiers et
une longue exprience;
Solutions personnalises la pointe de la technologie permettant des contrles tous les
stades de la supply chain ncessaires au maintien permanent dun trs haut niveau de
performance localement, rgionalement et lchelle internationale.
Figure 9 : Positionnement de la SNTL sur lensemble de la chaine de valeur
Freight Forwrding & Transit :
La SNTL propose des solutions de transport intgres et adaptes aux besoins de ses
clients afin de leur permettre de se positionner parmi les leaders de leur secteur en optimisant
leurs flux internationaux et multimodaux. Elle favorise lapprovisionnement en continu,
supprime les temps dattente, assure la scurisation des marchandises jusqu la fin des
oprations douanires dans ses MEAD et enfin propose une assistance et un accompagnement
tous les stades du processus douanier.
Transport & Affrtement :
Depuis 1937, la SNTL propose toute son expertise, son engagement dun leader. La
SNTL conoit pour chacun de ses clients des solutions spcifiques adosses son savoir-faire
global en mobilisant toutes ses comptences et tout son rseau (cf/ chapitre suivant).
La SNTL est une entreprise rsolument multi-mtiers : Affrteur, chargeur et transporteur routier
Logistique dEntreposage :
La SNTL offre des solutions logistiques globales, collaboratives et flexibles pour la
supply chain de ses clients, garantes de lamlioration continue de leurs budgets. Elle offre le
stockage et entreposage sous douane ou sous temprature dirige, en toute scurit de tous types
de marchandises: les matires dangereuses, les produits fragiles ou haute valeur ajoute, les
produits secs ou hors gel.
LASRY Ghita Page 25
Logistique de Distribution :
La SNTL recherche le rseau de distribution optimal (cot, temps, trajet) pour satisfaire
ses clients l o ils se situent, en tenant compte des spcificits de leur supply chain: voir figure
ci-dessous.
Dans le chapitre suivant le cas distribution est dtaill.
Figure 10 : Les diffrents types de distribution
Ingnierie et gestion de projets
Faire de la Supply Chain un avantage comptitif pour se positionner sur des marchs
cibls reste un atout capital. Cest grce une expertise majeure en ingnierie, performance de la
Supply chain et de solutions logistiques intgres que la SNTL concoit et met en uvre les
systmes cherchs par ses clients.
Leader du transport et de la logistique au Maroc depuis plus dun demi-sicle, elle offre une
multitude de solutions logistiques intgres et personnalises allant de la conception jusqu la
mise en uvre.
Ses talents, tous experts en Supply Chain, peuvent faire valoir leur connaissance approfondie
des produits, des secteurs et des marchs.
Son approche reste simple et pragmatique pour vous apporter des solutions vos besoins :
Analyse de la performance de la supply chain;
Ingnierie et recherche des solutions;
Identification des chantiers Quick Wins, chiffrage et choix des meilleures
solutions;
Personnalisation des solutions et accompagnement dans la monte en
comptence;
Revue et suivi permanent de la performance.
Durant la conception des solutions logistiques qui vous est propose, des propositions sont
livres plusieurs niveaux :
Conseil en optimisation et planification des oprations de transport;
LASRY Ghita Page 26
Conseil en optimisation du schma directeur dapprovisionnement et de
distribution;
Conception de la chane logistique et identification des goulets dtranglement;
Diagnostic et optimisation des processus dans lentrept.
Chez la SNTL, performance, proximit, citoyennet, engagement et valorisation du capital
humain ne sont pas les seules proccupations. Il importe avant tout que les clients se sentent bien
chez la SNTL.
La SNTL est prsente sur lensemble de la chaine de valeur en en proposant des Services
valeur ajoute, du conseil en optimisation et planification des oprations du schma directeur
dapprovisionnement et de distribution, la conception de la chaine logistique et lidentification
des goulets dtranglements, ainsi que le diagnostic et loptimisation de la gestion de lentrept.
Elle repose galement sur un des partenaires stratgiques slectionns selon un processus
matris tir par les besoins et attentes des clients.
II. Dtail des activits de la SNTL :
La Socit Nationale des Transports et de la Logistique est un grand prestataire de services
daffrtement national et international. Plus de 70 ans dexprience dans le domaine du transport
routier de marchandises au Maroc, Partenaire fiable et acteur principal du secteur au Maroc, la
SNTL demeure la rfrence nationale en matire de scurit, de qualit et de proximit. Le
premier oprateur sur le march de transport, elle a accord une attention particulire la qualit
de service et aux exigences de la clientle en la matire, do la certification de toutes ses
prestations commerciales ISO 9001 version 2008.
Plus de 300 clients desservis, la SNTL est connue et reconnue pour la qualit et la fiabilit de ses
prestations de transport routier de marchandises.
Comptant plus de 400 collaboratrices et collaborateurs et adoss un rseau commercial dune
trentaine dagences couvrant toutes les rgions du Royaume, la SNTL entend se dvelopper, de
faon profitable pour ses clients et ses partenaires, dans lactivit de transport routier de
marchandises, son cur de mtier.
La SNTL mobilise 750 1000 vhicules par jour et fait appel galement, des professionnels du
transport et des partenaires rpondant un haut niveau dexigence en termes de fiabilit, scurit,
rgularit, ractivit...
LASRY Ghita Page 27
Figure 11 : Activits de la SNTL
1. Rseau de la SNTL :
- 30 agences commerciales implantes travers le territoire national ;
- 7 directions rgionales qui coiffent les agences commerciales dont une ddie au
Transport International Routier ;
Figure 12: Un rseau national de proximit votre service
- 210 000 m
2
de surface utile terme (2015) pour les prestations logistiques :
Afin de diversifier son mtier, la SNTL a lanc en octobre 2009 les travaux de construction de
son centre logistique Mohammedia-Znata sur une superficie de 28 hectares. Idalement plac
proximit du port de Casablanca, lieu de groupement des activits industrielles. Dbut 2011 a
connu linauguration de cette plate-forme logistique avec une capacit actuelle de 50.000 m
2
, le
centre logistique multiflux de Mohammedia offrira terme 100.000 m de surface utile et
comprendra divers espaces de stockage adapts la nature de lactivit de ses clients :
LASRY Ghita Page 28
o Entrepts secs palettes pour le stockage des produits alimentaires et divers,
temprature ambiante ;
o Entrepts secs pour le stockage des produits en vrac ;
o Entrepts frigorifiques palettes ou vrac pour le stockage des produits frais, congels et
surgels.
o Aire de stockage des conteneurs secs et frais ;
o Magasin sous douane pour le stockage des produits dimport/export Aire de
stationnement pour les semi-remorques TIR.
Ci-dessous une image de lemplacement de la plateforme Mohammadia.
Figure 13 : Emplacement de la SNTL
En termes de services, le centre de logistique de Mohammedia propose des prestations
logistiques valeur ajoute dans un environnement moderne et un site amnag aux normes
internationales :
o Rception
o Rfrencement
o Contrle qualit
o tiquetage
o Mise en stock
o Prparation des commandes
o Enlvement et acheminement au point
de consommation
o Gestions des retours...
Voici une image relle de la plateforme aujourdhui :
LASRY Ghita Page 29
Et puisque les implantations logistiques sont concentres essentiellement dans cinq villes :
Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech et Fs voir la figure ci-dessous. La SNTL prvoit
une plate-forme dans chacune de ses villes galement.
Ce rseau permet une ractivit trs rapide de la force commerciale de la SNTL ainsi que de ses
centres de trafic, entits responsables sur le plan rgional de laffrtement des vhicules.
La force de vente de la SNTL est compose denviron 50 commerciaux forms pour :
- Rpondre aux attentes des clients,
- Recevoir leurs commandes et les prendre en charge,
- Proposer une gamme de produits diversifis,
- Conseiller les clients et les assister,
- Traiter leurs rclamations
LASRY Ghita Page 30
2. Le parc de la SNTL :
Le parc de la SNTL ralise 18 Millions de tonnes transportes/an et un Chiffre daffaires de
prs de 800 millions de Dhs/an. Elle sappuie sur deux types de parc :
+ Parc partenaire :
Pour assurer la disponibilit du parc, la SNTL fait appel des transporteurs partenaires. Et
pour ce faire, elle a mis en place un processus de slection trs strict pour garantir la scurit, la
fiabilit et la performance du transport.
Ces transporteurs doivent rpondre aux critres suivants :
- Professionnalisme avr,
- Parc diversifi et de qualit,
- Surface financire viable,
- Discipline des chauffeurs
+ Parc propre de la SNTL :
La loi 25-02 autorise la SNTL acqurir son propre parc. A cet effet, la SNTL sest lance dans
un programme dacquisition progressive dun parc propre spcialis constitu de bennes
cralires , de semi-remorques plywood, de plateaux munis de twist lock, de vhicules double
pont).
Son apptit de maintenir sa place du leader le pousse agir pour relever tous les dfis possibles.
Pour faire face la comptitivit acharne, la SNTL dispose aujourdhui dun parc propre de
vhicules diversifi, spcialis et rpondant aux normes internationales pour sadapter aux
exigences des clients. Son parc est de 114 vhicules spcialiss de dernire gnration, go
localisables par satellites.
Frigo
19%
Caisse Plywood
26%
Bennes
24
%
Double pont
5%
Plateaux
26%
LASRY Ghita Page 31
3. Les clients de la SNTL :
De par son histoire, son image de marque, et sa capacit de mobiliser jusqu 1000 camions/jour,
la SNTL a constitu un portefeuille clients important aussi bien publics que privs. Ses
principaux clients sont :
Administrations et organismes publics : F.A.R, ONICL, OCP
Priv : Fertima, Lesieur, Sonasid, Suta, Sonacos, Cosumar,
La satisfaction du client est le premier souci de la SNTL, pour cela elle a mis en place tous les
moyens humains et matriels pour assurer loptimisation des flux, la traabilit des produits et la
scurit des stocks :
Systme dinformation WMS permettant la gestion optimale des stocks et la prparation
des commandes ;
Equipes formes ;
Systme de surveillance la pointe de la technologie...
Leurs attentes sont donc schmatises ci dessous :
Figure 14 : Attentes des clients SNTL
LASRY Ghita Page 32
III. Les valeurs de la SNTL :
La SNTL sest construite sur des valeurs essentielles qui sont :
La performance : offrir une qualit de service leve dans un cadre de
professionnalisme et assurer une performance individuelle et collective ;
Lengagement : intgrit, transparence et responsabilit ;
la valorisation du capital humain : prserver la richesse humaine par la reconnaissance
et la motivation ;
la proximit : se mobiliser et tre lcoute active pour sadapter au mieux aux
exigences des clients ainsi quapporter des solutions personnalises ;
la citoyennet : contribuer au dveloppement social et conomique
LASRY Ghita Page 33
Chapitre 3 : De la logistique la Supply Chain : limportance de la logistique
de distribution
Aprs une premire partie ddie dfinir les enjeux, lobjet et le primtre des logistiques et
rvler les volutions cls qui ont marqu son histoire, nous passons en revue dans une seconde
partie les fonctions et les moyens dont la logistique a la responsabilit. Puis dans une deuxime
partie, nous aborderons la logistique de distribution.
I.Lvolution des dfinitions de la logistique
Le terme logistique vient dun mot grec logistkos qui signifie lart du raisonnement et du
calcul. La logistique dans le contexte militaire, est un ensemble des oprations ayant pour but
de permettre aux armes de vivre, de se dplacer, de combattre et dassurer les vacuations et le
traitement mdical du personnel (Le petit Larousse, grand format, 1993, p.608). La logistique
dentreprise est apparue aprs la fin de la seconde guerre mondiale, notamment avec la
rinsertion dans les entreprises, des spcialistes militaires en logistique. Mais, aussi bien quavec
le dveloppement du commerce. Le concept de logistique a volu depuis, avec les volutions de
systme doffre et de la demande.
1. Dfinitions :
Aujourdhui, aucune dfinition universelle de la logistique nexiste, car celle-ci recouvre des
interprtations trs diverses. Cela va du simple transport ! jusquau une science
interdisciplinaire combinant ingnierie, micro conomie, thorie des organisations et stratgie. Il
savre, en effet, que le concept de la logistique est un paradigme en soi (Mller, 1995). Cette
apparente contradiction tient au fait que la logistique est en mouvement perptuel et en constante
volution depuis la fin de la seconde guerre mondiale. La logistique est une dmarche que lon
pourrait qualifier dmergente, tant elle a volu et tant elle continue largir son champ
daction au sein des firmes. Les huit dfinitions qui suivent sont une slection qui nous semble
pertinente face notre problmatique, sans prtendre quelles sont reprsentatives de la diversit
des formes :
Dfinition 1 : La premire dfinition, sous le non de logistique, remonte 1948. Elle a t
propose par le comit des dfinitions de lAmerican Marketing Association. La logistique
concerne le mouvement et manutention des marchandises du point de production de
consommation ou dutilisation (Marks et Taylor, 1967). Cette dfinition nillustre que laspect
physique de la logistique (le transport et la manutention).
Dfinition 2 : En 1962, la dfinition propose par le NCPDM tait dj plus large que celle de
lAmerican Marketing Association : Terme employ dans lindustrie et le commerce pour
dcrire le vaste spectre dactivits ncessaires pour obtenir un mouvement efficient de produits
LASRY Ghita Page 34
finis depuis la sortie des chanes de fabrication jusquau consommateur, et qui dans quelques cas
inclut le mouvement des matires premires depuis leur fournisseur jusquau dbut des chanes
de fabrication. Ces activits incluent le transport des marchandises, lentreposage, la
manutention, lemballage de protection, le contrle des stocks, le choix demplacement dusines
et dentrepts, le traitement des commandes, les prvisions de march et le service offert aux
clients . En plus de llargissement des tches physiques, cette dfinition contient les prvisions
de march, le service offert aux clients et le choix des emplacements dusines et dentrepts qui
est une dcision stratgique.
Dfinition 3 : En 1968, la dfinition de Magee (1968) est lune des premires qui a clairement
englob les flux dapprovisionnement et laspect gestion dans la logistique : Technique de
contrle et de gestion des flux de matires et de produits, depuis leur source
dapprovisionnement jusqu leur point de consommation .
Dfinition 4 : Par rapport lancienne dfinition propose par le NCPDM :(National Council of
Physical Distribution Management (1972) la dfinition de 1976 met laccent sur la circulation
des informations en plus de laspect management: la logistique est une partie des activits
dune chane logistique (supply chain). Elle concerne la planification, lexcution et le contrle
du flux efficient et effectif du stockage de produits, du service de linformation relatif ces
fonctions du point dorigine au point de consommation visant satisfaire les exigences des
clients .
Dfinition 5 : En 1977, Heskett (1977) propose une dfinition plus concrte qui reflte laspect
pragmatique de la rflexion amricaine sur le management : la logistique englobe les activits
qui matrisent les flux des produits, la coordination des ressources et des dbouchs, en ralisant
un niveau de service donn au moindre cot . Avec cette dfinition, la logistique a
vritablement fait son apparition comme une discipline de management.
Il ne faudrait pas non plus croire que lobsession de la logistique nait exist depuis trente ans
quaux tats-Unis. En France, comme dans tous les pays dvelopps, il existe un courant de
pense sur la logistique dentreprise depuis dj plusieurs annes. Ainsi, on peut galement
suivre cet effort conceptuel dans lvolution des dfinitions. Cependant, nous nous contentons de
donner une dfinition issue de la littrature franaise :
Dfinition 6 : Tixier et al. (1996) proposent la dfinition suivante de la logistique : la fonction
de la logistique dans lentreprise est dassurer au moindre cot la coordination de loffre et de la
demande, aux plans stratgique et tactique, ainsi que lentretien long terme de la qualit des
rapports fournisseurs-clients qui la concernent . la diffrence des autres dfinitions, la
logistique est ici le management stratgique et tactique qui assure au moindre cot lquilibre
entre loffre et la demande.
Pour le Directeur de Dveloppement SNTL, : la logistique regroupe lensemble des oprations
(recueil des besoins, approvisionnement, pilotage des fournisseurs, gestion des stocks et des
LASRY Ghita Page 35
flux) qui permettent dobtenir la meilleure offre de service de mise disposition aux
utilisateurs du bon produit, au bon moment, au bon endroit et au meilleure cot global .
On peut souligner alors que les divergences ont essentiellement trait ltendue du champ
daction ou dintervention de la logistique. Cette vision largie considrablement les perspectives
logistiques et loigne le concept de la simple distribution physique en lui confrant un champ
daction plus large. La voie est ouverte, comme nous le verrons grce au mouvement que nous
vivons au Maroc, un largissement des champs dintervention de la logistique dans plusieurs
secteurs dactivits.
2. Les enjeux de la logistique :
Outil de comptitivit des entreprises Outil de dveloppement territorial
- Accrotre la productivit dans un univers
fortement concurrentiel
- Amliorer et acclrer le service
- Limiter les cots et les dlais de production
- Rpondre aux exigences de flexibilit, de
fiabilit et de rapidit
- Maximiser les potentialits des TI et des
autres technologies
- Optimiser les processus et les trajets
- Accentuer la collaboration entre les
partenaires de la chane
- Innover dans la gestion de la chane
logistique pour en retirer un avantage
concurrentiel
- Grer les risques
- Assurer le recyclage et grer les retours
- Mieux rpondre aux exigences des clients,
prvoir et susciter la demande
- Attirer et retenir les entreprises et les
prestataires logistiques
- Raliser des conomies dchelle grce la
concentration dactivits
- Contribuer la cration demplois dans une
rgion
- Mieux intgrer les oprations logistiques en
milieu urbain
- Favoriser une plus grande accessibilit
physique
- Optimiser les flux de marchandises
- Contribuer rduire les dlais et la
congestion
- Offrir des possibilits dintermodalit
- Offrir des possibilits de ralisation
dactivits valeur ajoute
-Desservir un bassin adjacent de
consommateurs
- Contribuer freiner la dgradation des
infrastructures
II. Le concept de supply chain :
1. Gnralits et dfinitions :
On dfinit assez souvent la supply chain comme la suite des tapes de production et
distribution dun produit depuis les fournisseurs des fournisseurs du producteur jusquaux clients
de ses clients (dfinition du Supply Chain Council).
La figure ci-dessous est assez caractristique de ce qutait autrefois la chane des intervenants
ncessaires dans la distribution classique pour amener un produit jusquau consommateur final.
LASRY Ghita Page 36
Figure 15 : La distribution historique
La chaine logistique est un concept issu de cette manire de penser les activits, alignes de
manire transversale vers la cration de valeur.
Figure 16 : chaine logistique et chaine de valeur
La valeur tant ce que le client est prt payer pour obtenir le produit ou la prestation quil
souhaite, la chaine est construite au plus juste pour liminer tous types de gaspillages :
inefficience, stocks plthoriques, fonctions inutiles ou mal dimensionnes, etc.
En outre, elle doit tre ractive et coller au mieux aux demandes et attentes des clients. Son
activit sera donc tire par la demande.
La chaine logistique peut se schmatiser laide de trois maillons de base : approvisionner,
produire ou transformer et distribuer. Voir figure ci-dessus.
Lapprovisionnement couvre les besoins en matires et/ou produits ncessaires la production
ou leur transformation.
LASRY Ghita Page 37
La distribution se charge de mettre ces produits la disposition du client final.
Ces trois maillons collaborent de faon obtenir la meilleure performance globale. Ils sont pour
cela manags, planifis et coordonns par une entit transversale le supply chain manager,
mme si chacun deux est encore intgr dans une structure hirarchique fonctionnelle classique.
La supply chain commence au sein de lentreprise, cest la chaine maitrise, louverture de
lentreprise. Une fois cette chaine maitrise, louverture de lentreprise ses fournisseurs
immdiats ainsi qu ses clients directs, sous forme de collaboration ou de partenariat, cre une
chaine tendue. On relie alors les trois maillons de base de chaque partie. Chaque segment prut
conserver sa planification et coordination locale le comportement distinct voqu
prcdemment- mais elle se fera sous lautorit de lentit qui gre lensemble de la chaine, elle-
mme garante de la meilleure performance globale. Cette organisation dborde alors le strict
primtre de lentreprise et constitue en quelque sorte une entreprise virtuelle.
Le troisime niveau est celui de la chaine logistique globale, qui prend en compte les
fournisseurs des fournisseurs et les clients des clients. Elle couvre thoriquement les activits
depuis les sources des matires premires jusquaux points de consommation.
On admet couramment que la supply chain comprend toutes les activits associes la
transformation et la circulation de biens et de services- y compris les flux dinformations
concomitants - depuis lextraction des matires premires jusquau client final (Hauguel et
Viardot, 2001)
Il existe ainsi de nombreuses dfinitions de la supply chain , qui se rejoignent sur lessentiel
mettant laccent plus particulirement sur une partie des activits de la chaine. Nous retiendrons
la suivante :
La supply chain est une organisation destine livrer :
Le produit attendu ;
En quantit dsire ;
Au niveau de qualit attendu ;
Au bon endroit ;
En temps et lheure.
Les quatre piliers supportant le Supply Chain Management (SCM), en font galement sa
dfinition :
une organisation en processus et en flux,
oriente vers la satisfaction du client,
coordonnant les contributions de toutes les parties prenantes pour atteindre le niveau de
performance attendu au moindre cot global
et dont la performance est constamment mesure.
LASRY Ghita Page 38
2. Les activits constituant les maillons de la supply chain
Chacun des maillons de la supply chain reprsente une activit ou un ensemble dactivits que
lon peut regrouper sous lune des quatre expressions de la mthode SCOR :
Source : cest--dire approvisionner, y compris toutes les activits que lon va trouver autour
de ce concept, lachat, le rfrencement, etc.
Make : cest--dire la fabrication dans ses diffrentes variantes industrielles : fabrication de
masse, fabrication la commande, etc.
Deliver : cest--dire la distribution sous toutes ses formes : ventes aux entreprises (B2B),
vente au grand public (B2C) et ses multiples variantes.
Plan : ce sont les oprations transverses deux maillons qui permettent de piloter les relations
entre deux maillons. Ce sont les activits mmes de pilotage de la supply chain telles quelles ont
t dcrites au paragraphe prcdent par opposition aux activits prcdentes qui constituent les
maillons mmes de la supply chain.
3. Les indicateurs de performance : un langage commun
La gestion de la chane logistique implique une synchronisation de toutes les activits de la
chane. L'objectif recherch tant la cration de la valeur ajoute pour le client et pour tous les
acteurs de la supply chain.
Cela suppose tout d'abord une intgration complte des acteurs de la chane en termes de partage
mutuel des informations (niveaux de stocks, prvisions) et de coopration (stratgie de
partenariat). Ensuite, il faut un partage mutuel des risques et des bnfices ncessaire
l'engagement et la coopration long terme entre les membres de la chane. Enfin, tous les
acteurs de la supply chain doivent partager une mme volont de satisfaire les clients. Une
supply chain performante exige videmment le respect de ces conditions, mais encore faut-il
prciser la notion de performance.
En effet, Diversit des acteurs Diversit des flux La Supply Chain runit plusieurs milliers
dentreprises, depuis les fournisseurs jusquaux points de vente, en passant par les industriels, les
prestataires logistiques, les grossistes et les dtaillants . Pour Thierry Jouenne, il y a lieu de
trouver un langage commun toutes ces entreprises pour analyser les situations et chercher
samliorer au travers des indicateurs de performances .
Dans le cadre des travaux mens lAFNOR (Association franaise de normalisation), quatre
leviers permettent de dfinir ces indicateurs :
La fiabilit logistique, Une organisation est dite fiable lorsque la probabilit de remplir
sa mission sur une dure donne correspond celle spcifie dans le contrat ou le cahier
des charges , explicite Thierry Jouenne, pour qui, pour la logistique, la fiabilit
consiste en la capacit de rpondre la demande du client selon un niveau de service fix
. Les indicateurs susceptibles de mesurer cette fiabilit logistique sont le taux de service
client, le taux de service fournisseurs, le taux de service transport, le taux de rclamations
ou de litiges, le taux de fiabilit des prvisions, le taux dabsentisme du personnel, etc.
LASRY Ghita Page 39
Lefficience logistique, rapport entre efficacit et cot. Il explicite la recherche dun
objectif avec le minimum de moyens engags. Plusieurs indicateurs defficience peuvent
tre dfinis : cot total dachat, cot de fabrication, cot de possession de stock, cot de
transport, cot de passage quai, etc.
La ractivit logistique, capacit dadapter rapidement les volumes de production et la
varit des produits aux fluctuations de la demande, et dacclrer la mise sur le march
dun nouveau produit. De multiples indicateurs donnent une mesure de la ractivit :
time-to-market, rotation des stocks, vitesse dcoulement des produits, ratio de tension
des flux, temps de cycle, de transit, dattente, cycle order-to-cash, cycle cash-to-cash, etc.
Lenvironnement, au travers de ladoption de pratiques "vertes" et dindicateurs co-
logistiques, comme la consommation dnergie, lmission de gaz effet de serre par les
activits logistiques, etc.
On peut ainsi dnombrer des centaines dindicateurs , estime Thierry Jouenne, et si on les
mettait tous au mme plan, on naurait quune faible visibilit pour la conduite des organisations
logistiques . Voil pourquoi ont t identifies quatre typologies dindicateurs dfinis de faon
rigoureuse et structure avec formules de calcul, donnes de calcul, unit et priodicit de
mesure, facteurs influents, plan daction, fichiers joints et liens Internet :
Les indicateurs de performance : taux de service, cot logistique, tonnes de CO2
mises.
Les indicateurs de processus : taux de fiabilit des prvisions de vente, taille de
lot ou minimum de commande, frquence de livraison, taux de remplissage des
vhicules, taux horaire...
Les indicateurs dinterface (entre lindustriel et le distributeur, entre lindustriel et
le transporteur, entre lentrept et les magasins de dtail) : taux de service, dlai
de livraison, temps dattente, le cot de linterface, etc.
Les indicateurs dactivit : nombre de commandes, dunits produites, dheures de
prparation, de colis prpars ou expdis, de palettes htrognes, de tonnes-
kilomtres parcourus, etc.
Lensemble de ces indicateurs constitue le rfrentiel En loccurrence une librairie interactive
o les indicateurs sont classs par niveau de maturit, levier daction, maillon de la Supply
Chain, fonction dans lentreprise et typologie.
Dans le chapitre suivant, nous traitons la logistique de distribution dans toutes ses formes, nous
abordons les types, les canaux, et les circuits de distribution. Nous dtaillons pour chaque type
les intrts, risques et limites potentielles.
LASRY Ghita Page 40
III. La distribution, dernire tape de la chane logistique
1. Introduction :
Dfinition1 : Yves Pimor &Michel Fender : Une logistique de distribution, celle des
distributeurs, qui consiste apporter au consommateur final, soit dans les grandes surfaces
commerciales, soit chez lui en VAD par exemple, les produits dont il a besoin
Dfinition2 : Lambert, 1978 La collection dunits organisationnelles qui font le marketing
dun produit, soit interne ou externe au manufacturier
La distribution, lment de la politique commerciale permet de mettre disposition du
consommateur final les biens et services. Elle consiste slectionner et grer un ensemble de
moyens pour que les biens soient disponibles au bon endroit, dans les quantits voulues et dans
les conditions matrielles les plus propices susciter lacte dachat.
Cela implique souvent lintervention dintermdiaires qui constituent alors les lments du canal
de distribution de lentreprise. Nous commenons par une petite comparaison entre les lments
intervenant dans le transport charge complte et dans la distribution, ci-dessous un tableau qui
les synthtise :
Charge complte Distribution
Marchandise Homogne (Une seule
expdition)
Un client et un seul point de
dchargement
Livraison dpt/usine
Marge restreinte
Plusieurs clients par expdition ou bien
un seul client et plusieurs points de
livraisons
Plusieurs rfrences de marchandises
par expdition
Groupage et dgroupage
Livraison client final/ Client
intermdiaire/ Grossiste/ GMS
Marge importante
Dlais de livraison maitriser :
- Contre remboursement
- Manutention manuelle et mcanique
- Retour de marchandises
Figure 18: Comparaison entre le transport Charge complte et la distribution
2. Canal, rseau et circuit de distribution :
La distribution fait intervenir les notions de :
LASRY Ghita Page 41
- Canal de distribution : cest le chemin commercial parcouru par un produit pour aller du
producteur au consommateur final.
Dfintion3 : Richard Speed, 1997 Un canal de distribution est un ensemble dinstitutions inter-
relis tant engags dans la production et approvisionnement dun produit ou service pour des
consommateurs.
Les diffrents canaux de distribution peuvent tre nomms & dcrits arbitrairement de la faon
suivante :
Canal direct : Fabricant >>> Consommateur
Canal court : Fabricant >>> Dtaillant >>> Consommateur
Canal long : Fabricant >>> Grossiste >>> Dtaillant >>> Consommateur
Canal long intgr : Fabricant >>> Centrale d'Achat >>> Dtaillant >>> Consommateur
Canal trs long : Fabricant >>> Grossiste >>> Semi-Grossiste >>> Dtaillant >>>
Consommateur
Le nombre d'intermdiaires qu'il convient d'utiliser pour chaque niveau de distribution est
fonction du degr de couverture du march vis par l'entreprise.
- Circuit de distribution : souvent confondu avec le canal de distribution, le circuit de
distribution regroupe lensemble des canaux par lesquels un mme bien est achemin du
producteur au consommateur.
- Rseau de distribution : cest lensemble des personnes (physiques ou morales) qui
interviennent dans la distribution dun bien ou dun service.
Nous dtaillons dans les chapitres suivants tous ces lments.
3. Les types de canaux de distribution :
Le canal de distribution peut tre dfini comme tant le chemin parcouru par un bien pour aller
du producteur au consommateur final.
Tout produit passe donc par un canal de distribution avant d'atteindre le consommateur final.
L'on distingue ainsi plusieurs types de canaux de distribution, qui sont classs en fonction du
nombre d'intermdiaire par lequel le produit transite depuis son point de dpart chez le
fournisseur jusqu' son arrive chez le client.
Il s'agit du canal ultra-court qui ne fait intervenir aucun intermdiaire. Dans ce cas, le produit
passe directement des mains du producteur ceux du consommateur.
LASRY Ghita Page 42
Le canal court quant lui fait intervenir un intermdiaire appel le dtaillant et qui sert de
relais entre le producteur et le consommateur.
Et enfin, le canal long fait intervenir plus de deux intermdiaires entre le producteur et le
consommateur : ce sont les ramasseurs, les grossistes, les semi-grossistes, les dtaillants...
Rappelons galement qu'un circuit de distribution est constitu par l'ensemble des canaux de
distribution. Ainsi, le choix des canaux de distribution s'avre important pour une entreprise car
il doit permettre de rduire au maximum le dlai requis pour l'coulement des produits ou des
biens. Il faudra donc prendre en compte diffrents paramtres tels que la nature du produit
couler, la rglementation en vigueur, la politique de distribution des concurrents, les habitudes
et les frquences d'Achat des clients... Gnralement, l'on pense que plus un canal de distribution
est court, plus les cots sont rduits du fait qu'il y'ait moins d'intermdiaires.
Mais, cette approche n'est pas toujours vrifie car quelle que soit la longueur du canal de
distribution, les intermdiaires doivent raliser certaines tches assez complexes et ce en fonction
de la nature du produit, ce qui n'a pas forcment un rapport avec la longueur du canal de
distribution.
Les tches ou fonctions assures par les intermdiaires sont de ce fait au nombre de trois :
d'une part, les tches spatiales que sont le transport, le regroupage des commandes et
le fractionnement qui ont pour but d'accrotre les gains et de dvelopper la logistique.
Ensuite, les tches temporelles que sont le stockage des marchandises et
le financement, tiennent compte des priodes de production et celles de consommation.
Et enfin, les tches commerciales telles que la communication et le service client qui
ont pour but d'informer le client (conseil d'utilisation, service aprs-vente...).
Les canaux sont au nombre de trois et se caractrisent par leur longueur, voir tableau ci-dessous :
Canal ultra court Canal court Canal long
Aucun intermdiaire entre le
producteur et le
consommateur
Producteur
Consommateur
(Vente de vin la proprit,
par le viticulteur)
Un seul intermdiaire entre le
Producteur et le
consommateur
Producteur
Dtaillant
Consommateur
(vente de vtements dans une
boutique)
Nombre dintermdiaires gal
ou suprieur deux
Producteur
Grossiste
Dtaillant
Consommateur
(vente de fruits et lgumes au
march)
Figure 17 : Types de canaux de distribution
LASRY Ghita Page 43
Selon la nature du produit vendu : prissable, industriel, de consommation courante...
Selon limage de marque : le style de vente doit tre cohrent avec le canal (exemple :
franchise).
Selon lefficacit du canal : flexibilit, pouvoir de contrle, volume des ventes ralis, cot des
intermdiaires, marges...
Selon le personnel : exprience de la vente, effectif.
Selon sa capacit de production : quantits produites, dlais de fabrication.
Selon sa clientle : dispersion gographique, attentes, habitudes dachat.
Ses objectifs commerciaux : parts de march, niveau de contrle et pouvoir de ngociation sur
les revendeurs.
4. Le circuit de distribution
Le circuit de distribution est form de lensemble des canaux utiliss pour distribuer le
produit.
Le choix du circuit doit tre cohrent avec le produit, le prix, la communication.
Lentreprise peut opter pour une des trois stratgies suivantes selon la diffusion du bien :
Stratgie slective : c'est--dire la slection d'un nombre limit de distributeurs selon
leur spcialisation et leur comptence, elle a pour objectif de limiter le nombre de
dtaillants pour tablir des relations de coopration plus fortes et viter de disperser son
effort.
Stratgie exclusive : qui correspond un monopole accord un nombre rduit de
distributeurs dans une zone gographique, elle a pour objectif de rserver la distribution
quelques points de ventes spcialiss, pour conserver un meilleur contrle des
intermdiaires et farder au produit une image de prestige.
Stratgie intensive, correspondant la diffusion gnralise du bien par tous les canaux
de distribution, elle a pour objectif de saturer le plus vite possible les marchs potentiels
en tant prsent dans un maximum de points de vente.
5. Types de distribution :
Selon le type d'intermdiaires, on compte plusieurs types de distributions.
Distribution directe : sans intermdiaire entre le producteur et l'utilisateur.
LASRY Ghita Page 44
Ex. : VPC, vente domicile, vente directe usine.
Distribution intgre : le producteur a son propre rseau de distribution.
Distribution sous-traite : le producteur fait appel un rseau de distributeurs extrieurs.
Ex. : concessionnaires, franchiss.
Distribution rpartie : le rseau de distribution, indpendant du producteur, comprend des
grossistes et des dtaillants.
5.1 Distribution Directe :
On parle de Distribution Directe lorsque le plan de transport ne comprend quun seul segment :
le camion va directement de lusine dorigine au concessionnaire sans utilisation de centres
logistiques intermdiaires.
Les intrts dune telle distribution se manifestent dans :
Performance en terme conomique qui est lie la minimisation du nombre de
kilomtres, labsence dutilisation de plates-formes intermdiaires vu que les passages
par ces plates-formes se traduisant par des cots de manutention et dans le cas o le
transporteur peut se passer de lutilisation dune plate-forme logistique pour lensemble
de son rseau de distribution, les cots fixes de cette plate-forme sont vits.
Performance en termes de dlais de distribution lie la minimisation du nombre de
kilomtres.
Ses risques sont:
Qualit de service : La distance du dernier segment est plus leve dans le cas dune
Distribution Directe que dans celui dune distribution via plateforme. Il existe donc un
risque davaries ou de salissures lies au transport plus important. Celles-ci ne sont pas
remdiables dans le cas du dernier segment puisquil ny a plus de plate-forme
traverser avant darriver chez le concessionnaire.
Performance conomique : en cas de volume insuffisant par destination finale, les
chargements risquent de ne pas tre optimiss dans la mesure o ils ne minimiseront pas
le nombre darrts en concessions. Dans ce cas, il est probable que les dtours effectus
augmenteront le nombre de kilomtres au-del de ceux parcourus pour une Distribution
Via plateforme.
Ses limites potentielles :
LASRY Ghita Page 45
Qualit de service : ce type de plan de transport require que les mmes services puissent
tre oprs sur lusine dorigine que sur les plates-formes alternatives (prestations de
type atelier). Dautre part les concessionnaires sont gnralement rassurs par le fait
dtre livrs depuis une plateforme locale.
Organisation oprationnelle : Deux cas se prsentent :
o Dans le cas o lusine et le concessionnaire de destination ne sont pas dans le
mme pays, les conducteurs risquent dtre confronts des problmes de
langage et de connaissance gographique.
o Dans le cas de la distribution directe, le besoin en termes de dimensionnement
des zones de chargement de lusine est plus important que dans celui de la
livraison via plateforme. Le temps consacr la constitution des chargements est
en effet gnralement plus long du fait de labsence de consolidation avec des
productions dautres usines.
5.2 Distribution de type Via Plate-Forme
On parle de massification logistique lorsque le plan de transport prvoie un transit par une plate-
forme logistique rgionale de manire bnficier de la massification avec des volumes
provenant dautres origines. Il sagit donc dune Distribution de type Via Plate-Forme. On
loppose par nature la Distribution Directe.
Les intrts que cette distribution prsente sont les suivants :
1) Performance en terme conomique lie :
la minimisation du vide sur le camion. Ex : au lieu de navoir quun seul trajet charg
75%, on aura 2 trajets chargs 100% (un trajet de lusine vers la plate-forme rgionale
et un trajet de la plate-forme rgionale vers le concessionnaire)
la minimisation du nombre de kilomtres entre les concessionnaires : on bnficie dans
ce cas des volumes qui proviennent dautres usines et qui peuvent permettre de limiter le
nombre darrts effectuer chez les concessionnaires (voir le dossier sur la dispersion)
2) Qualit de service :
de plus en plus les plates-formes rgionales offrent des prestations valeur ajoutes
avec ce type de plan de transport, la distance du dernier segment (celui dont larrive est
la concession) est plus courte que dans celui dune Distribution Directe, ce qui permet de
limiter les risques que le vhicule arrive sal ou endommag chez le concessionnaire
LASRY Ghita Page 46
enfin les concessionnaires sont gnralement rassurs par le fait dtre livrs depuis une
plate-forme locale.
Toutefois elle a bien videmment des risques et des limites potentiels :
Les risques dune massification des flux sont:
1) Performance conomique :
- en cas de volume suffisant par destination finale, lintrt de la Massification par rapport la
Distribution Directe disparat. On a intrt privilgier cette dernire, puisquelle permettra de
relier 2 points par une ligne droite plutt que de rajouter un site de rupture intermdiaire.
- les manutentions effectues sur les plates-formes ont un cot, dans le calcul de lintrt
conomique de la massification contre la distribution directe, il faut bien sr en tenir compte.
2) Qualit de service : A chaque transit sur une plate-forme logistique sont associs des risques
dendommagement des vhicules lis aux manutentions.
Ses limites potentielles apparaissent dans la ncessit de disposer de plates-formes logistiques
bien situes en fonction dorigine et la destination finale du vhicule, c'est--dire ne ncessitant
pas davoir revenir en arrire.
IV. Conclusion
Aprs une dfinition de la logistique, du concept supply chain, de la logistique de distribution
comme maillon final de la chaine logistique, nous attaquons dans le prochain chapitre loffre
logistique de distribution pour le compte dune industrie de peinture.
Cette activit est une premire exprience pour la SNTL, qui jusque l connu pour le leader du
transport charge complte et affrtement.
Pour raliser cette offre, il a t convenu de faire appel aux services dun partenaire sous le
contrle et la coordination de la SNTL.
Nous verrons dans le chapitre suivant les tapes et droulement de cette offre de llaboration
jusqu sa mise en uvre, en dautres termes nous analyserons la relation avant contrat qui a eu
lieu entre la fois le client et la SNTL puis entre le partenaire et la SNTL.
Celle-ci donnant lieu un contrat le chantier test commence et nous analyserons cette phase
aprs contrat pour tirer en fin de compte des pistes damlioration et des recommandations pour
la gestion du partenaire et du client ainsi que lamlioration du processus de coordination entre
ces deux entreprises.
LASRY Ghita Page 47
Chapitre IV : le lancement de loffre de la logistique de distribution : le cas
dune industrie de peinture
I. Contexte et problmatique de lIndustrie de Peinture :
Cre en 1957, Cette industrie de peinture dnomme IP compte aujourdhui parmi les leaders de
la production de peintures de btiment au Maroc et figure au premier rang des producteurs de
peintures dcoratives.
Le changement de management, la fin de lanne 1989, et ladoption dune stratgie centre sur
les technologies de pointe et la diversification des produits, ont donn une nouvelle impulsion
lentreprise. Ses performances se traduisent par lexplosion de son CA, pass de 18 millions de
dirhams en 1989 314 millions de dirhams en 2005.
Grce ses cinq agences rgionales (Casablanca, Rabat, Fs, Oujda, Marrakech et Agadir) qui
distribuent une large gamme de peinture auprs de quelque 1500 revendeurs, elle couvre
lensemble du territoire du Royaume.
Son schma logistique repose sur un entrept central de 3500 m2 Dar Bouaza et des dpts
rgionaux qui jouent la fois le rle de stockeur et dagences commerciales : (Rabat ;1000m2),
(Marrakech ; 700m2), (Oujda ; 700m2), (Agadir ; 600m2) et (Fs ;700m2).
Afin de garantir une rgularit et un taux de satisfaction client 98%, IP cherche un partenaire
fiable capable de :
mettre disposition un chauffeur et du matriel ddi 100%
respecter les horaires de chargement et de dchargement
assurer lintgrit de la marchandise
LASRY Ghita Page 48
former et monter en comptence les chauffeurs sur les pratiques mtiers et commerciales
(code de la toute, GPS, rglement de conduite, relation commerciale, taux de satisfaction
client, scurit)
assurer les aspects administratifs en matire de contrle et retour BL (quantit, volume,
prix, cachet client)
apporter une garantie assurance marchandise
piloter la performance du rseau de distribution en mettant en place des Business Review
Trimestriel
II. Etapes de lancement de loffre logistique de distribution:
Aprs une bonne comprhension du contexte et de la problmatique du client. Nous avons tabli
les tapes de collaboration concernant ce projet. Ente autre, nous avons fait appel un partenaire
en transport pour nous accompagner et nous aider russir cette nouvelle activit. Ces tapes
sont au nombre de 4 tapes :
- Etape 1 : Elaboration et validation de loffre
Il sagit de :
Comprendre les besoins du client
dtailler loffre cot client, et de prsenter les facteurs cls de succs
dfinir la relation avec le partenaire, partager un rfrentiel de labellisation, schma
de process
A ce stade nous sommes dans une phase de conception de loffre et de sa co-validation avec
le client en limpliquant dans la conception de loffre et le cadrage du besoin
- Etape 2 : Ngociation et contractualisation
La ngociation : Processus par lequel deux ou plusieurs parties interagissent dans le but
datteindre une position acceptable au regard de leur divergence. (Encyclopedia Universalis)
La ngociation peut se comparer une comptition sportive. Dans les deux cas nous devons :
Affronter des concurrents qui, eux aussi veulent gagner le march
Connatre la fois nos points forts et nos points faibles et ceux de nos adversaires
Connatre leur environnement, leurs objectifs, leurs motivations
Elaborer notre stratgie commerciale et de la tester
LASRY Ghita Page 49
Cette phase de prparation est rellement importante puisque c'est la phase d'analyse de la
situation, des enjeux, des objectifs. L'analyse permet d'anticiper les objections, les ractions de
nos clients et donc d'y tre prpar avec des rponses adaptes.
Dans cette tape nous avons :
- ngocier avec le client (plusieurs rounds de ngociation) ce qui donne lieu au contrat
- faire valider le contrat avec le partenaire pour scuriser et fiabiliser les oprations, puis
le faire valider avec le client nouveau
Ce sont donc deux tapes ralises en parallle afin dacclrer le lancement de ce nouveau
projet de la SNTL c'est--dire acclrer le time to market savoir le dlai de mise disposition
du nouveau produit sur le march.
- Etape 3 : Dmarrage du projet distribution et chantier test (3 camions/2 voyages par jour)
Recenser les problmes rencontrs la fois du ct client et du ct prestataire
Evaluation de la capacit du CT coordonner entre les deux entreprises client et partenaire)
- Etape 4 : Monte en charge et ouverture dune nouvelle opportunit
Nous esprons russir ce premier chantier test afin de pouvoir gagner des marchs client
avec un fort potentiel et se positionner sur le march autant que prestataire logistique
intgre ralisant les oprations transport, logistique dentreposage et la logistique de
distribution.
Les deux premires tapes font partie de lanalyse pr-contrat alors que les deux dernires
traitent de lanalyse aprs-contrat.
III. Objectifs et caractristiques de loffre distribution :
1. Les Objectifs de loffre:
Enfin loffre Distribution de Colorado a pour objectifs de :
Proposer une offre intgrant le pilotage de la performance de lactivit et lexcution des
oprations de distribution
Auto-financier le chantier distribution
Obtenir une rfrence et lancer une offre pilote pour construire une organisation plus
agile
Tester la relation avec le partenaire
LASRY Ghita Page 50
2. Les caractristiques de loffre :
Les caractristiques de loffre de base Distrib SNTL se rsument en:
= Une livraison [4H - J+1] vers agences ou clients des agences y compris
chargement et dchargement
= Une gestion du compte par un Key Account Manager et un Operational Key
Account Manager
= Un flash Report hebdomadaire et un tableau de bord mensuel
= Un systme de Track and trace accessible via le web
Pour des services supplmentaires, une nouvelle tarification sera applique
Possibilit de rviser loffre en proposant une optimisation des cots par la mise disposition des
centres de distribution rgionaux et des livraisons combinant charge complte 25 T, 14T, 7T
IV. Analyse de lexistant :
Souhaitant se positionner sur lensemble de la chaine logistique et pour la russite du
dploiement de la stratgie de diversification logistique, la SNTL leader aujourdhui du
transport et affrtement, qui sest lanc dans la logistique dentreposage grce la joint venture
avec Damco, tente un nouveau projet aujourdhui : la logistique de distribution. Son premier
client est une industrie de peinture.
La problmatique que nous allons traiter concerne la ralisation dune nouvelle activit au sein
de la SNTL, nous verrons alors les tapes de son laboration, son dmarrage, et enfin comment
nous pourrions russir un tel projet. Nous commenons donc par une analyse de lexistant o
nous dtaillons les relations avec le client : la socit IP, le partenaire, le transporteur qui
soccupe deffectuer la distribution pour le compte de la SNTL et enfin le coordinateur entre les
deux qui est la SNTL. Et cela avant et aprs la signature du contrat et du dmarrage de lactivit.
1. Analyse Pr- contrat :
1.1 Elaboration, validation de loffre, ngociation et contractualisation:
Nous avons ralis un certain nombre de runions avec le client afin de dterminer ses besoins,
dlaborer et daffiner une offre logistique qui rponde ses attentes. Dans le cadre de la
ngociation de loffre avec la socit IP, notre premire rencontre chez le client nous a permis de
rcuprer des donnes sur le march de la peinture, de connaitre leur environnement de travail, et
LASRY Ghita Page 51
de dfinir leur haute et basse saison. Nous avons dfini et discut le prix de vente de la prestation
logistique de distribution, mais il na pas t approuv du premier coup de la part du client ce qui
a ncessit une deuxime runion sur la base de quoi un contrat a t labor.
1.1.1 Attentes clients :
Nous avons fait une brve description du matriel et moyens mettre en place afin de rpondre
avec beaucoup de ractivit comme le ncessite la distribution.
Nous avons rcupr les donnes sur les villes desservir avec le dlai de livraison pour chacune
dentre elles et une ide sur les tarifs appliqus afin que nous puissions labors une offre
comptitive.
Il est indispensable alors de prparer pralablement un parc propre donc de rechercher un
partenaire fiable qui nous allons exposer les attentes de notre client et qui y rponde
favorablement en respectant les conditions du partenariat :
Types de camions demands: des camions 7T et 14T
Nombre de camions :
Nous avons fait un dimensionnement du nombre de camions affecter selon que lon travaille en
basse saison, en haute saison, laide de camion 7T ou 14T.
La formule qui a t utilise est la suivante :
Le tableau ci-dessous reprsente le calcul qui a t effectu pour le cas de la basse saison
camion 14T.
Nous avons les donnes sur les villes livrer qui sont au nombre de 35 avec le dlai de livraison
pour chacune ainsi que le nombre moyen de livraison par mois vers chacune de ces destinations.
Daprs la formule de calcul nous retrouvons dans le cas de la basse saison et pour le cas du
camion 7T nous devons mettre disposition 4 camions.
LASRY Ghita Page 52
Equipements de manutentions, savoir les transpalettes, les chariots lvateurs
Systme dinformation adapte cette activit (traabilit, enregistrement des rfrences
de marchandises )
Le schma ci-dessous synthtise notre comprhension des besoins de notre client :
AGADIR 12 48 1
48
ASSILAH 6 24 4
96
BNI MELLAL 6 24 4
96
BERKANE 12 48 0
0
BERRECHID 4 24 2
48
CASABLANCA 4 12 12
144
DAKHLA 24 120 0
0
EL HOUCEIMA 12 48 0
0
EL JADIDA 4 16 3
48
ERRACHIDIA 4 48 0
0
ESSAOUIRA 6 48 0
0
F.B. SALEH 6 24 4
96
: : : : :
: : : : :
: : : : :
TANGER 8 48 8
384
TANTAN 24 72 0
0
TAZA 16 48 1
48
TTOUAN 12 48 8
384
TIZNIT 12 48 0
0
Total Dlais TOTAL 2040
Nombre d'heure par mois 576
Nombre de camions 4
Lieu de livraison Dlais de livraison
Nombre d'heure de ralisation voyage
Aller / Retour
Nombre moyen de
livraison / mois
Nombre d'heure
mensuel de
voyage
Notre
comprhension des
besoins du client
1
2
3
4
5
6
Un parc de
transport dedie.
Excellence
oprationnelle
Une quipe
Administrative
ddie
Outils IT (Track
& Trace,
WMS.)
Un partenaire avec
un rseau solide
capable
daccompagner IP
dans sa croissance
Reporting
et analyse de la
performance
LASRY Ghita Page 53
1. Un partenaire avec un rseau solide capable daccompagner IP dans sa croissance
2. Un parc de camion ddie IP qui rpond aux exigences du transport de se produits.
3. Process & mthodologie prouve pour le dmarrage de la prestation logistique.
4. Gestion du compte IP par un KAM et un O KAM dont le rle est de proposer des
amliorations continues du process de la prestation logistique
5. Flash Report hebdomadaire et Tableau de bord mensuel de suivi de la performance
6. Une architecture SI performante
1.1.2 Les dtails de loffre ct client :
a. Le contrat client
Loffre distribution stipule les lments suivants :
Un engagement de la part de la SNTL dans la mise en place et la disponibilit dun parc
d vhicule 7T et 14T, de bonne qualit et suivants les normes, des chauffeurs forms et
comptents respectant le nouveau code de la route. Ainsi quun Engagement effectuer
le transport de la marchandise de la socit IP sur lensemble du territoire marocain
Les ordres de transport et le lieu de livraison nous sont adresss par fax ou appels
tlphoniques comme suit :
o Vers les agences de la SOCIETE IP Rabat, Fs et Marrakech ou vers les clients
des agences susdites : Avant 17h00 laprs midi pour les chargements effectuer
le lendemain matin avant 12H00.
o Vers les agences de la SOCIETE IP Agadir et Oujda ou vers les clients des
agences susdites : Avant 10h00 du matin pour les chargements effectuer avant
15H00 laprs-midi du mme jour.
Concernant lenlvement de la marchandise il a t convenu que:
Le chauffeur doit tre accompagn dun aide chauffeur au moment de lenlvement pour les
chargements en palettes et dun nombre suffisant de manutentionnaires pour les chargements en
vrac, et quil faut procder lenlvement de la marchandise au sige de la socit ou en tout
autre endroit que celle-ci nous indiquera.
La SOCIETE remettra au chauffeur au moment de lenlvement un bon de livraison dat et
sign contre une demande de transport qui devra tre dment remplie. Cette dclaration ayant
pour but de rgir les conditions du transport, et sert de preuve denlvement (cachet de notre
agent doit obligatoirement figurer sur ce document et sur le bon de livraison).
LASRY Ghita Page 54
La figure ci-dessous synthtise pour chaque rayon les horaires respecter lors de lenlvement et
de la livraison de la marchandise.
Figure 21 : Horaires enlvement et livraison marchandises
Le cas de la livraison est similaire celui de lenlvement en ce qui est de la prsence
dun aide chauffeur lors du dchargement, en plus du dlai respecter. Il a t ngoci
avec le client quil faut:
o 4 Heures pour lagence ou les clients de lagence de la SOCIETE RABAT
o 8 Heures pour les agences ou les clients des agences SOCIETE FES et
MARRAKECH.
o 16 Heures pour les agences ou les clients des agences de la SOCIETE AGADIR
et OUJDA.
Et ceci quel que soit le lieu denlvement de la marchandise et le lieu dexpdition. Voir
image ci-dessus.
Le contrat stipule que la marchandise va tre livre contre accus de rception par cachet et
signature du destinataire, attestant lintgrit et la quantit des produits livrs. Cet accus de
rception est remettre la SOCIETE dans un dlai de 7 jours au maximum compter de la
date de lenlvement.
Tanger
El Jadida
Rabat
Casablanca
Agadir
Sidi Ifni
Tan Tan
Dakhla
Safi
Mekns
Beni Mellal
Al Hoceima
Nador
Kenitra
4
Essaouira
Settat
Fs
Layoune
Rayon < 100 Km
Rayon de chalandise
Horaires
Villes
Casa, Nouacer, Benslimane,
Rabat, Sale, El Jadidia,,
Tanger, Ttouan, Agadir,
Oujda, Nador
Enlvement Livraison
4H
16H
Rayon > 300 KM
100 KM < Rayon < 300 KM
Knitra, Beni Mellal, Mekns,
Marrakech, Safi, Fs
8H
Avant 17h
pm pour le
chargement
lendemain
avant 12h
Avant 10h
ampour le
chargement
avant 15h
du mme
jour
LASRY Ghita Page 55
Un pilotage de la performance grce des indicateurs de suivi, une revue hebdomadaire,
mensuelle et trimestrielle
Une performance logistique en ce qui concerne les prix, la qualit de service, la
disponibilit, la ractivit et les techniques de chargement.
b. Conclusion :
Le tableau ci-dessous explicite et rsume cette tape ou il a t question danalyser les attentes
du client, loffre propose par la SNTL afin de rpondre ses besoins et enfin les facteurs cls de
succs de cette tape qui sont au nombre de quatre :
- Un rseau large de 30 agences commerciales implantes travers le territoire national et
7 directions rgionales qui les coiffent et une flotte propre ddie
- La maitrise des oprations : depuis la rception de la commande client vers le la livraison
destination finale en passant par le CT qui se charge de laffectation du partenaire idal
accompagn de la gestion des flux administratifs : comme le retour des bons de livraison.
- Un systme dinformation adquat et adapte cette activit qui permet de faire la
traabilit, lenregistrement des rfrences de marchandises
- Un suivi du progrs continu sur la base des indicateurs de performance afin de prparer la
monte en charge concernant ce nouveau projet
Figure 20 : Exigences clients et caractristiques de loffre
1.1.3 Les dtails de loffre ct partenaire :
En effet, le fait davoir un partenaire fiable est un facteur cl de russite du dmarrage de
lopration, nous avons mis en place un processus de labellisation afin de choisir le meilleur
prestataire qui puisse assurer cette opration distribution et nous aider la dmarrer.
LASRY Ghita Page 56
Le processus de labellisation est un processus qui dure six mois (voir figure en-dessous) avec 2
dfis majeurs pour les partenaires. Le premier consiste au choix du partenaire, il se fait selon la
qualit de base dtaille dans le chapitre suivant ; le deuxime dfi prvoit lvaluation du
partenaire retenu, elle se fait durant le chantier test o le partenaire doit maintenir un niveau de
performance continu pour arriver au rsultat final : la labellisation.
Figure : Processus de labellisation
a. Slection du partenaire :
La slection des partenaires est un processus sr qui repose sur une logique de maturit : il faut
disposer tout dabord essentiellement de la qualit de base c'est--dire sassurer de la bonne
qualit du parc roulant, des chauffeurs et du respect des formalits et procdures du partenariat.
Il dure un mois, et voici le dtail des lments qui doivent tre tests pour approuver la selection
ou pas de notre partenaire :
Qualit du parc roulant :
Lge du parc requis doit tre infrieur 5 ans,
Le partenaire doit, par ailleurs, maintenir continuellement les camions servant au transport
dans un bon tat mcanique et dans un tat de propret acceptable.
Comptences des chauffeurs :
LASRY Ghita Page 57
Le partenaire doit garantir que ses chauffeurs dtiennent un permis de conduire, quils ont
bnfici dune formation de base sur le nouveau code de la route et sur le transport des
matires dangereuses, ainsi quune exprience sur la route avec de bon antcdents de
conduite.
Procdures et formalits :
Le partenaire doit remettre au client le manifeste de fret dument rempli. Cette dclaration a
pour but de rgir les conditions du transport, et sert de preuve denlvement.
Le cachet de notre agent doit figurer sur cette dclaration ainsi que sur le bon de livraison.
En plus de ces trois lments prouvant la qualit de base du partenaire il ne faut pas oublier sa
capacit suivre la SNTL dans son dveloppement et notamment sa situation financire.
Dautres critres de slection des partenaires sous-traitants transport :
C Le prestataire ne doit pas exercer comme mtier principal la charge complte et
lentreposage
C Le prestataire doit disposer des rfrences multiples (secteurs dactivits)
C Le prestataire doit disposer dune taille critique (4MDH)
C Le prestataire doit disposer dune capacit financire suffisante pour accompagner la
SNTL dans sa stratgie de dveloppement dans la logistique de distribution
C Le prestataire doit disposer dune expertise minimum de 3 ans
C Le prestataire doit quiper sa flotte en GPS
b. Evaluation du partenaire
En ce qui concerne lvaluation du partenaire retenu ou slectionn, le partenaire doit russir un
chantier test par sa fiabilit et sa ponctualit, il doit assurer un service de qualit en ce qui
concerne la scurit, la prsentation et la serviabilit et enfin il faut quil maintienne un niveau
de performance la hausse pour avoir le label SNTL.
Nous dtaillons les trois tapes figurant sur le schma ci-dessus.
Russite du chantier test, pour cela le partenaire doit garantir un taux de disponibilit des
camions au quotidien, de faon ponctuelle en respectant les dlais et horaires de
chargement/dchargement et en mettant disposition des chauffeurs, aides chauffeurs et
manutentionnaires forms aux codes de la route et au transport de matires dangereuses
avec une exprience en minimum de 3ans.
LASRY Ghita Page 58
Une fois ce chantier test fini aprs une dure de 3 mois, le partenaire se doit de maintenir
son niveau de performance.
Maintien du niveau de performance : En capitalisant sur les indicateurs cits plus haut,
nous rajoutons dautres indicateurs comme la scurit quant lintgrit de la marchandise,
la rduction des nombres des accidents. Noublions pas la prsentation, tenue propre des
chauffeurs et leur serviabilit, discipline ainsi que respect du client. Ces indicateurs sont
des critres de labellisation que le partenaire doit entretenir pour tre la hauteur et arriver
au stade dtre labellis SNTL.
Labellisation, la dernire tape du processus o le prestataire est retenu autant que
partenaire SNTL qui roule pour la SNTL il est labellis partir du moment o le niveau de
son engagement est lev, il sera enclin raliser des efforts supplmentaires afin de
maintenir les objectifs long terme et malgr la pression ventuelle lie aux problmes
court terme. Cest pourquoi des niveaux levs dengagement sont susceptibles de conduire
au succs du partenariat.
Durant ces tapes, le partenaire est valu selon six indicateurs de performance :
La fiabilit c'est--dire lorsque la probabilit de remplir sa mission sur une dure donne
correspond celle spcifie dans le cahier des charges :
- Taux de disponibilit = nombre de vhicules disponibles / nombre de vhicules
demands
- Satisfaction de la demande : Nombre de commandes compltes Vs nombre de
commandes expdies;
- Exactitude des commandes: Nombre total de commandes expdies sans erreurs
Vs nombre total de commandes expdies
La ponctualit cest lexactitude faire certaines choses dans un temps donn, comme on
se lest propos, ou comme on la promis :
- Livraison temps : Nombre total de commandes expdies temps Vs nombre
total de commandes expdies;
- Cycle de temps des commandes: Date relle d'expdition Vs date d'expdition du
client
Technique de chargement : Le partenaire doit garantir ses chauffeurs, ses aides
chauffeurs et ses manutentionnaires :
- Cargaison endommage: Nombre de cargaisons endommages Vs nombre total de
cargaisons
LASRY Ghita Page 59
Scurit, le chauffeur et aide chauffeur doivent respecter toutes les consignes dfinies par
le client :
- Garder le badge remis la rception bien visible
- Ne pas circuler en dehors de la zone dintervention
- Respecter les consignes affiches dans cette zone
Prsentation, il faut quils soient bien rass, avec des tenues propres et respectueuses
Serviabilit, il ne faut pas quils rentrent en conflit avec le client mme sil a tort :
- En cas de dsaccord avec le client ou des difficults de trouver un arrangement
aimable ne jamais tenir de propos dplacs
- Et contacter immdiatement linterlocuteur de la SNTL pour rsoudre le problme.
Sans oublier quelques indicateurs concernant les procdures et formalits administratives
comme :
- Erreur de documents: Nombre de commandes de prlvement imprimes inexactes
Vs nombre total de commandes;
- Erreurs de facturation: Nombre de factures errones Vs nombre total de factures.
Ci-dessous un rcapitulatif des tapes de : slection et valuation du partenaire ainsi que les
principaux indicateurs de performance durant ces tapes :
LASRY Ghita Page 60
c. Conclusion :
Un prestataire a t approch dans ce sens, nous avons discut avec lui la possibilit de travailler
ensemble en plus du partenariat SNTL par lequel il doit passer pour pouvoir tre labellis, cest
une relation troite avec les transporteurs qui ont accept de mettre en commun leurs efforts en
vue de fournir une proposition de valeur, fonde sur un intrt conomique, une motivation des
obligations rciproques.
Intrt conomique :
Le partenaire pourra grce la SNTL se concentrer sur son activit principale et par consquent
produire plus et gagner plus, car en leur assurant un fret rgulier, la SNTL gnre des recettes
porteuses pour les transporteurs, elle optimise leurs cots de transport ce qui leur dgagera des
bnfices et facilitera leur monte en charge et en comptence et par consquent induira une
augmentation de leur CA. Nous savons que chaque camion possde des cots intrinsque par
jour qui sappelle des cots dimmobilisation indpendamment de son utilisation, la SNTL va en
plus standardiser les conduites des camions afin de minimiser les dpenses en termes de
carburant, entretien et maintenance selon un rfrentiel de prix partag.
Niveau de
maturit
Critres de labellisation Indicateur Commentaires
QUALITEDE
BASE
Qualit du parc roulant Age < 5 ans
Un dossier transporteur sera constitu (les photos du
camion, visite technique, type de vhicules).
Collecter le max. dinformations afin de faciliter par la
suite le projet du Fleet Management
Qualification du chauffeur
Permis de conduire
Formation de base + Exprience
Interviewer les chauffeurs par la DMT et SGTCR
Procdures et formalits Formation + Test
Avant le lancement du chantier test, des formations seront
dispenss pour lensemble des chauffeurs sur les
procdures et formalits SNTL et client
Un test sera fait par la SGTCR pour valider les qualit de
base
CHANTIER
TEST
Fiabilit
Taux de disponibilit = nbr de vhicules
disponibles/nbr de vhicules demands
Indicateur suivre par le CT quotidiennement
Ponctualit
Respect de dlais :
- Chargement
- Livraison
Indicateur suivre par la cellule suivi du progrs
Technique de chargement
Scurit
Intgrit de marchandises
Nbr des accidents
Indicateur suivre par la cellule suivi du progrs
Prsentation des
chauffeurs
Tenue propre
Indicateur suivre par la cellule suivi du progrs
Serviabilit Discipline et respect du client
Indicateur suivre par la cellule suivi du progrs
LASRY Ghita Page 61
Motivation :
La SNTL motive son partenaire en le soutenant toute preuve, en lpaulant et en le prenant en
charge. Il bnficie par consquent de et grce lexprience de la SNTL de la possibilit de
mettre niveau ses comptences vu quil devient partenaire dun leader du domaine de transport
et affrtement, une structure fiable qui inspire confiance et en reoit autant de la part des autres
entreprises.
Obligations rciproques :
La SNTL est connue autant que structure qui tient ses obligations financires cot transport. Il
n ya pas lieu sinquiter quant au rglement puisque le respect des clauses du contrat est
certain une fois la labellisation russie. Il est par ailleurs important pour le partenaire de pouvoir
sadapter aux changements et de maintenir leur niveau de performance conforme aux exigences
requises par la SNTL.
Le schma ci-dessous est un rsum des trois facteurs cls permettant de fournir aux clients une
proposition de valeur.
1.1.4 La procdure de Coordination entre les deux entreprises :
Afin de coordonner entre les deux entreprises, un processus de distribution a t mis en place, il
est supervis par le CT, ci-dessous nous prsentons les diffrents documents associs au
processus :
OBLIGATION
PROPOSITION
DE VALEUR
3
INTERET
ECONOMIQUE
1
MOTIVATION
2
FRET REGULIER : assurer des recettes
porteuses pour les transporteurs
PARTAGE DE VALEUR : un rfrentiel
de prix partag
FLEET MANAGEMENT : mesure
daccompagnement attractive pour les transporteurs
INTERET ECONOMIQUE
MISE ANIVEAU ET MONTEE EN COMPETENCES
1
MOTIVATION 2
OBLIGATIONS RECIPROQUES 3
REGLEMENT : SNTL qui tient ses obligations
financires envers le transport
LABELLISATION : slection et segmentation des
transporteurs, gestion de leur performance
LASRY Ghita Page 62
Documents internes Documents externes Enregistrement
Bon de chargement
Demande de transport
Feuille de route
Factures
Procdures
Contrat client
Bon de commande
Conventions
Bons de transport
Rglementation
FOR 007 : Demande de transport
FOR 011 : Bon de chargement
FOR 012 : Dclaration
dassurance spciale
FOR 013 : Etat de rpartition
FOR 014 : Feuille de route
FOR 015 : Bon de livraison
FOR 016 : Relev dexpdition
FOR 027 : PV de constat et
denqute
FOR 201 : Etat factures remises
FOR 202 : Etat factures encaisses
FOR 203 : Relance client
FOR 802 : Etat factures dposes
FOR 804 : Etat factures prise en
charge
FOR 805 : Etat factures en
instance de paiement
FOR 806: Situation de rglement
FOR 909 : Bon de paiement
Voici la procdure suivre pour une offre distribution :
LASRY Ghita Page 63
LASRY Ghita Page 64
1.1. 4 Verrouillage et rsum :
Enfin concernant cette analyse pr-contrat, nous avons vu llaboration de loffre avec notre
client IP et sa validation dou les ngociations et enfin la concrtisation via deux contrats tablis,
le premier concerne le client pour lequel nous effectuons cette offre distribution cest lindustrie
de peinture et le deuxime cest celui qui lie la SNTL et le partenaire. Il a t rdig suite la
lecture du premier en prsence du partenaire afin de fidliser cette nouvelle relation et
limpliquer dans la rdaction de son contrat suivant les exigences du client.
Dans ce contrat le partenaire sengage respecter les exigences de la SNTL concernant:
- La disponibilit des camions
- La qualit des camions en terme de propret, habillage, quipements (haillon lvateurs,
transpalette et en cas de besoin les manutentionnaires)
- Le respect de la date et lheure de mise disposition des camions,
- et les procdures et rgles interne de la SNTL.
Et reprend les articles concernant lenlvement et la livraison des marchandises cits dans le
contrat client. Sans oublier les clauses effet juridique.
Le schma ci-dessous rsume le lien entre la SNTL, son client et son partenaire. Nous pouvons
remarquer les flux figurant dessus qui sont au nombre de trois et que le coordinateur logistique
au niveau du CT doit contrler afin de mener bien cette opration.
II. Analyse Aprs contrat :
1. Analyse des anomalies ct client :
Parmi les dfaillances dtectes du cot des oprations avec le client nous citons :
Le client sest engag livrer un planning dordres denlvements qui comporte les destinations.
Ce planning est sens tre livr [J-1]. Alors que la SNTL na jamais reue de plannings cet
LASRY Ghita Page 65
effet. Cela se traduit par un manque d e visibilit et handicape le bon droulement des
prestations.
Il est arriv que le partenaire procde au chargement dchargement 2 fois suite une erreur de
communication de la bonne destination de la part du client.
Le client ne charge plus et donc na plus besoin de la prestation SNTL, suite une baisse de
cadence mais il ne dsiste pas. La SNTL met donc disposition du client comme tous les jours
son camion, qui reste immobilis et donc gnre des frais. Il est souhaitable dans ce cas davoir
plus de visibilit quant aux prvisions afin de rduire des cots dimmobilisation.
Le client dtient une flotte propre donc il nest pas dans une vision dexternalisation.
Figure X : synthse des problmatiques de la relation client
2. Analyse des anomalies ct partenaire :
Suite une visite chez le client pour assister au chargement, de nombreuses rclamations ont t
communiqus savoir :
Problmatiques
rencontres client
1
Partage des prvisions entre IP et SNTL
2
Fiabilit des informations
3
Dimensionnement du besoin
4
Partage des
responsabilits
Inf ormations non f iables sur
Le lieu de dchargement
Les horaires de chargement et de
dchargement
Dif f icult de raliser la planif ication des oprations de transport
Problmatique de ractivit et de disponibilit
Augmentation des urgences
Immobilisation des vhicules de f aon rcurrente
Manque de visibilit
Incidence sur les engagements de Fret avec le partenaire
Contrle de lintgrit de la marchandise
au chargement
Contrle de lintgrit de la marchandise
au dchargement
Cabossage et retour des palettes
LASRY Ghita Page 66
Le chauffeur ne vrifie pas la marchandise en cours dembarquement exactitude
marchandise
Le chauffeur ne rclame jamais le chargement de la marchandise dfaillante intgrit
marchandise
Le chauffeur ne rclame pas le bon de retour en cas de retour de marchandises par le client
formalits administratives
Le chauffeur ne vrifie pas le cachet sur le BL ce qui conduit des retours des BL
Mauvaise gestion documentaire
Le timing de mise quai et de chargement est trs lev (moyenne de 8 heures chez le client)
ce qui induit des frais dimmobilisations horaires chargement
Les rgles de transfert de proprit sont dfinir : le comptage ne doit en aucun cas
seffectuer lintrieur du dpt.
Le partenaire est cens livrer une seule ville par voyage et non pas 3 et au maximum 2 clients
par ville et non pas 4. respect clauses contrat
Cas de retour de palettes : il doit justifier ce retour par un bon de retour sign par le client
final. Cest une procdure interne cette IP qui na pas t respect.
Intgrit de la
marchandise
Bon de retour
Bon livraison
Retour des palettes
Exactitude de la
marchandise
Problmatiques
partenaires
1
2
3
4
5 Respect de temps
de chargement
6
LASRY Ghita Page 67
3. Analyse des anomalies dans la procdure de coordination
Durant la ralisation de oprations au niveau de la cellule coordination entre les deux entreprises,
des problmatiques ont t recenss, nous allons les prsenter dans le tableau ci-dessous en
dtaillant limpact quils ont sur la performance ainsi que les actions entreprendre afin de les
minimiser et de les rsoudre dans les plus brefs dlais.
Oprations
Problmatiques
Impact sur la
performance
Actions
entreprendre
Rception et traitement
commande
Problme durgence et
de planification
Mauvais traitement de
la commande
Verrouiller le timing
commande avec le
client dans le contrat
(timing min 24h)
Consultation de la liste
et vrification du parc
disponible
Indisponibilit
Inadquation du
parc avec le besoin
client
Retard sur la
commande
Problme de
satisfaction client
Retard impact sur
dautres commandes
Verrouiller la
commande du client
ds le dpart
Revoir contrat
partenaire
Aviser le commercial Ractivit
Concertation avec
back office et en
amont oprationnel
Problme de
satisfaction et de
confiance
Une planification et
communication en
interne pour cerner les
besoins du client
Edition et remise des
FR et bons de
chargement au
transporteur
Problme administratif Retard et non
ralisation
Non paiement
Gestion des alas et
les anticiper
Autonomie par
rapport au sige a
Rabat
Edition et remise des
FR et bons de
chargement au
transporteur
+
Valorisation des FR
+
Constitution du lot des
FR pour rglement des
transporteurs
Attente accumulation et
constitution des
documents
Retard de paiement
Confiance
partenaire
Ractivit
Rorganisation
Facturation Problme administratif Dmotivation des
acteurs
Retard de suivi et de
paiement
Rorganisation
Communication
LASRY Ghita Page 68
4. suivi de performance :
Les indicateurs de performance suivis lors du chantier test sont les suivants :
Pour le cas de la relation entre la SNTL et lindustrie de peinture le tableau ci-dessous, sur une
priode dobservation de deux semaines rsume le rsultat du suivi des 4 indicateurs savoir :
- La ralisation de la planification
- Le respect du temps de chargement
- Le type de chargement qui conditionne les risques de cabossage
- La fiabilit des informations
Concernant la relation entre la SNTL et son partenaire, nous parlons des indicateurs suivants (cf.
tableau ci-dessous) :
- Taux de ractivit
- Ponctualit
- Scurit
- Taux de disponibilit
- Prsentation des chauffeurs
- Serviabilit
Plannification Respect temps Chargement Type de Chargement Fiabilit des Informations
NON 1H30 / Moy VRAC
NON 1H00 / Moy VRAC
NON 2 H 00 / + Moy VRAC
NON 2H30 / ++ Moy VRAC
NON 2 H 00 + Moy VRAC
NON 1H30 / Moy VRAC
NON 1H30 / Moy VRAC
NON 1H30 / Moy VRAC
NON 1H / Moy VRAC
NON 1H30 / Moy VRAC
NON 1H30 / Moy VRAC
NON 2 H 00 / + Moy VRAC
NON 2 H 00 /+ Moy VRAC
Suivi Client / IP
La commande se fait par tlphone le
jour mme de la livraison et sans
mentionner les destinations.
LASRY Ghita Page 69
En ce qui est de la ponctualit : nous remarquons que pendant cette priode test le partenaire a
respect les dlais pour toutes les oprations effectues part pour deux de ces oprations o il a
connu un petit retard.
Concernant la scurit et plus prcisment lintgrit de la marchandise, nous trouvons que le
partenaire respecte les exigences clients quant au chargement/dchargement.
Ponctualit Scurit Taux Disponibilit Prsentation Chaufeurs Serviabilit
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 80% 50% 80%
90% 90% 100% 100% 90%
80% 100% 80% 50% 70%
100% 90% 90% 50% 90%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
90% 100% 80% 50% 80%
100% 100% 80% 100% 100%
100% 100% 80% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 80% 100% 80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Suivi Partenaire / Partenaire
Taux de Ractivit
100%
100%
0%
50%
100%
150%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213
Ponctualit
Ponctualit
85%
90%
95%
100%
105%
1 3 5 7 9 11 13
Scurit
Scurit
LASRY Ghita Page 70
Par rapport au taux de disponibilit le partenaire a tenu sa parole et donc a mis disposition le
nombre de camions convenu, du coup en ce qui concerne la disponibilit il est entre 80 et 100%,
le schma ci-dessous reflte la ralit des oprations effectues :
Par contre pour la serviabilit, le partenaire est entre 70 et 100% :
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213
Taux Disponibilit
Taux
Disponibilit
0%
50%
100%
150%
1 3 5 7 9 11 13
Serviabilit
Serviabilit
LASRY Ghita Page 71
5. Pistes damlioration :
Les pistes de recommandations sont au nombre de Huit et peuvent tre regroupes en trois macro
processus :
- Gestion de la relation avec le partenaire
- Coordination logistique
- Gestion de la relation avec le client
5.1. : Pilotage de la relation partenaire
Nous allons dtailler chaque macro processus :
Concernant la gestion du partenaire, ce processus se compose en trois pistes damlioration
savoir :
Gestion des commandes
En ce qui concerne la gestion des commandes, il est souhaitable de mettre en place un planning
des commandes, ds la rception de la commande de la part du client, de la remettre au Centre de
trafic qui soccupe de la traiter dans les plus brefs dlais, il avise le partenaire qui doit mettre
disposition la flotte en lespace de 2h.
Gestion de la
commande
Suivi du progrs
Contractualisation
Gestion du partenaire
Planification
Arbitrage
charges/capacit
Partages des
Prvision
Fiabilit des
informations
Dimensionnement
des besoins
Partage des
responsabilits
Gestion de la relation
client
Gestion documentaire
Coordination logistique
LASRY Ghita Page 72
Enfin, arrive chez le client, il commence le chargement et ne doit pas dpasser 3h en sassurant
de lintgrit de la marchandise et minimisant le taux de casse et de cabossage des seaux.
Le chargement termin, le chauffeur prend la route vers la destination mentionne sur la feuille
de route. Il est tenu par le respect des horaires et dlais de livraison selon la destination.
Le processus prend fin une fois lensemble de la marchandise est arrive au client final.
Suivi du progrs
Le schma ci-dessous explique le processus de suivi et contrle est un processus continu servant
mesurer et valuer la performance du partenaire qui met en place deux autres processus, le
premier est prventif et le second correctif.
Quand il sagit dun cart mineur ou lajout damlioration continue suite aux initiatives que ce
soit de la part du partenaire ou de la part de la SNTL lie des volutions technologiques
sectorielles nous parlons dun processus prventif.
Lorsque le performance est mdiocre ou ne rpond pas aux exigences du cahier de charge, il
sagit du processus correctif qui se traduira par une volution graduelle du niveau de pression sur
le client ou le partenaire (3 niveaux de mise sous contrle) :
Niveau 1 : Au moins un des indicateurs est en orange
Lettre au partenaire prcisant la mise sous surveillance avec un dlai de 2 mois pour ragir.
Envoi dun mail ou dun fax systmatiquement lors de tout incident pendant la priode
probatoire.
LASRY Ghita Page 73
mission de pnalits par les achats la demande du CT. Aprs une priode probatoire
ventuellement renouvele soit le fournisseur revient en mode de pilotage nominal, soit il passe
en niveau 2.
Niveau 2 : Priode probatoire chue
Convocation du partenaire
Plan daction court terme partenaire tabli pour rsoudre des problmes de service rcurrents ou
critiques.
Suivi des plans daction.
Niveau 3 : Plan dactions non respect
Ralisation dun audit logistique partenaire ou client.
Dclassement du partenaire ou client dans le panel.
Par ailleurs, tout retard par rapport la date de livraison contractuelle recevra un courrier du CT
lui spcifiant quil est susceptible de recevoir des pnalits qui lui seront notifies par la
Direction rgionale.
Suivi continu de
la qualit de
service
Pilotage des plans
de progrs
Revue gnrale de la
qualit de service
Synthses quantitative
et qualitative cales sur
les rounds de
ngociation
Communication aux
partenaires de leur
objectif de service
Adaptation
des conditions et
suivi de progrs
Ngociation et
contractualisation
Niveau 1
Alerte et mise sous
surveillance du
partenaire pendant
une priode test,
pnalits
Niveau 2
Convocation,
pnalits et
demande de
corrections
Niveau 3
intervention sur la
relation partenaire
par la Direction
rgionale, pnalits
Cas critique
CT
Direction
Rgionale
Processus
correctifs
Processus
prventifs
Processus de suivi et
contrle
LASRY Ghita Page 74
Dans le cadre de sa mission, la direction rgionale doit piloter la qualit de service
oprationnelle des partenaires.
Lobjectif consiste permettre lengagement des partenaires sur une qualit de service
avec une logique damlioration progressive de celle-ci sur la base de plans de progrs
tablir avec ceux-ci.
Le suivi de la qualit de service est fond sur un partage dindicateurs (engagement sur
les dlais et la quantit dans un premier temps).
Le passage dun des indicateurs de qualit de service du partenaire sous un seuil,
dclenchera sa mise sous surveillance.
Mensuellement, la cellule suivi du progrs analysera la qualit de service des principaux
partenaires et des partenaires critiques (ceux dj placs sous surveillance).
Trimestriellement, en collaboration avec la cellule suivi du progrs, le CT ralisera un
bilan de la qualit de service de tous ses partenaires.
Ralisation des bilans sur la qualit de service
LASRY Ghita Page 75
Contractualisation :
Partage des responsabilits au niveau de cabossage, intgrit et exactitude de marchandises.
Engagement sur le volume, savoir le Fret = le nombre de camion
Dtail du mode opratoire : procdure de gestion et de pilotage de la performance
Il est souhaitable de rajouter au contrat :
Une annexe des quipements et tonnages des camions mettre disposition.
Une autre annexe pour les tarifs pratiquer.
-Mettre disposition des camions adapts (tonnage) : achat, location, sous-traitance
-Elaborer de nouveaux contrats : nombre-quipement et tonnage des camions ncessaires, rgles
de transfert de proprits, nombre de villes et de clients livrer, tarifs, heures de livraison
-Envoyer le planning des commandes comme prvu J-1
-Optimiser les ressources humaines et amliorer leur efficience: rduction temps de mise quai
et de chargement, respect des horaires,
-viter la perte de seaux (superviser, valuer et rcompenser les ressources humaines)
Coordination logistique
Nous avons bien vu la gestion de la relation partenaire et nous avons compris que cest au niveau
de la maitrise du planning des commandes et du maintien du progrs durant tout le chantier test
que le partenaire aboutit la contractualisation qui ce niveau dtaille le mode opratoire
garder tout au long de la priode partenariat, ainsi que le partage de responsabilits,
lengagement sur le volume, la disponibilit, la ponctualit y est dfini Alors que pour la
coordination logistique qui est ralise au niveau du CT, nous voquons trois pistes
damlioration :
Planification
LASRY Ghita Page 76
La premire concerne la planification, nous nous intressons dabord la communication entre
le CT et le partenaire ou le client, au degr de fiabilit des informations et la capacit du CT
grer les alas, faire le suivi des oprations, ce qui rfre la gestion physique. Ensuite la
deuxime piste est la phase arbitrage entre charges et capacit, il doit par ailleurs dans cette tape
tre en mesure de raliser un bon suivi du cot du client ainsi que du cot du partenaire afin
dtre sr du bon droulement des oprations et par consquent de la russite de loffre logistique
de distribution.
Gestion documentaire
Enfin une gestion physique saccompagne dune gestion documentaire, sassurer que les bons de
livraisons, les bons de retours sont bien signs, cachets par les intresss et remis aux clients
Je vous communique ci-joint la mise jour au 16/06/2011 de l'tat des accuss de rception des factures
en votre possession.
Pour cela, je vous demande de nous les remettre au cours de cette semaine;
Il vous reste 10 BL accuss nous remettre d'un montant global de 127656,08
DH.
RAPPEL : Suite nos procdures internes de gestion des accuss de rception et fin de faciliter la
gestion de ces derniers, je vous rappelle que le dlai pour nous remettre les accuss de rception ne
devra plus dpasser une semaine de la date du chargement de la commande.
Pour cela, je vous invite de dposer les accuss de rception en votre possession et de s'organiser ainsi
fin de respecter dornavant le dlai convenu, car dans le cas contraire, a risque le blocage de vos
payements.
Arbitrage charges capacits
Afin danticiper la monte en charge de cette opration, savoir le passage de la mise
disposition dun seul camion journalier 5 camions dune part et dautres part la gnralisation
de loffre logistique de distribution dautres clients, la cellule coordination logistique doit
mettre en place des outils de modlisation qui permettent de raliser des arbitrage charges
capacits. Car pour faire face la fois la monte en charge et de nouvelles demandes, la SNTL
doit mobiliser un ensemble de partenaires. Ce pose une problmatique de choix de rgles
daffectation qui ne peuvent tre fait qu condition davoir un dimensionnement et une logique
darbitrage charges capacits correcte.
LASRY Ghita Page 77
Pilotage de la relation avec le client
Dimensionnement des besoins
Problme de conjoncture limination dun seul camion
Partage des prvisions
Matrice de Communication instaurer
Fiabilit des informations
Vrification de linformation
Partage des responsabilits
Rvision du cahier des charges
LASRY Ghita Page 78
http://www.iut-sn.univ-nantes.fr/SI00158/0/fiche___formation/
http://commerceinternational.centerblog.net/6555736-La-distribution
http://www.aquadesign.be/actu/article-5242.php
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ecoru_0013-0559_1977_num_121_1_2512
http://www.fda.ccip.fr/documents/melopee/fda/distribution.pdf
http://www.logistique-vehicules.com/Dossier-Interets-Limites-Distribution-Directe-
Concessionnaires.htm
http://www.fda.ccip.fr/documents/melopee/fda/distribution.pdf
http://commerceinternational.centerblog.net/6555736-La-distribution
http://chohmann.free.fr/SCM/SCM.pdf
http://books.google.co.ma/books?id=q5IrOrwTdAAC&pg=PA395&lpg=PA395&dq=Distribution+int%C3%
A9gr%C3%A9e&source=bl&ots=adyGPfTguH&sig=_y_Z4Jhm-
2bxiNe3J2QUMHyHcFE&hl=fr&ei=QXr2TZLRNZPC8QO3n_zBBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnu
m=3&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q=Distribution%20int%C3%A9gr%C3%A9e&f=false
Vous aimerez peut-être aussi
- Etude de MarcheDocument43 pagesEtude de MarcheTaha92% (13)
- Glossaire Transport MaritimeDocument28 pagesGlossaire Transport Maritimesouleymane sow100% (2)
- Mesure de La Performance Achats PDFDocument38 pagesMesure de La Performance Achats PDFninia27Pas encore d'évaluation
- Concevoir Une FicheDocument9 pagesConcevoir Une FichekhaledPas encore d'évaluation
- Transport Logistique Ministere Des Finances MarocDocument27 pagesTransport Logistique Ministere Des Finances MarocImane BenrahmounePas encore d'évaluation
- GESTION - DES - PLATES-FORME - LOGISTIQUES (1ére Partie)Document40 pagesGESTION - DES - PLATES-FORME - LOGISTIQUES (1ére Partie)Hanane AzizPas encore d'évaluation
- La Politique de MotivationDocument4 pagesLa Politique de MotivationMed SOUF100% (1)
- Les - Banques - Islamiques 05-12-2012 DéfinitiveDocument39 pagesLes - Banques - Islamiques 05-12-2012 DéfinitiveHanane Aziz75% (4)
- La Metropole AMP Une Construction LaborieuseDocument164 pagesLa Metropole AMP Une Construction LaborieuseJ.P.Pas encore d'évaluation
- CoursDocument71 pagesCoursjeff BAKA100% (1)
- GODET, Pierre. La Pensee de SchopenhauerDocument464 pagesGODET, Pierre. La Pensee de SchopenhauerforneriaPas encore d'évaluation
- Wacker Neuson RD16 Double Drum RollerDocument146 pagesWacker Neuson RD16 Double Drum RollerRichard Sullca CcorahuaPas encore d'évaluation
- La Performance PortuaireDocument23 pagesLa Performance PortuaireHanane Aziz100% (1)
- BMCE Capital Research Stock Picking DELTA HOLDING 16 02 12Document33 pagesBMCE Capital Research Stock Picking DELTA HOLDING 16 02 12Hanane AzizPas encore d'évaluation
- Extrait Logistique Et Transport International de MaDocument20 pagesExtrait Logistique Et Transport International de MaHanane Aziz67% (3)
- Actualité Logistique Au MarocDocument23 pagesActualité Logistique Au MarocHanane AzizPas encore d'évaluation
- Catalogue BrasDocument28 pagesCatalogue BrasHanane AzizPas encore d'évaluation
- Rapport Controle Interne de La Fonction LogistiqueDocument19 pagesRapport Controle Interne de La Fonction LogistiqueHanane AzizPas encore d'évaluation
- Optimisation de La Chaine Logistique Et Productivite Des EntreprisesDocument38 pagesOptimisation de La Chaine Logistique Et Productivite Des EntreprisestadlawiPas encore d'évaluation
- Les Exposes de L'audit Management IndustrielDocument1 pageLes Exposes de L'audit Management IndustrielHanane AzizPas encore d'évaluation
- Mise en Place D Un Tableau de Bord AchatsDocument141 pagesMise en Place D Un Tableau de Bord AchatsHanane AzizPas encore d'évaluation
- Gil Master LogDocument2 pagesGil Master LogHanane AzizPas encore d'évaluation
- Sciences de GestionDocument2 pagesSciences de GestionHanane AzizPas encore d'évaluation
- RDS Sabir NouhailaDocument47 pagesRDS Sabir NouhailaNouhaila SabirPas encore d'évaluation
- Ftec Hevea 6Document4 pagesFtec Hevea 6Felix KobenaPas encore d'évaluation
- Corrigé 06Document4 pagesCorrigé 06José Ahanda NguiniPas encore d'évaluation
- Dekra P 4200g 2020 01b Liste Des Documents A FournirDocument3 pagesDekra P 4200g 2020 01b Liste Des Documents A FournirWael LeplusbeauPas encore d'évaluation
- OrdonnancementDocument10 pagesOrdonnancementkrommPas encore d'évaluation
- September 2018: Messaoud MammeriDocument17 pagesSeptember 2018: Messaoud MammeriEco EcoPas encore d'évaluation
- Rapport de StageDocument16 pagesRapport de StageRayane NokrachiPas encore d'évaluation
- Meamar Tirenifi, Octave Mirbeau - Une Écriture NovatriceDocument51 pagesMeamar Tirenifi, Octave Mirbeau - Une Écriture NovatriceAnonymous 5r2Qv8aonf100% (2)
- Balzac, Le Roman de Sa Vie - Stefan ZweigDocument449 pagesBalzac, Le Roman de Sa Vie - Stefan ZweigClaude ClaudelPas encore d'évaluation
- MTD Energetiques2Document21 pagesMTD Energetiques2أسامة ابو ياسرPas encore d'évaluation
- Fiche TD1 2024Document8 pagesFiche TD1 2024tchombathiery100% (1)
- TP CatiaDocument9 pagesTP Catiabchou100% (2)
- 5-Histoires Des SciencesDocument27 pages5-Histoires Des Sciencescharaf eddinePas encore d'évaluation
- Les Propriétés PubliquesDocument60 pagesLes Propriétés PubliquesMatio ZaraPas encore d'évaluation
- Programme Final Du 5th Colloque CIGSDD2023-TEBESSA - Algeria RectifiéDocument17 pagesProgramme Final Du 5th Colloque CIGSDD2023-TEBESSA - Algeria RectifiéBouhadjar MeguenniPas encore d'évaluation
- Compo 1ère A4Document2 pagesCompo 1ère A4Crepin BAKATRAPas encore d'évaluation
- Chapitre XII Ferraillage Des Éléments PrincipauxDocument33 pagesChapitre XII Ferraillage Des Éléments PrincipauxAmin ZawiPas encore d'évaluation
- Fiche Std2a PoDocument2 pagesFiche Std2a Poceleste77390Pas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 1ère AS (2016-2017) MR RIDHA BEN YAHMEDDocument6 pagesDevoir de Synthèse N°1 - Sciences Physiques - 1ère AS (2016-2017) MR RIDHA BEN YAHMEDnadiaPas encore d'évaluation
- Fiche de Suivi Journalier Du Materiel de L'entrepriseDocument4 pagesFiche de Suivi Journalier Du Materiel de L'entreprisengendakumana sylvestrePas encore d'évaluation
- CCTP Temsia 7-11-22Document21 pagesCCTP Temsia 7-11-22Rabii El HadratiPas encore d'évaluation
- Scratch Exploration Geo Code Un JardinDocument17 pagesScratch Exploration Geo Code Un JardinalimessaoudiPas encore d'évaluation
- CV MarinaDocument2 pagesCV MarinaMariusPas encore d'évaluation
- Externalisation Et IntégrationDocument4 pagesExternalisation Et IntégrationHajiba AzPas encore d'évaluation