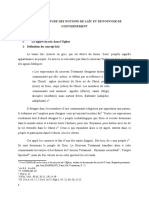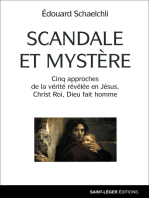Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
DupuisPatrickLEnigmeJesus
DupuisPatrickLEnigmeJesus
Transféré par
Moi le SageTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
DupuisPatrickLEnigmeJesus
DupuisPatrickLEnigmeJesus
Transféré par
Moi le SageDroits d'auteur :
Formats disponibles
LEnigme Jess, Dieu Homme ou Mythe Patrick Dupuis
1 INTRODUCTION
En cette fin de millnaire il semble naturel de s'interroger une fois de plus sur le mystre qui entoure le personnage le plus important de l'histoire du monde occidental: Jsus-Christ. Aprs des sicles d'tudes et de controverses et malgr le consensus apparent qui semble s'tre install sur ce sujet brlant entre croyants et non croyants l'nigme fondamentale demeure non rsolue. Dieu, homme ou mythe? C'est en partant de cette triple interrogation que je m'efforcerai de prendre part au dbat en non spcialiste. En relisant simplement mais exhaustivement les textes (essentiellement le Nouveau Testament) je tenterai de montrer que les opinions les plus rpandues ne sont pas forcment les plus logiques. Tout au long de cet essai j'utiliserai comme guide le fameux principe du rasoir d'Ockham ou principe dit d'conomie selon lequel il ne faut pas multiplier les hypothses qui ne sont pas ncessaires l'explication d'un phnomne. "Dieu existe -il?" est une question mtaphysique qui entrane le dbat vers le terrain de la philosophie et des sciences fondamentales. Une rponse ngative cette interrogation (athisme) a bien sur des consquences immdiates sur le sujet de notre expos mais inversement l'absence de rponse (agnosticisme) ou mme une rponse positive (croyance) n'est pas dcisive sur l'issu d'un dbat essentiellement historique. On mlange bien souvent inutilement dans les discussions propos de religion des questions qui relvent de la mtaphysique (ou de la physique) telles que :l'existence de Dieu, la ralit du monde (ralisme ou idalisme) ou encore la dualit matire esprit (spiritualisme/matrialisme) avec des questions qui relve plus simplement de l'histoire de l'humanit : ralit des vnements bibliques (Adam et Eve, pch originel, Dluge, prophtes, Messie, Jsus),rapports entre religions rvles et mythes. L'objet de cet essai sera donc exclusivement consacr l'histoire de Jsus-Christ. La triple interrogation mentionne plus haut en constitue le sujet central. En fait le dbat actuel se rsume bien souvent aux deux premires questions. Si les chrtiens affirment que Jsus n'est autre que le fils de Dieu qui s'est fait homme afin de venir sur Terre racheter nos pchs, et qui pour ce faire est mort sur la croix puis est ressuscit, les non croyants admettent quant eux sans rserve que Jsus tait un homme exceptionnel dont le message original a t aprs sa mort transform en religion par ses disciples. L'existence du Jsus de l'histoire n'est plus discute de nos jours et est considre par la grande majorit des historiens comme scientifiquement dmontre. Jsus fait donc partie des livres d'histoire au mme titre que Jules Csar ou Charlemagne. Dans un rcent manuel d'histoire d'une classe de 6eme il est mme prcis que durant sa vie Jsus a accompli des miracles comme d'autres font des dcouvertes ou des conqutes. Cette banalisation du phnomne Jsus, personnage historique incontestable renvoie aux oubliettes de l'histoire la troisime partie de notre triple interrogation : Le mythe Jsus? Bien qu'il ne soit pas "politiquement correct" de reformuler une hypothse que beaucoup considrent comme farfelue nous montrerons bien au contraire que rien
n'tant dmontr en dfinitive on se doit de n'luder aucune piste dans ce que nous conviendrons d'appeler ds prsent : L'nigme Jsus.
LES TROIS PARADIGMES
De l'interrogation pose ci-dessus il ressort que trois visions synthtiques du personnage de Jsus sont possibles. Par souci de clart avec le reste de cet essai nous conviendrons d'appeler ces visions des paradigmes signifiant par l qu'il s'agit de modles synthtiques pour ,chacun desquels on peut rattacher une grille de lecture bien spcifique des vnements bibliques. Le terme emprunt au vocabulaire de Thomas Khun (La structure des rvolutions scientifiques) sera utilis ici dans un sens analogue celui rserv par le philosophe aux modles thoriques des sciences. Nous verrons en outre comment d'un paradigme l'autre la lecture des mmes textes bibliques est diffrente et plus particulirement la signification attache tel ou tel vnement narratif. Les trois paradigmes en question font cho la triple interrogation initiale : Dieu ,Homme ou mythe et seront appels dans l'ordre de la discussion : Le paradigme chrtien, le paradigme rationaliste et le paradigme mythique. Le Paradigme Chrtien La vision synthtique propose par les glises chrtiennes quelles soient catholiques, protestantes ou orthodoxes est quelques dtails prs celle enseigne par les catchismes. Dieu a envoy son fils Jsus Christ sur terre en lui confrant le pouvoir de racheter par son sacrifice les pchs de tous les hommes. Jsus est le sauveur (sens du mot Jsus) et aussi le Messie (sens du mot Christ) dont le rgne annonc et imminent doit venir s'accomplir sur toute la Terre. Consubstantiel au pre Jsus est galement par l mme le crateur de l'univers et de toutes choses. Les points essentiels qui constituent les piliers de cette premire vision sont les suivants : Naissance d'une Vierge
Accomplissement de nombreux miracles qui sont autant de signes permettant d'affirmer son identit Message d'amour et d'humilit destination de tous les hommes (juifs et non juifs) dlivr sous forme de paraboles Crucifixion pour sauver l'humanit Rsurrection Ascension vers Dieu Promesse de retour et d'tablissement d'un royaume cleste
Quelle que soit la lecture critique ou nave que l'on puisse faire des vangiles les points numrs ci-dessus constituent le socle inbranlable sur lequel repose tout l'difice de ce premier paradigme. On verra qu' l'intrieur de cet ensemble on peut effectuer une lecture assez cohrente des textes du nouveau testament (cohrente bien que pourtant tonnante).Ainsi en va t-il des miracles et de la rsurrection dont le caractre surnaturel ne prsente ici aucune contradiction avec les axiomes de base de la thorie (Jsus fils de Dieu crateur de l'univers et de ses lois a bien naturellement le pouvoir de suspendre l'ordre naturel des choses). Le paradigme rationaliste C'est faut-il le rappeler une dernire fois la seule alternative au modle chrtien qui est propose de manire officielle au non croyant que celui-ci soit athe ou simplement agnostique. Ce modle sans Dieu ni surnaturel tentera d'expliquer le personnage de Jsus ,homme de l'histoire peu commun, partir de la biographie incomplte raconte par les vangiles. La premire observation que l'on fera propos de ce paradigme est qu'il renferme en son sein de nombreux courants d'opinions et d'interprtations varis. Pour plus de clart essayons de cerner comme ci-dessus les piliers fondamentaux de ce modle. Jsus est n en Palestine vers la fin du rgne d'Hrode et a vcu au dbut du premier sicle de notre re. Jsus a enseign sous forme de paraboles un message d'amour et de gnrosit Jsus a t arrt et jug par Ponce Pilate et le Sanhdrin (Conseil juif) Jsus est mort crucifi sur le Golgotha Aprs sa mort les aptres ont fait connatre au monde son enseignement et sa vie
En ce qui concerne les vnements surnaturels (miracles et rsurrection) on distingue schmatiquement deux courants que l'on pourrait qualifier d'interprtation faible (resp. forte du paradigme). Dans l'interprtation faible les lments surnaturels sont simplement gomms de la ralit comme autant d'inventions (d'embellissement) de la part des narrateurs .Ceux-ci dans le souci de diffuser et surtout d'amplifier le message de Jsus afin de transformer celui-ci en religion naissante ont ajout au cours du temps les vnements suivants : Rsurrection , gurisons miraculeuses et naissance virginale. Dans l'interprtation forte les lments surnaturels sont "expliqus" et r-interprts selon une grille de lecture purement rationaliste : C'est par exemple la thse de Grald Messadier dans son livre : L'Homme qui devint Dieu. Les vnements ont bien eu lieu tels que les narrateurs nous les dcrivent mais ont t mal compris par les tmoins directs et doivent par consquent tre r-examins selon une perspective moderne.
Le paradigme mythique
La thse du mythe aprs tre compltement tombe dans l'oubli et dcrie par tous les spcialistes du Nouveau testament a t soutenue de nouveau depuis 1975 dans les livre de G.A. Wells .Et plus rcemment sur Internet sur le site de Earl.Doherty. Comme nous essaierons de le montrer tout au long de cet essai le modle ou paradigme du Mythe, loin d'tre une thse l'abandon constitue pour le non croyant une grille de lecture beaucoup plus cohrente de l'ensemble des textes qui sont sa disposition . Cette grille de lecture propose dans ce paradigme permet de rinsrer plus facilement les textes chrtiens du Nouveau testament dans leur contexte d'origine sans avoir recours aux nombreux artifices et contorsions d'usage utiliss dans le modle prcdent. Les points fondamentaux de ce paradigme sont les suivants: Le Christianisme est n dans plusieurs communauts de Palestine et des environs selon une volution normale et attendue de la religion juive dominante de l'poque. Sous l'influence des religions mystre et de la philosophie grecque de nouvelles ides ont peu peu merg au sein de plusieurs communauts juives avec en toile de fond cette vision partage d'un Sauveur ou Messie dont l'arrive annonce par les critures (Ancien Testament) tait pressentie comme imminente. La premire image qui merge est donc tout naturellement celle d'un tre spirituel (Le Christ) sans qu'il soit question d'une quelconque "incarnation" au sens propre. Cette premire vision est celle de Paul et des auteurs des diverses ptres qui constituent les textes les plus anciens dont nous disposons. Peu peu une de ces communauts (ou plusieurs) construit une "histoire" d'un Christ " homme" en ajoutant au fur et mesure des rcits mlangeant contexte historique de l'poque et personnages fictifs comme il est de coutume depuis les dbuts de l'criture de l'Ancien Testament (Adam, No et Mose),sans doute par souci de pdagogie religieuse ou pour d'autres motifs plus naturels l'poque. Il ne s'agit pas bien entendu d'une invention ou cration au sens moderne du terme mais plus certainement l'expression d'une tradition religieuse de l'Antiquit. Les Evangiles qui dcrivent la vie de Jsus Christ apparaissent ainsi postrieurement aux Eptres. Autres paradigmes Il existe bien entendu d'autres lectures possibles de la bible. On peut citer en autres celles des musulmans et des juifs, ou bien celle des distes. Dans les deux premiers cas l'existence de Jsus n'est pas remise en cause ,mais celui-ci n'est pas reconnu comme tant le fils de Dieu. La grille de lecture reste toutefois assez proche de celle des chrtiens (abstraction faite de la rsurrection ).Le diste quant lui ne croit pas une intervention directe de Dieu dans les affaires humaines et pourra donc choisir d'adopter dans ce cas prcis une vision rationaliste ou mythique. En dfinitive ces lectures supplmentaires n'apportent rien de plus dans le prsent dbat et ne seront dons pas prises en considration par la suite.
Conclusion Dans l'analyse des textes ci-dessous on s'efforcera de mettre en relief les points forts et les points faibles de chacun des paradigmes et d'tablir deux faits: L'existence de Jsus loin d'tre prouve de manire certaine comme certains veulent le laisser croire pourrait n'tre qu'assez peu probable. La thse du mythe doit tre prise en considration pour des raisons aussi bien historiques que logiques. 3 PETIT RESUME DE L'HISTOIRE DES RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA VIE DE JESUS
Les premires recherches historiques critiques sur la vie de Jsus remontent au dixhuitime sicle. Jusqu'alors les textes tudis sans relche par des gnrations de thologiens n'avaient gure fait l'objet d'une remise en cause et l'on comprend bien pourquoi. Il s'agissait plutt de dfendre cote que cote le dogme tabli au troisime et quatrime sicle de notre re. Les premiers historiens ayant os jet un regard critique sur la bible et en particulier sur les vangiles n'ont pas du , on s'en doute , voir leur tche facilite par les autorits de l'Eglise soucieuses avant tout de dfendre le caractre sacr des critures. Parmi les contributeurs les plus marquants de cette histoire nous retiendrons les noms suivants: Hermann Samuel Reimarus (1694-1768) : Son tude publie en 1774 par Gotthold Lessing tablit une distinction entre le personnage de Jsus et l'image perptue par les aptres qui auraient drob le corps de celui-ci pour faire croire sa rsurrection dans le but d'tablir plus efficacement les fondements de la nouvelle religion. Dans son texte Reimarus affirme en outre que Jsus n'a accompli aucun miracle. Cette premire uvre s'inscrit donc parfaitement dans le cadre du paradigme rationaliste avec une ngation pure et simple des miracles et une tentative d'explication assez naturelle de la rsurrection. Notons au passage que les vangiles mentionnent trs clairement ce risque de voir les disciples de Jsus tenter de voler le corps de leur matre dans le but de proclamer la rsurrection et justifient ainsi l'envoi de gardes pour surveiller l'entre du Tombeau. Karl Friedrich Bahrdt (1741-1792) : Cet auteur fait de Jsus un Essnien fru de culture grecque qui chappe la mort grce Nicomde et Luc et qui finit ses jours dans une communaut essnienne. Ici non plus il n'est pas question de miracles et une nouvelle explication rationnelle est donne de la rsurrection et du tombeau vide la manire de Grald Messadier. David Friedrich Strauss(1808-1874) : C'est le premier auteur qui parle sans ambigut de mythes propos de la plupart des vnements de la vie de Jsus. Sans aller jusqu' nier compltement l'existence de celui-ci il considre nanmoins comme errones les
explications rationalistes des miracles. Il affirme galement que les auteurs des vangiles ne sont pas des tmoins de la vie de jsus. Ernest Renan (1823-1892) : Sa vie de Jsus est une des plus clbres mais aussi sans doute une des plus critique pour son manque d'objectivit. Son uvre s'inscrit sans problme dans la paradigme chrtien qu'elle vient conforter dans une tentative historicoromanesque. Albert Schweitzer : Dans son livre : La recherche historique sur la vie de Jsus publi en 1906 Albert Schweitzer affirme que Jsus est un prophte ayant un message eschatologique (fin du monde) mais que l' on ne peut rien savoir de sa vie; la recherche historique est un chec et le Jsus de l'Histoire ne peut tre dcouvert. Cette conclusion dfaitiste d'Albert Schweitzer sera reprise en 1920 par Rudolph Bultmann qui considrera comme vaine et illgitime toute recherche historique sur la vie de Jsus. On ne peut rien savoir de la vie ni de la personnalit de Jsus.
Depuis les annes 70 les mthodes d'investigation interdisciplinaires : historiques et scientifiques (archologie) tentent de porter un regard nouveau sur le personnage de Jsus et afin de mieux cerner sa personnalit s'intressent au milieu dans lequel Jsus est suppos avoir vcu (La Palestine du dbut du premier sicle). De nombreux documents ont t mis jour depuis la fin de la Guerre (manuscrits de la mer morte, vangile de Thomas) qui facilitent la mise en uvre de ce programme. Malgr tout on est encore loin de pouvoir tirer des conclusions dfinitives sur ce qui demeure il faut bien l'avouer une nigme totale. Les travaux rcents du Jesus Seminar (1993) aux Etats-Unis montrent que les textes passs la moulinette des analyses et des exgses les plus serres nous apprennent en dfinitif bien peu de choses surtout lorsque ceux-ci sont lus avec l'ide prconue que les vnements relats appartiennent l'histoire plutt qu'au mythe. L'tude mene sur plusieurs annes par ces spcialistes conclue que plus de 80% des paroles attribues d'ordinaire Jsus n'auraient en ralit pas t prononces par lui. Dans cette optique il faut admettre que Jsus a bel et bien exist mais n'a tenu aucun des propos ni commis aucun des actes que nous lui connaissons. Autant dire que c'est l'existence mme du personnage qui en prend un sacr coup car force de mettre en doute tous les vnements de sa vie celle-ci devient tellement peu "connaissable" que l'on comprend de moins en moins le caractre historique du personnage. Depuis une vingtaine d'annes une littrature abondante (surtout anglo-saxonne) s'est empare du sujet avec des contributeurs importants dans chacun des paradigmes mentionns ci-dessus. L'cole mythique est largement reprsente par des gens comme : John M. Robertson, T.Whitaker Robert Taylor,G.A. Wells ou encore Earl Doherty (sur Internet). L'cole rationnaliste a trouv son porte parole en France en la personne de Grald Messadi dont le best seller : "L'Homme qui devint Dieu" reprsente sans ambigut la
tendance maximaliste de cette cole. Pour cet auteur en effet tous les vnements de la vie de jsus y compris mme sa naissance miraculeuse sont interprtables en termes rationnels. Nous verrons plus loin dans l'analyse des textes ce que cela implique. On peut citer aussi le livre de John Dominic Crossnan : "'The Historical Jesus, the life of a Mediterranean Jewish peasant" qui dpeint Jsus comme un paysan juif adepte de l'cole philosophie cynique. Le paradigme chrtien reste traditionnellement reprsent par des auteurs croyants qui tentent pour certains de temprer l'interprtation orthodoxe de L'glise en proposant une grille de lecture plus moderne des vangiles mais sans renoncer aucun des lments fondamentaux de ce paradigme. En France on peut citer entre autres: Jacques Duquennes et Andr Frossard pour les plus connus. Aux Etats-Unis il faut citer l'incontournable Josh Mac Dowell dont l'ouvrage : Evidence that demands a verdict constitue une tentative de dmonstration rationnelle de la vracit des thses chrtiennes. Avec l'arrive d'Internet ce sont maintenant des centaines d'articles et de textes (tous genres confondus) qui viennent enrichir le dbat. On trouvera en annexe les liens vers les sites les plus pertinents. 4 LES TEXTES CHRETIENS
Avant d'entamer une lecture commente des textes du nouveau testament il est souhaitable de faire un petit rappel sur les documents en prsence. Ceux-ci sont trs nombreux et se divisent gnralement en deux familles : les textes du Canon considrs comme seuls fiables par l'Eglise catholique et les autres appels apocryphes moins connus mais tout aussi intressants. Les textes du Canon Une dition actuelle comme par exemple la bible de Jrusalem comprend donc: Les quatre vangiles de Marc, Luc Matthieu et Jean. Les trois premiers sont qualifis de synoptiques car ils peuvent tre poss en parallle l'un ct de l'autre et lus de cette manire. Ils relatent tous les trois la vie de Jsus avec beaucoup de ressemblance mais aussi de divergence dans les dtails comme nous le verrons. L'Evangile de Jean quant lui met plus l'accent sur certains faits accomplis par Jsus et prsente un caractre plus spirituel. Les Actes des Aptres relatent la vie des principaux aptres (Pierre et Paul) aprs la mort de Jsus. Les ptres sont des lettres adresses par les aptres aux premires communauts chrtiennes. Elles ne contiennent comme nous le verrons aucune
information concernant la vie de Jsus (sa biographie ou des dtails concernant les annes passes en Palestine).Les ptres du nouveau testament sont : Les ptres de Paul : 1 et 2 Tessaloniciens,1 et 2 Corinthiens, Les ptres aux Philippiens ,Galates, Romains, Colossiens et Ephsiens. L'Eptre Philmon; Les ptres pastorales (1 et 2 Timothe ,Tite) L'ptre de Jude Les deux ptres de Pierre Les trois ptres de Jean L'ptre de Jacques L'ptre aux Hbreux
L'Apocalypse de Jean : texte surprenant qui dpeint une vision assez terrifiante du Jugement dernier. Manuscrits originaux De quand datent ces textes et qui en sont les auteurs ? En ce qui concerne les vangiles ,la seule quasi-certitude que l'on est mme d'noncer en toute objectivit est que l'on ignore totalement qui les a crit ni quelle priode. Les nombreux manuscrits complets du nouveau testament datent tous du 4me sicle aprs Jsus Christ (Codex Vaticanus et Codex Sinaiticus pour ne citer que les deux plus clbres) . On trouve des papyrus plus anciens qui datent du 3me sicle : ce sont les papyrus Chester Beatty qui contiennent les 4 vangiles et les actes. Des fragments de papyrus qui remontent au 2me sicle ont t retouvs : ce sont les papyrus de John Rylands (130 aprs JC) qui renferment des extraits de l'Evangile de Jean ainsi que le papyrus Bodmer crit aux alentours de l'an 200 et renfermant lui aussi des extraits de l'vangile de Jean. Bien avant l'invention de l'imprimerie le seul moyen de conserver et de transmettre des documents tait la copie faite la main le plus souvent par des moines . La copie l'identique n'tait pas forcment garantie et l'existence de frquentes interpolations (modifications mineures) des textes originaux est atteste par de nombreux historiens. Le but de ces interpolations tait bien souvent de rendre tel ou tel passage plus conforme une certain orthodoxie voir plus simplement de "rajouter" des complments des explications juges insuffisantes ou trop fragmentaires. Toujours est-il que dans
ces considrations il est bien difficile d'affirmer la seule lecture des textes qui nous sont parvenus quels taient les intentions relles de leurs auteurs ni d'estimer en toute objectivit la sincrit et l'authenticit de leur rcit.
Malgr les dates mentionnes ci-dessus qui accompagnent les documents en question il est gnralement admis que les vangiles ont t crits au 1er sicle de notre re entre 60 et 65 pour l'vangile de Marc,80-85 pour ceux de Matthieu et Luc et 90-95 pour celui de Jean. Ces dates sont postules plutt que dmontres et sont en accord avec l'hypothse implicite de l'existence d'un Jsus historique. En fait l'examen global de l'ensemble des textes que nous esquisserons plus loin donne plutt l'impression que les rcits biographiques concernant Jsus (Les vangiles)sont plus tardifs (2eme sicle) en accord avec les fragments de documents rellement existants. Plus aucun thologien expert du Nouveau testament ne dfend aujourd'hui l'ide originelle stipulant que les auteurs des vangiles seraient des aptres de Jsus (Matthieu et Jean) ou mme des assistants dvous de ceux-ci (Marc et Luc).Il est admis plus gnralement que les vritables auteurs en question appartenaient plutt des communauts et que celles-ci ont emprunt les noms ci-dessus dans le souci vident de lgitimer l'authenticit de leur rcit. L'exgse classique attribue l'antriorit l'vangile de Marc. Matthieu et Luc auraient crit plus tard en s'inspirant de ce premier vangile et d'un autre document galement plus ancien baptis Q (Q est l'initiale du mot allemand Quelle qui signifie source).L'vangile de Marc tel que nous le connaissons serait le rsultat quant lui d'une volution partir d'un document primitif appel proto-Marc ou Marc original. Le document Q lui aussi aurait t rdig en plusieurs tapes ou "strates" appels Q1 Q2 et Q3. Dans la premire strate Q1 figurent les maximes de morale les plus connues (Aime tes ennemis) et des passages que l'on retrouve dans les Batitudes. La deuxime strate Q2 contient les messages prophtiques et apocalyptiques des vangiles (annonce du jugement dernier) les critiques des pharisiens et Jean le Baptiste. La dernire strate contient les miracles et certains pisodes de la vie de Jsus. L'ide du sauveur venu rachet les pchs des hommes et qui ressuscite aprs avoir t crucifi serait absente de ce document. Cette thorie de la double origine des vangiles (Proto-Marc et Q) ne constitue pas un argument spcifique en faveur de tel ou tel paradigme. Tout au plus donne t-elle plus de consistance la thse du mythe en mettant en relief un aspect souvent contest de cette cole : Celui de la construction progressive de la biographie de Jsus dans un laps de temps de quelques dizaines d'annes par un petit nombre de communauts.
Les dates de rdaction concernant les ptres sont tablies avec plus de certitude. Les premires ptres de Paul auraient t crites quelques annes seulement aprs la date officielle de la crucifixion (vers 30 aprs JC) puis les autres ptres s'chelonneraient jusque vers la fin du premier sicle. Les auteurs des ptres non pauliniennes ne sont pas connus avec prcision. Comme pour les vangiles Les ptres de Jude , de Pierre ou de Jean ne sont plus considres par les spcialistes comme manant des aptres concerns mais plutt de communauts. On parle ainsi de communaut johannique propos des auteurs prsums des ptres de Jean ,de l'vangile de Jean et du livre de l'apocalypse.
La premire conclusion provisoire concernant les textes historiques du canon est que les documents les plus anciens sont les ptres de Paul antrieures dans tous les cas aux premiers vangiles. Il est galement vraisemblable (mais non dfinitivement tabli) que les autres ptres ont galement t crites avant les vangiles synoptiques tels que nous les connaissons (mais peut-tre la mme poque que les protos vangiles de Marc et Q). Les Textes Apocryphes Les textes apocryphes consistent en des vangiles ,des actes, des ptres et des apocalypses qui n'ont pas t reconnus par les pres de l'glise comme suffisamment fiables (?) pour tre admis dans le canon mais qui constituent nanmoins un complment d'information historique non ngligeable pour mieux comprendre la gense de la religion chrtienne. Ces documents couvrent une priode allant du deuxime au septime sicle aprs JC. On compte environ plus d'une une vingtaine d'vangiles et autant d'actes, une dizaine d'ptres et d'apocalypses. Parmi les textes les plus connus on peut citer: L'Evangile de Thomas retrouv Nag-Hammadi en Egypte en 1945. Ce document qui contient des maximes de Jsus serait contemporain du document Q cit plus haut et peut-tre issu de la mme communaut ou d'une communaut voisine ? Le Protvangile de Jacques ,l'vangile des hbreux et les vangiles de l'enfance dont la fiabilit est juge trs faible par les spcialistes. Une liste plus exhaustive des principaux vangiles et actes apocryphes peut-tre trouve sur le site http://www.hrnet.fr/~dupuypas/Apocryphes/Les_Apocryphes_NT_tableau.htm Les textes eux mmes peuvent tre lus sur le site : http://wesley.nnc.edu/noncanon.
Il convient de noter ds prsent que le degr de fiabilit de tel ou tel document n'est estim que dans le paradigme chrtien qui possde implicitement une chelle de valeurs pr-tablie pour juge de l'authenticit des tmoignages. Dans une moindre mesure
aussi le paradigme rationaliste dispose de critres propres pour juger du caractre de plausibilit de tel ou tel document. L'hypothse de l'existence d'un Jsus historique impose en effet un ensemble de contraintes sur ce que l'on peut savoir de sa vie et sur ce qui relve donc de l'invention et du conte. Pour le paradigme mythique au contraire l'existence de nombreux documents apocryphes mmes trs diffrents dans le fond et dans la forme des textes habituels du canon constituent autant d'illustrations du processus de cration d'un personnage partir du vcu de plusieurs communauts chacune enrichissant l'histoire sa faon. On peut dire galement que si l'existence de Jsus ne faisait aucun doute les rcits concernant sa vie et son ministre tous issus de tmoins de la premire heure n'auraient pas du faire l'objet de dbats aussi passionns dans l'glise pour dcider de ce qui tait authentique et de ce qui ne l'tait pas.
Parmi les autres documents importants qu'il nous faut citer il y a : Les lettres de Clment de Rome Les lettres d'Ignace Le Didache L'ptre de Barnab Les dates attribues gnralement ces documents vont de 100 120 aprs JC. Ce sont donc des documents qui se rattachent aux tous dbuts de la formation de L'Eglise et qui sont par consquent trs importants pour l'analyse qui suit. Les textes des pres de l'Eglise Parmi les nombreux textes qu'il faut imprativement lire pour se faire une ide gnrale du phnomne chrtien figurent les textes des pres de l'Eglise qui relatent les nombreux dbats propos du Dogme qui ont eu lieu au sein mme du clerg. A partir du deuxime sicle et jusqu'au cinquime sicle environ il a fallu en effet mettre en place le dogme dfinitif de la religion que nous connaissons aujourd'hui et en particulier rsoudre les problmes suivants : Parmi la multitude de textes (vangiles ,actes, ptres, apocalypses) choisir les textes les plus vridiques ou authentiques qui vont ainsi former le canon du nouveau testament. Rpondre aux interrogations et aux arguments des non chrtiens pour qui l 'existence et la nature de Jsus ne sont pas vidents. Combattre les diffrentes "hrsies" ou "htrodoxies" (Marcionisme, Doctisme, Gnosticisme) pour mieux assurer l'avenir d'une seule orthodoxie.
Ce programme va se raliser progressivement du 2me au 4me sicle grce au travail acharn des pres apologistes parmi lesquels on peut citer entre autres: Justin Martyr, Tertullian, Irne, Clment d'Alexandrie, Thohile d'Antioche, Origen, Eusbe de Csare etc.Leurs crits seront particulirement instructifs pour mieux saisir ce phnomne dynamique de la naissance du dogme et peut tre aussi mieux comprendre les relations entre les trois paradigmes. C'est notamment Irne qui vers 185 aprs JC imposera les quatres vangiles que nous connaissons comme seuls authentiques et devant ainsi constituer le canon du Nouveau testament. Les principaux documents sont disponibles sur le site consacr aux : Early Church fathers http://ccel.wheaton.edu/fathers2/: Nous consacrerons un chapitre l'analyse de ces documents. 5 LES EVANGILES CANONIQUES Introduction Dans l'analyse qui suit nous nous efforcerons de mettre en lumire les trois lectures possibles des textes correspondant chacune un paradigme ; nous comparerons ainsi les points de vue rationalistes et mythiques que nous essaierons de confronter la lecture chrtienne classique. Nous relverons galement les contradictions les plus importantes entre les trois synoptiques et nous essaierons enfin de confronter les rcits avec les connaissances historiques dont nous disposons sur cette poque ainsi que sur les personnages qui sont censs y avoir jou un rle. Les contradictions releves sont de deux sortes: Les contradiction primaires qui rendent inconciliables les points de vue des narrateurs (par exemple lorsque les vnements relats sont trs diffrents).Celles-ci jettent un doute important sur l'authenticit des vnements en question et prchent fortement en faveur de l'hypothse du mythe. Les contradictions secondaires qui sont mineures et peuvent s'expliquer par des points de vue diffrents mais conciliables d'un mme vnement. La Nativit Les gnalogies Le rcit de la nativit commence dans l'vangile de Matthieu par une longue description de l'ascendance de Jsus. Une deuxime gnalogie se retrouve dans l'vangile de Luc (3-23).Il s'agit en fait pour les vanglistes de retracer la filiation d'Abraham Jsus (ou mme d'Adam Jsus dans Luc) en passant par David ceci afin de bien montrer que la naissance du Messie remplit une prophtie de l'Ancien Testament stipulant que ce dernier doit tre un descendant du roi David. Ces deux gnalogies sont surprenantes pour deux raisons: Elles sont contradictoires (Il y a dsaccord sur presque tous les noms)
Elles concernent toutes les deux Joseph qui en est le dernier maillon. Or Joseph n'tant pas le vrai pre de Jsus la filiation depuis David ( supposer que l'une des deux gnalogies soit exactes) est totalement sans objet. Pour certains experts ces gnalogies seraient antrieures au rcit de la virginit plus tardif ce qui expliquerait l'apparente contradiction. L'Annonciation L'annonce de la naissance de Jsus est faite tantt Joseph (Matthieu 1-20) tantt Marie (Luc 1.26).L'un comme l'autre connaissent donc ds le commencement la vrai nature de leur fils ainsi que le rle que celui-ci doit jouer. Il aura le trne de David et rgnera sur la maison de Jacob (Luc 1-32 et 1-33),deux prophties qui ne se raliseront pas. Date de la naissance Les lments nous permettant de situer la naissance de jsus dans l'histoire sont les suivants: Jsus est n au temps du roi Hrode le Grand selon Matthieu (Matthieu 2-1) Jsus est n pendant le recensement gnral ordonn par Auguste (Luc 2-1) Jsus est n alors que Quirinius tait gouverneur de Syrie (Luc 2-2) Ces lments posent de graves problmes pour l'tablissement d'une date mme approximative de la naissance de Jsus. En effet Hrode est mort en l'an 4 avant JC alors que Quirinius n'entre en fonction qu'en l'an 6 aprs JC. D'autre part il n'y a aucune trace d'un quelconque recensement gnral ordonn par l'empereur Auguste. Seul un recensement pour impt est ordonn en Jude par Quirinius en 6. Ce recensement qui a entran des rvoltes en Palestine est rapport par Flavius Joseph dans les Antiquits Juives. Trois arguments avancs par les apologistes chrtiens veulent rendre justice Luc : . Publius Sulpicius Quirinius aurait gouvern une premire fois la Syrie en 9-8 avant JC si l'on en croit les inscriptions dcouvertes sur une pierre Antioche en Syrie en 1912 . En fait l'inscription fragmentaire tablit simplement que Quirinius aurait jou un rle militaire en Asie mineure vers cette poque. Certains en ont dduit qu'il aurait alors pu remplir les fonctions de gouverneur de Syrie par la mme occasion et conduire un premier recensement. . Un papyrus gyptien datant du dbut du 2me sicle (London Papyrus) mentionnerait l'obligation pour un rsident de retourner vers son lieu de naissance pour se faire recenser confirmant ainsi le rcit de Luc. Ce fait est souvent cit comme argument pour nier la ralit du recensement dont il est question. En effet on comprend mal pourquoi les autorits romaines auraient exig que les ressortissant d'une province aille se faire
recenser sur leur lieu de naissance alors qu'il tait bien plus simple de le faire sur le lieu d'habitation. L'authenticit tablie (?) de ce dtail pourrait indiquer que Luc relate bien des vnements rels. . Les romains procderaient un recensement tout les 14 ans ce qui situerait celui de Luc vers l'an 8 avant notre re c'est dire bien sous le rgne d'Hrode. Cet argument est affaibli par le fait qu'il faudrait alors expliquer pourquoi les romains auraient procd un recensement dans une province non directement administre par eux contrevenant ainsi leurs lois. La Jude n'est devenu province romaine qu'en 6 aprs JC. En fait les spcialistes sont trs diviss sur ces arguments et de ce fait il est aujourd'hui bien difficile d'adopter leur gard une opinion dfinitive. Il est assez vraisemblable de croire que Luc parle du recensement de l'an 6 poque ou Quirinius est bel et bien gouverneur de Syrie (c'est du moins l'hypothse qui colle le plus simplement avec les faits) On peut donc penser (paradigme chrtien et rationaliste) qu' quelques dtails prs (?) Luc nous laisse un rcit historique assez prcis pour tre considr comme authentique apportant ainsi la preuve que la naissance de Jsus n'est pas un vnement mythique. On peut tout aussi bien conjecturer que les contradictions releves entre les rcits des deux vanglistes sont assez graves pour dmontrer le caractre d'invention des rcits que leur narrateurs par souci de vraisemblance ont truff de dtails d'poque sans prendre toujours la prcaution d'en vrifier la fiabilit. Une tude plus approfondie de cet pisode du recensement et de la controverse propos de la date de naissance de Jsus peut tre trouv sur le site : http://humanist.net/~ltaylor/bible-notes/luke-two.html L'toile de Bethlem L'apparition de l'toile de Bethlehem est galement utilis par les spcialistes des paradigmes chrtiens et rationalistes pour affiner la date de naissance de Jsus. L'hypothse de base tant dans ce cas l'existence d'un vnement astronomique remarquable qui pourrait tre assimil l'toile de Bethlehem. Plusieurs hypothses ont t envisages. Parmi les plus clbres on peut citer: La triple conjonction de Jupiter et Saturne qui a eu lieu en 7 avant JC dans la constellation des Poissons. Le signe zodiacal du Poisson tant celui attribu au peuple Juif et Jupiter la plante annonant la naissance d'un roi on voit sans peine la signification qu'a pu revtir un tel vnement aux yeux des astrologues de cette poque. Grald Messadier souligne cette concidence dans son livre . L'ennui avec cette hypothse c'est qu'il faut admettre que les rois mages astrologues aient pu confondre une toile avec une conjonction plantaire (ce qui fait d'eux de
pitres observateurs) et que l'on comprend mal comment une conjonction de Jupiter et de Saturne aussi remarquable soit elle puisse indiquer avec prcision aux voyageurs astrologues le lieu exact de la naissance de Jsus comme il est report dans Matthieu. Si nous lisons le texte le plus simplement du monde nous voyons qu'il y est question de l'astre annonant la naissance du Roi des Juifs qui prcde les rois mages et qui vient s'arrter au dessus de l'endroit o est l'enfant (Matthieu 2-9): Quoi que l'on dise on est bien plus proche avec cette description d'un rcit mythique comme on peut en lire dans bien des contes pour enfants que de la description d'un vnement astronomique. Le regroupement de Jupiter Saturne et Mars qui a eu lieu en 6 avant JC: Dans un livre rcent intitul The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi
Michael R. Molnar insiste sur la signification particulire de l'occultation de Jupiter par la Lune survenu en 6 avant JC dans la constellation du Blier sense symbolise elle aussi la nation d'Isral. Aprs un dplacement remarquable dans ce signe zodiacal Jupiter serait venu s'immobiliser dans le ciel aux alentours du 19 Dcembre de l'an 6 avant notre re remplissant ainsi parfaitement la description qu'en donne Matthieu dans son vangile. Une Comte en l'an 5 avant JC. Parmi tous les candidats potentiels la comte est sans nul doute le plus crdible pour jouer le rle de l'astre "baladeur" guidant les rois mages venus de l'est vers le lieu de naissance de Jsus. Une Nova : Cette hypothse mise par Johannes Kepler vient rejoindre une observation faite par des astronomes Chinois en l'an 5 avant notre re. En fait il pourrait s'agir de la comte reporte ci-dessus. Cet astre (comte ou Nova) serait rest visible pendant environ 70 jours. Toutes ces hypothses nous montrent combien il peut tre aventureux de vouloir a tout prix chercher une explication rationnelle d'un vnement trs certainement mythique. Certains auteurs toutes croyances confondues font d'ailleurs remarquer judicieusement que personne part les rois mages ne semble avoir remarqu l'toile en question (Ni Hrode ni les bergers dcrits par Luc). L'explication mythique est dans ce cas prcis de loin la plus simple et satisfait par la mme au principe d'conomie du rasoir d'Ockham voqu en introduction. Pour plus d'informations sur ce sujet on peut consulter les pages WEB suivantes: http://www.csis.org.uk/Articles/Papers/Paper7/paper7.htm pour l'hypothse de la comte http://www.eclipse.net/~molnar pour l'hypothse de Molnar http://www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF13/1315.html pour des informations plus gnrales. Massacre des innocents - Fuite en Egypte
Dans Matthieu il est question de deux vnements clbres qui posent de srieux problme aux adeptes des explications rationnelles et bien sur chrtiennes. Il s'agit du massacre des enfants de moins de deux ans ordonn par Hrode ds que celui-ci apprend la naissance du Messie (2-16).Cet pisode macabre dcid par Hrode est rest totalement inconnu des historiens et notamment de Flavius Joseph qui s'est pourtant attach dcrire avec prcision tous les faits marquants ayant eu lieu pendant les annes du rgne de ce monarque qui ft tout sauf clair. L'pisode est absent aussi des autres vangiles et notamment de celui de Luc qui n'est pourtant pas avare de dtails concernant le rcit de la nativit. Cet pisode ressemble trop celui qui affecta le jeune Mose et qui semble se reproduire chaque naissance d'un "sauveur" ou d'un grand homme pour que l'on puisse viter de le ranger dans la catgorie des rcits mythiques. Il conditionne totalement la suite du rcit de Matthieu qui justifie ainsi un prtendu voyage effectu par Joseph Marie et l'enfant jsus en Egypte afin d'chapper au courroux du souverain. Les rationalistes discuteront sans fin sur la faisabilit d'un tel voyage et ses circonstancesIl faut s'arrter un moment sur ce rcit pour noter un fait plus important: Cet vnement est en parfaite contradiction avec le rcit de Luc concernant la prsentation au Temple. Selon celui-ci en effet les parents de Jsus conduisent le nouveau n au Temple comme le veut la coutume afin de" consacrer ce premier n au Seigneur" (Luc 2-23).La crmonie qui a lieu en prsence de Symon et d'Anne est dcrite avec beaucoup de dtails. Cette contradiction "primaire" tend prouver que l'un au moins des deux rcits est erron pour ne pas dire invent. C'est logiquement l'hypothse la plus simple mme si pour les rationalistes et les chrtiens on peut en voquer d'autres afin de sauver la cohrence des deux rcits comme par exemple que les deux vnements ont pu se drouler des moments diffrents mal perus par les deux narrateurs. Comme on le verra plusieurs fois par la suite c'est toujours la grille de lecture mythique qui est la plus claire et la plus simple. Les deux autres doivent s'efforcer en permanence de composer avec le texte soit pour r-ordonner les vnements selon une chronologie plus vraisemblable soit pour habiller la fable avec le manteau de la description romance. Nazareth Dans le rcit de Matthieu on comprend que Joseph et Marie viennent s'installer Nazareth leur retour d'Egypte (Matthieu2-23) tandis que chez Luc ils sont partis de Nazareth o ils vivaient pour ce rendre Beethlm (Luc-4). Bien qu'il s'agisse pris isolment d'une contradiction que l'on peut qualifier de secondaire ce dtail quant au rle jou par Nazareth dans chaque rcit s'inscrit logiquement dans la trame des rcits de chaque narrateur. Nazareth comme destination et point d'aboutissement du priple gyptien pour Matthieu. Nazareth comme point de dpart du recensement de Quirinius pour Luc. On
est bien par la mme en prsence de deux rcits diffrents que seul le paradigme mythique peut facilement justifier. Prophties et oracles A plusieurs reprises dans l'vangile de Matthieu il est question de prophties qui doivent se raliser. Matt 1-23,Matt 2-6,2-15 et 2-18 et enfin Matt 2-23.Ces prophties ou oracles qui ponctuent le rcit de manire priodique se retrouveront tout au long des vangiles comme autant de balises pour guider le lecteur qui pourrait tre perplexe devant les vnements incroyables qui lui sont narrs. Bien sur pour les croyants ces petits rajouts sont autant de signes envoys par Dieu pour confirmer le caractre sacr du message dlivr et mettre en lumire le dessein du crateur. Pour les rationalistes qui cherchent tout pris expliquer les vnements bibliques en les dbarrassant de leurs oripeaux irrationnels, il est difficile d'expliquer comment des vnements annoncs par des oracles ont pu effectivement se produire comme par magie au moment le plus opportun et en des lieus attendus. Bien videmment les prophties s'expliquent de manire plus naturelle si l'on part du point de vue oppos selon lequel c'est le rcit qui sert d'illustration celles-ci. Entre la Nativit et la Passion Jsus et les Docteurs L'pisode de Jsus en train de converser avec les docteurs de la foi est le seul des vangiles canoniques qui se rapporte l'enfance de Jsus. L'lment surprenant dans cette histoire n'est pas tant l'invraisemblance de la situation dans laquelle un jeune garon de douze ans se trouve paisiblement participer une runion avec des religieux mais plutt dans l'incomprhension de ses parents pourtant avertis ds sa naissance de sa vritable nature. Jean-Baptiste Jean Baptiste annonce l'arrive de Jsus en des termes sans quivoque (Matt 3-11):Il baptise les gens mais son baptme dans les eaux du Jourdain n'est que le prlude de celui que Jsus effectuera avec l'esprit saint. Il faut rappeler que dans l'vangile de Luc la naissance de Jean baptiste est annonce grand renforts d'vnements miraculeux (l'Ange du Seigneur Gabriel en personne avertit Zacharie que sa femme pourtant vieille enfantera et devant le scepticisme de celui-ci lui te la parole jusqu' la naissance de l'enfant). Nous passerons sur ce rcit qui n'est pas sans rappeler toutes les naissances extraordinaires auxquelles l'Ancien Testament nous a habitu (Sarah ou la mre de Samson par exemple);Ce qui est ici troublant c'est le rle nigmatique que les vanglistes font jouer au personnage de Jean Baptiste. En effet en fonction des lments cits ci-dessus on pourrait s'attendre ce que jean Baptiste soit le premier
disciple de jsus lui qui connat si bien la mission de ce dernier y ayant t prpar en quelque sorte depuis sa naissance. Or curieusement Jean Baptiste ne fera mme pas partie des douze et doutera mme un moment de Jsus (lorsqu'il enverra quelqu'un demander Jsus s'il est vraiment le Messie Luc 6-19). Ces contradictions sur le fond se retrouvent chez les trois vanglistes (la concordance des trois rcits est tellement frappante qu'il ne s'agit videmment pas de tmoignages indpendants). Jean Baptiste annonce la venue de Jsus mais en mme temps ne le suit pas. Si Jean Baptiste a rellement exist (son existence n'est gure plus certaine que celle de jsus mais comme son rle est relativement secondaire il n'est pas ncessaire de la mettre en doute) son attitude demeure nigmatique tant dans le paradigme chrtien que dans le paradigme rationaliste. Les miracles et les paraboles Une lecture chronologique des vnements marquants de la vie de Jsus entre le dbut de son ministre en Galile et son entre Jrusalem montre qu'il n'existe principalement que deux sries d'vnements qui se succdent ou s'entrelacent dans un ordre variable selon tel ou tel vangile: Il s'agit des miracles et des paraboles. Si Jsus a rellement exist il faut croire qu'il a pass le plus clair de son temps s'adonner l'une ou l'autre activit. Ces deux lments constituent l'aspect le plus frappant des textes et confre ceux-ci une tranget et un mystre qui ne cessent d'aiguiser notre curiosit. Bien videmment ces vnements sont senss avoir eu lieu il y a prs de deux mille ans une poque qu'il nous est bien difficile de comprendre mais il faut bien avouer que l'impression gnrale que l'on retire de la lecture l'tat brute des textes (sans commentaires) peut se rsumer ceci: Il ne s'agit pas du rcit de la vie d'un homme ft-il aussi extraordinaire que certains le prtendent. Ces rcits n'ont rien en commun avec les tentatives de rcritures d'auteurs rationalistes dsireux de redonner un "peu d'humanit" au personnage. L'impression gnrale qu'il s'agit ou bien d'un Dieu comme le prtendent les chrtiens ou bien d'un mythe sort renforce de la confrontation avec le texte. Bien des vies de Jsus ont t rcrites dans le paradigme rationaliste pour attnuer le ct extra-humain du personnage mais celles-ci sont trop loignes des vangiles pour tre crdibles. On ne peut pas attnuer l'effet des miracles ou diminuer leur nombre tant ces vnements jouent un rle considrable dans les vangiles. Quant aux paraboles rien ne permet logiquement de penser que des tmoins directs ou indirectes aient pu mettre de telles phrases dans la bouche de Jsus (et de plus si longtemps aprs sa mort). Les miracles se dcomposent de la manire suivante: Les gurisons miraculeuses Les rsurrections (Lazare et les autres)
Les "autres miracles" (multiplication des pains,marche sur l'eau)
Nous analyserons ensuite les problmes poss par les enseignements de Jsus. Les Gurisons miraculeuses . Le premier lment frappant propos de ces gurisons est leur nombre lv. Jsus gurit beaucoup de dmoniaques (Matt 8-16) Jsus parcourt des villes et des villages en gurissant toute maladie et toute langueur (Matt 9-35) Jsus gurit des foules nombreuses (Matt 15-30) . Tous les types de maux sont guris par Jsus Jsus gurit des malades atteints de maux divers (Luc 3-40) Les principales gurisons concernent : Des aveugles qui recouvrent la vue (Matt 9-27,Marc 8-22,Luc18-35) .Il est mme prcis qu'il peut s'agir d'aveugles de naissance (Jean 9). Des sourds-muets (Matt 9-35) Des pileptiques (Matt 17-14) Des boiteux (Matth 21-14) Des paralytiques (Luc 5-17,Jean 5-1) Des Lpreux (Luc 17-11) Des Possds (Marc 5-1,Luc 3-33,Marc 7-24)
Des maux divers (Homme la main sche Luc 6-6,serviteur d'un centurion Luc 7-1,Gurison d'une hmorroisse Marc 5-21) La multiplicit des gurisons rapportes rend caduque l'hypothse soutenue par la plupart des rationalistes selon laquelle tous les maux guris par Jsus seraient en fait des maladies psycho-somatiques sans lsions relles. D'une part il convient de noter que mme si cela tait vrai l'exploit accompli par Jsus serait quand mme remarquable car on a jamais vu dans toute l'histoire une telle accumulation de pareilles gurisons en si peu de temps du fait d'un seul individu. Mais il est encore plus invraisemblable que toutes ces personnes atteintes des maux les plus
divers puissent tre ranges dans la catgorie des malades psychosomatiques une poque o les vraies maladies devaient tre bien plus nombreuses qu'aujourd'hui . Il est tentant d'essayer par tous les moyens d'attnuer le caractre miraculeux de l'acte de gurison en refusant de lire le texte au premier degr pour tenter d'extraire de l'impossible un lment rationnel. On voit ainsi Grald Messadier essayer de nous expliquer comment Jsus gurissait les aveugles en leur nettoyant les yeux pour y retirer la boue qui les empche de voir. Mme si cette explication peut satisfaire un cas ou deux il ne faut pas oublier que le texte est suffisamment non ambigu sur certains dtails sans doute pour dissuader des dtracteurs potentiels (Gurison de l'aveugle n dans Jean 9).Parfois la gurison a lieu sans intervention directe de Jsus (Gurison d'une Syrophnicienne Marc 7-24).L'vangliste veut ainsi montrer sans ambigut qu'il y eu miracle sans doute pour viter des tentatives d'explication o le surnaturel serait absent. La faiblesse des arguments rationalistes dans ce cas consiste admettre que la mme personne qui a eu tant le souci du dtail pour nous raconter des "vnements rels" se trompe compltement ds qu'il s'agit de raconter un miracle. Tromperie volontaire ou involontaire selon les auteurs, l'explication est boiteuse et colle mal avec le reste du texte. Seul l'interprtation faible du rationalisme qui rejette l'ensemble des vnements miraculeux peut sauver momentanment le paradigme de cette incohrence. Mais avec le risque de se rapprocher de trs prs du paradigme mythique car comme on aura l'occasion de le re-prciser s'il s'avre que l'on doive retirer une part trop importante des textes (et les miracles constituent une partie non ngligeable des quatre vangiles) c'est toute la crdibilit du tmoignage qui se retrouve ipso facto en cause. Il ne reste plus alors qu' simplement postuler l'existence de Jsus tout en rappelant que l'on ne peut rien savoir concernant sa vie, position trs voisine de celle du mythe. Les rsurrections On trouve dans les vangiles plusieurs rcits de morts ressuscits par Jsus: Rsurrection de la fille de Jare (Marc 5-23) Rsurrection du fils de la veuve de Nan (7-11) Rsurrection de Lazare (Jean-11)
Il s'agit ici des rsurrections accomplies par Jsus auxquelles il conviendrait d'ajouter la sienne et celles des morts le jour de la crucifixion. La rsurrection de Lazare est celle qui est dcrite avec le plus de dtails; l'vangliste nous prcise que Lazare est dcd depuis quatre jours et qu'une odeur forte commence se faire sentir ;ce dtail encore une fois est destin persuader le lecteur qu'il ne s'agit pas d'un fait pouvant s'expliquer de manire plus simple comme par exemple en supposant que Lazare tait simplement tomb dans un coma profond mais qu'il n'tait pas vraiment mort. C'est pourtant l'explication prfre des rationalistes qui feignent de ne pas remarquer que mme dans ce cas "extraordinaire" l'acte accompli serait quand mme tout fait
incroyable. On a rarement vu en effet dans toute l'histoire de la mdecine un comateux se rtablir brusquement en obissant simplement aux injonctions d'une tierce personne. Encore une fois les rationalistes devront prfrer l'explication de l'invention pure et simple quitte affaiblir un peu plus la crdibilit du tmoignage. Les autres miracles Jsus accomplit encore bien d'autres miracles dont l'accumulation constitue un vrai problme pour les tenants du paradigme rationaliste selon lesquels ces actes surnaturels sont bien sur impossibles. Seule la thse du mythe et bien sur la thse chrtienne restent cohrentes par rapport ces faits. La tempte apaise (Marc 4-35):Jsus a le pouvoir de commander aux lments (mer et vent) de se calmer Premire multiplication des pains (Marc6-30): Jsus nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Jsus marche sur les eaux (Marc 6-45)
Deuxime multiplication des pains (Marc 8-1) : Jsus nourrit 4000 personnes avec 7 pains et quelques poissons. Notons au passage quelque chose de surprenant sur ce deuxime rcit identique (au nombre de pains prs) au premier rcit. Les disciples qui ont assist la premire multiplication (qui a du constitu un vnement plus que mmorable) semblent ne pas s'en souvenir puisqu'ils demandent une nouvelle fois Jsus comment ils peuvent trouver la quantit de pains ncessaire pour nourrir cette nouvelle multitude. La transfiguration (Marc 9-2): il ne s'agit pas proprement parler d'un miracle accompli par Jsus mais plutt d'un vnement surnaturel dans lequel celui-ci est impliqu en compagnie de Mose et d'Elie avec en final une intervention directe de Dieu par le biais de la traditionnelle nue. Jsus transforme l'eau en vin aux noces de Cana (Jean 2).
En conclusion on peut raffirmer que les vnements surnaturels constituent une part importante des vangiles qu'il n'est pas possible d'ter sans affaiblir considrablement la vracit du tmoignage des aptres. Pour les rationalistes qui tiennent dmontrer l'existence historique de Jsus en insistant sur le souci du dtail dont ont fait preuve les vanglistes dans leur description des vnements en question il y a l un vrai problme de cohrence. Ce problme n'existe pas dans les deux autres paradigmes puisque pour les chrtiens les miracles se sont rellement produits tels qu'ils sont dcrits et pour les tenants du mythe ils ne sont qu'invention. La renomme de Jsus
Un petit paragraphe pour noter un fait important qui ressort de la lecture de cette partie des Evangiles savoir la renomme impressionnante qui entoure Jsus au travers de ses voyages en Galile et ailleurs. Les deux pisodes de la multiplication des pains ont montr que plusieurs milliers de personnes suivaient parfois Jsus afin d'entendre ses paroles. Sa renomme gagne la Syrie (Matth 4-24) Des foules nombreuses le suivent (Matt 4-25)
Hrode et Jsus (Marc 6-14) : "Le roi Hrode entendit parler de lui car son nom tait devenu clbre". Les foules la suite de Jsus (Marc 6-17) : Une grande multitude de gens viennent l'entendre de Jude,de Jrusalem de Tyr et de Sidon. La renomme de Jsus est principalement due aux nombreux miracles qu'il accomplit en parcourant le pays ainsi qu'au contenu surprenant et novateur de son discours. Une question essentielle se pose en guise de conclusion cette renomme. Pourquoi aucun historien ou observateur de l'poque n'a-t-il mentionn Jsus ? A part les quelques allusions pseudo-historiques que nous analyserons plus loin personne n'a cru bon de simplement citer Jsus comme une personne de cette poque et de ce pays qui a compt. L'incroyable renomme du Jsus des vangiles est en contradiction flagrante avec la discrtion totale du Jsus de l'histoire. La plupart des rationalistes lvent cette difficult en niant cette prtendue renomme que Jsus doit principalement aux miracles qu'il accomplit (puisqu'ils nient aussi les miracles). L'enseignement de Jsus Quand Jsus n'accomplit pas de miracles ,il enseigne au peuple dans les synagogues ou parfois en plein air. Son message apostolique est dlivr le plus souvent sous forme de paraboles. Nous allons analyser le fond et la forme de cet enseignement en essayant de dgager des grandes catgories utiles pour l'analyse ci-aprs. Le contenu du message de Jsus est trs ingal ;c'est un mlange surprenant de maximes parfois trs sages ou trs potiques et parfois aussi trs douteuses. Parmi les maximes les plus connues et qui sont encore trs populaires de nos jours ,on peut citer: Les Batitudes (Matt 5 1-11) Aimez vos ennemis (Matt 5-43) Si quelqu'un te donne un soufflet sur la joue droite, tends lui encore l'autre (Matt 5-39) Ne juger pas afin de ne pas tre jugs (Matt 7-1).
Tu aimeras ton prochain comme toi mme (Matt 22-39). Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous ,faites le vous mme pour eux etc Malgr le caractre parfois trs potique de ces maximes il faut bien reconnatre que leur efficacit est plus que douteuse si elles devaient tre suivies la lettre. Parmi les maximes plus quivoques on peut citer : Il faut s'abandonner la providence (Matt 5 25-34) : Ne vous inquiter donc pas du lendemain : demain s'inquitera de lui-mme. A chaque jour suffit sa peine. Il est inutile d'insister sur le caractre peu efficace voir dangereux d'un tel prcepte pour la survie de l'espce humaine et on peut se fliciter que nos anctres ne l'ait pas mis en pratique trop souvent. Efficacit de la prire (Matt 7 7-11) : Demander et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez; frapper et l'on vous ouvrira. Encore une fois Jsus recommande de s'en remettre la providence aide par la prire pour venir bout de toutes les difficults. L'efficacit est mme renforce en cas de prire commune (Matth18-19). L'histoire de l'humanit montr depuis toujours que cette philosophie plus passive qu'active ne marchait que rarement et n'engendrait aucun progrs. La chance qui sourit parfois certains est bien souvent occulte par le malheur qui frappe le plus grand nombre. N'appelez personne votre "pre" sur la terre (Matt 23-9): Comment faut-il donc appeler son pre ? Si ton il droit est pour toi une occasion de pcher (quiconque regarde une femme pour la dsirer) arrache le et jette le loin de toi. Si ta main droite est une occasion de pcher : coupe l et jette la loin de toi (Matth 5-29 5-30).Cette dernire maxime se passe de commentaires.
Le contenu du message n'est pas exempt de contradictions. Contradictions parfois internes au Nouveau Testament et aussi en rfrence l'Ancien Testament. Jsus affirme tre venu pour accomplir la loi dans sa totalit : Pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit ralis (Matt 5-18). Pourtant il va plus loin modifier celle-ci en remplaant certaines exigences par des exigences opposes. Ainsi le commandement il pour il ,dent pour dent est -il remplac par "tendre l'autre joue". Si je me rends tmoignage moi-mme, mon tmoignage n'est pas valable (Jean 531). Bien que je me rende tmoignage moi mme ,mon tmoignage est valable (Jean 814).
La forme du message est celle des paraboles. C'est volontairement que Jsus s'exprime en paraboles car il n'a pas t donn aux gens ordinaires de connatre les mystres du royaume des cieux; cette facult a t donn aux seuls disciples (Matt 1311). On peut remarquer cependant en contradiction avec cette explication que les disciples ne semblent pas comprendre d'avantage les dites paraboles puisqu'ils demandent par exemple Jsus de leur expliquer la parabole de l'ivraie (Matt 13-36).On peut aussi s'tonner des raisons plus explicites donnes par Jsus dans l'vangile de Marc (Marc4-12);l il nous explique que les gens ne doivent en aucun cas comprendre le message dlivr de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonn. On peut se demander alors : Pourquoi Jsus se donne t-il la peine d'enseigner des foules nombreuses un message que seule une poigne d'lus peuvent comprendre ? Pourquoi veut-il alors que les gens reconnaissent en lui l'envoy de Dieu (en multipliant notamment les miracles) alors que dans le mme temps la signification de son message doit rester secrte ? Interprtation selon les trois paradigmes Pour le paradigme chrtien les contradictions releves sur le fond sont inconciliables avec le fait admis que Jsus est le fils de Dieu . La difficult n'est pas propre au nouveau testament mais existe galement dans l'Ancien. Par exemple le commandement :<< Tu ne tueras point>> qui est bafou par Dieu lui-mme lorsque celui -ci ordonne son peuple de massacrer les habitants d'un village situ l'endroit de la Terre promise. Les nombreuses contradictions et/ou aberrations contenues dans l'Ancien Testament (Rcit de la Gense) sont connues et passes sous silence au profit d'un Nouveau testament cens apporter plus de cohrence et de force au message divin. On vient de voir qu'il n'en est rien et que les vangiles ne diffrent pas sur ce point des textes de la bible hbraque. Le paradigme rationnaliste peut expliquer les contradictions de fond en mettant en avant le ct humain de Jsus soumis l'erreur comme tout un chacun. Mais il est plus difficile pour lui d'expliquer pourquoi le Jsus de l'histoire s'exprimait en paraboles devant des foules nombreuses qui ne comprenaient rien son discours. Ce discours qui n'apparat d'ailleurs pas comme celui d'un homme mais plutt comme une sorte de compilation tablie progressivement au cours du temps. C'est le sentiment global qui ressort de la lecture des textes. A aucun moment on a l'impression que le principal hros de l'histoire est un homme semblable d'autres hommes et ayant vcu une poque dtermine. Quel homme en effet pourrait tenir pareil discours et accomplir autant de miracles en si peu de temps ? (sans parler des prophties sur lesquelles nous reviendront) Encore une fois seul le paradigme mythique parvient rendre compte de tous ces faits en refusant le recours des hypothses trop fantaisistes: Une compilation de maximes juxtaposes et mise dans la bouche d'un personnage cre de toutes pices dans le but de
servir de "support" vivant au texte comme une sorte de rcitant, le tout baignant dans une atmosphre surnaturelle permanente peinte aux couleurs des miracles. Les annonces de la passion A plusieurs reprises Jsus annonce lui mme son destin tragique mais ncessaire,son arrestation ,sa crucifixion puis sa rsurrection aprs le troisime jour Premire annonce : Matt16-21 Deuxime annonce :Matt 17-22 Troisime annonce : Matt 20-17
Ces passages dmontrent le pouvoir de divination de Jsus, pourtant ce mme pouvoir sera mis en dfaut plus tard lors de l'annonce des vnements eschatologiques (arrive imminente de la fin des temps). L'interprtation des ces annonces est bien sr diffrente selon le paradigme choisit. Pour les chrtiens il s'agit de la raison mme de la venue sur terre de Jsus dont celui-ci est parfaitement conscient. Il n'y a donc pas d'incohrence par rapport l'acte de prvision proprement dit. Seules quelques paroles de Jsus cadreront mal avec sa connaissance du caractre invitable de son destin : Notamment ses dernires paroles sur la croix : Mon Pre pourquoi m'as tu abandonn ? L'interprtation rationaliste est quant elle impuissante expliquer ces visions de Jsus excluant par principe toute intervention surnaturelle (et donc bien sr la prdiction de l'avenir).Il ne reste donc plus encore une fois qu' considrer les passages en question comme des embellissements ultrieurs n'ayant aucun rapport avec le personnage historique. Dans le paradigme mythique ces passages prennent une signification plus vidente: Ils rappellent au lecteur quel est le but essentiel assign au personnage que les parties narratives du texte ne doivent pas faire oublier. Le Discours Eschatologique Jsus annonce la fin des temps et l'avnement du royaume des cieux. Plusieurs remarques intressantes s'imposent quant ce passage essentiel des vangiles dont le texte de Matthieu (Matth 24) nous fournit le tmoignage le plus complet: La fin des temps annonce est imminente : "En Vrit je vous le dis,cette gnration ne passera pas que tout cela ne soit arriv " (Matth 24-34). La fin des temps surviendra aprs que l'vangile aura t proclam dans le monde entier (Matth 24-14).
Ces deux indications de date ne sont pas cohrentes entre elles du point de vue du paradigme chrtien puisque l'on sait que l'Evangile ne fut "proclam" dans le monde entier que bien longtemps aprs la disparition de la premire gnration dont il est fait ici mention.Elles sont par ailleurs dmenties toutes deux par les faits puisque deux mille ans aprs ces prophcies et bien que l'vangile ait t proclam sur toute la Terre aucune fin du monde ne s'est encore produite. Pas d'incohrence en revanche selon le point de vue rationaliste.En ce qui concerne le paradigme mythique il faut noter que la premire indication de date (cf cette gnration) place dans la bouche de Jsus semblerait plaider pour une premire rdaction du texte antrieure la fin du premier sicle .En effet quel intrt aurait eu l'auteur de ce texte vivant au deuxime sicle de placer une fausse prophtie dans la bouche du fils de Dieu ? Le tableau de la fin des temps fait cho celui de la cosmogense de l'ancien Testament (Gnse):Jsus parle d'toiles qui tomberont du Ciel ,du soleil qui s'obscurcira, de la Lune qui ne donnera plus sa lumire Il est de nouveau bien difficile pour le paradigme chrtien de justifier le sens de cette vision cosmique et d'en assurer la cohrence avec la connaissance moderne que nous possdons de l'univers. Que Jsus ait la mme vision de l'univers que celle de l'auteur de la Gense est plausible dans les deux paradigmes non chrtien mais pas dans ce dernier qui se doit de reflter au minimum la ralit des choses (qui correspond ncessairement aussi celle de Dieu) : On connat les efforts de l'Eglise pour remplacer la lecture trop imag et allgorique de la Gense par une autre plus moderne intgrant la thorie du Big-Bang .Or il est manifeste que les expressions utilises dans les vangiles font cho celles de l'ancien Testament et correspondent bien une vision du Cosmos partage par les hommes de l'Antiquit. La Passion L'accomplissement des critures Voici venu l'pisode final et sans doute le passage le plus important des vangiles. Les rcits des vanglistes diffrent parfois dans le dtail mais prsentent nanmoins une certaine similitude du moins en ce qui concerne les synoptiques. Ce qui frappe aprs une premire lecture rapide des faits qui se succdent de manire assez rapproche c'est cette impression d'une incroyable mise en scne d'vnements se droulant avec la prcision du mtronome dans le but rappel plusieurs fois d'accomplissement des critures. En effet, Jsus a dj annonc plusieurs reprises ce qui va suivre et le rappellera inlassablement jusqu'au dernier moment : "La Pque, vous le savez, tombe dans deux jours, et le fils de l'homme va tre livr pour tre crucifi." (Matth 26-2). "Voici toute proche l'heure o le fils de l'homme va tre livr aux mains des pcheurs." (Matth 2645). Jsus annonce la trahison d'un des douze et va mme jusqu' le nommer. (Matth 24-25).
Jsus prdit le reniement de Pierre (avec une petite diffrence entre Matthieu et Luc pour lesquels le reniement arrive avant que le coq n'ait chant une fois alors que chez Marc c'est avant le deuxime chant du coq que Pierre va renier Jsus). Lors de l'arrestation Jsus n'offre aucune rsistance en prcisant que s'il le voulait il pourrait faire appel son Pre qui lui fournirait sur le champs douze lgions d'anges (Matth 26-53).Mais dans ce cas comment s'accomplirait alors les critures d'aprs lesquelles il doit en tre ainsi ? (Matth 26-54).Les vnements qui se succdent sont donc bien inluctables car ainsi voulus. Dans l'vangile de Jean les exemples abondent de situations ou de faits se droulant dans l'accomplissement des critures: . Les soldats qui prennent la Tunique de Jsus afin que l'criture ft accomplie: "Ils se sont partags mes habits et mon vtement ,ils l'ont tir au sort" (Jean 19-24) . Sachant que tout tait achev pour que l'criture ft parfaitement accomplie ,Jsus dit:" J'ai soif."(Jean 19-28). . Les soldats ne brisent pas les jambes de Jsus (comme le voulait la coutume) et lui perce le ct avec une lance. "Car cela est arriv afin que l'criture ft accomplie :Pas un os ne lui sera bris. Et une autre criture dit encore : Ils regarderont celui qu'ils ont transperc.(Jean 19-36,37). Cette ide sans cesse rpte de l'accomplissement des critures est totalement inconciliable avec les faits relus la manire rationnaliste.Le fait que toutes les predictions de Jsus ici se ralisent en conformit avec les prophties de l'Ancien Testament est tout a fait irrationnel. A la lumire du paradigme chrtien les choses ne sont pas plus simples.Certes ici le metteur en scne s'appelle Dieu et il est donc parfaitement normal que Jsus soit parfaitement au courant du droulement des vnements jusque dans les moindres dtails.Il n'empche que cette succession de scnes programmes l'avance (trahison,arrestation,procs et crucifixion) semble pour le moins trange pour ne pas dire incroyable eu gard l'enjeu de l 'vnement central savoir la mort du fils de Dieu venu racheter les pchs des hommes. En somme seule la grille de lecture mythique nous offre nouveau une interprtation logique et beaucoup plus simple de cette incroyable mise en scne. Les vnements surprenants Tout au long de l'pisode de la Passion on assiste plusieurs reprises des vnements dont la vraisemblance est soit douteuse soit plus simplement incroyable. Le caractre historique du rcit s'en trouve ainsi profondment troubl: L'attitude de Pilate qui fait montre d'une incroyable faiblesse de dcision l'gard de Jsus et qui semble carrment obir aux injonctions de la foule et du Sanhdrin en contradiction flagrante avec le portrait sans nuance du personnage laiss par les historiens et avec les pratiques de la justice romaine qui n'avait pas pour habitude
de condamner ainsi un homme sans motif valable (Pilate le rappelle d'ailleurs plusieurs reprises). Cette foule qui acclamait encore Jsus il y a si peu de temps lorsque celui-ci faisait son entre dans Jrusalem (Luc 19-36) et qui louait ses innombrables prodiges et gurisons miraculeuses est si presse ensuite de le voir crucifi et rclame sa mise mort et son change contre un vulgaire voleur nomm Barabbas. L'obscurit qui s'tablit sur la Terre entre la sixime et la neuvime heure c'est dire en plein jour et qu'aucun observateur de l'poque ne semble avoir remarqu (voir l'article sur Thallus). Les morts qui ressuscitent et qui se promnent dans la ville.
Les anges qui apparaissent devant ou dans le tombeau vide le matin du premier jour de la semaine. Les plusieurs apparitions de Jsus ressuscit "en chair et en os" devant ses disciples.
Bien sur tous les vnements surnaturels trouvent leur explication cohrente dans le paradigme chrtien. Il n'en va pas de mme pour le paradigme rationaliste dans lequel une telle accumulation de faits dfiant les lois de la nature est tout simplement impensable. Bien sur on peut arguer comme le fait Grald Mssadi dans "l'Homme qui devint Dieu" que la rsurrection de Jsus n'en est pas une car celui-ci , mortellement bless et mis mal sur la croix aurait toutefois survcu ses blessures (puisque les soldats ne lui ont pas bris les os) et aurait t ensuite soign et sauv grce au concours de Joseph d'Arimathie et de quelques comparses. Puis Jsus serait donc effectivement apparu en chair et en os devant ses disciples (puisqu'il n'tait pas mort) et aurait ensuite dfinitivement quitt la rgion pour rejoindre d'autres contres qui garderaient encore le souvenir de son passage (Jsus de Srinagar). On reste pantois devant les trsors d'imagination dont fait preuve l'auteur pour sauver tout pris la ralit d'un vnement qui serait sinon soit surnaturel (hypothse chrtienne) soit invent (hypothse mythique).Le seul ennui avec cette tentative d'explication malgr tout assez improbable rside dans le fait qu'elle laisse de ct les autres vnements dcrits ci-dessus (Les anges ,les morts ressuscits, l'obscurit) pour sauver ce qui semble tre l'essentiel : la rsurrection de Jsus qui devient alors un vnement "naturellement possible". La plupart des auteurs rationalistes prfrent arrter la lecture des vangiles la mort de Jsus et laisser tout le reste dans le domaine du mythe. Quelque soit l'option choisie (minimaliste ou maximaliste) cette grille de lecture ne parvient pas rendre le texte globalement cohrent et se trouve dans l'obligation de procder un tri minutieux des passages garder et des passages rejeter. Les contradictions
Les contradictions sont nombreuses dans les quatre rcits de la passion notre disposition. Rappelons les plus connues : Dans les vangiles de Matthieu et Marc Jsus est amen devant le Sanhdrin puis devant Pilate tandis que dans l'vangile de Luc Jsus comparait galement devant Hrode avant d'tre ramen une deuxime fois chez Pilate. Jsus porte sa croix dans l'vangile de Jean alors que les Synoptiques affirment que c'est Simon de Cyrne qui l'a porte sa place. Les trois femmes qui se rendent au tombeau sont Marie de Magdala, Marie mre de Jacques et Salom dans l'vangile de Marc. Pour Matthieu il s'agit simplement de Marie de Magdala et de Marie mre de Jacques. Luc ajoute le nom de Jeanne celui des deux Maries. Quant Jean il ne parle que d'une seule femme: Marie de Magdala. Les Anges et le tombeau : Pour Matthieu il y a un ange qui arrive soudainement dans un grand tremblement de terre et qui fait rouler la Pierre qui masque l'entre du Tombeau. Il avertit les femmes que Jsus est ressuscit (Matth 28).Pour Marc la pierre est roule lorsque les femmes arrivent au tombeau et voient l'Ange. Pour Luc et Jean il est question de deux anges. Les apparitions de Jsus: Jsus apparat aux femmes venues au Tombeau puis aux disciples en Galile dans l'vangile de Matthieu. Dans l'vangile de Marc Jsus apparat Marie de Magdala puis deux disciples en chemin (Marc 16-12) et enfin aux onze disciples qui sont table sans aucune indication de temps (on peut penser d'aprs le rcit qu'il s'agit du mme jour. Luc nous raconte que Jsus est d'abord apparu deux disciples d'Emmas puis aux Onze le mme jour Jrusalem. Pour Jean enfin Jsus apparat devant Marie de Magdala puis devant ses disciples le mme jour avant d'apparatre une dernire fois au bord du Lac de Tibriade. L'interprtation de ces contradictions est bien sr diffrente selon les paradigmes concerns. Pour les paradigmes chrtien et rationaliste elles sont la preuve de l'authenticit et des point de vue diffrents des vanglistes. Les dtails contradictoires apporteraient la dmonstration de la ralit de l'vnement racont par des tmoins qui ne se sont pas concerts. Bien sr les rationalistes rejettent les phnomnes surnaturels tels que les apparitions des anges. Le point de vue mythique quant lui interprte ces disparits comme autant d'indications que les rcits ne sauraient provenir de tmoignages directs ou indirects. En effet si les rcits proviennent de tmoins ayant assists aux vnements comme par exemple les trois Maries on a du mal imaginer que celles-ci aient pu inventer les tres surnaturels (les anges) ou simplement se tromper sur le fait qu'ils taient un ou deux ou sur d'autres dtails. Si au contraire et comme le suppose la plupart des spcialistes les rcits se sont transmis de bouche oreille on devrait assister des points de vue vraiment diffrents des vnements plutt qu' des rcits quasiment calqus les uns sur les autres. On a plutt le sentiment d'un rcit imagin par un auteur sur lequel viendrait se greffer ici et l des modifications (dtails ou noms diffrents). La Rsurrection
Le mystre de la rsurrection dcrit dans les Evangiles revt plusieurs aspects: Dans un premier temps il s'agit d'un phnomne surnaturel qui ne trouve aucune explication satisfaisante selon le point de vue rationaliste hormis la tentative de Grald Messadi pour qui Jsus aurait survcu ses blessures et aurait t soign par des proches (en contradiction cependant avec les rcits concernant les trois femmes dont on doit admettre dans ce cas l qu'elles n'taient pas au courant). Dans un deuxime temps il convient de noter qu'il s'agit bien d'une rsurrection dans la chair. Jsus apparat "en chair et en os" ses disciples qui peuvent le toucher et le voir manger (Luc 24 -3943) et (Jean 21-12).Cette interprtation est plus surnaturelle que religieuse (on s'attendrait en effet ce que le point de vue religieux mette en avant une survivance de l'me loin des contingences matrielles. Les rationalistes auraient pu alors parler dans ce cas de "visions" ce qui aurait permis de sauver la cohrence de l'intgralit du rcit. Au contraire l'insistance avec laquelle les vanglistes mentionnent la rsurrection "dans la chair" de Jsus est de nature affaiblir considrablement l'authenticit du rcit. Seuls les points de vue chrtiens et mythiques restent sur ce sujet cohrents. Il ne reste pour le rationaliste qu' rejeter le rcit en bloc ou bien nier comme le fait Grald Messadier que Jsus soit rellement mort sur la croix. Encore une fois le point de vue mythique offre au non croyant une solution qui satisfait au principe du rasoir d'Ockham (un minimum d'hypothses supplmentaires). 6 LES ACTES DES APOTRES
Introduction Les Actes des Aptres nous dcrivent les vnements postrieurs la crucifixion et notamment la formation des premires communauts chrtiennes et la proclamation de l'vangile (la Bonne Nouvelle) parmi les Juifs et les paens. Les principaux protagonistes en sont : Pierre ,Paul, Etienne et Philippe. L'impression gnrale de l'ensemble de l'ouvrage n'est gure diffrente de celle releve propos des vangiles (ce qui est normal puisque l'auteur est un des vanglistes) savoir un rcit historico-fantastique dans lequel alterne les passages crdibles sur la vie des personnages et les pisodes purement incroyables (gurisons miraculeuses, prodiges etc).Il est ainsi bien difficile de se prononcer sur l'authenticit de ce tmoignage aussi n'est-il pas surprenant de trouver de nombreux auteurs qui vont jusqu' mettre en doute l'existence mme des aptres Pierre et Paul. On peut cependant noter que ceux-ci sont dpeint avec une certaine vraisemblance historique et qu' l'inverse de Jsus ils ne prtendent pas au statut d'tre surhumain ou divin. On peut donc adopter l'hypothse de leur existence sans que cela ne soulve de difficults particulires pour la suite de l'analyse. Les vnements surnaturels Comme nous l'avons soulign dans l'introduction le texte des actes est parsem de nombreux pisodes surnaturels parmi lesquels on peut relever :
La gurison par Pierre et Jean d'un impotent (Actes 3)
La mort subite inflige aux disciples Ananie et Saphire (Actes5).Cet pisode est assez surprenant plusieurs titres: la punition inflige aux deux disciples semblent disproportionne par rapport la faute commise. L'vnement surnaturel voqu ici va bien au del d'un simple prodige comme une gurison miraculeuse et ne saurait donc s'expliquer de manire rationnelle. Il convient donc d'admettre en dehors de l'explication chrtienne que ce passage (comme beaucoup d'autres) est une pure invention de l'auteur. Les nombreuses gurisons miraculeuses accomplies par Pierre (Actes 5-16).
La dlivrance miraculeuse des aptres puis de Pierre par un ange (Actes 5-17 et Actes 12). Les gurisons accomplies par Philippe en Samarie. (Actes 8-7): "Nombres de paralytiques et d'impotents furent galement guris". La vision de Saul (Paul) sur le chemin de Damas et sa perte de la vue pendant trois jours (Actes 9). Le paralytique gurit par Pierre Lydda (actes 9-32).
La femme ressuscite par Pierre Jopp: Sans doute un des plus extraordinaires prodiges relat dans les Actes et qui rend dfinitivement impossible toute lecture rationaliste du texte: En effet on ne peut pas sans cesse prtendre que les gens guris n'taient pas vraiment malades et que les morts ressuscits n'taient pas vraiment morts sans encourir le risque de discrditer compltement l'auteur de ces rcits. L'hypothse de l'invention est donc plus naturelle et n'entre pour autant pas en conflit avec la thse chrtienne. Seul le paradigme rationaliste sort trs affaibli aprs la lecture d'un tel texte pourtant considr comme un tmoignage historique (et donc en grande partie rationnel) fiable de cette poque. Le magicien Elymas qui devient aveugle suite une intervention de Paul (Actes 13-11). La gurison d'un impotent a Lystres par Paul: Il est prcis ici qu'il s'agit d'un impotent de naissance ;encore une fois ce dtail est utilis par l'auteur pour affermir le caractre miraculeux incontestable de l'vnement. Pas question donc d'interprtation en termes d'affection psycho-somatique gurissable par suggestion. Paul Luc fait tenir Paul des propos que l'on ne retrouvera plus dans les uvres de Paul luimme (Les Eptres): sa prdication devant les juifs (Actes13-17) mentionne Jsus et Pilate et fait donc rfrence aux vnement qui se sont drouls Jrusalem quelques annes plus tt (?).On verra dans les ptres que les dits vnements ne sont jamais
mentionns par Paul ni mme suggrs et que Pilate n'est jamais cit. La partie des Actes consacre Paul comprend de nombreux dtails historiques qui ont permis aux historiens de dater avec assez de prcision la priode correspondante. Cette datation permet entre autres de considrer les premires ptres de Paul dont nous allons parler comme les documents chrtiens les plus anciens que l'on sache dater avec prcision. Les trois voyages de Paul relats dans les Actes ne nous apprennent pas grand chose sur les vnements historiques qui nous proccupent mais semblent indiquer toutefois que des communauts de chrtiens ou plutt de judo-chrtiens se sont formes assez tt dans tout le bassin mditerranen. Si l'on en croit les Actes c'est surtout l'uvre de Paul, Barnab et quelques autres qui n'ont pas mnag leurs efforts pour convaincre les juifs comme les gentils. On pourrait penser que les arguments mis en avant pour convaincre les incrdules taient en grande partie constitus de tmoignages concernant les vnements rcents de Palestine (Les miracles accomplis par Jsus, son enseignement ,sa mise mort par Pilate et sa rsurrection).En fait comme on le verra dans les lettres de Paul celui-ci ( l'exception du passage cit plus haut) n'utilise ni ne cite jamais aucun de ces vnements mais prfre prcher en citant les critures et en invoquant Dieu. On comprend alors mal comment en faisant l'conomie des arguments ayant le plus de poids (la citation des nombreux tmoins qui ont par exemple assist aux miracles de Jsus) Paul ou Barnab peuvent ainsi emporter aussi facilement l'adhsion de si nombreuses communauts et parvenir former en l'espace de quelques annes autant "d'glises" tout le long du trajet accompli durant leur voyage. Il semble plus logique d'admettre que des communauts pr-chrtiennes existaient avant cela chacune avec une interprtation de son cr des critures et que le rle de Paul a plutt consist fdrer et unifier ces croyances en gestation qui ne demandaient qu' se dvelopper. L'poque en question tait on ne peut plus propice l'closion et au dveloppement des ides de sauveur et de messie ou encore d'annonce de la fin des temps et d'un salut accord tous ceux qui auraient la foi. Il ne faut pas oublier que la priode en question est celle de l'essor des religions mystres et du stocisme. Le creuset tait donc prt comme jamais pour recevoir le message chrtien des premiers aptres. - Un dtail marquant des Actes vient semble t-il conforter cette hypothse :c'est le passage concernant Apollos (Actes 18.24-28).Apollos est un juif rudit originaire d'Alexandrie qui a t instruit de la "Voie du Seigneur" et qui est venu enseigner Ephse. Il est prcis "qu'il n'a connut que le baptme de Jean mais qu'il enseigne avec exactitude ce qui concerne Jsus" .On ne peut donc pas en dduire qu'il a t un tmoin direct des vnements concernant Jsus mais que son enseignement comme celui de Paul est plutt relatif au Christ (Sauveur et Messie).Priscille et Aquila qui sont avec Paul se chargent de "lui exposer plus exactement la Voie" autrement dit de revoir son interprtation des critures afin "d'unifier" le crdo naissant. S'il s'agissait de confronter des tmoignages historiques les choses ne seraient sans doutes pas aussi simples. - On peut aussi s'tonner que les "convertis" qu'ils soient juifs ou paens ne posent aucune question concernant le ministre rcent de Jsus. Ils ont du entendre parler des nombreux miracles accomplis par celui-ci et son enseignement si nouveau n'a pas pu manquer de se propager de bouche oreille. Paul et les premiers missionnaires auraient du donc en toute logique affronter des foules de questions sur tous ces sujets et surtout sur celui concernant le problme pineux de la rsurrection. Paul a parl a ceux (les
Onze) qui ont vu Jsus ressuscit quelques heures seulement aprs la crucifixion et ensuite pendant plusieurs jours; il serait donc normal qu'il fasse part de son tmoignage aux gens qu'il cherche convertir soit spontanment soit pour rpondre leurs questions. Mais lorsque Paul prend la parole c'est pour prcher selon les critures en invoquant seulement le nom du Christ et sans jamais mentionner aucun fait "historique" rcent. Nous allons maintenant analyser plus en dtail ce "silence" travers la lecture des Epitres. 7 LES EPITRES
Introduction Le plus grand mystre concernant les Eptres de Paul et des autres auteurs concerne le silence entourant les vnements historiques relatifs Jsus. Comme nous venons de le voir ces lettres ont pu tre dates avec assez de prcision et il est certain aujourd'hui qu'il s'agit des plus vieux documents chrtiens qui nous soient parvenus. Les dix ou vingt ans qui sparent la crucifixion des premiers voyages de Paul constituent la priode charnire pendant laquelle la diffusion des premiers tmoignages a eu lieu. Faut-il rappeler que selon les vangiles la popularit de Jsus est assure de son vivant dans toute la Jude et la Galile du simple fait des nombreux miracles accomplis. La crucifixion ordonne par Pilate et entoure de nombreux vnement surnaturels (tremblement de Terre, obscurit en plein Jour ) a du trs vite donn naissance une multitudes de rcits historico-lgendaires sur le personnage de Jsus. Malgr cela les premiers textes en notre possession font montre d'un silence total et parfaitement incomprhensible sur tous ces vnements: Paul et les autres (Jacques, Jude, Pierre, Jean) ne mentionnent jamais le nom de Jsus de Nazareth. Ils ne citent aucun moment les vnements survenus pendant le ministre de Jsus (Les miracles, l'arrestation de Jsus ,son procs, sa crucifixion). Les lieux des vnements rapports par les vangiles ne sont jamais cits. (Bethlehem, Nazareth, Getsmani, Golgotha) L'enseignement de Jsus n'est pas mentionn. Les nouvelles directives suivre (en remplacement de celles prescrites par la Loi) ne sont jamais attribues directement Jsus : Par exemple Paul ne dit jamais : Jsus a dit :) A aucun moment Paul ne cherche retrouver la trace des vnements passs . Paul clame haut et fort dans toutes ses Eptres qu'il a t choisi par Dieu pour porter l'Evangile chez les paens (Il ne mentionne pas la vision qu'il aurait eu sur le chemin de Damas).Cet vangile n'est jamais justifi directement partir de Jsus Christ mais presque toujours par rapport aux critures (l'Ancien Testament).
L'explication chrtienne orthodoxe de tous ces paradoxes consiste dire que Paul et avec lui les premiers auteurs des Eptres ne se sont pas intresss la vie de Jsus mais seulement la signification de sa venue sur terre. Seuls les vanglistes s'intresseront aux circonstances historiques de la vie du Messie.
L'analyse complte de toutes ces contradictions constitue la pierre angulaire du paradigme mythique. L'analyse exhaustive des silences contenus dans les Eptres a t faite par Earl Doherty pour qui l'hypothse du mythe ne fait aucun doute. Selon lui lorsque Paul parle du Christ mort et ressuscit il ne s'agit en aucun cas d'un vnement historique ayant eu lieu sur Terre mais bien plutt d'un vnement imaginaire ayant eu lieu dans un de ces mondes parallle peupls d'anges et de dmons comme savaient si bien l'imaginer les peuples de l'antiquit. Ce serait dans ce monde imaginaire que le Christ serait venu mourir et ressusciter dans la chair pour que s'accomplissent les critures. Earl Doherty insiste sur le fait que lorsque Paul parle du Christ c'est en fait d'un personnage purement spirituel dont il est question et que sa venue sur Terre ne doit pas tre comprise dans un sens littral mais plutt dans un sens symbolique. Cette hypothse semble davantage s'ajuster avec le contenu des Eptres et permet de mieux rendre compte des invraisemblables silences propos des dtails historiques qui n'apparatront que plus tard dans les vangiles. Les ptres seront examines dans l'ordre de leur apparition dans le texte du Nouveau Testament (Bible de Jrusalem). L'Epitre aux Romains " La cration en attente aspire la rvlation des fils de Dieu" (8-19) " Notre salut est objet d'esprance; et voir ce qu'on espre, ce n'est plus l'esprer : ce qu'on voit comment pourrait-on l'esprer encore ?" (8-24) Ces phrases nigmatiques semblent renvoyer le lecteur une priode future annonce par les critures. La priode toute proche pendant laquelle Jsus a uvr n'est mme pas mentionne. Tout reste venir, tout n'est que promesse. Aucune allusion la venue rcente sur Terre du Fils de Dieu qui a t "rvl" et "vu" par tant de personnes. Jsus n'a t-il pas permis au plus grand nombre de "voir" directement le salut promis.
Paul cite de nombreuses reprises des passages des critures en consolidation de ses arguments. Il cite souvent les prophtes (3Isae l'a dit : 3(10-16) et surtout Mose ("Mose crit "10-5 et "Mose dit"10-18).On cherche en vain par contre des phrases de Paul qui commencent par "Jsus a dit".
"Comment croire sans d'abord l'entendre?" "Et comment entendre sans prdicateur". Paul insiste plusieurs reprises dans les ptres sur son rle de prdicateur qui prend
ainsi plus d'importance que celui de Jsus lui-mme. C'est au prdicateur d'apporter la Bonne Nouvelle (et on a vu succinctement que plusieurs d'entre eux se font concurrence).Le rle du Jsus historique se trouve ici comme ailleurs ainsi rduit peu de choses.
Dans le chapitre sur la charit (12-14) Paul dclare : "Bnissez ceux qui vous perscutent". Dans le chapitre suivant sur la soumission aux pouvoirs civils il dit :"Rendez chacun ce qui lui est d" (13-7) Pourquoi Paul ne cite t-il jamais en pareille circonstance les phrases prononces par Jsus lui mme (Le sermont sur la Montagne par exemple et Il faut rendre Csar ce qui est Csar).Faut-il croire que Paul ignorait les phrases qui sont toujours considres de nos jours comme les plus importantes que l'on doit Jsus. Les seules phrases sur l'authenticit desquelles s'accordent tous les spcialistes. Comment pouvait -il prtendre transmettre le message de Jsus s'il en ignorait les passages les plus novateurs susceptibles d'emporter l'adhsion de tous. Les Epitres aux Corinthiens La premire pitre aux Corinthiens Dans cette ptre Paul demande aux membres de la communaut d'viter les disputes et les clans en particulier entre ceux qui prfrent couter son message lui et ceux qui se reconnaissent plutt dans la prdication d'Appolos (3-4).On retrouve ici le personnage d'Apollos dont le discours semble diffrer lgrement de celui de Paul tout en restant compatible avec celui-ci. Sans doute Apollos enseigne t- il comme Paul un message propos du Christ mais il ne semble pas s'agir cette fois non plus de Jsus de Nazareth puisque comme nous l'avons vu il est peu probable qu' Apollos qui vient d'Alexandrie ait connu celui-ci. Pas plus que pour Paul cela ne semble poser un problme puisque les deux ont t commissionns par Dieu (3-5).Aucune allusion donc une autorit de fait qui proviendrait par exemple d'un contact direct avec le groupe des douze de Jrusalem qui a reu expressment cette autorit de Jsus lui-mme. Plus loin dans le passage intitul "Diversit et unit des charismes" Paul explique le grand nombre de discours et de comportements possibles (sagesse, foi, dons de gurisons, miracles) qui sont tous inspirs par l'Esprit. Nul mention d'un quelconque pouvoir transmis par un Jsus historique. Les citations faites par Paul au sujet de l'eucharistie ne nous apprennent rien de particulier sur ce dernier repas de Jsus. Aucun dtail historique particulier ne vient agrmenter la citation rituelle ; Paul parat citer directement des textes dont le contenu est fig. "Les princes de ce monden'auraient pas crucifi le Seigneur de la Gloire" (28): Pour Earl Doherty cette phrase montre que la crucifixion est un vnement qui s'est produit dans le monde "sur-naturel" des esprits et des dmons" et non pas dans celui o nous vivons.
Dans le passage relatif la rsurrection (15) Paul nous rappelle que le Christ est mort "pour nos pchs selon les critures" qu'il est ressuscit le troisime jour selon les critures". Encore une fois Paul prche un Christ intemporel et qui vit d'abord dans et par les critures. Plus loin Paul parle des apparitions du Christ Cphas (Pierre) puis aux douze puis cinq cent frres et enfin lui mme : Cette exprience commune un si grand nombre semble tre de nature purement spirituelle et pourrait bien reprsenter les dbuts mystiques d'une nouvelle relation avec la divinit et donc aussi d'une nouvelle religion. Il n'est nullement question d'une exprience se rapportant un phnomne rel et temporel. La rsurrection des morts semble tre une pierre d'achoppement pour beaucoup de croyants ,aussi Paul insiste t -il sur le fait que le fondement de la nouvelle foi rside dans la croyance la rsurrection du Christ. Aucune allusion ici aux nombreux tmoins de cet vnement "historique". On pourrait penser que le problme central concerne plutt l'interprtation de l'vnement que l'vnement lui-mme Dans le chapitre concernant le mode de la rsurrection Paul explique celle-ci grce au concept de corps spirituel qu'il oppose au corps psychique. Pourtant lorsque Jsus est apparu aux aptres et a mang devant eux et s'est laiss touch par l'un d'eux ce n'tait bien sr pas son corps spirituel qui tait alors concern. On retrouve ici les ambiguts logiques du concept de rsurrection (rsurrection dans la chair ou rsurrection spirituelle ?) La deuxime pitre aux Corinthiens "C'est Dieu qui a mis dans nos curs les arrhes de l'Esprit" (1-22).
"Notre capacit vient de Dieu qui nous a rendu capable d'tre ministres d'une nouvelle alliance" (3-6). Comme le remarque E.Doherty l'accumulation de telles phrases dans les ptres montre que l'origine du mouvement pourrait davantage se rattacher une sorte de foi mystique plutt qu' un fondateur en la personne de Jsus. C'est bien l'esprit saint qui est le moteur initial ayant mis le mouvement en marche. Le Christ est l'image de Dieu (4-4).
"Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous". Le Christ est l'intermdiaire entre Dieu et les hommes. C'est en tous cas le rle que les philosophies mystiques attribuent au fils. Ce besoin d'un intermdiaire entre Dieu et les hommes est dans l'air du temps comme en tmoigne le succs des nombreuses religions mystres.
E.Doherty dfend la thse de la rvlation de Dieu travers un Christ spirituel pour expliquer le manque total de rfrences au Jsus de l'Histoire. C'est dans le cur des aptres nous explique-t-il que cette foi se dveloppe progressivement. L'pitre aux Galates
Dans cette pitre Paul revient sur les autres vangiles qui semblent concurrencer le sien : "Je m'tonne que si vite vous abandonniez Celui qui vous a appel par la grce du Christ, pour passer un vangile diffrent" (1-6). "si quelqu'un vous annonce un vangile diffrent de celui que nous avons prch ,qu'il soit anathme!" (1-9). L'existence d'vangiles diffrents est en contradiction avec les thses rationalistes et chrtiennes d'un Jsus fondateur du mouvement et qui est apparu ressuscit devant de nombreux tmoins. Comment en effet expliquer que l'enseignement de celui-ci ait pu si peu de temps aprs sa mort et tel qu'il a t transmis aux douze aptres faire l'objet d'autant de versions diffrentes au point d'tre considres pour certaines comme anathmes par Paul. Pour parler "d'autres vangiles" il faut considrer que les divergences portent sur des questions de fond et non pas seulement sur quelques dtails ou faits mineurs comme on pourrait le comprendre s'il s'agissait simplement de souvenirs diffrents concernant la vie publique et le ministre de Jsus.
Paul nous explique galement dans cette ptre que c'est Dieu qui a rvl en lui son Fils. (1-15) ( Moins spectaculaire que le rcit des Actes concernant la vision sur le chemin de Damas cette explication fait cho un peu plus bas une autre phrase dans laquelle Paul compare " sa rvlation intrieure" qui constitue le point de dpart de sa mission d'vanglisation des Paens avec celle de Pierre qui s'est vu confi la mission d'vanglisation des Juifs: "car Celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un aptre des circoncis, avait pareillement agi en moi en faveur des paens". Paul nous explique ici que chez lui comme chez Pierre il s'est s'agit d'une exprience spirituelle intrieure alors que dans le cas de Pierre la situation est toute diffrente puisque celui ci a reu sa mission de Jsus lui mme dont il a t l'un des principaux disciples et qu'il a suivi pendant tout son ministre. Dans le chapitre intitul "Preuve par les faits" et dont l'objet est d'expliciter aux Galates le point de dpart de l'vangile annonc par Paul et par Pierre il n'est jamais question d'un "fait" se rapportant au ministre de Jsus ou Jsus lui-mme mais seulement d' inspirations divines et de rvlations intrieures : Paul parle d'une "rvlation de Jsus Christ" produite par Dieu lui mme.
Les Epitres de captivit On dsigne sous ce terme les ptres aux Ephsiens, aux Colossiens, aux Philippiens et Philmon. Dans l'Eptre aux Ephsiens Paul nous dit qu'il est "ministre des mystres du Christ " et il prcise que c'est Dieu qui lui a accord par "rvlation" la connaissance du mystre (3-3).Il ajoute : " Ce mystre n'avait pas t communiqu aux hommes des temps passs comme il vient d'tre rvl maintenant ses saints aptres et prophtes".(3-5). A aucun moment il n'est question d'une connaissance directe de Jsus Christ de la part de certains aptres. Paul nous dit qu'il est all voir Cphas (Pierre) et qu'il est rest une quinzaine de jours avec lui. On pourrait penser que ce dernier lui aurait alors transmis une grande partie des propos de Jsus sinon l'intgralit de son enseignement, qu'il lui aurait fait part d'innombrables dtails propos du ministre de celui-ci; mais sur tous ces sujets Paul garde un silence incomprhensible. Il n'est question que de "mystre" et de "rvlation spirituelle" termes qui ne prennent toute leur signification que dans l'hypothse d'un Jsus mythique. Dans l'Eptre aux Philippiens Paul mentionne son souhait de communier avec les souffrances du Christ.(3-10).Comme Earl Doherty le souligne justement ce besoin de communion devrait lgitimement s'accompagner d'un besoin de se rendre sur tous les lieux importants qui ont marqu la vie terrestre de Jsus: Nazareth (Le Mont des Oliviers, le jardin de Gethsmani, le Golgotha ).Ni Paul ni les chrtiens du premier sicle qui sont ses contemporains n'ont jamais exprim de tels souhaits pourtant comprhensibles. Quant on sait les millions de plerins qui se rendent chaque anne sur les lieux saints (chrtiens, juifs, musulmans) on ne peut tre que troubl par une telle indiffrence de la part des premiers fidles. L'explication traditionnelle qui veut que Paul et ses compagnons ne portaient aucun intrt dans la vie terrestre de Jsus ne tient pas; car dans pareille situation les ractions humaines ont toujours t similaires les unes aux autres. Par contre si Jsus n'est que pur esprit, si aucun personnage historique n'a jamais foul le sol de la Palestine alors tout est beaucoup plus simple et cohrent. Les Epitres aux Thessaloniciens Dans la premire ptre figure la phrase suivante : "Ces gens l (les juifs) ont mis mort Jsus le Seigneur et les prophtes". (2-15) Il est curieux de voir ici mentionn sur un mme plan la mise mort de Jsus qui est suppose tre un vnement historique rcent et celles des prophtes qui est au plus symbolique. Se pourrait-il que dans les deux cas la mort en question soit comprise dans un sens littraire ? Plus loin Paul affirme : "Puisque nous croyons que Jsus est mort et ressuscit" (414).Comment justifier ici l'emploi du mot croire en lieu et place du mot savoir. La mort et la rsurrection de Jsus ne constituent -ils pas des faits tablis devant de nombreux tmoins? Dans le mme passage on trouve galement :
"Nous, les vivants, nous qui seront encore l pour l'Avnement du Seigneur". Cet avnement constitue bien un vnement attendu comme imminent et qui doit concerner la gnration actuelle (cf. vangiles). Les Epitres Pastorales Sous ce vocable sont regroupes Les deux ptres Timothe et celle adresse Tite. C'est dans la premire ptre adresse Timothe que l'on trouve l'unique rfrence Ponce Pilate extrieure aux Evangiles. Cette rfrence est nanmoins douteuse pour deux raisons: Les spcialistes s'accordent pour penser que Paul n'est vraisemblablement pas l'auteur de cette ptre . La date de composition est inconnue mais pourrait bien se situer vers la fin du 1er sicle. En consquence de quoi la citation de Ponce Pilate pourrait dater d'une poque postrieure aux premiers vangiles en circulation. Certains auteurs pensent galement que cette citation est une interpolation. L'Epitre aux Hbreux E.Doherty cite le passage en 12-15 qui raconte comment Esa pour un seul mets livra son droit d'anesse et ft rejet par la suite. L'intrt de ce passage rside dans l'absence de rfrence Judas qui plus qu'Esa symbolise la trahison et ft aussi rejet. L'abondance de citations en provenance de l'Ancien Testament dans les Eptres remplit l'espace vide laiss par l'absence totale de rfrence aux vnements concernant Jsus et aux personnes qui l'ont accompagn. Les Epitres catholiques Ce terme regroupe les ptres de Jacques le frre de Jsus, les deux ptres de Pierre, les trois ptres de Jean et l'ptre de Jude. Comme les ptres prcdentes celles-ci sont "pleines" de silences propos de Jsus et de son ministre. Qu'il s'agisse de Jacques son frre ou de Pierre et Jean ses plus proches disciples aucun souvenir ni tmoignage ne nous est transmis qui viendrait complter ou prciser les rcits vangliques; On trouve dans la deuxime ptre de Pierre un rappel de la scne de la Transfiguration (Le tmoignage apostolique 2 Pierre 12).La reprise mot pour mot du passage des vangiles laisse penser qu'il peut s'agir d'une interpolation postrieure la rdaction des vangiles ou plus simplement d'une reprise de la mme source qui a donn naissance ce passage des vangiles. Pas de dtail supplmentaire ni d'clairage nouveau donc de la scne en question.
Les trois ptres de Jean ne nous apprennent rien de plus mais font rfrence pour les deux premires une "hrsie" bien surprenante qui consiste pour certains "faux docteurs" nier la venue du Christ dans la chair: 1Jean 4-2 et 2Jean 7. Il est invraisemblable en effet que si peu de temps aprs la mort de Jsus qui ft connu dans toute la Palestine et entour dans ses moindres dplacements par une foule immense que l'on puisse ainsi nier son existence. On peut penser que ces affirmations se contentent de nier que Jsus (personnage connu de tous) et le Christ sont une seule et mme personne mais rien dans la formulation de la proposition ni aucun autre indice dans toute la littrature pistolaire ne nous laisse envisager cette hypothse. A aucun moment en effet n'est souleve la question pourtant la plus pertinente nos yeux consistant savoir si Jsus qui a vcu en Palestine et a t crucifi sous Ponce Pilate est bel et bien le Christ , le Messie tant attendu. Le dbat qui semble s'instaurer entre les auteurs des ptres et les "faux docteurs" porte simplement sur une hypothtique "venue dans la chair" du Christ sans une quelconque rfrence des vnements historiques pourtant connus de tous. Il s'agit donc bien ds cette poque de dbattre d'une question purement thologique sans qu'il soit jamais question d'Histoire . 8 LES APOCRYPHES
Introduction Sans vouloir analyser dans le dtail les nombreux vangiles et actes apocryphes il convient de rappeler que ceux-ci sont dats entre le 2me et le 7m sicle ce qui leur enlve presque toute crdibilit quant au problme qui nous occupe. Bien sur tous ces crits fourmillent de dtails supplmentaires sur la vie de Jsus et viennent complter merveille les trous laisss par les textes canoniques. Mais justement dans le cas prsent l'abondance de supplments enlve encore un peu plus de crdibilit l'histoire globale. On est pas tonn dans ces conditions du rejet dont ont t victimes ces textes de la part des pres de l'glise tant les contradictions avec les textes du canon sont nombreuses. Mais ce que montrent avant tout ces textes c'est une certaine continuit dans le processus de cration du mythe de telle sorte que ce ft n'en pas douter une raison majeure pour les carter. On s'attachera dans ce qui suit un rsum succinct des principaux vangiles apocryphes. Le Protvangile de Jacques Dans cet vangile qui demeure un des apocryphes les plus connus l'auteur nous retrace la naissance de Marie dont la mre se prnomme Anna et le pre Jrmie. Comme maintes reprises dans la bible on a affaire un couple qui ne peut pas avoir d'enfant et qui va nanmoins mettre au monde un fille grce l'intervention divine. Celle-ci sera une " vierge du temple" et seize ans sera confie Joseph (choisi parmi plusieurs prtendants grce un "signe").Puis on retrouve la compilation des vangiles
synoptiques avec la visite de l'archange Gabriel, le recensement de l'empereur Auguste, le massacre des innocents ordonn par Hrode et la naissance de Jsus Beethlem entour des rois mages ,d'une sage-femme et de Salom .Ces deux personnages inconnus des synoptiques ont pour but de tmoigner de l'accouchement de Marie qui est encore vierge. En conclusion cet vangile renforce comme nous l'avons dj soulign le caractre mythique de l'histoire de la nativit sans apporter de dtails qui pourraient cautionner une interprtation rationaliste . L'Evangile de Pierre Cet vangile qui daterait du deuxime sicle aprs J.C. ne fait que reprendre les rcits des synoptiques relatifs la Passion sans apporter l non plus de renseignement supplmentaire sur les circonstances ou sur les personnages des vangiles. L'Evangile de Thomas Cet vangile dcouvert Nag-Hamadi en Egypte en 1945 se compose de citations de Jsus. On retrouve beaucoup de passages identiques aux Synoptiques (paraboles, sermons, batitudes ).C'est un peu une compilation de l'enseignement de Jsus. Lui non plus ne nous apprend rien de plus sur la vie de Jsus. Il se pourrait que cet vangile soit un des documents les plus anciens et contemporain du fameux document Q mais toute datation demeure comme pour les synoptiques hasardeuse. Les Evangiles de l'Enfance Ces vangiles ont pour but de nous renseigner sur la priode de l'enfance et de la jeunesse de Jsus entre la Nativit et le Baptme du Jourdain. Le discours mythique touche ici son apoge et les nombreux dtails rapports n'ont de toute vidence aucune valeur historique. Les prodiges de l'enfant Jsus commencent avec l'affirmation de sa vritable identit et de sa mission ds le berceau. Puis les prodiges succdent aux prodiges: Gurisons miraculeuses de la part de Marie ou de Jsus Nombreux exorcismes de dmons
Intelligence prcoce et "extraordinaire" de Jsus qui n'a nul besoin d'apprendre puisqu'il se montre plus savant que son matre. Le chapitre XXI contient une description sommaire des connaissances de Jsus en Astronomie et en Physique. Le moins que l'on puisse dire est que celles-ci quoiqu'apparemment nombreuses correspondent dans la description qui en est faite celles de son poque et non celles que devrait possder le "crateur de toutes choses".
Les Eptres apocryphes des premiers pres de l'glise (pres apostoliques) Parmi ces ptres on citera les plus connues : L'ptre de Barnab, le Didache, le Pasteur d'Hermas , les deux lettres de Clment de Rome, la lettre de Polycarp,les ptres d'Ignace. Tous ces personnages ont en commun d'avoir vcu vers la fin du 1er sicle et le dbut du second. Leurs crits sont considrs comme les tmoignages chrtiens les plus anciens qui nous soient parvenus juste aprs les ptres canoniques. Censs tre postrieurs aux premiers vangiles (qui dateraient eux de 60 aprs J.C.) toutes ces lettres l'exception de celles d'Ignace (cf. ci-dessous) partagent avec celles du canon (examines plus haut) les points communs suivants: Il y est presque toujours question d'un Jsus Christ spirituel . Aucune allusion ne se rapporte la vie "historique" de Jsus de Nazareth.
Aucun dtail des vangiles n'y est jamais mentionn (Ni les lieux saints ,ni Ponce Pilate, ni aucun des nombreux miracles accomplis par Jsus pendant son ministre.) Ces textes crits pour les premires communauts chrtiennes donnent toutes la mme impression que celle que nous avons trouve dans les ptres Pauliniennes et les autres. Il y est presque exclusivement question de la foi dans un Christ spirituel, le fils du Pre venu racheter les pchs des hommes; Aucune personne physique ayant vcu peu de temps auparavant n'est jamais associe cet tre spirituel qui volue dans un autre monde que le monde terrestre. On ne peut qu'tre d'accord avec E. Doherty pour dire que ce silence qui va se prolonger jusqu'au 2me sicle est tout simplement incomprhensible et constitue en soi un argument de taille en faveur du paradigme mythique. Pourtant la diffrence des ptres canoniques on commence voir apparatre ici et l certaines allusions phmres en liaison avec des lments appartenant aux vangiles. - Dans l'Eptre de Barnab il est question de "miracles" sans autre prcision et du Christ venu dans la chair. - Les Eptres d'Ignace possdent galement quelques lments nouveaux. On trouve par exemple dans l'ptre aux habitants de Smyrne les premires rfrences la naissance virginale et Ponce Pilate .Dans l'ptre aux habitants de Philadelphie on trouve galement une brve allusion un "vangile". Ignace est ainsi le premier auteur chrtien mentionner quelques lments parses des vangiles mais en passant toutefois sous silence l'essentiel de l'histoire. Tout se passe donc comme si aprs un silence de plus de cinquante ans (entre la premire ptre Paulinienne et les lettres d'Ignace) on assistait un timide dbut de transcription des premiers lments d'un rcit ou d'une tradition orale qui allait progressivement devenir les Evangiles tels que nous les connaissons. Peut-tre les premiers rcits de Marc ou de la communaut l'origine du document Q commencent ils circuler cette poque ou bien sont ils en train d'tre labors?
LES ECRITS DES PERES APOLOGISTES DU 2me Sicle
On dsigne par Pres apologistes les pres de l'Eglise qui partir du 2m sicle vont porter tmoignage de leur foi devant les paens et les empereurs de cette poque. Ils vont sans cesse dbattre de toutes sortes de questions relatives la foi chrtienne et notamment des "hrsies". Les plus connus d'entre eux sont : Justin Martyr (milieu du 2me sicle) Clment d'Alexandrie (fin du 2me sicle) Thophile d'Antioche (milieu du 2me sicle) Tertullien (fin du 2me sicle) Minucius Flix (milieu du 2me sicle) Tatien (milieu du 2me sicle) Athenagoras d'Athne
Tous ces apologistes vont s'efforcer de rfuter les nombreuses calomnies dont le christianisme fait alors l'objet et de montrer que celui-ci est une philosophie qui peut rivaliser d'gale gale avec la philosophie grecque. En fait les apologistes vont procder en quelque sorte au mariage entre la philosophie grecque no platonicienne et le judasme revu et complt par le christianisme. Les concepts de "verbe" ou "logos" vont s'associer celui de fils de Dieu. Il est surprenant de voir comment les Pres utilisent abondamment ces concepts abstraits pour convaincre les paens en lieu et place de tmoignages historiques remontant au personnage fondateur du Christianisme c'est dire Jsus de Nazareth. Hormis Justin les autres Pres du milieu du 2me sicle dont il est question ici n'utilisent jamais de rfrence Jsus de Nazareth dans leurs Apologies. L'interprtation chrtienne classique veut que le phnomne historique associ Jsus soit quelque peu masqu pour ne pas choquer les paens plus enclin entendre un discours philosophique gnral qu'une histoire invraisemblable. Il faut attendre la fin du 2me sicle avec Tertullien et Clment d'Alexandrie pour voir Jsus plac au centre de l'apologie. En fait selon l'interprtation mythique l'histoire en question qui s'labore tout doucement au fil du temps commence seulement tre accepte comme mythe fondateur par certains Pres tout en restant l'cart du corps de doctrine principal, un peu comme une illustration que l'on ajoute un texte pour mieux clairer celui-ci et qui joue au demeurant un rle secondaire. Les philosophies grecques taient d'ailleurs elles mmes accompagnes de mythes populaires avec leur lot de personnages extraordinaires et de surnaturel. On peut comprendre que la nouvelle philosophie chrtienne naissante qui comme on l'a dit plus haut reprsente une symbiose entre un certain platonisme et la tradition judaque ait peu peu intgr le mythe issu des vangiles. L'intgration du courant paulinien d'inspiration apocalyptique viendra complter le tout pour donner naissance la religion chrtienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Justin
Justin est n en Palestine et se convertit au christianisme sans doute Ephse. C'tait auparavant un platonicien. Il est dcapit en 165 Rome aprs un procs de martyre. Il est le premier avoir rvler le contenu des runions secrtes que les premiers chrtiens tenaient entre eux et qui faisaient scandales car l'on s'imaginait alors qu'elles comportaient des rites rprhensibles (obscnits et meurtres d'enfants). Les uvres de Justin sont : Le Dialogue avec le Juif Triphon et les deux Apologies (destines aux empereurs Antonin et Marc Aurle).Justin essaie de concilier philosophie platonicienne et christianisme en montrant que Jsus est le "Logos" incarn. Justin est le premier auteur citer explicitement des extraits des vangiles qu'il appelle La Mmoire des Aptres. On peut donc raisonnablement penser que l'laboration de ces documents est antrieure sans qu'il soit possible de prouver leur degr de compltude vers cette poque. Tatien Tatien est l'lve de Justin. Il est clbre pour avoir rdiger une uvre : Le Diatessaron qui reprsente une sorte de compilation globale des quatre vangiles. Pourtant dans son Apologie aux Grecs Tatien n'utilise aucune rfrence Jsus lorsqu'il s'agit de convaincre ses interlocuteurs. Il n'y est question que de Dieu et du "Verbe". Il confesse mme dans cette Apologie (chap. 21) que le Christianisme comporte galement son propre mythe semblable aux mythes grecs ce qui pourrait constituer un argument de nature rassurer les paens sceptiques devant cette nouvelle philosophie. (Pour plus de dtails voir E.Doherty : Second Century Apologists). On trouve ainsi les deux facettes du christianisme : Le mythe des Evangiles et la philosophie issue du Judasme qui sont encore spars et qui sont traits sur des plans diffrents. L'histoire raconte dans les Evangiles ne sera compltement assimile qu'avec les Apologistes de la fin du deuxime sicle : Tertullien et Clment d'Alexandrie. Thophile d'Antioche Theophile est Evque d'Antioche vers 168 aprs J.C. Sa principale uvre s'intitule : A Autolycus. Comme les autres apologistes Thophile ne mentionne jamais le fondateur historique du christianisme et ne nomme jamais Jsus Christ. Les vangiles sont mentionns non comme l'Histoire vcue de Jsus mais comme les paroles inspires de Dieu. Lorsqu' Autolycus lui demande une preuve de rsurrection Thophile ne mentionne mme pas celle de Jsus. L'accent est mis sur le Dieu d'Isral , les prophtes et le "verbe" incarn.
Athnagoras d'Athne L'uvre d'Athnagoras est une apologie intitule "Une Plaie pour les chrtiens" et destine l'Empereur Marc Aurle. Il y est question une fois de plus du Logos et du fils de Dieu mais pas de son incarnation en la personne de Jsus de Nazareth. Jsus Christ n'est d'ailleurs jamais mentionn. Il parle de philosophie platonicienne et des mythes grecs mais pas de la vie terrestre de celui qui est au centre de la religion naissante. Quelques maximes chrtiennes semblables celles du Sermon sur la Montagne sont cites mais sans rfrence aucune leur auteur prsum. Minucius Flix L'uvre de Minucius Flix est un trait appel "Octave" rdig en Latin et datant probablement du mileu du deuxime sicle. Il y est question de la rsurrection des morts mais pas une seule fois de celle de Jsus qui n'est d'ailleurs jamais mentionn dans toute l'uvre. Le plus surprenant est que l'auteur se moque de ces mythes paens o des hommes meurent et deviennent des dieux qui engendrent leur tour d'autres dieux. Il se moque galement des soi-disant dieux qui accomplissent des miracles. Minuciux Flix est un des rares apologistes (avec Justin) qui essaie de rfuter les accusations infamantes dont les premiers chrtiens sont l'objet . Ceux-ci sont en effet accuss de pratiquer par exemple des sacrifices d'enfants au cours de runions secrtes. Parmi ces accusations figure celle de vnrer un homme mort sur une croix. Minuciux Flix dment alors en bloc toutes ces accusations sans jamais essayer d'expliquer que cette dernire constitue pourtant le cur mme de la nouvelle foi. Irne,Clment d'Alexandrie et Tertullien
Les trois derniers pres apologistes et certainement les plus importants de cette poque partagent avec les autres pres le got pour la philosophie grecque (ils vivent tous dans un monde imprgn de culture hellnistique) et vont donc continuer dans la ligne du mariage de cette philosophie avec la thologie chrtienne naissante. A la diffrence des autres pres ils semblent avoir compltement intgr le rcit des vangiles qui devient de ce fait le "canon" des critures chrtiennes. On peut dire qu'avec eux commence la priode "classique" du dogme. Irne, vque de Lyon qui a connu Polycarp fait explicitement rfrence l'vangile selon Saint Jean mais n'est pas trs bavard sur son contenu. S'il est vrai que les vangiles semblent tre dfinitivement admis vers la fin du deuxime sicle leur contenu pourtant si riche (vie de Jsus, miracles, paraboles )est rarement comment.
Dans son combat contre les hrsies (Gnosticisme et Doctisme) Irne ne s'appuie jamais sur ces rcits pourtant si fondamentaux. Il est cependant l'origine de la constitution du "canon" biblique. Clment d'Alexandrie ainsi appel parce qu'il passa une grande partie de sa vie dans cette ville part en lutte contre le paganisme et fait l'apologie d'un christianisme synthse de la philosophie grecque et des traditions religieuses de son poque (Judasme) mais sans rfrences directes Jsus de Nazareth. Le Christ est pour lui "La Raison incarne". Le Christianisme est ici dpeint comme une nouvelle philosophie. La vie et les enseignements du fondateur de cette nouvelle religion sont compltement passs sous silence. Cette attitude commune la plupart des premiers Pres de l'Eglise est tout simplement incomprhensible selon les points de vue chrtien et rationaliste. Indpendamment des textes vangliques Tertullien dans son Apologie prtend que Tibre a pris la dfense de Jsus devant le Snat romain ce qui aux yeux de certains historiens constituerait une confirmation indpendante de l'existence de Jsus. Cependant l'authenticit du texte est discutable dans la mesure o aucun commentateur contemporain ne cite ce passage et galement cause du fait bien connu celui l de l'intolrance de cet empereur envers les cultes trangers. Il est extrmement improbable en effet qu'un empereur romain quel qu'il soit ait d'ailleurs pu prendre la dfense d'un personnage qu'il ne pouvait connatre que par des tmoignages chrtiens indirects. 10 LES TEXTES NON CHRETIENS
Introduction Il existe quelques rares textes non chrtiens faisant rfrence Jsus. Loin de constituer une preuve objective de l'existence du fondateur du christianisme ces textes accentuent leur manire le caractre nigmatique du problme pos. En effet les trop brves allusions Jsus ne cadrent absolument pas avec la popularit tonnante de celui-ci telle que nous la dpeignent les vangiles. Un homme connu dans toute la Palestine qui prche et accomplit des miracles devant des multitudes ne peut avoir laiss les commentateurs de l'poque indiffrents. Hors tel semble bien tre le cas mme en tenant compte des textes dont il sera question plus loin. Tous les vnements miraculeux ou surnaturels qui jalonnent le passage de Jsus sur Terre n'ont semble t-il laiss aucune trace dans les crits du moment et ce malgr le fait que l'poque recelait de nombreux chroniqueurs qui ont par ailleurs tant crit sur les moindres faits ou vnements de Palestine. Inutile de dire que cette situation constitue un argument fort l'encontre du paradigme chrtien qui ne peut sans entrer en contradiction avec les vangiles minimiser l'impact de Jsus sur ses contemporains. Pour le paradigme rationaliste en revanche il ne s'agit pas d'un cueil incontournable puisque selon les dfenseurs de cette thse Jsus a pu exister sans tre trop remarqu par ses contemporains. les vangiles ayant simplement embelli un fond historique rel et construit ainsi une vritable lgende dans l'acceptation courante du terme. Pour ceux qui parmi les rationalistes dfendent cette position il faut alors renoncer au trois quart du texte des vangile et proposer une grille de lecture minimaliste (C'est par exemple la
position des membres du "Jesus Seminar"). Ceci ne constitue pas la position d'une majorit de rationalistes qui se contentent comme on l'a vu de r-interprter les vnements surnaturels dans un cadre historique pur de toute violation des lois naturelles. L'hypotse minimaliste est bien sur la seule dans ce cas pouvoir tre concilie avec la quasi inexistence de tmoignages historiques concernant l'existence de Jsus. Cette version rationaliste est cependant assez proche du paradigme mythique et perd de ce fait beaucoup de son intrt puisqu'elle revient admettre peu ou prou que Jsus a effectivement exist mais qu'on ne peut rien savoir de sa vie puisque celle -ci est passe inaperue de ses contemporains. Les rares textes qui font mention de Jsus ne sont pas proprement parl des tmoignages puisqu'ils ont tous t crits plusieurs dizaines d'annes aprs les vnements. On tudiera dans l'ordre d'importance les rcits de : Pline le Jeune, Sutone, Bara Srapion, Tacite et Flavius Josphe. Seuls les deux derniers mentionnent explicitement le nom de Jsus en relation avec des vnements des vangiles (la condamnation par Pilate). Deux autres textes de Phlgon et Thallus sont souvent cits comme preuve indpendante de l'existence de l'obscurit qui accompagna la crucifixion, et donc d'une certaine manire de la vracit du rcit des vangiles; on les tudiera en dernier. Pline Le Jeune Pline le Jeune qui fut gouverneur de Bythinie a crit une lettre l'empereur Trajan vers 106 aprs J.C. dans laquelle il parle des chrtiens et de leur vnration du Christ. Il mentionne que les chrtiens se runissent la tombe de la nuit pour prier et qu'ils sont inoffensifs. Nanmoins il demande l'empereur quelle attitude il doit prendre envers ce nouveau groupe religieux. Tout ce que cette lettre nous apprend c'est qu'il existait effectivement des hommes se rclamant de la croyance dans le Christ comme Dieu. Aucun rapprochement n'est mentionn entre ce "Christ" et Jsus condamn mort par un procurateur romain. En consquence de quoi on comprend mal que ce document soit si souvent cit comme "preuve" non chrtienne de l'existence de Jsus. Beaucoup de spcialistes considrent que Pline ne dtenait que des informations de seconde main sur les chrtiens et leur croyance. Sutone L'auteur romain a crit une vie des douze Csars et dans l'une d'elles (Vie de Claude) crite probablement vers 120 aprs J.C. il rapporte la phrase suivante : " Claude expulsa les juifs de Rome qui causaient des troubles permanents l'instigation de Chrestus". Le nom de Chrestus serait une rfrence au Christ (le nom est dform car le vrai nom devrait tre Christus). En fait ce nom peut trs bien dsigner une autre personne directement responsable des agitations dans Rome, le nom de Chrestus semblant tre assez courant l'poque. Il est peu vraisemblable en effet que l'auteur ait voulu affirmer que Jsus Christ tait prsent Rome en 44 (poque o Claude expulsa les juifs de Rome).S'il s'agit malgr tout d'une rfrence indirecte au Christ celle-ci ne nous apporte aucun claircissement quant l'existence effective d'une personne historique qui aurait
fond le mouvement. En aucun cas ce document comme le prcdent ne constitue une confirmation indpendante de l'existence de Jsus. Sutone peut trs bien en effet se contenter de citer le nom du responsable du mouvement tel que celui-ci est rapport par les premiers chrtiens. Il ne faut pas oublier en effet que l'auteur crit au dbut du deuxime sicle c'est dire un moment o l'influence des premiers chrtiens commence prendre de l'importance. Lettre de Mara Bar Serapion Ce document si souvent cit comme un tmoignage de l'historicit de Jsus Christ est une lettre crite par Mara Bar Serapion alors en prison son fils qui il demande de rechercher les voies de la sagesse. "Quel avantage les athniens tirrent-ils en mettant mort Socrates ? La famine et la peste vinrent sur eux comme jugement pour leur crime. Quel avantage les hommes de Samos tirrent-ils en brlant Pythagore? En un instant, leur pays fut recouvert par le sable. Quel avantage les Juifs gagnrent-ils en excutant leur Roi sage ? Leur nation fut abolie peu de temps aprs cet vnement. Dieu vengea justement ces trois hommes : les Athniens moururent de faim; les Samiens furent engloutis par la mer; et les Juifs, ruins et arrachs de leur pays, vivent dans la complte dispersion. Mais Socrates ne mourut pas pour toujours; il survcut dans les enseignements de Platon; Pythagore ne mourut pas pour toujours, il survcut dans la statue d'Hera. Le Roi sage ne mourut pas non plus toujours, il vit dans les enseignements qu'il a donn".
Cette lettre appelle les commentaires suivants: Jsus n'est pas explicitement nomm dans le texte.
Le "Roi sage" peut trs bien se rfrer un roi juif ayant vcu la mme poque que Pythagore ou Socrate (6me ou 5me sicle avant J.C.) Le sort rserv aux Juifs fait penser la dportation qui a suivi la prise de Jrusalem par Nabuchodonosor (exil et dispersion des juifs).Un roi Juif du nom d'Amon ft effectivement assassin environ cinquante ans avant cet vnement. Pythagore n'a pas t brul par les siens mais est parti vivre Crotone en Italie du Sud. Aucune famine ni peste recense n'est venue s'abattre sur Athnes aprs la mort de Socrates. En conclusion il semble que cette lettre au contenu si peu historique (en ce qui concerne notamment les personnages de Socrates et Pythagore ) ne nous apporte aucun renseignement concernant ce roi des juifs qui pourrait tre Jsus ?
Le document serait lgrement postrieur 73 aprs J.C. d'aprs certains spcialistes (F.F.Bruce : "The New testament Documents") soit prs de quarante ans au minimum aprs les vnements qui nous proccupent. Le caractre trop vague du texte ainsi que sa date de rdaction un peu tardive contribuent ne pas retenir ce document comme une preuve srieuse de l'historicit de Jsus. Cornlius Tacitus (Tacite) Historien romain et gouverneur en Asie Tacite rapporte les propos suivants dans ses Annales: "Quelque ft le soulagement apport par un homme, ou les bonts qu'un prince puisse apporter, ou les sacrifices d'expiation que l'on pourrait prsenter aux dieux, rien n'aurait soulag Nron de l'infamie des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il aurait luimme ordonn cette conflagration, c'est--dire, l'incendie de Rome. C'est pourquoi, pour faire cesser ces rumeurs, il accusa les chrtiens qui taient has pour leur normit, les chargea de cette culpabilit, et les punit par toutes sortes de tortures affreuses. Christus, qui tait le nom de leur fondateur, fut mis mort par Ponce Pilate, procurateur de Jude sous le rgne de Tibre : mais la superstition pernicieuse qui fut rprime pour un temps clata de nouveau, pas seulement en Jude o le mfait tenait ses origines, mais aussi dans la cit de Rome." Ce document constitue avec le Testimonium Flavanium la preuve historique la plus souvent cite car manant d'un historien romain non chrtien qui cite prcisment la condamnation de Jsus par Pilate sous le rgne de Tibre. Ce texte crit vers 117 aprs J.C. est pourtant bien tardif pour constituer une preuve indpendante de tout tmoignage chrtien. En effet vers cette poque comme on l'a dj remarqu circule "l'histoire du fondateur du christianisme" qui n'a pas manqu d'arriver jusqu'aux oreilles de Tacite. Pour pouvoir affirmer que Tacite crit partir d'une source indpendante il faudrait par exemple montrer qu'il avait accs aux archives impriales ce qui donnerait son tmoignage un caractre vraiment incontestable. Cependant ceci demeure douteux car le titre donn Pilate (procurateur) n'est pas exact (Pilate n'tait que prfet) et qui plus est il semble peu probable que Christus ait pu tre le nom de Jsus enregistr dans les archives officielles si tant est qu'un tel vnement ait pu tre enregistr: Il est peu vraisemblable que toutes les excutions de messie ou de prophtes juifs de l'poque se droulant dans une lointaine province romaine aient pu tre consciencieusement enregistres dans des archives officielles. Certains spcialistes s'interrogent par ailleurs sur l'authenticit de ce texte qui n'est pas cit par les pres de l'glise : ni Origen, ni Tertullien qui connat bien Tacite ni Clment d'Alexandrie si prompt utiliser tout l'arsenal des "preuves" pour convaincre les paens ne font rfrence ce texte qui est "retrouv" en 1468.Eusbe de Csare qui a lui aussi "compil" toutes les sources documentaires sur Jsus ne parle pas de ce passage de Tacite.
Pour toutes ces raisons , le texte de Tacite ne constitue pas proprement parl une preuve indiscutable de l'historicit de jsus. Lucien de Samosata Lucien de Samosata est un rhtoricien satiriste qui a vcu au 2me sicle aprs J.C. Athnes et Alexandrie. Il port un jugement critique sur ses contemporains ,leurs croyances et surtout leurs superstitions. Dans l'une de ses uvres il parle du fondateur du christianisme en ces termes : "... l'homme qui a t crucifi en Palestine parce qu'il avait introduit cette nouvelle secte dans le monde... En plus, celui qui leur avait donn sa loi les persuada qu'ils taient tous frres les uns des autres aprs qu'ils aient transgress une fois pour toutes en reniant les dieux grecs et en adorant ce mme sophiste crucifi, et vivant sous ses lois...". (dans "Le Plerin qui passe") Ce "tmoignage" on l'aura compris n'en est pas vraiment un l'auteur tant un contemporain de Justin et des pres apologtiques. Il confirme simplement qu'au 2me sicle la tradition d'un Jsus Christ crucifi en Palestine tait dj rpandue un peu partout (ce que nous savions dj par ailleurs) et qu'il existait des chrtiens dans de nombreuses rgions. Le Talmud Parmi les rfrences les plus frquemment cites comme preuves historiques figurent quelques passages tirs du Talmud Juif. Ce document rappelons le comprend deux parties : Le Mishna (texte) et le Gemara (commentaires); le premier aurait t codifi vers le 2me sicle et rdig pour la premire fois vers le 5me sicle,la deuxime partie daterait aussi de cette priode. Dans son livre "Evidence that demands a Verdict" McDowell considre que les rfrences incertaines se rapportant Jsus de Nazareth constituent des preuves indpendantes de l'historicit du fondateur du christianisme. En fait les passages concerns racontent tous " des anecdotes" assez loignes du rcit biblique: Yeshu (Jsus ?) est pendu la veille de Pques aprs avoir t lapid pour cause de sorcellerie ? Il a cinq disciples : Matthai,Nakai,Nezer,Buni,et Todah (Sanhedrin 43a) Ben Strada est pendu la veille de Pques en Lydie (Sanhedrin 67a)
Balaam est mis mort par dcapitation ou strangulation ou lapidation ? l'age de 33 ans (Sanhdrin 106b) Jesus doit fuir en Egypte sous le rgne du roi Janas? Il pratique la magie (Sanhedrin 107b)
Ces quelques rfrences parses semblent s'inspirer du Nouveau Testament (largement diffus l'poque de la rdaction du Talmud) en y ajoutant des passages ou des allusions d'autres mythes. Il n'existe pas proprement parler de tmoignage indpendant des sources chrtiennes. Dans le paradigme mythique il est plus que vraisemblable que des variantes du mythe fondateur ont du exister une poque trs recule dont le Talmud se ferait l'cho ce qui expliquerait les diffrents rcits qui nous sont parvenus et qui demeurent incomprhensibles la lumire des autres paradigmes.
Flavius Josphe Introduction Nous arrivons maintenant la "preuve historique" sur les origines du christianisme la plus souvent cite et considre par la plupart des apologistes chrtiens modernes comme le tmoignage indpendant des vangiles le plus important. Flavius Joseph est un historien juif de l'antiquit qui a vcu dans la deuxime moiti du premier sicle et a crit une monumentale histoire du peuple juif dont les deux ouvrages les plus connus sont : Les Antiquits juives et la Guerre des juifs . Travaillant pour le compte des empereurs romains "Flaviens" (Vespasien, Titus et Domitien) il s'est toujours efforc d'adopter un point de vue plutt favorable Rome notamment propos des rvoltes juives qui conduisent la destruction du Temple de Jrusalem. Joseph s'en prend avec virulence tous les agitateurs (les plus connus sont les Zlotes) et prtendus magiciens de l'poque qui provoquent le courroux des autorits romaines et par l mme la ruine de l'tat hbreux. Parmi la trentaine de volumes rdigs par cet historien hors du commun figurent deux passages de quelques lignes sur Jsus dont l'authenticit est discute et discutable. L'essentiel du dbat porte sur la question de savoir si ces passages ont bien t rdigs par Joseph ou sont l'uvre d'un copiste chrtien tardif. L'interpolation comme l'appelle les spcialistes consistant remanier le texte d'un auteur au moment de la recopie du manuscrit (systme en vigueur avant l'invention de l'imprimerie) . Le Testimonium Flavianum Tel est le nom usuellement donn au premier des deux passages des Antiquits juives. Antiquits 18.3.3 : "Maintenant il y avait, en ce temps-l, un certain Jsus, un homme sage, s'il est permis de l'appeler un homme, parce que c'tait un faiseur de miracles, et un enseignant qui enseignait de telle manire que les hommes l'coutaient avec plaisir. Il s'attirait aprs lui,
la fois beaucoup de Juifs, et beaucoup de Gentils. C'tait le Christ, et lorsque Pilate le condamna tre crucifi, la suggestion des principales personnalits parmi nous, ceux qui l'aimrent depuis le dbut ne l'abandonnrent pas; parce qu'il leur apparut de nouveau le troisime jour, comme le leur avaient annonc les prophtes, ainsi que dix mille autres merveilles son sujet. Et la tribu des Chrtiens, ainsi nomms d'aprs son nom, n'est pas encore teinte ce jour." Disons tout de suite que la plupart des historiens considrent que le texte ci dessus qui nous est parvenu n'est pas intgralement de Flavius Josphe. La raison essentielle en est que Josphe tait juif pratiquant et qu'en tant que tel il n'aurait jamais pu dire de Jsus que c'tait le Christ ,qu'il tait ressuscit et que c'tait un faiseur de miracles sans s'tre aprs cela converti au christianisme. D'aucun pense que le texte entier est une interpolation mais l'opinion la plus gnrale reste cependant d'admettre l'authenticit d'une partie plus restreinte du texte qui aurait t "complt" par la suite par un copiste chrtien. Pour confirmer cette thse on cite souvent une deuxime version du passage en question transmise par les arabes et dont le contenu est d'apparence plus conforme ce que Josphe aurait pu dire : (d'aprs l'historien juif Shlomo Pines) Le texte arabe de ce passage apparat dans un manuscrit du Xme sicle Kitab AlUnwan .Voici ce texte : "En ce temps-l, vivait un homme sage qui s'appelait Jsus. Il avait une conduite irrprochable, et il tait connu comme un homme vertueux. Et beaucoup de gens parmi les Juifs et les autres Nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna tre crucifi et mourir. Ceux qui devinrent ses disciples ne cessrent pas de suivre son enseignement. Ils rapportrent qu'il leur tait apparu le troisime jour aprs sa crucifixion et qu'il tait vivant. A ce propos, il tait peut-tre le Messie dont les prophtes avaient rapport les merveilles...". La Question de l'authenticit reste pose donc propos de ce passage .Examinons maintenant les points qui font difficults: Flavius Josphe travaillant pour le compte des empereurs romains et toujours prompt dans ses uvres a critiquer la volont de rbellion de ses compatriotes aurait -il pu faire une exception notable pour Jsus et suggrer comme c'est le cas que celui-ci aurait t injustement condamn la crucifixion par un fonctionnaire romain . Si Flavius Josphe n'a certainement pas dit que Jsus tait le Messie a t -il pu dire nanmoins qu'il tait peut-tre le Messie prenant par l mme fait et cause pour la nouvelle religion chrtienne? La rfrence la plus ancienne concernant ce texte se trouve chez Eusbe de csare (IVme sicle aprs J.C.).Avant lui aucun des Pres de l'glise ne cite le passage. Ni Clment d'Alexandrie, ni Tertullien, ni Cyprien, ni Origne (dans son argumentation avec Celsus) tous si prompts pourtant utiliser toutes les armes concevables afin de convaincre et de convertir les paens. Origne dit de Flavius Josphe que celui-ci n'a pas reconnu que Jsus tait le Messie ce qui prouve au minimum que la phrase en question (quelle que soit la version) est une interpolation.
Deuxime passage des Antiquits Juives Antiquits 20.9.1 "Mais le plus jeune, Anne qui, comme nous l'avons dit, reut la charge de Souverain Sacrificateur, tait aventureux, et d'une dfiance exceptionnelle; il suivit le parti des Sadducens, qui sont trs svres dans leur jugement parmi les Juifs, comme nous l'avons dj montr. Comme Anne avait de telles dispositions, que Festus tait mort, et que Albinus tait encore sur le circuit, il pensa que le moment tait venu d'assembler le conseil des juges, pour faire comparatre devant lui le frre de Jsus, le soi-disant Christ, qui s'appelait Jacques, en mme temps que d'autres. Et aprs les avoir accuss d'avoir enfreint la loi, ils les condamnrent la lapidation.". Parmi les arguments mis en avant pour soutenir l'authenticit de ce passage le principal concerne le fait que l'accent est mis sur Jacques le frre de Jsus et non sur Jsus luimme. L'expression Jsus le soi disant Christ ne pourrait galement tre une interpolation d'un copiste chrtien et enfin le style gnral du texte est bien celui de Josphe. Examinons brivement chacun des points en question. Le fait que le texte parle de Jsus et non de Jacques peut tout simplement signifier que seule le complment de phrase "frre de Jsus, le soi disant Christ" a t rajout ; le texte d'origine pourrait tout simplement parler de Jacques un des fondateurs de l'glise de Jrusalem ? L'expression "le soi-disant Christ" est rendue dans certaines traductions par "Celui qu'on appelle le Christ" et fait cho comme le rappelle E. Doherty au passage dans Matthieu (1.16) : Jsus, qu'on appelle le Christ. Par consquent on voit bien qu'une telle expression peut tout a fait avoir t rajoute sans difficult par un copiste chrtien . Les copistes n'avaient bien entendu aucun mal imiter le style de l'auteur aprs plusieurs centaines de pages recopies. Comme le prcise E.Doherty il pouvait mme s'agir chez eux d'une seconde nature. Pour une analyse plus exhaustive de l'origine probable de ce passage il faut consulter le document de E.Doherty : "Josephus Unbound : Reopening the Josephus Question". L'auteur y explique qu'il existe un troisime passage concernant de nouveau Jacques le "frre de Jsus" qui ne nous est pas parvenu mais qui est cit par Origen et Eusbe . Ce passage contiendrait galement l'expression : "Jsus qu'on appelle le Christ" et expliquerait que le martyr de Jacques a entrain la destruction du temple de Jrusalem en guise de punition divine. Pour E.Doherty il pourrait exister un lien entre ce passage disparu et le passage ci-dessus qui aurait ainsi rcupr la mme interpolation : "frre de Jsus qu'on appelle le Christ". En fait les points les plus marquants a l'encontre de ce passage sont les suivants :
La rfrence au Christ pour parler de Jsus laisse entendre que prcdemment Josphe a dj parl de Jsus en ces termes. Ce pourrait tre le passage 18.3 ;mais on a vus plus haut que ce passage ne contient certainement pas une telle indication (Christ ou Messie). Les Pres de l'glise avant Origen et Eusbe ne mentionnent pas ce passage qui pourtant aurait t fort utile dans les controverses avec les dtracteurs du Christianisme. Conclusion Si Jsus a exist et vcu les vnements dcrits dans les Evangiles il est incomprhensible qu'un des plus grands historiens de l'Antiquit ne lui accorde gure plus qu'une dizaine de lignes perdues dans son uvre par ailleurs gigantesque. Les innombrables miracles accomplis par Jsus ainsi que tous les vnements surnaturels qui accompagnent son ministre jusqu' sa mort et sa rsurrection devant plusieurs tmoins devaient ncessairement tre connus de Josphe qui aurait d de ce fait y consacrer plus de quelques lignes. L'hypothse rationaliste minimale d'un Jsus trs peu connu et plus discret peut bien sur expliquer le peu de place que lui consacre Flavius Josphe mais comme on a dj eu l'occsaion de le prciser cette hypothse est presque indiscernable dans ce contexte de l'hypothse du mythe sans en possder par ailleurs toute la cohrence. Philon d'Alexandrie Philon ft aussi un grand historien et philosophe juif et le seul (parmi les plus connus) qui soit vraiment contemporain de Jsus et de Paul. Philon est n vers 25 avant J.C. et est mort aux alentours de 50 aprs J.C. Son uvre comprend essentiellement des commentaires sur l'Ancien Testament. Trs pris de philosophie grecque (il vit Alexandrie) il est l'un des premiers parler du Logos (le Verbe) comme intermdiaire entre Dieu et les hommes. Il crit galement sur la communaut des Essniens sur laquelle s'exprimera galement Flavius Josphe. Historien, philosophe et observateur de son poque Philon ne dit pas un mot sur Jsus de Nazareth ou les premiers chrtiens. Il n'est pas sur qu'il se soir rendu en Palestine mais son uvre sur les Essniens montre qu'il s'intresse de prs tout ce qui touche sa Patrie toute proche. Si Jsus est le personnage renomm dpeint par les Evangiles il est plus que surprenant que Philon n'en ai jamais entendu parl. Les nombreux miracles accomplis par Jsus devant des multitudes devaient ncessairement tre transmis de bouche oreille par des juifs se rendant Alexandrie. On a mentionn plus haut l'incroyable vitesse avec laquelle se seraient rpandues les ides ainsi que les premires communauts chrtiennes dans tout le bassin mditerranen partir du foyer fondateur reprsent par Jsus et les douze aptres de Jrusalem.
Ce phnomne au demeurant si nigmatique ne s'accorde pas vraiment avec l'absence totale d'information dont semble disposer Philon propos de ce mouvement naissant et surtout de son fondateur. Encore une fois seule la thse du mythe donne une explication satisfaisante ce silence. Pour les partisans du paradigme rationaliste il faut admettre une fois de plus que l'existence de Jsus ft contre tout tmoignage vanglique d'une discrtion totale. Thallus Thallus est prsent par beaucoup d'apologistes chrtiens modernes comme un personnage contemporain du Christ qui aurait tmoign de l'incroyable obscurit survenue au moment de la crucifixion et relate dans les vangiles synoptiques. Une analyse assez complte de ce "tmoignage" est disponible en anglais [R.Carrier]. Le rsum qui suit s'en inspire largement avec quelques hypothses supplmentaires pour la discussion: Thallus est un "historien/chroniqueur" de l'Antiquit qui crivit sur de nombreux vnements passs ou contemporains ? Son uvre comprendrait les "Histoires" et le "Bref Compendum" tel que rapports par les pres de l'Eglise qui se sont intress ses crits. Les crits de Thallus ,notamment ceux qui se rapportent aux vnements qui nous intressent sont cits par G.Syncellus (9me sicle) et Eusbe (4me sicle) eux mmes citant Jules l'Africain (3me sicle).La source de la rfrence est donc passablement indirecte pour un tmoignage ayant vocation servir de preuve aux rcits vangliques. On ne sait pas exactement quand Thallus a crit ce qu'il aurait crit! Les seules rfrences dates sur son uvre (Le bref Compendum) renvoient la priode allant de 1184 avant J.C. (Chute de Troie) 109 avant J.C. R.Carrier fait l'hypothse que Thallus a crit au 2me sicle mais confesse que toute priode allant de 109 avant J.C. au 2me sicle est possible. Flavius Joseph aurait parl de Thallus personnage samaritain ayant vcu sous le rgne de l'empereur Tibre. Cette rfrence qui date du 18me sicle positionnerait Thallus dfinitivement au 1er sicle de notre re. En fait le passage de Josphe ne comprend pas explicitement le nom de Thallus qui aurait t "conjectur par un dnomm Hudson donnant ainsi toute sa consistance au tmoignage en question." Le passage rapport par Jules l'africain est le suivant :
<< Thallus appelle cette obscurit une clipse de soleil dans le troisime livre de ses Histoires, cela sans raison apparente. Car comment peut-on croire une clipse de soleil lorsque la lune est situe l'oppos de
celui-ci.>>Ainsi Jules l'Africain semble se moquer de la confusion que Thallus fait entre une clipse et cette obscurit exceptionnelle qui ne peut tre que d'origine divine. Plus loin dans le mme passage Jules l'Africain cite un autre auteur : Phlgon qui lui aussi aurait remarqu l'obscurit : <<Phlegon rapporte qu'aux temps de Tibre une clipse totale eu lieu pendant la pleine lune et dura de la sixime la neuvime heure>>.La citation de Phlgon ne correspond pas du tout celle rapporte par Eusbe de Csare qui lui aussi cite ce mme auteur: << Alors ,dans la quatrime anne de la 202me olympiade (32 aprs J.C.) se produisit une magnifique clipse de soleil la sixime heure qui surpassa toutes les prcdentes et produisit une telle obscurit que l'on pouvait distinguer les toiles dans le ciel; la terre bougea Bythynia renversant plusieurs constructions dans la ville de Nicaea.>>.Il semble que Phlgon est fait mention d'une clipse accompagne d'un tremblement de Terre sur la cte de la mer noire sans rapport apparent avec les vnements supposs contemporains de Jrusalem. Cette citation plus crdible affaiblit considrablement la rfrence rapport par Jules l'Africain sur Phlgon et par la mme le passage correspondant sur Thallus.
Conclusion : En dfinitive il semble que le tmoignage de Thallus ne pse pas bien lourd sur la balance de l'histoire eu gard toutes les questions qu'il soulve. Il semble nanmoins probable (c'est mon hypothse) que seul le tmoignage de Phlgon tel que rapport par Eusbe de Csare soit historiquement valable. Cette clipse accompagne d'un tremblement de terre aurait alors inspir les auteurs des vangiles en qute d'un dcor sur mesure pour le tableau de la crucifixion. Car il ne faut pas oublier que si cette "incroyable" obscurit s'tait rellement produite comme relate dans les vangiles celle-ci n'aurait pas manqu d'attirer l'attention des historiens rputs de l'poque qui tel Snque ou Pline notait scrupuleusement tout vnement naturel un temps soit peu remarquable. La citation de Thallus dcoule alors sans doute de celle de Phlgon; les deux auraient d'ailleurs pu tre confondues par les moines copistes (supposition de R.Carrier).Ou bien Thallus a crit au deuxime sicle une poque o le rcit vanglique commence circuler dans les milieux chrtiens. Les Manuscrits de la mer morte
Ces manuscrits dcouverts dans des grottes prs du site de Qumram en 1947 constituent les documents les plus anciens jamais retrouvs concernant le judasme. La plupart de ces parchemins renferment des extraits des textes de l'Ancien testament. Ces manuscrits auraient t rdigs par des membres de la secte des Essniens vivant sur le site de Qumram (Selon d'autres auteurs certains manuscrits pourraient avoir une autre origine : Zlotes ?) Les Essniens taient avec les Pharisiens et les Saduccens une des trois composantes majeures du Judasme l'poque de Jsus. Certains des manuscrits ont t dcouverts bien avant 1947:Le document de Damas par exemple a t dcouvert vers la
fin du dix neuvime sicle. Origen cite une traduction de la bible en grecque qui aurait t dcouverte dans une jarre prs de Jricho Rsumons brivement les lments d'information fiables concernant ces manuscrits : Les datations effectues sur des bouts de papyrus par spectromtrie de masse au carbone 14 montrent que ceux-ci remontent approximativement au 1er et 2me sicle avant J.C. Cependant cette datation ne concernant que le support lui mme laisse subsister le doute sur la priode relle d'criture qui pourrait ainsi selon certains experts tre beaucoup plus tardive (aux alentours de l'an 0).Toutefois les dates indiques par l'analyse au carbone 14 semblent correspondre celles issues des tudes palographiques menes par ailleurs. Certains passages comportent des analogies avec le contenu du message chrtien montrant ainsi que la communaut des Essniens a pu jouer un rle dans la naissance du christianisme. Aucun des textes retrouvs ne parle de Jsus ni des Aptres. Cela peut s'expliquer soit par la date de rdaction antrieure l'poque qui nous intresse (2me sicle avant J.C) soit par l'absence dans l'histoire relle des personnages en question. Un des manuscrits appel le manuscrit de Damas parle d'un Matre de Justice que certains identifient Jsus ou bien son frre Jacques (Pr Eisenman).
En conclusion on voit que malgr toute la mdiatisation faite autour de ces manuscrits ceux-ci ne nous apprennent pour l'instant quasiment rien sur la naissance du christianisme ni sur la personne de Jsus. 11 COMPARAISON AVEC D'AUTRES MYTHES Une caractristique essentielle d'un mythe est bien souvent d'tre issu d'un fond commun de croyances et de prsenter en cela de nombreuses analogies avec d'autres mythes issus du mme fond. Contrairement un fait historique dont la singularit confre l'authenticit, "l'lment d'histoire mythique" tient plutt de la compilation d'histoires ou de portraits. Jules csar, Alexandre le Grand ou Bonaparte sont des personnages uniques aux biographies non superposables. Il semble bien qu'il en soit autrement pour Jsus Christ. C'est la thse gnrale dfendue par plusieurs personnes et notamment sur Internet par S. Acharia et K.Graves. Selon ces auteurs certains faits marquants de la vie de Jsus se retrouvent tels quels dans les biographies d'autres personnages divins de l'antiquit. Les plus connus sont : Horus (Egypte)
Promthe (Grce) Krishna (Inde) Buddha (Inde) Mithra (Perse)
Les points communs marquants seraient (toujours selon ces auteurs ) : La naissance virginale La date de naissance fixe au 25 dcembre Le Qualificatif de Fils de Dieu et Sauveur de l'Humanit La Crucifixion suivie d'une Rsurrection Les disciples (souvent 12) Les miracles La Compassion envers le reste de l'Humanit
L'tude dtaille de cette thse est disponible sur les sites Internet des deux auteurs cits. Malheureusement il est trs difficile de contrler dans le dtail les points mis en avant, les sources cites tant le plus souvent invrifiables.
Une comparaison plus facile est gnralement faite entre le christianisme et le Mithraisme. Les deux religions ont t un moment en concurrence sous l'empire Romain jusqu' ce que le Christianisme devienne la religion officielle de l'Empire . On retrouve ainsi chez les fidles du culte de Mithra la crmonie du repas partag avec les symboles du pain et du vin comme dans la Cne des chrtiens. La date du 25 Dcembre fixe tardivement par les autorits ecclsiastiques comme jour de la naissance du Christ est trs certainement emprunte au culte de Mithra. Cette date qui comme le remarque les auteurs cits ci-dessus a une signification astronomique vidente (nouvelle ascension du soleil dans le ciel 3 jours aprs le solstice d'hiver) n'a pas t choisie au hasard pour symboliser la naissance du dieu sauveur. 12 CONCLUSION PROVISOIRE En guise de conclusion on peut rappeler les points les suivants :
Il n'existe pas de preuves historiques srieuses et irrfutables de l'existence de Jsus La vie de Jsus est plus proche du mythe que de l'histoire mme revisite selon nos critres modernes Les Evangiles contiennent tant de contradictions et d'invraisemblances qu'il ne sauraient reprsenter une source scientifiquement valable sur le Jsus de l'histoire. L'histoire du dveloppement de l'Eglise montre plutt une construction progressive du dogme que la transmission d'un hritage historique bien prcis. Paul qui est le personnage chrtien le plus ancr dans l'histoire ne parle aucun moment du Jsus de Nazareth dpeint par les vangiles. Son silence sur la vie de Jsus est plus loquent que tout le reste. Son Christ ne se rattache aucun personnage historique prcis. Le paradigme chrtien est le seul pouvoir expliquer de manire cohrente l'ensemble des miracles et des actes surnaturels prsents dans les vangiles. Si Jsus est le fils de Dieu alors bien sur il a pu vivre une vie semblable celle raconte par les vanglistes. Pour autant il reste expliquer dans ce cas les contradictions entre les quatre rcits vangliques. Il faut expliquer aussi les silences des historiens de l'poque sur Jsus qui ayant vraiment accompli tous ces miracles aurait du tre ncessairement remarqu des intellectuels de son poque(philosophes, historiens, hommes politiques etc).Contre ce paradigme galement un simple argument logique et de bon sens: Jsus, fils de Dieu aurait pu venir sur Terre a n'importe qu'elle poque; les malheurs qui frappent notre bonne vieille plante ne datant pas d'hier sa prsence aurait t justifie tout au long de l'histoire de l'humanit. Hors voil qu'il apparat justement au moment le plus vraisemblable : Tout le monde attend et espre un Messie, un Sauveur. En ce premier sicle de notre re la venue d'un tel personnage est considre en Palestine comme imminente et les signes accompagnant sa venue sont bien connus de tous. Dans ce contexte comment faire la diffrence entre l'existence relle d'un personnage remplissant par ses actes toutes les prophties des critures et l'invention pure et simple du dit personnage pour donner corps au mythe. Le paradigme rationaliste doit pour rester cohrent rejeter la plus grande partie des faits relatifs l'histoire de Jsus. Tous les vnements surnaturels tant exclus par dfinition d'une grille de lecture rationnelle de la Bible. La tentative de rinterprtation rationnelle des vnements miraculeux par certains auteurs est trop invraisemblable et improbable pour y accorder un quelconque crdit. Le Jsus qui reste aprs cette analyse est alors bien diffrent de celui des vangiles et a tout jamais inconnaissable .Malgr toutes les tentatives de biographies pseudo-historiques tires des vangiles et quel que soit le talent de leurs auteurs Jsus demeure un personnage "sur-humain" qui ne ressemble aucun philosophe ou sage de l'Antiquit. Ses actes et ses paroles rapports par les vangiles en font un personnage irrel qui agit selon un destin qu'il semble tout la fois connatre (puisqui'il est le fils de Dieu et donc divin lui aussi) et redouter ou ne pas comprendre (cf. ses dernires paroles sur la croix).
Enfin le paradigme mythique est le seul capable de garantir une cohrence maximale entre tous les faits passs au crible de l'analyse historique. Toutes les pices du puzzle s'agencent parfaitement dans cette hypothse qui devient ainsi la plus probable mme si aucune preuve absolue n'existe pour la consacrer dfinitivement.
13 ANNEXE : DOCUMENTATION Paradigme chrtien
Josh Mac Dowell : Evidence that demand a verdict Jacques Duquesne : Jsus (DDB-Flammarion, d. poche J'ai lu) Ernest Renan :Vie de Jsus (Paris: Michel Levy Frres, 1863, "Introduction", 9e dition), Blaise Pascal : Abrg de la vie de Jsus Christ (Descle de Brouwer )
Paradigme rationaliste
Grald Messadi : L'Homme qui devint Dieu (Broch 1988) : Jsus de Srinagar (Poche) Jeffery Jay Lowder : http://www.infidels.org/library/modern/jeff_lowder/jury/chap5.html
Paradigme mystique : http://www.magi.com/~oblio/jesus/home.htm
Earl Doherty
James Still : http://www.infidels.org/library/modern/james_still/jesus_search.html S.Acharya G. Stein K.Graves G.A.Wells : http://www.truthbeknown.com/christ3.htm : http://www.infidels.org/library/modern/gordon_stein/jesus.html : http://www.infidels.org/library/historical/kersey_graves/16/ : Did Jesus Exist (Paperback 1987)
Documentation gnrale
http://www.ccel.org/ http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html#fathers http://www.qtm.net/~trowbridge/NT_Hist.htm Bible de Jrusalem (Ed. Poche) http://www.hrnet.fr/~dupuypas/Apocryphes/Les_Apocryphes_NT_tableau.htm http://religion.rutgers.edu/jseminar/index.html
RETOUR A LA TABLE DES MATIERES
Vous aimerez peut-être aussi
- Poison BlancDocument446 pagesPoison BlancEdden Ahaut Fred Akichi100% (4)
- Histoire de Le Eglise A SavoirDocument488 pagesHistoire de Le Eglise A SavoirMouanga Lino100% (1)
- Parlons BaouléDocument198 pagesParlons BaouléEdden Ahaut Fred Akichi100% (2)
- The Isis PapersDocument130 pagesThe Isis PapersEdden Ahaut Fred Akichi88% (8)
- La Douzième PlanèteDocument370 pagesLa Douzième PlanèteEdden Ahaut Fred Akichi100% (3)
- Roger Vigneron ElohimDocument277 pagesRoger Vigneron ElohimEmo Risaliti100% (1)
- Jésus Et La Loi PDFDocument292 pagesJésus Et La Loi PDFAdony Ndinga NdingaPas encore d'évaluation
- 1-Plan Et But de DieuDocument238 pages1-Plan Et But de DieuAnonymous 25kIbDPas encore d'évaluation
- Le Christianisme Occidental À L'épreuve de MessianismesDocument31 pagesLe Christianisme Occidental À L'épreuve de MessianismesDEAPas encore d'évaluation
- MILLENIUMDocument6 pagesMILLENIUMrosibeautePas encore d'évaluation
- FR Parole Eternelle Vert1 LucDocument73 pagesFR Parole Eternelle Vert1 LucAurélien HaddadPas encore d'évaluation
- Le Mystère de MarieDocument15 pagesLe Mystère de MarieKomlan Jérémi AtamekloPas encore d'évaluation
- 18 Yehoshua PDFDocument136 pages18 Yehoshua PDFnepherPas encore d'évaluation
- Dieu Créateur Du Ciel Et de La TerreDocument16 pagesDieu Créateur Du Ciel Et de La TerreFranck Kpt100% (1)
- L Hermeneutique Spirituelle Chez SwedenborgDocument30 pagesL Hermeneutique Spirituelle Chez SwedenborgLena Magodtt100% (1)
- Is (CHS) - Instruction Pour Un Service Chretien EffectifDocument293 pagesIs (CHS) - Instruction Pour Un Service Chretien Effectifemiletambwe21100% (1)
- Notes de Séminaire Sur L'interpretation de La Bible PDFDocument222 pagesNotes de Séminaire Sur L'interpretation de La Bible PDFJeanWilliamPierre50% (2)
- Le Pape Noir Des Jésuites Partie 1Document7 pagesLe Pape Noir Des Jésuites Partie 1C1rt0uche123 CartouchePas encore d'évaluation
- La Vie de Jesus - Livre Numerique 2021Document24 pagesLa Vie de Jesus - Livre Numerique 2021guillaume molinski100% (1)
- Feu BibleDocument93 pagesFeu BibleFolsonPas encore d'évaluation
- Fausse Doctrine EnlevementDocument98 pagesFausse Doctrine Enlevementkouadio yao ArmandPas encore d'évaluation
- La Naissance de Jesus Legende Ou Fait HiDocument21 pagesLa Naissance de Jesus Legende Ou Fait HiSylvain SeglaPas encore d'évaluation
- Haiti Couleurs Croyances CreoleDocument338 pagesHaiti Couleurs Croyances CreoleMargotinePas encore d'évaluation
- Le Signe de Caïn-4Document18 pagesLe Signe de Caïn-4yeno100% (1)
- La Vérité Sur L'après Vatican II - Frères Dimond Tome 1 PDFDocument300 pagesLa Vérité Sur L'après Vatican II - Frères Dimond Tome 1 PDFPour La NationPas encore d'évaluation
- Evangiles ApocryphesDocument13 pagesEvangiles Apocryphesheros doubsPas encore d'évaluation
- 25431-OLIVIER BACH-Dieu Et Les Religions A Lepreuve Des Faits - (InLibroVeritas - Net)Document420 pages25431-OLIVIER BACH-Dieu Et Les Religions A Lepreuve Des Faits - (InLibroVeritas - Net)Isabelle PiconPas encore d'évaluation
- Exposé Sur Josué2022Document6 pagesExposé Sur Josué2022Enoc Mora100% (2)
- Mémoire CorrigéDocument40 pagesMémoire CorrigéAlan Christian EkwallaPas encore d'évaluation
- Bible de L'épée 2010, Version LeducDocument1 366 pagesBible de L'épée 2010, Version LeducJean leDuc100% (2)
- Hommes Femmes EdenDocument84 pagesHommes Femmes EdenBienvenu Best ParsyPas encore d'évaluation
- Les Quatre DoctrinesDocument392 pagesLes Quatre DoctrinesGilbertPas encore d'évaluation
- Historacles Et Prophetie 2Document32 pagesHistoracles Et Prophetie 2tifus1410100% (1)
- La Clef Des SongesDocument422 pagesLa Clef Des SongesVincent TnecnivPas encore d'évaluation
- Lettre D'Elie Lescot Approuvant La Campagne Anti-Vodou en HaïtiDocument9 pagesLettre D'Elie Lescot Approuvant La Campagne Anti-Vodou en Haïticlaro legerPas encore d'évaluation
- Textes Apocryphes Sur Marie MadeleineDocument3 pagesTextes Apocryphes Sur Marie MadeleineepoptaePas encore d'évaluation
- Le Cycle D'abraham PDFDocument22 pagesLe Cycle D'abraham PDFabbraxasPas encore d'évaluation
- Le Role de La FemmeDocument3 pagesLe Role de La FemmeYeshoua HoldingPas encore d'évaluation
- Le Lavement Des PiedsDocument6 pagesLe Lavement Des PiedsmerlinoutPas encore d'évaluation
- Memoire de Licence Théologique - Docx CORRIGERDocument30 pagesMemoire de Licence Théologique - Docx CORRIGERMinakpon AndréPas encore d'évaluation
- Témoignage de Tom, Ex Franc-Maçon Sauvé Par Jésus-ChristDocument5 pagesTémoignage de Tom, Ex Franc-Maçon Sauvé Par Jésus-ChristTatywata Unkisy-MashyPas encore d'évaluation
- FR - Parole - Eternelle - Bleu2 - Bible FamilleDocument92 pagesFR - Parole - Eternelle - Bleu2 - Bible FamilleAurélien HaddadPas encore d'évaluation
- CONNAISSANCE DES GROUPES BIBLIQUES (GB) - CopieDocument65 pagesCONNAISSANCE DES GROUPES BIBLIQUES (GB) - CopieJoseph LankoandePas encore d'évaluation
- 01 Israël Et Les 7 Evidences Bibliques Et Prophetiques Pour Notre TempsDocument17 pages01 Israël Et Les 7 Evidences Bibliques Et Prophetiques Pour Notre TempsYeshoua HoldingPas encore d'évaluation
- Enlevement 02Document14 pagesEnlevement 02Jean-LucPas encore d'évaluation
- 2021 FTL Écrits JohanniquesDocument28 pages2021 FTL Écrits JohanniquesBrou Cédrick ATSE100% (1)
- Les Sept Conciles OecuméniquesDocument99 pagesLes Sept Conciles OecuméniquesspiennaPas encore d'évaluation
- Caïn Mon FrèreDocument9 pagesCaïn Mon FrèreTantely RamaromiantsoPas encore d'évaluation
- 2 Theologie CoursDocument745 pages2 Theologie CoursAurélien Haddad100% (2)
- Histoire Et Sagesse D'ahikar L'assyrienDocument370 pagesHistoire Et Sagesse D'ahikar L'assyrienJean De CompostellePas encore d'évaluation
- Canevas Des Etudes Bibliques 2021-2022Document45 pagesCanevas Des Etudes Bibliques 2021-2022ybe100% (1)
- 0235fr PDFDocument137 pages0235fr PDFEmpire LucienPas encore d'évaluation
- Cahiers Eudiste - Doctorado San Juan Eudes - La Formation de Jesus Dans NosDocument243 pagesCahiers Eudiste - Doctorado San Juan Eudes - La Formation de Jesus Dans NosCergio Becerra MartinezPas encore d'évaluation
- Jésus Et Le FiguierDocument2 pagesJésus Et Le FiguierJon JayPas encore d'évaluation
- Jésus Guérit Un Sourd-MuetDocument5 pagesJésus Guérit Un Sourd-MuetBORISPas encore d'évaluation
- Vers La Source - Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov - Oeuvres ComplètesDocument1 pageVers La Source - Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov - Oeuvres ComplètesOrphée LebonguiPas encore d'évaluation
- Le Systeme de Protection de Le Enfant in HaitiDocument91 pagesLe Systeme de Protection de Le Enfant in HaitiVitam Noel100% (1)
- La Grande TragédieDocument36 pagesLa Grande TragédieJelzz100% (3)
- Job, La Foi Et La Souffrance - Ian Flanders - 230716 - 173200Document33 pagesJob, La Foi Et La Souffrance - Ian Flanders - 230716 - 173200Chris LouisPas encore d'évaluation
- Eschatologie Dans La Bible Et Chez Les PeresDocument36 pagesEschatologie Dans La Bible Et Chez Les PeresebaPas encore d'évaluation
- Revelation de La Volonté de DieuDocument1 pageRevelation de La Volonté de DieuMo le ModestePas encore d'évaluation
- Fiche Bible 133 Jésus Envoie Ses Disciples en Mission PDFDocument2 pagesFiche Bible 133 Jésus Envoie Ses Disciples en Mission PDFCocoPas encore d'évaluation
- Scandale et mystère: Cinq approches de la vérité révélée en Jésus, Christ Roi, Dieu fait hommeD'EverandScandale et mystère: Cinq approches de la vérité révélée en Jésus, Christ Roi, Dieu fait hommePas encore d'évaluation
- Jean : l'évangile en filet: L'oralité méconnue d'un texte à vivreD'EverandJean : l'évangile en filet: L'oralité méconnue d'un texte à vivrePas encore d'évaluation
- Le Savoir Égyptien - (Science Et Vie 2009)Document57 pagesLe Savoir Égyptien - (Science Et Vie 2009)Edden Ahaut Fred Akichi100% (2)
- 43 Flavius Josephe Antiquites JudaiquesDocument1 961 pages43 Flavius Josephe Antiquites JudaiquesCelestin RengnezPas encore d'évaluation
- L'Évangile Selon Les ProphètesDocument441 pagesL'Évangile Selon Les ProphètesLuc MARINPas encore d'évaluation
- L'Évangile Selon L'olivierDocument452 pagesL'Évangile Selon L'olivierLuc MARINPas encore d'évaluation
- L'enigme Jésus - Patrick DupuisDocument44 pagesL'enigme Jésus - Patrick DupuisEdden Ahaut Fred AkichiPas encore d'évaluation
- Réponse À 5 Théories Sur Jésus Christ PDFDocument25 pagesRéponse À 5 Théories Sur Jésus Christ PDFAnonymous uizzppxufPas encore d'évaluation