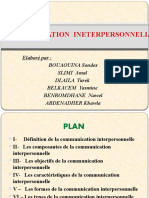Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Dire La Pratique, Savoir de La Pratique
Dire La Pratique, Savoir de La Pratique
Transféré par
almoiseCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Dire La Pratique, Savoir de La Pratique
Dire La Pratique, Savoir de La Pratique
Transféré par
almoiseDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cahiers de la recherche en ducation, vol. 2, no 1, 1995, p.
39 56
Dire la pratique, savoir de la pratique
Adle Chen Universit de Montral Rsum partir dune pratique universitaire en formation de formateurs dadultes, lautrice rflchit sur les possibilits quoffre la mthode des cas pour construire le savoir de la pratique professionnelle et pour le lgitimer. Elle prsente le dispositif pdagogique, lui associe la comprhension des savoirs en jeu dans laction et trouve des appuis thoriques pour nommer ces savoirs. Enfin, elle adopte le cadre pistmologique du constructivisme discursif et cherche explorer le potentiel de la mthode des cas, considre comme dispositif dexpression, dcoute et de partage de messages au sujet de la pratique professionnelle.
Introduction La mthode des cas est actuellement prconise dans le cadre des formations professionnelles universitaires et elle est souvent prsente, comme lapproche par problme, comme transformant radicalement et les programmes et lenseignement. On vante son mrite de rapprocher de la pratique autant que de tracer une voie privilgie pour comprendre la thorie. Comme, depuis longtemps dj, le rapport entre la thorie et la pratique a t un objet de la rflexion pistmolo-
40
Cahiers de la recherche en ducation
gique et que, actuellement, les positions sur la connaissance sont multiples, se partageant entre la vision plus traditionnelle du savoir comme reprsentation du monde et dautres visions, plus ou moins radicales, attribuant un rle central aux circonstances socioculturelles ou au langage, on peut se demander quoi tient la vertu spcifique de la mthode des cas laquelle on accorde une place de plus en plus importante dans lenseignement. Nous avons donc entrepris de rflchir sur la mthode des cas, aprs lavoir exprimente dans le cadre dun enseignement professionnel universitaire, plus prcisment en formation de formateurs dadultes1. Cette rflexion effectue en quelque sorte un retour sur une pratique, pour en comprendre le potentiel autant que le bien-fond. Ce qui nous proccupe plus particulirement est le savoir auquel donnent accs les rcits de pratique. Il nous semble en effet quil soit possible avec la mthode de faire merger dans la situation de formation ces savoirs qui, en amont ou en aval des rcits de pratique professionnelle, ont servi ou serviront laction et conserveront leur signification dans des situations encore indites. Notre rflexion comporte trois parties. Dans la premire, nous faisons tat dune pratique pdagogique qui vise une rflexion sur laction de formation. Dans la deuxime, nous cherchons voir comment la rdaction et la discussion de rcits de pratique permettent de faire merger les savoirs en jeu dans laction. Dans la troisime, nous tentons de comprendre comment, dans lespace de la formation des formateurs dadultes, les savoirs lis la pratique peuvent se construire et se lgitimer.
1. Un dispositif de mise en rcit de la pratique : la mthode des cas En tant que pratique sociale, la formation de formateurs peut, avec des dispositifs pdagogiques appropris selon les publics et les objectifs viss, offrir un espace privilgi lmergence et la consolidation de savoirs. Aussi, dans le cadre de deux cours sur la nature de la formation continue et cherchant, entre autres objectifs des cours, contextualiser les pratiques et dvelopper une comprhen-
Notre rflexion est seconde par rapport celle des groupes-classes ETA 4610/A94 et ETA 6600/A94, laquelle nous avons particip et que nous amenons avec nous, bien simplement, hors de la classe. Nous voulons remercier nos collgues Marie-Franoise Legendre et mile Ollivier de la lecture critique quils ont accept de faire de la premire version de ce texte.
Dire la pratique, savoir de la pratique
41
sion de laction de formation, nous avons rcemment opt de recourir la mthode des cas. La mthode des cas consiste amener un groupe se pencher sur une situation problmatique partir du rcit qui en est fait. Le rcit raconte une situation vcue, dans laquelle un moment critique appelle une dcision. Le cas peut tre retenu dun corpus en fonction du thme ou des principes ltude, mais la rdaction du cas peut aussi tre incluse dans la mthode. Aprs avoir pris connaissance du rcit et en avoir analys les lments problmatiques, on explore les solutions les plus efficaces, ralistes et pertinentes possible, puis on formule les rgles ou les principes qui les expliquent ou les justifient. En conclusion de la discussion, on dgage des principes plus gnraux qui pourraient valoir dans des situations analogues. Un rapport crit dans lequel on retient et approfondit les diffrents lments de la discussion vient complter ltude du cas. En optant pour la mthode des cas, notre intention premire tait dassurer un point de contact des participants avec le monde de la formation des adultes, tel quils se le reprsentent aujourdhui et quils sy voient confronts. Comme il nexiste pas de corpus de cas constitu dans le domaine de la formation professionnelle des formateurs dadultes, il fallait commencer par rdiger les cas2. tant donn lhtrognit des domaines de pratique dans les groupes, il allait de soi que les situations choisies seraient varies, ce qui prsentait galement un avantage didactique pour les personnes en formation. Devant composer avec les contraintes de temps, la dimension des groupes-classes et le niveau des programmes, nous avons choisi dajuster diffremment dans les deux groupes les modalits de ralisation de la mthode. Ainsi, dans le premier groupe-classe, compos de trente-cinq personnes inscrites un programme de premier cycle, chaque personne a rdig un rcit de pratique, la analys et discut dans un petit sous-groupe de trois ou quatre personnes, puis en a rdig lanalyse. Dans le second groupe-classe, compos de dix-huit tudiants et tudiantes de deuxime et de troisime cycle, cinq sous-groupes
Selon Blondin (1994), il est plutt exceptionnel que les tudiants rdigent eux-mmes les cas. Dans lexemple quil rapporte, la rdaction des cas se fait en petits groupes, sous la supervision des professeurs, et elle constitue une tape importante de leur formation. De son ct, Wasserman (1993) considre lexercice trs formateur, en ce quil force lauteur se mettre distance de sa pratique et devenir critique.
42
Cahiers de la recherche en ducation
de trois ou quatre personnes ont travaill la rdaction dun cas, puis les rcits ont t soumis lensemble du groupe pour analyse et discussion; il avait t entendu davance que la rdaction finale porterait sur un des cinq cas, choisi au hasard. Nous avons donn aux deux groupes-classes la mme information sur la mthode et les mmes consignes relatives la procdure3. Pour le choix du cas, il fallait sappuyer sur son exprience en formation des adultes, cest--dire puiser, dans des situations vcues, une squence particulirement difficile o une dcision simposait. Par la suite, on devait raconter la situation dans un rcit bref et vivant, en prenant le soin de prsenter les faits retenus de manire prcise et objective4. Quant la discussion, aprs avoir identifi les lments cls du rcit et aprs avoir analys les aspects problmatiques, il fallait proposer des solutions possibles, leurs avantages et leurs inconvnients, en les appuyant sur des principes tirs de lexprience ou de la thorie pour, enfin, retenir quelques principes plus gnraux, valables dans dautres situations. Les rcits recueillis tmoignent dune varit de proccupations. Mentionnons, entre autres difficults, lajustement la demande dun groupe, les dmarches conscutives lvaluation dun formateur, lempchement dexcuter un programme prvu, lhtrognit des apprenants, la confrontation des schmes culturels non familiers, la contestation larve et le manque de support de ses suprieurs, le plagiat, la gestion du dveloppement des ressources humaines, les occurrences les plus frquentes mettant en scne ladaptation au rythme dapprentissage des adultes et des comportements perturbateurs ou contestataires dans un groupe dapprenants.
3 4
Pour prparer les consignes, nous nous sommes inspire des sources suivantes : Blondin (1994), Mucchielli (1987) et Poisson (1992). Nous avons galement consult Blondin, que nous remercions de son conseil. Par souci de simplification et dconomie, nous avions limit le texte une page. En mme temps, nous pensions favoriser une analyse plus approfondie et un resserrement des lments significatifs au moment de la rdaction. Quelques participants ont critiqu cette contrainte parce quils avaient d vacuer des dtails de situation qui se sont avrs utiles au moment de lanalyse. La discrimination entre lessentiel et laccessoire au moment de reconstruire la situation et de lanalyser nous semble ici entrer en jeu. Selon Van Stappen (1989), le texte dun cas peut aller de huit quinze pages, mais il peut tre appropri, pour le milieu collgial par exemple, de le rduire quelques pages seulement. Il va sans dire que le temps requis pour la discussion sera beaucoup plus long si le texte est plus long et linformation plus complexe.
Dire la pratique, savoir de la pratique
43
Le feedback des participants et lanalyse des rsultats ont confirm les vertus de la mthode. Dune part, lintrt a t manifeste et limplication, relle, tant au moment de la rdaction qu celui de la discussion; lengagement communiquer aux autres le rcit de son cas a sembl commander un engagement rciproque en discuter et le plaisir dapprofondir une exprience qui avait laiss des insatisfactions ou des incertitudes navait dgal que celui de dcouvrir la multiplicit des perspectives et des interprtations pour une mme situation raconte, et de se sentir partie prenante dans lissue envisage. Dautre part, dans la dynamique de la discussion, les points de vue ont pris forme travers la parole et les manires de dire sont demeures celles du langage courant. Par exemple, le mme problme pouvait tre engendr par un adulte rcalcitrant ou par un formateur autoritaire, la fermet simposait autant que la souplesse, les compromis se construisaient en prenant en compte les contraintes du contexte et le souci envers ladulte en difficult; on se proccupait de la transformation des personnes sans pour autant oublier les effets structurants de la dynamique organisationnelle et la solution se justifiait quand elle ne simposait pas tout simplement par intuition. La discussion des solutions possibles na pas men ncessairement un consensus, celui-ci pouvant se dstabiliser avec un regard pos sur lenvers du problme, et les solutions souhaitables se sont construites avec lanticipation de rsultats positifs lpreuve de laction. Les participants ont aussi pu se rendre compte que, si la discussion allait et venait entre des notions et la situation concrte, ils se voyaient avant tout mobiliss par les exigences de la dlibration autour de la meilleure conduite adopter en tant que formateur. Enfin, la rdaction finale a permis chacun de faire le point de manire personnelle sur la situation raconte, de communiquer sa comprhension des choses et des personnes, son option et son intention daction.
2. Le rcit de pratique, ancrage la construction dun systme de savoirs La mthode des cas est un moyen pdagogique qui favorise la comprhension des pratiques en engageant la mise en rcit, lanalyse et la discussion de situations professionnelles. Cette entreprise requiert tout le moins quatre types de comptences : 1) une comptence langagire, cest--dire non seulement une capacit gnrale utiliser le langage, mais aussi une aptitude traduire avec des catgories com-
44
Cahiers de la recherche en ducation
prhensibles lanalyse dune situation problmatique et des solutions possibles, et comprendre le discours des autres, 2) une disposition affective engager un dialogue, celle-ci supposant son tour lauthenticit ainsi que la confiance vis--vis de linterlocuteur, 3) une capacit imaginer un tat autre, celui qui donne sens au changement vis dans laction et, 4) une comprhension de lenjeu de laction, des tats, des sentiments, des ides, des intentions en cause. cette comprhension qui est nettement dordre cognitif, nous aimerions accorder plus dattention, dabord en montrant comment nous lassocions au savoir en usage et, plus particulirement, au savoir pratique qui en fait partie intgrante. Nous nous rfrons ici la totalit des savoirs qui rgissent laction, telle que la dsigne Malglaive (1990, 86) en parlant de savoir en usage. Le savoir en usage correspond au savoir de la pratique5 et il est constitu dun ensemble de savoirs, mis diffremment contribution dans la pratique et selon une dynamique propre une action dans une situation donne. Selon Malglaive, le savoir en usage peut se dcomposer en deux grandes catgories, les savoirs qui peuvent sinvestir dans laction et les savoirs qui peuvent se formaliser dans le discours. Ces savoirs se subdivisent leur tour. Dun ct, les savoirs thoriques permettent de connatre lobjet et les savoirs procduraux prcisent les faons de faire; de lautre, les savoirs qui sagissent plus quils ne se disent comprennent les savoirs pratiques, directement lis laction et donnant du rel une connaissance contingente mais souvent efficace loprationalit de lacte, et les savoir-faire moteurs ou intellectuels, manifests dans les actes euxmmes. Ajoutons que les savoirs pratiques permettent une familiarit avec les particularits concrtes de la situation et les implications de linteraction sociale, inconnue des savoirs thoriques et procduraux, et que les savoir-faire se prsentent comme un rpertoire dactes expriments et russis ou dactes potentiels6 qui rendent possible la ralisation des savoirs procduraux.
5 Nous voyons un rapport troit entre le savoir en usage de Malglaive et ce que Cervero (1992) appelle la connaissance utilise dans la pratique. Cette connaissance reoit sa signification du contexte dans lequel elle a t gnre; Cervero ajoute ceci : De plus, lusage de ce savoir nest pas simplement une question de reconnaissance, mais il est plutt orient vers laction. Il est incorpor au processus du raisonnement pratique, l o un problme se rsout dans un systme ouvert, lequel inclut les objets et linformation de lenvironnement ainsi que les buts et intrts de la personne qui solutionne le problme et des autres dans ce contexte (Cervero, 1992, 95). Voir Malglaive (1990, 83-85). Pour sa comprhension du savoir-faire, Malglaive recourt Bruner, plus explicite sur la question que Piaget, auquel il se rfre par ailleurs largement dans son ouvrage.
Dire la pratique, savoir de la pratique
45
Les manires de catgoriser les types de savoirs ne font pas lunanimit des chercheurs. Baskett et Marsick (1992) font tat des diffrentes faons de catgoriser les savoirs. Nous avons choisi de nous appuyer sur Malglaive (1990) parce que sa typologie fournit des repres suffisamment clairs pour faire ressortir les possibilits de la mthode des cas en termes de construction de savoirs. Si laction suppose une totalit de savoirs, lenseignement oblige passer par des voies diffrentes pour construire ou acqurir les diffrents types de savoirs, ceux-ci ayant des qualits et des modes dexpression diffrents. Les proccupations pdagogiques de Malglaive sont explicites et conduisent reconnatre non seulement limportance de dispositifs qui conviennent aux diffrents types de savoirs viss, mais aussi la ncessaire complmentarit de ces savoirs dans lorganisation dune formation. Pour Malglaive, la formation ne va pas sans lien troit entre le savoir et le faire, le thorique et le pratique, comme on peut le voir dans lextrait suivant :
Apprendre, que ce soit la faveur de lexprience ou la faveur dun enseignement rgl, consiste donc en un cycle rcursif fait de deux moments articuls : le moment du faire, o le savoir sinvestit dans les activits; le moment du savoir, o ce qui est dj connu dans la pratique se rlabore un niveau suprieur de formalisation. Enseigner cest, nos yeux, conduire les lves sur le chemin de ce cycle rcursif, ce qui suppose que le savoir propos soit toujours un savoir susceptible de sinvestir dans laction, que les connaissances tires de laction soient le point de dpart de nouvelles acquisitions pour llaboration desquelles ceux qui apprennent doivent mobiliser et repenser ce quils savent dj (Malglaive, 1994, 133).
Les typologies des savoirs ne concordant pas toujours, il devient difficile dtablir le bien-fond dune intervention qui vise tel savoir en particulier. La typologie de Malglaive prsente, notre avis, lintrt dune vision dynamique des savoirs, ceux-ci tant configurs diffremment selon les situations. Pour donner un exemple des diffrences que lon peut trouver sur le sujet, mentionnons que Cervero (1992) associe le savoir procdural au savoir-faire et affirme quil sacquiert dans la pratique, la diffrence du savoir thorique; chez Malglaive (1990), le savoir procdural se confirme et se rajuste dans la confrontation au rel mais il peut tre acquis par le truchement du langage des schmas, entre autres, ce qui nest pas le cas du savoir-faire. Certes, on peut reprer les savoirs procduraux et les savoir-faire dans le rcit de pratique et les solutions proposes aux impasses, du moins reconnat-on lexprience de celui qui intervient propos ou les lacunes de celui ou celle dont la parole ou le geste sont inhibs un moment plus critique. Mais il sera plutt difficile
46
Cahiers de la recherche en ducation
de dpartager entre ces types de savoirs. La distinction introduite par Ryle (1949) entre la connaissance dclarative et la connaissance procdurale peut nous tre utile ici pour ajouter quelques nuances; dans le cas de la premire, les noncs dcrivent des phnomnes observs, on sait que quelque chose est tel, alors que dans le cas de la seconde, on sait comment faire quelque chose, ce qui se formalise habituellement par une srie dinstructions, une marche suivre, des techniques7. Or, dans les domaines de pratique, la connaissance dclarative, qui correspond au savoir thorique, offre ses repres pour expliquer ou pour comprendre la situation, alors que la connaissance procdurale, celle qui est luvre et se construit lpreuve de laction, sinvestit avec le savoir-faire8. Nous disons donc que lanalyse dun cas de pratique permet didentifier les savoirs procduraux et les savoir-faire en action dans la situation raconte. Par exemple, tel conseiller en formation aura pris soin dadresser un questionnaire aux futurs participants dune formation en informatique pour sajuster leur niveau de connaissances dans le domaine et il aura prpar un programme convenant son public et pertinent pour le milieu dapplication vis (savoir procdural); ds la premire rencontre pourtant, son projet se bute au mcontentement dun public captif dune formation oblige et il utilise son habilet dialoguer (savoir-faire) pour rtablir un climat favorable, en mettant momentanment en veilleuse son programme pour dsamorcer la rsistance et en sappliquant construire un projet significatif pour le groupe9. Dans une autre instance, le formateur qui uvre en formation de base pourra connatre trs bien le programme individualis (savoir procdural) dont on lui a confi la responsabilit, mais il peut se trouver dcontenanc et court de mots (savoir-faire) en rponse une question inattendue ou sil est amen par ladulte sur un terrain de difficults personnelles.
8 9
Cette distinction entre le savoir dclaratif et le savoir procdural est devenue une sorte de passage oblig en psychologie cognitive, mais si on la considre utile, il faut rester attentif aux variantes dans les dfinitions, ce que lon constate par exemple dans lexpos de Lohman (1989) sur lutilisation que fait Anderson (1976, 1983) de la typologie et des nuances de dfinitions qui lui sont propres. Jarvis (1992) discute des deux catgories de Ryle et dit quil ne suffit pas de savoir ce quil faut faire et comment le faire, encore faut-il tre capable de le faire (savoir-faire). Nous nous rfrons ici au cas rdig par Claude Cornellier, Jean-Pierre Fredette et France Le Bourdais, et discut avec le groupe-cours ETA 6610/A94. Nous remercions ici tous les participants de ce groupe pour leur contribution dire le savoir en usage.
Dire la pratique, savoir de la pratique
47
Les savoirs thoriques alimentent spontanment lanalyse des rcits de pratique, mme sils ne sont pas toujours savamment formaliss. Par exemple, on se rfrera des notions comme celles de motivation, de rsistance au changement, de transfert des connaissances, de crise de la vie adulte, destime de soi, de mmoire courte, voire de types de savoirs; on reconnatra les contradictions entre les objectifs de la formation et les politiques sociales qui influent sur le cours de la formation; on opposera la logique du systme celle de lacteur; on classera les types de difficults dapprentissage, nommera les facteurs dabandon des tudes chez les adultes ou encore relativisera certains postulats dominants dans la culture pdagogique, bref on nest pas court dides pour dcrire le monde dans lequel on se trouve. Selon le niveau de familiarit avec le langage des disciplines scientifiques o les savoirs thoriques se sont dvelopps, les notions de rfrence seront plus ou moins nuances et les formules, plus ou moins condenses. Toutefois, cest avant tout le savoir pratique que la mthode des cas met au dfi de se dire, car le rcit de pratique situe le formateur dadultes au cur dune action, linstant o lintention de dpart est contrarie par ce qui se produit; il le presse de dcider de la suite et il lincite se poser les questions : Que dois-je faire? Quadviendra-t-il si je fais ceci ou cela? Le savoir pratique se rattache au raisonnement pratique et il se construit dans laction. Il ne dcoule pas de la thorie, mme si celle-ci peut tre mise contribution dans lvaluation de ce qui se passe. Le savoir pratique est le rsultat du jugement port dans le contexte dune situation indite et souvent complexe par un agent saiguillant vers un but, partir de croyances ou de connaissances possiblement incompltes des lments en jeu, et lequel privilgie une direction particulire quand des valeurs entrent en conflit. Signalons deux caractristiques du raisonnement pratique : il pense le contingent et il dfinit lintention. Reprenant les distinctions dAristote, Ladrire affirme que le propre du savoir pratique est de dlibrer (Ladrire, 1990, 33). Or, on ne dlibre pas sur ce qui est ncessaire ou impossible, on ne dlibre que sur du contingent, on ne peut dlibrer que sur ce qui peut tre autrement quil nest et dont le changement dpend de nous (Ibid.). Si les solutions taient videntes ou invitables, elles nauraient qu suivre leur cours. Au moment de la dlibration, lagent est confront lincertain, lindtermin; ds quil modifie par son action un des lments de la situation, cest lensemble de la situation qui se reconfigure. Par exemple,
48
Cahiers de la recherche en ducation
lorsque le conseiller en formation du cas cit ci-dessus a dcid de mettre momentanment en veilleuse le programme quil avait prpar, il aurait pu aussi ne pas droger ce quil entendait faire; tant donn les circonstances, sa dcision parat sage, mais leffet nest que probable, il dpend de la raction des participants qui accepteront ou non de dialoguer avec lui. Le savoir pratique du conseiller prend son sens dans la situation et il est subjectif, quoique dautres formateurs pourraient appuyer sa dcision. Ces derniers pourraient lui dire ta place, jaurais fait comme toi, mais non ta solution tait la seule valable. De plus, si le cumul dexpriences concluantes peut tre mis contribution dans une situation ultrieure, il ne dtermine en rien une nouvelle dcision prendre. Le savoir pratique porte galement sur le but de laction. En effet, une action entrane une modification dans ltat des choses et le raisonnement pratique organise en squence les moyens qui permettent datteindre le but. Or, quand un but fait partie du plan daction, on appelle intention le but de lagent (Walton, 1990, 213). Une fois lintention tablie ou dclare, lagent se trouve li par elle, cest-dire que lensemble de ses sous-programmes daction na de sens quen fonction de ce qui est vis terme. Mais dans la situation professionnelle quotidienne, les intentions vritables sont rarement identifiables. Elles ne sont mme pas toujours claires pour le formateur qui compose avec les particularits dun contexte donn et sy ajuste au fur et mesure. Il pourra aussi arriver au formateur de modifier son intention parce que ses priorits auront chang ou encore pour justifier ce quil a effectivement ralis. Lintrt danalyser un rcit de pratique est prcisment de dcouvrir les rseaux dintentions possibles et la hirarchie des actions qui conduisent au but final. Dans la dlibration qui conduit au choix dune hypothse de solution, lintention peut se dire sous la forme dun des rsultats envisags comme possibles et souhaitables. Par exemple, le conseiller en formation visera dsamorcer la rsistance des participants (rsultat intermdiaire 1), puis construire avec eux un projet dapprentissage significatif (rsultat intermdiaire 2) pour ne pas compromettre leur initiation linformatique (rsultat final). La clarification des intentions est dautant plus ncessaire la connaissance de laction de formation que le formateur se trouve engag avec dautres agents, fussent-ils le demandeur de formation, le responsable du service de formation ou ladulte en formation, et ceux-ci ont leurs propres intentions. Si lintention du formateur est pervertie par un systme qui vise avant tout la rentabilit ou par des politiques qui confient la formation de panser les plaies sociales, il devra
Dire la pratique, savoir de la pratique
49
reconsidrer son rle et trouver un compromis viable; par contre, il peut dcouvrir quil pervertit lui-mme laction de formation en ne gardant pas le cap sur le dveloppement de la comptence, par exemple, la mise niveau des connaissances ou la transformation de soi que visent les personnes engages dans des formations particulires. La construction de la connaissance des intentions daction est variable selon le groupe qui analyse la situation raconte. En effet, mme si la logique du rcit permettait linfrence de lintention de dpart, la situation problmatique introduit une rupture qui oblige valuer non seulement comment parvenir au but, mais, dans lordre, ce qui permet le mieux de le faire. Il nous parat possible, partir des rcits de situations de formation, de construire le savoir inhrent la pratique professionnelle. Nous avons tent de dcomposer ce savoir en usage et de mettre en valeur la spcificit du savoir li au raisonnement pratique. Il va sans dire que les distinctions sont thoriques et que la comptence se traduit dans la pratique quotidienne par lharmonie de ces savoirs. Celui qui aura approfondi son savoir thorique disposera de moyens danalyse plus varis et le formateur dexprience aura aiguis son sens des situations. On voit que la formation exige, au-del de la simple description de la situation ou de la mise en train de procdures, lengagement de la personne dans une action, qui ne va pas non plus sans un savoir sur soi.
3. La construction et la lgitimation du savoir de la pratique La mthode des cas est utilise dans les milieux de la formation professionnelle depuis plus dun sicle dj; ses tapes et ses exigences sont connues; on a soupes ses avantages et ses inconvnients. Elle ne fait pas lunanimit cependant, comme le rapporte Schn (1983), soit quon reproche ses tenants de faire lconomie des thories et des mthodes scientifiques, celles dont lapplication permet de mieux rsoudre les problmes, soit quon la considre efficace pour dvelopper des habilets cognitives qui seront par la suite utiles dans la pratique professionnelle. En adoptant le modle de la rflexion en cours daction ou de la rflexion sur laction du professionnel, la mthode des cas compterait parmi les stratgies pdagogiques qui favorisent chez le professionnel en formation le dveloppement dun savoir pratique, laccs son propre savoir et ses processus de raisonnement, ainsi que lautonomie dfinir et rsoudre les problmes.
50
Cahiers de la recherche en ducation
On peut comprendre lintrt actuel pour la mthode des cas si on le situe dans la mouvance de la remise en question de la rationalit technique (Cervero, 1992; Schn, 1983, 1987). La rationalit technique consacre la supriorit de la connaissance scientifique et appuie la rigueur des pratiques sur des mthodes et des techniques qui en dcoulent. On passe de la thorie la pratique comme du haut vers le bas. En revanche, le souci de thoriser la pratique, cest--dire de la considrer comme un univers de connaissance de plein droit (Usher, 1991), adopte la position du dedans; il conduit mettre en vidence les processus de rflexion qui accompagnent laction intelligente, ainsi que les faons que lon a de comprendre le monde dans lequel on agit. On reconnat ici linfluence du cognitivisme et de lhermneutique. Or, cette influence est manifeste galement dans le milieu scientifique. Par exemple, certains chercheurs voient une analogie entre les thories professionnelles, une sorte de thories subjectives, et la thorie objective scientifique. Entre autres, Dann (1990) sest pench sur les reprsentations et les processus cognitifs des enseignants en supposant que, puisquils sont des experts dans leur domaine et quils ont acquis une connaissance dans lexercice de leur mtier, cest bien cette connaissance tacite qui guide leurs actions dans la vie de tous les jours. Les thories subjectives se dfinissent comme un ensemble de connaissances sur soi et sur le monde, dont la structure est argumentative; elles permettent dexpliquer, de prdire et de penser le changement. Les thories subjectives sont caractrises comme suit :
elles sont des reprsentations cognitives relativement stables qui peuvent se modifier avec lexprience; elles sont souvent implicites, mais peuvent accder la conscience de lacteur; elles ressemblent aux thories scientifiques par leur structure argumentative (ce qui se traduit par exemple par des noncs si, alors); semblablement celles des thories objectives en science, leurs fonctions sont de dfinir les situations, dexpliquer ou de justifier le pass, de prdire ou danticiper le futur, de gnrer des suggestions pour laction venir; enfin, elles sont partie intgrante des connaissances qui servent laction et, avec dautres facteurs, elles influencent le comportement, particulirement dans le cadre dune action dirige vers un but (Dann, 1990, 228)10.
Si les thories professionnelles sont des thories subjectives, elles ne sont donc pas ici mises dos dos avec les thories scientifiques, mais plutt rconci10 Nous pensons avoir retenu lessentiel du texte de Dann dans cette traduction libre.
Dire la pratique, savoir de la pratique
51
lies par des conceptualisations savantes qui ne renient en rien le modle prvalant en science. Ceci est important pour nous, dans la mesure o nous pourrions objecter quune telle posture pistmologique ne parvient saisir la qualit du savoir professionnel quen prenant le dtour du savoir scientifique et que, en consquence, les stratgies pdagogiques dnonciation des savoirs lis la pratique qui sy appuient risquent dengendrer un discours analogue et parallle celui de la science. Avec lanalyse de Groeben (1990, 21-23), nous apprenons que les psychologues qui retiennent le concept de thorie subjective ont bien vu quun paralllisme de fonctions entre les thories subjectives et les thories savantes conduit conceptualiser semblablement le sujet qui fait la science et le sujet que ce dernier observe; comme sujets humains, ils reoivent tous les deux en partage la rflexivit, une habilet communiquer, une potentielle rationalit et une comptence agir. Mais, se centrant sur le concept daction et ce qui la caractrise, savoir lintentionalit, la dcision libre, le sens (la signification), la dpendance du contexte, lorientation vers un but, la planification et le contrle du processus (Ibid, 22), ces mmes psychologues diront que, ces caractristiques tant interrelies et lintentionalit tant celle de lagent, une action demeure un fait dinterprtation. En consquence, mme si la capacit dinterprter sapplique autant celui qui observe les actions dun autre qu celui qui pose ces actions, la connaissance de lagent est plus proche de laction que celle dun observateur extrieur et cest la seule qui puisse tre mise en uvre, autrement dit, devenir opratoire. Pour les domaines daction, la thorie subjective a donc prsance. Ainsi, les savoirs tacites ou les thories professionnelles se voient justement rhabilits et lgitims par la recherche scientifique elle-mme, qui se trouve son tour justifie de revoir ses mthodes de validation. Les pratiques de formation professionnelle sont actuellement largement influences par le cognitivisme. Les positions particulires qui portent sur les thories subjectives paraissent dautant plus sduisantes pour asseoir la pratique de la mthode des cas quelles relient le savoir de la pratique la contingence et lintention de laction. Nous choisissons plutt dassocier la mthode des cas la construction discursive des savoirs de la pratique et de la situer dans le cadre plus gnral de la formation professionnelle des formateurs, entendue comme praxis communicationnelle (Chen, 1993). Concrtement, cela veut dire que la mise en rcit de situations profes-
52
Cahiers de la recherche en ducation
sionnelles, lanalyse ralise en groupe et la rdaction finale dans laquelle sont traduits les choix de laction entreprendre sont avant tout des vnements de parole et dcriture qui se structurent selon les pratiques discursives et prennent un sens dans leur contexte dnonciation et dinterprtation. Quand le formateur dadultes entreprend dcrire lhistoire dune pratique, son exprience se moule dans la forme narrative; sil argumente en faveur dune solution plutt que dune autre, son expression nest pas la mme que sil sapplique pousser la description des lments de la situation. Les formes de discours utilises font partie dune tradition de langage et de culture et elles sont retenues dans des lieux de pratique donns, uniquement si elles continuent dy tre comprises. De plus, la mthode des cas fait aussi partie des dispositifs reconnus dans le champ social des pratiques de formation professionnelle et elle faonne avec les consignes provenant de sa culture dorigine la mise en discours des situations de pratique. En outre, la mthode des cas permet dagir le savoir immanent la pratique professionnelle en le faisant dire, analyser, discuter, comprendre; on peut ainsi la considrer comme un dispositif dexpression, dcoute et de partage de messages au sujet de la pratique professionnelle. Il y a plusieurs implications considrer ainsi la mthode des cas. Dune part, le savoir en usage mis en mots dans le rcit est destin slargir avec le groupe des formateurs dadultes qui poursuivent lanalyse et la discussion de la situation raconte, cest--dire quil prend place dans lhistoire dune communaut qui cherche comprendre ses pratiques. Savoirs thoriques, savoirs procduraux, savoirs pratiques et savoir-faire sont reprs et comprhensibles par le relais de la parole mme si, dans le cas des savoirs pratiques et des savoirfaire cette parole risque dtre parfois approximative et, ensemble, ils forment un systme ouvert, sujet tre dstabilis ou reconfigur dans lchange du groupe. Ils demeurent non seulement lis lindtermination et lincertitude de la situation de rupture discute, mais aussi la contingence de laction communicationnelle elle-mme. Dautre part, en tant que pratique sociale centre sur les savoirs de la pratique professionnelle, la formation par la mthode des cas peut aussi lgitimer ces savoirs. Litinraire social des connaissances issues du monde des pratiques professionnelles nest pas balis comme celui des connaissances scientifiques. Dans le cas de la science, les premiers balbutiements du chercheur ou des quipes de recherche trouvent leur expression dans le langage disciplinaire, ils sont lgitims
Dire la pratique, savoir de la pratique
53
dans des changes entre spcialistes, puis diffuss dans des priodiques scientifiques; les rsultats de recherche sont parfois communiqus un public plus large par les mdias dinformation, quand ils ne sont pas aussi vulgariss, et ils font dsormais partie du bagage commun des connaissances. Il nen est pas de mme en ce qui concerne les connaissances lies la pratique professionnelle. Non seulement celles-ci demeurent largement ignores, mais rares sont les espaces de communication o elles peuvent sexprimer par la parole ou lcriture et recevoir la lgitimation dune discussion entre les spcialistes de ces pratiques. Dailleurs, le regret de ne pas pouvoir changer facilement ou plus souvent dans le milieu de pratique est partag par plus dun praticien. De plus, le discours de la recherche scientifique, quoiquil soit parfois largement narratif, sattelle spcifiquement au dveloppement des connaissances, quil traduit sous forme de thories ou de modles, comprhensibles aux initis. Centr avant tout sur des actions, le discours des pratiques est autre; il sapplique raconter, il dcrit une situation ou rend compte dune intervention. Captivant, il peut enfermer linterlocuteur ou le lecteur dans la singularit dune exprience, moins que ne soit retrac, dans un contexte de formation par exemple, ce qui apparat commun plusieurs lectures. Mais on a vu comment la mthode des cas place le rcit de pratique lintersection de laction et de la construction dun systme complexe de savoirs, pertinents laction. Son utilisation permet au savoir de la pratique de se dire, voire de se contredire, de dcouvrir ses possibles et de se voir confirm par des spcialistes dun mme domaine daction. Il nest pas indiffrent aux pratiques de discours dont nous parlons ici quelles se produisent dans lespace social de la formation universitaire des formateurs dadultes, luniversit tant par excellence le lieu de lgitimation du savoir dans la socit moderne. En revanche, il nest pas indiffrent pour luniversit que de telles pratiques y trouvent une lgitimit on sait que lenseignement par la mthode des cas ou par problmes se gnralise dans les facults professionnelles o se ctoient thorie et pratique puisquelles remettent en question, non pas la validit du savoir de la science, ce quelles nauraient pas les moyens de faire, mais sa signification pour laction. Certes, la construction du savoir de la pratique nest pas lapanage de luniversit; le trait distinctif de ce savoir par ailleurs est de se trouver naturellement mtiss avec le savoir construit dans les pratiques de recherche. On pourrait en effet donner maints exemples puiss dans lchange dun groupe sur une situation de pratique, o les manires de nommer empruntent
54
Cahiers de la recherche en ducation
consciemment des champs disciplinaires des thories ou des modles rcents, parce que ceux-ci permettent de dire autrement les choses et, ainsi, den pousser plus loin la comprhension. Conclusion En rflchissant sur lutilisation que nous avons faite de la mthode des cas dans le cadre de lenseignement universitaire des formateurs dadultes, nous avons tent de clarifier les possibilits quoffre la mthode pour construire avec les formateurs le savoir de la pratique et le lgitimer. Un dispositif parmi dautres, la mthode aide le savoir se dire, ce savoir que les formateurs ont acquis avec lexprience, auquel il leur arrive de ne pas faire confiance, quils ne souponnent pas ou quils ont peut-tre oubli. Limportance de lgitimer le savoir de la pratique professionnelle est grandement reconnue dans lunivers des pratiques de la formation des adultes qui se dfinit la fois comme champ de pratique sociale et champ dtudes, autant que celle de jeter des ponts entre le savoir de la pratique et celui de la recherche et de la formation (Chen, 1993; Toupin, 1993). Contrairement une lgitimit qui lui viendrait par le haut, cest--dire par le langage et le savoir de la science, sa lgitimit peut se construire du dedans, dans lespace social de la formation, avec la communaut des formateurs dadultes elle-mme et par le langage courant, celui des difficults et des solutions, des checs et des russites, des intentions contraries et des projets. Les universitaires qui sengagent dans de telles pratiques discursives avec les formateurs dadultes se trouvent eux-mmes placs en position de construire le savoir avec les autres et de collaborer sa transformation. Ceci suppose quils gardent ouvert leur propre systme de savoirs et quils ne cessent de sinterroger sur la connaissance elle-mme. Rfrences
ANDERSON, J. R. (1976). Language, memory and thought. Hillsdale [NJ] : Lawrence Erlbaum. ANDERSON, J. R. (1983). The architecture of cognition. Cambridge [MA] : Harvard University Press. BASKETT, H.K. ET MARSICK, V.J. (1992). Confronting new understandings about professional learning and change. In H.K. Baskett et V.J. Marsick (d.), Professionals ways of knowing : New findings on how to improve professional education (p. 7-15). San Francisco [CA] : Jossey-Bass.
Dire la pratique, savoir de la pratique
55
BLONDIN, D. (1994). La mthode des cas : pour une formation professionnelle qui fait le lien entre la thorie et la pratique. Coup dil, 12, 2-4. CERVERO, R. (1992). Professional practice, learning and continuing education. International Journal of Lifelong Education, 11(2), 91-101. CHEN, A. (1993). Praxis, formation et recherche en ducation des adultes. In F. Serre (d.), Recherche, formation et pratiques en ducation des adultes (p. 157-186). Sherbrooke : ditions du CRP. DANN, H.-D. (1990). Subjective theories : A new approach to psychological research and educational practice. In G.R. Semin et K.J. Gergen (d.), Everyday understanding : Social and scientific implications (p. 226-243). Londres : Sage. GROEBEN, N. (1990). Subjective theories and the explanation of human action. In G.R. Semin et K.J. Gergen (d.), Everyday understanding : Social and scientific implications (p. 19-43). Londres : Sage. JARVIS, P. (1992). Learning practical knowledge. In H.K. Baskett et V.J. Marsick (d.), Professionals ways of knowing : New findings on how to improve professional education (p. 89-95). San Francisco [CA] : Jossey-Bass. LADRIRE, P. (1990). La sagesse pratique. In P. Pharo et L. Qur (dir.), Les formes de laction (p. 15-37). Paris : cole des hautes tudes en sciences sociales. LOHMAN, D.F. (1989). Human intelligence. Review of Educational Research, 59(4), 333-373. MALGLAIVE, G. (1990). Enseigner des adultes. Paris : Presses universitaires de France. MALGLAIVE, G. (1994). Les rapports entre savoir et pratique dans le dveloppement des capacits dapprentissage chez les adultes. ducation permanente, 119, 125-133 (1re d. 92, 1988). MUCCHIELLI, R. (1987). La mthode des cas. Paris : ditions ESF. POISSON, Y. (1992). La mthode des cas dans la formation universitaire des enseignants. Actes du congrs de lAIPU Enseigner luniversit (p. 167-172). Montral : AIPU. RYLE, G. (1949). The concept of mind. Chicago [IL] : The University of Chicago Press. SCHN, D.A. (1983). The reflective practitioner. New York [NY] : Basic Books. SCHN, D.A. (1987). Educating the reflexive practitioner. San Francisco [CA] : Jossey-Bass.
56
Cahiers de la recherche en ducation
TOUPIN, L. (1993). Rapprocher formation, recherche et praxis Une perspective thique-motionnelle. In F. Serre (d.), Recherche, formation et pratiques en ducation des adultes (p. 59-89). Sherbrooke : ditions du CRP. USHER, R. (1991). Theory and metatheory in the adult education curriculum. International Journal of Lifelong Education, 10(4), 315. VAN STAPPEN, Y. (1989). Lenseignement par la mthode de cas. Joliette : Cgep Joliette-de-Lanaudire. WALTON, D.N. (1990). Practical reasoning. Savage [MD] : Rowman and Littlefield Publishers. WASSERMAN, S. (1993). Getting down to cases. Learning to teach with case studies. New York [NY] : Teachers College Press, Columbia University. Abstract Based on her own practice in the university education of adult educators, the author reflects on the potential of the case method for building practical professional knowledge and legitimizing it. She presents the instructional program, links it with the understanding of the types of knowledge operating in action, and seeks out a theoretical basis for naming these types of knowledge. Last, adopting the epistemological framework of discursive constructivism, she attempts to explore the potential of the case method as an instrument for expressing, listening to, and sharing messages about professional practice. Resumen A partir de una prctica universitaria de capacitacin de formadores de adultos, la autora reflexiona sobre las posibilidades que ofrece el mtodo de casos para construir y legitimar el saber de la prctica profesional. Ella presenta el dispositivo pedaggico, al cual le relaciona la comprensin de saberes en juego en la accin y encuentra apoyos tericos para nombrar esos saberes. En fin, ella adopta el marco epistemolgico del constructivismo discursivo y busca explorar el potencial del mtodo de casos, considerado como dispositivo de expresin, de escucha y de participacin de mensajes respecto a la prctica profesional. Zusammenfassung Auf Grund ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der Ausbildung von Erwachsenenausbilder frgt sich die Verfasserin, inwieweit die Methode des Falles dazu benutzt werden kann, die Kenntnis der beruflichen Praxis zu konstruieren und zu legitimieren. Sie legt die pdagogischen Mittel dar, bringt diese in Zusammenhang mit den jeweiligen erforderlichen Kenntnissen und findet theoretische Anhaltspunkte, um diese Kenntnisse zu bezeichnen. Schlielich bernimmt sie den epistemologischen Rahmen des diskursiven Konstruktivismus und versucht, die Mglichkeiten der Methode des Falles als Mittel des Ausdruckes, des Zuhrens und des Austauschs hinsichtlich der beruflichen Praxis weiter zu erforschen.
Vous aimerez peut-être aussi
- Roland Barthes Essais CritiquesDocument149 pagesRoland Barthes Essais Critiquesvivanchy100% (3)
- Rapport de Stage Poste MarocDocument31 pagesRapport de Stage Poste MarocToufik Zerouk38% (8)
- JCRafoniDocument24 pagesJCRafoniSalim SaliimPas encore d'évaluation
- HTMJS Formation HTML Css Fondamentaux Javascript PDFDocument2 pagesHTMJS Formation HTML Css Fondamentaux Javascript PDFCertyouFormationPas encore d'évaluation
- VOCABULAIRE Enseigner Le Vocabulaire À L'école, MNG PP 2011Document64 pagesVOCABULAIRE Enseigner Le Vocabulaire À L'école, MNG PP 2011Gina GheorghițăPas encore d'évaluation
- Téléverser Un DocumentDocument2 pagesTéléverser Un DocumentAdnane Elmouttaki100% (1)
- Bulletin Officiel - Terminale AMCDocument18 pagesBulletin Officiel - Terminale AMCyoann.garciaPas encore d'évaluation
- W Carlota TCCDocument20 pagesW Carlota TCCDenilson Justino LangaPas encore d'évaluation
- Analyse TransactionnelleDocument9 pagesAnalyse TransactionnelleAbdelmalekRajiPas encore d'évaluation
- Alchimie de L'espritDocument20 pagesAlchimie de L'espritmathaccohPas encore d'évaluation
- Mbaye Ndiaye Samb l3Document55 pagesMbaye Ndiaye Samb l3Adris NanquePas encore d'évaluation
- PUREN 2008e AC PA Culturel CoculturelDocument16 pagesPUREN 2008e AC PA Culturel CoculturelCassiPas encore d'évaluation
- 12.guide Galgary Cambridge EPU 2020Document80 pages12.guide Galgary Cambridge EPU 2020ikourzoulikha08Pas encore d'évaluation
- LexicologieDocument6 pagesLexicologiemelisa77890% (1)
- Developpement Personnel 2Document15 pagesDeveloppement Personnel 2IAM CONSULTGPas encore d'évaluation
- Cours N°2 - Architecture Du Réseau Mobile 3G 2021Document39 pagesCours N°2 - Architecture Du Réseau Mobile 3G 2021wakeurboromsam mbackéPas encore d'évaluation
- Cours de Linguistique GénéraleDocument28 pagesCours de Linguistique GénéraleMohamedPas encore d'évaluation
- Les Composantes Formelles de La CommunicationDocument8 pagesLes Composantes Formelles de La CommunicationAnas BenchemmarPas encore d'évaluation
- COURS VulgarisationDocument81 pagesCOURS VulgarisationDiakaridia Konate67% (3)
- Bertrand Leblanc Barbedienne A LireDocument45 pagesBertrand Leblanc Barbedienne A LireBertrand Leblanc-BarbediennePas encore d'évaluation
- Communications Numériques-Ensa - Ch2.1Document49 pagesCommunications Numériques-Ensa - Ch2.1Jawad MaalPas encore d'évaluation
- Les Reseaux WANDocument14 pagesLes Reseaux WANzaza zaza1Pas encore d'évaluation
- Langue, Littérature Et Culture Françaises en Contexte Francophone (Ed. Zvonko Nikodinovski), 2012, 463 P PDFDocument467 pagesLangue, Littérature Et Culture Françaises en Contexte Francophone (Ed. Zvonko Nikodinovski), 2012, 463 P PDFzvonko_nikodinovskiPas encore d'évaluation
- RapportDocument25 pagesRapportahoubaPas encore d'évaluation
- Société de PresseDocument22 pagesSociété de PresseTiffany RasandisonPas encore d'évaluation
- Version Finale Projet de ThèseDocument11 pagesVersion Finale Projet de Thèsemary radiiPas encore d'évaluation
- Module 6 Suivi EvaluationDocument20 pagesModule 6 Suivi EvaluationJonas HabaPas encore d'évaluation