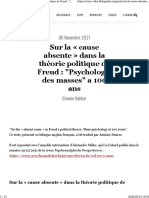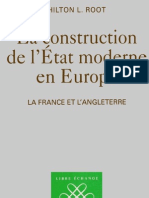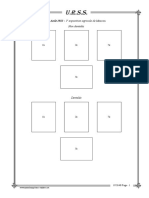Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Althusser, Louis - 1966 - Sur La Révolution Culturelle
Althusser, Louis - 1966 - Sur La Révolution Culturelle
Transféré par
Michele ZaffaranoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Althusser, Louis - 1966 - Sur La Révolution Culturelle
Althusser, Louis - 1966 - Sur La Révolution Culturelle
Transféré par
Michele ZaffaranoDroits d'auteur :
Formats disponibles
D ecalages
Volume 1, Issue 1 2010 Article 8
Sur la r evolution culturelle
` Louis Althusser] Anonyme [Attribu ea
Copyright c 2010 by the authors. D ecalages is produced by The Berkeley Electronic Press (bepress). http://scholar.oxy.edu/decalages
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser] Quel que soit le parti qu'il ait pris, il n'est pas admissible qu'un communiste traite automatiquement, sans autre forme de procs, la R.C, chinoise, comme un fait parmi d'autres, comme un argument parmi d'autres. La R.C. n'est pas d'emble un argument : c'est tout d'abord un fait historique. Ce n'est pas un fait comme les autres, c'est un fait historique sans prcdent. Ce n'est pas un fait historique de circonstance, ce n'est pas une dcision prise propos de la lutte du P.C.C. contre le rvisionnisme moderne , ou de l'encerclement militaire et politique de la Chine. C'est un fait historique de grande importance et de longue dure. Il appartient au dveloppement de la Rvolution Chinoise. Il reprsente une de ses phases, une de ses mutations. Il plonge ses racines dans son pass, et prpare son avenir. Comme tel, au mme titre que la Rvolution Chinoise, il appartient en mme temps au Mouvement Communiste International. C'est donc un fait historique qu'il faut examiner en lui-mme, dans son indpendance et sa profondeur, sans le rduire pragmatiquement tel aspect de la conjoncture actuelle. De surcrot, c'est un fait historique exceptionnel. D'une part, il n'a aucun prcdent historique, et, d'autre part, il prsente un extrme intrt thorique. Marx, Engels et Lnine ont toujours proclam la ncessit absolue de donner l'infrastructure socialiste, mise en place par la rvolution politique, une superstructure idologique correspondante, c'est--dire socialiste. Pour cela, une rvolution idologique est ncessaire, une rvolution dans l'idologie des masses. Cette thse exprime un principe fondamental de la thorie marxiste. Lnine avait une conscience aigu de cette ncessit, et le parti bolchevik a fait de grands efforts dans ce sens. Mais les circonstances n'ont pas permis l'U.R.S.S. de mettre l'ordre du jour politique une rvolution idologique de masse. Le P.C.C. est le premier s'engager et engager les masses dans cette voie, en appliquant des moyens nouveaux. le premier mettre l'ordre du jour cette rvolution idologique de masse, dsigne par l'expression R.C. .
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
Ce rapprochement entre une thse thorique marxiste jusqu'ici demeure l'tat thorique, et un fait historique nouveau, qui en est la ralisation, ne peut videmment laisser aucun communiste indiffrent. Ce rapprochement ne peut que susciter un extrme intrt, politique et thorique. Bien entendu, la nouveaut, l'originalit, l'inattendu des formes de l'vnement ne peuvent manquer de surprendre, dconcerter, et de soulever toutes sortes de questions. Le contraire serait tonnant. Dans un tel cas, il est exclu de trancher sans un examen pralable srieux. Un communiste ne peut, distance comme nous le sommes, se prononcer sur la R.C., donc la juger, sans avoir analys, au moins dans le principe, sur les documents originaux dont il dispose, et la lumire des principes marxistes, les titres politiques et thoriques de la R.C. Cela veut dire : 1) il faut d'abord analyser la R.C. comme un fait politique, ce qui suppose de considrer la fois la conjoncture politique o elle intervient, les objectifs politiques qu'elle se fixe, Les moyens et mthodes qu'elle se donne et applique. 2) il faut ensuite examiner ce fait politique la lumire des principes thoriques du marxisme (matrialisme historique, matrialisme dialectique), en se posant la question de savoir si ce fait politique est, ou non, conforme ces principes thoriques. Sans cette double analyse, politique et thorique, dont on ne donnera ici qu'un bref schma il n'est pas possible un communiste franais de juger la R.C. 1 ANALYSE POLITIQUE DE LA REVOLUTION CULTURELLE a) Conjoncture de la Rvolution Culturelle Le P.C.C. a, dans ses dclarations officielles, insist sur la raison politique fondamentale de la R.C. (cf. Les 16 points, le compte rendu du C.C., les ditoriaux du Renmin Ribao). Dans les pays socialistes, aprs l'accomplissement, pour l'essentiel, de la transformation socialiste de la proprit des moyens de production,
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
subsiste encore cette question : quelle voie suivre? Faut-il mener jusqu'au bout la rvolution socialiste et passer graduellement au communisme ? Ou bien s'arrter mi-chemin et rtrograder vers le capitalisme ? Cette question se pose nous de manire aigu. (Editorial du R.R., 15-8-66.) La R.C. est ainsi prsente, sans quivoque, comme une rponse politique une question politique extrmement prcise. Cette question est dclare aigu et cruciale . Cette question cruciale est une question de fait, qui se pose au P.C.C. dans une conjoncture politique dfinie. De quelle conjoncture s'agit-il ? Il ne sagit pas essentiellement, comme le croient certains commentateurs, de la conjoncture mondiale , cest--dire du grave conflit provoqu par l'agression amricaine contre le Mouvement de Libration du Vietnam du Sud, contre lEtat socialiste de la R.V.D.N., et par les menaces contre la Chine. La conjoncture qui explique la R.C. est essentiellement intrieure au socialisme. Mais cette conjoncture nest pas non plus, essentiellement, constitue par le conflit entre le P.C.C. et le P.C.U.S. Ce conflit est, l'gard de la R.C., relativement latral. La R.C. nest pas avant tout une rponse au conflit , un argument du P.C.C. contre le P.C.U.S. La R.C. rpond une autre question fondamentale, dont le conflit nest quun aspect ou un effet. La conjoncture de la R.C. est constitue par les problmes actuels du dveloppement de la Rvolution socialiste en Chine. Le P.C.C. parle de la Chine lorsquil dit : la question se pose nous de manire aigu . De fait, il ne propose pas sa solution aux autres pays socialistes, il ne les invite pas sengager dans la R.C. Mais il est bien clair que la conjoncture de la R.C. nest pas seulement celle des problmes du dveloppement de la seule, Rvolution chinoise. A travers la conjoncture chinoise, cest la conjoncture de tous les pays socialistes qui est, directement ou indirectement, intresse. La conjoncture chinoise apparat en effet comme un cas particulier de la conjoncture des pays socialistes en gnral. Pour comprendre le problme fondamental, crucial, qui constitue le fond de la conjoncture politique de la R.C., il faut donc aller le chercher l o il se pose. Il ne faut pas se tromper de conjoncture. Il ne faut pas aller chercher ce problme ni dans la conjoncture mondiale (agression
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
imprialiste), ni dans la conjoncture du conflit P.C.C./P.C.U.S. . Il faut aller le chercher dans la conjoncture de la rvolution socialiste chinoise et, plus gnralement, dans la conjoncture intrieure des pays socialistes. Rappelons ce quest un pays socialiste. C'est un pays o a eu lieu une rvolution politique socialiste (prise du pouvoir dans des conditions historiques diffrentes, mais aboutissant la dictature du proltariat), puis une rvolution conomique (socialisation des moyens de production, mise en place de rapports de production socialistes). Un pays socialiste ainsi constitu construit le socialisme sous la dictature du proltariat, et, le moment venu, prpare le passage au communisme. C'est une uvre de longue haleine. Or, aux yeux du P.C.C., l'examen critique des expriences positives et ngatives des rvolutions socialistes, de leurs victoires et de leurs checs, de leurs difficults, de leur progrs, de leur degr d'avancement (en U.R.S.S., dans les pays socialistes d'Europe Centrale, en Yougoslavie, en Chine, en Core du Nord, en R.D.V.N., Cuba) montre que tout pays socialiste sest trouv, ou se trouve, ou va se trouver, mme une fois ralise pour l'essentiel la socialisation des moyens de production, devant un problme crucial : celui des deux voies . Ce problme est le suivant. On va lnoncer sous forme de questions. Dans les phases de transition rvolutionnaires qui font passer une formation sociale du capitalisme au socialisme puis au communisme, nexiste-il pas, chacune de ces phases, un risque objectif de rgression ? Ce risque nest-il pas fonction de la politique suivie par le parti rvolutionnaire, de sa justesse ou de sa fausset ; non seulement dans la ligne gnrale, mais aussi dans les dtails de son application? De la faon dont les objectifs, leur hirarchie, leur articulation sont dtermins et des mcanismes objectifs (conomiques, politiques, idologiques) mis en place par cette politique? N'y a-t-il pas une logique et une ncessit de ces mcanismes telles qu'ils peuvent faire rgresser le pays socialiste vers le capitalisme ? De surcrot, ce risque nest-il pas multipli du fait de lexistence de limprialisme, de ses moyens (conomiques, politiques, militaires, idologiques), de lappui quil peut prendre sur certains lments d'un pays socialiste, en occupant certains de ses vides (cf. lidologie), en utilisant ses mcanismes, pour neutraliser et utiliser politiquement, puis dominer conomiquement ce pays? Pour reprendre, en fonction de ce risque gnral, les termes actuels du
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
Parti Communiste Chinois, l'avenir du socialisme dans un pays est-il assure 100 %, cest--dire dfinitivement, sans retour, du seul fait que ce pays a accompli une double rvolution, politique et conomique? Ne peut-il pas rgresser vers le capitalisme ? N'en avons-nous pas dores et dj un exemple : la Yougoslavie? Un pays socialiste ne peut-il pas alors conserver, et mme pendant une assez longue dure, les ou des formes extrieures (conomiques, politiques) du socialisme, tout en leur donnant un contenu conomique, politique et idologique tout diffrent (mcanisme de restauration du capitalisme), et en se laissant progressivement neutraliser puis utiliser politiquement, puis conomiquement dominer par l'imprialisme? Ce problme fait un avec la thse du P.C.C. sur le risque de rgression d'un pays socialiste vers le capitalisme. Cest en fonction de cette thse gnrale quil est possible de dire que les pays socialistes se trouvent constamment devant l'alternative des deux voies , Cette alternative peut, en certaines circonstances, devenir particulirement critique, mme aujourd'hui. Devant les pays socialistes, et en considration des rsultats obtenus dans leur rvolution, s'ouvrent bien deux voies : la voie rvolutionnaire, qui mne au-del des rsultats obtenus, vers la consolidation et le dveloppement du socialisme, puis vers le passage au communisme; la voie de la rgression, qui ramne en-de des rsultats obtenus, vers la neutralisation puis l'utilisation politiques, puis la domination et la digestion conomiques d'un pays socialiste par limprialisme : la voie de la rgression vers le capitalisme . L'alternative des deux voies cest cela : ou sarrter mi-chemin , cest--dire en fait rgresser; ou ne pas s'arrter mi-chemin , c'est-dire aller de l'avant. Dans les textes officiels chinois, la premire voie est qualifie, par une expression raccourcie, de voie capitaliste (cest ainsi quil est question des dirigeants qui suivent la voie capitaliste ), et la seconde voie est qualifie, par une expression raccourcie, de voie rvolutionnaire . Tel est le problme politique dominant, pos par la conjoncture politique de la R.C. b) Objectifs politiques de la Rvolution Culturelle
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
La R.C. donne, pour la Chine, la rponse cette question, la solution de ce problme. Pour la Chine : mais il est clair que cette solution, comme ce problme, dpasse infiniment la conjoncture chinoise par sa porte et ses effets. Le P.C.C. dit : nous sommes la croise des chemins. Nous devons choisir: ou bien, nous nous arrtons mi-chemin, et alors, en fait, mme si nous prtendions le contraire, nous nous engageons sur la voie de la rgression, la voie capitaliste ; ou bien nous sommes rsolus aller de l'avant, prenons les mesures ncessaires, et alors nous nous engageons sur la voie rvolutionnaire . Cest ici, trs prcisment, qu'intervient, dans la conjoncture chinoise, la R.C. Le P.C.C. dclare que pour renforcer et dvelopper le socialisme en Chine, pour assurer son avenir, et le prserver durablement de tout risque de rgression, il faut ajouter la rvolution politique, et la rvolution conomique, une troisime rvolution : la rvolution idologique de masse. Cette Rvolution idologique de masse, le P.C.C. lappelle Rvolution Culturelle proltarienne. Son but final consiste transformer lidologie des masses, remplacer lidologie fodale, bourgeoise et petite-bourgeoise qui imprgne encore les masses de la socit chinoise, par une nouvelle idologie de masses, proltarienne, socialiste, et donner ainsi une infrastructure conomique et une superstructure politique socialistes, une superstructure idologique correspondante. Ce but final dfinit lobjectif lointain de la R.C. La R.C. ne peut tre quune uvre de trs longue haleine. Cependant, ce but final sarticule ds aujourd'hui sur le problme dominant, essentiel, de la conjoncture : le problme de la croise des chemins, le problme des deux voies. Cette articulation ressort trs nettement de tous les textes officiels chinois fixant la hirarchie des objectifs actuels. Le mouvement en cours vise principalement ceux qui, dans le Parti, dtiennent des postes de direction, et sengagent sur la voie capitaliste. Cest donc dans le Parti lui-mme, de qui tout dpend, par le Parti lui-mme que doit commencer la R.C., tout en se dveloppant en mme temps dans tous les autres domaines. La R.C. pose immdiatement, directement aux dirigeants, la question essentielle, la question de la voie quils suivent, la question de la voie quils entendent suivre : voie capitaliste ou voie rvolutionnaire .
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
Cet objectif essentiel indique sans quivoque quel est le problme essentiel auquel rpond la R.C. Bien entendu, la R.C. a ds maintenant dautres objectifs. Dans la mesure o lidologie est prsente dans toutes les pratiques dune socit donne, la R.C. concerne galement les formes de lidologie qui interviennent dans la pratique conomique, dans la pratique politique, dans la pratique scientifique et technique, dans la pratique esthtique, dans la pratique pdagogique, etc. Dans tous ces domaines, la R.C. se propose des objectifs proches, dfinis en fonction de ses buts lointains. Ils sarticulent tous en dernire instance sur la solution du problme essentiel : le problme des deux voies. c) Moyens et mthodes de la Rvolution Culturelle Quant aux moyens et aux mthodes de la R.C., ils reposent sur le principe que la R.C. doit tre une rvolution de masses, qui transforme lidologie des masses, et qui soit faite par les masses elles-mmes. Il ne sagit pas, en effet, de transformer lidologie ou de rformer lentendement de quelques intellectuels ou de quelques dirigeants. Il ne sagit mme pas de transformer l'idologie du seul Parti communiste, au cas o ce serait ncessaire. Il sagit de transformer les ides, les faons de penser, les faons dagir, les murs des masses du pays tout entier, de plusieurs centaines de millions dhommes, paysans, ouvriers, et intellectuels. Or, une telle transformation de l'idologie des masses ne peut tre luvre que des masses elles-mmes, agissant dans et par des organisations, qui sont des organisations de masse. La politique du P.C.C. consiste alors faire le plus large appel et la plus large confiance aux masses, et inviter tous les responsables et dirigeants politiques suivre, sans rticences, mais avec audace, cette ligne de masse . Il faut donner la parole aux masses, et faire confiance aux initiatives des masses. Des erreurs, invitables dans tout mouvement, se produiront : elles seront corriges dans le mouvement, les masses sduqueront elles-mmes dans l'action. Mais il ne faut aucun prix freiner ou restreindre d'avance le mouvement, sous le prtexte derreurs ou d'excs possibles : ce serait briser le mouvement. Il faut aussi prvoir quil y aura des rsistances, parfois srieuses, au mouvement des masses : elles sont normales, puisque la R.C. est une forme de la lutte des classes. Ces
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
rsistances viendront des reprsentants des anciennes classes dominantes, elles peuvent venir aussi, dans certains cas, de masses mal diriges, ou utilises, elles peuvent venir enfinde certains dirigeants du Parti eux-mmes. Il faudra traiter tous ces cas diffrentiellement, distinguer les ennemis des amis, et parmi les adversaires, distinguer les lments hostiles, irrductibles, les dirigeants routiniers ou dconcerts, les hsitants et les pusillanimes. En aucun cas, mme contre lennemi de classe bourgeois (les crimes tant punis par la loi), on ne devra recourir aux coups et la violence, mais toujours au raisonnement et la persuasion. Les masses ne peuvent agir que dans des organisations de masse. Le moyen le plus original, linnovation propre de la R.C. consiste dans lapparition d'organisations propres la R.C., organisations distinctes des autres organisations de la lutte des clases (syndicat et parti). Les organisations propres la R.C. sont des organisations de la lutte de classe idologique. Ces organisations semblent avoir t, lorigine, dues des initiatives de la base (cration de cercles, de groupes dtudes, de comits populaires), Comme Lnine l'avait fait pour les Soviets, le P.C.C. en a reconnu limportance, les a soutenues, et en a tendu lexemple toute la R.C., appelant alors ouvertement la constitution dorganisations propres la R.C., chez les ouvriers, les paysans, les intellectuels et la jeunesse. Le P.C.C. prend grand soin de rattacher ces organisations nouvelles aux anciennes organisations, les objectifs nouveaux aux anciens objectifs. Cest ainsi quil est constamment rappel que la R.C. saccomplit sous la direction du Parti, et que les objectifs de la R.C. doivent tre constamment combins, dans les usines et les campagnes, avec les objectifs dj dfinis pour l ducation socialiste , que les organisations dtudiants ne doivent pas intervenir dans les usines ni les units paysannes, o les ouvriers et les paysans assureront eux-mmes la R.C., que la R.C. ne doit pas entraver mais, au contraire, aider la production, etc. En mme temps, le P.C.C. dclare que ce sont les organisations de masse de la jeunesse, principalement de la jeunesse urbaine, donc avant tout des lycens et tudiants, qui sont actuellement lavant-garde du mouvement. Cest une situation de fait, mais dont limportance politique est vidente. Dune part, en effet, le systme denseignement en place, o la jeunesse est forme (il ne faut pas oublier que lEcole marque toujours profondment les hommes, mme pendant les priodes de mutations historiques) tait en Chine le bastion de lidologie bourgeoise et petite-bourgeoise. Dautre part,
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
la jeunesse, qui na pas fait lexprience des luttes et guerres rvolutionnaires, constitue, dans un pays socialiste, un point trs sensible, o se joue une partie davenir capitale. La jeunesse nest pas rvolutionnaire du seul fait de natre dans un pays socialiste, ni de grandir dans les rcits des exploits de ses ans. Si malgr toutes les nergies de son ge, elle se trouve, du fait dune carence politique, abandonne dans un dsarroi ou un vide idologiques, elle est alors livre en fait aux formes idologiques spontanes qui ne cessent de peupler ce vide : idologies petites-bourgeoises et bourgeoises, soit hrites du pass national, soit importes de ltranger. Ces formes trouvent leurs points dappuis naturels dans le positivisme, lempirisme et le technicisme apolitique des savants et autres spcialistes. En revanche, si un pays socialiste associe sa jeunesse une grande uvre rvolutionnaire, sil lduque dans cette action, non seulement la jeunesse contribuera, dans la RC., transformer lidologie existante, mais en luttant contre lidologie bourgeoise, elle se formera elle-mme, et transformera sa propre idologie. Cest en tout tat de cause sur la jeunesse que lidologie, quelle quelle soit, agit avec le plus de force. La question est de savoir quelle idologie doit agir sur la jeunesse dun pays socialiste. Cest une question politique de grande importance. La R.C. rpond en gnral cette question. Les organisations de jeunesse de la R.C. y rpondent pour la jeunesse. Il faut enfin bien noter que lappel la R.C., lappel aux masses, au dveloppement des organisations de masse de la R.C., ses mthodes, et y compris les conditions de la cri tique des dirigeants qui suivent la voie capitaliste , sont le fait du Parti Communiste, qui demeure donc lorganisation matresse, centrale, et dirigeante de la Rvolution chinoise. Il faut noter galement que le Parti fixe, avec la plus grande insistance, la loi thorique et pratique de la R.C., sa loi suprme : la pense de Mao Tstoung , cest--dire le marxisme-lninisme appliqu lexprience de la Rvolution et du socialisme chinois, le marxisme-lninisme enrichi par cette exprience, et exprim dans une forme directement accessible aux masses. La R.C. nest donc pas "exaltation du spontanisme aveugle des masses, ni une aventure politique. Lappel aux masses, la confiance faite aux masses, la cration des organisations de masse rpondent aux besoins et aux possibilits des masses. Mais en mme temps la R.C. est une dcision rflchie du Parti, elle repose sur une analyse scientifique de la situation, et donc sur les principes de la thorie et de la pratique marxistes; en mme temps la loi suprme de la R.C. est, dans la thorie, comme dans la pratique
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
le marxisme-lninisme. Voil pour la conjoncture, les objectifs, les moyens et les mthodes politiques de la R.C. 2 - REVOLUTION CULTURELLE ET PRINCIPES THEORIQUES MARXISTES Naturellement cette analyse politique de la R.C. pose toute une srie de problmes thoriques. La R.C. met en avant, sous ses dcisions, un certain nombre de thses politiques nouvelles: risque de rgression dun pays socialiste vers le capitalisme, maintien de la lutte des classes en rgime socialiste aprs ta transformation, pour lessentiel, des rapports de production, ncessit dune rvolution idologique de masse, et dorganisations de masse propres cette rvolution, etc. Ces thses politiques nouvelles sont-elles ou non conformes la thorie marxiste? a) La thse centrale, qui pose les problmes thoriques les plus importants, est la thse de la possibilit de rgression dun pays socialiste vers le capitalisme. Cette thse heurtera bien des convictions, ancres dans des interprtations idologiques du marxisme (interprtations religieuses, volutionnistes, conomistes). Cette thse est, en effet, impensable si le marxisme est une philosophie de lhistoire dessence religieuse, qui garantit le socialisme en le prsentant comme le but auquel depuis toujours travaille lhistoire humaine. Mais le marxisme nest pas une philosophie de lhistoire, et le socialisme nest pas la fin de lhistoire. Cette thse serait galement impensable si le marxisme tait un volutionnisme. Dans une interprtation volutionniste du marxisme, il y a un ordre de succession ncessaire et garanti des modes de production : par exemple, on ne peut pas sauter par-dessus un mode de production. Dans cette interprtation, on se donne la garantie quon va toujours de lavant donc on exclut en principe tout risque de rgression : du capitalisme on ne peut aller que vers le socialisme, et du socialisme que vers le communisme, pas vers le capitalisme. Et quand, par ncessit, lvolutionnisme admet la rgression , il pense que rgresser cest retourner aux formes anciennes elles-mmes, revenir au pass lui-mme, inchang. Mais le marxisme nest pas un volutionnisme. Sa conception de la dialectique historique admet des dcalages, des
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
10
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
distorsions, des rgressions sans rptition, des sauts, etc. Cest ainsi que, pour le marxisme, certains pays peuvent passer au socialisme sans avoir besoin de passer par le capitalisme. Cest pour cela que la rgression vers un mode de production, en principe dpass, est possible (cf. la Yougoslavie). Mais cest pour cela aussi que cette rgression nest pas un retour pur et simple en arrire, vers un pass intact, vers les formes anciennes: elle seffectue par un processus diffrent, linsertion de formes nouvelles (formellement socialistes) dans le systme du mode de production capitaliste, ce qui produit une forme originale de capitalisme, sous des apparences socialistes. La thse de la rgression serait enfin impossible si le marxisme tait un conomisme. Dans une interprtation conomiste du marxisme, il suffit que les bases conomiques des classes sociales aient t, pour lessentiel, abolies, pour que lon puisse affirmer que les classes sociales ont disparu, et avec elles la lutte des classes, et avec elles la ncessit de la dictature du proltariat, donc le caractre de classe du Parti et de lEtat, pour affirmer que la victoire du socialisme est dfinitivement assure . Mais le marxisme nest pas un conomisme. b) Une classe sociale nest pas dfinie, en effet, uniquement par la position de ses membres dans les rapports de production, donc par les rapports de production : elle est dfinie aussi, et en mme temps, par leur position dans les rapports politiques et les rapports idologiques, lui demeurent des rapports de classe longtemps aprs la transformation socialiste des rapports de production. Sans doute, cest lconomique (les rapports de production) qui dfinit en dernire instance une classe sociale, mais la lutte a es classes constitue un systme, elle sexerce diffrents niveaux (conomique, politique, idologique), et la transformation dun niveau ne fait pas disparatre les formes de la lutte des classes des autres niveaux. Cest ainsi que la lutte des classes peut se poursuivre avec virulence au niveau politique, et surtout au niveau idologique, longtemps aprs la suppression, pour lessentiel, des bases conomiques des classes possdantes, dans un pays socialiste. Cest alors essentiellement en fonction des formes de la lutte de classe politique et surtout idologique que se dfinissent les classes sociales : selon le parti quelles prennent dans les luttes politiques et idologiques. Cela ne veut pas dire que la dtermination des classes sociales par
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
11
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
lconomie soit suspendue. Dans les pays socialistes, et selon les tapes de leur histoire, subsistent certains rapports conomiques (au moins la petite production marchande, qui proccupait tant Lnine) qui constituent une base conomique pour la distinction des classes et la lutte des classes. De mme, des diffrences notables de revenus peuvent servir de points dappui conomiques pour les distinctions ncessaires la survie dune lutte de classes qui se Joue alors, pour lessentiel, ailleurs que dans lconomique : dans le domaine politique, et surtout dans le domaine idologique. c) Voil le point essentiel: la thse de la rgression suppose que, dans une certaine conjoncture de lhistoire des pays socialistes, lidologique puisse tre le point stratgique, o tout se dcide. Cest alors dans lidologique que se situe la croise des chemins. Cest de lidologique que dpend lavenir. Cest dans la lutte de classe idologique que se joue le sort (progrs ou rgression) dun pays socialiste. Cette thse de la possibilit dun rle dominant de lidologique dans une conjoncture politique de lhistoire du mouvement ouvrier ne peut heurter que les marxistes conomistes, volutionnistes et mcanistes, cest--dire ceux qui ignorent la dialectique marxiste. Elle ne peut surprendre que ceux qui confondent contradiction principale et contradiction secondaire, aspect principal et aspect secondaire dune contradiction, changement de place des contradictions et de leurs aspects, etc., bref, ceux qui confondent la dtermination en dernire instance par lconomique avec la domination de telle ou telle instance (lconomique, le politique, lidologique) dans tel ou tel mode de production ou dans telle ou telle conjoncture. Dcider et raliser la R.C. revient donc proclamer deux thses : 1. Cest par lidologique que peut commencer, dans un pays socialiste, le processus de rgression , cest par lidologique que passent les effets qui toucheront progressivement le domaine politique, puis le domaine conomique. 2. Cest en faisant la rvolution dans lidologique, en menant la lutte de classes dans lidologique quon peut empcher et renverser ce processus, et entraner un pays socialiste dans lautre voie: la voie rvolutionnaire . Formellement, la premire thse veut dire: un pays socialiste ayant supprim les bases conomiques des anciennes classes sociales peut croire quil a supprim les classes et de ce fait la lutte des classes. Il petit croire que
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
12
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
la lutte des classes est dpasse, alors quelle continue se jouer dans le domaine politique, et avant tout dans le domaine idologique. Ne pas voir que la lutte des classes peut se drouler par excellence dans le domaine idologique, cest abandonner le domaine de lidologique l idologie bourgeoise, et abandonner le terrain ladversaire. Si ladversaire est dans la place, sans tre identifi comme adversaire et trait comme adversaire, alors cest lui qui mne le jeu, et il ne faut pas s tonner quil gagne du terrain. Il peut sensuivre la mise en place de mcanismes idologiques, politiques et conomiques tendant la restauration du capitalisme. Il peut sensuivre la neutralisation politique, puis lutilisation politique, puis la domination conomique du pays socialiste par limprialisme. Il est en effet impensable quun pays socialiste puisse rester durablement socialiste sil repose en fait sur cette contradiction : tre dot dune infrastructure socialiste, et dune superstructure idologique bourgeoise. La R.C. t ire les conclusions de cette contradiction : il faut faire la rvolution dans lidologique pour donner un pays socialiste dot dune infrastructure socialiste, une superstructure idologique socialiste. Cette thse nest pas nouvelle. On la trouve constamment rappele dans Marx et dans Lnine. Marx disait qu chaque infrastructure doit correspondre une superstructure propre, et que dans la rvolution socialiste non seulement lconomique et le politique, mais aussi lidologique doivent changer de base et de forme. Lnine parlait ouvertement de la ncessit vitale de la rvolution culturelle. Ce qui est nouveau, cest que cette thse thorique est aujourdhui lordre du jour de la pratique politique dun pays socialiste. Pour la premire fois dans lhistoire du mouvement ouvrier, un pays socialiste se trouve la fois dans la ncessit et la capacit de mettre cette thse en uvre, et de lappliquer. Il ne suffit pas de dire: cette thse est, dans son fond, classique. La pratique de sa mise en uvre est quelque chose de tout fait nouveau, qui claire en retour cette thse thorique, et les principes qui la soutiennent. On ne fait pas une rvolution idologique de masse sans apprendre quelque chose de nouveau et sur lidologie et sur les masses. On commence apercevoir ici que la R.C. ne pose pas seulement des problmes thoriques en fonction des principes thoriques existants : elle force lattention sur les connaissances thoriques nouvelles que sa pratique produit, et oblige produire.
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
13
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
d) Cest ainsi que la R.C. met en jeu les principes marxistes concernant la nature de lidologique. Rvolution culturelle veut dire, en effet, rvolution dans le domaine de lidologique. Quest-ce que le domaine de lidologique? La thorie marxiste montre que toute socit comporte trois niveaux, instances, ou domaines spcifiques : lconomique infrastructure le politique } superstructure lidologique Ces niveaux sont articuls les uns sur les autres dune manire complexe. Cest lconomique qui est dterminant en dernire instance. Lorsquon se sert dune mtaphore architecturale (celle dune maison : infrastructure/superstructure) on dit que lidologique reprsente un des niveaux de la superstructure. Cest pour indiquer la fois sa position dans la structure sociale, (superstructure et non infrastructure), son autonomie relative par rapport au politique et lconomique, et en mme temps ses relations de dpendance par rapport au politique et lconomique. Si, en revanche, on veut suggrer la forme dexistence concrte de lidologique, il vaut mieux le comparer un ciment , plutt qu ltage dun btiment. Lidologie se glisse, en effet, partout dans les pices de ldifice : dans le rapport des individus toutes leurs pratiques, tous leurs objets, dans leurs rapports la science, la technique, aux arts, dans leurs rapports la pratique conomique et la pratique politique, dans les rapports individuels , etc. Lidologique est ce qui, dans une socit, distingue et cimente, quil sagisse de distinctions techniques ou de distinctions de classe. Lidologique est une ralit objective indispensable lexistence de toute socit. Bien que lidologique rgle les rapports vcus des individus leurs conditions dexistence, leurs pratiques, leurs objets, leurs classes, leurs luttes, leur histoire et leur monde, etc., lidologique nest pas de nature individuelle ou subjective. . Comme tous les niveaux de la socit, lidologique est fait de rapports sociaux objectifs. Comme il existe des rapports sociaux de production (conomiques), il existe des rapports sociaux politiques, et des rapports sociaux idologiques . Cette dernire expression est de Lnine (dans Ce que sont les Amis du Peuple ). Il faut la prendre au pied de la lettre. Pour
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
14
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
connatre lidologique, il faut connaitre ces rapports sociaux, et ce dont ces rapports sont faits. De quoi ces rapports sont-ils faits? Ils sont faits non seulement de systmes dides-reprsentations, mais aussi de systmes dattitudescomportements, donc de systmes thoriques et de systmes pratiques . Lidologique comprend donc non seulement les systmes dides (les idologies au sens troit), mais aussi les systmes pratiques dattitudes-comportements (les murs). Ides et murs sont en rapport dialectique. Selon la situation de classe, et selon la conjoncture, il peut y avoir identit gnrale ou partielle, ou dcalage ou contradiction entre les ides et les murs, et selon leurs rgions. Dans la lutte idologique, il est trs important de reconnatre les ides et les murs qui incarnent le parti de lidologie adverse, comme il est trs important de savoir faire entre les ides, ou entre les ides et les murs, les distinctions requises. Les grands rvolutionnaires ont toujours su faire ces distinctions et garder du pass ce qui est bon , rejeter du pass ce qui est mauvais , dans les ides comme dans les murs. Quoi quil en soit, une rvolution idologique doit ncessairement tre une rvolution non seulement dans les ides ou idologies , mais aussi dans les attitudes et comportements pratiques, ou murs. Cette double nature de lidologique permet de comprendre que des tendances idologiques peuvent tre inscrites dans certains comportements et dans certaines attitudes pratiques aussi bien que dans des ides. Elle permet de comprendre que certaines coutumes ou habitudes de travail et de commandement , certain style de direction, peuvent avoir une signification idologique, et tre contraires lidologie rvolutionnaire, mme quand ils son t le fait de dirigeants socialistes. Lidologie bourgeoise peut ainsi trouver appui dans certaines pratiques, cest--dire dans certaines murs, politiques, technicistes, bureaucratiques de dirigeants socialistes, etc., exactement comme lidologie bourgeoise trouve appui dans lattitude positiviste ou pragmatiste des hommes de science, des techniciens, etc. Ces habitudes de travail et de commandement , si elles se multiplient, ne sont plus des manies ou des travers personnels : elles peuvent tre ou devenir des signes de distinction sociale, des prises de parti (inconscientes ou non) dans la lutte de classe idologique. Par exemple, le comportement bureaucratique ou technocratique des dirigeants, quils soient conomiques, politique ou militaires, peuvent constituer autant de points dappui, dans le
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
15
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
domaine idologique dun pays socialiste, pour loffensive idologique de la bourgeoisie. Si la R.C. prend au srieux cette menace, cest quelle se conforme la thorie marxiste de lidologique. Mais en mme temps, pour lavoir prise au srieux, elle oblige lapprofondir, et donc la faire progresser. e) La RC. met enfin en jeu les principes du marxisme propos de ses formes dorganisation. La thse du P.C.C. suppose, en effet, quil existe des organisations de masse propres la R.C., donc que ces organisations soient distinctes du Parti. Ce qui manifestement fait problme, pour beaucoup de communistes, cest lexistence de ces organisations nouvelles, distinctes du Parti. La question des organisations de la lutte des classes, et de leur distinction, est une vieille question de lhistoire du mouvement ouvrier. Elle a t rgle par Marx, Engels et Lnine en ce Qui concerne la distinction de lorganisation de la lutte de classe conomique (le syndicat) et de lorganisation de la lutte de classe politique et idologique (le parti). Cette distinction des fonctions allait de pair avec une distinction dans la forme dorganisation. Le syndicat tait une organisation de masse (sans centralisme dmocratique). Le Parti tait une organisation davant-garde (avec centralisme dmocratique). Jusquici le Parti tait donc charg la fois de la lutte politique et de la lutte idologique. La R.C. apporte une innovation tonnante, en crant une nouvelle, une troisime organisation : une organisation propre la lutte idologique de masse. Sans doute elle est charge d appliquer les dcisions du Parti. Mais elle est distincte de lui. De plus, elle se distingue du Parti en ce quelle est, comme le syndicat, une organisation de masse (le centralisme dmocratique ny rgne pas : il est dit que les responsables des organisations de la R.C. doivent tre lus comme les dputs la Commune de Paris ). Cette innovation tonnante est-elle conforme aux principes thoriques du marxisme? Formellement, on peut dire que la distinction des organisations reflte la distinction des instances ou niveaux de la ralit sociale. Une organisation de masse pour le niveau de lconomique (le syndicat) ; une organisation davant-garde pour le niveau du politique (le Parti); et une organisation de masse pour le niveau de lidologique (les organisations de la R.C.). Mais il faut peut-tre aller p lus loin, et se demander pourquoi cette troisime organisation, qui nexistait pas jusquici, et que ni Marx ni Lnine
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
16
[Attribu Louis Althusser]: Sur la rvolution culturelle
Anonyme [attribu Louis Althusser]
navaient formellement prvue, est dsormais indispensable dans un pays socialiste. On peut avancer, avec prudence, mais non sans fortes raisons, que la rponse cette question peut se trouver dans le changement de position du parti et du syndicat lgard de lEtat en rgime socialiste. Aprs la prise rvolutionnaire du pouvoir, dans la priode de dictature du proltariat, le Parti doit prendre en charge la direction de l Etat, du pouvoir dEtat et de lappareil dEtat. Une fusion partielle, mais invitable, sopre alors entre le Parti et lappareil dEtat. Ainsi se pose un trs grave problme, que Lnine a pos en termes dramatiques dans les textes de la fin de sa vie (cf. LEpuration du Parti. Sur lInspection ouvrire et paysanne, etc.) : comment rgler les rapports du Parti et de lEtat pour viter de tomber dans les dfauts de la bureaucratie et de la technocratie, et leurs graves effets politiques? Lnine a cherch la solution de ce problme dans un organisme : lInspection ouvrire et paysanne. Cet organisme tait une manation du Parti. Ce ntait pas une organisation propre. A plus forte raison, ce n tait pas une organisation de masse. Au problme pos par Lnine en termes dramatiques (il avait conscience que sa solution tait au-dessus des forces historiques alors existantes en U.R.S.S.), le P.C.C. rpond, quarante ans plus tard, par la R.C. Il y rpond par la mise en place non pas dun organisme de contrle des rapports Parti-Etat, mais par la mise en place dun mouvement de masse et dorganisations de masse, dont la tche principale actuelle consiste, dans la R.C., dnoncer et critiquer les dirigeants qui se coupent des masses, qui ont un comportement bureaucratique ou technocratique, qui par leurs ides ou par leurs murs , habitudes de vie, de travail et de commandement, abandonnent la voie rvolutionnaire et sengagent dans la voie capitaliste . La R.C. apporte ainsi une solution tout fait nouvelle au problme pos par Lnine. La troisime organisation, charge de la troisime rvolution, doit tre distincte du Parti (dans son existence, et dans sa forme dorganisation) pour obliger le Parti se distinguer de lEtat, dans une priode o il est en partie contraint et en partie tent de se confondre avec lEtat. Si ces analyses sont, malgr leur caractre schmatique, justes dans le principe, il est clair que la R.C. intresse, directement ou indirectement, tous les communistes.
Dcalages
Volume I: Issue 0
Produced by The Berkeley Electronic Press, 2010
17
Dcalages, Vol. 1 [2010], Iss. 1, Art. 8
Sur la revolution culturelle
Le grand intrt politique et thorique de la R.C. est de constituer un rappel solennel de la conception marxiste de la lutte de classes et de la rvolution. La question de la rvolution socialiste nest pas rgle dfinitivement par la prise du pouvoir, et la socialisation des moyens de production. La lutte de classes continue sous le socialisme, dans un monde soumis aux menaces de limprialisme. Cest alors, avant tout, dans lidologie que la lutte de classes dcide du sort du socialisme : progrs ou rgression, voie rvolutionnaire ou voie capitaliste. Les grandes leons de la R.C. dpassent et la Chine et les autres pays socialistes. Elles intressent tout le mouvement communiste international. Elles rappellent que le marxisme nest ni une religion de lhistoire, ni un volutionnisme, ni un conomisme. Elles rappellent que le domaine de lidologique est un des champs de la lutte de classes, et quil peut devenir le lieu stratgique, o, dans certaines circonstances, se joue le sort de la lutte des classes. Elles rappellent quil existe un li en extrmement profond entre la conception thorique du marxisme et la lutte de classe idologique. Elles rappellent que toute grande rvolution ne peut tre que luvre des masses, et que le rle des dirigeants rvolutionnaires est, tout en donnant aux masses les moyens de sorienter et de sorganiser, tout en leur donnant pour boussole et pour loi le marxisme-lninisme, de se mettre lcole des masses, pour pouvoir ensuite les aider exprimer leur volont, et rsoudre leurs problmes. Il ne sagit pas dexporter la R.C. Elle appartient la Rvolution chinoise. Mais ses leons thoriques et politiques appartiennent tous les communistes. Ces leons, les communistes doivent les emprunter la R.C., et en faire leur bien.
Dcalages
Volume I: Issue 0
http://scholar.oxy.edu/decalages/vol1/iss1/8
18
Vous aimerez peut-être aussi
- Correction Analyse de Document Sur Le Printemps Des PeuplesDocument2 pagesCorrection Analyse de Document Sur Le Printemps Des PeuplesLudivine MauchausséePas encore d'évaluation
- Jacques Derrida L'Ecriture Et La DifferenceDocument437 pagesJacques Derrida L'Ecriture Et La DifferenceVeronica Olariu100% (9)
- Moncomble Yann - L'irrésistible Expansion Du Mondialisme PDFDocument252 pagesMoncomble Yann - L'irrésistible Expansion Du Mondialisme PDFSérgio Renato Del Rio100% (1)
- 6752 f120744d PDFDocument20 pages6752 f120744d PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- Le Château Et La Châtellenie de La Bruyère-L'AubépinDocument10 pagesLe Château Et La Châtellenie de La Bruyère-L'AubépinJean-Pierre MolénatPas encore d'évaluation
- Biographie de StalineDocument2 pagesBiographie de Stalineaziz ben aissaPas encore d'évaluation
- L'intelligence de La PolitiqueDocument172 pagesL'intelligence de La PolitiqueСергей Ермаков100% (1)
- Etienne Balibar, Sur La Cause Absente Dans La Théorie Politique de Freud "Psychologie Des Masses" A 100 Ans - Collectif de PantinDocument21 pagesEtienne Balibar, Sur La Cause Absente Dans La Théorie Politique de Freud "Psychologie Des Masses" A 100 Ans - Collectif de PantinYoshiyuki SatoPas encore d'évaluation
- Jacques Rancière C'est Vrai Que L'alibi Littéraire' A Servi À Rendre Plus Fréquentables Certaines Idées (Les Trente Inglorieuses)Document15 pagesJacques Rancière C'est Vrai Que L'alibi Littéraire' A Servi À Rendre Plus Fréquentables Certaines Idées (Les Trente Inglorieuses)Yoshiyuki SatoPas encore d'évaluation
- Prog Homo SacerDocument2 pagesProg Homo SacerYoshiyuki SatoPas encore d'évaluation
- Bourgeois R. La France Des RégionsDocument138 pagesBourgeois R. La France Des RégionsVeronicaPas encore d'évaluation
- Situation Classe OuvriereDocument270 pagesSituation Classe OuvrierelouiscalafertePas encore d'évaluation
- Etienne BALIBAR - Remarque de Circonstance Sur Le CommunismeDocument13 pagesEtienne BALIBAR - Remarque de Circonstance Sur Le CommunismeantriccaPas encore d'évaluation
- Dates de L'histoire en France, en Bretagne Et À RoscoffDocument33 pagesDates de L'histoire en France, en Bretagne Et À RoscoffWebmaster100% (5)
- Hilton Root La Construction de L Etat Moderne en Europe ICDocument401 pagesHilton Root La Construction de L Etat Moderne en Europe ICAAAA00001111Pas encore d'évaluation
- André Siegfried, L'âme Des Peuples (1950) PDFDocument117 pagesAndré Siegfried, L'âme Des Peuples (1950) PDFAnonymous WE5dIf7BHPas encore d'évaluation
- PerestroïkaDocument6 pagesPerestroïkaMarco RodriguezPas encore d'évaluation
- Georg Lukacs Mon Chemin Vers MarxDocument27 pagesGeorg Lukacs Mon Chemin Vers MarxJean-Pierre Morbois100% (1)
- MICHEL BAKOUNINE: ŒUVRES Tome IV (P.-V STOCK, ÉDITEUR, 1895)Document385 pagesMICHEL BAKOUNINE: ŒUVRES Tome IV (P.-V STOCK, ÉDITEUR, 1895)Bibliotecário da Silva100% (1)
- LH - JUNIORS 6 - 1848 - A ImprimerDocument4 pagesLH - JUNIORS 6 - 1848 - A ImprimerRyme AllaguiPas encore d'évaluation
- The Millionaire Next Door (Book) - MANTESH - Pdf.compressedDocument166 pagesThe Millionaire Next Door (Book) - MANTESH - Pdf.compressedStivy Wendpenga0% (2)
- Studii. Revista de Istorie, 1957Document226 pagesStudii. Revista de Istorie, 1957Adrian Geo100% (1)
- Ludd Contre LénineDocument80 pagesLudd Contre LénineEmile ChaverondierPas encore d'évaluation
- Revolution Annee 1789 EvaluationDocument1 pageRevolution Annee 1789 EvaluationJean-Philippe Solanet-Moulin100% (2)
- Le RéalismeDocument21 pagesLe RéalismeAbir AjroudiPas encore d'évaluation
- CasanovaDocument6 pagesCasanovaLukPas encore d'évaluation
- Urss 1923-1940 PDFDocument43 pagesUrss 1923-1940 PDFAntonio AraujoPas encore d'évaluation
- 6 6757 87551a99 PDFDocument24 pages6 6757 87551a99 PDFSAEC LIBERTEPas encore d'évaluation
- Zibel62 PDFDocument80 pagesZibel62 PDFGilles MalatrayPas encore d'évaluation
- Le Volontaire de 92Document540 pagesLe Volontaire de 92Raibaut PamiPas encore d'évaluation
- Discours Du Grand Rabbin Au Cimetière de PragueDocument11 pagesDiscours Du Grand Rabbin Au Cimetière de Praguejuliusevola1100% (2)