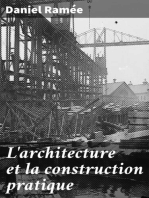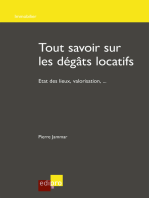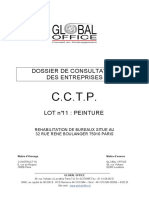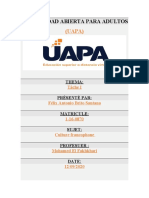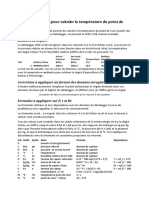Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Totures
Totures
Transféré par
J GastonTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Totures
Totures
Transféré par
J GastonDroits d'auteur :
Formats disponibles
Mmento technique
du btiment
les outils
CETE
Nord Picardie
pour le charg dopration de constructions publiques
Les toitures
Certu
MEMENTO TECHNIQUE DU BATIMENT
pour le charg dopration de constructions publiques.
LES TOITURES
Juillet 2003
Ministre de l'quipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme et de la Mer.
Centre dtudes sur les rseaux, les transports,
lurbanisme et les constructions publiques.
Certu
3
SOMMAIRE
1. LES ENJEUX................................................................................................................. 5
2. GENERALITES SUR LES TOITURES........................................................................ 6
3. LES CHARPENTES...................................................................................................... 6
3.1. Les charpentes en bois................................................................................................ 6
3.2. Les charpentes mtalliques......................................................................................... 8
3.3. Les charpentes lgres poutrelles en I ..................................................................... 8
4. LES TOITURES INCLINEES ....................................................................................... 9
4.1. Les couvertures en petits lments............................................................................. 9
4.1.1. Les ardoises naturelles...................................................................................... 10
4.1.2. Les tuiles........................................................................................................... 10
4.1.3. Points de vigilance ........................................................................................... 11
4.2. Les couvertures en grands lments ......................................................................... 12
4.2.1. Couvertures en plaques mtalliques................................................................. 12
4.2.2. Couvertures en feuilles et longues feuilles mtalliques ................................... 14
4.2.3. Points de vigilance ........................................................................................... 14
4.3. Le choix dun matriau de couverture...................................................................... 15
5. LES TOITURES TERRASSES ................................................................................... 16
5.1. La classification des toitures terrasses en fonction de leur accessibilit et de leur
utilisation.............................................................................................................................. 16
5.2. Conception globale................................................................................................... 17
5.3. Les matriaux employs et leurs particularits demploi ......................................... 18
5.3.1. Llment porteur ......................................................................................... 18
5.3.2. Le pare-vapeur .............................................................................................. 19
5.3.3. Lisolant thermique ...................................................................................... 19
5.3.4. Le systme de liaisonnement du revtement dtanchit lisolant ......... 20
5.3.5. Le revtement dtanchit .......................................................................... 21
5.3.6. La protection du revtement dtanchit .................................................... 25
5.4. Les points singuliers des toitures-terrasses............................................................... 26
5.4.1. Leur rle important dans la qualit................................................................... 26
4
5.4.2. Diffrents types de points singuliers ................................................................ 27
5.4.3. Implantation et espacement entre ces points singuliers.................................... 28
5.5. Les toitures jardins et les toitures vgtalises......................................................... 29
5.5.1. Gnralits........................................................................................................ 29
5.5.2. Constitution dune toiture terrasse jardin ou vgtalise ................................. 31
5.5.3. Entretien spcifique des toitures terrasse jardin ou vgtalises...................... 32
5.6. Lentretien des toitures terrasse................................................................................ 32
5.6.1. Ncessit de lentretien .................................................................................... 32
5.6.2. Frquence et teneur .......................................................................................... 33
5.7. La rfection des toitures-terrasse.............................................................................. 34
6. Lvacuation DES EAUX PLUVIALES..................................................................... 35
6.1. Les gouttires ........................................................................................................... 35
6.2. Les chneaux ............................................................................................................ 36
6.3. Les descentes deaux pluviales................................................................................. 36
6.4. Lentretien ................................................................................................................ 37
6.5. La gnoise................................................................................................................. 37
7. GLOSSAIRE................................................................................................................ 39
8. BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET.................................................................. 41
Les toitures
5
1. LES ENJEUX
En tant que paroi extrieure, la toiture est une composante de lenveloppe dun btiment; elle
en est en quelque sorte la cinquime faade et les qualits qui lui sont demandes
rejoignent celles des faades.
Stabilit et rsistance structurelle toutes les actions susceptibles dintervenir pendant la
dure de vie. La toiture doit prsenter une bonne rsistance mcanique aux surcharges
atmosphriques : neige et vent ; aux chocs : grle ; aux circulations du personnel dentretien.
Scurit au feu : raction et rsistance au feu provenant soit dun feu intrieur soit dun feu
extrieur voisin, dictes par la rglementation incendie.
Isolation thermique. Cette fonction concerne principalement les toitures terrasses mais les
toitures inclines peuvent galement y participer.
Isolation acoustique : La toiture peut constituer un point faible dans l'enveloppe d'un
btiment. Les points de vigilance concernent notamment l'isolement vis vis des bruits
ariens provenant de l'extrieur, les bruits d'impacts que la pluie est susceptible de gnrer
(couvertures en tle) ou encore les sifflements provoqus par le vent.
Impermabilit leau. En complment de cette impermabilit, la couverture est charge de
diriger cette eau rapidement vers les dispositifs dvacuation.
tanchit la neige poudreuse et la poussire. Celles-ci tant susceptibles de pntrer
entre les lments de couverture sous leffet du vent, il est ncessaire, dans certains cas, de
recourir des dispositions particulires (crans de sous-toiture) assurant un complment
dtanchit.
Stabilit au vent. Le poids de la toiture doit tre tel que le vent ne puisse la soulever par la
dpression quil cre ; toutefois ce poids ne doit pas surcharger la charpente.
Image (esthtique). A linstar des revtements de faade, les divers matriaux de couverture
apportent une contribution larchitecture de par leur varit de couleurs, de formes,
daspects et de texture. Mais les rgles durbanisme imposent souvent de recourir un
matriau local afin de ne pas tre en opposition avec les constructions voisines.
Durabilit et maintenabilit. Les matriaux de couverture doivent avoir une aptitude
correcte au vieillissement sans altration notable et surtout irrgulire des couleurs. Ils doivent
galement prsenter une bonne tenue au gel et aux chocs thermiques successifs, tels quun
brusque refroidissement aprs un orage la fin dune journe ensoleille dt.
Respect de lenvironnement :
La qualit environnementale de lenveloppe dun btiment (et des constructions en gnral) se
traduit par une dmarche globale intgrant notamment lutilisation de matriaux et procds
conomes en matire premire et en nergie pour leur fabrication, de matriaux locaux, de
matriaux produisant peu de dchets lors de leur mise en oeuvre, de matriaux dont le
recyclage est possible aprs dconstruction. Il nexiste pas pour le moment de certification
concernant les produits respectueux de lenvironnement.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
6
2. GENERALITES SUR LES TOITURES
La toiture dun immeuble se dcompose en deux sous-ensembles : la charpente, dune part, et
la couverture, dautre part.
En outre, une distinction est faite entre deux catgories de toiture : les toitures inclines, qui
proposent de nombreux matriaux de couverture, et les toitures-terrasse qui sont ainsi
nommes lorsquelles prsentent une pente infrieure 15% (Cf Dicobat).
3. LES CHARPENTES
La charpente, support de la couverture, est la plupart du temps en bois mais les charpentes
mtalliques sont galement rencontres.
3.1. Les charpentes en bois
Il existe trois types diffrents de charpente en bois :
- La charpente en bois traditionnelle qui est compose dun assemblage dlments en bois
constituant des fermes, elles mmes soutenant des pannes et des chevrons en bois.
- La charpente en bois industrialise, dnomme fermette. Prfabrique et plus lgre que
la charpente en bois traditionnelle, elle ne comporte ni pannes ni chevrons, la couverture
est directement pose sur ces fermettes. Les fermettes sont de faible paisseur (36 47 mm
environ) et sont relies par des pices de contreventement et dantiflambement. Ce type de
charpente permet des portes plus importantes que la prcdente.
- La charpente en bois lamell-coll. Cette technique permet de constituer des
quarrissages introuvables naturellement par collage de lamelles de bois avec des mises en
forme particulires. Les portes possibles sont trs importantes.
Les toitures
7
Charpente bois traditionnelle Charpente bois industrialise Charpente bois lamell-coll
Avantages
- Technique matrise et bien
connue.
- Gage de prennit.
- Esthtique si elle est destine
rester apparente.
- Meilleure rsistance au feu
que les charpentes mtalliques.
- Les sections de bois sont
rduites ce qui entrane moins
de charges et, ainsi, des murs
porteurs moins consquents
quen charpente bois
traditionnelle.
- Les faibles sections de bois
sont le gage dun traitement
cur.
- Adapte aux grandes
portes, elle permet de
dgager des surfaces au sol
sans porteurs verticaux
intermdiaires (poutres,
refends) ce qui est
intressant pour la
construction de vastes halls
(gymnase, hangars,...).
- Multiples possibilits
architecturales.
- Meilleure rsistance au feu
que les charpentes
mtalliques.
Inconvnients
- Assemblages bois sur bois
entailles, plus performants en
compression quun traction.
- Reconduction empirique
dquarrissages
prdimensionns par des
habitudes locales de sciage.
- Avec les fermettes pour
combles perdus,
lamnagement ultrieur des
combles est difficile et
coteux, voire impossible. La
surface en combles est alors
perdue car encombr par les
lments de triangulation des
fermettes.
- Ncessite une tude
particulire, surtout pour les
charpentes extrieures
(exposes aux intempries).
- Doit faire lobjet dune
fabrication particulire en
usine.
- Les contraintes de transport
des grands lments entre
lusine et le lieu de pose
renchrissent les cots.
- Pour de trs grandes
portes, les poutres peuvent
atteindre 2 m de large.
Porte
Les inconvnients prcits
conduisent un
surdimensionnement crant
des ouvrages lourds ainsi que
des murs porteurs consquents.
Ds lors, cette charpente nest
utilise que pour des portes
nexcdant pas 10 mtres.
La porte peut atteindre 40
mtres.
Thoriquement illimite, des
portes suprieures 100 m
peuvent tre atteintes.
Espacement des
lments
Entre fermes : jusqu 4 m
Entre pannes : jusqu 2,50 m
Entre chevrons : 0,35 0,40 m
Entre fermettes, lentraxe est
de lordre de 0,5 1,5 m
maximum.
De 5 10 m environ.
Points de
vigilance
- utiliser des bois secs afin
dviter les retraits,
dformations et fentes
importantes.
- Concernant les transport des
fermettes, il est conseill de
les transporter verticalement
afin dviter leur
dsarticulation (DTU 31.1 art
7.1)
Attention en ce qui concerne lutilisation des charpentes bois industrialises (fermettes), des
pathologies rcurrentes sont observes par lAgence Qualit Construction (AQC) ;.il sagit de
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
8
dformations des fermettes pouvant aboutir leffondrement de la toiture. Elles sont dues
labsence ou la mauvaise mise en place des barres de contreventement et dantiflambement ;
ces dfauts de mise en oeuvre sont surtout le fait dentreprises non spcialises dans la
technique. En consquence, il faut veiller ce quun plan de pose dtaill et explicite quant
la position et aux liaisons des barres rapportes soit tabli et joint la livraison.
En matire de rsistance au feu, il est admis que la vitesse de destruction en profondeur par le
feu est de lordre de 0,7 mm par minute et par face expose dans le cas de bois rsineux
utiliss couramment en charpente (DTU 31.1 art 4.1.3.2). Ce qui explique que les charpentes
en bois massif aient une meilleure rsistance au feu que les charpentes mtalliques, lacier
devenant mou au-dessus de 600C lorsquil nest pas protg.
3.2. Les charpentes mtalliques
Il sagit pour lessentiel de charpentes en acier mais elles peuvent galement tre ralises en
alliage daluminium pour obtenir des charpentes plus lgres.
Lutilisation de charpentes mtalliques pour certains types de constructions repose sur les
particularits suivantes :
* leurs qualits mcaniques de rsistance, de fiabilit et de tenue ;
* leur facilit de fabrication et de mise en oeuvre ;
* leur lgret ;
* leur cot.
En revanche, elles entranent des contraintes particulires pour les protger de llvation de
temprature lors dun incendie. On protge lacier en le recouvrant de peintures
intumescentes, de flocage, de pltre ou de laine de roche ou en lisolant laide de coffrages
de protection.
Les profils constituant les charpentes mtalliques sont assembls par lintermdiaire de
goussets, pattes, querres et laide de boulons haute rsistance (HR) serrage contrl, par
rivetage ou par soudage.
Lattention doit surtout tre porte la phase chantier o lon peut rencontrer des erreurs de
montage telles que :
* dfaut de contreventement ;
* inobservation, lors de soudage sous intempries, des prcautions adquates prendre ;
* emploi de boulons ordinaire la place de boulons HR (daspect identique, seul le
marquage permet de les diffrencier) ;
* serrage des boulons HR ne respectant pas lordre prescrit.
3.3. Les charpentes lgres poutrelles en I
Les poutrelles section en I de ce type de charpente sont constitues de deux membrure de
section rectangulaires et dune me mince. Leur porte dpasse rarement 10m.
Les toitures
9
Le procd le plus couramment rencontr est la poutre
NAIL-WEB qui est ralise avec des membrures en bois
massif et une me ondule en tle, les dents de cette me
tant enfonce par pressage dans les membrures (voir ci-
contre).
Dautres procds existent qui associent des membrures en bois massifs ou lamell-coll et
des mes mtalliques ou en panneau de particules ou encore en panneau de fibres (Nordex,
Poutralpha, Mega Poutre, Trica, Optipanne, Solipanne,... ).
Lemploi de ces poutrelles est du domaine non traditionnel et nest donc pas vis par une
norme (DTU). En consquence, il est prfrable de sassurer que le procd envisag a un avis
technique favorable et de prendre connaissance de ce dernier notamment en ce qui concerne le
comportement en cas dincendie.
Pour information, ces poutrelles sont galement utilises pour la ralisation de planchers.
4. LES TOITURES INCLINEES
Il sagit des toitures de pente suprieure 15%. Les matriaux de ces couvertures sont
nombreux, la mise en oeuvre de la plupart dentre eux est normalise travers les DTU de la
srie 40 qui comporte actuellement 18 DTU.
Mais attention, la majorit de ces DTU ne traite pas des couvertures prvues une altitude
suprieure 900m. Dans ce cas il convient de faire une tude particulire ; sinon, il existe
galement un guide des couvertures en climat de montagne (voir les rfrences dans la
bibliographie).
Ne sont cits ci-aprs que les matriaux de couvertures du domaine traditionnel (sous DTU).
Il sagit des matriaux les plus frquemment rencontrs mais il en existe dautres pour
lesquels il convient de consulter leur avis technique afin de connatre leurs particularits et
domaine demploi (ex : les tuiles en terre cuite canal paulement).
La manire la plus classique de classifier les matriaux de couverture est de retenir les
dimensions des lments : couvertures en petits lment dune part et en grands lments
dautre part.
4.1. Les couvertures en petits lments
Suivant leur nature et dimensions unitaires, il faut compter de 7 80 lments au mtre carr.
Par ailleurs, leur mise en oeuvre implique une main duvre qualifie. Ces deux lments
entranent des cots de pose relativement levs.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
10
4.1.1. Les ardoises naturelles
Elles sont dcoupes dans une roche schisteuse (le phyllade) qui a comme particularit davoir
une structure lamellaire entirement oriente dans un mme plan. La roche est dbite en
plaques de faibles paisseurs dans lesquelles sont dcoups les lments de couverture.
Les gisements se trouvent en Anjou (Angers-Trlaz), dans les
Ardennes, en Bretagne, dans les Alpes et galement dans les
Pyrnes. Les ardoises sont la plupart du temps de couleur gris-
bleu, plus rarement violettes ou verdtres mais toujours avec
un fond gris et cette teinte dpend du gisement.
Carres ou rectangulaires, avec ou sans bords arrondis, un
grand nombre de dimensions est disponible et le choix est
surtout fonction de la rgion dutilisation ainsi que de la pente
et lexposition de la toiture.
Les ardoises sont poses de telle manire quil y ait un
recouvrement de trois paisseurs quelque soit le point de la
couverture. Elles sont toutes fixes leur support soit par
clouage soit par lintermdiaire de crochets en acier galvanis
ou inoxydable ou encore en cuivre.
4.1.2. Les tuiles
On peut diffrencier trois grandes familles.
Les tuiles embotement ou glissement, galement
appeles tuiles mcaniques. Fabriques en terre cuite ou en
bton, il en existe deux grandes familles de format : les
tuiles grand moule dont le nombre au mtre carr est
infrieur ou gal 15 et les tuiles petit moule pour lesquels
ce nombre est strictement suprieur 15.
Les tuiles plates. En terre cuite ou en bton, elles se
posent de manire similaire lardoise la diffrence
quelles sont munies dun nez leur permettant de
saccrocher aux liteaux.
En gnral de forme rectangulaire, elles ont des
dimensions qui sont denviron 16x27 cm. ; leur nombre au
mtre carr est variable de 40 80 environ, il est fonction
des dimensions des tuiles et du recouvrement ralis.
Ardoise en caille et modle
rectangulaire
Tuile losange et tuile romane
Principe de recouvrement des tuiles plates
Les toitures
11
Il existe des modles de tuiles plates en terre cuite qui sont
vernisss, on les rencontre plus particulirement en
monuments historiques et btiments religieux.
Les tuiles canal (ou tuiles creuses ou romaines ou encore
tiges de botte). Exclusivement en terre cuite, leur origine
remonte lantiquit ; elles ont une forme tronconique
demi-ronde. De longueur 25 60 cm, leur largeur vase
est de 16 21 cm. et leur nombre au mtre carr va de 20
40.
La tuile de couvert (imbrex) est place concavit vers le
bas et est pose cheval sur deux tuiles contigus appeles
tuiles de courant (tgula) disposes concavit vers le haut.
4.1.3. Points de vigilance
Pour les couvertures en ardoises :
* Outre la mise en oeuvre, il convient galement de prendre garde ce que les ardoises
proviennent bien du mme gisement car leur couleur varie en fonction de celui-ci. Toutefois,
pour un gisement donn, le ton et le reflet peuvent varier lgrement ; ces diffrences sont
dues au caractre naturel du matriau et sont prises en compte par les norme NF P 32-301 et
302 qui dfinissent les caractristiques gnrales et les spcifications des ardoises de
couverture.
* Les ardoises qui ont des inclusions de pyrite (sulfure de fer) oxydable entranent des
coulures de rouille sur les toitures. La norme NF P 32-302 rparti les ardoises en trois classes
A, B et C en fonction, notamment, de limportance de ces inclusions. Les ardoises de classe C
sont les plus sujettes des coulures de rouille dues aux inclusions de pyrites mais il faut
savoir que ce dfaut nest quinesthtique, il nenlve rien la fonction couverture et le choix
dardoises de classe A entrane une plus-value.
* La fixation par crochet, bien quinesthtique, est prfrable au clouage car elle prsente
lavantage de faciliter les travaux de rfection de couverture. En revanche, ce mode de
fixation nest pas toujours autoris en btiments historiques pour lesquelles une pose par
clouage simpose souvent.
* Il existe sur le march des ardoises en fibre-ciment, sous avis technique, sans DTU.
Attention, ce matriau prsente des risques de dcoloration, les ardoises devenant blanches.
Pour les couvertures en tuiles :
* Contrairement aux ardoises et dune manire gnrale, toutes les tuiles ne sont pas
obligatoirement fixes. Cela permet aux tuiles non fixes de jouer un rle de fusible en cas de
tempte : elles sont emportes par le vent et permettent au restant de la couverture de ne pas
tre arrache. Si toutes les tuiles taient fixes, la dpression cre par une tempte risquerait
demporter la totalit de la couverture. Ce sont les DTU qui fixent, en fonction de la pente et
de la rgion climatique, le nombre et la rpartition des tuiles fixer ainsi que les cas
particuliers, il en existe nanmoins, o toutes les tuiles doivent tre fixes. En consquence, il
Tuiles canal poses sur chevrons
rectangulaires
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
12
faut faire attention de bien respecter ces prescriptions de fixation, ni plus ni moins, et ne pas
accepter dun Matre dOeuvre quil exige, par scurit, que lentreprise fixe toutes les tuiles
si le DTU ne le demande pas.
* Avec les tuiles en bton il ny a pas de problmes de glivit que lon peut quelquefois
rencontrer avec les tuiles en terre cuite qui nont pas le marquage NF.
Dune manire gnrale, pour les couvertures en ardoises et en tuiles :
* Ces matriaux, et en particulier les ardoises, sont fragiles et des prcautions sont prendre
pour circuler sur les toitures qui en sont recouvertes afin de ne pas les casser : interposition
dchelles plates, de planches,...
* Faire en sorte que lentrepreneur laisse au Matre dOuvrage ou au gestionnaire du btiment
un stock dlments de remplacement provenant du mme lot que les ardoises ou tuiles qui
ont t poses. Si possible, les entreposer dans les combles.
* Les DTU prvoient que dans certaines rgions un cran de sous-toiture soit dispos sous les
lments de couverture. Cet cran sert crer une barrire dtanchit la neige poudreuse
qui sinfiltre entre les joints et recouvrements des couvertures en petits lments. On peut
toutefois recommander de prvoir la pose dun cran de sous-toiture mme dans les cas o le
DTU ne lexige pas, cela permet davoir une tanchit leau correcte en cas denvol de
tuiles par exemple. Mais il faut galement prendre garde ce que cette disposition naille pas
lencontre de la ventilation de la sous-toiture. Dune manire gnrale, il convient de choisir
un cran qui est sous avis technique.
* Concernant lentretien de ces couvertures il faut notamment veiller lenlvement rgulier
des mousses. La prsence de mousses, phnomne inesthtique, en arrive galement
occasionner des infiltrations lorsque des amas importants se crent, notamment au droit des
jonctions dlments.
4.2. Les couvertures en grands lments
Dune manire gnrale, il sagit des toitures du type industriel, de grande surface et peu
tourmentes mais certains btiments publics de conception rcente utilisent maintenant ces
grands lments de couverture. On distingue les plaques (nervures) et les feuilles (non
nervures).
4.2.1. Couvertures en plaques mtalliques
Ces plaques sont nervures et, selon la forme de ces nervures, on peut en distinguer deux
types :
Les plaques de grande longueur nervures longitudinales
Plus connus sous le nom de bac acier, ce systme est constitu de plaques nervures en acier
galvanis, prlaques ou non, dont la longueur des lments peut aller jusqu 8m pour une
Les toitures
13
largeur de 0,6 1,10m. Les nervures longitudinales sont destines amliorer la tenue en
flexion ; les lments reposent directement sur les pannes.
Pour la mise en oeuvre, le DTU 40.35 fait la distinction entre toiture froide et toiture
chaude :
La toiture froide est caractrise par la prsence, entre la plaque nervure et lisolation,
dune lame dair ventile avec lair extrieur.
Dans ce cas on a lisolation qui est suspendue
sous pannes (voir ci contre).
Source : site de lAgence Qualit Construction
La toiture chaude na, dans la plupart des cas, pas de
lame dair entre la plaque nervure et lisolant. Toutefois,
lorsque quune lame dair existe, elle nest pas ventile avec
lextrieur et est rpute immobile.
Ainsi, dans la configuration toiture chaude , on peut rencontrer une isolation pose sur
pannes, ou pose entre pannes ou encore une isolation pose entre deux plaque nervures
trame parallle (systme plus couramment appel double-peau) (voir ci-dessous).
Isolation pose sur pannes Isolation pose entre panne Double-peau
Source : site de lAgence Qualit Construction
Le choix entre ces diffrentes solutions est fonction principalement de lhygromtrie des
locaux concerns, de la performance du pare-vapeur et du taux de renouvellement dair des
locaux. Lannexe A du DTU 40.35 contient un guide de choix des matriaux et revtements
selon lexposition atmosphrique.
Ces grandes plaques nervures existent galement en aluminium, leur mise en oeuvre est alors
traite par le DTU 40.36.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
14
Les plaques de grandes longueurs ondules
Les matriaux employs pour la tle ondule sont lacier galvanis, lacier inoxydable, le zinc
ou laluminium. Les plaques sont disponibles en diffrentes longueurs pouvant aller jusqu
3,00 m pour une largeur denviron 0,9 m. Les ondes ont un pas de 76 mm pour une hauteur de
18 mm. Ce type de plaque prend galement appui directement sur les pannes.
4.2.2. Couvertures en feuilles et longues feuilles mtalliques
Les matriaux utiliss pour ces feuilles sont le zinc, le cuivre, laluminium, lacier galvanis
ou inoxydable ainsi que le plomb. Les lments de ces couvertures ne sont pas nervurs.
Les feuilles ont une largeur de 0,50 1 m et leur longueur est de 2 m. tandis que les longues
feuilles ont une longueur qui peut aller de 15 20 m. et qui correspond la longueur du
rampant des toitures courantes. Les longues feuilles permettent ainsi dobtenir des couvertures
sans recouvrement transversal des lments.
La faible paisseur des lments (de 4 10/10 de mm) ainsi que labsence de nervures
implique que leur pose doit se faire sur un support continu (voligeage, parquet ou panneau de
particules).
Pour le recouvrement transversal (perpendiculaire la ligne de
pente) des feuilles, trois techniques sont employes en fonction
de la pente de la couverture : lagrafure simple (ci-contre), la
double agrafure et la couverture ressauts.
Quant au recouvrement longitudinal des
feuilles, deux types dassemblage sont
employs : la technique du couvre-joint
sur tasseau (ci-contre gauche) et celle
du joint debout ( droite).
4.2.3. Points de vigilance
Pour les couvertures en bacs acier :
* En toiture chaude, des sinistres sont causs par une lame dair parasite qui est suppose
immobile mais qui, en ralit, ne lest pas par la suite de labsence des closoirs ou dune
erreur de conception.
* Attention aux dcoupes effectues dans les plaques, notamment en rhabilitation : la
coupure doit tre nettoye des copeaux et de la limaille et tre protge afin que la corrosion
Les toitures
15
ne soit amorce. De mme, larticle 6.1.4.1 du DTU 40.35 attire lattention sur le perage des
plaques et indique que les particules mtalliques chaudes issues de perage doivent tre
enleves afin de ne pas risquer leur oxydation sur le revtement.
* Des plaques clairantes (translucides) en polyester, PVC ou encore polycarbonate sont
disponibles pour ces couvertures. Dans tous les cas, il convient de sassurer que leur profil est
exactement analogue celui des bacs acier sinon, il se produit un billement au recouvrement
des plaques qui occasionne dinvitables infiltrations deau. Les plaques translucides en PVC
sont sujettes changement de teintes et dformations sous leffet des UV, do galement des
risques dinfiltrations deau.
Pour les couvertures ondules :
* Pour la pose de plaques ondules mtalliques sur une charpente galement mtalliques, cette
dernire doit tre peinte afin dviter le contact bimtal (DTU 40.32 art. 3.5).
* Lors dune rhabilitation de ce type de couverture, il faut sinterroger sur le matriau
constitutif, il peut sagir damiante-ciment (plaques Eternit) qui ncessite des prcautions pour
la dpose et lvacuation. Le diagnostic amiante du btiment doit permettre de lever le doute.
A titre informatif, le DTU (aujourdhui abrog) qui sappliquait la pose de ces matriaux
tait le 40.31 ; il peut tre utile de le garder en bibliothque car en cas de rhabilitation il
permet dapprhender la manire dont les plaques ont t poses.
Pour les couvertures en feuilles et longues feuilles mtalliques :
* A la date de rdaction du prsent document, les DTU sappliquant aux feuilles et longues
feuilles de zinc et de cuivre (respectivement DTU 40.41 et 40.45) sont en cours de rvision.
* Concernant la pose des longues feuilles en zinc et en cuivre, il existe peu dentreprises
spcialises sur le march.
4.3. Le choix dun matriau de couverture
Ce choix ne doit pas seulement se faire en fonction dhabitudes locales, il est galement dict
par la pente et lexposition de la toiture, la longueur des rampants ainsi que la rgion
climatique (zone) concerne. Ainsi, afin de savoir si un matriau est adapt au projet, il
convient de consulter les DTU de mise en oeuvre qui indiquent la pente minimale admissible
pour le matriau concern en fonction notamment de la zone climatique dans laquelle on se
trouve. La France est divise en trois zones climatiques dont les limites sont dtailles aux
DTU.
Les feuilles et longues feuilles mtalliques sont parfaitement adaptes aux faibles pentes mais
peuvent galement tre utilises en pente verticale.
Les ardoises saccommodent galement de presque toutes les pentes sous rserve dadapter
leur mode de fixation.
En revanche, les tuiles se posent dans une fourchette de pente plus rduite, centre autour de
45.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
16
La pente a galement un impact conomique : une faible pente demande moins de matriau
pour une mme surface couverte ; le temps et les contraintes de mise en oeuvre sont
galement sensiblement rduits.
5. LES TOITURES TERRASSES
5.1. La classification des toitures terrasses en fonction de leur
accessibilit et de leur utilisation
La conception des toitures terrasses est lie lutilisation qui en sera faite. En effet,
limportance de la circulation en quantit et qualit sur la terrasse va influer sur le choix
des matriaux, leur paisseur, sur les caractristiques de la protection de ltanchit, etc.
Ainsi, on catgorise les toitures terrasses de la manire suivante :
* Inaccessibles : toitures non accessible sauf pour lentretien courant du revtement
dtanchit et des accessoires tels que lanterneaux dclairement ou de dsenfumage,
antennes, etc.
* Techniques ou zones techniques : laccessibilit est seulement lie lentretien des
installations places en terrasse (chaufferie, dispositifs de ventilation ou de traitement dair,
machineries dascenseurs, etc.
* Accessibles aux pitons : elles permettent la circulation et le sjour des personnes quelle
quen soit la raison (entretien, loisir, circulation,...).
* Accessibles aux vhicules lgers (charge maximale infrieure 2t/essieu) : ces vhicules
peuvent y circuler et y stationner. Il sagit, par exemple, des parkings ariens situs en
terrasse de grands magasins. Les rgles de conception de ces toitures permettent laccs
exceptionnel aux vhicules de dfense contre lincendie et aux camions de dmnagement
mais ne prennent pas en compte celui des bennes ordures.
* Accessibles aux vhicules lourds (charge maximale suprieure 2t/essieu) : ces vhicules
peuvent y circuler et y stationner.
* Toitures terrasses jardins : elles sont recouvertes de terres vgtales et de plantations. Un
paragraphe spcifique de ce document leur est consacr (voir infra).
Les toitures
17
5.2. Conception globale
La partie courante dune toiture terrasse est compose de trois parties superposes qui
permettent chacune de garantir une fonction diffrente de la toiture.
* la partie porteuse (fonction de stabilit et rsistance
structurelle):
llment porteur
* lisolation thermique:
le pare-vapeur
lisolant thermique
* ltanchit:
le systme de liaisonnement du revtement
dtanchit lisolant
le revtement dtanchit proprement dit
la protection du revtement dtanchit contre les
chocs et les UV
Il sagit l de la manire traditionnelle de raliser une toiture terrasse mais on peut galement
rencontrer des toitures terrasses dont lisolant est plac au dessus de la couche dtanchit
mais cette disposition est assez rare. En terme de vocabulaire il sagit alors dune toiture
inverse. Linconvnient majeur de ce type de toiture est que ltanchit ne protge pas
lisolant de leau de pluie et qualors ce dernier perd tout pouvoir isolant lorsquil est gorg
deau.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
18
5.3. Les matriaux employs et leurs particularits demploi
Les constituants ci-aprs sont cits dans lordre et avec la numrotation de la coupe figurant
dans le paragraphe conception globale .
5.3.1. Llment porteur
Il peut tre principalement de deux types :
* en maonnerie de bton arm dont la mise en oeuvre est dcrite
par le DTU 20.12
* ou en acier. Il sagit de tles dacier nervures (abrges TAN
dans les documents techniques) poses sur une ossature
(gnralement une charpente en acier) selon le DTU 43.3. Les
matriaux employs pour les TAN sont lacier galvanis ou prlaqu.
Elment
porteur
Avantages Inconvnients Points de vigilance
BETON
ARME
- Rigide ;
- Contribue linertie
thermique des locaux ;
- Adapt toutes les toitures
terrasses, quelle que soit leur
degr daccessibilit.
TLES
DACIER
NERVUREES
TAN
- Lgres ;
- Faciles mettre en oeuvre
- Seulement destines aux
toitures inaccessibles ou
zone technique ;
- Ncessit dun faux-plafond en
locaux nobles afin de masquer
la sous-face des tles.
- Ltude des dispositifs
dvacuation des eaux
pluviales et leur entretien :
risque deffondrement si leau
est mal vacue ;
- Les quipements disposs en
toiture doivent ltre au droit
des lments de lossature ;
- Attention aux dcoupes et
percements de chantier qui
peuvent entraner la corrosion
des tles. La limaille doit tre
vacue.
Les supports bton reprsentent 60% du march, les supports acier 40% (source : magazine
SYCODES Information septembre / octobre 2001).
Le bois est aussi
utilis comme lment
porteur mais de manire
de plus en plus rare. Sa
mise en oeuvre est traite
par le DTU 43.4.
Les toitures
19
5.3.2. Le pare-vapeur
Il peut tre :
* en chape souple de bitume avec une armature en carton feutre ou en tissu de verre ou
encore en polyester. Le matriau se prsente sous forme de rouleaux denviron 20x1 m
environ et est normalis (voir NF P 84-3xx).
* appliqu in situ, sous forme liquide : un bitume chaud que les documents techniques
nomment EAC (enduit dapplication chaud).
La pose du pare-vapeur doit prcder immdiatement, dans le temps, celle de lisolant ; en
aucun cas il ne constitue une mise hors deau provisoire du btiment et ne doit pas tre
considr comme un revtement dtanchit.
5.3.3. Lisolant thermique
Trois familles peuvent tre distingues :
* Les isolants base de mousse plastique alvolaire
- Polystyrne expans ou extrud.
- Polyurthanne
- Mousses phnoliques RESOL (ou rsine RESOL).
* Les isolants base minrale
- Laine minrale (laine de roche exclusivement).
- Verre cellulaire (a laspect de la pierre ponce, il sagit de lisolant de toiture le plus cher
du march, seule la socit FOAMGLAS le fabrique).
* Les isolants base de matriaux cellulosiques
- Perlite fibre
- Lige agglomr (peu utilis)
Des avis technique existent pour chacun de ces matriaux, hormis
le lige agglomr pour lequel il existe la norme NF B 57-054.
Si le revtement dtanchit envisag est sous avis technique, il
faut alors veiller ce que lisolant soit galement sous avis
technique et que ces deux avis techniques soient compatibles.
Un isolant support dtanchit est notamment caractris par sa classe de compressibilit qui
comporte quatre stades (A, B, C et D) que lon peut relier la destination de la toiture (voir
En toiture inverse
(isolant au-dessus de
ltanchit), le matriau
isolant qui est
exclusivement employ est
le polystyrne extrud.
Dune manire
gnrale et lorsque quil
en existe, il est vivement
recommand de
nemployer que des
matriaux sous avis
technique.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
20
tableau ci-dessous). On trouve lindication de la classe de compressibilit dun isolant support
dtanchit dans son avis technique en mme temps que les limites dutilisation de cet
isolant.
TOITURE
Uniquement accessible pour son
entretien
Accessible aux
pitons
Accessible aux
vhicules
CLASSE DE
COMPRESSIBILITE
A
(Etude particulire)
B C D
ISOLANT
THERMIQUE
CONCERNE
- Laine minrale
- Mousse RESOL
- Polystyrne
- Polyurthanne
- Mousse RESOL
- Verre cellulaire
- Perlite fibre
5.3.4. Le systme de liaisonnement
du revtement dtanchit lisolant
Ce mode de liaison entre ltanchit et lisolant peut connatre diffrents degrs : adhrent
(soudage ou collage au bitume chaud EAC), semi-adhrent (soudage sur feutre perfor ou
collage par point) ou pose en indpendance (papier kraft ou voile de verre).
Ce sont les DTU qui en fixent le choix, celui-ci est fonction de llment porteur, de la pente,
du revtement dtanchit, des conditions climatiques, de laccessibilit de la toiture terrasse.
Les toitures
21
5.3.5. Le revtement dtanchit
Les diffrents revtements que lon peut rencontrer
Matriaux
manufacturs en feuilles
A base de bitume
oxyd.
A base de bitumes
modifis par
polymres.
Membranes base
exclusivement de
polymres
(ne contiennent pas de
bitume).
Matriaux
appliqus in situ
Un seul type :
Multicouche en
bitume oxyd.
Quasiment plus
utilis, on le trouve
encore dans les
magasins de
bricolage. A viter.
Nota : beaucoup
utiliss jusquaux
annes 80, ils sont
depuis remplacs par
les bitumes SBS (ci-
contre) qui prsentent
de meilleures qualits
lastiques et de tenue
dans le temps.
De deux types :
Bicouche en bitume
modifi SBS. Le plus
utilis.
Bicouche en bitume
modifi APP. Emploi
restreint en France, on
les trouve
principalement en
Italie et en Belgique.
Nota : SBS et APP
sont le nom des
polymres utiliss
pour amliorer les
caractristiques du
bitume :
SBS = styrne-
butadine-styrne
APP =
polypropylne
atactique
Les plus utiliss sont
(liste non
exhaustive) :
PVC P (plastifi). Le
plus rpandu, il
reprsente 80 90%
du march des
membranes.
TPO
(thermoplastique
olfine). En
progression,
commence
simplanter sur le
march.
EPDM (thylne-
propylne-dine-
monomre). Trs
employ aux USA
pour les toitures, cest
le caoutchouc
galement utilis pour
les zodiacs.
PIB
(polyisobutylne).
CSPE (polythylne
chlorosulfon).
Il en existe deux :
Asphalte
Systmes
dtanchit liquide
(SEL). Egalement
appels rsine, ils sont
appliqus sur les
balcons, loggias ou
garages.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
22
Les commentaires suivants peuvent tre apports ce tableau :
- Les revtements dtanchit peuvent tre classs en deux grandes familles : les matriaux
manufacturs en feuilles (livrs en rouleau sur le chantier) et les matriaux appliqus in situ
(sous forme liquide).
- La majeure partie des revtements dtanchit sont base de bitume (environ les trois
quarts, voir tableau ci-dessous), lasphalte est galement employ pour ltanchit des
toitures terrasses. Ce sont des matriaux dtanchit trs anciens, dj utiliss dans
lantiquit ; on trouve des citations du bitume dans lAncien Testament.
- Nanmoins, les matriaux de synthse sont largement utiliss dans la technique des
revtements dtanchit : les polymres (assemblage de plusieurs monomres) servent
doper les bitumes afin damliorer leurs caractristiques. Mais ces polymres servent
galement fabriquer des membranes dtanchit qui ne contiennent pas de bitume mais
exclusivement des matriaux synthtiques.
Le march des revtements dtanchit
Rpartition des procd en France (source : magazine SYCODES Information septembre /
octobre 2001) :
Matriaux
manufacturs en feuilles 88%
A base de bitume
oxyd.
, non significatif
A base de bitumes
modifis par polymres.
76%
Membranes base
exclusivement de
polymres (ne
contiennent pas de
bitume).
12%
Matriaux
appliqus in situ 12%
rpartis ainsi :
Asphalte 10%
SEL 2%
Bitume, bitume oxyd, asphalte. Quelle est la diffrence ?
Le bitume se trouve sous forme naturelle (le bitume natif) au sein de
formations gologiques calcaires, mais il est galement et surtout
fabriqu industriellement par raffinage de ptrole brut (le bitume de
distillation direct). Inutilisable en ltat pour servir dtanchit aux
toitures terrasses, le bitume est modifi soit par ajout de polymres
soit par oxydation (le bitume oxyd),technique qui consiste faire
ragir le bitume avec de loxygne en insufflant de lair dans le bitume
fondu.
Lasphalte naturel est une roche sdimentaire poreuse, gnralement
calcaire, imprgne naturellement de bitume natif (NF B 13-001).
Le bitume et
lasphalte nont rien
voir avec le goudron
qui, lui, provient de
la distillation de la
houille.
Les toitures
23
Lasphalte coul, qui rpond la norme NF P 84-305, est un mlange
de bitume, de poudre dasphalte naturel et de granulats.
Le classement F.I.T. des revtements dtanchit
Cr par le CSTB et la Chambre Syndicale Nationale de lEtanchit (CSNE), le classement
F.I.T. est un classement performanciel des tanchits de toitures ; il constitue un complment
aux Avis Techniques. Les bitumes oxyds et les revtements dtanchit appliquer in situ
nont pas de classement F.I.T.
La signification de ses trois critres est :
F : rsistance la Fatigue (endurance aux mouvements des supports) de F1 F5
I : rsistance lIndentation (poinonnements statique et dynamique) de I1 I5
T : Temprature (tenue au glissement sous laction de la temprature) de T1 T4
Lindication du classement F.I.T. dun revtement dtanchit se trouve dans les Avis
Techniques.
En phase tudes, afin daider la prescription dun revtement dtanchit, le document de
prsentation du classement F.I.T. prsente un tableau indiquant le classement minimal
retenir pour un revtement dtanchit, en fonction de laccessibilit de la toiture, de la pente,
du support et de la protection de ltanchit. Ce document se trouve dans le cahier du CSTB
n2358, livraison 302 de septembre 1989.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
24
Principales caractristiques des revtements dtanchit
Revtement
dtanchit
Avantages Inconvnients Points de vigilance
Multicouche
en bitume
oxyd
- Son lasticit est largement plus
faible que celle des bitumes
modifis par polymres : ils
sont sensibles aux grands
intervalles de tempratures ;
- Sa durabilit (10 ans) est plus
faible que celle des autres
revtements;
- Faible rsistance aux
poinonnements.
- A ne plus utiliser. De toute
faon, il a quasiment disparu
du march.
Bicouche en
bitumes
modifis par
polymres
- Durabilit prsume suprieure
25 ans ;
- Les polymres incorpors leur
permettent davoir une assez
bonne lasticit ;
- Bon march.
- Faible rsistance aux
poinonnements.
- Attention aux ngligences lors
de la pose, lorsque la
protection nest pas encore
ralise: la circulation de
personne ou le dpt doutils
percent facilement le
revtement.
Membranes
polymres
- Durabilit prsume suprieure
25 ans ;
- Nombreux accessoires
prfabriqus : angles,
dversoirs, passages de cbles,
etc.;
- Rapidit de mise en oeuvre ;
- Esthtique : aspect lisse,
coloris possibles ;
- Respect de lenvironnement :
les 4 principaux fabricants
sengagent reprendre les
matriaux en fin de vie et les
recycler.
- Main duvre spcialise : le
soudage des membranes
ncessite que les tancheurs
possdent une qualification
spcifique la technique ;
- Glissantes par temps de pluie.
- En cas de rhabilitation de
toiture, attention aux
incompatibilits : il faut une
sparation chimique entre le
PVC P et le bitume, lasphalte
ou le polystyrne expans ;
- Vrifier que lentreprise
emploie du personnel form et
qualifi pour le soudage des
membranes.
Asphalte - Durabilit prsume suprieure
25 ans.
- Au fil du temps, il devient gris
blanc.
- Sur les toitures partir de 3%
de pente, lors de journes trs
chaudes, il a tendance
scouler sous leffet de
llvation de tempratures.
Systmes
dtanchit
Liquide
(SEL)
- tanchit continue, sans
joints ;
- Mise en oeuvre sans flamme ni
air chaud ;
- Permet de raliser des surfaces
complexes (courbes, ondules)
ou daccs difficile (chneaux) ;
- Finitions dcoratives varies.
Les rsines transparentes
permettent dtancher des
structures transparentes.
- Le systme dtanchit le plus
cher du march ;
- Ne sappliquent pas sur isolant :
limits aux toitures non isoles
thermiquement, aux balcons ou
loggias ;
- Fortes contraintes de mise en
oeuvre : support adhrent (propre
et sec), temprature, aucune
humidit ;
- Demande une main duvre
trs spcialise
- A rserver pour de faibles
surfaces, o les flammes sont
interdites et la pose de ls
difficile ;
- Vrifier que lentreprise
emploie du personnel form et
qualifi pour lapplication de
rsines.
Les toitures
25
5.3.6. La protection du revtement dtanchit
Cette protection est la partie visible de la toiture terrasse ; son rle est de protger le
revtement dtanchit contre les effets naturels des rayons ultraviolets, des carts de
temprature, du vent ainsi que contre les effets mcaniques de la circulation, des charges et
des chocs.
On peut distinguer:
* Lauto-protection : la protection est intgre en usine sur la face externe du revtement
dtanchit, on parle alors de revtement auto-protg.
La couche dauto-protection est solidaire du revtement et na que
quelques millimtres dpaisseur, elle peut tre soit mtallique
(daspect gaufr en cuivre ou en aluminium, voire en inox) soit
minrale (paillettes dardoise ou graviers fins de divers coloris).
Les revtements auto-protgs ne sont destins quaux terrasses
inaccessibles ou aux relevs dtanchit.
Revtement dtanchit
avec auto-protection mtallique
* La protection rapporte : galement nomme protection lourde, elle est mise en oeuvre
immdiatement aprs la pose du revtement dtanchit. Cet impratif dabsence de dlai
entre la pose des deux matriaux est du au fait que le revtement dtanchit est extrmement
fragile lorsquil nest pas protg, il peut facilement tre perc par la circulation des ouvriers,
lutilisation de leurs outils ou le dpt provisoire de matriels en toiture.
On diffrencie la protection lourde meuble et la protection lourde dure :
La protection meuble : elle est constitue dun lit de gravillons
de 4 6 cm dpaisseur.
Elle est destine aux toitures-terrasse inaccessibles car la
circulation sur les gravillons abouti des infiltrations deau par
percement du revtement dtanchit. Pour accder aux
quipements techniques de la toiture sans percer ltanchit, des
chemins techniques sont crs laide de dalles ou de caillebotis
mtalliques par exemple.
A viter, si possible, en site venteux car les tourbillons dplacent
les gravillons.
Prfrer les gravillons
rouls que concasss afin
de rduire les risques de
poinonnement de
ltanchit.
Les gravillons doivent
tre de qualit lavs ,
cest dire sans trace de
sable afin de ne pas
favoriser le
dveloppement de
vgtation.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
26
La protection dure : obligatoire sur toutes les toitures-terrasse
circulables, elle se prsente le plus souvent sous lune des formes
suivante :
Source : www.siplast.fr
une dalle de bton arm
pose sur une couche de 3
cm de gravier
des pavs poss sur un lit de
sable
des dalles en bton ou en bois,
de 50 cm de ct, poses sur
des plots rglables en hauteur
5.4. Les points singuliers des toitures-terrasses
5.4.1. Leur rle important dans la qualit
La qualit et la durabilit dune toiture terrasse dpend, pour la plus grande part, de la bonne
excution de ses points singuliers et de lattention qui y est porte lors de lentretien
priodique (voir 5.6 pour ce qui concerne lentretien). En effet, les statistiques sur les
pathologies des toitures terrasses indiquent que la grande majorit (70%) des dsordres sont
localiss aux points singuliers (source : Agence Qualit Construction).
La phase de conception ncessite une tude pralable complte
avec plan de reprage des points particuliers, schmas de dtails et
rdaction des prescriptions de pose. La mise en oeuvre est
videmment effectuer en accord avec les DTU, en utilisant des
lments ou procds sous avis techniques.
A noter : les DTU dcrivent une preuve qui nest que trs rarement effectue voire jamais -
dtanchit leau : la terrasse est mise en eau pendant plusieurs heures selon un processus
bien dfini afin de dtecter dventuelles dfauts dtanchit.
Ce type de protection
doit comporter des joints
de fractionnement afin de
permettre le libre jeu des
dilatations.
Linterdiction de pose
par temps de pluie doit
imprativement tre
respecte.
Les toitures
27
5.4.2. Diffrents types de points singuliers
* Les reliefs : ouvrages mergents, solidaires des lments porteurs et sur lesquelles
ltanchit est releve.
On trouve dans cette catgorie les acrotres, les seuils, les ressauts, les souches, les poutres en
allge, les supports de nacelles de nettoyage, les dicules et locaux divers tels que machineries
dascenseurs par exemple.
Ltanchit doit tre remonte verticalement sur ces reliefs et une protection doit tre prvue
en tte de ltanchit afin dviter que leau ne pntre sous le revtement dtanchit. Cette
protection en tte est gnralement ralise par un retrait ou par la pose dune bande de solin
mtallique ou encore par une couvertine mtallique.
Source : www.siplast.fr
Protection en tte par retrait ... par bande de solin ... par couvertine
En cas dutilisation de bande de solin, il ne faut utiliser que du matriel sous avis technique ;
lheure actuelle, seuls deux procds sont sous avis technique : Solinet (fabriqu par DANI
ALU) et Bande Trapco (fabriqu par TRAPCO). Ces bandes de solin doivent tre
imprativement associs aux lments spciaux prvus par leur fabricant pour les angles sans
quoi des infiltrations se produiront sous le revtement dtanchit.
* Les joints de structure : joints de dilatation, de tassement.
Ces joints doivent tre continus travers les diffrents matriaux de construction, il ne faut
donc pas passer par dessus avec lisolant et ltanchit de la toiture car cette dernire sera
immanquablement dchire par les mouvements de dilatation et retrait de la structure. Les
dispositions dcrites par les DTU permettent de traiter correctement ces joints, les DTU
rappellent galement quil ne faut utiliser que des accessoires sous avis techniques pour ce
traitement.
Pour les terrasse accessibles aux vhicules des joints plats sont mettre en oeuvre. Leur
description en est faite par les DTU ainsi quun rappel de quelques principes observer : ils
doivent tre organiss de faon recevoir une circulation la plus rduite possible. Dans le
cas, o il est impossible d'viter les joints plats, l'organisation des joints de dilatation doit
tre mene de faon que le plus petit linaire possible de joint soit circul (par exemple en
orientant les places de stationnement de part et d'autre des joints, en plaant des barrires de
sparation au droit de ceux-ci...). Leur trac doit tre tel qu'il ne coupe pas les rampes
d'accs.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
28
* Les ouvrages dvacuation des eaux pluviales : ils comprennent les entres deaux
pluviales (EEP) et les trop-pleins (TP). Leur nombre et leurs dispositions figurent aux DTU.
Si la terrasse ne comporte quune seule descente deaux pluviales, un ou plusieurs trop-plein
sont obligatoires afin dassurer lvacuation de leau lorsque la descente est obstrue. Ce trop-
plein vite la mise en charge de la terrasse et son ventuel effondrement.
De manire gnrale, les trop pleins doivent tre de prfrence de forme rectangulaire avec le
grand ct horizontal car cette disposition permet une meilleure vacuation de leau que celle
permise par un trop-plein circulaire ayant la mme surface douverture.
Nanmoins, en ce qui concerne les toitures terrasses avec lment porteur en tles dacier
nervures (TAN), le DTU 43.3 rend obligatoire la mise en oeuvre de trop-pleins
rectangulaires car lorsque leau sy accumule, elles prsentent un fort risque dcroulement
par la suite de phnomne itratif : la charge deau creuse la terrasse (les TAN sont souples),
ce creux semplit alors dune nouvelle hauteur deau qui enfonce un peu plus la terrasse et
ainsi de suite jusqu la rupture des tles et la ruine de la toiture. Pour lviter il faut dune
part observer les dispositions du DTU et dautre part assurer lentretien rgulier de la toiture
(voir 5.6 ci-dessous).
* Les pntrations diverses : elles correspondent aux traverses de la toiture par des
ouvrages tels que les conduits de fumes ou de ventilation.
* Les lanterneaux et exutoires de fumes
5.4.3. Implantation et espacement entre ces points singuliers
Des dispositions impratives sont prendre en ce qui concerne limplantation des points
singuliers et notamment la distance minimale respecter entre deux ouvrages mergents
voisins.
Cette prescription dcoule des
exigences de ralisation,
d'entretien et de rfection des
ouvrages d'tanchit et figure sous
forme de schmas et tableaux dans
les DTU de mise en oeuvre (voir
ci-contre, un extrait du DTU 43.3)
mais elle nest que trop rarement
respecte par les concepteurs.
Les toitures
29
5.5. Les toitures jardins et les toitures vgtalises
5.5.1. Gnralits
Il convient de distinguer les toitures-terrasse jardin et les toitures-terrasse vgtalises :
Les toitures terrasse jardin
Elles sont en gnral accessibles la circulation pitonnire et prsentent un aspect
traditionnel de jardin.
Elles ne sont ralisables que sur lment porteur en maonnerie. Lpaisseur de terre vgtale
est adapte la nature des vgtaux plants, elle peut varier de 0,30 1,00 m. Il en rsulte une
surcharge importante sur la structure, de lordre de 600 kg/m et au-del.
La vgtation ncessite gnralement un entretien frquent et un arrosage ponctuel, comme
pour toute vgtation traditionnelle.
Les toitures terrasse vgtalises
Ce sont, quant elles, des toitures inaccessibles ; la circulation y est rduite lentretien du
revtement dtanchit et des vgtaux.
Les vgtations implantes sont choisies pour ncessiter une frquence darrosage et un
entretien plus rduit que pour les toitures terrasse jardin. Il sagit de vgtation basse (25 cm
maximum) conome en ressources nutritionnelles, rsistante et colonisatrice. Le mixage de
plusieurs varits slectionnes conduit un aspect multicolore variant au gr des saisons.
Lpaisseur de terre vgtale est faible ( de 3 20 cm) et nentrane quune surcharge rduite
sur la structure (115 135 kg/m). Les toitures terrasse vgtalises sont ralisables sur
lment porteur en maonnerie, acier ou bois.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
30
Quel quen soit le type, ces terrasses vertes ont les caractristiques communes suivantes :
Confort thermique
Lisolation et linertie
thermique sont amliors.
Confort acoustique
La couche vgtale filtre les
bruits extrieurs.
Aspect visuel, bien-tre
Lesthtique de ces toitures
participe au climat de dtente
et de repos ncessaire dans
certains tablissements. Elles
influent sur le bien-tre
ressenti ou inconscient.
Environnement
Ces systmes amliorent la
qualit de lair extrieur car
ils fixent le gaz carbonique et
produisent de loxygne.
Les vgtaux fixent galement
les poussires lies la
pollution.
Ils ont un effet rgulateur sur
lvacuation des eaux
pluviales : cette eau est
restitue lenvironnement
par lintermdiaire des plantes
et par vaporation directe.
Protection de la
construction
Le revtement dtanchit est
protg des risques de
poinonnement et du
rayonnement UV.
La rgulation des carts de
temprature par la vgtation
vite les chocs thermiques et
rduit les effets de dilatation
ou de retrait sur la structure.
Cot
Par rapport une toiture-
terrasse simplement revtue
dune tanchit autoprotge,
le surcot dune toiture-
terrasse jardin varie de 75
750 euros HT/m. Celui dune
toiture-terrasse vgtalise est
de lordre de 25 75 euros
HT/m.
Urbanisme
La plupart des POS et des
PLU acceptent que ces
terrasses soient assimiles
des espaces verts.
En ce qui concerne leur conception et mise en oeuvre, il faut se reporter aux rgles
professionnelles tablies par la chambre syndicale nationale de ltanchit (CSNE) et lunion
nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) :
- Rgles professionnelles pour la conception et la ralisation des terrasses et toitures
vgtalises (CSNE, UNEP, juillet 2001).
- Rgles professionnelles pour lamnagement des toitures-terrasses-jardins (CSNE, UNEP,
juin 1997).
Elles prcisent notamment les essences interdites ou dconseilles sur ces ouvrages, comme le
bambou par exemple qui y est totalement proscrit.
Une prochaine refonte des DTU est prvue et devra englober ces rgles professionnelles.
Les toitures
31
5.5.2. Constitution dune toiture terrasse jardin ou vgtalise
De bas en haut, on retrouve des lments communs toutes les toitures terrasses :
- Un lment porteur ;
- Un pare-vapeur ;
- Un isolant thermique. Tous les types disolants usuellement utiliss sous tanchit
sont admis, ils doivent tre au moins de classe C en compressibilit.
- Un revtement dtanchit. Au del de son rle dtanchit classique, il doit rsister
la pntration des racines et contenir des adjuvants anti-racines. Afin de savoir si un
revtement dtanchit est agr comme tel, il convient de consulter son avis technique.
Viennent ensuite des lments spcifiques ce type de toiture terrasses :
- Une couche drainante charge de conduire
leau vers les dispositifs dvacuation et de
permettre aux racines de respirer. Elle peut tre
constitue soit de granulats dargile expans,
pouzzolane, cailloux, gravier ou encore de
plaques de polystyrne alvoles et nervures.
Son paisseur varie de 6 10 cm.
- Une couche filtrante qui a pour fonction de
retenir les lments fins de la terre vgtale afin
dviter quils ne colmatent la couche drainante.
Cette couche doit tre trs permable leau,
rsistante au dchirement et au poinonnement
et tre imputrescible. Il sagit habituellement de
nappes de laine de verre ou de non tisss
synthtiques en polyester ou polypropylne.
- Une couche de terre vgtale dpaisseur variable de 0,03 1,00 m. en fonction du
type de vgtation retenue.
Deux particularits figures sur le dessin ci-dessus et introduites par les rgles
professionnelles sont prendre en compte :
- la ralisation dune zone strile (ou bande de pourtour) en priphrie de la toiture. Dune
largeur minimale de 40 cm, elle permet le contrle des relevs dtanchit et des
vacuations deaux pluviales ainsi que respect de la hauteur des relevs conformment aux
DTU. Le revtement dtanchit antiracine doit tre continu et ne prsenter aucune
interruption entre la zone vgtalise et la zone strile. La protection de ce revtement est du
mme type que celle des toiture terrasse non vgtalises : autoprotg, gravillons ou dalles
sur plots.
Source : www.soprema.fr
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
32
- la mise en place dun dispositif de sparation entre la zone vgtalise et la zone strile. Il
peut sagir soit de bandes mtalliques ajoures (voir dessin), soit de bordures en bton ou en
brique qui retiennent la couche de culture mais permettent le passage de leau.
5.5.3. Entretien spcifique des toitures terrasse jardin ou vgtalises
En plus de lentretien classique du revtement dtanchit et des points singuliers (voir
5.6), les toitures terrasse jardin ou vgtalises ncessitent un entretien propre leurs
particularits.
Pour ce faire, la chambre syndicale nationale de ltanchit (CSNE) associe lunion
nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP) proposent un contrat type dentretien qui
prvoit des recommandations destination des entrepreneurs paysagiste qui interviennent en
toiture-terrasse.
Les points de vigilance lors de lentretien sont :
- viter lutilisation de bche, fourche et crochet susceptibles dendommager ltanchit ;
- Vrifier que les produits fertilisants et phytosanitaires utiliss sont compatibles avec les
ouvrages prsents en toiture (revtement dtanchit, isolation, ...) ;
- Ne pas ngliger larrosage en priode de scheresse. Des racines non agressives en temps
normal peuvent le devenir par une recherche de survie de la plante : si, en priode de
scheresse, elles flairent des condensats dans lisolant, les racines sefforceront datteindre
cette zone et perforeront le revtement dtanchit pour y parvenir.
5.6. Lentretien des toitures terrasse
5.6.1. Ncessit de lentretien
Tous les efforts accomplis pour bien concevoir une toiture-terrasse puis mener bien sa mise
en oeuvre peuvent tre rduits nant si aucun entretien nest effectu par la suite.
Lentretien est indispensable afin de garantir le maximum de durabilit aux constituants et aux
systmes. Le dfaut dentretien entrane des infiltrations qui finissent par dgrader lisolant
thermique et le pare-vapeur et entranent des sinistres en chane dans les locaux sous-jacents.
Cet entretien doit tre dfini et pris en compte ds lorigine du projet. Le Matre dOuvrage
doit en tre conscient et prvoir son financement ; il ne peut faire limpasse sur lentretien de
sa toiture sans prendre de grands risques.
Les toitures
33
5.6.2. Frquence et teneur
Une terrasse doit tre contrle et entretenue au minimum une deux fois par an ainsi
quaprs un gros orage ou une tempte.
Les contrles doivent particulirement porter sur la bonne tenue
des relevs dtanchit et de leur protection en tte, des
dispositifs dvacuation des eaux pluviales, des couvre-joints et
de la protection du revtement dtanchit (gravier, dalles,
autoprotection,...).
Lentretien consiste principalement remettre en place les
lments dcolls, dplacs ou dgrads (protections en tte,
couvertines, ...), rgaler et rgulariser la couche de gravillons,
reprer et traiter les cloques, liminer les dtritus, mousses,
feuilles et vgtations, nettoyer les crapaudines dvacuation
deaux pluviales et les dalles sur plots.
Un point particulier auquel il faut prendre garde lors des visites de contrle et dentretien,
surtout sur les terrasses non accessibles, est le dpt de matriels qui nont rien y faire tels
quchelles mtalliques, salons de jardin ou jardinires qui percent remarquablement les
tanchits. Il convient galement dy dtecter dventuels travaux pirates accomplis en
dehors des rgles de lart, comme la pose dantennes haubanes par exemple, ou lusage
abusif par les utilisateurs dune toiture inaccessible.
Lidal est de mettre en place un contrat dentretien avec lentreprise qui a ralis les travaux.
Dans ce cas, il est judicieux de demander la proposition de contrat dentretien lors de la phase
de consultation des entreprises et, ventuellement, den faire un critre de choix prvu dans le
Rglement de Consultation.
Pour mettre en place cet entretien, les documents suivants sont des sources indispensables :
- Chacun des DTU de la srie 43 consacre un article lentretien des toitures-terrasse ;
- Les avis techniques des systmes utiliss donnent les prescriptions dentretien de ce
systme ainsi que des mises en garde aux utilisateurs ;
- Les recommandations EPEBAT pour lentretien des toitures-terrasses non accessibles
(voir bibliographie).
La remise en place du
gravier doit exclusivement se
faire avec un rteau en bois ou
en plastique, les dents
mtalliques risquant de percer
ltanchit.
Ne pas employer de
produits dsherbants pour
liminer les mousses et
vgtaux afin de prserver
ltanchit des agressions
chimiques. Le mieux est
dutiliser un rteau en bois ou
en plastique ou encore de
dsherber la main.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
34
5.7. La rfection des toitures-terrasse
Actuellement, on peut estimer que la dure de vie moyenne des revtements dtanchit la
valeur suivante :
- asphalte : 25 30 ans
- bitume multicouches autoprotg : 10 ans
- bitume lastomre (modifis SBS ou APP) : plus de 25 ans
- membranes polymres : plus de 25 ans
La rfection de ltanchit dune terrasse doit, dune part, tre prcde dun diagnostic du
gros uvre, surtout si la rfection saccompagne dun changement dusage dinaccessible
accessible, par exemple afin de sassurer que les structures porteuses supporteront les
nouvelles charges.
Les entreprises dtanchit ne sont pas comptentes pour mener bien ce diagnostic, il relve
dun bureau dtudes de structures.
Dautre part, il est galement ncessaire de raliser un diagnostic de louvrage dtanchit
dont le champ doit recouvrir lisolant, le revtement dtanchit et sa protection afin de
dterminer les causes des dsordres subis ou attendus. Ce diagnostic permet galement
dviter la pose dun nouveau revtement qui soit incompatible avec lancien.
Les tancheurs sont le plus souvent comptents pour ce genre de diagnostic.
En matire de compatibilit des matriaux, il faut savoir que les membranes polymres base
de PVC sont totalement incompatibles avec les revtements base de bitume ou dasphalte,
leurs huiles agressant chimiquement le PVC.
La rfection des tanchits de toitures-terrasse est maintenant traite par un DTU. Il sagit du
DTU 43.5 (NF P 84-208-1) rcemment paru en novembre 2002.
Attention, ces valeurs
sentendent pour une toiture-
terrasse mise en oeuvre dans
les conditions des DTU et des
avis techniques mais surtout
dont lentretien a t
correctement ralis.
Les toitures
35
6. Lvacuation DES EAUX PLUVIALES
6.1. Les gouttires
Une gouttire est un collecteur deaux pluviales qui est apparent contrairement au chneau
qui est masqu et support par des crochets.
Les matriaux employs sont lacier, laluminium laqu, le cuivre, le zinc ou le PVC. Leur
mise en oeuvre est rgie par le DTU 40.5. La pente minimale respecter est dau moins 5
mm/m et lon peut distinguer trois modes de pose (illustrations : Dicobat) :
La gouttire pendante :
Cest la plus courante, elle ne prend appui que du ct
du toit par lintermdiaire de crochets relis aux
chevrons. Les extrmits sont fermes par un talon et
une besace de dilatation est dispose au raccord de
deux lments.
La gouttire langlaise (ou gouttire anglaise) :
De section demi-ronde, elle est faonne avec un
dveloppement variable de manire laisser lourlet
horizontal malgr la pente. Elle repose sur un
entablement ou une corniche.
La gouttire havraise :
La gouttire est mise en place au bas du versant de la
toiture, sur une feuille de zinc, et est recouverte par les
derniers rangs de tuiles ou dardoises. Le collecteur est
de forme cylindrique dveloppement constant (ci-
contre en haut) ou variable (en bas, galement
dnomm portant sa pente ).
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
36
Selon un mode de pose similaire la gouttire havraise, il existe la gouttire Laval ( gauche)
et la gouttire nantaise qui ont un profil triangulaire :
6.2. Les chneaux
Un chneau est de dimensions plus grandes que la
gouttire et est support par un encaissement,
gnralement en bois.
Il peut-tre mtallique (zinc, cuivre, acier inoxydable,
plomb, acier galvanis), en PVC, en bton ou en bois ;
avec ces derniers matriaux il reoit alors un revtement
dtanchit.
Le chneau prend appui directement soit sur la
maonnerie, soit sur la charpente. Il est beaucoup plus
discret quune gouttire.
Un chneau est appel chneau encaiss lorsquil est situ entre deux versants de toiture de
manire recueillir les eaux de ces deux pans de toiture. Il a galement cette appellation
lorsquil est situ entre un versant et un mur vertical.
6.3. Les descentes deaux pluviales
Les tuyaux de descente sont la plupart du temps de forme ronde mais aussi carre ou
rectangulaire. Ils sont mtalliques ou en PVC, le matriau employ devant tre identique
celui des gouttires de manire viter les incompatibilits de matriaux et les dilatations
diffrentielles.
Les principales prcautions prendre sont les suivantes :
* La descente doit tre verticale et ne comporter, si possible, aucun coude. Ces dispositions,
outre le fait doptimiser lcoulement, permettent dviter leur obstruction par les dchets
entrans par leau.
* A la jonction de la descente et de la gouttire (ou du chneau), une crpine (galement
nomme crapaudine) est mettre en place. Il sagit dune sorte de panier mtallique ou
plastique qui fait office de filtre et vite lobturation de la descente par des corps trangers,
feuilles mortes ou balle de tennis par exemple.
* Les tuyaux ne doivent pas tre appuys sur les murs mais carts de 2 cm minimum.
Les toitures
37
* La partie basse de la descente doit tre protge des chocs mcanique, le plus souvent on y
trouve un dauphin en fonte.
* Le pied de la descente doit tre relie un regard. Celui ci comporte parfois un siphon,
surtout lorsque la gouttire se trouve sous un niveau habit (mansarde) ou lorsque la
descente dessert une toiture-terrasse accessible ; ceci afin dviter les retours dodeurs
dsagrables.
Dune manire gnrale, il convient de ne pas faire passer les descentes deaux pluviales
lintrieur des btiments. Hormis le fait que cela entrane des nuisances acoustiques dans les
locaux traverss, il est en effet plus que prudent de canaliser les eaux pluviales lextrieur
des btiments afin de rduire les risques dinfiltration deaux dans les locaux.
Une disposition originale consiste remplacer le tuyau de descente par une chane qui conduit
la veine liquide mais linconvnient est que par temps venteux le flux deau peut tre dirig
contre la faade et/ou lextrieur du regard de pied de chute.
6.4. Lentretien
Une gouttire nest pas une jardinire : une deux fois par an et au moins lautomne, les
gouttires et les chneaux doivent tre visits et dgags de tout ce qui les encombrent
(feuilles mortes, mousses, objets,...). Cest galement loccasion de vrifier quil ny ait pas de
contre pente qui se soient formes.
Labsence dentretien conduit des dbordements de collecteurs et des ruissellements
abondants sur les faades puis, petit petit, des infiltrations lintrieur des murs de faades.
6.5. La gnoise
On appelle gout la ligne basse dun pan de toiture, l o leau sgoutte. Le rle dune
gouttire ou dun chneau est de rcuprer cette eau afin quelle ne ruisselle pas sur le mur de
faade mais il existe une disposition la gnoise - qui permet galement dviter ce
ruissellement et de protger la faade.
Il sagit dune corniche compose de tuiles canal disposes en plusieurs rangs dcals qui
surplombent la faade. Cette disposition est propre aux rgions mditerranennes.
Les toitures
39
7. GLOSSAIRE
Artier
Angle saillant form par lintersection de deux versants de toiture. Lartier est linverse de la
noue.
Cache-moineaux
Lattes ou lambris situs entre les chevrons, au droit du mur ou lgout pour interdire laccs
aux oiseaux et aux rongeurs lintrieur du comble.
Chanlatte
Liteau de section triangulaire ou trapzodale destin recevoir le premier rang de tuiles ou
dardoises.
Chatire
Ouvrage servant laration des combles. Il peut sagir de tuile chatire ou, pour les
couvertures en ardoises, douvrage mtallique faonn.
Chevtre
Dispositif de charpente qui permet dinterrompre un ou plusieurs chevrons afin de faire passer
un ouvrage au travers de la couverture (une chemine par exemple).
Chevrons
Pices de charpente disposes suivant la ligne de pente, sur les pannes. Les chevrons
supportent les liteaux.
Douille
Orifice dune tuile spciale dite tuile douille et destin au passage dun conduit de
ventilation.
gout
Cest la ligne la plus basse dun pan de toiture, l o leau de pluie ruisselle (ou sgoutte)
pi
Accessoire de finition et dtanchit en zinc ou terre cuite plac la rencontre de plusieurs
ligne de fatage.
A lorigine, il correspondait la marque des couvreurs lorsque la couverture tait termine.
Fatage
Ligne de jonction suprieure de deux pans de toiture inclins, il constitue la ligne de partage
des eaux pluviales.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
40
Fatire
Tuile spciale place au fatage.
Voir galement Pannes
Fourrure
Pice de bois ou de mtal enserrant une pice de charpente pour la renforcer.
Gnoise
Voir 6.4.
Liteaux
Pices de bois, de section carre ou rectangulaire, places horizontalement sur les chevrons
pour recevoir les tuiles ou les ardoises.
Noue
Angle rentrant form par lintersection de deux versants de toiture. La noue est linverse de
lartier.
Cest, avec lgout, la ligne de couverture qui reoit le plus deau.
Pannes
Pices de charpente horizontale supportant les chevrons ou des panneaux rigides de
couverture. On distingue :
- la panne sablire, la plus basse, place au dessus du mur de faade.
- la panne fatire, la plus haute, place au droit de la ligne de fate de la toiture.
- les pannes intermdiaires.
Pannetonnage
Fixation des tuiles mcaniques aux liteaux par un fil de mtal galvanis.
Sablire
Voir Pannes
Solin
Voir 5.4.2.
Tabatire
Fentre plac sur une toiture en pente et souvrant par projection. Sa largeur correspond
lespacement de deux chevrons.
Tuile douille
Voir douille.
Les toitures
41
8. BIBLIOGRAPHIE ET SITES INTERNET
Ouvrages et sites gnraux :
Dicobat (dictionnaire gnral du btiment) - Ed. Arcatures
Anatomie de lenveloppe des btiments - Ed. du Moniteur, 1997.
Encyclopdie du btiment (12 tomes) Ed. Weka, mises jour trimestrielles.
Guide technologique du clos et couvert ralis par le CETE Mditerrane, le CETE du Sud-
Ouest et la Direction de lHabitat et de la Construction, janvier 1996.
Le site du CSTB (www.cstb.fr). On y trouve notamment en consultation libre lensemble des
avis technique ainsi que la page de garde et le sommaire de chacun des D.T.U.
Le site de lAgence Qualit Construction (www.qualiteconstruction.com). Il donne un aperu
des sinistres dans les btiments, des statistiques sur leur frquence et dite des
recommandations afin de les prvenir. Cette agence dite le magazine SYCODES
Informations.
Charpente :
La charpente industrialise en bois, livre ralis linitiative de la Fdration Nationale des
Industries du Bois pour le Btiment, d. Eyrolles, 1998, ISBN 2-212-11835-X. Ouvrage
produit par les membres de la profession qui traite de manire didactique et illustre des
fermettes, de la faon de les concevoir, les calculer, les mettre en uvre, les contreventer, etc..
Guide pratique de conception et de mise en oeuvre des charpentes en bois lamell-coll, d.
Eyrolles. Guide qui intgre les rgles professionnelles du Syndicat National des Constructeurs
et Fournisseurs de Charpentes en Bois Lamell-Coll.
Pour en savoir plus sur le lamell-coll, le site ralis par le Syndicat National des
Constructeurs et Fournisseurs de Charpentes en Bois lamell-coll : www.glulam.org
www.nailweb.com le site du fabricant de poutrelles en I me mince mtallique.
Mmento technique du btiment - Certu - Juillet 2002
42
Toitures inclines :
Les couvertures en pente, Michel JAILLER, E.G. diteur, 1993, ISBN 2-905423-34-X. Il
sagit dune publication de lAgence Qualit Construction qui traite des pathologies de ces
couvertures et propose des recommandations techniques pour les viter.
Guide des couverture en climat de montagne, publi dans les Cahiers du CSTB, n 2267/1,
livraison 292 de septembre 1988.
Toitures-terrasses :
Recommandations EPEBAT pour lentretien des toitures-terrasses non accessibles, CSTB,
avril 1982, 30 pages. Recueil de recommandations destines aux gestionnaires de patrimoine,
ce guide permet galement dapprhender le problme de lentretien dune toiture-terrasse au
stade de la conception. Ses annexes contiennent un exemple de contrat dentretien simple.
Indispensable.
Sa diffusion ntant plus assure par le CSTB, il est difficile den trouver des exemplaires.
Toutefois, le CETE Nord Picardie peut en raliser des copies la demande.
Rgles professionnelles pour la conception et la ralisation des terrasses et toitures
vgtalises (Chambre Syndicale Nationale de lEtanchit (CSNE) et Union Nationale des
Entrepreneurs du Paysage (UNEP), juillet 2001).
Rgles professionnelles pour lamnagement des toitures-terrasses-jardins (CSNE, UNEP,
juin 1997).
www.etancheite.com site propos par la socit Siplast (tanchit de toitures terrasses) qui
donne de manire image beaucoup de prcisions sur les toitures terrasses : historique,
volution des techniques, rglementation, matriaux utiliss ainsi quun vaste lexique. Le site
de la socit Siplast : http://www.siplast.fr/
www.soprema.fr le site de cette socit possde un petit outil daide la dcision (lien
dcision tanchit ) qui permet de dterminer, en fonction de laccessibilit de la terrasse
et de la protection de ltanchit, les matriaux mettre en oeuvre. Evidemment, seuls les
matriaux Soprema sont proposs mais lintrt est que la solution propose est dcrite mais
surtout visualisable grce un corch et une perspective.
www.sopranature.com est un site cr par Soprema qui est ddi leurs procds de toiture
vgtale.
www.meple.com l aussi, cette socit propose des solutions aux prescripteurs lien
prescri+ ). En fonction de laccessibilit de la terrasse, la solution propose est illustre
dune coupe en perspective.
Les toitures
43
www.sika-trocal.fr le site de lun des fabricants de membranes dtanchit polymres.
http://www.etancheite.asso.fr/ le site la chambre syndicale franaise de ltanchit (CSFE)
http://www.unep-fr.com/ le site de lunion nationale des entrepreneurs du paysage (UNEP)
Certu
9 rue juliette rcamier
69456 Lyon Cedex 06
France
www.certu.fr
tlphone :
33 (0) 4 72 74 58 00
tlcopie :
33 (0) 4 72 74 59 00
ml : certu@equipement.gouv.fr
Ce mmento sur les toitures reprsente lun des quatre premiers
documents synthtiques relatifs aux ouvrages et systmes
techniques du btiment. Ils ont pour objet dapporter rapidement
des informations de base utiles aux chargs doprations des
services des constructions publiques des DDE.
Tous les mmentos comportent une structure commune : rappel des
enjeux, prsentation des dfinitions lmentaires ou description
des systmes selon les cas, mise en exergue des points de vigilance
surveiller, un glossaire et une bibliographie.
Les trois autres documents concernent :
- Les faades
- Le confort thermique
- Le confort acoustique
Vous aimerez peut-être aussi
- Cours Toiture TerrasseDocument24 pagesCours Toiture TerrasseLionnel Agbomenou100% (1)
- L'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirD'EverandL'architecture et la construction pratique: Mise à la portée des gens du monde, des élèves et de tous ceux qui veulent faire bâtirPas encore d'évaluation
- Réussir la construction de sa maison: à l'usage de ceux qui vont construire ou faire construire une maison individuelleD'EverandRéussir la construction de sa maison: à l'usage de ceux qui vont construire ou faire construire une maison individuellePas encore d'évaluation
- Chap5 98 99 RenaudDocument3 pagesChap5 98 99 RenaudAndrei SimonPas encore d'évaluation
- Étanchiété Point SingulierDocument16 pagesÉtanchiété Point SingulierIsm Black J100% (1)
- Dico 1 PDFDocument22 pagesDico 1 PDFDrancyPas encore d'évaluation
- Ext Guide Couv DTU 40.23Document9 pagesExt Guide Couv DTU 40.23pionj100% (3)
- Etancheite Des Toitures Terrasses Toitures VégétaliséesDocument53 pagesEtancheite Des Toitures Terrasses Toitures VégétaliséesFairouz JammalPas encore d'évaluation
- Détails de Construction de Maison-2016Document1 pageDétails de Construction de Maison-2016lrgPas encore d'évaluation
- Lot 3 Charpentes BoisDocument27 pagesLot 3 Charpentes Boislaunayr0% (1)
- Sol Fini en BetonDocument50 pagesSol Fini en BetonNERI000Pas encore d'évaluation
- GUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE PETITS BÂTIMENTS EN MAÇONNERIE CHAÎNÉE EN HAÏTI - Juillet 2010Document124 pagesGUIDE DE BONNES PRATIQUES POUR LA CONSTRUCTION DE PETITS BÂTIMENTS EN MAÇONNERIE CHAÎNÉE EN HAÏTI - Juillet 2010Laurette M. Backer100% (5)
- Pathologie CarrelageDocument2 pagesPathologie CarrelageYoussoupha Cherif Haidara100% (1)
- Conception Technique Du Batiment PDFDocument59 pagesConception Technique Du Batiment PDFBouraida EL YAMOUNIPas encore d'évaluation
- Guide pratique des règles de l'art: Contraintes et signes de qualité dans la constructionD'EverandGuide pratique des règles de l'art: Contraintes et signes de qualité dans la constructionPas encore d'évaluation
- Afpa - 18 Maçonnerie en PierreDocument252 pagesAfpa - 18 Maçonnerie en PierreChristopher Andele100% (5)
- Notice de Pose Menuiserie BoisDocument36 pagesNotice de Pose Menuiserie BoisfreemanokPas encore d'évaluation
- Maconnerie GeneraleDocument30 pagesMaconnerie Generalecbochris100% (4)
- Rehabilitation ThermiqueDocument10 pagesRehabilitation ThermiqueDr House EnergiePas encore d'évaluation
- Tout savoir sur les dégâts locatifs: Etat des lieux et valorisation des biens immobiliers en BelgiqueD'EverandTout savoir sur les dégâts locatifs: Etat des lieux et valorisation des biens immobiliers en BelgiquePas encore d'évaluation
- Descente Des Charges Bâtiments Lourds - BâtimentsDocument9 pagesDescente Des Charges Bâtiments Lourds - Bâtimentskotozone3452Pas encore d'évaluation
- L'architecture pratique: Les ouvrages de massonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie, ardoise, tuille, pavé de grais & impressionD'EverandL'architecture pratique: Les ouvrages de massonnerie, charpenterie, menuiserie, serrurerie, plomberie, vitrerie, ardoise, tuille, pavé de grais & impressionPas encore d'évaluation
- Guide Pretique de La ConstructionDocument46 pagesGuide Pretique de La ConstructionClaude Fregeau0% (1)
- Les Assemblages en CharpenteDocument5 pagesLes Assemblages en CharpenteAntoine LM100% (1)
- BatimentDocument216 pagesBatimentSawadogo100% (1)
- Catalogue IsolationDocument20 pagesCatalogue IsolationBcd CdePas encore d'évaluation
- Dtu Guide CSTB TuilesDocument129 pagesDtu Guide CSTB TuilesJean-Christophe COPPÉE100% (1)
- Guide Faux PlafondsDocument40 pagesGuide Faux PlafondsIlyas AmraouiPas encore d'évaluation
- Construction Comment Ca Marche PDFDocument20 pagesConstruction Comment Ca Marche PDFfernandamoreirac100% (6)
- Guide Charpente Industrielle PDFDocument74 pagesGuide Charpente Industrielle PDFbaiadil100% (1)
- Lot 11 - PeintureDocument18 pagesLot 11 - PeintureChafiq OufridPas encore d'évaluation
- Plancher 2hDocument36 pagesPlancher 2hNasr Houssem67% (3)
- Le logement contemporain: Entre confort, désir et normes (1995-2012)D'EverandLe logement contemporain: Entre confort, désir et normes (1995-2012)Pas encore d'évaluation
- Ossatures MetalliquesDocument99 pagesOssatures Metalliquesgaci kenzaPas encore d'évaluation
- Construction Bois Type MBOCDocument28 pagesConstruction Bois Type MBOCToinou06100% (4)
- Cles Pour ConstruireDocument83 pagesCles Pour Construiremetoui62Pas encore d'évaluation
- Cours1 Gros OeuvreDocument32 pagesCours1 Gros OeuvreYoussef EttaajPas encore d'évaluation
- Manuel Technique Du Maçon - Organisation Conception ApplicationsDocument284 pagesManuel Technique Du Maçon - Organisation Conception ApplicationsAEMa CCC100% (3)
- Maison zéro consommation : Mode d'emploiD'EverandMaison zéro consommation : Mode d'emploiPas encore d'évaluation
- Manuel D'analyse de Dossier de Bâtiment1 PDFDocument48 pagesManuel D'analyse de Dossier de Bâtiment1 PDFTOURE80% (5)
- Guide Dalle BetonDocument6 pagesGuide Dalle BetonchokamPas encore d'évaluation
- Henri Renaud Charpentes Et CouverturesDocument81 pagesHenri Renaud Charpentes Et CouverturesMohamed Iziki100% (3)
- CCTP PDFDocument145 pagesCCTP PDFfourPas encore d'évaluation
- Construire en Béton CellulaireDocument132 pagesConstruire en Béton CellulaireYacine Tilaoui100% (9)
- Retour Dexperience Logements Bois 2013Document62 pagesRetour Dexperience Logements Bois 2013Al Fonz100% (1)
- Cours Etude de PrixDocument18 pagesCours Etude de Prixmehdialaoui90100% (3)
- 00 - Les METIERS Du Batiment OnisepDocument44 pages00 - Les METIERS Du Batiment OnisepChiwar Atheope100% (3)
- Techniques Et Materiaux 2012 PDFDocument6 pagesTechniques Et Materiaux 2012 PDFpapPas encore d'évaluation
- L'évaluation des biens immobiliers: Comment estimer la valeur d'un bien immobilier en BelgiqueD'EverandL'évaluation des biens immobiliers: Comment estimer la valeur d'un bien immobilier en BelgiquePas encore d'évaluation
- Applications Des Revêtements D'étanchéité PréfabriquésDocument15 pagesApplications Des Revêtements D'étanchéité PréfabriquésAnes Arc100% (1)
- Conception Des OuvragesDocument25 pagesConception Des OuvragesAWOUNANGPas encore d'évaluation
- 16-Guide Faux PlafondsDocument39 pages16-Guide Faux PlafondsBENSAAOUDPas encore d'évaluation
- Calfeutrement Des Joints Dans Le Bâtiment. ApplicationsDocument14 pagesCalfeutrement Des Joints Dans Le Bâtiment. ApplicationsAnes ArcPas encore d'évaluation
- Bétons Spéciaux de Protection PDFDocument29 pagesBétons Spéciaux de Protection PDFsalma.souissi100% (1)
- 206 e Guide Voirie Amenagements PublicsDocument92 pages206 e Guide Voirie Amenagements PublicsCorbuserap Roi Makoko100% (1)
- NIT 188 Pose Menuiseries ExterieuresDocument58 pagesNIT 188 Pose Menuiseries Exterieureslabo est100% (1)
- Nolwenn LeroyDocument40 pagesNolwenn LeroyJoséArimatéiaPas encore d'évaluation
- KolbrinDocument11 pagesKolbrinGuy PortelancePas encore d'évaluation
- A1 EC-Niger PDFDocument454 pagesA1 EC-Niger PDFFatoumata DoucouréPas encore d'évaluation
- Chioukh Menouar, Amrani KamelDocument203 pagesChioukh Menouar, Amrani KamelMourad Ezz100% (1)
- PAprincipal PDFDocument13 pagesPAprincipal PDFAymane AbdenourPas encore d'évaluation
- 4.cours III-2020Document97 pages4.cours III-2020Robert Kendley FlorestalPas encore d'évaluation
- Ordre Alphabétique Ce1 Coloriage MagiqueDocument1 pageOrdre Alphabétique Ce1 Coloriage MagiqueChris ManonPas encore d'évaluation
- Module L2 Maitrise de La LangueDocument4 pagesModule L2 Maitrise de La Languediouftapha220Pas encore d'évaluation
- Cours - BENHAMICHE Nadir - Eléments Pour L'étude Du Climat Et La BioclimatologieDocument94 pagesCours - BENHAMICHE Nadir - Eléments Pour L'étude Du Climat Et La Bioclimatologiemalik100% (2)
- Abs127 ArticleDocument23 pagesAbs127 ArticleBrandon NgniaouoPas encore d'évaluation
- Wmo - 1148 - FRDocument144 pagesWmo - 1148 - FRLowell SmithPas encore d'évaluation
- Class 7 L2 French MidTerm Question Paper August 2021Document3 pagesClass 7 L2 French MidTerm Question Paper August 2021Krish ReshmaPas encore d'évaluation
- Cours de Geographie 4e ApcDocument37 pagesCours de Geographie 4e ApcLaurent MarenaPas encore d'évaluation
- Venzia VehiculesVoyages PDFDocument39 pagesVenzia VehiculesVoyages PDFGor100% (1)
- ConteDocument3 pagesConteIbtissam KossorPas encore d'évaluation
- Culture Francophone Tarea 1Document7 pagesCulture Francophone Tarea 1Otoniel Natanael Almonte BelliardPas encore d'évaluation
- AD&D1 Module OA1 Les Sabres Du Daimyo Livret 1Document32 pagesAD&D1 Module OA1 Les Sabres Du Daimyo Livret 1Emmanuel Picardat100% (2)
- Point de RoseDocument4 pagesPoint de RosecvncxnPas encore d'évaluation
- Module 4 Secrets de La NatureDocument4 pagesModule 4 Secrets de La NatureAhmad EllouzePas encore d'évaluation
- ST T26-P26 TC 245 KVDocument16 pagesST T26-P26 TC 245 KVingPas encore d'évaluation
- ReducnometcDocument20 pagesReducnometcoussama2012Pas encore d'évaluation
- INFCOM-2 Progress Report FrDocument605 pagesINFCOM-2 Progress Report FrNaas MohamedPas encore d'évaluation
- Rapport Essai Permeabilite ISOLASUP PDFDocument5 pagesRapport Essai Permeabilite ISOLASUP PDF2ste3Pas encore d'évaluation
- Exercices 3ap Francais 2Document20 pagesExercices 3ap Francais 2nouna86% (7)