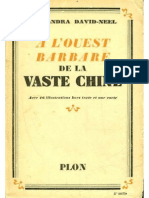Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bainville La Russie
Bainville La Russie
Transféré par
Scripca AurelCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bainville La Russie
Bainville La Russie
Transféré par
Scripca AurelDroits d'auteur :
Formats disponibles
J acques Bainville (1879-1936)
Historien franais
(1937)
La Russie et
la barrire de lEst
Un document produit en version numrique par Rjeanne Toussaint, bnvole,
Chomedey, Ville Laval, Qubec
Courriel: rtoussaint@aei.ca
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://classiques.uqac.ca/
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 2
Cette dition lectronique a t ralise par Rjeanne Toussaint, bnvole,
Courriel: rtoussaint@aei.ca
partir de :
J acques Bainville (1879-1936)
La Russie et la barrire de lEst.
Paris : Librairie Plon, 1937, 294 pp. ditions dhistoire et dart. Col-
lection bainvillienne.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 14 points.
Pour les citations : Times 12 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 12 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2004 pour
Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 12 mars 2006 Chicoutimi, Ville de Saguenay, Qubec.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 3
Table des matires
Prface
Avant-propos de J ean Marcel
1. La Russie
1.1 L'alliance russe, L'Action franaise, 30 juillet 1908.
1.2 J ournes rvolutionnaires Ptrograd, L'Action franaise, 17 mars 1917.
1.3 Le monde en mouvement, L'Action franaise, 23 mars 1917.
1.4 Instructions un ambassadeur en Russie, L'Action franaise, 20 avri1
1917,
1.5 Le parti allemand en Russie, L'Action franaise, 27 avril 1917.
1.6 Les problmes russes , L'Action franaise, 12 mai 1917.
1.7 La statue de Stolypine, L'Action franaise, 2 avril 1917.
1.8 Vingt cinq ans d'alliance russe, L'Action franaise, 8 juin 1917.
1.9 Le livre jaune de l'alliance franco-russe, L'Action franaise, 21 septembre
1918.
1.10 Les morceaux de la Russie, L'Action franaise, 23 novembre 1917.
1.11 L'abandon de Riga, L'Action franaise, 5 septembre 1917.
1.12 Les Allemands et la Russie, L'Action franaise, 3 mai 1918.
1.13 La politique allemande en Russie, L'Action franaise, 5 juillet 1918.
1.14 Les allis et la Russie, L'Action franaise, 10 dcembre 1918.
1.15 Le problme russe, L'Action franaise, 16 janvier 1919.
1.16 La paix l'Est, L'Action franaise, 10 mai 1919.
1.17 La Russie de demain, L'Action franaise, 19 juin 1919.
1.18 Un moment de mditation au milieu de l'apothose, L'Action franaise, 14
juillet 1919.
1.19 La Russie ressuscite, L'Action franaise, 30 janvier 1920.
1.20 Allemagne et Russie, L'Action franaise, 31 janvier 1920.
1.21 Le bolchevisme assagi, L'Action franaise, 28 fvrier 1920.
1.22 Par o atteindre la Russie ?, L'Action franaise, 12 aot 1920.
1.23 La recherche des alliances et le premier amour, L'Action franaise, 9 sep-
tembre 1920.
1.24 L'avenir du bolchevisme, L'Action franaise, 19 Mars 1921.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 4
1.25 La Russie et l'Occident, L'Action franaise, 18 mai 1922.
1.26 Le Congrs de Moscou, L'Action franaise, 1er juin 1923.
1.27 La mort de Lnine, L'Action franaise, 23 janvier 1924.
1.28 Le diplomate russe, L'Action franaise, 17 dcembre 1925.
1.29 Un remarquable fanatique, L'Action franaise, 24 juillet 1926.
1.30 Rumeurs sur la Russie, L'Action franaise, 20 octobre 1926.
1.31 Dcouverte d'un professeur danois, L'Action franaise, 12 avril 1927.
1.32 Vorochilov et Tolsto, L'Action franaise, 2 mai 1927.
1.33 Les dix ans du bolchevisme, La Libert, 18 octobre 1927.
1.34 Dix ans de sovitisme et l'avenir de la Russie, L'Action franaise, 11 no-
vembre 1927.
1.35 Staline et Trotsky, La Libert, 13 novembre 1927.
1.36 Russes et Allemands, La Libert, 20 mars 1928.
1.37 Un procs historique, La Libert, 16 juin 1928.
1.38 Un grenier o l'on a faim, L'Action franaise, 7 juillet 1928.
1.39 Nouvelles de Russie, L'Action franaise, 24 novembre 1928.
1.40 L'angoisse, La Libert, 18 fvrier 1929.
1.41 La thorie de l'accident, L'Action franaise, 19 mars 1929.
1.42 Intelligentsia, La Libert, 23 octobre 1929.
1.43 Les lapins de Staline, La Libert, 7 octobre 1931.
1.44 Illusions sur la Russie, La Libert, 30 dcembre 1931.
1.45 Vive la Russie !, L'Action franaise, 23 fvrier 1933.
1.46 La grande alliance, L'Action franaise, 15 dcembre 1934.
1.47 Toujours l'alliance russe, L'Action franaise, 12 fvrier 1935.
1.48 Encore un belliciste, L'Action franaise, 13 fvrier 1935.
1.49 Une aventure dangereuse, L'Action franaise, 14 Avril 1935.
1.50 La nouvelle alliance, La Libert, 4 Mai 1935.
1.51 L'Occident et l'Orient, L'Action franaise, 19 mai 1935.
1.52 La ratification de l'alliance avec les Soviets, L'Action franaise, 14 no-
vembre 1935.
1.53 Entre Hitler et Staline, L'Action franaise, 23 novembre 1935.
1.54 L'alliance aventureuse, L'Action franaise, 30 novembre 1935.
1.55 Enrags et possds, L'Action franaise, 11 dcembre 1935.
1.56 Chacun son Sadowa, L'Action franaise, 17 dcembre 1935.
1.57 Pas de choix entre deux alliances, L'Action franaise, 2 janvier 1936.
1.58 Rcidive, L'Action franaise, 26 janvier 1936.
1.59 Vie et opinion d'un marchal des Soviets, L'Action franaise, 4 fvrier
1936.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 5
1.60 L'intervention force et l'intervention libre, L'Action franaise, 9 mai
1935.
2. La Pologne
2.1 Varsovie, L'Action franaise, 10 novembre 1916.
2.2 L'alerte de 1920, L'Action franaise, 29 juillet 1920.
2.3 De l'alliance franco-russe l'alliance franco-polonaise, L'Action franaise,
22 fvrier 1921.
2.4 Pologne et Turquie, L'Action franaise, 20 mai 1923.
2.5 La Pologne et la paix, L'Action franaise, 22 Mars 1925.
2.6 La Pologne puissance militaire, L'Action franaise, 13 juillet 1925.
2.7 Pilsudski et l'aristocratie polonaise, L'Action franaise, 6 avril 1926.
2.8 Un trs grand changement, L'Action franaise, 4 mars 1927.
2.9 Vive la Pologne, Monsieur ! , L'Action franaise, 18 mars 1927.
2.10 Le marchal Pilsudski et le rgime parlementaire, L'Action franaise, 7
juillet 1928.
2.11 La bataille de la Vistule, L'Action franaise, 15 octobre 1928
2.12 Les tapes, L'Action franaise, 29 dcembre 1930.
2.13 Pierre prcieuse, L'Action franaise, 14 janvier 1931.
2.14 Le quatrime partage, L'Action franaise, 5 fvrier 1931.
2.15 La Pologne et ses amis, L'Action franaise, 24 octobre 1934.
2.16 Le sjour de M. Goering en Pologne et le problme de Memel, La Libert,
29 janvier 1935.
2.17 Rapprochement avec l'Allemagne ?, La Libert, 4 avril 1935.
2.18 Pilsudski, L'Action franaise, 14 mai 1935.
3. La Roumanie
3.1 Le cinquantenaire de l'indpendance roumaine, L'Action franaise, 11 Mai
1927.
3.2 La mort de Ferdinand 1er, L'Action franaise, 21 juillet 1927.
3.3 En Roumanie, L'Action franaise, 10 octobre 1927.
3.4 En Roumanie, L'Action franaise, 21 mars 1928.
3.5 Le testament cass, L'Action franaise, 9 juin 1930.
3.6 lections en Roumanie, L'Action franaise, 4 juin 1931.
3.7 Aprs le meurtre de Sinaa, L'Action franaise, 6 janvier 1934.
3.8 La grande et la petite pointure, L'Action franaise, 5 octobre 1934.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 6
4. La Turquie
4.1 Le pril asiatique, L'Action franaise, 5 janvier 1920.
4.2 Constantinople et la Russie, L'Action franaise, 24 septembre 1922.
4.3 Le gouvernement turc aujourd'hui et demain, L'Action franaise, 5 no-
vembre 1922,
4.4 L'expulsion du calife, L'Action franaise, 6 mars 1924.
4.5 Le trait de Lausanne et nos intrts en Orient, L'Action franaise, 5 mai
1924.
4.6 Les Turcs, les Soviets et Constantinople, L'Action franaise, 26 dcembre
1925.
4.7 L'enlvement de la Tchadra, L'Action franaise, 16 avril 1927.
5. Finlande, Gorgie, Lettonie
5.1 L'indpendance de la Finlande, L'Action franaise, 9 janvier 1918.
5.2 La victoire du Lappo, La Libert, 24 octobre 1930.
5.3 Du Caucase la cour d'assises, La Libert, 8 juillet 1927.
5.4 Renaissances, L'Action franaise, 20 novembre 1928.
6. Les effets du sionisme.
L'Action franaise, 20 dcembre 1920.
7. L'Asie, Chine, J apon
7.1 L'Asie et l'Occident, L'Action franaise, 20 juillet 1925.
7.2 L'Asie qui fermente, La Libert, 31 mars 1927.
7.3 Les rats bruns et les rats noirs, La Libert, 9 avril 1927.
7.4 En Chine, La Libert, 12 avril 1927.
7.5 Aventures d'un chemin de fer, La Libert, 20 juillet 1929.
7.6 L'impntrable avenir, L'Action franaise, 24 fvrier 1932.
7.7 Une expulsion, L'Action franaise, 25 fvrier 1933.
8. Perse, Afghanistan
8.1 Les lois de l'imitation, L'Action franaise, 16 dcembre 1925.
8.2 Pierre le Grand Kaboul, L'Action franaise, 26 janvier 1928.
8.3 Despotes clairs, L'Action franaise, 27 octobre 1928.
8.4 Une victime du progrs, L'Action franaise, 16 janvier 1929.
8.5 Le fils du porteur d'eau, La Libert, 19 janvier 1929.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 7
J acques Bainville (1879-1936)
La Russie et la barrire de lEst.
Paris : Librairie Plon, 1937, 294 pp.
Editions dhistoire et dart. Collection bainvillienne.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 8
Prface
Retour la table des matires
Dans la prface de la Fortune de la France, le premier ouvrage pos-
thume de J . Bainville, M. Gignoux a bien raison de dire que ce livre
est un bienfait. Voici, dans un autre ordre d'ides, un nouveau bienfait,
non moins insigne, et plus tendu, car il franchit nos frontires. Sont
appels en profiter tous les peuples dignes d'entendre les leons d'un
pareil matre. Y participent galement toutes les grandes causes aux-
quelles il avait dvou sa vie, patrie, paix, civilisation, humanit, vri-
t. Nos amis et allis polonais et roumains y trouveront, avec un juste
hommage aux vertus qui expliquent le miracle de leur rsurrection,
des vues singulirement pntrantes sur tous les problmes dont d-
pend leur avenir.
Mais si ces tudes s'appliquent plus particulirement l'Europe
orientale, leur porte en dpasse de beaucoup le sujet. Sans doute,
c'est surtout en politique extrieure, o les lments en apparence les
plus distincts se combinent et ragissent les uns sur les autres, qu'il est
exact de dire que tout est dans tout, en ajoutant ou non, selon la bou-
tade connue : et rciproquement. Reste dcouvrir le secret de ces
ractions mutuelles en dgageant les rapports qui les dterminent. Or,
nul n'y excelle comme J . Bainville, prince de la synthse et, par
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 9
consquent, de l'analyse. C'est le grand art de l'historien et aussi du
politique, l'histoire tant la politique du pass, et la Politique tant
l'histoire de l'avenir. C'est pourquoi les hommes d'Etat, ou plutt (car
ce serait un trop petit public pour J . Bainville) les politiciens qui aspi-
rent mriter ce beau nom si galvaud de nos jours, seront bien inspi-
rs de se mettre son cole. Ce sera pour eux une chance de promo-
tion. Ils y trouveront aussi la rare bonne fortune d'un avantage accord
tous sans rien coter aucun d'eux, l'intelligence de J . Bainville
tant comme la grce et la lumire selon Bossuet : elle se distribue
sans se diviser. Puissent-ils faire de ses crits, notamment de celui-ci,
leurs livres de chevet ! S'ils le mditaient pendant la nuit, ils se four-
voieraient moins pendant le jour. l'exemple de Richelieu, prcdent
flatteur, ils pourraient se dire que les peuples dorment tranquilles
l'ombre de leurs veilles.
Cependant les conducteurs de peuples, mme en y comprenant
ceux qui se flattent de les diriger tout en les suivant, ce qui est le cas
de tous les dmagogues, ne seront jamais que la partie la moins nom-
breuse et la moins perfectible des lecteurs de J . Bainville. Sa vraie fa-
mille intellectuelle, les fils de son esprit, ceux qui lui doivent le jour,
puisqu'il les a clairs, c'est cette lite de plus en plus innombrable de
jeunes gens qu'il a affranchis des sophismes o tant d'autres s'attardent
encore, et qui ont la noble ambition de faire l'histoire ou de l'crire, ou
simplement de la comprendre en observant sa mthode. La volupt de
comprendre devrait attirer vers lui tous les lecteurs et toutes les lectri-
ces qui y sont sensibles ; nul ne la dispense plus srement ni plus g-
nreusement que lui, ni plus discrtement. C'est un matre qui est le
contraire d'un magister. A tel point que, par un prodige de simplicit
dans la lucidit, et de transparence dans la profondeur, le lecteur a par-
fois l'illusion - qu'il prouve aussi en lisant par exemple La Fontaine,
et c'est la marque de la perfection - de dcouvrir tout seul et de rame-
ner la surface les trsors dont l'auteur lui fait largesse. Cette maeu-
tique fait de tout lecteur un ami parce qu'il se croit un collaborateur.
Rendons grces aux disciples de J . Bainville d'avoir li ces tudes,
ne disons pas en faisceau, afin d'pargner sa mmoire un procs de
tendance, mais en gerbe ou en bouquet. Et, pourtant, si J . Bainville
n'tait pas fasciste, c'est bien un faisceau de lumire qu'il promne sur
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 10
quelques-uns des aspects et des replis les plus obscurs de la vie inter-
nationale.
Si ce faisceau est un bouquet, il exhale, comme tout ce qui vient de
J . Bainville, un parfum discret de sagesse et de finesse, et, bien que
telles de ses fleurs aient plus de vingt ans, il est aussi frais que s'il tait
cueilli ce matin. O est la clef de ce mystre ? Ce n'est pas seulement
la magie du style. C'est un lieu, commun de rpter que les articles de
journaux ne durent que par le style. Pour voler au-dessus du temps, et
par tous les temps, sans se friper et sans passer inaperue, il faut que
la forme en soit lgre, solide et brillante. On a tout dit sur le style
merveilleux de J . Bainville. J 'allais dire sottement, en usant d'un de
ces clichs dont il avait horreur, que ce style brille dans ces pages de
tout son clat. Mais, s'il tait l, il me reprendrait gentiment, me ferait
observer que je manque d'une de ses qualits essentielles, la proprit
des termes, son style vitant l'clat avec autant de soin que d'autres le
recherchent. Il met sa coquetterie l'assourdir, l'estomper, ce qui est
autrement difficile que de le brillanter . Il le dpouille volontaire-
ment, ce qui nous permet de l'admirer, et d'admirer la vigueur de sa
pense, dans sa densit plus lumineuse que brillante, dans sa nudit
muscle d'athlte.
Certains critiques ont compar J . Bainville Voltaire. C'est faire
beaucoup d'honneur Voltaire qui a t dfini, je crois, par mile Fa-
guet, un chaos d'ides claires, alors que J . Bainville a fait sortir d'un
chaos d'ides fausses un monde ordonn d'ides justes et claires. La
ressemblance, s'il y en a une, serait plutt dans la forme que dans le
fond. Ne pourrait-on dire, de J . Bainville dont le style prfre la ver-
roterie de l'pithte rare le pur diamant d'une savante simplicit, qu'il
crit, comme Voltaire, la langue de tout le monde, mais comme Per-
sonne ?
Et pourtant, le haut mrite de ces pages est dans le fond plus en-
core que dans la forme. Le suc en est aussi nourrissant que si savou-
reux. C'est si bien crit qu'on les lirait avec plaisir mme ce n'tait pas
si bien pens. C'est si bien pens qu'on les lirait avec fruit et aussi
avec plaisir mme si ce n'tait pas si bien crit. Le temps coul de-
puis les faits qui les ont inspires ajoute ce plaisir et ce fruit en
confirmant les prvisions de J . Bainville. L'exprience aujourd'hui les
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 11
certifie conformes au rel dont il avait le culte, ce qui est une rare ori-
ginalit une poque o l'esprit de chimre a fait plus de dgts dans
la politique extrieure que partout ailleurs. Cette preuve - il serait
piquant, cruel et difiant d'y soumettre les vaticinateurs patents de
l'idologie encore rgnante en composant avec leurs prophties un
sottisier qui servirait de repoussoir ce florilge - cette preuve cau-
tionne la doctrine de l'auteur. En lui apportant la sanction du pass,
elle engage ceux qui ont souci de l'avenir le construire sur cette base
indestructible. Ce qui en fait la valeur permanente et gnrale, c'est
qu'elle est elle-mme fonde sur le sens du permanent et de l'univer-
sel, sans ngliger le transitoire et le particulier, mais en clairant
ceux-ci la lumire de ceux-l, C'est en appliquant aux problmes de
la politique les constantes et les concordances de l'histoire qu'il en d-
couvre, avec les vritables donnes, le lien, la jointure, la solution. Il
mdite sur la politique du jour en Philosophe et en pote, si philoso-
pher c'est expliquer le divers par l'un en ramenant le contingent l'es-
sentiel, et si la posie consiste extraire le rare du commun et se
rapprocher de l'absolu en Partant du concret. Car J . Bainville part tou-
jours du concret - il en part avec esprit de retour - mais toujours pour
s'lever des conclusions qui le dpassent tout en le rendant intelligi-
ble. C'est ce qui le distingue de tant d'esprits prsomptueux et superfi-
ciels qui prennent les gnralits pour des ides gnrales, alors qu'ils
n'en ont pas plus qu'ils n'ont le sens du concret.
*
* *
En accueillant J . Bainville l'Acadmie, M. Maurice Donnay l'a
compliment d'estimer qu'il avait le devoir non seulement de rensei-
gner , mais d' enseigner le lecteur. Il a ajout, en se rfrant son
livre le plus rpandu, je crois : C'est l'histoire de France en avion.
Ces heureuses formules caractrisent aussi ce nouveau livre. Il en-
seigne aujourd'hui plus qu'il ne renseigne, les faits qui y sont exposs
devant tre surtout retenus pour la leon qu'il en dgage. C'est encore
de l'histoire, et de la politique en avion. Non par la rapidit, c'est un
avion planeur et qui ne s'en prive pas quand le spectacle en vaut la
peine, mais par la hauteur et par la lucidit dans la vision des ensem-
bles, de leurs rapports et de leurs proportions. Quelque sujet qu'il
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 12
traite, J . Bainville le survole. En histoire et en politique, comme la
guerre, c'est le meilleur procd d'observation. Dans leurs traits essen-
tiels les grands panoramas n'y sont pas moins immuables que ceux de
la terre. La nature des choses y est aussi stable que les choses de la
nature. Le coeur humain et ses passions, les courants de sentiments,
d'ides et d'intrts qui en drivent ne changent pas plus de place que
les chanes de montagnes, les fleuves et les mers. l'altitude variable
de J . Bainville, soit au-dessus des nues, soit au-dessous, jamais au
milieu, si ce n'est pour les percer, tantt il contemple les vrits ter-
nelles, les astres qui le guident, tantt il scrute les horizons de notre
plante o tout lui apparat son vrai plan, avec son exact relief, y
compris les moindres dtails. Mais il voit que ce sont des dtails et il
ne les relve que s'ils ont un rle dans l'ensemble.
Pour dire les choses tout simplement, la qualit matresse de J .
Bainville, qui en a tant d'autres, c'est le bon sens, le sens commun, si
l'on veut, mais un degr si rare qu'on s'en merveille. Le sens com-
mun, noble facult puisque, comme son nom l'indique, elle nous per-
met de communier avec l'humanit. Ce bon sens appliqu de grands
sujets en tire de grandes leons parce qu'il est clair par une sre doc-
trine, inform par une science universelle, aiguis par l'exprience et
la rflexion. Si les jugements de J . Bainville s'imposent nous avec
tant de force, c'est parce que leurs considrants en sont aussi dcisifs
que les termes en sont incisifs. Le cours des vnements donne au-
jourd'hui ces jugements une valeur prophtique, qu'ils portent sur la
Russie, la Pologne, la Petite-Entente, la Turquie ou l'Asie.
J . Bainville qui a horreur des paroles inutiles, du dveloppement
oratoire, triomphe dans le raccourci. Il a au plus haut point le don de
la formule qui rsume une situation et illumine tout un horizon. Dans
ses articles sur la Russie, il dfinit sa faiblesse : gigantisme et dbili-
t . Il dnonce la purilit des plans conus par les Allis, en 1918,
pour touffer la rvolution russe au berceau. On n'occupe pas la moiti
du monde, dit-il, avec quatre hommes et un caporal . Bien avant
que les rapports de la France avec les Soviets aient donn les fruits
amers que nous gotons aujourd'hui, il constate que la Russie nous
tient plus que nous ne la tenons . Sans mconnatre l'action des cau-
ses profondes dans le destin des peuples, un esprit aussi avide de
comprendre ne nglige pas les causes secondes, ce qu'il appelle l'acci-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 13
dent, l'accident qui parfois dclenche la catastrophe, le petit fait qui
dtermine tout coup comme une combustion gnrale de l'orga-
nisme . Saviez-vous que ce petit fait, en Russie, est le voyage de M.
Doumer Ptrograd pendant la guerre ? Il est le principal auteur de la
Rvolution parce qu'il a obtenu de Nicolas II, non sans peine, de gi-
gantesques leves d'hommes. Ce fut un magnifique succs diplomati-
que. Mais c'est l'entassement de tous ces moujiks dans les casernes de
la capitale qui a fourni une arme la rvolution.
J . Bainville fixe un regard aussi perant sur les consquences du
cataclysme que sur ses causes. Pour lui, la restauration de l'ordre est
un rve. Et ce n'est pas un beau rve. La Russie ne retrouvera pas
d'elle-mme son assiette comme les fleuves rentrent dans leur lit aprs
une inondation. Il y faudra un immense effort d'ordre. Or, en Russie,
l'ordre est allemand. D'ailleurs, depuis la dernire guerre, l'alliance
germano-russe (qui, en droit, existe, le trait de Rapallo ayant t non
pas dnonc, mais renouvel) est, en fait, impose par la force des
choses, c'est--dire par l'histoire et par la gographie. Par l'histoire des
traits qui ont mis fin la guerre et qui ont t imposs la Russie
comme l'Allemagne, avec cette nuance qu'elle ne les a mme pas
signs. Par la gographie, par la rsurrection entre l'Allemagne et la
Russie d'une Pologne qu'elles aspirent se partager de nouveau. Mal-
gr les apparences, l'antinomie des rgimes n'est pas un obstacle la
collaboration, l'Allemagne n'ayant pas l'habitude de subordonner,
l'exemple de notre Rpublique sa politique extrieure sa politique
intrieure. J . Bainville fait observer qu'elle a toujours gard le contact
avec Moscou, mme alors qu'elle crasait chez elle les Spartakistes, et
que, pour elle, les ides des autres peuples ne sont que des explosifs
qu'elle manipule dans ses laboratoires pour faire sauter ceux qui la
gnent. C'est dire que la collusion germano-russe ne se dveloppe que
plus dangereusement l'abri du pacte franco-sovitique, le pige le
plus grossier o soit jamais tombe la diplomatie franaise.
Autre point o la clairvoyance de J . Bainville lui a fait pressentir
l'volution de la crise russe. Les pontifes du bolchvisme juraient
qu'ils n'imiteraient pas les grands anctres en s'entre-dvorant. J .
Bainville avait un mince sourire devant ces serments. Il connat la loi
d'anthropophagie mutuelle qui rgit les terroristes. Or, voici que le
Guignol russe devient sanglant mme pour ses vedettes. Il avait prvu
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 14
ce massacre en masse des premiers aptres du bolchvisme, cette jon-
che de cadavres comme dans les dnouements des drames de Sha-
kespeare, sans qu'on puisse dire que c'est un dnouement.
*
* *
La bouffonnerie du pacte franco-sovitique n'est pas seulement si-
nistre en elle-mme ; elle l'est aussi parce qu'elle loigne de nous nos
meilleurs amis de l'Europe orientale. Cette alliance contre-nature d-
truit nos alliances naturelles. Elle est incompatible avec le maintien de
la Pologne, de la Roumanie et de la Yougo-Slavie dans notre systme
dfensif. cet gard, les dfaillances et les erreurs du gouvernement
franais donnent malheureusement raison J . Bainville dans la
controverse amicale que j'ai eue parfois avec lui sur la solidit et l'ef-
ficacit de nos accords avec la Pologne et la Petite-Entente. ses
yeux, je surestimais ces accords, alors qu'il me semblait enclin les
sous-estimer. Son scepticisme portait non sur la vitalit de ces nations
- il en faut moins pour vivre que pour ressusciter - ni sur leur fidlit
envers la France, mais sur l'aptitude de notre rgime dmocratique
leur assurer des garanties suffisantes pour les dtourner d'en chercher
ailleurs. Ayant moi-mme t tmoin de l'hrosme de ces nations et
de leur culte pour la France libratrice, notamment en Roumanie dont
on a dit que son attachement la grande soeur latine est le seul cas
vraiment passionnel de la politique internationale, je ne pouvais croire
que la France aurait jamais un gouvernement assez ennemi d'elle-
mme pour compromettre un pareil capital d'amiti, de prestige et de
scurit. Ayant longtemps reprsent la Rpublique franaise
l'tranger alors qu'elle avait une diplomatie nationale, je ne pouvais
l'imaginer capable de sacrifier nos meilleurs atouts en Europe en
jouant, pour des raisons inavouables de politique intrieure, la carte
malfique de Moscou. J . Bainville qui avait observ Paris, de plus
prs que moi, la subordination croissante de notre politique extrieure
notre politique intrieure ne partageait pas cet optimisme. Dans cette
discussion, les rles taient intervertis entre nous. J e considrais le
problme en journaliste, d'aprs mes impressions locales, J . Bainville
l'examinait en diplomate, d'aprs ses rflexions dans le cadre de la po-
litique gnrale dont il connaissait tous les lments mieux que moi,
notamment la maladie organique de notre dmocratie sur laquelle
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 15
j'avais encore quelques illusions. En fait, la cohsion du groupement
Pologne-Petite-Entente, comme lment d'quilibre, rempart de la
paix, et alli de revers ventuel contre l'imprialisme allemand,
postule sa solidarit active avec la France et, si possible, l'Angleterre,
ou, tout au moins, aussi longtemps que Londres dclinera toute res-
ponsabilit sur le continent en dehors du Rhin, l'appui d'autant plus
ferme et vigilant d'une France fidle sa vocation d'Etat rgulateur et
pacificateur. Ce groupement serait inbranlable s'il s'adossait au front
Londres-Paris-Rome et la coordination des deux systmes rendrait
impossible toute entreprise contre la paix. dfaut de cet idal qui
tait presque ralis quand la crise thiopienne a clat, la constella-
tion pacifique de l'Orient tiendrait encore si l'attraction de l'Occident,
c'est--dire surtout l'attraction de Paris, s'exerait fortement sur elle ;
mais si le ple d'attraction devient un ple de rpulsion, comme c'est
le cas depuis la conjonction Paris-Moscou, la dislocation est invita-
ble. Quand l'astre aujourd'hui aberrant de la France aura rintgr son
orbite, tout rentrera dans l'ordre. Les allis ne lui manquent que parce
qu'elle se manque elle-mme.
Les leons de J . Bainville montrent la France et l'Europe la voie
du salut. C'est la mme, pour l'une et l'autre ; mais c'est la France de
s'y engager la premire parce qu'elle est la plus menace de toutes les
grandes Puissances et parce que les autres peuples ont l'habitude de lui
faire cortge quand elle ne s'gare pas. Metternich disait : l'Europe
ternue quand la France est enrhume. Que la France recouvre la san-
t, ce sera tout bnfice pour la sant de l'Europe.
La France et l'Europe trouveront dans ces pages de J . Bainville des
rgles d'hygine qui, si elles sont observes, leur pargneront des cri-
ses redoutables et l'intervention du chirurgien.
*
* *
Tous ceux qui ont connu l'auteur, l'ont aim et admir, mditeront
ces conseils, discrets par le ton et premptoires par la souverainet de
la raison, la lois avec joie et avec tristesse.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 16
J oie de l'esprit qui entre en possession de la vrit, son objet, dans
sa plnitude et dans ses nuances ; joie qui ne va pas sans plaisir, car on
se sent plus intelligent en pntrant dans son intimit, et nous y go-
tons le double et contradictoire attrait de la nouveaut et de la scuri-
t : les questions qu'il traite, mme si nous les connaissons dj, nous
semblent nouvelles parce que nous les comprenons pour la premire
fois ; et son explication nous rassure parce que nous la sentons
conforme la sagesse ternelle.
Tristesse du coeur, la pense que la mort a ferm ces yeux si
clairvoyants et teint cette voix si persuasive, alors que les vne-
ments donnent la sagesse de J . Bainville tout son prix et que sa
gloire toujours grandissante lui donne tout son rayonnement. C'est ce
qui confre ces paroles une gravit testamentaire et impose tous les
amis de la paix en France et dans le monde, le devoir de les traduire
en actes. Sa voix est teinte, sa lumire ne l'est pas. Les gnrations
nouvelles accompliront ses dernires volonts et se sauveront elles-
mmes en transformant cette lumire en force.
Saint-Aulaire.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 17
Avant-propos
Par Jean Marcel
Retour la table des matires
LA mort d'un crivain est d'ordinaire suivie d'une sorte de pnom-
bre qui s'tend sur son oeuvre. Annes de silence, o il est difficile de
faire la part de l'oubli et du recueillement. Les parties solides de l'oeu-
vre, quand il y en a, mergent plus tard. Le temps se charge de les
consacrer. Exceptionnel en tout, J acques Bainville n'aura mme pas eu
connatre celle preuve. La substance de ce deuxime volume porte,
l'gal du premier, le tmoignage de l'actualit intense de sa pense.
Rien, depuis tantt vingt ans, n'a pu infirmer la vue d'ensemble
qu'il avait prise de l'Europe du Trait de Versailles, pacte moral et non
point trait politique. Une Allemagne unifie dans ses rapports avec
une Europe morcele, formule brve et qui dit tout. Le reste n'est
que pour expliquer et fixer par avance les zones de rupture. Vanit du
chapelet de Serbies pour ceinturer une Prusse que le trait a
confondue avec l'Allemagne et qui garde la puissance politique,
celle qui engendre toutes les autres . Pese fatale de la masse germa-
nique sur le Brenner, complique du conflit sculaire renaissant entre
le Sacerdoce et l'Empire. Retour au drame du dix-huitime sicle avec
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 18
le coin Polonais enfonc entre le Brandebourg et la vieille Marche de
l'Est. Russie refoule dans la steppe asiatique par la perte presque to-
tale des conqutes europennes de Pierre le Grand et de Catherine - et
conjonction profonde de l'tat prussien et de l'tat moscovite, allis
naturels dans la recherche de leurs Alsaces-Lorraines arraches, et
tout prts, comme au temps de Frdric II, communier, en vieux
complices, du corps eucharistique de la Pologne . Il ne manquait,
pour achever le tableau, que l'ide prodigieuse venue la politique
franaise de conduire de front l'alliance russe et l'alliance polonaise,
comme la vieille diplomatie s'tait vertue jusqu'au casse-tte rete-
nir dans notre amiti l'Autriche, la Pologne et la Russie - et cette fois,
sans secret et sans roi. Errare humanum est -, perseverare...
On a puis toutes les ressources de la langue pour qualifier l'intel-
ligence d'un Bainville. Que dire de sa volont inflexible considrer
que les mmes causes produisent les mmes effets et les produiront
encore, et que seules les dates doivent tre rserves ! Nuages, brouil-
lards ni mirages n'ont jamais pu voiler dans son esprit l'existence des
grandes masses aux artes vives. Bainville avait le sens de l'instinct de
conservation inhrent chaque peuple en mme temps que des res-
sorts historiques de sa politique. ses cts, l'ombre d'Albert Sorel
l'amenait dcouvrir le corps dur et l'invitable rflexe, sous le vte-
ment des rgimes mouvants ou le voile des idologies.
Faudra-t-il une catastrophe pour arriver comprendre que le d-
sordre europen a son sige et son moteur dans l'tat militaire prus-
sien, inventeur, protecteur et bnficiaire du messianisme russe, frap-
p encore du triple sceau de la philosophie allemande ? Il n'est pas sr
que l'Europe doive chapper l'preuve, puisqu'il s'en trouve encore
qui songent Belzbuth pour chasser les dmons. Nous avons peine
croire qu'une illusion aussi cruelle puisse rsister la lecture de cet
ouvrage.
Bainville donnait leur importance aux alliances orientales de la
France, mais il avait horreur de la contradiction et il songeait aux tra-
hisons de la Russie. Pour reposer son esprit de l'amer souvenir de
Brest-Litovsk, il est probable qu'il se reportait au carnage des Teuto-
niques Tannenberg de la main de fer des chevaliers polonais. Il ne
faisait pas mystre en tout cas de considrer qu'auprs du mariage rus-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 19
so-polonais, espoir de notre diplomatie, celui du Grand Turc et de la
Rpublique de Venise tait un jeu d'enfant.
J ean Marcel.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 20
La Russie
1.1
L'alliance russe
1
L'Action franaise, 30 juillet 1908.
Retour la table des matires
EN lisant les commentaires embarrasss et un peu froids de la
presse officieuse sur la rencontre de M. Fallires et de l'empereur Ni-
colas II, nous songions que ce serait une triste et instructive histoire
crire que celle de l'amiti franco-russe. Personne n'en est plus per-
suad que nous : l'alliance avec la Russie est bienfaisante et nces-
saire. Si nous ne disons pas naturelle, c'est parce que toutes les allian-
ces le sont, du moment qu'elles sont utiles, et que le systme des al-
liances naturelles nous a fait trop de mal en son temps pour qu'il soit
jamais propos de le rajeunir. Mais plus on est partisan de l'amiti
avec la Russie, plus on a de raisons de tenir cette amiti et plus on
voit les services qu'elle est capable de rendre, plus on est dispos
s'attrister sur les mauvaises chances qui l'ont frappe depuis ses origi-
1
Cet article est le seul de la priode d'avant guerre que nous ayons cru devoir
reproduire. Il est significatif de la mfiance que l'auteur a toujours professe
l'gard de l'alliance russe. Il est frappant de mettre en regard celui qui porte la
date du 14 juillet 1919.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 21
nes et qui ne l'ont mme pas pargne lorsqu'elle a t dment scelle
et jure solennellement.
Ne parlons pas des brves journes, ni des mauvais lendemains de
Tilsitt. C'est par la Restauration que l'alliance franco-russe fut d'abord
noue avec solidit. Au jugement d'Albert Sorel, historien non sus-
pect, l'alliance en ce temps-l fut un dessein conu de haut et men
de longue main . Quelle dignit, quelle sagesse, quelle prudence
avaient prsid cet arrangement ! En 1821 - six ans aprs Water-
loo. ! - c'est Alexandre 1er lui-mme qui faisait des avances et des ou-
vertures M. de La Ferronnays. Le duc de Richelieu donnait pour
instructions notre ambassadeur de n'accepter les propositions de
l'Empereur que s'il consentait leur donner la forme de stipulations
crites . Et quand, un peu plus tard, M. de Nesselrode s'inquitait de
notre rserve, M. de La Ferronnays lui rpondait : L'exprience nous
a appris les soupons que nous vous inspirerions vous-mmes si
nous allions plus loin avec vous.
Que l'on compare donc cette attitude l'attitude du faible gouver-
nement de 1875 rduit implorer la protestation d'un autre Alexandre.
Et pourtant, en 1821 et en 1875, la France se trouvait la mme dis-
tance de la dfaite et de l'invasion. Que l'on compare aussi les rsultats
que la Restauration fit sortir de l'amiti russe, ceux qu'en a tirs la
troisime Rpublique ; c'est cette amiti que nous dmes jadis
d'avoir les mains libres pour conqurir Alger. Et sans doute l'entente
aurait-elle port bien d'autres fruits. Le fameux projet de remaniement
europen de Polignac et de Bois-le-Comte pchait, il est vrai, par bien
des cts. Il offrait plus d'un danger, et il est douteux que Charles X,
ce roi passionn pour le relvement national , a dit M. mile Olli-
vier, lui et donn son approbation, Mais le fait subsiste que, d'accord
avec le cabinet de Ptersbourg, la monarchie se prparait effacer les
dernires consquences de 1815 lorsque la rvolution vint mettre fin
aux pourparlers, aux plans d'avenir et aux plus solides esprances.
Plus d'une fois, par la suite, des tentatives furent faites pour re-
nouer le lien bris. La fatalit s'acharnait. La guerre de Crime rendit
vains les efforts de M. de Castelbajac, et Morny se heurta au refus de
son matre. Mais, depuis qu'en 1891 les deux pays ont contract une
union retarde par tant de pripties, le sort les a-t-il enfin mieux trai-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 22
ts ? Non. La mauvaise chance a dur. Peut-tre l'alliance portait-elle
en elle-mme ds ses origines un fcheux lment de disproportion :
des deux pays amis, le plus anciennement civilis, le ntre, qui et d
jouer le rle d'avertisseur et de conseil, n'tait-il pas aussi celui que
ses institutions rendaient le plus mou, le plus faible, le plus instable
dans ses desseins et le moins port agir ? Incapable de prserver du
pril son allie - tmoin la guerre de Mandchourie, laquelle personne
ne croyait, M. Hanotaux l'a encore dit il y a trois jours, - la France
tait expose elle-mme tous les dsordres. L'affaire Dreyfus, et la
rvolution qui s'ensuivit, conspira avec les dfaites et la rvolution
russes pour affaiblir l'alliance.
Qu'en reste-t-il prsent ? Quelles esprances fait-elle concevoir ?
Qu'on pense tout ce que l'enthousiasme franais en attendit autrefois.
Qu'on se souvienne de Cronstadt, de Toulon, de la visite des marins
russes, et mme de la revue de Btheny. M. Hanotaux a beau dire,
pour rappeler son oeuvre aux gnrations prsentes, que la Vrit a
repris le sillage du Pothuau . Il y a quelque chose de chang, quelque
chose de fl peut-tre. C'est le Temps qui le fait remarquer avec in-
sistance et en le regrettant : ni dans l'une ni dans l'autre des allocutions
prononces Reval, il n'est question des forces militaires des deux
pays ni de leurs armes. Or, dit le Temps, les alliances ne servent
rien si elles associent des impuissances . Impuissance est peut-tre
un mot un peu fort et jusqu'o nous n'irons pas. Mais si la France est
affaiblie, nous savons bien qui la faute. Et il se pourrait aussi que la
Rpublique n'et pas fait remplir la France l'gard de l'empire
russe tout son devoir d' amie et allie : une France plus forte et sur-
tout plus prvoyante et sage devait, par d'opportuns et utiles conseils,
permettre la Russie d'chapper bien des causes d'affaiblissement.
Aujourd'hui, ceux mmes qui demeurent le plus attachs l'alliance
reconnaissent qu'elle n'a pas encore rempli son mrite. Sera-ce la der-
nire rigueur du sort qui depuis un sicle s'acharne sur elle ?
L'Action franaise, 30 juillet 1908.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 23
1.2
J ournes rvolutionnaires
Petrograd
L'Action franaise, 17 mars 1917.
Retour la table des matires
NICOLAS II ne s'est pas conform la maxime : Rois, gouver-
nez hardiment. Il aurait termin par une abdication qui n'est pas en-
core certaine un rgne d'hsitations et de scrupules. Lorsque l'on voit
le cours de la crise qui vient d'aboutir la formation d'un gouverne-
ment provisoire, issu de la Douma et qui a proclam la rgence du
grand-duc Michel, frre de l'empereur, on se rend compte de la bonne
volont du peuple russe, des possibilits qui s'offraient pourtant au
souverain.
La Russie, qui est en retard de quatre-vingts ans sur le reste de
l'Europe, vient de faire une demi-rvolution qui est dans le style des
journes de 1830 beaucoup plus que dans celui de 1789. Il montait, l-
bas, comme nous l'avons souvent indiqu, un mouvement o le libra-
lisme s'associait au nationalisme. C'est un phnomne bien connu.
Presque tous les pays de l'Europe occidentale ont pass par l jadis.
Les monarchies du dix-neuvime sicle qui ont su comprendre ce
mouvement, qui en ont pris la tte, en sont sorties plus grandes et plus
fortes : ce fut le cas de la maison de Savoie, ce fut, en partie grce
Bismarck, le cas des Hohenzollern. Les rois qui n'ont pas su conduire
cette eau leur moulin, ont fait ce qui vient d'tre demand Nicolas
Il : ils ont tristement abdiqu.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 24
Comme les autres formes de gouvernement, les monarchies ont be-
soin de se renouveler. C'est ainsi qu'elles durent. Alexandre Il avait
inaugur un autre systme que celui de Pierre le Grand et de Cathe-
rine. Pierre le Grand lui-mme avait d briser d'acharnes rsistances
pour moderniser son Empire. La Russie des Romanof a toujours t le
pays du progrs impos par en haut. Ce n'est ni Pierre le Grand ni
Alexandre qui se sont crus, comme leur doux, loyal mais faible suc-
cesseur, enchans leurs traditions : ils les avaient interprtes pour
le bien de leur Empire. Ce n'taient pas eux, non plus, qui taient pri-
sonniers de leurs fonctionnaires : ils n'imaginaient pas un tsar entran
dans la chute de la bureaucratie. Le tchin tait la crature du tsarisme,
un instrument ncessaire pendant la phase de formation et d'unifica-
tion de la Russie. Qu'un empereur ait permis la bureaucratie de de-
venir plus forte que lui-mme, qu'il l'ait laisse creuser un abme entre
lui et son peuple, on ne peut rien concevoir qui contredise davantage
l'ide directrice de l'autocratie, telle que ses fondateurs et ses grands
chefs l'ont toujours reprsente.
Que la monarchie soit d'utilit publique pour la Russie, c'est ce que
savent parfaitement les libraux eux-mmes. Ils n'ignorent pas les dif-
ficults, les prils de toute sorte auxquels ils s'exposeraient en mcon-
naissant les puissances de sentiment qui s'attachent la dynastie. Les
plus intelligents d'entre eux, indpendamment de toute autre consid-
ration politique, savent bien que, selon le mot que nous disait un jour
un des plus brillants parmi les hommes de la gauche, le meilleur
moyen d'alimenter la raction serait de laisser le trne vacant. A cet
gard, le gouvernement provisoire form par la Douma a montr une
modration et une habilet qui taient conformes aux prvisions. Ses
manifestes, autant du moins qu'ils nous sont connus jusqu' ce jour,
ont vit jusqu'aux apparences du style rvolutionnaire. On garde la
monarchie, mais on change le monarque. Cela aussi est une tradition
russe.
L'Empereur Nicolas aura surtout pch par absence de volont et
par excs d'idalisme. C'tait un Vieux-Russe lev par des profes-
seurs de l'universit franaise. Deux ducations contradictoires, join-
tes son caractre, expliquent les illusions et les dboires de son r-
gne. Le souverain qui avait lanc l'ide de la paix aura subi deux
grandes guerres : c'est le fait, honorable pour son coeur, qui juge son
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 25
esprit d'illusion, sa mconnaissance du temps et des hommes. S'il a
fait passer la couronne sur la tte d'un enfant de treize ans sous la sau-
vegarde d'une rgence, il aura encore montr cette confiance que les
vnements auront si souvent trompe.
Par la rgence, du moins, l'essentiel serait sauf et la Russie prot-
ge contre le pire des prils, celui d'un de ces retours l'anarchie slave
dont son histoire offre tant d'exemples. Ce qui fait, justement, l'origi-
nalit de cette crise, c'est qu'elle est sortie de la guerre, que le patrio-
tisme l'a engendre et qu'elle est ne d'une dbilit du pouvoir qui
contrastait trop violemment avec les ncessits de l'heure. En s'asso-
ciant au mouvement, l'arme en a assur le succs. Elle en a aussi pr-
cis le caractre. L'arme sentait le besoin d'un pouvoir fort et d'une
administration nationale. Son chef populaire, c'est un homme comme
le grand-duc Nicolas Nicolaevitch, un des hros de la guerre et qui
sait pendre propos les tratres et les prvaricateurs.
C'est ainsi que la voie se trouvera indique au nouveau gouverne-
ment pour qu'il remplisse la lourde tche dont il se sera charg. L'Al-
lemagne, qui comptait sur une rvolution en Russie comme sur une
des cartes de son jeu, verra ses calculs djous si les choses suivent
bien le cours que les journes de Petrograd indiquent. Il faut que la
rnovation russe ne devienne pas ce que, jusqu'ici, elle ne veut pas
tre : une rvolution. Il faut que le nationalisme, qui l'inspire, la rgle
aussi. La Russie veut la victoire que n'avait pas su lui donner l'admi-
nistration bureaucratique. Qu'elle se souvienne que ce n'est pas le d-
sordre qui la lui apportera.
Il y a neuf ans, un autre Empire des pays d'Orient, o l'esprit natio-
nal s'alliait l'esprit libral, a essay, lui aussi, de se rgnrer par un
changement de monarque. L'exemple de Constantinople montre Pe-
trograd les fautes viter. Que la leon des J eunes-Turcs ne soit per-
due ni pour les J eunes-Russes ni pour personne.
L'Action franaise, 17 mars 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 26
1.3
Le monde en mouvement
L'Action franaise, 23 mars 1917.
Retour la table des matires
IL y a des gens qui ont cru que des vnements aussi vastes que
ceux de la guerre europenne pourraient s'achever sans que des modi-
fications profondes se fussent produites dans la vie des peuples. La
rvolution russe est un des signes du contraire. C'est peu prs
comme si l'on disait que, quand on a battu des oeufs pendant un cer-
tain nombre de minutes et qu'on les a mis dans la pole, on les re-
trouve ensuite dans leur tat primitif.
Les nations auront t secoues pendant un espace de temps consi-
drable et soumises au feu de batailles dont la violence ne s'tait ja-
mais vue. Il n'est pas douteux qu'elles sortent de l transformes. On
peut dire que les gouvernements qui n'auront pas conscience de ces
transformations sont condamns d'avance.
C'est ce qui vient d'arriver au gouvernement russe. Nicolas Il m-
rite les sympathies et le souvenir de la France dont il aura t l'alli
fidle. On l'aurait voulu plus perspicace ou mieux conseill. M. Ribot,
avant-hier, a dit ce qu'il fallait dire sur les vingt-cinq ans d'alliance qui
ont uni la Rpublique et l'autocratie. Nous saluerons aussi la loyaut
de Nicolas II. Il sera permis de ne pas admirer sa politique. Les jour-
nes de mars et l'effondrement de son trne viennent d'ailleurs de la
juger.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 27
J amais plus belle occasion ne s'tait offerte un tsar, depuis qu'au
dix-neuvime sicle la Russie s'tait occidentalise, de renouer le
pacte de la dynastie avec le peuple russe et de repartir, sur des don-
nes nouvelles, pour une prolongation de bail. La Russie, de 1914
1916, tait, au fond, dans l'tat de la Russie de 1613, l'lection et
l'avnement de Michel Romanof. Un puissant mouvement national,
dtermin comme alors par la menace trangre, pouvait servir une
rgnration de la Russie dont les tsars, suivant leur rle historique,
eussent pris la tte. Leur vritable tradition tait l. Voit-on un tradi-
tionaliste qui, par respect pour les ides de son pre, s'obstinerait
porter les mmes bottes et le mme chapeau que lui ? Voil pourtant
ce qu'a fait, ou peu s'en faut, Nicolas II. Il y avait, dans son Empire, au
dbut de la guerre, des bonnes volonts qui s'offraient, des possibilits
telles que, depuis l'origine de son rgne, il ne s'en tait jamais prsen-
t. Nicolas II est pass ct de tout cela. Il n'a pas su s'affranchir de
cette hirarchie bureaucratique qui, aprs avoir t l'manation du tsa-
risme, en tait devenue la matresse. L'autocratie prisonnire de la bu-
reaucratie : tel est le non-sens historique et politique d'o la chute de
Nicolas II est venue.
L'Action franaise, 23 mars 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 28
1.4
Instructions un ambassadeur
en Russie
L'Action franaise, 20 avri1 1917,
Retour la table des matires
LE public franais, dans sa partie moyenne, a t lgrement d-
contenanc par la rvolution russe. Comme la France est, au fond, un
pays conservateur ! Notre ancienne politique n'avait pas ces timidits.
Les rvolutions chez autrui ne lui faisaient pas peur. Le mot lui pa-
raissait aussi naturel que la chose parce qu'elle n'y attachait pas un
sens infernal ou cleste. Une rvolution, c'tait un changement de sys-
tme, et la tche de la politique tait d'en tirer le parti qu'elle pouvait
aprs en avoir pes le bien et le mal.
La France, pendant la guerre de Sept ans, s'tait trouve allie de la
Russie contre la Prusse dans des conditions qui, nous l'avons rappel
souvent, ressemblaient singulirement celles d'aujourd'hui. A Berlin
non plus ce prcdent n'tait pas oubli et l'on y a spcul, on y sp-
cule encore sur une paix spare avec la Russie, pareille celle qui
avait sauv Frdric II. Avec quelle nettet la monarchie franaise se
reprsentait le danger d'une dfection de la Russie la mort d'lisa-
beth et l'avnement de Pierre III ! C'est ce que l'on peut voir par les
instructions qui taient envoyes notre ambassadeur Saint-
Ptersbourg. Quand Sturmer et Protopopof rgnaient sous le nom de
Nicolas II, il n'y aurait eu qu' faire le dcalque de cette lettre de
Choiseul, pour avoir l'image frappante de la situation. L'instruction de
Choiseul, si vigoureuse et si limpide, date de l'avnement de Pierre III.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 29
En voici des passages d'une tonnante actualit. Changez seulement
quelques noms propres et quelques mots, tout y est.
Le comte de Choiseul au comte de Breteuil.
Versailles, 31 janvier 1762.
J 'ai reu, Monsieur, jeudi dernier, une lettre de M. du Chtelet
laquelle il tait joint la copie de celle que vous avez crite cet am-
bassadeur pour lui apprendre la catastrophe arrive en Russie et sur
laquelle nous tions rassurs par les nouvelles favorables que vous
nous aviez envoyes en dernier lieu...
J e vous envoie de nouvelles lettres de crances. Vous ajouterez
verbalement tout ce qui peut concourir cimenter l'union des deux
cours... Vous direz encore, Monsieur, que le Roi, invariable dans ses
sentiments ainsi que dans les principes de sa politique, n'a jamais
manqu ses amis ni ses allis, qu'il a toujours rempli ses engage-
ments avec la plus scrupuleuse exactitude et que sa fidlit inbranla-
ble lui donne droit d'attendre en retour de pareils procds.
Aprs ces gnralits que vous pouvez, Monsieur, tendre et d-
tailler suivant que vous le jugerez propos, je conois que vous dsi-
riez suivre des instructions claires et prcises pour vous guider dans la
circonstance critique et intressante o vous vous trouvez ; mais vous
sentirez aisment combien il nous est difficile de vous donner des r-
gles de conduite assez tendues et assez positives pour diriger vos
dmarches dans la route pineuse et obscure o vous allez peut-tre
entrer.
En poussant aussi loin qu'il est possible les spculations sur l'ave-
nir, il semble qu'on ne peut faire que trois hypothses : la premire
que le nouvel Empereur suivra l'ancien systme ; la seconde, qu'il en
adoptera un tout oppos en se liant avec nos ennemis ; la troisime,
qu'il prendra un parti intermdiaire.
La premire est sans doute la plus dsirable mais malheu-
reuse-ment elle est la moins vraisemblable. Si elle a lieu, vous n'aurez
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 30
pas besoin de nouvelles instructions... Vous observerez cependant
qu'il faut se dfier des apparences : l'Empereur pourrait afficher ext-
rieurement le systme quoiqu'il soit contraire ses inclinations vri-
tables. C'est pourquoi il est important de pntrer ses sentiments se-
crets soit pour prendre nos mesures en consquence et nous prcau-
tionner contre ses mauvaises intentions, soit pour viter de l'indisposer
et de le cabrer par des instances trop vives sur des objets qui pour-
raient lui dplaire... Pour vous dire notre secret, ce qui nous importe
essentiellement, c'est que la Russie demeure attache la grande al-
liance ; qu'elle ne rappelle pas ses armes ; qu'elle persiste dans l'an-
cien systme et qu'elle ne fasse point sa paix particulire...
La deuxime hypothse n'exige pas de grands claircissements. J e
ne doute pas que vous ne mettiez en usage tous les moyens possibles
pour prvenir un parti si dangereux et que vous n'employiez cet effet
la force du raisonnement, les reprsentations amicales, la fermet, la
douceur, la sduction et la perspective du dshonneur qui rejaillirait
sur la Russie d'un pareil procd.
Enfin, Monsieur, la troisime hypothse me parat la plus naturelle
et celle qui prsente le plus de probabilit ; mais on peut l'envisager
sous diffrentes faces et elle est susceptible de plusieurs modifica-
tions.
I L'Empereur pourrait chercher faire sa paix particulire des
conditions plus ou moins avantageuses pour lui, sans s'embarrasser de
ses allis et sans prendre l'avenir aucune part la guerre prsente.
Quoique ce parti ft moins fcheux qu'une union avec nos ennemis, ce
serait cependant une violation manifeste des traits et une djection
honteuse, laquelle nous devons mettre tous les obstacles possibles ;
2 Une suspension d'armes entre les Russes et le roi de Prusse, tou-
tes choses demeurant en tat, pourrait avoir pour objet de parvenir
une paix gnrale par la mdiation de la Russie. Une pareille conven-
tion serait un peu moins fcheuse qu'une paix particulire, mais elle
serait encore fort contraire nos intrts ;
3 L'Empereur, voulant servir le roi de Prusse et se retirer de la
guerre, pourrait nous faire des insinuations de paix, nous communi-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 31
quer le dsir qu'il aurait de pacifier les troubles de l'Europe et nous
proposer diffrents moyens de parvenir une pacification gnrale ou
limite la guerre d'Allemagne... Ce n'est pas, Monsieur, que nous
soyons loigns de la paix, mais nous ne croyons pas qu'elle puisse
nous tre avantageuse si elle vient par le canal de la Russie...
Tel tait le pril que reprsentait pour la France l'avnement de
Pierre III. Ce pril avait t discern Paris avec clairvoyance, car le
nouvel empereur devait s'empresser de faire sa paix et mme de s'al-
lier avec le roi de Prusse.
Il ne vint l'ide de personne, dans la France de Louis XV, que la
couronne ni mme la tte de Pierre III dussent tre respectes par
scrupule lgitimiste. Sans doute, on n'alla pas jusqu' aider la Grande
Catherine supprimer son mari. Mais, vingt ans plus tt, La Ch-
tardie, notre ambassadeur, avait second de toutes ses forces la rvolu-
tion qui, dj, avait affranchi les Russes de la domination allemande et
port lisabeth sur le trne. Cette fois, Catherine agit seule. Et lors-
qu'elle annona que son mari tait mort d'une certaine colique , on
accueillit paisiblement, Paris, la nouvelle de l'affaire. Louis XV
crivait, du ton le plus naturel du monde, dans sa correspondance se-
crte : La dissimulation de l'impratrice rgnante et son courage, au
moment de l'excution de son projet, ainsi que la manire dont elle a
trait ce prince, indiquent une princesse capable de concevoir et
d'excuter de grandes choses. Mon Dieu, oui, c'est un monarque qui
a crit cela de la suppression d'un autre monarque...
Plus timor ou plus dlicat que La Chtardie, notre ambassadeur,
en 1762, pressentant ce qui allait arriver Pierre III, avait cru bon de
s'absenter de son poste. Il faut voir comme il fut rabrou pour n'avoir
pas t l au moment de cette rvolution intressante , comme di-
sait le cabinet de Paris. Si Sa Majest, crivait le comte de Broglie
Breteuil, dans la correspondance secrte, et t informe temps
des moyens que vous pouviez entrevoir de faire clore, la mort de
l'impratrice lisabeth, la rvolution qui vient d'enlever le trne au
czar, elle vous et certainement autoris prparer cet vnement, au
lieu que nous avons appris depuis que le ministre a rejet les proposi-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 32
tions, la vrit trop vagues, que vous lui avez faites de chercher
mettre en jeu le mpris et la haine que les Russes portaient l'empe-
reur.
La diplomatie franaise, en ce temps-l, n'tait pas bgueule. Elle
allait l'urgent et l'essentiel, c'est--dire l'intrt de la France. Et
puis elle n'aimait pas se laisser surprendre ou dpasser par les vne-
ments.
Au fond, que vient-il de se passer en Russie le mois dernier ? Une
nouvelle priptie de cette lutte entre l'esprit national et les influences
allemandes qui est chronique chez elle depuis deux cents ans, une r-
ptition de ces rvolutions de palais qui jalonnent l'histoire de l'Em-
pire russe. La diffrence, c'est que la rvolution de palais de 1917 s'est
termine dans la rue et qu'on ne sait plus trop o elle va, parce que, ne
l'ayant pas prvue, on ne l'a pas dirige. Les vieilles recettes se sont
perdues.
L'Action franaise, 20 avri1 1917,
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 33
1.5
Le parti allemand en Russie
L'Action franaise, 27 avril 1917.
Retour la table des matires
IL semble que ce soit pour la Russie comme une fatalit historique
d'tre dispute entre les influences germaniques et son esprit national.
Chez ses rvolutionnaires eux-mmes se retrouve la mme division et
Bakounine n'a pas cess de s'y opposer Karl Marx. Bakounine est
comme le Proudhon de la Russie. Il semble que ce soit, en ce moment,
Bakounine qui l'emporte sur Karl Marx et Sturmer. C'est le plus grand
bonheur qui pourrait arriver la rvolution russe. Et si la rvolution
avait russi en 1905, au lieu de survenir pendant la guerre europenne
et dans le grand conflit des nationalismes, c'est alors qu'elle et t
tout fait certaine de mal tourner. Que l'on compare seulement la
conversion des dfaitistes au manifeste de Vyborg !
Un vieux proverbe russe dit que tout ce qui est bon pour l'Alle-
mand est la mort du moujik. L'invasion allemande en Russie est un
phnomne qui a plus de deux cents ans de date. La Russie a t colo-
nise, exploite, gouverne par les Allemands. La rgence de Biren a
t, cet gard, au dix-huitime sicle, comme le premier modle du
rgime Sturmer. Depuis lors, disait Herzen, il y a eu des Allemands
sur le trne ; autour du trne des Allemands ; les gnraux taient al-
lemands, les ministres allemands, les boulangers allemands, les phar-
maciens allemands. Quant aux Allemandes, elles avaient le monopole
des fonctions d'impratrices et de sages-femmes.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 34
Germanise jusqu'aux molles, gouverne par des Allemands, a
crit Maurras dans Kiel et Tanger en parlant de la Russie. Le rve
d'une partie, - et non la moins influente, - de la diplomatie des tsars
tait, par le moyen de l'alliance franaise, de conclure un pacte franco-
germano-russe, de former une chane continue entre Ptersbourg, Pa-
ris et Berlin. Plus d'un diplomate russe affichait ouvertement cette
ide. Et l'on n'a pas assez remarqu que l'ambassadeur d'Alexandre III
qui avait conclu l'alliance portait un nom d'Allemagne. Loin de nous
la pense de reprocher quoi que ce soit la mmoire de M. de Mo-
hrenheim. Mais l'abondance du sang allemand, la persistance des tra-
ditions allemandes dans la diplomatie comme dans l'arme russe
(qu'on se rappelle Stoessel, Rennenkampf), suffisent expliquer beau-
coup des flchissements, des faiblesses et des contradictions de la po-
litique de l'alliance franco-russe.
L'Action franaise, 27 avril 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 35
1.6
Les problmes russes
L'Action franaise, 12 mai 1917.
Retour la table des matires
LORSQU'UN monarque croit qu'il ne s'agit que d'une meute, il
faut au moins que son entourage l'avertisse qu'il s'agit d'une rvolu-
tion. Bien des choses s'expliquent par le fait, aujourd'hui avr, que
Nicolas II a t abominablement tromp par les hommes qui il avait
eu le tort de donner sa confiance. Nous avons, l'heure qu'il est, des
dtails circonstancis sur les moments qui ont prcd l'abdication,
dans le train imprial errant de gare en gare. Ces moments suprmes
offrent en raccourci l'histoire du rgne tout entier.
Les bonnes intentions ne suffisent pas pour gouverner les hommes.
Aprs Nicolas II, les idalistes du gouvernement provisoire commen-
cent s'apercevoir de cette vrit. Mais il ne suffit pas davantage de se
dire autocrate dans les papiers officiels et les proclamations publiques
pour exercer l'autocratie. En ralit, Nicolas II, qui refusait de faire
des concessions la Douma, avait depuis longtemps laiss tomber
l'Empire en quenouille, et, loin de gouverner par lui-mme, il tait
manoeuvr par ses vizirs, par ses maires du palais. S'il ne connaissait
que par ces hommes-l ce qui se passait en Russie, la catastrophe n'est
pas difficile comprendre.
La rvolution tait dj un fait accompli Petrograd, que Nicolas
II ne se rendait encore aucun compte des vnements. Mais, dira-t-on,
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 36
il y avait des lettres vraiment pathtiques o, non seulement M. Rod-
zianko, prsident de la Douma, mais les chefs d'arme eux-mmes
avaient averti le souverain qu'il n'y avait plus un moment perdre ni
une faute commettre. Aucune de ces dpches ne lui avait t re-
mise, et son entourage les avait interceptes. Dans la nuit du 14 mars,
c'est--dire quand la rvolution tait matresse de la capitale, le gn-
ral Tsabel, commandant du train imprial, avait adjur les trois ou
quatre personnes qui chambraient l'empereur de lui dire la vrit. On
objecta que le tsar dormait. A deux heures du matin, Nicolas II, s'tant
rveill, demanda des nouvelles l'amiral Nilof. Celui-ci rpondit
qu'il y avait des troubles srieux, mais qu'en un ou deux jours il serait
facile de les rprimer. Le gnral Vokof renchrit. Il assura que sept
cents chevaliers de Saint-Georges accouraient Tsarko-Slo, que
l'empereur se mettrait leur tte et rallierait l'arme qui marcherait
contre la Douma. A ce moment, le gnral Tsabel survint et s'cria :
Sire, on vous trompe. Voici une dpche qui enjoint au train imp-
rial de rentrer Petrograd. Elle est signe du lieutenant Grkof, com-
mandant la gare Nicolas. A ces mots, le tsar commena compren-
dre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Une rvolte ? C'est le lieutenant
Grkof qui commande Petrograd main-tenant ? Le gnral Tsabel
dut apprendre l'empereur stupfait qu'il existait un gouvernement
provisoire du ct duquel 60 000 hommes avec leurs officiers taient
passs. Alors Nicolas II pronona les paroles qui contenaient le triste
aveu de l'ignorance o, depuis trop longtemps, il tait tenu sur le vri-
table tat des esprits et des choses : Pourquoi ne m'a-t-on pas dit tout
cela plus tt ? Pourquoi me dcouvre-t-on la vrit peine mainte-
nant, quand tout est fini ?
Un chapitre se fermait. Et, quelques heures plus tard, s'en ouvrait
un autre.
La scne n'est plus dans le train imprial. Elle est au palais de Tau-
ride, dans la salle Catherine, le 15 mars. Devant une foule de soldats,
de marins et de civils, M. Milioukof, au nom du gouvernement provi-
soire, expose le programme du premier cabinet russe national . Ce
discours, avec les interruptions de l'auditoire, constitue un document
politique extraordinairement prcieux, car il annonce toutes les diffi-
cults auxquelles les libraux, ports soudain au pouvoir, allaient
avoir faire face.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 37
cette aurore des nouveaux jours, une opposition d'extrme-
gauche commenait dj se montrer. L'union entre citoyens russes
avait t le thme initial de M. Milioukof. De l, il tait pass l'union
dans l'arme, l'union ncessaire des soldats avec les officiers, et de
premires exclamations avaient t pousses dans l'assistance. Il y
avait eu des exclamations nouvelles lorsque M. Milioukof avait dit
que le gouvernement provisoire ne voulait pas s'imposer au peuple,
mais que la confiance de tous lui tait ncessaire pour consolider la
victoire du peuple. Qui sont les ministres ? avaient demand des
voix impatientes. Et M. Milioukof avait nomm d'abord le prince Lvof
qui est la tte de tous les Zemstvos russes . Des cris ironiques
s'taient fait entendre : Les Zemstvos de privilgis ! Ici, l'orateur
avait relev l'allusion la lutte de classes : Vous parlez, dit-il, des
forces sociales organises par les classes privilgies. Mais vous. ou-
bliez que ce sont les seules organisations qui permettront d'englober
dans la suite les autres classes de la nation russe. Point de vue d'un
volutionniste intelligent et d'un historien. tait-ce le point de vue
d'une foule ?
Cependant, il fallait la calmer. Et M. Milioukof, parmi les minis-
tres, lui nomma tout de suite M. Kerenski, travailliste. A ce nom, il y a
des applaudissements. Il y a aussi des clameurs. Kerenski est donc
dj suspect ! Aprs le ministre de la J ustice, celui des Affaires tran-
gres se dsigne : on l'acclame courtoisement. Puis vient le nom de
Goutchkof. Oh ! celui-l, c'est un archi-modr, un octobriste, une
sorte de ractionnaire. Son nom ne passe qu'avec peine. Il a t mon
ennemi politique, dit M. Milioukof. Votre ami, vous voulez
dire ! Mais Milioukof ne se laisse pas dmonter. Il explique les ser-
vices rendus par Goutchkof la cause de la rvolution. S'il en est ain-
si, pour le moment, on laissera Goutchkof tranquille. Au tour d'un au-
tre : le titulaire des Finances, Trechtchenko. Ce nom cause une sur-
prise. Il ne parat pas connu, Qui est Trechtchenko ? demandent
des voix. Alors Milioukof explique : C'est un nom qui a un fier re-
tentissement dans le Midi de la Russie, mais la Russie est grande, il
est difficile de connatre tous ses meilleurs citoyens. C'est vrai : M.
Trechtchenko est un grand industriel, un esprit distingu, ajoutons un
ami de la France. Tout le monde le connat Kief. Mais la Russie est
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 38
si vaste et si diverse ! Et dj c'est le danger des autonomies et des
sparatismes qui se dessine...
Voil pour le ministre. Et le rgime ? Il semble qu'on soit au Pa-
lais-Bourbon, le 4 septembre, lorsque la foule interrompait Gambetta
et lui criait imprieusement : Et la Rpublique ? Comme Gambet-
ta, Milioukof, le 15 mars, tait encore pour une transaction. Il annonce
que le grand-duc Michel sera rgent et que le petit Alexis reste prince
hritier. Mais c'est l'ancienne dynastie ! s'crie-t-on avec sur-
prise. Parfaitement, reprend Milioukof avec fermet. J e n'ai pas,
moi non plus, d'affection pour la dynastie. Mais il ne s'agit pas de ce
qui nous plat ou de ce qui nous dplat. Il faut, avant tout, viter la
guerre civile. Tout le monde sait le chemin parcouru depuis que ce
danger naissant a t dnonc au berceau de la rvolution...
Le premier de ces tableaux historiques de la rvolution russe fait
comprendre en quoi a consist la dfaillance politique et mentale de
l'autocratie. Le second montre que, ds la premire heure, les hommes
du gouvernement provisoire se sont rendu compte des difficults de la
tche qui, d'un seul coup, est tombe sur leurs paules. Lorsqu'ils
taient, il y a quelques semaines encore, dans l'opposition, ils avaient,
pour tous les problmes que pose le gouvernement de la vaste Russie,
des solutions d'apparence sduisante. Il s'agissait, par exemple, de
donner un home rule la Pologne, la Finlande, aux autres nationali-
ts. Hlas ! l'Angleterre, depuis trente ans, en est encore se deman-
der comment elle l'appliquera l'Irlande ! Les formules, l'preuve,
ne se montrent pas d'une application si aise.
Les hommes de bonne volont qui sont au gouvernement provi-
soire cherchent mettre leurs actes en accord avec leurs doctrines.
Nous craignons qu'ils ne s'puisent cette besogne. Leur appel au
pays est le signe de leurs inquitudes. Pourtant, ils ne dsesprent ni
de la vertu souveraine de la libert, ni du patriotisme, ni de la raison
du peuple russe. Par un compromis avec l'extrme gauche, ils s'effor-
cent de rtablir l'ordre et de crer un quilibre. Est-ce la bonne voie ?
Ont-ils le moyen de faire autre chose ? Ils sont juges de la situation.
Mais, l'un des principaux reproches qu'ils peuvent, - avec nous, -
adresser l'ancien rgime, c'est d'avoir laiss la Russie dans un dsor-
dre tel qu'en se suicidant il n'a mme pas lgu ses successeurs ces
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 39
parties solides sur lesquelles peut reposer un pouvoir nouveau et que,
en pleine crise et en pleine guerre, tout est crer.
Ah ! si Stolypine, qui avait prvu tant de choses, tait l pour voir
ce gchis ! Et quelle doit tre l'amertume de ses hritiers et de ses dis-
ciples, qui auraient pu tout sauver et que Nicolas II n'a mme pas su
appeler son aide !
L'Action franaise, 12 mai 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 40
1.7
La statue de Stolypine
L'Action franaise, 2 avril 1917.
Retour la table des matires
Nous connaissons des libraux russes qui s'taient jur de n'avoir
pas de repos jusqu' ce que la statue de Stolypine ft dans le Dniepr.
Nous ne savons pas si la statue a fait dans le grand fleuve le mme
saut que, jadis, aprs le baptme de Vladimir, l'idole Peroun, mais il
est certain que la population de Kief l'a jete bas de son socle. C'tait
une des manifestations symboliques les plus faciles prvoir de la
rvolution russe.
L'homme qui avait rtabli l'ordre en Russie, aprs 1905, avait pri
par un des plus tnbreux complots de police et d'anarchie que l'on
connaisse. Son souvenir tait rest odieux au libralisme russe qui re-
prochait Stolypine d'avoir consolid le tzarisme et restaur la rac-
tion. Mais sa mmoire n'tait gure plus honore par le souverain qu'il
avait sauv. Avant d'tre dboulonne par le peuple, la statue de Sto-
lypine l'aura t par Nicolas II.
L'ingratitude de l'ancien empereur l'gard du meilleur serviteur
qu'il ait trouv fait comprendre les causes de sa chute. Homme d'ordre
inflexible et svre, Stolypine n'tait pas un ractionnaire born.
C'tait un rformateur. Il laissait des collaborateurs, des disciples p-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 41
ntrs de sa pense qui auraient assur la Russie une politique natio-
nale, en accentuant l'esprit de progrs qui animait leur matre. Mais les
Sazonof, les Ignatief ont t abandonns par Nicolas II. Un Krivo-
chine s'est vu systmatiquement cart du gouvernement. Et quels
hommes auront t prfrs ceux-l ! Lorsque le prisonnier de
Tsarsko-Slo apprendra l'incident de Kief, il pourra, - s'il a compris !
- faire un triste retour sur les fautes de son rgne !
L'Action franaise, 2 avril 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 42
1.8
Vingt-cinq ans d'alliance russe
L'Action franaise, 8 juin 1917.
Retour la table des matires
LE mois de juillet 1914 a eu son quart d'heure des alliances, le
quart d'heure tragique o il a fallu que la France se dcidt. La France
serait-elle fidle au pacte conclu avec la Russie ? Ou bien couterait-
elle les suggestions, s'inclinerait-elle devant les menaces de M. de
Schoen qui, plusieurs reprises, rpta que la situation tait grave,
que la France devait savoir quoi elle s'exposait si elle ne dclarait
pas qu'elle se dsintressait du conflit de l'Orient. Quoiqu'on ait pr-
tendu le contraire dans une certaine partie de l'opinion russe, la France
n'hsita pas une minute remplir ses devoirs d'allie.
Elle n'en conoit pas de regrets. La France sait que, derrire la
Russie, c'est elle-mme que l'Allemagne visait. Et les choses ont tour-
n de telle sorte qu'en tenant sa parole envers la Russie, la France a
gagn une autre alliance, aussi ferme qu'efficace : celle de l'Angle-
terre. l'accord indcis qui existait avant le 4 aot 1914, la guerre a
substitu cette intimit et cette solidarit franco-anglaises qui parais-
sent devoir tre l'axe de la politique gnrale pour bien longtemps,
pour, aussi longtemps, en tout cas, que le pril allemand existera en
Europe.
Aujourd'hui, pourquoi le dissimuler ? La question de l'alliance
franco-russe tend changer d'aspect. C'est un autre quart d'heure qui
sonne. C'est nous qui pouvons nous demander, avec de trop fortes rai-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 43
sons l'appui, si la Russie est bien rsolue persvrer dans l'ancien
systme. Les inquitudes que donnaient Sturmer et Protopopof, elles
se rveillent sous une autre forme qui a, du moins, l'avantage du grand
jour et de la franchise, avec le rgime des J eunes-Russes, aprs les
deux mois de gouvernement des patriotes de la Douma, aprs la brve
exprience des nationaux-libraux.
Nous devons le remarquer : c'est la galerie des neutres qui a le plus
de svrits, en ce moment, pour la Russie et pour son rle dans la
guerre. C'est un journal de la Suisse romande qui parlait, il y a deux
jours, des responsabilits de la Russie rvolutionne, qui faisait le
compte des cruelles dceptions apportes par les Russes leurs
allis, depuis qu'est passe la priode premire et fugitive de l'action
concerte, de la collaboration sans arrire-penses, la priode de l'in-
vasion de la Prusse orientale. Le mme journal ne craint pas d'crire
que, depuis longtemps, la Russie n'est pas une allie sre , et il la
rappelle ses obligations sacres ...
Il y a des Franais, et nous en sommes, qui n'ont pas attendu ces
jours difficiles pour concevoir quelques doutes au sujet de la Russie.
Nous n'avons eu besoin ni de la guerre, ni de la rvolution pour ex-
primer nos inquitudes et pour montrer la Russie aussi lointaine que
fuyante. Le colosse est capricieux, crivions-nous en 1912, et il a de
vastes parties obscures. Ses associs gagneraient le bien connatre.
Il suffisait de le connatre seulement un peu pour savoir qu'il y
avait, ds l'origine, un lger malentendu sur le principe de l'alliance
entre la France et la Russie. Les circonstances font que M. Ribot, qui a
prsid, voil vingt-cinq ans, aux premiers accords franco-russes, se
trouve de nouveau la direction de nos affaires extrieures. M. Ribot
sait mieux que personne qu'en se rapprochant, la France et la Russie
obissaient un mme besoin, celui de l'quilibre, mais que, par la
force des choses, elles n'occupaient pas exactement la mme position
par rapport au problme central. Pour la France, la grande, la seule
question, c'tait le pril allemand, c'tait la scurit de sa frontire de
l'Est. Ni la gographie, ni l'histoire ne montraient ce pril la Russie.
Sauf dans une trs petite lite, jamais la Russie n'a senti comme nous
la menace allemande. En outre, elle n'a jamais conu l'Allemagne
comme nous et l'ide de la barbarie germanique chappe un pays qui
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 44
a connu l'Europe par les Allemands. C'est pourquoi, en 1891, date des
premires conversations utiles, le ministre d'Alexandre III insistait
avant tout, dans ses conversations, sur le caractre pacifique du
rapprochement franco-russe. Par toutes les tendances de son esprit, un
homme comme M. de Giers voyait mme Berlin comme une arche du
pont jet entre Ptersbourg et Paris. Et le fait est qu'en 1895 la jeune
alliance, pour ses dbuts, conduisait des navires franais Kiel.
O allaient donc les intrts et les sentiments de la Russie ? Non
pas, comme les ntres, directement contre l'Allemagne. Ils allaient en
Orient, et c'est l que l'ide slave se heurtait au germanisme. On sait
quand la Russie s'est trouve pour la premire fois face face avec
l'Allemagne. C'est Constantinople, au moment o y arriva la mission
Liman von Sanders. Comment, d'autre part, le conflit de 1914 est-il
n ? Par les rivalits d'influences dans les Balkans. Mais l, c'tait
l'Autriche que la Russie rencontrait sur le domaine qu'elle se croyait
rserv. Il suffira de rappeler les incidents diplomatiques austro-russes
qui ont prcd les guerres balkaniques et que symbolise le nom de
M. Isvolski. J ustement, M. Isvolski, venu ensuite Paris comme am-
bassadeur, a quitt ces jours-ci la scne politique. C'est un acte et c'est
une date de la nouvelle Russie. C'est la liquidation de tout un pass.
Les vrais objectifs de la guerre, pour la Russie, c'taient Constanti-
nople et les Balkans. Ses moteurs, c'tait l'achvement de la lutte tra-
ditionnelle contre le Turc, son ennemi hrditaire , et c'tait le pan-
slavisme. Mais o sont, aujourd'hui, ces mobiles historiques ? Pour
Constantinople, la Russie de la rvolution y a renonc. Quant l'ide
slave, avant la fin de l'ancien rgime, elle ne battait dj plus que
d'une aile. L'indiffrence croissante pour les frres des Balkans tait
un phnomne significatif et, en somme, bien explicable aprs le d-
senchantement qu'avait apport la Bulgarie, jadis la prfre du sla-
visme. Que cette guerre tait loin de ressembler la croisade de
1877 ! Qu'elle en avait donc peu l'enthousiasme ! Il faut se reprsenter
ce dclin pour comprendre bien des choses qui ont surpris et du...
Voil, dans un trs bref raccourci, le chemin que la politique russe
a parcouru depuis les temps o l'alliance s'est noue, jusqu' la guerre
qui l'a mise l'preuve. Que devient aujourd'hui le rle de la Russie
en Europe ? Que veut-elle ? Sur quelles bases s'entendre avec elle ? Et
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 45
qui ne sent que, de toute manire, il y a quelque chose de chang en
Europe depuis qu'il n'y a plus d'attraction russe qui se fasse sentir sur
les Slaves d'Autriche et des Balkans ? Si l'alliance franco-russe est
encore susceptible d'une mise au point (et nous voulons le croire, nous
n'en dsesprons pas), sur quelles donnes, moins fragiles que l'ide
de la coalition contre les autocraties, pourra-t-on rajeunir le pacte ?
L'alliance s'tait faite, il y a vingt-cinq ans, sur un lger malentendu et
c'est ce qui explique bien des incidents et des pripties de son his-
toire. Du moins pouvait-on adapter les unes aux autres et faire mar-
cher ensemble les intentions de chacune des parties, mme quand elles
ne se dirigeaient pas exactement vers le mme but. Mais si la Russie
nouvelle, en fait de politique extrieure, n'a plus que celle du dsiste-
ment, la base d'une transformation devient difficile dcouvrir. Il
reste cependant, pour la Rvolution russe, la libration de son terri-
toire. Est-ce dsormais le minimum ou le maximum de ses buts de
guerre ?
L'Action franaise, 8 juin 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 46
1.9
Le livre jaune de l'alliance
franco-russe
L'Action franaise, 21 septembre 1918.
Retour la table des matires
LE Livre jaune que vient de publier le gouvernement franais est
un supplment bien curieux l'histoire de l'alliance franco-russe. Il y a
l l'explication de bien des choses anciennes et rcentes. Les faibles-
ses de l'alliance se voient ds ses origines, mais ces faiblesses mme
sont une singulire justification pour la France et pour la Russie imp-
riale que l'Allemagne accusait et accuse encore d'avoir complot sa
ruine ds 1892...
L'alliance, dans la pense des dirigeants franais qui l'avaient
conclue, tait une combinaison d'quilibre videmment destine pro-
tger la France contre le pril allemand. Indpendamment du souvenir
de 1870, o la guerre nous avait trouvs seuls en Europe, la Triplice
faisait un devoir tout gouvernement franais de chercher nous
soustraire ce fatal isolement. Mais la Russie, toute dispose qu'elle
tait se rapprocher de nous, comprenait encore mal le danger que
l'Allemagne reprsentait pour elle-mme. Au fond, ce que l'on peut
affirmer plus fortement que jamais, aprs la lecture du Livre jaune,
c'est que, loin de se faire sur une ide et sur un programme anti-
allemands, l'alliance franco-russe s'tait faite sur un malentendu ou au
moins sur une quivoque.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 47
Ce Livre jaune appuie la dmonstration du Kiel et Tanger de
Maurras, auquel il fournira videmment de bons textes pour une pro-
chaine dition. Quand la France, en 1891 et 1892, parlait Allemagne,
la Russie rpondait quoi ? Angleterre. Fachoda tait l en germe. Bien
loin de songer la Vistule, encore plus loin de penser au Rhin, le mi-
nistre russe, M. de Giers, s'obstinait nous attirer du ct de l'gypte
et de l'Orient. Dans une communication du 6 aot 1891, M. Ribot si-
gnalait cet tat d'esprit M. de Freycinet, son prsident du conseil : la
Russie cherchait en somme nous exciter contre l'Angleterre.
M. Ribot ajoutait que c'tait l'cueil prvu et qu'il n'en fallait
pas moins se prter l'examen des vues du gouvernement russe .
L'alliance s'est faite ainsi. Mais avec un tel point de dpart, la station
de Kiel et l'tape de Fachoda deviennent faciles comprendre. Et l'on
ne peut pas dire non plus que l'alliance ait t cette grande conjuration
dont l'Allemagne se plaint. Il et mieux valu qu'elle et t cela, elle
aurait peut-tre mieux tourn pour l'un et l'autre des associs.
Bien d'autres enseignements pourraient se tirer de ce Livre jaune.
Mais la difficult que la France et la Russie prouvaient ds 1892,
quand leurs deux tats-majors discutaient sur l'ennemi principal ,
c'est encore la difficult de notre coalition. L'exemple et la destine de
l'alliance franco-russe prouvent qu'une ligue de gouvernements et de
peuples a intrt ne pas entretenir les confusions de cette nature qui
entranent les fautes politiques et plus encore les fautes militaires.
L'Action franaise, 21 septembre 1918.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 48
1.10
Les morceaux de la Russie
L'Action franaise, 23 novembre 1917.
Retour la table des matires
CEUX qui, comme nous, ne se sont jamais fait beaucoup d'illu-
sions sur la Russie ont toujours t dans les meilleures conditions pour
dire que l'alliance franco-russe tait naturelle, ncessaire et qu'il fal-
lait, par tous les moyens possibles, la pratiquer, la cultiver, la prser-
ver et lui faire rendre tout ce qu'elle tait capable de donner. Ni Stur-
mer, ni Lnine ne nous ont surpris. Sous Lnine comme sous Stur-
mer, il n'y a qu'une ligne de conduite suivre : sauver de l'alliance ce
qui peut en tre sauv et ne pas renoncer, par dpit, vingt-cinq ans
de politique et de collaboration.
Un peu de scepticisme nous a mis l'abri de cette mauvaise hu-
meur que sont ports ressentir ceux qui avaient cru un mariage
d'amour avec la Russie, comme ceux qui avaient estim trop haut sa
valeur militaire. Nous qui doutions, nous avons t agrablement
tonns de ce qu'ont fait les armes russes dans la premire partie de
la campagne. On tait dispos l'indulgence pour les dfaillances et
les trahisons des gnraux d'ancien rgime, quand on se reprsentait
par la pense la dfection en bloc laquelle l'anarchie ne manquerait
pas de conduire. Trotsky fait regretter Soukhomlinof qui, du moins,
n'a jamais enjoint aux commandants d'arme de conclure un armistice
avec l'ennemi.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 49
Le principe observer vis--vis de la Russie, a toujours t pour
nous celui du moindre mal. C'tait un triste gouvernement que celui
du tsar. Pourtant, c'tait encore un gouvernement : notre rle n'tait
pas de le dmolir... Il fallait le soutenir, le renflouer, le guider, si l'on
pouvait, par des avis sages. Ses tares les plus graves venaient de la
faiblesse et de l'aveuglement de l'autocrate lui-mme. Dans des cas
semblables, la France avec Pierre III, l'Angleterre avec Paul 1er
n'avaient pas hsit recourir aux grands remdes. La France dmo-
cratique et l'Angleterre librale du vingtime sicle ont t beaucoup
plus respectueuses de la majest impriale. Et ce respect, qui nous
cote trs cher, n'a mme pas prserv Nicolas II de l'abdication et de
l'exil. Une politique hardie et raliste et pris les devants. Une inter-
vention opportune, mille fois justifie par la gravit des circonstances,
une opration csarienne Petrograd eussent pargn des flots de sang
franais.
Quiconque tait un peu renseign savait bien que le trne de Nico-
las II ne tenait qu' un fil. Tel qu'il est, le rgime, dont la guerre a
accus les tares, n'a qu'un nombre infime de dfenseurs, cri-
vions-nous le 1er juin 1916, en revenant de Russie, dans un rapport
qui fut remis qui de droit. L-dessus, toutes les observations taient
concordantes. tait-ce une raison pour laisser venir la catastrophe ?
La monarchie tombe, il ne pouvait plus y avoir en Russie qu'un
affreux dsordre. Les plus intressants entendre ce sujet taient les
libraux russes eux-mmes. Ils apprhendaient une rvolution et ils
l'ont bien prouv lorsqu'en mars 1917 ils ont essay de substituer un
rgent Nicolas II. Si l'on n'et pas attendu, pour cette tentative, que
la foule ft matresse de la rue et qu'elle et envahi la Douma, il et
t possible de russir.
Tant que l'ancien rgime subsistait, nous devions l'appuyer, en d-
fendre au moins le principe, mme si l'on doutait de sa solidit. Ce
qu'on disait contre lui, dans la presse franaise ou anglaise, l'affaiblis-
sait encore et rendait toute combinaison plus difficile. La vraie marche
suivre, c'tait d'abord de lui sauver la face en public : jusqu' la der-
nire limite du possible nous avons essay de remplir cette tche in-
grate au lieu de rgaler le lecteur des scandales de Raspoutine. En
quoi cela empchait-il de concerter une action dfinie avec les lib-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 50
raux patriotes, avec un nationaliste comme Pourichkivitch, avec les
grands-ducs signataires de la lettre de remontrances ?
Le trne s'est effondr sous le poids des fautes commises par Nico-
las II. Il n'y avait plus qu' s'incliner devant le fait accompli. A quoi
bon pleurer sur cette jument de Roland ? Pour le tsar comme pour les
Allis, tout tait trop tard. Aprs quelques avis discrets donns au pu-
blic, aprs-avoir indiqu le pril de l'anarchie et fait entendre qu'il fal-
lait craindre des J eunes-Russes la dception que les J eunes-Turcs nous
avaient dj mnage, quoi et-il servi de rpandre de tristes pronos-
tics et de noirs pressentiments ? La rvolution avait triomph, - chose
presque unique dans l'histoire, - sans soulever le moindre mouvement
contre-rvolutionnaire. Il n'y avait qu' en prendre son parti.
Avec la mme abngation et la mme absence de foi, comme nous
avions dfendu Nicolas II, nous avons appuy Goutchkof, Milioukof,
le gouvernement des libraux-nationaux. Ils ont dur deux mois. Ke-
rensky est venu : le mme crdit lui a t ouvert et il importait de le
lui ouvrir, parce qu'il tait clair que Lnine tait au bout de la chane.
Maintenant, Lnine est au pouvoir. Il a dpass et de beaucoup
Sturmer, qui au moins rencontrait, comme barrire suprme, le senti-
ment de l'honneur toujours vivant chez Nicolas II. Lorsque, le jour de
l'abdication, un de ses pires conseillers avait propos d'ouvrir les li-
gnes aux Allemands, l'empereur avait repouss cette ide avec dgot.
Lnine n'y a pas regard de si prs.
Mais, aujourd'hui que l'anarchie et le dfaitisme triomphent, quel
est donc le moindre mal en Russie ? Peut-on sauver encore quelque
chose de l'alliance ? Oui, on le peut en rservant l'avenir. On le peut si
l'on ne dsespre pas, si l'on ne brle pas ce que l'on a ador, si l'on ne
jette pas par-dessus bord, dans un mouvement de dpit, tous les pr-
cieux intrts que reprsente la politique franco-russe.
Un des plus grands risques que court la Russie, c'est que sa mosa-
que se disjoigne. Elle menace de tomber en morceaux. Dans le nom-
bre, il y en aura peut-tre de bons. A nous de ne pas les laisser finir. Si
la France se dsintressait de la Russie, s'habituait la regarder
comme perdue sans recours, elle dcouragerait ceux des ntres qui, l-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 51
bas, peuvent la servir en faisant fonction de diplomates et d'agents vo-
lontaires. Elle laisserait le champ libre aux Allemands dj prts se
saisir d'une proie facile. Tout cela par dsappointement sentimental !
Il ne reste plus qu'une faute commettre pour que l'alliance fran-
co-russe ait achev le cycle de ses malheurs. Depuis l'enthousiasme
aveugle qui avait salu l'amiral Avellan jusqu' la dsillusion passion-
ne d'aujourd'hui, rien n'aurait manqu la dtestable application
d'une ide juste, si l'on ne s'arrtait pas au bord de l'erreur dernire.
Voil le moment, au contraire, de pratiquer l'alliance plus srieuse-
ment et dans un esprit plus positif qu'on ne l'a jamais fait. Le mot
d'ordre doit tre de ne renoncer rien.
L'Action franaise, 23 novembre 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 52
1.11
L'abandon de Riga
L'Action franaise, 5 septembre 1917.
Retour la table des matires
ON nous parle beaucoup de l'Europe future qui doit sortir de la
guerre. En attendant, si nous nous retournions vers le pass ? Nous
verrions que l'oeuvre de Pierre le Grand est en train de tomber en
morceaux et que l'Europe du nord retourne un tat semblable celui
o elle se trouvait avant l'apparition de la puissance russe.
Riga perdu, et perdu sans bataille, c'est pour la Russie un recul de
deux sicles. En 1915 encore le sang moscovite s'tait rveill lorsque
les Allemands avaient attaqu Riga la fois par terre et par mer. L'h-
ritage de Pierre le Grand avait t sauv par un effort hroque succ-
dant de longues semaines d'une dprimante retraite. Cette fois l'en-
nemi est entr dans Riga sans coup frir. La flotte russe n'aurait pas
mme t l pour protger la ville, le cas chant, contre une attaque
maritime, car la flotte russe, de la Baltique n'existe plus : tous ses offi-
ciers instruits et capables, comme dsigns d'avance aux mutins, ont
t tus au cours des rvoltes d'Helsingfors et de Cronstadt.
C'est ainsi que la Russie nouvelle vient de perdre sans gloire cette
fentre sur la mer Baltique dont la conqute avait marqu jadis sa
promotion au rang d'tat europen. J usqu'alors la Russie n'avait t
qu'une sorte de canton asiatique. C'est partir du moment o la Balti-
que eut cess d'tre un lac sudois, o la Russie y eut accs, que l'em-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 53
pire des Romanof commena de compter en Europe et de communi-
quer avec les puissances occidentales. Par l, nous pouvons mesurer la
rgression dont la dmocratie russe est menace.
L'ancien lac sudois sera-t-il demain un lac allemand ? Le spara-
tisme finlandais, qui ne pourra manquer de se sentir encourag par la
prise de Riga, peut singulirement aider les oprations de l'Allemagne,
qui y possde d'ailleurs de nombreuses intelligences. Cependant l'his-
toire nous enseigne aussi que la Russie a obtenu son dbouch sur la
Baltique en mme temps qu'au sud-ouest elle s'emparait de l'Ukraine.
La dfaite de Mazeppa est contemporaine de la conqute de la Livo-
nie, Cette relation va-t-elle se rtablir ? Or, le mouvement sparatiste
ukrainien ne se ralentit pas, et l'Ukraine garde la mer Noire. Sans la
rsistance hroque des Roumains, qui sait o en serait en ce moment
Odessa ?...
Ces dangers, cette dilapidation de l'hritage national, ces sombres
perspectives feront-elles rflchir les Russes ? Leur dmocratie est-
elle capable de sentir qu'elle est menace de la pire et de la plus relle
des rgressions, la rgression gographique ? Comprendra-t-elle aussi
combien les formules peuvent coter cher ? n'couter que le prin-
cipe des nationalits, l'Allemagne a bien sur Riga autant de droits que
la Russie. Dans cette ancienne cit hansatique, les Allemands vont
entendre leur langue, retrouver les souvenirs de Brme, de Lbeck et
de Hambourg. Est-ce pour cela que les Russes ont cd Riga sans
combattre ? C'est un systme qui pourrait les mener loin.
L'Action franaise, 5 septembre 1917.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 54
1.12
Les Allemands et la Russie
L'Action franaise, 3 mai 1918.
Retour la table des matires
Nous ne savons pas encore au juste pourquoi M. von dem Bussche
a prouv le besoin de faire connatre au monde qu'il s'intressait aux
bruits d'une restauration monarchique Petrograd et qu'il ne tenait pas
ces rumeurs pour invraisemblables. Ce qui vient de se passer Kiev
montre que l'Allemagne s'occupe de faire rgner en Russie l'ordre al-
lemand. Nous voil loin d'une restauration russe avec le tsar de l'al-
liance rtabli sur le trne de ses pres.
Il y a pourtant beaucoup de personnes qui ne se font pas facilement
l'ide que la guerre a boulevers beaucoup de choses et qui croient
la baguette magique qui rtablira l'Empire dans son ancien tat. Il y a
partout, jusque chez les rvolutionnaires, des conservateurs par man-
que d'imagination. Ceux qui ne croyaient pas la possibilit de la
guerre, des invasions, des annexions, des croulements d'empires,
croyaient en somme la stabilit du monde tel qu'ils l'avaient connu et
l'ternit de la carte telle qu'ils l'avaient vue dessine l'cole.
Quand les catastrophes sont arrives, les mmes n'ont pas admis que
ce pt tre srieux et ils ont toujours pens que le monde n'allait pas
tarder rentrer dans son assiette, comme les fleuves rentrent dans leur
lit aprs une inondation.
Cette illusion explique un certain nombre des fautes politiques et
militaires que l'Entente a commises.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 55
Soucieux de disculper une administration dont il est le dfenseur,
le colonel Repington explique dans le Morning Post que si l'Amiraut
a attendu le mois d'avril 1918 pour embouteiller Zeebrugge, c'est
parce que l'ancienne direction avait cru que les Allemands vacue-
raient la Belgique d'un jour l'autre. Il ne fallait pas croire, mon-
sieur, disait Louvois dans un cas pareil. C'est par suite d'une erreur
du mme genre qu'on avait laiss la Turquie dclarer la guerre avant
d'essayer de forcer les Dardanelles dont le passage tait grand ouvert
au mois d'aot 1914. Qu'on prenne garde que ce qui est arriv pour les
Dardanelles ne recommence pour l'Escaut !
Loin que les choses redeviennent toutes seules ce qu'elles taient
avant la guerre, la guerre, au contraire, a pour effet de les dcomposer
davantage tous les jours. Elle agit la faon de ces maladies qui, peu
peu, affectent les divers organes du corps humain. Compter sur un re-
tour naturel la sant, c'est compter sur le miracle et non sur l'antisep-
sie aprs une grande infection.
Endormies par une longue priode de tranquillit et d'quilibre, les
puissances occidentales avaient perdu le sens du mouvement. Tout
coule ! disaient les anciens sages. On avait oubli que les construc-
tions politiques sont fragiles. L'exprience de la guerre montre pour-
tant combien peu de mois suffisent pour jeter par terre ce qu'il a fallu
des sicles pour difier. Ce que les tsars avaient mis trois cents ans
rassembler s'est dissous en moins de trois cents jours. L'accs la mer
Baltique reprsentait l'effort du rgne de Pierre le Grand ; l'Ukraine et
la mer Noire l'effort du rgne de la grande Catherine. Calculez com-
bien de semaines il aura fallu pour que le vent de la dfaite et de la
rvolution rduise en poussire ce puissant Empire ! C'est le chteau
de cartes de la fable de Florian. Mais nous ne savons mme plus les
fabulistes de la petite enfance.
S'imaginer aujourd'hui que la Russie se relvera bientt et marche-
ra comme un autre Lazare, c'est faire trop bon march de toutes les
leons de la politique et de l'histoire. Nous avons eu jadis le roi de
Bourges. Mais cette royaut presque drisoire c'tait encore un point
solide sur lequel le patriotisme franais suscit par J eanne d'Arc put
s'appuyer, et il fallut bien du temps et bien des luttes avant que la
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 56
France reprt figure. On cite aussi la Prusse aprs Ina, lorsque, sui-
vant le mot de Henri Heine, Napolon n'avait qu' siffler pour qu'il n'y
et plus d'tat prussien. D'abord Napolon s'abstint de siffler, genre
de clmence que l'Allemagne ignore. Et puis la Prusse conservait son
roi, sa reine populaire, l'espoir de sa dynastie. Il y avait aussi en Alle-
magne un puissant mouvement national, des philosophes, des potes,
qui levaient les coeurs et qui rpandaient l'ide du relvement.
Peut-tre, un jour, quelque chose de pareil pourra-t-il se produire
en Russie. J adis, la Moscovie a dj connu la conqute de l'tranger.
Les Polonais taient au Kremlin. Le brigand de Touchin
2
tenait le
rle de Lnine. C'est de cet abme que surgirent le boucher Minine et
le prince Pojarsky pour sauver la patrie russe et porter un Romanof au
pouvoir. Alors mme, cette restauration ne se fit pas du jour au len-
demain et demanda bien du temps et bien des peines. dfaut de
l'histoire, trop austre, que les Parisiens consultent donc leurs souve-
nirs de thtre. L'opra russe, avant la guerre, avait apport Paris la
Vie pour le tsar. Aussi longtemps que n'aura pas reparu en Russie
l'tat d'esprit du moujik qui se sacrifiait pour sauver le petit Michel
Romanof, compter sur une restauration vraiment russe sera purement
chimrique.
La Russie a t aussi gravement dissocie et dcrbre ,
comme disait jadis Barrs, qu'un pays peut l'tre. Les ides librales et
socialistes ont d'abord frapp les intelligences et fait disparatre, du
haut en bas, toute espce de capacit de gouverner. Le principe des
nationalits, jet dans cette anarchie, a amen une dissolution imm-
diate. Au lieu de servir de ractif, l'invasion trangre n'a servi qu'
dcomposer davantage ce demi-cadavre. Voil les choses comme elles
sont. Pour le civet d'une restauration russe, il faut un livre. Le livre
est invisible jusqu' prsent.
Si le tsarisme, sous une forme quelconque, pouvait en ce moment
tre rtabli en Russie, il ne s'appuierait que sur le dgot caus par
2
L'auteur fait ici allusion l'affaire des faux Dmitri, conscutive la mort de
Boris Godounov. Pendant des annes, surgirent de partout des gens qui se pr-
tendaient fils ou petits-fils d'Ivan le Terrible. Le bandit de Touchino tait
le deuxime faux Dmitri . Le trouble se prolongea pendant huit ans.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 57
l'anarchie maximaliste, et l'ordre, pour les Russes, est allemand. Il est
reprsent par Guillaume II. Les Allis, eux, reprsentent la fois la
guerre et les dmocraties, et les Russes patriotes qui ne rpugnent pas
l'ide de la guerre voient de leurs yeux ce que c'est qu'une intgrale
dmocratie. Alors ? Comme le coup d'tat de Kiev l'a montr hier, la
Russie rpublicaine est trop faible pour se dfendre contre les Alle-
mands. Une monarchie ne serait faite et ne se soutiendrait que par les
Allemands. Plus que jamais on doit demander : Alors ?...
Alors, il faudra que bien des choses aient chang pour que la Rus-
sie qu'on regrette ou qu'on rve se rveille et reparaisse parmi les vi-
vants. Il y a un long travail tenace faire avant d'effacer les traces de
la guerre, l-bas et ailleurs. Nos soldats, sur la terre de France envahie,
savent ce qu'il en cote de reprendre pouce par pouce le terrain
conquis par l'ennemi. Il y a aussi du terrain politique et moral rega-
gner en Europe et il y faudra la mme patience. Accoutumons-nous
cette ide au lieu de croire l'instantan merveilleux.
L'Action franaise, 3 mai 1918.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 58
1.13
La politique allemande en Russie
L'Action franaise, 5 juillet 1918.
Retour la table des matires
TOUT ce qu'on voudra, mais ne plus douter que les bolcheviks et
l'Allemagne ne font qu'un.
Oui, jusqu' prsent, dans la confusion gigantesque de la Russie,
on pouvait se demander quelle tait la part de la sincrit chez Trotsky
et chez Lnine. On pouvait se demander si, les circonstances et les
coups aidant, ils n'en viendraient pas nationaliser plus ou moins leur
pouvoir. Sept mille gardes rouges ont t fusills sans autre forme de
procs dans la Finlande germanophile. Il y a de quoi retourner les
ides des thoriciens les plus ttus. Rien n'y a fait. Et, dans l'espace de
quarante-huit heures, il s'est rvl par deux fois que le maximalisme
tait un auxiliaire conscient de l'Allemagne.
Il y a eu d'abord l'annexe secrte au trait de Brest-Litovsk par la-
quelle les bolcheviks abandonnent aux Allemands l'exploitation terri-
toriale et conomique de la Pologne, se rservant, pour leur compte,
d'y propager l'anarchie. Et il y a eu ensuite le dcret de Trotsky, d-
nonant et menaant l'imprialisme des Allis, pour mieux aider
l'arme germano-finlandaise, fusilleuse de gardes rouges, couper la
route d'Arkhangel et de Kola, - la seule voie de communication qui
subsiste pour nous avec la Russie.
Dans ce qui fut l'Empire russe, la politique de l'Allemagne est
base de mpris pour le slavisme. Voil ce qu'il ne faut pas oublier. Les
Allemands procdent comme s'ils taient au centre de l'Afrique, et
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 59
n'attachent pas plus d'importance aux ides ractionnaires ou rvolu-
tionnaires que s'il s'agissait de tribus ngres vivant soit en communau-
t, soit sous un roitelet. L'Allemagne oppose ou combine, selon les
cas, et selon son intrt, les tendances contraires. Pour le moment, elle
fait marcher de front le gouvernement des blancs et une tentative de
monarchie en Finlande, le maximalisme en Grande Russie et la dicta-
ture de l'hetman Skoropadski en Ukraine, sans compter de multiples
expriences dans les petites rpubliques qui foisonnent au Caucase et
le long de la mer Noire.
C'est de l'imprialisme sans doctrine. L'absence de tout esprit doc-
trinaire permet la politique allemande ces retournements brusques et
cyniques, - un cynisme que les Allis n'ont pas, ne voudront jamais
avoir et qu'ils auraient grand tort, tous les gards, d'imiter, car il n'est
pas dans leurs cordes. Mais c'est ce qui explique tant de dsagrables
surprises et de dceptions prouves par eux depuis la rvolution
russe.
Qu'est-ce qui donne donc l'Allemagne assez d'assurance pour
jouer avec les ides rvolutionnaires ? Elle fait comme les chimistes
qui manient dans leurs laboratoires les substances explosives les plus
dangereuses. On s'est tromp lorsqu'on a cru que ses militaires et ses
diplomates rpugneraient traiter avec Trotsky et ses camarades. Non
seulement ils ont ngoci avec eux, mais encore ils se sont assis la
mme table. La chute du tsarisme avait commenc par choquer et par
alarmer chez Guillaume II et sa cour des sentiments traditionnels.
On s'est remis de ces inquitudes.
Le fait, c'est que l'Allemagne se considre comme une citadelle
monarchique et militaire sur qui la rvolution n'a pas de prise. Elle
envoie au dehors des poisons contre lesquels elle se regarde comme
immunise. D'ailleurs tout n'est pas faux dans ce calcul. Guillaume II,
lorsqu'il se retourne vers son pass, peut admirer les progrs de son
Empire vers la discipline. Dans sa chair elle-mme, laquelle il tient,
il prouve un sentiment de scurit. Son grand-pre, le premier empe-
reur, avait encore subi les menaces et les attentats de l'anarchie. A une
poque o taient assassins Sadi-Carnot, Mac-Kinley, Humbert 1er,
les prsidents de Rpublique comme le roi de l'Italie nouvelle, Guil-
laume II allait, venait travers son Empire et travers l'Europe, pro-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 60
nonait des discours extravagants ou provocants sans qu'il y et seu-
lement un fou pour le viser de son revolver. Depuis la guerre, dont il
porte la responsabilit, comme chef suprme, pas une main qui se soit
leve pour faire payer les flots de sang rpandu. Propager chez les au-
tres l'anarchie et la rvolution et rester soi-mme indemne, quelle si-
tuation privilgie ! C'est ce sentiment-l qui inspire tant d'audace la
politique allemande en Russie.
Guillaume Il a mme ses thoriciens qui dmontrent que l'Allema-
gne impriale, en faisant la guerre, cette immense guerre, a t le
grand agent du marxisme et qu'elle a avanc de cent ans l'volution
sociale de l'Europe. L-dessus, Paul Lensch s'extasie. Plus de petite
bourgeoisie, plus de petite proprit : la guerre tue cela et les proph-
ties de Marx s'accomplissent. Ainsi la rvolution s'est faite sous les
auspices de l'imprialisme allemand et le grand soir est arriv. Que
le proltariat de tous les pays en rende grces Hinden-burg, Lu-
dendorff et Guillaume IL
Ces contes-l prennent Berlin. Ils prennent aussi Petrograd et
Moscou.
Krieg ist Revolution... C'est un trs vieux thme allemand. Les
guerres de 1866 et de I870 avaient t la rvolution politique de l'Al-
lemagne. Cette guerre-ci, c'est la rvolution sociale. La rvolution
comme je la comprends , aurait dit le chancelier Michalis. Cepen-
dant l'Allemand n'imprime pas sa vraie formule, sa formule secrte. Il
se contente de se la rpter en se frottant les mains. La guerre, c'est
la rvolution... pour les autres. Pour nous, c'est la consolidation de
l'ordre existant. Befestigung des Zustandes.
Quand on a ces ides-l, on peut faire de la politique dans la Russie
dcompose.
L'Action franaise, 5 juillet 1918.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 61
1.14
Les Allis et la Russie
L'Action franaise, 10 dcembre 1918.
Retour la table des matires
D'APRS les journaux anglais, un des principaux objets de la vi-
site de M. Masaryk Londres a t de convaincre les Allis de la n-
cessit de venir en aide la Russie et d'examiner le rle que la R-
publique tchco-lovaque remplirait dans cette oeuvre. M. Masaryk a
sans doute plaid la mme cause Paris. La reconnaissance d'une Bo-
hme indpendante de 7 ou 8 millions d'habitants doit-elle dterminer
une entreprise qui aurait pour but de restaurer une puissance russe de
80 millions d'habitants ?
Si c'est dans ces termes disproportionns que la question se pose, il
faudrait nous le dire tout de suite. On saurait o mne la politique des
nationalits.
Une intervention des Allis en Russie (intervention dont le poids
principal retomberait fatalement sur la France) serait destine quoi ?
A renverser le rgime bolchevik ? A nous faire rentrer dans nos mil-
liards ? remettre sur pied une puissance russe dans l'intrt de
l'quilibre europen ? Peut-tre l'intervention servirait-elle aux trois
choses la fois puisque le Temps parlait encore hier soir de rorga-
niser la Russie. Il serait pourtant recommandable de distinguer un
peu.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 62
S'il s'agit d'extirper le bolchevisme, il faut d'abord savoir par quoi
on entend le remplacer. On nous dit depuis de longs mois, selon les
assurances donnes par les migrs russes, que la population n'attend
que l'arrive des Allis pour briser la tyrannie de Lnine. Mais des
migrs, mme quand ils sont libraux, sont toujours des migrs. Les
libraux russes sont dans leur pays une exception, un fruit exotique.
Le plus spirituel et le plus sincre d'entre eux aime dire : Pour
nous autres Cadets, il n'y a de place en Russie qu'au bout d'une po-
tence. Les Allis peuvent-ils attacher une grande expdition politi-
que et militaire cette corde de pendus ?
S'il s'agit de retrouver le capital franais engag en Russie sous des
formes diverses, c'est une autre affaire. Vingt milliards, songez vos
vingt milliards, nous disent les girondins russes de Paris. Mais si,
pour retrouver ces milliards, il nous faut d'abord en avancer d'autres,
d'un total inconnu, avec des chances de succs incertaines, voil une
belle opration.
Quant restaurer de nos mains une puissance moscovite, on est en
pleine chimre si l'on en est penser cela. Il est fcheux que l'quili-
bre de l'Europe soit rompu par l'croulement de l'Empire des tsars. Ce
n'est pas une raison pour se mettre croire qu'il ne nous reste plus qu'
chausser les bottes de Pierre le Grand. Qu'on cherche une autre politi-
que d'quilibre continental, voil tout. L'occasion est bonne pour re-
construire une Europe qui se passerait de la Russie, comme elle s'en
est passe si longtemps. Cette fidlit posthume l'alliance russe, fi-
dlit qui va jusqu' vouloir ressusciter la jument de Roland, est une
manifestation de routine intellectuelle et une dfaillance d'imagination
dont nous reconnaissons volontiers l'humilit touchante.
J usqu' prsent, aucun groupement russe vraiment srieux ne s'est
lev contre Lnine et n'a rclam notre aide. D'autre part, le gouver-
nement de Lnine nous traite en ennemis. Nous n'avons, pour le mo-
ment, qu' ne tolrer aucune de ses provocations et interdire sa pro-
pagande. Un cordon sanitaire commence tre tendu autour de ce
foyer pestilentiel. Ce qui a t fait Arkhangel et en Sibrie devra tre
continu par la mer Baltique et par la mer Noire. Pologne, Bohme et
Roumanie pourront nous aider complter ce blocus. Quand la Russie
aura cuit dans son jus bolcheviste, on verra bien ce qui s'y passera. Si
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 63
les circonstances deviennent favorables, il sera toujours temps d'agir.
Mais, mme alors, la Russie des Pierre, des Catherine, des Alexandre
et des Nicolas, qui hante le souvenir de la diplomatie, ne sera pas prs
de renatre. J usque-l il sera prudent de combiner nos scurits
comme si la Russie n'existait plus.
L'Action franaise, 10 dcembre 1918.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 64
1.15
Le problme russe
L'Action franaise, 16 janvier 1919.
Retour la table des matires
Il y a, dans la littrature anglaise, une page clbre qui excuse tous
les excs des rvolutions. Macaulay y compare les peuples affranchis
du despotisme un prisonnier qui, sortant de son cachot, bloui par la
lumire, dirige d'abord mal ses pas. En vertu de cette image, toute r-
volution mrite crdit et le libralisme anglais n'aura pas mnag le
sien la rvolution russe. De l cette indulgence pour le bolchevisme
laquelle le gouvernement britannique a failli un moment cder.
Quelle est, sur la Russie, la thse qui a cours ? C'est une thse
sommaire et, par consquent, fconde en causes d'erreur. On s'ima-
gine, en gros, un peuple russe abruti par des sicles de tyrannie tsa-
rienne, rendu incapable de se gouverner lui-mme et retomb sous un
nouveau joug, le joug bolcheviste, aprs un essai de libert. Il y a l
un norme contre-sens historique. Tel quel, le tsarisme n'avait pas seu-
lement constitu la Russie et rassembl la terre russe . Il y avait
introduit, par la force, contre le gr des habitants, la civilisation euro-
penne. Il l'avait fait entrer dans le courant europen, et seulement
depuis le dix-huitime sicle. Le tsarisme a t l'instrument du pro-
grs par en haut . Cette europanisation, pour laquelle Pierre le
Grand fut jadis tant admir de nos philosophes, a pu tre superficielle
et artificielle. La Russie n'en a pas connu d'autre et si elle ne l'avait
pas eue par les tsars elle n'en aurait pas eu du tout.
Avec le tsarisme et son administration, la pellicule civilise de la
Russie est tombe. Voil le fait. On pouvait tre sans illusions sur le
gouvernement de Nicolas II. Ce qui tait sr, c'est que, ce gouverne-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 65
ment une fois disparu avec ses traditions importes des pays occiden-
taux, la Russie retournerait ses origines orientales. Dostoevski avait
compris que le tsar et les bureaucrates taient les allis des intellec-
tuels contre la barbarie. Dans la lutte des libraux russes contre les
bolcheviks, ce sont les vestiges inorganiques de la Russie europenne
qui livrent combat la Russie asiatique.
Lnine et Trotsky commenceraient-ils s'en rendre compte ? Arri-
vs Moscou avec le marxisme et le germanisme dans leurs bagages,
ils semblent, d'aprs de curieuses indications, russifier le bolchevisme.
Une correspondance de Stockholm adresse au Manchester Guardian
signale en Russie une renaissance du sentiment religieux que Trotsky
et quelques autres travailleraient confisquer et canaliser dans le
sens de la rvolution, aprs s'en tre alarms. Le mysticisme russe est
une force et les bolcheviks trouvent qu'elle est bonne prendre. Ils
savent que la religion, en Russie, a toujours t associe au nationa-
lisme, et qu'il vaut mieux l'avoir pour soi que contre soi.
Que valent ces renseignements ? On sait que le journal anglais qui
les donne est, par son libralisme exalt, favorable au bolchevisme.
Pourtant, il ne serait pas inutile de les contrler. La Russie est plus
complexe qu'on ne pense et le fanatisme peut pouser bien des formes
imprvues. Pour s'occuper utilement des affaires de cette masse hu-
maine, il faut la comprendre et la connatre. Si la Russie tsariste a d-
u l'Occident, si la Russie librale l'a due plus encore, c'est parce
que l'Occident ignorait l'une et l'autre. Il serait temps de ne plus se
tromper. Et, pour ne plus se tromper, il faudrait tre inform.
La Confrence de la paix va s'occuper de savoir comment la Rus-
sie pourrait tre reprsente et l'on agite des projets divers. Il y a des
gens qui ne se consolent pas d'un Congrs sans Nesselrode ni Gort-
schakof et qui proposent d'y asseoir des Gortschakof en cire. Si l'on
avait d'abord une ide un peu nette du pays et de ses habitants, on sau-
rait peut-tre mieux ce qu'il y a faire avec les Russes.
L'Action franaise, 16 janvier 1919.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 66
1.16
La paix l'Est
L'Action franaise, 10 mai 1919.
Retour la table des matires
LA paix va se faire l'Est en l'absence de la Russie. C'est une sim-
plification. Il ne serait pas possible d'tendre la Pologne et la Rouma-
nie aux limites orientales qu'on leur accorde s'il existait encore un tat
russe et que cet tat russe ft notre alli. De mme, en ce qui concerne
la Galicie et les Ruthnes. Il serait trop long d'entrer dans le dtail des
attributions et des partages projets. Il suffit de dire qu'ils seront faits
sans que la Russie de Moscou ni celle de Kiev soient prsentes.
Telles sont les conditions dans lesquelles la Confrence lve la
barrire des nouveaux tats sur lesquels toute une cole veut
compter pour contenir l'Allemagne du ct de l'Est.
Pour contenir l'Allemagne sur le versant oppos au ntre, il faut, en
effet, une grande Pologne, une grande Bohme, une grande Rouma-
nie. Ces trois tats ne peuvent avoir de consistance, ils ne peuvent
communiquer entre eux qu'en s'adjoignant des territoires russes ou
habits par des populations slaves traditionnellement soumises l'in-
fluence ukrainienne ou moscovite.
Ce qu'on fera l-bas durera donc aussi longtemps qu'il sera possi-
ble de ngliger la Russie ou que la Russie sera en sommeil. L'tablis-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 67
sement de la barrire postule ce sommeil ternel. Du jour o un
tat russe renatrait et serait capable d'avoir une politique extrieure,
son alliance se nouerait automatiquement avec l'Allemagne contre les
pays forms leurs communs dpens. La Pologne, comme au temps
de ses malheurs, serait prise entre deux feux.
Il ne dpend pas de nous que la Russie soit jamais raye de la vie
europenne. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'Europe s'organise
comme si elle devait toujours se passer de la Russie. Cependant un
curieux paragraphe des prliminaires, qui est une amorce jete au
peuple russe, laisse ouvert son droit aux revendications. La renais-
sance de la Russie est prvue par les puissances occidentales. Pourvu
qu'elle ne renaisse pas trop tt ! Aprs la paix qu'on aura faite l'Est,
il y aura contradiction et mme danger rveiller le chat qui dort
Moscou.
L'Action franaise, 10 mai 1919.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 68
1.17
La Russie de demain
L'Action franaise, 19 juin 1919.
Retour la table des matires
M. Pichon a annonc la Chambre que la chute du rgime bolche-
vik tait prochaine et nous en acceptons l'augure avec plaisir. Cepen-
dant, lorsque Lnine et Trotsky auront quitt le Kremlin, par qui et par
quoi seront-ils remplacs ? C'est une question qu'on ne peut pas car-
ter toujours sous prtexte que l'essentiel est de dtruire l'abjecte domi-
nation des dictateurs de Moscou.
Nous n'interprtons pas trop troitement les faits en constatant que,
dans la Russie contemporaine, le pouvoir bolchevik est, aprs le tsa-
risme, celui qui s'est maintenu le plus longtemps. Lnine a dj dur
dix-neuf mois. De mars novembre 1917, la rvolution avait us une
demi-douzaine de gouvernements. Il nous semble que l'exprience
n'est pas ngligeable. Elle prouve que la Russie accepte volontiers une
autorit forte et mme pousse jusqu' la tyrannie. C'est peut-tre
parce qu'elle en a besoin. Faute de bon tyran, la Russie en subit de
mauvais.
Est-ce que la nature et le temprament des Russes auront chang
quand ils seront affranchis du bolchevisme ? Nous demandons la per-
mission d'en douter.
Personne ne peut rien ce fait que, si la Russie existe, elle le doit
l'pieu de fer d'Ivan le Terrible, la volont des Pierre et des Cathe-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 69
rine. Le seul tat russe qu'on ait connu a t autocratique, bureaucra-
tique et centralis. Les Allis recommandent aujourd'hui la formule
d'une Russie non seulement dmocratique et librale mais encore f-
drative. Deux expriences la fois, c'est beaucoup.
Nous craignons, en outre, que ces expriences se fassent dans des
conditions mauvaises pour nous. Connat-on l'tat d'esprit des pa-
triotes russes sur lesquels on croit pouvoir compter ici ? Sait-on as-
sez combien ils sont aigris ? Ils trouvent Paris des dlgus ukrai-
niens, esthoniens, lettons, etc... Mettons-nous la place des patriotes
russes qui nous demandons d'abord, pour mriter ce titre, d'tre
anti-allemands. Ces patriotes voient leur patrie dmembre. L'ide
fdrative, reprsente par des sparatistes que nous accueillons offi-
ciellement, ne leur inspire que de la mfiance quand ce n'est pas du
dgot. Lorsqu'ils dcouvrent jusqu'o vont s'tendre l'Est les fron-
tires de la nouvelle Pologne, leurs alarmes patriotiques s'expli-
quent sans peine.
Qu'on ne croie donc pas que tout sera facile quand Lnine et
Trotsky seront tombs. En premier lieu, il faudra qu'ils aient t ren-
dus incapables de nuire et remplacs par d'autres gaillards que les
Lvof, les Milioukof et les Kerensky. Il en est des bolcheviks comme
des J eunes-Turcs : c'est de la mauvaise herbe qui repoussera si on ne
l'arrache pas fond.
Ensuite, on s'imagine peut-tre un peu navement que la Russie d-
bolchevise suivra en politique extrieure la ligne la plus conforme
nos dsirs. Souvenons-nous qu'il y a maintenant, entre l'Allemagne et
la Russie, une Pologne qui peut devenir un fameux trait d'union. Notre
politique, l'Est, ne sera pas simplifie par la rsurrection de la Rus-
sie. Il faudrait y penser avant de rver un retour aux douceurs de l'al-
liance franco-russe.
L'Action franaise, 19 juin 1919.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 70
1.18
Un moment de mditation
au milieu de l'apothose
L'Action franaise, 14 juillet 1919.
Retour la table des matires
J USQU'EN cette journe de fte et de dtente des esprits opprims
par une longue horreur, il faut demander aux Franais de consacrer
quelques moments un retour sur le pass et une mditation sur
l'avenir.
La gigantesque aventure qui finit par une apothose a eu ceci de
prodigieux que les peuples vainqueurs sont ceux qui ne pensaient pas
la guerre, et qui la croyaient mme impossible. Les Allemands ont
dsobi au prcepte de Bismarck. Ils ont agit ce qui tait tranquille.
Ils ont dtruit de leurs mains un tat de choses dont ils taient les b-
nficiaires. Les amateurs de guerre civile pourront s'instruire de
l'exemple. Ils jouent avec la rvolution. Ils avertissent la France par
des provocations successives. Telle a t la mthode de l'Allemagne
entre 1905 et 1914, grce quoi, le jour dcisif, notre mobilisation
s'est faite admirablement. De mme le bolchevisme rveille chez nous
le chat qui dort.
Il n'en est pas moins vrai que l'Allemagne nous a attaqus, envahis,
qu'elle a occup de longs mois une vaste partie de notre territoire et
que nous avons chapp des prils mortels. La victoire d'aujourd'hui
rpare la dfaite de 1870, mais quel prix ! Et dans l'un comme dans
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 71
l'autre cas, c'est l'ennemi qui a mdit et entrepris l'agression. La
France est un pays que la guerre vient chercher. Voil la vrit qui
crve les yeux.
Serons-nous mieux abrits dans l'avenir contre les rpercussions de
la politique europenne devenue universelle ? La France avait pris
l'alliance russe pour une garantie de la paix, et c'est par l'alliance russe
qu'est arrive la guerre. Aprs cela, on peut tre sceptique. L'encha-
nement des effets et des causes a trop de mystres pour qu'on se fie,
en politique, une prcaution conue comme devant drouler sans fin
ses bienfaisantes consquences.
Lorsque approcha le fatal t de 1914, on dcouvrit par quel mca-
nisme la guerre allait s'engager. En appuyant sur le ressort serbe, l'Al-
lemagne mettait en mouvement la Russie et l'alliance franco-russe.
Heureusement, par l'invasion de la Belgique, elle a complt elle-
mme la chane de nos alliances. Il n'en est pas moins vrai que si la
menace russe avait empch Bismarck de nous attaquer en 1875, c'est
travers la Russie, beaucoup moins redoute en 1914, que ses succes-
seurs ont engag le fer avec le peuple franais.
Nous avions aperu et dcrit ce danger, les collections de l'Action
franaise et de sa revue en font foi. Elles font foi galement que nous
nous refusions soutenir les querelles slaves, exciter le panslavisme
ou la slavophilie. Eh bien ! pour viter les orages de l'avenir, il faudra
encore essayer de voir clair. Il faudra aussi se garder de prendre pour
une assurance infaillible de tranquillit ce qui peut devenir le principe
de complications nouvelles. Ds le lendemain des ftes, la vie des
peuples retrouvera ses droits. Elle sera comme toujours pleine de pas-
sions et d'incertitudes. Mais rarement, pour la France, la matire de la
politique aura t plus vaste et plus tnbreuse.
L'Action franaise, 14 juillet 1919.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 72
1.19
La Russie ressuscite
L'Action franaise, 30 janvier 1920.
Retour la table des matires
POURQUOI la politique des Allis se montre-t-elle si incohrente
au sujet de la Russie ? Les contradictions sont clatantes et il y en a de
nouvelles tous les jours. Hier encore, on annonait de Copenhague
que Litvinof, l'envoy de Lnine, et O'Grady, l'envoy de M. Lloyd
George, avaient largi leurs thmes de conversation. En mme temps,
M. Lloyd George refusait des passeports aux dlgus travaillistes
dsireux de se rendre dans la Rpublique des Soviets. La versatilit est
vidente. quoi tient-elle ? autre chose qu' une inconsistance na-
turelle de la pense chez les directeurs de l'Entente.
En ralit, le problme russe - car il y a un problme russe - est vu
travers des prjugs nombreux et divers. On hsite surtout le voir
tel qu'il est.
L'Occident considre gnralement que le bolchevisme est le
monstre qui a dnatur la Russie loyale. Il suffirait donc que le mons-
tre ft terrass pour que la France retrouvt l'allie des temps anciens.
Trop de signes montrent que cette illusion retarde. Le bolchevisme a
bien entran la trahison le pays fidle ses alliances tant qu'ont r-
gn Nicolas II et la tradition d'Alexandre III. Mais le bolchevisme n'a
pas t non plus, on du moins il n'a pas t longtemps ce que disaient
ici ses stupides admirateurs. Sous le bolchevisme, selon la loi dont
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 73
plus d'une rvolution occidentale a donn l'exemple, une autre Russie
a pouss. Et c'est la Russie ternelle, qui se dplace, qui cherche de
l'espace et de l'air dans le sens o la Russie en a toujours cherch. Il
ne fallait pas trop souhaiter que la Russie, depuis que ses bolcheviks
nous avaient abandonns au milieu de la bataille, redevnt forte et re-
part dans le monde comme puissance politique. L'affaiblissement
terrible que les ides absurdes de ses dictateurs socialistes lui ont ap-
port au temps o ils les appliquaient, est devenu un avantage pour
nous. Imprudents ceux qui continuaient soupirer aprs la renaissance
de la Russie. Elle renat et, malgr son anarchie et sa misre, c'est dj
pour inquiter l'Europe.
Ses voisins immdiats, les peuples auxquels nous nous intressons
le plus, n'ont jamais souhait la rsurrection de la puissance qui les a
touffs jadis. Le bolchevisme, ce n'est pour eux qu'un aspect de la
Russie. Ils ne le cachent pas. La Pologne, la Roumanie voient l'arme
rouge s'approcher d'elles. Entre les annes de Trotsky et celles de la
grande Catherine elles ne font pas de diffrences et elles ont raison.
Un communiqu roumain que nous avons sous les yeux crit : En
Bessarabie, d'innombrables volontaires s'offrent tous les jours pour
combattre contre les Russes. C'est rendre service que de dire les
choses comme elles sont. Sovitique ou non, la Russie est la Russie.
Telle est la vrit qu'il faut regarder en face. Sous quelque forme
que ce ft, la Russie ne devait sortir du jus o elle cuisait que pour
redemander sa place. Elle la redemande dans une Europe dsquili-
bre par la paix de Versailles et o elle trouve naturellement pour al-
lie la seule grande masse qui subsiste et qui est l'Empire allemand.
L'Allemagne unie aspire se dlivrer des obligations que le trait lui
impose. Et c'est l'Est qu'elle a t le plus rogne, qu'elle a perdu le
plus de territoires. Contre les Polonais, le mme intrt continue ras-
sembler la Russie et l'Allemagne. Du moment qu'une Pologne tait
cre, il fallait s'attendre la conjonction germano-russe et ren-
contrer un jour l'Allemagne et la Russie associes sans contrepoids
srieux dans l'Europe orientale et centrale. M. Wilson a eu raison de
dire que la politique de l'quilibre tait finie. Les lments de l'quili-
bre n'existent plus.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 74
Ces vues anticipent peut-tre sur les vnements. Mais l'inquitude
et la nervosit des puissances occidentales les justifient. Ne sent-on
pas dj le besoin de s'unir et de s'organiser contre un danger qu'on ne
dfinit pas ? Il serait bon de le dfinir hardiment. Si, dans le wa-
gon-salon o M. Poincar et le roi Albert ont caus avec leurs minis-
tres et le marchal Foch, il a t question de l'avenir, ce conseil fran-
co-belge n'a pu manquer d'envisager les consquences d'une nouvelle
guerre, venue cette fois de Russie.
L'Action franaise, 30 janvier 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 75
1.20
Allemagne et Russie
L'Action franaise, 31 janvier 1920.
Retour la table des matires
APRS l'humiliation d'Arkhangel, aprs l'humiliation d'Odessa,
l'humiliation d'Irkoutsk atteint durement la politique des Allis en
Russie. J usqu' preuve du contraire, nous nous refusons croire qu'un
gnral franais ait livr l'amiral Koltchak aux bolcheviks, c'est--dire
l'ennemi. Ce qui est probable, ce qui transparat dj, c'est que le
gnral J anin et la mission franaise, perdus dans l'immensit sib-
rienne, ont t impuissants lorsque le roman d'aventure des lgions
tchco-slovaques a mal tourn.
On dira que, si le gnral J anin avait eu plus de monde avec lui, il
lui et t possible de sauver Koltchak et l'honneur. Mais combien de
monde ? On n'occupe pas la Sibrie, ni mme la Crime, avec quatre
hommes et un caporal. Dans la voie de l'intervention militaire, jamais
il n'y aurait eu assez de monde pour rien, pas mme pour surveiller les
Tchco-Slovaques dont l'Anabase se termine par une trahison et une
dbandade.
Il y a longtemps que les personnes raisonnables ont reconnu que
nous n'avions sur la Russie aucune prise directe. Le pril russe n'en est
pas moins certain. Ce pril est la fois europen et asiatique. Eh bien,
en Asie, les Anglais cherchent le conjurer par la Turquie et par la
Perse. En Europe, c'est par l'Allemagne que le mal doit tre trait.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 76
L'arme rouge ne sera vraiment dangereuse pour l'Occident que le
jour o la masse russe et la masse allemande se seront fondues. Sur la
Russie, nous ne pouvons rien. Sur l'Allemagne, nous pouvions tout et
nous pouvons beaucoup encore. C'est elle qu'il faut rendre incapable,
par des mesures prventives, de dtruire un jour la paix avec le
concours de la Russie.
En ce moment, le gouvernement de Berlin essaye, au moins pour la
troisime fois, d'amollir les Allis en voquant le spectre du commu-
nisme. Pour ne pas avoir livrer les coupables, pour conserver celles
de leurs organisations militaires dont les contingents dpassent les
limites fixes par le trait et celles qu'ils ont cres par fraude, les di-
rigeants du Reich prtendent qu'ils sont menacs d'une nouvelle rvo-
lution. D'aprs les meilleurs observateurs, c'est le contraire qui est
vrai. Un puissant mouvement de raction commence soulever l'Al-
lemagne. Ce n'est pas un adolescent du groupe Spartakus mais un
jeune nationaliste qui a tir sur Erzberger, l'homme de l'armistice et de
la paix. Quelle erreur ce serait, dans un pareil moment, de mnager
l'Allemagne et de lui permettre de se fortifier !
L'Action franaise, 31 janvier 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 77
1.21
Le bolchevisme assagi
L'Action franaise, 28 fvrier 1920.
Retour la table des matires
ON s'est abus bien des fois sur la Russie, et pour ainsi dire depuis
toujours, mais surtout depuis que Lnine a pris le pouvoir. Il serait
donc imprudent de se fier aux signes de modration et de sagesse que
parat donner le gouvernement bolchevik. Abdul-Hamid et l'Impra-
trice de Chine excellaient galement dans l'art de promettre des rfor-
mes quand ils avaient besoin des bonnes grces de l'Europe. La meil-
leure chance qu'on ait de ne pas se tromper trop lourdement sur les
affaires russes c'est de les juger l'talon de la Chine et de l'Orient.
Lnine dsire la paix. Il l'offre tous ses voisins la ronde, et c'est
bien naturel puisqu'il est vainqueur. Il s'est aperu aussi qu'un systme
qui produit surtout le typhus ne mne pas autre chose qu' la fin du
monde. C'est pourquoi, aprs la dictature militaire, il instaure la dicta-
ture du travail, condamnant ainsi, avec une logique rigoureuse, l'anar-
chie digne fille du libralisme son pre. Que Caliban devienne homme
de gouvernement, c'est l'usage et ce qui est l'actif du rgime bolche-
vik, c'est qu'il dure depuis plus de deux ans dj. Mais l'volution et
l'adaptation du monstre, mme si elles se poursuivaient, voudraient-
elles dire que l'Europe serait au bout de ses peines avec la Russie ?
Formons une hypothse. Le bolchevisme est un gouvernement
comme un autre. Le commerce et l'agriculture recommencent pros-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 78
prer. L'ordre se rtablit dans les finances. La reprise des relations
conomiques avec l'Occident a produit les bons effets qu'en attend M.
Lloyd George, et des ambassadeurs russes fort convenables, peut-tre
mme des princes, qui s'abstiennent de toute propagande, sont admis
Paris, Londres, Rome et ailleurs. En d'autres termes, la Russie a
repris sa place parmi les nations. Que va-t-il se passer ?
Ceci que la Russie comptera de nouveau comme lment de la po-
litique internationale. Elle aura d'ailleurs le grand moyen qui permet
de parler et d'agir, c'est--dire une arme que commanderont des
Broussilof, un Polivanof tant, comme sous le tsar, ministre de la
Guerre. Alors, est-ce que cette Russie ne dira pas son mot dans un
grand nombre d'affaires ? Est-ce qu'elle n'aura pas un point de vue
particulier sur la paix de Versailles et la paix de Saint-Germain, si-
gnes sans elle ? Est-ce que la question de Turquie et de Constantino-
ple ne l'intressera pas autant qu'elle intressait les Pierre, les Cathe-
rine, les Nicolas et les Alexandre ? Et d'abord, et surtout, n'est-ce pas
sur ses frontires qu'elle jettera les yeux ? Avec la Pologne, avec la
Roumanie, ce seront des conflits presque immdiats et qui ne resteront
peut-tre pas toujours purement diplomatiques.
S'il est possible que la Russie se relve sans nouvelles crises et
sans rechutes dans l'anarchie, si elle reparat en Europe comme une
puissance forte et honorable, tout ce qui sera fait tandis qu'elle dor-
mait, elle ne le reconnatra pas, ou bien elle ne le reconnatra que du
bout des lvres. Elle deviendra l'allie naturelle de ceux qui auront
intrt renverser les traits, bouleverser la distribution nouvelle des
tats et des territoires. Au moment de nouer - car on en nouera - des
relations diplomatiques avec un bolchevisme qui se montre assagi ou
qui feint de se montrer tel, a-t-on pens cela ? C'est un risque au
moins aussi grave que la propagation des ides rvolutionnaires
l'Ouest, sans compter que les deux peuvent fort bien marcher de pair.
L'Action franaise, 28 fvrier 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 79
1.22
Par o atteindre la Russie ?
L'Action franaise, 12 aot 1920.
Retour la table des matires
Devant le pril de l'Est, les Allis donnent l'impression de patau-
ger. Les bolcheviks le voient bien. L'Allemagne aussi : l'Entente n'a
pas de politique. Elle ne sait par quel bout prendre une Europe que le
marchal Wilson appelait, l'autre jour, un chaos. L'Entente, en
vingt-quatre heures, passe du systme des concessions aux mesures de
rigueur. Elle est aussi peu cohrente que le trait de Versailles, qui
craque, de l'aveu universel, mais dont elle dpend et qui la lie, au
moins autant que l'Allemagne.
Tout ce qui arrive, arrive par l'effet de ce trait. On ne sortira pas
des difficults prsentes et qui rapparatront tt ou tard, mme si le
danger immdiat est cart, moins d'avoir, pour commencer, une
ide nette de la situation.
Et la situation se rsume ainsi :
1 L'Allemagne, vaincue de la guerre, soumise de lourdes obliga-
tions, garde, avec son unit, sa puissance politique. Elle reste le seul
grand tat, la seule masse organise de l'Europe centrale. Elle
conserve donc les moyens d'obtenir sa libration, sinon sa revanche.
Ses sentiments, ses instincts, ses intrts nationaux la pousseront tou-
jours profiter des circonstances et se servir de sa position et de ses
forces pour essayer d'chapper aux consquences de sa dfaite.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 80
2 La Russie est une autre vaincue de la guerre. Elle a perdu le
contact avec l'Europe, et ses fentres sur l'Occident. Bolcheviste
ou non, elle s'efforcera toujours de les reprendre. Les territoires dont
elle est prive l'Ouest s'adaptent exactement ceux dont l'Allemagne
est prive l'Est. L'alliance de 60 millions d'Allemands et de 100 mil-
lions de Russes contre les faibles tats qui les sparent est presque
fatale, sans compter qu'au point de vue conomique, Allemagne et
Russie sont complmentaires.
3 l'unit allemande, il n'existe pas de contrepoids dans l'Europe
centrale. Il n'en existe pas davantage contre l'alliance germano-russe.
L'ancienne politique fondait ses combinaisons d'quilibre soit sur la
Russie, soit sur l'Autriche. Il n'y a plus d'Autriche et la Russie est hos-
tile. Concluez : c'est le vide.
4 Les nouveaux tats crs par le trait de Versailles ne sont pas
un secours. Ils sont une charge. La barrire tait une plaisanterie.
Le rempart tait de roseaux. Attaque d'un seul ct, la Pologne
n'a pas pu tenir. Que serait-ce si elle tait attaque simultanment par
la Russie et par l'Allemagne ?
5 Les nouveaux tats, dits de nationalit, sont faibles. Ils sont in-
frieurs leurs ennemis par le nombre et par les ressources. Ils n'ont
ni administration, ni organisation et le patriotisme ne tient pas lieu de
tout. Ils ont des frontires indfendables. Ce sont des peuples qui ont
perdu jadis leur indpendance, qui ne l'ont retrouve que par miracle,
qui le savent, qui connaissent leurs faiblesses - mme politiques - et
qui ne veulent pas tout jouer sur un coup de ds. Les Tchco-
Slovaques sont, de ces peuples, ceux qui ont, ce qu'on dit, l'duca-
tion politique la plus avance. Ils le montrent bien. Voil quinze mois
qu'ils nous rptent, par M. Bens, leur inamovible ministre des affai-
res trangres, que, quoi qu'il arrive, leur attitude sera celle de la neu-
tralit. Ils ne trompent pas les puissances occidentales. Ce sont les
puissances occidentales qui se sont trompes.
6 Admettons toutefois qu'une ligue des petits tats soit possible.
L'efficacit de leur concours militaire se juge celui de la Pologne,
qui a pourtant une arme nombreuse, des soldats braves et patriotes. Il
faudrait encore payer ce concours douteux par des subsides, par des
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 81
renforts et, de plus, par des avantages politiques qui dtruiraient quel-
ques-unes des dispositions tablies par les traits, car ces tats, pour
la plupart, sont insatisfaits, quand ils n'ont pas entre eux des sujets de
querelles et de rivalit. La Hongrie s'est propose pour la croisade an-
tibolcheviste. Ce serait, bien entendu, condition que la paix qui la
concerne ft rvise. L'exemple ne sera pas perdu.
7 Nous ne pouvons, en dfinitive, compter que sur nous-mmes
dans une Europe dsquilibre et dsarticule. Par quel bout la saisir ?
8 La Russie est invulnrable. On ne l'atteint pas directement par
l'Ouest. Les plus grands capitaines, Charles XII et Napolon, s'y sont
cass le cou. Sans la Rvolution russe, l'Allemagne n'aurait pas eu la
paix de Brest-Litovsk. Et encore, aprs Brest-Litovsk, elle n'a pas pu
seulement tre matresse de l'Ukraine. Quand la Russie devient dange-
reuse pour l'Europe, tout ce qu'on peut obtenir, c'est de lui barrer la
route (guerre de Crime, San Stefano) et de crer des circonstances
politiques telles (congrs de Paris, congrs de Berlin, paix de Brest-
Litovsk) qu'elle rentre dans ses steppes et qu'elle s'y tienne en repos.
9 Conclusion qui nous ramne au point de dpart : le pril tant
celui d'une alliance germano-russe, c'est par l'Allemagne qu'il faut le
conjurer et le prvenir. Pour dsarmer la Russie, il ne faut plus avoir
compter avec une grande Allemagne. Dans une histoire du temps ja-
dis, deux cochers tant en querelle, le premier donne des coups de
fouet au voyageur de l'autre qui riposte et cingle le voyageur du pre-
mier. Les bolcheviks frappent les Polonais pour nous atteindre. En
frappant l'Allemagne nous atteindrons les bolcheviks.
Et il n'y a pas sortir de l.
L'Action franaise, 12 aot 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 82
1.23
La recherche des alliances
et le premier amour
L'Action franaise, 9 septembre 1920.
Retour la table des matires
Dans le gchis de l'Europe orientale, la politique franaise cherche
aujourd'hui sa voie. Elle ne la trouvera pas si elle continue tre ob-
sde par le souvenir de l'alliance russe.
La France a toujours eu besoin de contrepoids la masse germani-
que et plus cette masse a grandi, plus il a fallu que le contrepoids ft
gros. De l'autre ct de l'Allemagne unie, il ne pouvait y avoir, pour
rtablir l'quilibre, que l'Autriche ou la Russie. Or, la Russie, en ce
moment, nous est hostile pour des causes qui tiennent en partie au
bolchevisme et aussi pour des causes qui ne tiennent pas au bolche-
visme. Quant l'Autriche, elle n'existe plus comme puissance. Et
l'unit allemande subsiste. En face d'une Allemagne qui est celle du
dix-neuvime sicle, nous devons chercher des allis dans une Europe
qui est peu prs celle du dix-septime sicle sinon celle du moyen
ge. Voil la situation vraie. Elle rend compte de ce qui s'est pass au
mois d'aot quand il a fallu s'apercevoir que les petits tats de la fa-
meuse barrire taient trs faibles et que nous ne pouvions pas
compter sur eux.
Cette constatation rend certainement l'alliance avec la Russie dsi-
rable, quels que soient les dboires que cette alliance nous ait apports
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 83
dans le pass. Mais la Russie amie et allie est loin. Elle est pour le
moment en Crime avec Wrangel. Mais si Wrangel tait Moscou,
penserait-il comme il pense Sbastopol ?
Il est possible que la Russie cesse un jour d'tre bolcheviste. Est-il
certain que, pour tre dbolchevise, elle sera ncessairement notre
amie ? Le gouvernement des Soviets, succdant aux Kerensky et aux
Lvov qui avaient totalement dtraqu la Russie, a, bon gr mal gr,
remis ses pas dans les pas des premiers tsars rassembleurs de la terre
russe Hier, Lnine, dans l'Humanit, tait compar par Maxime
Gorki Pierre le Grand, ce qui devient une banalit et, d'autre part, M.
Lucien Cornet, snateur, observait dans un journal bourgeois que les
bolcheviks ont continu la politique des tsars l'gard de la Polo-
gne et que les Polonais se sont dfendus contre la Russie bolcheviste
comme ils s'taient dfendus autrefois contre la Russie tsariste. Rai-
sons nationales, galement fortes Varsovie et Moscou.
Puisque les bolcheviks ont continu les tsars, pourquoi les tsars, s'il
en revenait, ne continueraient-ils pas les bolcheviks ? Les rveurs d'al-
liance russe ne voient pas qu'il y a dsormais une Pologne entre l'Al-
lemagne et la Russie. Au temps de l'alliance, la diplomatie franaise
Saint-Ptersbourg prenait une prcaution lmentaire : c'tait de ne
jamais parler des Polonais.
Il n'est pas interdit d'esprer qu'un jour nous retrouverons une Rus-
sie loyale, fidle, o tous les Russes seront comme Nicolas II, o Ni-
colas II n'aura mme plus de Sturmer. D'ici l, nous devons faire
comme si la Russie tait perdue pour nous. Nous n'organiserons ja-
mais rien en Europe si nous ne pouvons pas nous dtacher du premier
amour de la troisime Rpublique.
L'Action franaise, 9 septembre 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 84
1.24
L'avenir du bolchevisme
L'Action franaise, 19 Mars 1921.
Retour la table des matires
CRONSTADT a bien chang depuis les temps o l'amiral Gervais
y conduisait nos navires. Cronstadt en rvolte contre Lnine a capitul
le jour o mourait l'amiral dont le nom fut si prodigieusement popu-
laire chez nous il y a vingt-cinq ans. Les jeunes gens ne peuvent pas
se douter de cet enthousiasme. Ceux qui retrouveront des titres russes
dans l'hritage de leur pre comprendront peine la prsence de ces
papiers. L'alliance franco-russe est du pass, un pass dj lointain.
Quant savoir ce qui s'est pass en Russie ces jours derniers, on en
est rduit aux hypothses. Les explications sont diverses, mais il en
apparat de curieuses et qui mritent d'tre retenues parce qu'elles
s'accordent avec la nature des choses politiques et des socits.
Une contre-rvolution proprement dite ne semble pas avoir de
chances en Russie. Ce qui lui manque, ce sont les lments. L'an-
cienne bourgeoisie russe n'tait qu'une trs mince pellicule en forma-
tion. Elle a t peu prs anantie par la Terreur. Lnine rgne, mal-
gr la famine, sur un peuple amorphe et sur des millions de moujiks. Il
n'a plus craindre les bourgeois libraux ni les intellectuels nihilistes
et les tudiantes filles d'officiers suprieurs qui jetaient des bombes
sur les tsars et sur les grands-ducs. Lnine a supprim peu prs tout
ce monde-l.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 85
Toutefois, et c'est aux vnements de ces derniers jours une expli-
cation assez rationnelle, une nouvelle classe moyenne se serait forme
l'intrieur du bolchevisme. Toute rvolution n'est qu'un dplacement
des fortunes. De nouveaux riches ou presque riches se sont forms
l'intrieur du bolchevisme, occupent des places dans la bureaucratie
rouge et commencent supporter mal le rgime communiste dont ils
sont issus. Ils aspirent un autre ordre de choses tir et dduit comme
eux-mmes de l'organisation bolchevique.
S'il en est ainsi, et nous rptons que c'est une vue acceptable, le
bolchevisme durerait en se transformant. Les ides et l'esprit qui ont
prsid sa naissance ne se transformeraient que dans la mme me-
sure que lui. Les nouvelles classes moyennes qui s'empareraient un
jour du pouvoir et le ptriraient leur image auraient une idologie et
des traditions bolchevistes. Elles les porteraient en politique trangre.
Grandies dans la haine des pays imprialistes et des dmocraties
bourgeoises, leur prjug serait long cder. Il serait imprudent d'at-
tendre d'elles des manifestations d'amour pour la France crancire. Et
dans cette hypothse d'un bolchevisme renouvel par une volution
intrieure, les jours de l'alliance franco-russe seraient encore loin.
L'Action franaise, 19 Mars 1921.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 86
1.25
La Russie et l'Occident
L'Action franaise, 18 mai 1922.
Retour la table des matires
L'CHEC de la Confrence de Gnes
3
laisse l'Europe occidentale
en face de la question russe. La mthode de M. Lloyd George n'a pas
russi et elle ne pouvait pas russir. Il tait aussi vain de demander au
bolchevisme de se modrer qu'il l'tait sans doute de demander l'au-
tocratie de devenir librale.
La longue erreur qui a t commise sur la Russie tsariste tait en
partie volontaire. Cette Russie tait notre allie, nous n'en avions pas
d'autre, et les alliances demandent un peu d'illusion. Nous n'avons
plus les mmes raisons de refuser de voir clair. Les observateurs d'au-
trefois nous ont laiss du peuple russe des dfinitions dont la vrit
reste entire et qui sont encore de la plus grande utilit. Aucun sys-
tme, clos dans l'esprit de quelques conomistes et traduit par l'ima-
gination de M. Lloyd George, ne peut rsister certaines ralits his-
toriques et politiques. On et vit bien des faux pas en se souvenant
des bons documents qui existent sur le peuple russe ou en prenant la
peine de les consulter.
3
C'est au milieu de cette confrence qu'clata la nouvelle du Trait de Rapallo
conclu entre l'Allemagne et la Russie.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 87
Le livre trop oubli du marquis de Custine, la Russie en 1839, qui
fut au sicle dernier une rvlation, contient des remarques toujours
justes. Quatre-vingts ans ne changent rien la nature et l'histoire des
peuples. Et le marquis de Custine marquait comme le trait dominant
qui spare la Russie, formation asiatique, de l'Occident latin, cette
diffrence fondamentale : La Russie est peine aujourd'hui quatre
cents ans de l'invasion des Barbares, tandis que l'Occident a subi la
mme crise depuis quatorze sicles : une civilisation de mille ans plus
ancienne met une distance incommensurable entre les moeurs des na-
tions.
C'est ce que l'on a vu par la tragdie de la rvolution bolcheviste.
Entre l'Occident et la Russie s'est ouvert tout de suite cet abme de
mille annes. Dans ce qu'on appelait avec raison l'Empire des tsars,
car c'tait leur construction, ce qu'il y avait d'europen a sombr avec
le tsarisme. la cour, la chancellerie impriale, on trouvait des
hommes levs la manire occidentale et qui avaient la mme du-
cation, les mmes moeurs, presque les mmes faons de penser que
leurs interlocuteurs occidentaux. Tout cela a t balay par la rvolu-
tion. la place, qu'est-il apparu ? Les Russes dont parlait le marquis
de Custine : Ils n'ont point t forms cette brillante cole de la
bonne foi dont l'Europe chevaleresque a su si bien profiter que le mot
honneur fut longtemps synonyme de fidlit la parole et que la pa-
role d'honneur est encore une chose sacre. M. Lloyd George a pu
s'apercevoir avec Tchitcherine, rengat de la civilisation europenne,
que la parole d'honneur, pour transformer un peu le mot clbre, est
un machin de bourgeois , c'est--dire un machin des peuples
forms par Rome, le catholicisme et la chevalerie, des peuples qui
taient depuis longtemps fiers et libres lorsque les Russes payaient
tribut la Horde d'Or en frappant la terre du front.
Ces vues ne sont pas trangres au sujet actuel. M. Hoover vient de
dire avec raison que le bolchevisme avait ruin la Russie et qu'il tait
vain de chercher remdier au mal tant que durait la cause. Mais le
bolchevisme est un fait auquel nous ne pouvons rien : ni le renverser
par la force du dehors ni l'amliorer par la bienveillance et la persua-
sion. Il faut le prendre et le traiter tel qu'il est, comme un phnomne
de rgression monstrueuse. La Russie est devenue une sorte de Chine,
entoure d'un mur moral. Il s'agira de ne pas l'en laisser sortir.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 88
Ce qu'il ne faut pas, en revanche, c'est craindre le pril russe l'ex-
cs. Cette disposition s'accuse chez M. Lloyd George. Elle peut tre
mauvaise conseillre. Au milieu du dix-neuvime sicle, la crainte du
pril russe a cach le pril allemand. Tous deux sont surveiller au-
jourd'hui. Mais ngliger ou mme favoriser l'Allemagne pour dtour-
ner l'orage russe serait la plus grande des folies.
L'Action franaise, 18 mai 1922.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 89
1.26
Le congrs de Moscou
L'Action franaise, 1er juin 1923.
Retour la table des matires
ON vient de publier, d'aprs les comptes rendus de la presse bol-
cheviste, un rsum des rapports qui ont t prsents au congrs du
parti communiste russe qui s'est tenu en avril Moscou. Il se dgage
de ces documents que les dirigeants de la Rpublique des Soviets ne
sont plus trs srs de la route qu'ils doivent suivre mais qu'ils n'ont pas
d'inquitude relle pour leur domination en Russie.
Lnine leur manque. Le congrs a envoy toutes sortes de tmoi-
gnages d' ardent amour Vladimir Ilitch, Nadiedja Constanti-
novna sa femme et toute sa famille avec un accent d'adoration qui
rappelle l'hommage au Gossoudar Imperator et la famille impriale
modul selon la liturgie. Vladimir Ilitch a t salu par le Congrs des
noms de chef et de gnie de l'ide proltarienne et de l'activit rvo-
lutionnaire .
Le chef est malade. L'ide aussi. Le rapport de Zinoviev sur la po-
litique extrieure rvle une grande hsitation. Zinoviev s'en tient un
programme ngatif qui s'autorise de la parole sacre de Vladimir Ilitch
et qui se traduit textuellement ainsi : D'une manire gnrale (sic)
tout recul t suspendu cette dernire anne et nous avons mme,
dans certaines branches, commenc prparer, trs lentement, bien
entendu, un mouvement d'offensive. Ce n'est ni chaleureux ni en-
courageant.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 90
Mais plus loin, toujours en s'abritant derrire les oracles et les pro-
phties de Lnine, Zinoviev accorde un point capital : Le retard dans
la rvolution proltarienne internationale, dit son rapport, est aujour-
d'hui un fait acquis et personne ne saurait dire combien de temps dure-
ra cet arrt. Un arrt aussi prolong s'appelle un chec et si la rvo-
lution internationale doit venir dans une centaine d'annes, elle ne
nous intresse pas plus qu'elle ne peut intresser Zinoviev lui-mme.
On verra d'ici l. D'ailleurs le rapport ajoute, sans dguiser la vrit :
L'affaiblissement rel du proltariat europen, au point qu'il ne peut
se mesurer avec la bourgeoisie, est un fait galement acquis.
De ces constatations extrmement prcieuses il rsulte que les cho-
ses ne se sont point passes comme le croyaient les bolcheviks. Ils
avaient certainement cru que leur rgime ne serait pas durable sans la
rvolution universelle ou sans progrs des ides rvolutionnaires en
Occident. La rvolution recule et le bolchevisme dure. Il est lui-mme
embarrass de ce dmenti. Gardant le pouvoir dans des conditions qui
ne sont pas celles qu'il avait calcules, il faut qu'il s'adapte ces
conditions. Le rsultat, c'est qu'il devient et que la Russie redevient
avec lui tous les jours un peu plus asiatique. Le rapport de Zinoviev
met son espoir sur l'Orient mais, semble-t-il, avec une confiance m-
diocre. Au total, on garde de cette lecture l'impression d'une langueur.
Et l'on se demande si la Russie n'est pas carte d'Europe pour long-
temps.
L'Action franaise, 1er juin 1923.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 91
1.27
La mort de Lnine
L'Action franaise, 23 janvier 1924.
Retour la table des matires
LNINE meurt le jour o Ramsay Macdonald arrive au pouvoir.
Le hasard a de ces rencontres. Et sans doute M. Ramsay Macdonald
n'est pas communiste. Il s'en dfend. Mais il y a un commencement
tout.
Dans nos pays d'Occident, le bolchevisme ne serait pas possible. Il
y dterminerait une raction violente, en admettant qu'il ft capable de
s'emparer du pouvoir. Ce qui est bien plus dangereux, c'est la dmo-
cratie socialiste, moins violente que dissolvante. L'Allemagne a r-
prim le spartakisme avec l'appui des social-dmocrates hostiles au
socialisme asiatique . Mais la social-dmocratie a ruin l'Allema-
gne en cinq ans et c'est en rtablissant mthodiquement tout ce qu'elle
a supprim et en dfaisant ce qu'elle a fait que l'Allemagne essaie au-
jourd'hui de sortir de son chaos financier.
En Russie, Lnine avait impos le communisme comme Pierre le
Grand avait impos la civilisation europenne : avec l'aide du bour-
reau. Il avait restaur une autocratie, l'autocratie rouge, et il aurait pu
dire, plus juste titre que jadis M. Kokovtsov : Grce Dieu, nous
ne sommes pas en rgime parlementaire. Son gouvernement a t
fort par la terreur.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 92
Il a t fort aussi par ce qui avait rendu si longtemps le tsarisme
inbranlable : la passivit d'une immense population rurale. On disait
autrefois que le tsar avait pour lui cent millions de moujiks. L'vne-
ment a prouv que ce n'tait pas trs sr, mais il lui suffisait de ne pas
les avoir contre lui. La rvolution n'a pu clater que par la guerre,
quand la mobilisation a rapproch et concentr des millions d'hom-
mes, impuissants quand ils taient dissmins sur un territoire colos-
sal, forts quand ils n'taient plus isols. La rvolution russe de 1917 a
clat et flamb d'un seul coup. En 1905, la rvolution avait t rpri-
me parce qu'elle n'tait que sporadique. Aprs 1917, quand les mou-
jiks ont t de retour dans leurs villages, il a suffi que Lnine - qui
savait la manire de gouverner la Russie - et une arme peu nom-
breuse mais discipline, et il a teint tous les foyers de rvolte, les uns
aprs les autres : Stolypine, en somme, ne s'y tait pas pris autrement.
Tragique et absurde, le bolchevisme s'est montr adquat la Rus-
sie parce que, dans ses sanglantes violences, il a gouvern la Russie
comme veut l'tre un pays o est rest clbre l'pieu de fer d'Ivan le
Terrible. La Russie n'a eu qu'un seul gouvernement europen : celui
des tsars depuis Pierre le Grand. Tout ce qui lui est arriv partir de la
chute de Nicolas II n'a rien qui tonne : elle est retourne vers la
Chine. Quant ce qui lui arrivera aprs la mort de Lnine, redout
mme sur son lit de malade, c'est ce que personne ne saurait prophti-
ser. Il n'y a pas de prophtie ni de raisonnement valable pour un pays
que se disputent l'Europe et l'Asie et o, depuis sept ans, l'Asie mon-
golique et smitique l'a emport.
L'Action franaise, 23 janvier 1924.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 93
1.28
Le diplomate russe
L'Action franaise, 17 dcembre 1925.
Retour la table des matires
M. Tchitcherine a expos, devant les reprsentants de la presse
franaise, les ides directrices de la politique trangre des Soviets. Si
l'on nglige quelques pointes de tradition diplomatique et quelques
ironies de tradition acadmique, ses dclarations ont t modres. Le
bolchevisme, comme disent les marins, donne du mou. Et l'on a l'im-
pression que tout n'est pas faux dans ce qu'on rapporte des difficults
que les dirigeants de Moscou commencent rencontrer auprs de
l'immense paysannerie russe.
Les dclarations de M. Tchitcherine contiennent aussi quelques
parties originales. Le point de vue de Moscou sur les accords de Lo-
carno sort de la banalit. L'ambassadeur Rakovsky avait dj dit que
le pacte formait un groupement de puissances, que ce groupement de
puissances crait un dsquilibre et que le dsquilibre conduisait fa-
talement aux conflits. Doctrine de la pure diplomatie classique. M.
Tchitcherine a renchri. Il voit dans le pacte les germes de guerres fu-
tures. Selon lui, M. Chamberlain et M. Briand auraient sem les dents
du dragon. L'avenir dmontrera si l'accord de Locarno a vraiment le
caractre pacifique que lui attribuent ses participants, a-t-il ajout, ou
si plusieurs de ces derniers n'auront pas regretter leur oeuvre.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 94
On ne risque rien prophtiser le mal, sinon le pire. Au fond, M.
Tchitcherine a, comme Bismarck, le cauchemar des coalitions. Et c'est
lui qui cherche le contact de l'Europe tout en affectant de croire que
l'Europe a besoin de la Russie.
Il prtend qu'on a vu clairement, en France et dans les autres pays,
qu'un rglement gnral des affaires internationales tait impossible
sans l'Union sovitique. Les faits ne sont pas entirement d'accord
avec cette allgation. Il est probable que la paix de Versailles et t
encore plus difficilement ralisable si la Russie avait t prsente la
Confrence et si elle avait rclam ce que les Allis lui avaient promis
pour prix de la victoire et de sa fidlit, c'est--dire Constantinople, ni
plus ni moins. Depuis sept ans, il y a eu en Europe bien des affaires.
Vaille que vaille, jusques et y compris Locarno, elles ont t rgles
sans la Russie, et il n'est pas sr que la prsence de la Russie ne les
et pas beaucoup compliques.
Aprs avoir voulu rentrer dans la politique internationale par ef-
fraction et par la rvolution universelle, les Soviets y rentrent sous les
aspects courtois de la diplomatie d'ancien rgime. Derrire les chan-
gements de dcor, la Russie que nous retrouvons est toujours la
mme, atteinte la fois de gigantisme et de dbilit - et, dans son
vaste corps, aussi altre d'emprunts et de crdits.
L'Action franaise, 17 dcembre 1925.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 95
1.29
Un remarquable fanatique
L'Action franaise, 24 iuillet 1926.
Retour la table des matires
LE comit bolcheviste qui, au mois d'octobre 1917, avait renvers
Kerenski, tait compos de cinq rvolutionnaires : Lnine, Trotsky,
Kamenef, Dzerjinsky et Staline. Le premier est mort. Les deux sui-
vants, coupables d'hrsie, n'occupent plus qu'un rang secondaire.
Dzerjinsky vient de mourir son tour. Seul Staline (alias le Gorgien
Djugaschvilli) continue reprsenter l'cole primitive du bolche-
visme.
Figure singulire que celle de Flix Edmundovitch Dzerjinsky, de
sanglante mmoire. Un journal anglais, qui publie sur lui d'intres-
sants dtails, l'appelle un remarquable fanatique. Ce n'tait pas en ef-
fet un rvolutionnaire banal que ce fils d'un petit noble lithuanien, r-
volutionnaire depuis l'enfance, rvolutionnaire-n, et qui, dans son
horrible besogne d'excuteur des hautes oeuvres de la Rvolution,
inaccessible tout sentiment d'humanit, tait rest gentilhomme au
point qu'un Amricain, l'ayant approch Moscou au moment o le
chef de la Tchka ordonnait des excutions tous les jours, a pu dire
que c'tait l'homme le plus charmant qu'il et rencontr de sa vie .
Charmant comme Saint-J ust et gentilhomme comme M. de Ro-
bespierre. C'est lui qui disait un jour, comme on lui reprochait d'avoir
du sang sur les mains : On ne fait pas une rvolution avec des gants
de chevreau blanc. La rvolution russe, comme la ntre, a d son
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 96
nergie et sa dure ces sortes de monstres. La brute populaire se
lasse plus vite des excutions sommaires et des massacres que l'intel-
lectuel et l'aristocrate sans qui une rvolution s'puiserait au bout de
six mois.
L'autre trait par lequel Dzerjinsky se rapproche de nos terroristes,
c'est sa volont farouche d'puration. C'tait un redoutable autant que
remarquable fanatique de la vertu. En 1923, il avait fait fusiller, sans
autre forme de procs, onze architectes communistes coupables de
malversations dans les travaux de l'Exposition de Moscou. Commis-
saire aux transports, ayant constat que des abus taient commis dans
l'administration du Transsibrien, il dcima, littralement et au sens
romain, le personnel du chemin de fer. Un fonctionnaire sur dix fut
excut !
Cette mthode impitoyable, qui rappelle l'pieu de fer d'Ivan le
Terrible, rend compte de la solidit du bolchevisme. Aucun rgime n'a
pu s'installer en Russie sans recourir la rigueur, qui ne produit pas
chez le Moscovite des rvoltes et des ractions rapides comme dans
les autres pays. C'est pourquoi un 9 Thermidor a t vainement atten-
du. Et une autre cause de la fortune du sovitisme c'est que les chefs
avaient jur de ne pas recommencer la lutte de Robespierre et de Dan-
ton, mme s'ils cessaient d'tre d'accord. Ils ont tenu parole comme le
prouve le cas de Trotsky.
Le bruit court cependant, et les journaux allemands le propagent,
que la mort de Dzerjinsky serait bien soudaine pour ne pas tre myst-
rieuse. Il n'avait que quarante-neuf ans. Sa mort changera-t-elle quel-
que chose de plus que la mort de Lnine ? Tout ce qu'on peut dire c'est
qu'en perdant ses crateurs, le ressort du bolchevisme se dtend. Mais
ne dit-on pas en Italie que si Mussolini venait mourir, l'organisation
fasciste continuerait aussi ?
L'Action franaise, 24 juillet 1926.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 97
1.30
Rumeurs sur la Russie
L'Action franaise, 20 octobre 1926.
Retour la table des matires
LE conflit politique qui vient d'avoir lieu au pays des Soviets a
prt des commentaires inexacts, autant du moins qu'on peut en ju-
ger. Cette inexactitude mme a fourni hier l'Humanit l'occasion de
triompher, et pourtant 'aurait d tre le contraire.
Si l'on comprend bien, en effet, l'espce de rvolte dont Trotsky
avait pris la tte avait pour cause le modrantisme du gouvernement
dont Staline est aujourd'hui le chef. Il n'y a pas eu en Russie de Ther-
midor. Il n'y a pas eu de raction. Il y a eu de l'opportunisme. Les
chefs responsables du bolchevisme ont volu. Ils ont fait une politi-
que de mnagement l'gard de la masse paysanne russe avec laquelle
Lnine avait dj d compter puisqu'en dpit de ses principes il l'avait
laisse partager la terre, ce qui tait une concession considrable
l'ide de la proprit individuelle.
Au nom des principes communistes, Trotsky et Zinoviev condam-
naient la faiblesse de Staline l'gard des ruraux. Au fond, cet inci-
dent trahit, dans la Rpublique ouvrire et paysanne, l'opposition fon-
damentale des ouvriers et des paysans. L'enseigne n'est qu'un mot,
peu prs comme le fameux : Proltaires de tous les pays, unis-
sez-vous. Car le mineur franais ou allemand ne se gne pas, en ce
moment-ci, pour profiter de la grve des mineurs anglais.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 98
J usqu' prsent le communisme avait pu tant bien que mal et en
dpit de l'absurdit de sa thorie se tirer d'affaire en Russie grce au
systme dit des ciseaux . Rduite sa plus simple expression, la
dfinition de ce systme est la suivante. Il consiste sacrifier tantt
les paysans aux ouvriers en prenant soit par l'impt, soit par des rqui-
sitions payes vil prix, la rcolte des paysans afin de faire vivre l'ou-
vrier bon march, tantt sacrifier les ouvriers aux paysans en r-
duisant les salaires des premiers pour fournir les seconds d'objets ma-
nufacturs de premire ncessit. Staline voudrait laisser les ciseaux
ouverts en faveur des paysans sur lesquels Trotsky voudrait les refer-
mer. Staline dit : La rvolution est perdue si nous mcontentons les
vastes masses rurales. Trotsky rpond : La rvolution a fait faillite
si elle doit les masses ouvrires des villes.
Staline, c'est--dire le gouvernement officiel des Soviets, l'a em-
port. En cela l'Humanit a le droit de triompher mais en cela seule-
ment, car il est vident que si l'interprtation que nous venons de don-
ner de cet pisode est la vraie (et il y a de srieuses raisons de penser
qu'il en est ainsi), c'est une victoire des modrs et des opportunistes
sur les doctrinaires et les intransigeants. Le bolchevisme, pour durer,
compose avec les ralits et avec les forces de la nature et de la soci-
t.
Ce n'est pas le premier pouvoir temporel ou spirituel qui cette
aventure arrive. Mais si le principal, pour un pouvoir, est d'agir en
sorte qu'il dure, Staline et ses partisans ne le servent peut-tre pas mal.
C'est toujours une question de savoir si l'on se renforce ou si l'on s'af-
faiblit par des concessions. Mais il est certain que celui qui ne s'adapte
jamais finit par tre bris.
L'Action franaise, 20 octobre 1926.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 99
1.31
Dcouverte d'un professeur danois
L'Action franaise, 12 avril 1927.
Retour la table des matires
M. Wickham Steed analyse dans la Review of Review un livre du
professeur danois Karlgren, la Russie bolcheviste, qui est un tableau
de la vie au pays sovitique. Tout cela n'est d'ailleurs pas nouveau. Ce
qui en fait le prix, c'est que le professeur Karlgren (plaignons-le) a
d'abord cru que le communisme tait aussi confortable qu'admirable.
Du moins s'est-il rendu compte par lui-mme. Voici ce qu'il a vu et ce
qu'il rend avec loyaut :
Un professeur qui arrive en Russie, avec la mmoire frache de
tout ce, qu'il a entendu dire de la nouvelle socit proltarienne, n'en
croit pas ses yeux au premier moment. Est-ce l rellement la Russie
proltarienne ? Il se sent, en vrit, tent d'oublie qu'il y a eu quelque
chose qu'on appelle la grande Rvolution russe ; ce qu'il a devant les
yeux, c'est purement et simplement l'ancien systme russe des distinc-
tions sociales qui existait avant la Rvolution. bord de tel ou tel
steamer sur la Volga, comme on reconnat bien le milieu d'autre-
fois !.. C'est le mme ple-mle nausabond en troisime et quatrime
classes. Des paysans et des artisans russes sont entasss au-dessous
du pont, dans un gte rpugnant tellement bond que, s'ils taient des
btes et non des tres humains, on taxerait de cruaut dans l'Europe
occidentale un tel traitement inflig des animaux. Et au-dessus, dans
le salon de premire classe, on voit se prlasser, tout comme aupara-
vant, un petit nombre de privilgis qui jouissent du mme confort et
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 100
du mme luxe qu'autrefois... En bas, dans ces rgions infrieures, les
pauvres hres mchent pour tout rgal un morceau de pain noir avec
un concombre peine mr, tandis qu'en haut les gros bonnets savou-
rent le dner fin quatre services des steamers, en commenant par
des bols pleins de caviar frais de la Volga, et laissent derrire eux sur
le Pont des batteries compltes de bouteilles de champagne vides.
Il y a ceci de chang en Russie que ceux qui voyagent en premire
ne sont plus les mmes, ou, plus exactement, ne sont plus toujours ni
tout fait les mmes, car il doit bien y avoir, comme dans la Rvolu-
tion franaise, des hommes qui ont pass travers tout, et quand il n'y
aurait que Tchitcherine, ancien diplomate du tsar, c'en serait au moins
un.
Cependant, on fera remarquer au professeur Karlgren qu'avant sa
dcouverte on avait rsum en peu de paroles ce rtablissement d'une
classe privilgie. Il y a longtemps que court ce mot des paysans rus-
ses : Autrefois, le barine tait en haut, nous au milieu, l'ouvrier en
bas. Aujourd'hui, l'ouvrier est en haut, le barine est en bas, mais nous
sommes toujours au milieu.
C'est, du reste, ce qui a fait la dure du bolchevisme et ce qui em-
pche d'en prvoir la chute. La masse paysanne russe le supporte
comme elle a support le tsarisme. Et elle n'aime pas plus les commu-
nistes qu'elle n'aimait, en dpit de la lgende, le petit pre le tsar ,
pour lequel elle n'a jamais chouann. La rvolution de 1917 ne se se-
rait pas produite sans la faute qui a consist mobiliser trop d'hommes
et rassembler pour la premire fois le peuple, les lioudi, les gens de
Russie (lioudi, c'est allemand Leute, d'o le mot de leudes, petite
preuve de l'unit des langues indo-europennes). Dissmine travers
un pays immense, la paysannerie russe reste, comme jadis, la merci
de l'administration.
Le professeur Karlgren constate que la bureaucratie communiste
est encore plus nombreuse que la bureaucratie tsariste. Celle-l a-t-elle
t assez dcrie ! Pourtant, comme on l'a trs bien dit, les tchinovniki
aux casquettes multicolores faisaient rgner l'ordre et la paix sur la
sixime partie du monde. Et pour gouverner, depuis le lac Ladoga
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 101
jusqu' Vladivostok, nul rgime, mauvais ou bon, ne se passera de
fonctionnaires.
Le professeur Karlgren a d lire Dostoevski. Il y aura trouv ce
mot : Ne dis pas de mal du Tchin ; c'est ce que nous avons de meil-
leur en Russie. Bref, le voyage de dcouvertes du professeur de Co-
penhague et de quelques autres travers la Rpublique des Soviets
ressemble beaucoup celui de J ean-Paul Choppard qui dcouvrit ga-
lement, travers plusieurs msaventures, les ralits de la vie.
L'Action franaise, 12 avril 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 102
1.32
Vorochilov et Tolsto
L'Action franaise, 2 mai 1927.
Retour la table des matires
Quelques personnes commencent prophtiser la chute des So-
viets. La conqute de la Chine par le communisme tait, dit-on, leur
dernire carte. Les dirigeants et les doctrinaires de Moscou ont tou-
jours profess que le succs dfinitif du bolchevisme en Russie d-
pendait de la rvolution universelle. Si, aprs l'Europe, l'Asie se ferme
la rvolution, le pouvoir sovitique n'a plus qu' disparatre.
On pourrait rpondre, il est vrai, que l'autocratie russe a dur long-
temps aprs que l'Europe s'tait mise au rgime constitutionnel et qu'il
a fallu les circonstances extraordinaires de la guerre pour la renverser.
Rien ne dit que les Soviets replis sur eux-mmes ne dureront pas en-
core longtemps. Ils n'abdiqueront, comme tous les autres gouverne-
ments, que le jour o ils y seront contraints et forcs et non pas parce
qu'ils auront reconnu que leur thorie tait en dfaut.
Rien ne dit non plus que, s'ils se sentent prs de prir, ils n'essaient
de se sauver par une solution violente. C'est ce que tendrait indiquer
le rapport sur la situation de l'arme rouge que le commissaire la
guerre Vorochilov a lu au Congrs de tous les Soviets de l'Union. Du
rsum qu'en a donn le Times, voici un passage assez frappant, au
moins comme signe d'un tat d'esprit :
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 103
Tout le discours de Vorochilov repose sur ce principe qu'il est n-
cessaire de retarder le choc avec le monde occidental jusqu'au jour
o les forces militaires sovitiques, suffisamment entranes, pourront
tre certaines de vaincre. Pour Vorochilov, et d'autres dirigeants, le
conflit est invitable, mais il se produira plus tard. Vorochilov a
adress des injures la Socit des Nations qui, d'aprs lui, aurait
compltement chou. La priode actuelle, dit-il, peut se comparer
la priode qui a prcd la grande guerre. Aucun tribunal, aucun
trait ne peuvent arrter la course aux armements, qui est activement
mene dans les petits et dans les grands tats. Toutes les nations, y
compris les nations frontires, de la Finlande la Roumanie, se pr-
parent la guerre contre les Soviets. L'orateur a violemment repro-
ch au Parlement britannique ses rcentes allusions aux armements
des Soviets.
Suit un tableau de la force et des faiblesses de l'arme rouge, de ce
qu'elle a fait et de ce qui lui reste faire. S'instruisant par l'exemple de
la guerre, o la Russie ressentit si cruellement l'insuffisance de son
armement et de son matriel et dut recevoir l'aide de ses allis, Voro-
chilov recommande le dveloppement des industries de guerre et la
fabrication immdiate de vastes stocks de munitions.
Dans ce programme de prparation la lutte finale , impossible
de dire quelle est la part de l'illusion, celle du bluff et celle de la vri-
t. Ce que nous retiendrons, c'est un mot de Vorochilov sur la ncessi-
t d'organiser la guerre chimique. Il faut, a-t-il dit, que nous dve-
loppions cette branche jusqu' l'extrme limite, car nous ne sommes
pas tolstoens.
Cette ironie est, dans l'ordre des ides, le plus cruel chtiment
qu'ait reu la doctrine de l'aptre Tolsto.
L'Action franaise, 2 mai 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 104
1.33
Les dix ans du bolchevisme
La Libert, 18 octobre 1927.
Retour la table des matires
Les Soviets, qui n'ont pas tant d'occasions de se rjouir, ftent le
dixime anniversaire du coup d'tat de Lnine. On a un peu oubli les
circonstances dans lesquelles les bolcheviks avaient pris le pouvoir et
les marins rouges qui, mettant la main sur l'paule du prsident de
l'Assemble kerenskyste, l'avaient pri de sortir, quoi le prsident et
l'Assemble avaient aussitt consenti, abdiquant avec la mme facilit
que Nicolas Il. ce moment-l, rares taient les personnes qui
croyaient la dure du rgime communiste en Russie. Pourtant il dure
depuis dix ans. Il est de ceux dont on peut dire, selon le mot clbre :
Il est arriv, mais dans quel tat !
Deux choses ont rendu possible le coup d'Etat de Lnine, et, de ces
deux choses, l'une est trangre, l'autre est contraire au communisme.
Il y avait d'abord que les bolcheviks promettaient (c'est une des rares
promesses qu'ils aient tenues) la paix immdiate avec les Allemands,
et le peuple russe en avait assez de la guerre. Cependant, parti de
l'ide de la guerre des classes, le communisme n'est pas essentielle-
ment pacifique, et il l'a bien prouv.
Il s'est donc difi sur la facile dmagogie du pacifisme. En mme
temps, par une violation grave de ses principes, Lnine laissait les
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 105
moujiks s'emparer de la terre. C'est--dire, point essentiel et trop peu
vu, que le communisme s'est tabli par sa propre ngation qui est la
gnralisation de la proprit individuelle. Ce fait n'a pas t aperu
d'abord. Lnine le dissimulait avec soin et, en Occident, on tait sur-
tout frapp par les mesures rvolutionnaires qu'il prenait. Lnine
n'tait qu'un opportuniste figure de doctrinaire. Il savait parfaitement
qu'un rgime, ft-il rvolutionnaire de nom, devait avoir une base
conservatrice. Et, dans un pays agricole, la premire chose faire est
d'avoir avec soi les paysans.
Le partage des terres, qui a pargn une rvolution la Roumanie,
a consolid la rvolution en Russie. Le rgime des Soviets, par un pa-
radoxe trange, est en somme fond sur la proprit individuelle. Car
c'est une assez pauvre dfaite d'allguer que les terres n'ont t cdes
que pour quatre-vingt-dix-neuf ans. D'abord, le moujik s'en est empa-
r. Qu'on aille donc les lui reprendre ! Et puis, d'ici quatre-vingt-dix-
neuf ans, Staline, Rykof et moi nous mourrons. Lnine lui-mme est
dj mort.
Rsumons donc ce que le bolchevisme a fait en Russie depuis dix
ans. Il a cr une nouvelle classe de propritaires ruraux, dont quel-
ques-uns sont aiss ou mme riches et auxquels il n'ose pas toucher. Il
a mis le commerce, l'industrie, les finances dans un tat pitoyable,
telles enseignes qu'il cherche partout des crdits auprs des pays capi-
talistes et bourgeois. Enfin, malgr des efforts persvrants, il n'a pas
russi se rpandre au del des frontires russes, pas mme en Chine,
et la rvolution universelle est demeure l'tat de mythe.
Ce que le bolchevisme a de plus clair son actif, c'est d'tre rest
au pouvoir dix ans. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y reste pas dix
annes encore et mme davantage. Le tsarisme tait malade depuis
bien longtemps. Il se serait prolong indfiniment s'il n'y avait eu la
guerre, si les troupes inutilement entasses dans les casernes de Petro-
grad ne s'taient souleves, si l'arme, en un mot, n'avait fait dfec-
tion. Tant qu'il aura son arme avec lui, le communisme n'a rien
craindre. Staline touffera les insurrections comme Stolypine les
touffait en 1905, car il ne peut pas tre question d'une insurrection
gnrale en Russie et des foyers loigns les uns des autres de centai-
nes de kilomtres peuvent tre facilement teints. Beaucoup de choses
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 106
de l-bas, et mme la dure du communisme comme la dure du tsa-
risme, s'expliquent par le caractre amorphe des masses rpandues sur
des espaces presque infinis. En somme, tout calcul politique, quand il
s'agit de la Russie, doit tre fond sur la notion de la distance.
La Libert, 18 octobre 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 107
1.34
Dix ans de sovitisme
et l'avenir de la Russie
L'Action franaise, 11 novembre 1927.
Retour la table des matires
LE dixime anniversaire de la conqute du pouvoir par les Soviets
a donn lieu, dans les journaux du monde entier, mille considra-
tions diverses sur le pass, le prsent et l'avenir du bolchevisme. On
s'est accord reconnatre et la faillite du systme et sa dure, deux
choses qui ne sont peut-tre pas aussi contradictoires qu'elles en ont
l'air, parce que, du jour mme o Lnine eut transig avec ses princi-
pes, il put s'crier : Enfin, nous avons fait faillite.
Les journaux dmocrates-socialistes ou social-dmocrates ont t
gnralement les plus svres parce que les migrs russes du parti,
cruellement perscuts par les bolcheviks, poussent les hauts cris
contre la dictature de Moscou. Dans l'ensemble, ces commentaires
n'ont rien apport de bien neuf ni de bien intressant. C'est qu'il n'y a
gure constater qu'une chose : que le communisme est une absurdit.
Mais c'est encore dans la presse allemande, et non pas la plus
avance, qu'on trouve les points de vue les plus originaux. Chez les
conservateurs eux-mmes, et peut-tre surtout chez eux, l'ide ma-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 108
tresse de l'alliance germano-russe fait passer sur les rpugnances que
le rgime sovitique inspire. La Russie reste-t-elle forte ? Est-elle en-
core capable de compter en Europe ? L'Allemagne a toujours gard le
contact avec Moscou, mme au temps de la pire rpression de Sparta-
kus, parce qu'elle mnageait une collaboration pour l'avenir. Cette col-
laboration garde-t-elle du prix ? On rpond par l'affirmative.
C'est un lieu commun de dire que tout pouvoir rvolutionnaire se
range avec le temps. La modration des Soviets est d'ailleurs toute
relative. Elle s'atteste presque uniquement par le fait que les dirigeants
sovitiques d'aujourd'hui ont sur leur gauche l'opposition de Trotsky.
C'est pourtant un symptme, et surtout les Staline et les Rykoff pren-
nent l'ide de leurs responsabilits par les attaques auxquelles ils doi-
vent faire face. C'est ainsi que Caliban devient homme d'tat. Dj les
enrags produisaient le mme effet sur Robespierre dont les mdi-
tations furent interrompues par Thermidor.
Tout cela est encore assez banal. Les esprits politiques allemands
vont plus loin. Ils considrent que l'vnement le plus heureux qui ait
pu se produire pour consolider la Russie sous sa dissolvante enve-
loppe bolcheviste, c'est l'chec de la rvolution mondiale . Revenue
de ce mythe, gurie de la propagande rvolutionnaire, la Russie garde-
ra ses forces pour elle-mme. Elle visera des buts moins lointains,
mais plus utiles, par exemple de replacer les petits tats baltes sous
son influence ou sa domination, ce qui aura pour effet de la rappro-
cher de l'Allemagne et de lui donner plus de valeur dans une combi-
naison germano-russe. C'est tout juste si ces subtils docteurs alle-
mands ne vont pas jusqu' dire que l'Angleterre, par la rupture de ses
relations diplomatiques avec Moscou, la France par le renvoi de Ra-
kowsky, n'ont pas rendu service l'Allemagne en dgotant la Russie
rouge de sa mission internationale qui dispersait vainement ses efforts.
Quoi qu'il en soit de ces vues peut-tre trop subtiles, il demeure
certain que l'alliance russe reste pour l'Allemagne comme la grande
carte de l'avenir. Personne, en effet, ne sait mieux qu'un Allemand ce
qu'on oublie trop dans nos pays d'Occident. La Russie n'a eu aucune
part aux traits qui, en 1919, ont cr une nouvelle Europe. Elle ne les
connat pas. Elle ne les reconnatra sans doute jamais. Le jour o elle
comptera de nouveau comme un lment politique, et non plus
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 109
comme un simple lment de dsordre et de destruction, elle sera na-
turellement du mme ct que les pays sur la dfaite desquels ces trai-
ts ont t tablis.
L'Action franaise, 11 novembre 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 110
1.35
Staline et Trotsky
La Libert, 13 novembre 1927.
Retour la table des matires
CE qui se passe chez les Soviets commence devenir intressant.
On annonce qu'en prenant le pouvoir les chefs bolcheviks s'taient
jur de ne jamais se combattre entre eux, de ne pas retomber dans les
convulsions de la Rvolution franaise, de ne pas s'exterminer comme
les girondins, les dantonistes, les hbertistes et les robespierristes. Ils
ont tenu parole dix ans, et c'est beaucoup. Mais quand a-t-on vu des
hommes vivre ternellement d'accord l'intrieur d'un parti, quel qu'il
soit ?
Hors la loi ! La terrible formule de la Rvolution franaise, sous
laquelle Robespierre lui-mme finit par succomber, menace Trotsky et
Zinoviev. Staline et Rykov les ont dnoncs la vindicte des organi-
sations communistes comme Robespierre dnonait les enrags
aux organisations jacobines, avant d'tre mis son tour hors la loi .
Car on ne fait pas assez attention ceci que Trotsky et Zinoviev
accusent Staline et Rykov de modrantisme. Ils leur reprochent d'alt-
rer les principes communistes sinon de les trahir. D'ailleurs, que Ry-
kov et Staline transigent par ncessit d'argent, un communiqu de
l'ambassade de l'U.R.S.S. Paris, en date d'hier, en fournit la preuve.
On y lit avec quelque surprise que le pouvoir sovitique a toujours
cru la possibilit de la coexistence des deux mondes, capitaliste et
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 111
socialiste, et mme la possibilit de leur collaboration conomi-
que . En consquence, les Soviets, qui avaient dj cess de repous-
ser par systme les concessions de richesses exploiter par le capital
tranger, ne se contentent plus de recevoir des propositions. Ils les ap-
pellent. Trotsky et Zinoviev n'ont donc pas tout fait tort. Mais que
feraient-ils la place de Rykov et de Staline ? C'est toujours terrible
quand on doit se demander : Comment faire pour manger ?
La Libert, 13 novembre 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 112
1.36
Russes et Allemands
La Libert, 20 mars 1928.
Retour la table des matires
LE sultan Moulay Hafid, tant venu en France, vit des pompes
piston, trouva cet instrument admirable et en commanda vingt-quatre
douzaines qu'il emporta avec lui au Maroc. Vous n'avez, dit-il, ses
sujets, qu' remuer ce levier et vous aurez de l'eau autant que vous en
voudrez. Mais comme Moulay Hafid avait pos ses pompes sur le
sable, il ne vint pas une goutte de liquide et il accusa le fabricant fran-
ais de l'avoir vol. C'est ce qui vient de se passer en Russie avec les
ingnieurs allemands. Les Soviets commandent les machines les plus
perfectionnes et les plus compliques de la civilisation capitaliste et
ils s'tonnent que rien ne marche dans leur pauvre, primitif et rudi-
mentaire tat communiste. Alors ils se fchent et ils se plaignent
d'tre trahis.
Voil le fond de l'affaire. L'arrestation des six ingnieurs alle-
mands a t un incident digne du Thibet, de la Chine et mme du Cen-
tre de l'Afrique, une colre de roi ngre. Les Allemands, du reste, ne
se sont pas laiss intimider et leur gouvernement a obtenu la libration
des prisonniers en quelques jours. De l voir la fin des relations
germano-sovitiques, il y avait un pas.
Cependant ce pas a t franchi. L'Angleterre, qui a d rompre avec
Moscou aprs une exprience malheureuse, a construit aussitt une
interprtation optimiste de l'affaire. On a voulu y voir la preuve d'un
changement d'attitude du Reich en politique trangre et d'une solida-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 113
rit nouvelle entre les grandes puissances occidentales, qui serait, dans
une large mesure, la consquence de Locarno. On a mme annonc
la fin du trait de Rapallo conclu une poque o l'Allemagne se
croyait maltraite et mprise par les allis . Bref un immense chan-
gement de front, l'Allemagne renonant dfinitivement toute arrire-
pense et collaborant joyeusement l'ordre, au bonheur et la prosp-
rit de l'Europe. Le Daily Telegraph, aprs avoir donn la parole ses
voyants, observe avec raison qu'ils peignent la situation actuelle et
future de trop belles couleurs.
Il est entendu que le bolchevisme se dbat au milieu des difficults
qui tiennent sa propre nature et qu'il ne peut rsoudre sans sortir de
sa doctrine, ce qui l'expose alors des crises intrieures. Tel est le se-
cret du conflit Staline-Trotsky auquel succderait maintenant un
conflit Staline-Rykov. Ce n'est pas une raison pour que le sovitisme
succombe demain, mme si l'Allemagne venait rompre toutes rela-
tions avec Moscou. La force d'inertie de la Russie dpasse les limites
qui sont concevables pour les Occidentaux. C'est une trs grande
force. Elle a jou pour le tsarisme avant de jouer pour le bolchevisme.
Elle a jou contre Charles XII et Napolon 1er. Elle est capable de
neutraliser trs longtemps les efforts des Napolon de la finance.
Quant l'Allemagne, ce serait trs probablement une erreur de
croire qu'elle se sparera jamais du monde russe. Elle y gardait bien
de l'influence pendant la guerre et malgr la guerre ! La Russie est
aussi ncessaire l'Allemagne que l'Allemagne la Russie. Y aurait-il
rupture diplomatique, l'ambassadeur allemand serait rappel de Mos-
cou tandis que l'ambassadeur de France y resterait que, nanmoins, la
place de l'Allemagne serait plus grande l-bas que celle de n'importe
quel autre pays. Le Russe n'aime peut-tre pas l'Allemand mais il ne
peut se passer de lui plus que de th. Et il y a trois quarts de sicle,
bien avant Raspoutine et Lnine, qu'Alexandre Herzen a crit : Chez
nous, tout est allemand, les boulangers, les pharmaciens, les sa-
ges-femmes et les impratrices.
La Libert, 20 mars 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 114
1.37
Un procs historique
La Libert, 16 juin 1928.
Retour la table des matires
ON se demande pourquoi les romanciers vont chercher si loin leurs
sujets, moins qu'ils n'aillent prendre toujours le mme, c'est--dire
l'histoire du monsieur et de la dame qui ont une aventure sentimentale
Venise. La vie contemporaine abonde en situations dramatiques et
Balzac aurait bien su les reconnatre. De son temps aussi il y avait des
romans fades, alors que les siens taient puissants. L'imagination
consiste moins inventer qu' voir les choses et en saisir le sens pro-
fond.
Qui se doutait qu'une fille de Raspoutine vivait Paris ? L'migra-
tion russe est remplie de tragdies et de surprises. chaque instant, ce
sont des dcouvertes tonnantes qui eussent fcond le roman balza-
cien. Mais rien peut-tre n'avait encore atteint l'intensit du procs par
lequel le premier pisode sanglant de la rvolution russe sera voqu
devant la justice franaise.
Quelque crime toujours prcde les grands crimes... Pourquoi
est-ce une rgle ou une fatalit ? Pourquoi le double assassinat de Se-
rajevo la veille de la guerre ? Pourquoi le meurtre de Raspoutine
avant l'effondrement du tsarisme, l'assassinat de la famille impriale et
la grande tragdie moscovite ? Pourtant le prince Youssoupof et le
grand-duc Dimitri avaient bien cru que la dynastie des Romanof et la
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 115
Russie seraient sauves lorsque Raspoutine aurait disparu. Il semble
au contraire que le meurtre du Staretz ait produit l'effet de ces pe-
tits accidents qui dterminent tout coup comme une combustion g-
nrale de l'organisme.
L'histoire de Raspoutine elle-mme a quelque chose de sombre et
de mystrieux. Elle est la fois lgendaire, merveilleuse et pathologi-
que. Elle est un mlange des chroniques du moyen ge, de l'Ane d'or
d'Apule, et de la psychanalyse de Freud. D'o le thaumaturge errant
tenait-il son influence ? Le fait est qu'il n'exerait pas son pouvoir sur
l'impratrice seulement. Il avait ce don extraordinaire d'intresser les
masses, d'avoir du prestige distance et de frapper les imaginations.
Son malheur a t que son nom ft rpt tous les jours des millions
de fois et son personnage dmesurment grossi. Un moment vint o la
Russie entire rapporta Raspoutine ses maux et plus rarement son
bien. Si les Allemands avanaient, c'tait Raspoutine qui avait rgl
avec eux la retraite de l'arme russe. Si une arme impriale rempor-
tait un succs, Raspoutine tait regagn la bonne cause. Il ne mritait
ni tant d'indignit ni tant d'honneur. Mais il fut un moment un sym-
bole : celui du mauvais gnie de la patrie russe.
Le procs que sa fille intente fera d'abord lire le rcit du prince
Youssoupof puisque l'assignation de Marie Grigorievna Raspoutine
est fonde sur ce livre. Et l'on chappe difficilement une impression
de malaise quand on lit, raconte par l'assassin, la mort de cet homme
trange, dou d'une vitalit si prodigieuse qu'il se relevait aprs avoir
t terrass par le plus violent des poisons. Grand sera sans doute
l'embarras des juges franais pour accorder ou refuser Marie Grigo-
rievna Raspoutine les dommages-intrts qu'elle demande. L'Histoire
n'est pas moins embarrasse qu'eux. Car si le grand-duc Dimitri et le
prince Youssoupof ont cru, par cet homicide, sauver leur pays, si leur
intention a t patriotique et noble, il n'en est pas moins vrai que le
trouble profond qui s'empara de la Russie la suite de ce meurtre fut
le point de dpart de la rvolution.
La Libert, 16 juin 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 116
1.38
Un grenier o l'on a faim
L'Action franaise, 7 juillet 1928.
Retour la table des matires
L'ADMINISTRATION sovitique a, comme on le sait, le com-
merce russe en mains. Elle se livre en ce moment, sur tous les mar-
chs o il y a du disponible, de vastes achats de bl. J adis la Russie
tait un des greniers du monde, un puissant producteur de crales. Au
bout de dix ans de rgime marxiste, elle ne peut plus se nourrir
elle-mme. Pitoyable rsultat !
Elle alla crier famine
Chez la fourmi, sa voisine.
Les Soviets se sont humilis jusqu' demander des crdits aux
puissances capitalistes. Maintenant ils leur demandent du pain.
Qu'est-il arriv ? La ralisation d'une prophtie de Proudhon. Dans
sa vieillesse, bien revenu du socialisme, l'homme qui avait dit : La
proprit, c'est le vol , reut un jour une lettre o on lui demandait
quels signes on reconnatrait la rvolution sociale. Et Proudhon r-
pondit : Quand les boutiques seront fermes, quand les transports ne
marcheront plus, quand le paysan gardera sa rcolte le fusil la main,
alors vous pourrez dire que c'est la rvolution sociale.
On peut le dire en Russie. Assez longtemps, la Terreur et le Gu-
pou aidant, les choses ont pu marcher. Les villes avaient une faible
population par rapport aux campagnes. Il n'tait pas trs difficile de
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 117
les nourrir. On a fait durer assez longtemps le systme dit des ci-
seaux que l'on ouvrait et que l'on fermait tantt au profit des ou-
vriers, tantt l'avantage des paysans. Cependant, le moment inluc-
table est venu, celui o le paysan, matre de la terre, mais ne pouvant
jouir des fruits de son travail, n'a ensemenc que juste assez pour sa-
tisfaire ses propres besoins et a rsist farouchement aux rquisi-
tions.
C'est ainsi que, peu peu, la famine a gagn dans un pays qui, sauf
certaines rgions dshrites, tait jadis une terre d'abondance. Les
Soviets ont fait des efforts dsesprs dans tous les sens. Ils n'ont pas
pu se soustraire la loi commune qui est de manger et, pour manger,
d'acheter la nourriture. Pour avoir de l'argent, aprs avoir puis les
ressources que leur avait laisses le tsarisme et celles que leur avaient
donnes les spoliations, ils ont remis en train les exportations de p-
trole. Mais qu'ils paient au comptant ou crdit le bl qu'ils achtent
en ce moment-ci, il reste que la Russie, au lieu de contribuer l'ali-
mentation des autres peuples, vient maintenant chercher chez eux une
part de son pain, ce qui ne peut avoir d'autre effet que d'accrotre le
prix de la vie et des subsistances dans le monde aux dpens des tra-
vailleurs.
Mais, dit-on, cela ne peut plus durer. Le rgime sovitique touche
sa fin. Un effondrement conomique et financier le guette. Tel est,
effectivement, l'avis de personnes que l'on tient en gnral pour s-
rieuses, - jusqu' ce qu'elles tombent, par exemple, d'un avion. Cepen-
dant la Russie n'est pas un pays comme un autre. Aucun pays d'ail-
leurs n'est comme un autre. La Russie diffre de tous surtout par la
lenteur avec laquelle s'y accomplissent les vnements et par sa capa-
cit presque infinie de souffrir et de se priver. Comme le prouvent ses
propos, rapports par Caulaincourt et qui sont publis en ce moment
par M. le duc de La Force, Napolon se trompait encore sur les Russes
pendant la retraite de Moscou. Cet exemple doit rendre prudents les
faiseurs de pronostics avec dates l'appui.
L'Action franaise, 7 juillet 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 118
1.39
Nouvelles de Russie
L'Action franaise, 24 novembre 1928.
Retour la table des matires
Que les affaires des Soviets soient en mauvais tat, ce n'est pas un
conte. Les chefs bolchevistes eux-mmes l'avouent. Il circule en ce
moment des nouvelles tires de l'organe officiel, les Izvestia, et qui ne
laissent pas douter de l'impopularit du rgime communiste dans les
masses rurales de la Russie, c'est--dire dans le plus gros de la popula-
tion.
La question que l'on se pose est de savoir pourquoi Staline donne
cette publicit aux rvoltes paysannes, aux assassinats d'agents sovi-
tiques qui ont lieu chaque jour dans les villages. Rgulirement, on
accuse de ces meurtres politiques les koulaki, ou paysans riches .
Le plus pauvre de nos cultivateurs ne voudrait pas, d'ailleurs, manger
la soupe d'un koulak. Mais, pour tre class koulak, il suffit de ne pas
aimer le bolchevisme.
On suppose qu'en attirant l'attention sur ces incidents sanglants,
Staline se propose de dmontrer qu'il faut en finir avec le modran-
tisme. Ayant triomph de l'opposition de gauche, il rsiste l'opposi-
tion de droite. Il cherche la persuader qu'elle encourage des rbel-
lions, moins qu'il ne prpare contre elle des griefs et des armes. Car
il y a aussi un juste milieu sovitique, et dj Robespierre envoyait
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 119
tour tour, au tribunal rvolutionnaire, les exagrs et les mod-
rs.
Quand on y regarde de prs, on a, du reste, l'impression que les Iz-
vestia peuvent sans danger publier la liste des petites insurrections
locales. Les Russes, qui connaissent leur pays, ne les estimeront pas
trs dangereuses pour les Soviets. Par rapport la vaste superficie et
l'norme population de l'U.R.S.S., c'est peu prs comme, en France,
les accidents de la route par rapport aux automobiles en circulation.
Une carte de ces attentats villageois montrerait en outre qu'ils clatent
sur des points loigns les uns des autres de plusieurs centaines de
kilomtres, de sorte qu'il n'y a pas de mouvement d'ensemble et que
rien n'est plus facile que la rpression.
C'est ainsi dj que, sous les tsars, les soulvements taient rpri-
ms. La tentative de rvolution de 1905, qui fut grave, avorta parce
que l'incendie allum Saratov tait dj teint quand il clatait Vo-
logda et l'ordre rtabli Kharkov lorsque Perm commenait bouger.
Le tsarisme est tomb par l'effet d'une mobilisation excessive, par
l'inutile et dangereux entassement des hommes dans les casernes de
Saint-Ptersbourg. Aussi longtemps que les Soviets pourront compter
sur l'arme rouge et qu'ils n'auront pas leur rvolte des Strelitz, ce
n'est pas la paysannerie mcontente qui viendra bout du bolche-
visme. Il est mme probable que ce ne serait pas, lui seul, le peuple
de Moscou. L-bas comme ailleurs, pour que le pouvoir succombe, il
faudra des crosses en l'air.
L'Action franaise, 24 novembre 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 120
1.40
L'angoisse
La Libert, 18 fvrier 1929.
Retour la table des matires
IL y a dix ans et plus qu'on crit des articles sur la Russie, des li-
vres sur la Russie, des considrations sur la Russie et des enqutes sur
la Russie. Il y a eu, dans le nombre, normment de fatras de roman et
de bourrage de crne dans les deux sens, le communiste et l'autre.
Il y a eu aussi quelques tudes srieuses. En ce moment mme, M.
Ashmead-Bartlett poursuit dans le Daily Telegraph une srie de ta-
bleaux de la vie au pays sovitique qui semblent trs prs de la vrit.
Mais nous donnerions tous ces dossiers et toute cette littrature pour
un mot, un seul mot, que nous venons de lire.
C'est dans une lettre de Riga, signe Nediloff, et que nous avons
trouve dans la Nation Belge. Sans doute on a dat beaucoup de faus-
ses nouvelles de Riga. Mais il ne s'agit pas de nouvelles. Il s'agit d'une
impression rsume en huit lettres. Nediloff dit que, de l'avis gnral,
avis des voyageurs, avis des partisans comme des adversaires des So-
viets, avis des dirigeants sovitiques eux-mmes, ce qui domine en ce
moment l'U. R. S. S., c'est l'angoisse.
Mot frappant parce qu'il est, comme on disait autrefois, au temps
de Marie Bashkirthseff et de J ean Lorrain, trs russe . L'angoisse
est quelque chose de russe. Dostoevski est le puissant romancier de
l'angoisse. Et l'angoisse domine aussi les romans de Tolsto. Elle
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 121
treint Anna Karnine. Elle rgne tout le long de la Sonate Kreutzer.
Elle plante son drapeau noir , comme Baudelaire dit du spleen,
au-dessus des steppes, au-dessus des cits silencieuses et ouates de
neige. tre angoiss, c'est--dire se trouver dans un tat de crainte
mystrieuse, d'attente d'un malheur : il n'y a pas de pays o l'on
prouve avec plus d'intensit qu'en Russie ce sentiment indfini et in-
dfinissable.
On l'avait dans les derniers temps du rgime tsariste. Sans doute
les institutions n'avaient pas chang. Tout tait encore en place. Mais
il y avait un malaise, quelque chose de pesant pour les coeurs et d'op-
primant pour les esprits. On chuchotait des paroles tranges. On les
coupait de silences plus tranges encore. C'tait comme si des vne-
ments sinistres avaient rd autour de vous. L'angoisse, celle qui dut
s'appesantir sur Moscou en 1812, la veille du grand incendie, dura
longtemps avant la chute de Nicolas II, avant la tragdie pouvanta-
ble. Elle treint de nouveau le pays des Soviets. Ce qu'il est impossi-
ble de dire c'est encore ce qu'elle durera avant qu'arrive ce qu'on croit
pressentir.
La Russie est toujours russe, mme avec le bolchevisme. Et nous
finirons par une histoire plus gaie. J 'ai connu un homme de l-bas, un
homme aimable, un peu lger, qui n'tait pas fait pour les catastro-
phes. Lui, l'angoisse ne l'atteignait pas. Elle ne l'avait pas averti. Il
n'migra pas quand la rvolution survint et il fut pris dans la tour-
mente rvolutionnaire. Aprs le coup d'tat de Lnine, on le cueillit
un jour chez lui pour le jeter en prison. D'abord tourdi de cette aven-
ture, il reprit ses sens au bout de vingt-quatre heures et pensa :
Aprs tout, sous les bolcheviks, il ne doit pas y avoir plus d'ordre
qu'avant. Est-il sr que je sois vraiment enferm ? Il regarda la
porte. Il n'y avait qu' l'ouvrir. Il sortit tranquillement de la gele et
passa en Finlande. Ce Russe avait compt sur les caractres perma-
nents de son pays.
La Libert, 18 fvrier 1929.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 122
1.41
La thorie de l'accident
L'Action franaise, 19 mars 1929.
Retour la table des matires
ON a racont que les bolcheviks s'taient jur autrefois de ne pas
recommencer la faute des hommes de la Rvolution franaise et de ne
pas se combattre, se proscrire et se guillotiner entre eux. Ce serment
du Grutli partait d'une conception de l'histoire assez nave. Les hom-
mes de la Rvolution franaise se sont extermins dans un guignol
sanglant parce qu'ils s'en prenaient les uns aux autres des consquen-
ces d'une situation absurde. Les thermidoriens n'ont pas plus sauv la
Rpublique en supprimant Robespierre que Robespierre en suppri-
mant Danton et les dantonistes, Hbert et les hbertistes. Il arrive la
mme chose Staline et Trotsky.
Leur duel n'est pas celui de deux hommes, ni de deux partis, ni
mme de deux ides. Les bolcheviks en sont venus se quereller et
se battre entre eux parce qu'ils ont tent l'impossible, ce qui ne man-
que jamais d'engendrer les frnsies avant le dcouragement final.
Mme en Russie, et avec ce que la Russie avait d'asiate, le com-
munisme, quoi qu'on ait dit, n'tait ni naturel, ni fatal, pas plus que la
Rvolution russe n'tait ncessaire. On voit trs bien, par l'ouvrage
purement documentaire que publie M. Serge Oldenbourg (le Coup
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 123
d'tat bolcheviste) comment la Rvolution a clat puis comment L-
nine s'est empar du pouvoir, c'est--dire comment la Rvolution au-
rait pu ne pas clater, ou clater d'une faon diffrente et alors prendre
un autre cours et Lnine rester un thoricien obscur.
M. Serge Oldenbourg marque trs bien que, pour renverser le tsa-
risme, tout affaibli qu'il tait, il n'a pas seulement fallu une secousse
aussi violente que celle de la guerre europenne, mais encore la pr-
sence dans les casernes de Saint-Ptersbourg de quantits d'hommes
inutilement mobiliss et qui, travaills par le dfaitisme, ont cr le
milieu rvolutionnaire. Ce n'est pas la Douma, ce ne sont pas les
zemstvos, ce n'est pas Raspoutine qui ont fait le mal. Le principal au-
teur de la Rvolution russe est peut-tre M. Doumer qui avait obtenu
de Nicolas Il trop bon de gigantesques leves d'hommes, fort agra-
bles compter de loin et vues du front occidental, mais qui ne de-
vaient servir qu' acheminer la Russie vers la paix de Brest-Litovsk.
La rvolution ouverte, il a encore fallu Kerensky, puis le conflit de
Kornilof et de Kerensky pour fournir Lnine l'occasion de prendre le
pouvoir, qu'il n'avait d'ailleurs saisi que par un coup de force et aprs
des hsitations. On voit, dans le Coup d'tat bolcheviste, que tout,
certains moments, a tenu sept cents cosaques. C'est continuel dans
l'histoire de tous les pays. Du reste, on rapprochera utilement des do-
cuments runis par M. Serge Oldenbourg et qui, eux seuls, sont une
preuve en faveur de la thorie de l'accident , l'ouvrage, non moins
rcent et non moins intressant de M. Henry Laporte, le Premier
chec des rouges. Il s'agit de leur chec en Finlande, et c'est le rcit
des circonstances par lesquelles, aux portes mmes de la Russie sovi-
tique, les blancs finlandais reprirent Helsingfors aux communistes.
Il faut lire le chapitre que M. Henry Laporte a intitul : Une bour-
geoisie qui se dfend. On comprendra mieux pourquoi il n'y a pas,
dans la politique et dans l'histoire, d'vnements invitables, et pour-
quoi le rgime le plus absurde lui-mme, ft-il celui des Soviets, peut
se prolonger s'il ne commet pas de fautes trop grossires.
L'Action franaise, 19 mars 1929.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 124
1.42
Intelligentsia
La Libert, 23 octobre 1929.
Retour la table des matires
LA rvolution russe est ne dans les Universits. L'tudiant, l'tu-
diante taient, comme on disait alors, nihilistes. Et le gouvernement
tsariste avait beau faire, il avait beau proscrire les livres, caviarder les
journaux, envoyer en Sibrie les imprimeurs de presse clandestine, les
ides subversives faisaient leur chemin. Lorsqu'une bombe tait lan-
ce, il tait rare qu'on ne trouvt pas dans le complot une jeune intel-
lectuelle, fille d'un gnral et noble. Mais aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on dcouvre encore des organisations secrtes d'tu-
diants dans les Universits sovitiques. Les conjurs sont des fils
d'ouvriers, de commissaires du peuple, de fonctionnaires rouges, les
seuls qui soient admis l'enseignement suprieur, les enfants de bour-
geois tant privs de science. Et ces adolescents se livrent la critique
du bolchevisme comme les gnrations prcdentes se livraient la
critique du tsarisme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'on leur
cachait quelque chose et qu'on les obligeait penser d'une certaine
faon. C'est presque toujours par contradiction que la jeunesse adopte
des ides.
Alors l'intelligentsia russe commence se retourner contre le
communisme. Et la Pravda s'en dsole. Les vieux de la Rvolution ne
comprennent plus. Pour eux, c'est le monde renvers. C'est au
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 125
contraire le monde naturel. C'est le monde comme il va. Le Quartier
latin, Paris, tait rpublicain sous le second Empire. Les lves de
l'cole polytechnique avaient fait le coup de feu sur les barricades de
1830. Nous sommes bien loin de l... On s'est demand souvent com-
ment finirait et comment pourrirait le bolchevisme. Ce sera peut-tre
par la tte, comme le poisson, selon le proverbe qui a cours en Russie.
Quelles sont donc les lectures subversives qui passionnent, d'aprs
les rvlations indignes et attristes de la Pravda, les lves du Poly-
technicum de Tver et de celui de Viatka ?. Fatigus de la vrit dog-
matique qu'a rvle Karl Marx, pris de doutes sur le Coran de ce pro-
phte, les tudiants se sont mis penser que le monde des ides n'tait
pas enferm dans un livre. Ils aiment les philosophies, les systmes. Il
y a d'autres systmes que le marxisme. Ils ont voulu connatre le capi-
talisme qu'on leur cachait ou dont on ne leur prsentait que la carica-
ture. Ils ont voulu savoir. Damnable curiosit qui dsole la Pravda.
Science, c'est comparaison. Les intellectuels russes comparent
l'tat de leurs pays l'tat de pays qui ne sont pas en rgime commu-
niste. Et quel est l'exemple qui les frappe ? L'antithse des tats-Unis
o, dans l'panouissement du rgime capitaliste, dans la ngation et la
rfutation vivante de Karl Marx, le niveau de la vie est plus lev que
partout ailleurs, - ailleurs o des doses plus ou moins fortes de socia-
lisme ont t introduites dans les lois. Il parat qu'un des livres qui
font le plus de ravages dans l'intelligentsia, c'est celui du prsident
Hoover sur le rle de l'initiative individuelle dans le dveloppement
des tats-Unis. Ce livre n'tant pas autoris par la censure, on a ou-
vert une enqute pour dcouvrir comment il a pu pntrer en Russie.
Les bolcheviks s'aperoivent leur tour qu'il n'est frontires si bien
gardes que ne traverse l'esprit du sicle et ils avaient eu le tort de
croire qu'ils possdaient le monopole de cet esprit.
La Libert, 23 octobre 1929.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 126
1.43
Les lapins de Staline
La Libert, 7 octobre 1931.
Retour la table des matires
On connat les concessions que Staline a dj d faire aux ides
bourgeoises, c'est--dire la nature humaine. Il a rtabli le travail aux
pices et reconnu qu'il fallait donner chacun selon ses oeuvres si l'on
voulait du rendement. De l reconnatre que la proprit, rcom-
pense de l'effort et de l'pargne, est lgitime, il n'y a d'ailleurs qu'un
pas. En attendant, Staline s'est aperu que le brouet noir n'tait pas un
bon stimulant pour le succs du plan quinquennal. Il a dcid d'am-
liorer l'ordinaire des travailleurs et aussi de le varier.
Il a donc, conjointement avec Molotof, prsident du Soviet des
commissaires du peuple, annonc qu'un programme triennal allait tre
mis excution. Aprs quoi, les masses de l'U. R. S. S. auraient de la
viande, du poisson, des lgumes et des fruits. Les communistes fran-
ais seront sans doute assez tonns d'apprendre que les choses, qu'ils
ont l'habitude de trouver sur leur assiette, seront servies leurs frres
de Russie dans trois ans. S'ils se donnaient la peine de rflchir,
peut-tre prouveraient-ils aussi quelque surprise en lisant dans le
manifeste de Staline et de Molotof cette dcouverte que l'ouvrier qui
n'est pas bien nourri ne travaille pas bien. Et ce n'est pas tout.
Staline, comme on sait, est un ralisateur et un puissant cerveau. Il
concilie la doctrine avec les ncessits de la vie. Il a constat que les
produits de la campagne taient devenus rares, sinon inexistants de-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 127
puis que les paysans taient collectiviss. Alors, il a song une pro-
duction qui restt conforme aux principes communistes et il a eu un
trait de gnie. Quel est l'animal dou d'un esprit de masse plus caract-
ris que le lapin ? Il n'en est pas dont l'levage en grand soit mieux
indiqu. Les Soviets ont donc achet de vaillants reproducteurs qui
vont pulluler dans une ferme d'tat modle. On compte, en 1933, sur
700 000 kilogs de gibelotte, ce qui ne fera pas, mme avec de minus-
cules portions, le djeuner de 120 Millions de Russes.
Il y a l une indication qui n'est pas ngligeable. On a vu des
voyageurs, nullement bolcheviks, revenir de Russie remplis d'admira-
tion ou d'effroi, ce qui est peu prs la mme chose, par les rsultats
du plan quinquennal. Surtout, les kolkhoses, les organisations agrico-
les, leur semblaient promis un rendement redoutable pour les autres
pays. C'est possible. En tout cas, l'exemple des lapins de Staline mon-
tre que ce genre de production ne s'adresse qu' des sries en grand,
tout ce qui se conoit sur le modle de l'usine, mais exclut ce qui
s'labore dans l'atelier de l'artisan ingnieux, dans le potager ou dans
le jardin du maracher et du ppiniriste. Il exclut tout ce qui est per-
sonnel, tout ce qui fait la varit des menus et de l'existence.
On songe ce que dit M. Georges Duhamel de l'Amrique o, par
la rationalisation, il n'est plus possible de manger qu'une seule espce
de poire. Il y a, d'ailleurs, une parent entre ces deux manires d'abou-
tir l'uniformit et au gigantesque. Et la manie du colossal n'est-elle
pas une des causes du mal dont le monde est atteint en ce moment
comme elle a t une des causes de la chute de l'Empire allemand ?
Superposition de milliards, superposition de crdits, tout cela ressem-
ble l'entreprise d'levage de Staline. On n'avait oubli qu'une chose,
la maladie des lapins. Et les banques reproductrices sont en train de
crever.
La Libert, 7 octobre 1931.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 128
1.44
Illusions sur la Russie
La Libert, 30 dcembre 1931.
Retour la table des matires
La Russie, il y a trois sicles, tait un pays ignor, aussi lointain,
aussi fabuleux que la Chine. Par la Pologne on connaissait l'Ukraine.
Au moyen ge (o l'on tait plus europen qu'aujourd'hui), un Ca-
ptien avait mme pous la fille du grand-duc de Kiev. Mais la Mos-
covie restait mystrieuse. Un soldat de fortune, le capitaine Margaret,
qui s'tait engag au service de Boris Godounof (c'tait au temps de
notre Henri IV), raconta ses aventures et ses souvenirs comme s'il ft
all au Thibet. La Russie ne fut vraiment rvle aux Franais qu'un
sicle plus tard, lorsque Pierre le Grand vint Paris.
On l'y reut comme un phnomne, comme une bte curieuse.
Avec lui, la lgende russe naissait. Le tsar tait une espce de bon
sauvage, d'homme de la nature qui recommenait la socit et prenait
la civilisation ce qu'elle avait de meilleur - comme Lnine. On disait
bien aussi que son gouvernement tait un peu rude. Mais il coupait
des ttes dans une gnreuse intention. Il incarna, et la grande Cathe-
rine, qui d'ailleurs tait Allemande, incarna aprs lui le despotisme
clair . On rpta, par flatterie et par snobisme : C'est du Nord,
aujourd'hui, que nous vient la lumire. Cette illusion a dur. Elle a
grandi avec le bolchevisme.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 129
Si ce n'tait pas si loin, dans un pays trange, dans une sorte de
Chine qui touche l'Europe, on verrait le bolchevisme tel qu'il est,
c'est--dire comme un des tats les plus tristes o puisse tomber l'hu-
manit. Mais il y a au coeur des Franais les plus sdentaires et les
plus terriens un certain romanesque par lequel ils voient en beau tout
ce qui est loin. Ainsi, le socialisme australien a paru comme une idylle
jusqu' ce que l'Australie ft en faillite. Ce romanesque est le mme
qui avait jet nos bourgeois dans les placements exotiques. On et,
nagure, lanc un emprunt d'Honolulu qu'il et trouv preneurs.
Comment tout ne serait-il pas trs joli Honolulu ? Comment le bol-
chevisme n'aurait-il pas son charme ?
On savait vaguement l'histoire des villages en carton peint que Po-
temkine montrait sa marraine. On savait moins que le marquis de
Custine, visitant l'empire des tsars sous le rgne de Nicolas 1er, avait
dj crit cette phrase lapidaire : En Russie, on voit tout ce qu'on
veut bien vous montrer. Des voyageurs enthousiastes et nafs sont
alls dans la Russie des Soviets. Ils y ont vu ce que leur montraient
des guides qui les prenaient la descente du train et ne les quittaient
plus qu'aprs la promenade rituelle sur la Volga... Aprs l'illusion,
aprs le roman, la vrit. Le numro de J e suis partout, entirement
consacr aux Soviets, remet objectivement les choses au point.
Il tait temps. Le Quai d'Orsay a prpar un pacte avec Staline. Le
plan quinquennal lui-mme a abus. Cette amricanisation force de
la Russie, une amricanisation avec des principes collectivistes et des
capitaux bourgeois, a fait des dupes. Cependant, jadis, c'tait qui
mdirait de la bureaucratie tsariste du tchin ( la seule chose de bien
que nous avons en Russie, disait pourtant Dostoevski), qui avait
peu prs polic cette sixime partie du monde. Les bureaucrates aux
casquettes multicolores taient souvent trop sensibles aux agrments
du rouble. Mais ils faisaient marcher les trains de Gumbinnen Vla-
divostock. Les trains, aujourd'hui, marchent mal sur des voies cons-
truites avec de l'argent franais. Quant aux roubles, voil longtemps
que, pour personne, il n'y en a plus.
La Libert, 30 dcembre 1931.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 130
1.45
Vive la Russie !
L'Action franaise, 23 fvrier 1933.
Retour la table des matires
M. douard Herriot, prsident de la commission des Affaires
trangres la Chambre, c'est--dire dsign pour occuper le Quai
d'Orsay demain comme il l'occupait hier, vient de publier dans le Petit
Provenal les lignes suivantes qu'on lira sans tre oblig de partager la
joie de l'auteur :
J'ai souvent signal ici des indices inquitants. Cette fois, je veux
observer avec joie les ractions provoques par l'excs de certaines
audaces. Le pacte de la Petite-Entente, le rapprochement franco-russe
procdent l'un et l'autre des mmes raisons. Il n'est pas interdit de
penser que les carts des nationalistes allemands provoqueront, bien
mieux que des procds plus sournois, LA CONTRE-ATTAQUE DE
LA DMOCRATIE ET DU SOCIALISME.
Vous avez bien lu. Il y a rapprochement franco-russe . Nous ne
nous tions pas tromp. On y revient. Le pacte avec les Soviets an-
nonce une visite de l'amiral Avellane avec quelques drapeaux rouges,
une revue de Btheny et une rception Compigne.
Si l'illusion de l'alliance russe est tenace, l'quilibre est un besoin.
Seulement, il est craindre que M. Herriot ne parte de cette ide que
les Soviets ont rompu, rompent ou rompront avec l'Allemagne du
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 131
chancelier Hitler, ce qui n'est pas dmontr. C'est mme une hypo-
thse qui vaut tout juste celle qu'avait faite Guillaume Il quand il es-
sayait, en invoquant l'intrt commun des trnes, de dtacher Nicolas
Il des athes et des rgicides de la Rpublique franaise.
J e ne donne pas cher de la nouvelle alliance avec l'U.R.S.S. rebap-
tise Russie. Quant une ligue des dmocraties socialistes contre les
fascismes (ligue o M. Herriot engage le roi Alexandre et le roi Ca-
rol), c'est un simple rve, ou bien, si c'est srieux, la contre-attaque
veut dire la guerre.
Alors, cette fois, c'est peut-tre un tsar qui signera une paix spare
Brest-Litovsk.
L'Action franaise, 23 fvrier 1933.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 132
1.46
Grande alliance
L'Action franaise, 15 dcembre 1934.
Retour la table des matires
CEUX qui, durant la guerre, traitaient les Allemands de Huns, de
barbares et de boches taient des amoureux dus qui se sont hts de
retourner leurs premires amours. Il arrive avec les Russes ce qui
s'est pass pour les Borusses. On n'a tant parl de Gupou et de
Tchka que pour n'en plus souffler mot. On voulait aller au Kremlin
pour y enfumer les tyrans bolcheviks et l'on y va pour signer avec eux
des accords. Si les plus exalts n'avaient t retenus, ils nous auraient
lancs dans une expdition de Moscou. C'et t la manire de Na-
polon inconsolable d'avoir perdu l'amiti d'Alexandre.
Nous avons celle de Staline. Ressusciter l'alliance avec la Russie,
c'tait l qu'on voulait en venir. La rvolution internationale, la propa-
gande communiste, le pril rouge aux colonies, il n'en est pas plus
question que si toutes ces horreurs n'avaient jamais exist. Ne se di-
saient-elles que par dpit ?
La pire horreur est peut-tre le changement des habitudes. Celle de
la Russie amie et allie est reprise. Et nous n'avons pas fini d'entendre
chanter la palinodie. Qui fait maintenant grise mine aux Soviets mal-
gr le Front commun ? Lon Blum. Il a protest contre les excutions
en masse qui ont suivi l'assassinat de Rykof et qui n'ont pas mu un
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 133
instant la presse bien pensante. Tout cela se passe entre gens d'autre-
fois avec leurs vieux souvenirs. Si J aurs tait encore de ce monde, il
serait repris de son aversion pour le pays des moujiks.
Et peut-tre, aprs avoir jet feu et flamme contre Hitler, commen-
cerait-il admettre une attitude plus ouverte l'gard de l'Allema-
gne hitlrienne. Plus ouverte, c'est--dire sans doute plus intelligente.
C'est ce qu'un journaliste nazi croit discerner chez Lon Blum et le
compliment qu'il lui adresse.
Qu'y a-t-il donc de srieux dans ces renversements de sympathies
et d'alliances ? Que fait ici la politique ? Et qu'y fait le raisonnement ?
Un de nos confrres, chaleureux partisan du demi-cercle oriental,
expose que le systme de la France et de la Petite-Entente reli
Moscou et Ankara forme un bloc assez fort pour peser sur l'Angle-
terre et sur l'Italie et les amener cette grande alliance . J e crains
que Pertinax ne voie un peu grand . Il crit : Auprs des tats
slaves de l'Europe centrale et de l'Europe orientale, la Russie reprend
peu peu son rle d'avant-guerre. Ce retour au pass ne rassurera
pas tout le monde et pourrait produire plus de rpulsion que d'attrac-
tion.
Pertinax dit encore : Ou nous traiterons avec les cinq pays, ou,
les uns entranant les autres, ils s'en iront au loin. Pour prendre la d-
cision, nous avons devant nous quelques semaines ou quelques mois.
En fait, de la France la Russie sovitique, une chane de contrats est
dj tendue. Il s'agit d'en rgulariser, d'en assembler les anneaux. Ces
phrases ne sont pas crites l'aventure, mais aprs des entretiens rp-
ts avec la plupart des intresss. Prenez garde, l'occasion passe-
ra ! nous disait, l'autre jour, Genve, le plus ancien, le plus dvou
de nos amis. Il doit s'agir de M. Titulesco, et ce n'est pas lui qui nous
inquite, ce n'est pas son jugement, qui est bon. C'est le mot dont il se
sert.
Qu'est-ce qu'un systme d'alliances qui se prsente comme une
occasion saisir ? Pour qu'une alliance soit solide, il faut qu'elle
repose sur la conformit des intrts et cette conformit ne dpend pas
de l'heure qui passe. Elle est permanente ou elle n'est pas. L'ancienne
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 134
alliance russe, qu'on ne doit pas trop vanter et dont on ne doit pas trop
mdire, avait mis prs de dix-sept ans (1875-1892) germer et se
conclure. Mais ce qui est ferme est toujours l'oeuvre du temps.
L'Action franaise, 15 dcembre 1934.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 135
1.47
Toujours l'alliance russe
L'Action franaise, 12 fvrier 1935.
Retour la table des matires
EST-CE la France qui tient l'alliance sovitique ou l'alliance sovi-
tique qui tient la France ? Les partisans du nouveau Vive la Rus-
sie ! soutiennent que nous sommes engags par le protocole du 5
dcembre et que Litvinof a notre signature. Ils nous disent aussi que la
force et l'autorit de la politique franaise ont beaucoup grandi depuis
que nous avons retrouv les allis russes sous un autre drapeau.
quoi serviront-ils ? Dans quelles circonstances, par quels
moyens et en quels lieux peuvent-ils nous aider ? Ces questions re-
viennent trs exactement demander d'abord ce que vaut l'arme so-
vitique et si l'on peut attendre d'elle la mme diversion qu'en 1914.
Mais les Soviets feraient-ils la guerre fond pour nous ? La fe-
rions-nous pour les Soviets ? Voil encore deux points d'interrogation,
et ils sont de taille.
Enfin, nous pouvons faire que le phnix de l'alliance russe renaisse
des cendres de Brest-Litovsk. Trois fois en moins de deux sicles et
demi nous avons t les allis de la Russie, sous Louis XV, sous Na-
polon, sous la troisime Rpublique, et trois fois la Russie a fait d-
fection. Et les Russes, cette fois, fussent-ils plus fidles, que nous ne
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 136
pourrions empcher une chose. C'est que la Pologne est ressuscite
aussi.
Sa rsurrection est antrieure au renouvellement de la bonne en-
tente entre Paris et Moscou. Mais ds que la France a fait un pas vers
les Soviets, l'oiseau polonais s'est envol. L'arme polonaise tait-elle
quantit ngligeable quand la Pologne tait notre amie ou bien a-t-elle
cess de compter depuis que, de Pilsudski, Hitler peut dire : Mon
cousin de Varsovie ?
On ne nous promet plus que l'arme rouge passera sur le corps de
la Pologne pour arriver plus vite trois tapes de Berlin. Mais elle
pourrait arriver chez les amis de la Petite-Entente qui logent dans son
voisinage. Elle porterait secours la Tchcoslovaquie et la Rouma-
nie. Trs bien, mais ensuite en sortirait-elle ? De tout temps, l'alliance
de la Russie a prt en France des mirages.
L'Action franaise, 12 fvrier 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 137
1.48
Encore un belliciste
L'Action franaise, 13 fvrier 1935.
Retour la table des matires
IL vaut mieux entendre certaines choses que d'tre sourd et les lire
que d'tre aveugle.
L'Europe nouvelle du 9 fvrier publie un article du dput Vinot
intitul : 1912-1935, deux alliances russes. J e passe quelques propos
l'usage de l'lecteur et au niveau des lus sur les adversaires d'une al-
liance avec les Soviets qui taient, parat-il, les partisans d'une alliance
avec le tsar, alors que l'on faisait des rserves toute alliance avec la
Russie dans un journal que je n'ai pas besoin de dsigner plus claire-
ment.
La thse de M. Pierre Vinot, c'est qu'une entente politique et mili-
taire entre la France et l'U.R.S.S. mne la guerre tout droit, pour la
raison excellente que l'U.R.S.S. se rapproche de la France cause des
craintes que l'Allemagne hitlrienne lui inspire et parce que le gouver-
nement sovitique regarde un conflit avec l'Allemagne comme invi-
table.
J e ne dis pas que M. Pierre Vinot ait tort. J e ne suis pas sr non
plus que son explication soit suffisante. Mais il est certain que la poli-
tique franaise doit se mfier des complications o peut l'entraner la
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 138
nouvelle alliance russe et dont la premire se manifeste par l'entente
de la Pologne et de l'Allemagne.
Cela tant, on est abasourdi de lire, sous la plume du mme auteur
et dans le mme article, ces lignes belliqueuses : J e n'insisterai pas
non plus sur les consquences que cette menace (du Reich hitlrien
aux Soviets) entrane pour la France et sur l'impossibilit, pour nous,
de laisser l'Allemagne libre de remporter contre la Russie une victoire
qui la restaurerait en Europe dans sa prminence et son hgmonie
d'avant-guerre.
J e me frotte les yeux. Que veut cet crivain politique ? Que nous
fassions une guerre d'quilibre ? Sans doute, puisqu'un peu plus loin il
prcise ainsi sa pense : J 'ai dj indiqu que je ne concevais pas
que la France puisse laisser attaquer la Russie ou porter atteinte, d'une
manire quelconque, l'intgrit du territoire de l'U.R.S.S. sans pr-
ter secours celle-ci.
En avant pour Dieu, pour le tsar, pour la patrie. Nous y revenons
mme avec M. Pierre Vinot, ennemi de l'alliance russe, seconde di-
tion. Alors, qui se fier pour avoir la paix ? C'est dsolant !
L'Action franaise, 13 fvrier 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 139
1.49
Une aventure dangereuse
L'Action franaise, 14 Avril 1935.
Retour la table des matires
LE 9 avril, un accord a t sign Paris entre le gouvernement
franais et l'ambassadeur de l'U.R.S.S. Il n'y a pas se dissimuler que
c'est la prface d'un renouvellement de l'alliance avec la Russie, si ce
n'est dj le renouvellement de l'alliance elle-mme, clauses militaires
comprises. Nous entrons dans une aventure. Si l'on veut connatre le
chemin par lequel viendra la guerre, le voil.
Sur les services que les Soviets peuvent rendre la France en cas
de pril, Hitler est difi. Il en sait encore plus que nous. Et s'il attend
l'occasion d'un casus belli qui lui permettra, le jour venu, de rejeter
sur la France la qualit d'agresseur, elle lui est promise.
L'Action franaise, 14 Avril 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 140
1.50
La nouvelle alliance
La Libert, 4 Mai 1935.
Retour la table des matires
Nous avons un alli de plus et, du coup, Litvinov est promu Excel-
lence. Voil que nous allons assister aux recommencements de la
vieille alliance avec la Russie. Est-il donc vrai que l'on revienne tou-
jours ses premires amours ?
Les Franais connaissent la Russie des Soviets aussi mal qu'ils
connaissaient la Russie des tsars. Cette ignorance est un attrait. On n'y
peut rien. Il y a chez le Franais, bourgeois, ouvrier, paysan, politi-
cien, un petit coin de romanesque ternellement accessible au charme
slave. Napolon lui-mme y avait succomb. Ce qu'il allait chercher
Moscou, c'tait l'amiti d'Alexandre, un renouveau des embrassades
sur le radeau de Tilsitt. On veut aussi un renouveau de l'hymne Bog
tsara Krani.
La rvolution communiste triomphant dans tout autre pays que ce-
lui de Boris Godounov et d'Anna Karnine n'et jamais produit le
mme effet parce qu'elle n'et pas possd la mme qualit de mys-
tre. Les rvolutionnaires de chez nous reoivent volontiers le mot
d'ordre venu du Kremlin parce que cela fait image comme une affiche
de voyage lointain dans une gare de banlieue.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 141
De mme l'pargnant d'autrefois souscrivait aux obligations de la
Banque foncire de la Noblesse sans savoir le moins du monde ce que
c'tait, mais avec un vague souvenir du gnral Durakine et l'impres-
sion de s'associer une bonne oeuvre de Tolsto.
Rsurrection ! L'alliance russe recommence avec les illusions de
l'ternel roman russe qui prend successivement toutes les formes et
repasse par le mme cycle.
Nous nous retrouvons les allis de la Russie, tels qu'il y a trente-
cinq ans lorsque le tsar et la tsarine taient acclams Paris. Les Fran-
ais et leurs ministres ont-ils, depuis ce temps-l, fait des progrs en
histoire et en gographie ?
Nous en doutons. Les signataires du pacte de Son Excellence Lit-
vinov ont oubli que nos alliances avec le grand pays de l'Est ont tou-
jours fini par une dfection. Et nous croyons, ou plutt nous sommes
sr, qu'il n'y a pas un Franais sur mille qui soit capable de dessiner le
croquis le plus gauche et le plus sommaire des frontires de la Russie
et des pays qui l'avoisinent...
La Libert, 4 Mai 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 142
1.51
L'Occident et l'Orient
L'Action franaise, 19 mai 1935.
Retour la table des matires
L'HOMME d'une intelligence si vive qui est ministre des affaires
trangres Prague depuis dix-sept ans bientt a pass ces temps-ci
par de grandes perplexits. Il avait toujours travaill assurer son
pays une sorte de neutralit et lui procurer l'immunit l'gard de
l'Allemagne. Il rvait mme d'tre comme un intercesseur ou un cour-
tier entre Paris et Berlin. Il a d opter. La Tchco-Slovaquie devient
un maillon de chane qui, depuis l'alliance avec Moscou, lie la France
aux obscures destines du slavisme.
Le mot d'ordre est de dire que le nouveau systme militaire et di-
plomatique prserve et garantit la stabilit de l'Europe. Le Ceske Slo-
vo, propre organe de M. Bens, crit : L'Occident et l'Orient se don-
nent la main, par la Tchco-Slovaquie, pour assurer l'ordre et la tran-
quillit en Europe. La conception franaise de la consolidation de la
paix enregistre donc un nouveau succs. A notre got, c'est trop
pompeux. Et c'est trop beau.
Peut-tre ces deux phrases sont-elles du genre de celles qu'il
convient de retenir, de dcouper et d'pingler pour les comparer aux
vnements futurs ou prochains. L'histoire est remplie de ces monu-
ments de l'illusion et de l'erreur humaines.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 143
Le nouveau systme qui nous rassocie au slavisme, mais dans des
conditions plus troites, plus compliques et plus obscures qu'avant
1914, garantit la paix moins qu'il ne provoque la guerre. Il intimide
l'Allemagne moins qu'il ne l'excite et ne lui donne des prtextes pour
rompre l'encerclement .
Le pacte que la Tchco-Slovaquie vient de conclure son tour
avec les Soviets contient cette clause trange. L'U.R.S.S. sera tenue de
prter assistance aux Tchques au cas o dj la France les assisterait.
Est-ce une prcaution ? Est-ce un engrenage ? Agrable vision de
l'avenir o, sur les champs de bataille de la Bohme, l'Occident et
l'Orient se donneront la main .
L'Action franaise, 19 mai 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 144
1.52
La ratification de l'alliance
avec les Soviets
L'Action franaise, 14 novembre 1935.
Retour la table des matires
UN accord politique avec une puissance trangre n'a pas besoin
d'tre approuv par le Parlement. C'est le prsident de la Rpublique
qui ngocie et ratifie les traits autres que ceux de paix ou de com-
merce et sauf les exceptions que l'on connat. Les traits d'alliance,
qui le secret est utile quand les alliances sont bonnes, ne font donc
pas, d'ordinaire, l'objet d'un dbat public. Il en va autrement pour l'ac-
cord avec les Soviets, sans doute parce qu'il touche des droits appar-
tenant des Franais. En somme, c'est une chance que cet accord sca-
breux, aventureux, prilleux soit soumis la discussion publique.
Pourquoi en parle-t-on si peu ? Pourquoi ne prpare-t-on pas mieux
ce dbat ? Pourquoi n'claire-t-on pas mieux l'opinion ?
La vieille alliance russe renouvele avec Staline est pourtant ce que
l'on peut dcider de plus grave, ce qui engage le plus profondment
notre avenir. Nous n'avons pas le droit d'oublier que la guerre de 1914
nous est venue sous le prtexte de notre alliance avec la Russie et par
le dtour de la Serbie. L'alliance nouvelle est de nature nous jeter
bien plus directement dans un conflit qui ne serait plus seulement ce-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 145
lui du germanisme et du slavisme, mais celui du communisme et du
nationalisme hitlrien.
Les socialistes d'autrefois se plaignaient des interventions du tsa-
risme dans notre politique. C'tait une des spcialits de J aurs. Que
dire aujourd'hui ! Notre politique est sous l'influence moscovite par
une multitude de canaux et aussi de procds dont le plus grossier
consiste ranimer l'illusion du gant russe et flatter chez les Fran-
ais, toujours sensibles leur infriorit numrique, l'ide qu'il y a
l-bas, sous les neiges, un inpuisable rservoir d'hommes pour nous
prserver de la trop fconde Germanie.
De ces procds, le plus habile, de la part des diplomates bolche-
viks, est de dissimuler leurs intentions vritables, de ne pas laisser en-
trevoir les rsultats qu'ils cherchent, de ne pas dcouvrir leur action.
Dans l'affaire des sanctions, ils ont t les plus acharns contre Mus-
solini et ils sont rests dans l'ombre o ils pesaient de toutes leurs for-
ces sur nos slavophiles de gauche et de droite. La masse du public
franais s'y est, notre sens, trompe. Elle a dit : Angleterre,
quand il aurait fallu dire : Russie.
Cependant, et fussions-nous cent fois plus prts suivre la politi-
que britannique dans le cas de l'Italie, l'Angleterre garde toujours la
mme mfiance l'gard de toute entente et de tout pacte qui seraient
capables de l'entraner notre suite dans les conflits de l'Europe orien-
tale, comme nous nous exposons y tre entrans nous-mmes par
une alliance avec les Soviets.
Les combinaisons politiques, depuis quelques mois, en sont arri-
ves un degr de complexit tel que tout est devenu possible, insta-
ble, indfinissable et mme impalpable. La ruse fline et savante des
Asiatiques qui rgnent au Kremlin n'en est pas seule cause. Il a fallu,
pour qu'elle ft aussi efficace, qu'elle rencontrt une dose gale de
navet chez une partie des Franais.
L'Action franaise, 14 novembre 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 146
1.53
Entre Hitler et Staline
L'Action franaise, 23 novembre 1935.
Retour la table des matires
CONFLITS du communisme et du nationalisme socialiste, conflits
du germanisme et du slavisme, voil ce que nous avons viter. Hitler
aimerait nous lancer contre Staline et Staline contre Hitler. Chacun
des deux dictateurs se dispute la France. Chacun des deux appuie sur
elle comme sur un ludion. Si l'on aime mieux, notre pays ressemble
l'homme tirant sur le grison et qui avait deux matresses, dont l'une
lui arrachait les cheveux blancs, l'autre les cheveux noirs.
Staline et son subtil Litvinof sont d'ailleurs les mieux placs pour
nous mener o il leur convient. Ils ont ce qui manque Hitler, une
prise directe sur notre politique par le Front populaire et tout un en-
semble de naves sympathies qui vont de ceux que les simples mots de
rvolution et de socit nouvelle patent toujours jusqu'aux conserva-
teurs aussi frus d'alliance russe, malgr tant de dboires, que Napo-
lon, lequel s'enfona jusqu'au coeur de la Russie pour retrouver celui
d'Alexandre.
L'Action franaise, 23 novembre 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 147
1.54
L'alliance aventureuse
L'Action franaise, 30 novembre 1935.
Retour la table des matires
LES services que la Russie peut nous rendre en cas de pril (tant
donn que la seule alliance que l'on conoive serait dfensive), on
nous en parle trs peu. Le plus srieux des arguments favorables est
que les pays de la Petite Entente seraient, en cas de guerre, ravitaills
par les Russes. C'est accorder beaucoup aux capacits de production et
de transport de l'administration communiste. Quant au concours de
l'arme rouge, il est problmatique. D'autre part, il semble peu dsira-
ble pour les principaux intresss. M. Georges Bratiano demandait
l'autre jour ce qui arriverait le jour o la Roumanie aurait accueilli
chez elle les soldats bolcheviks. Il y a des Roumains qui se souvien-
nent des fcheux prcdents, ceux de la guerre russo-turque, ceux de
la guerre europenne, o ils se sont livrs pieds et poings lis aux
tranges amis qui leur venaient du nord.
Quant nous, il s'agit avant tout de savoir quoi nous engage,
nous expose, nous entrane une alliance avec le pouvoir de Moscou.
La Russie du tsar, la Russie qui avait ses bureaux Saint-
Ptersbourg, tait sre, mais ne l'tait pas tous les moments, Une
partie du tchin tait allemande d'origine et de tradition. Une autre tait
panslaviste. Nous avions redouter et les dfections et les excitations.
Encore, d'une faon gnrale, la diplomatie tsariste dont Sazonof fut le
dernier reprsentant tait-elle sre la fois et prudente. Elle annula la
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 148
faiblesse de Nicolas II aprs son entrevue de Bjorkoe avec Guillaume
Il. Elle temprait ceux de ses agents qui poussaient les pays slaves la
guerre.
Le nouveau gouvernement autocratique de Moscou ne nous donne
aucun gard les mmes garanties. Il est encore plus byzantin. Sa
bonne foi est suspecte : hier encore l'insurrection communiste du Br-
sil rvlait son action. Surtout il est aventureux. Il l'est par nature. Hi-
tler, de son ct, ne l'est pas moins. Staline et lui font la paire. L'un et
l'autre, ils seraient enchants de nous entraner dans leur orbite, et nul
ne sait, pas mme eux, o elle conduit les dtenteurs d'une puissance
aussi anormale Berlin qu' Moscou. Le mieux sera de nous tenir
gale distance de ces inquitants mtores.
L'Action franaise, 30 novembre 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 149
1.55
Enrags et possds
L'Action franaise, 11 dcembre 1935.
Retour la table des matires
Pendant ce temps, les rapports entre la Sovitie et l'Hitlrie se ten-
dent un peu plus tous les jours. Ils deviennent mme dangereusement
tendus.
Et par ce temps , nous ne voulons pas parler seulement de celui
o chaque jour qui n'est pas gagn pour la proscription des mesures de
rigueur et de blocus contre l'Italie est perdu pour la sret de l'Europe
et pour la sret des puissances europennes qui ont des possessions
en Asie, sujet grave sur lequel nous reviendrons. Ce temps est aussi
celui o, dans le silence et l'ombre, se prparent la ratification, l'appli-
cation et l'entre en vigueur de l'alliance avec les Soviets.
Alliance dangereuse, alliance surprises, alliance explosions.
Ceux qui l'acceptent comme ceux qui la prnent savent-ils tous ce
qu'ils font ? Au mains faut-il mettre sous les yeux du public ce qu'on
ne s'empresse pas de lui faire connatre dans le dossier de la suspicion
rciproque qui grandit entre Moscou et Berlin.
Comme on devait s'y attendre, l'Allemagne, l'ide d'une conjonc-
tion de la France et de l'U.R.S.S., se croit menace et menace. Les di-
rigeants du sovitisme, qui ont peur du national-socialisme, s'enhar-
dissent l'ide que les Franais seront l pour se battre cette pre-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 150
mire ligne qui est sur le Rhin, l'Allemagne devant plus que jamais
chercher rompre l'encerclement du ct de l'Ouest depuis qu'elle
n'a plus de frontire commune avec la Russie. Que risquent les hom-
mes de Moscou souffler sur le feu ?
Et ils soufflent. Une revue de la presse sovitique que nous trou-
vons dans le Bulletin quotidien montre que les rcentes dclarations
de Hitler ont provoqu une irritation violente Moscou et donn une
nouvelle impulsion la campagne contre le fascisme allemand . En
guise de spcimen, il faut lire ce passage d'un article des Izvestia :
L'opinion publique sovitique, s'appuyant sur sa volont de paix,
sur la force de l'arme rouge et les sympathies des amis de la paix au-
del de ses frontires, surveille de prs la nouvelle explosion de pas-
sions imprialistes du fascisme allemand. L'opinion publique soviti-
que pourra dire : Vous voulez les mains libres ? Mais, primo, les
mains qui tranglent le grand peuple allemand ne peuvent tre libres ;
secundo, vos mains sont trop courtes ; tertio, si vous tentez de fourrer
votre groin dans notre potager, vous recevrez sur les mains un coup
qui vous tera toute envie de recommencer.
Ici le ton fait la musique. Mais qui doit danser ? Les amis de la
paix au-del des frontires sur lesquels on compte Moscou, c'est
nous. On nous attend. On nous charge de mettre Hitler au pas. Telles
sont les conditions dans lesquelles nous allons nous engager envers un
pouvoir anormal en conflit avec un autre pouvoir non moins anormal
que lui, alors que nous devons nous tenir le plus loin possible de ces
enrags et de ces possds , comme les appelait Dostoevski.
L'Action franaise, 11 dcembre 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 151
1.56
Chacun son Sadowa
L'Action franaise, 17 dcembre 1935.
Retour la table des matires
TOUTES les thses sont interchangeables et les partis, tour tour,
ne se font pas faute de se les emprunter, ce qui affermit les sages dans
leur ddain des vaines opinions. Hier, l'anglophobie tait droite. De-
puis que M. Baldwin et sir Samuel Hoare sont d'accord avec M. Pierre
Laval, elle repasse gauche.
Mme jeu pour l'alliance avec la Russie dont les adeptes se sont
mis chanter le grand air de l'quilibre europen et rpter : Sa-
dowa ! Sadowa !
On dirait que Sadowa a t jadis une dfaite de la Russie et que la
faute de Napolon III ait consist permettre Bismarck de battre les
Russes. D'ailleurs, il n'est pas sr que beaucoup de ceux qui sadowi-
sent en ce moment sur le mode le plus lugubre ne croient pas qu'en
effet ce champ de bataille au nom slave ne se soit trouv moins prs
de Vienne que de sa rime Poltava. Dites donc Koeniggraetz. Vous vi-
terez quelques confusions.
J aurs, jadis, selon ce qui tait alors l'opinion des gauches, ne re-
prochait qu'une chose Napolon III. C'tait de ne pas avoir persist
dans l'abstention et de ne pas avoir favoris jusqu'au bout l'unit alle-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 152
mande. De plus, au dbut du second Empire, toutes les gauches, Mi-
chelet tant chef de choeur, avaient acclam le nouvel empereur parce
qu'il envoyait nos soldats en Crime contre le tsar tyran, vampire ,
et cela d'accord avec l'Angleterre.
Le tsar se vengea en 1870 par sa neutralit. Au surplus, si Napo-
lon III tira l'pe contre la Russie, il n'eut jamais l'occasion de la tirer
pour elle.
L'exemple de Sadowa ne s'applique ici ni dans le particulier ni
dans le gnral. La Prusse victorieuse au centre de l'Europe, cela n'a
pas le mme sens que l'Allemagne victorieuse l'est de l'Europe, c'est-
-dire que cela en a beaucoup plus. Et jamais les principes de notre
politique ne nous ont command de nous mler des guerres de la Rus-
sie.
Ou bien, alors, il et fallu, il y a trente ans, que la France vnt en
aide son alli russe alors aux prises avec le J apon. On n'y pensa pas.
Les auteurs du trait d'alliance n'y avaient mme pens que pour ex-
clure formellement l'hypothse d'une intervention hors d'Europe.
Pourtant, il peut y avoir aussi des Sadowa aux extrmits de la Sib-
rie. Mais, moins d'tre prt guerroyer partout, comme au service de
la S. D. N., mme entre les Sadowa il faut bien choisir.
L'Action franaise, 17 dcembre 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 153
1.57
Pas de choix entre deux alliances
L'Action franaise, 2 janvier 1936.
Retour la table des matires
LES rcidivistes et relaps de l'alliance avec le gant de l'Est
prtendent que, si la politique franaise ne noue pas de liens avec
Moscou, elle sera conduite en nouer avec Berlin. Cette alternative
n'est pas ncessaire. Elle est purement artificielle. Qui nous oblige
choisir ?
Hitler, il est vrai, fait savoir que si la France s'allie avec les So-
viets, elle s'interdit toute entente avec l'Allemagne. Nous ne lui de-
mandons son avis ni pour signer un pacte avec l'U.R.S.S. ni pour n'en
pas signer. Cela ne regarde que nous.
Et c'est pour ne nous mler que des affaires qui nous regardent que
nous ne devons pas contracter d'engagements politiques et militaires
avec la Russie. Ainsi, justement, nous nous conduirons l'exemple de
Londres et l'instar des Anglais.
Il est facile de discerner, depuis quelque temps, les symptmes
d'une tension croissante entre national-socialisme et marxisme, entre
germanisme et slavisme. La tendance de la politique allemande est
mme de dsigner Prague comme le centre d'une conspiration dirige
contre le Reich. Accuse d'tre l'intermdiaire entre Moscou et Paris,
la Tchco-Slovaquie sera prise comme otage la premire. La France
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 154
venant au secours des Tchques sera l'otage numro deux. J amais
nous ne serons trop prudents si nous ne voulons pas favoriser les pro-
jets sur l'Europe de l'Est qui sont nourris par Hitler.
Au total, alliance russe et alliance allemande sont galement dignes
de l'illustre personnage qui se mettait dans la rivire pour viter l'hu-
midit.
L'Action franaise, 2 janvier 1936.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 155
1.58
Rcidive
L'Action franaise, 26 janvier 1936.
Retour la table des matires
M. Pierre Laval manquait d'enthousiasme pour le nouveau pacte
avec la Russie. C'est la raison majeure de la haine qu'il a encourue.
Lui parti, les Soviets comptent bien que le principal obstacle la rati-
fication sera lev.
Ceux qui, dans tous les camps, droite et gauche, sont favorables
au renouvellement de l'alliance dcevante entre toutes les alliances,
reprennent du courage et de la voix. Pour l'treinte de Tilsitt, que Na-
polon alla chercher jusqu' Moscou lorsqu'Alexandre s'y fut drob,
tout est pardonn Staline. Alexandre, ayant fui le baiser, n'tait plus
un beau et noble jeune homme , mais un Grec du Bas-Empire .
Combien de temps faudra-t-il pour que, d' excellents amis , Staline
et Litvinof, le poignard entre les dents, redeviennent les suppts de la
Ill e Internationale ?
En attendant, leur fable est adopte. On ne veut plus que IIIe Inter-
nationale et gouvernement de l'U. R. S. S. se confondent. Pour rendre
l'alliance acceptable, il faut que le pouvoir de Moscou soit un pouvoir
normal, dcent, correct, qui se garde de toute ingrence dans les affai-
res d'autrui, - bien que Pierre Laval vienne d'tre renvers sur son or-
dre. L'Uruguay a renvoy le reprsentant sovitique qui fomentait la
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 156
rvolution au Brsil et dans l'Amrique du Sud. C'est l'Uruguay que
la Socit des Nations est en train de donner tort.
Lisse est le velours sur lequel jouent Litvinof et Staline. Il parat
qu'on obit l'esprit de faction, qu'on mconnat les intrts de la
France, qu'on tourne le dos aux principes de la grande politique lors-
qu'on met en doute la valeur de leur alliance. C'est pourtant sur cette
valeur qu'il importerait d'tre fix.
La question n'est mme pas de mesurer la capacit militaire des
Soviets. C'est de savoir d'abord o et comment elle s'appliquerait.
Que prvoit-on ? Est-ce le cas o l'Allemagne attaquerait la Rus-
sie ? Comment les Allemands s'y prendraient-ils ? Par o passeraient-
ils ? Il est beaucoup plus craindre que, pour rompre l' encercle-
ment , ils n'attaquent la France avec plus de chances qu'en 1914 de la
mettre hors de cause, puisqu'ils sont l'abri d'une incursion russe en
Prusse orientale, - faute, simplement, de frontire commune.
Et si l'Allemagne dirige le gros de ses forces contre nous, sur quel
concours venant de l'Est pouvons-nous compter ? Il n'est pas sr que
l'U.R.S.S. (ni mme la Tchco-Slovaquie) sorte d'une abstention dont
la seule ide, au titre de la rciproque, est dnonce ici comme un
crime. Mais les Allemands peuvent toujours esprer d'tre sous Paris
dans les six semaines tandis que, pour les envahisseurs de la Russie, il
y a toujours des passages de la Brzina et des marais de Poltava.
L'Action franaise, 26 janvier 1936.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 157
1.59
Vie et opinion d'un marchal
des Soviets
L'Action franaise, 4 fvrier 1936.
Retour la table des matires
Un nom vient de passer soudain la grande notorit. Celui de Mi-
chel Nicolaievitch Toukhatchevski, marchal de l'Union sovitique,
qui reprsentait l'arme rouge aux obsques de George V.
Et non pas marchal de la Dite ou marchal de la noblesse,
c'est--dire marchal civil, comme il y en a ou comme il y en a eu en
Pologne et en Russie. Toukhatchevski est un vritable militaire, sa
dignit est militaire, son caractre et son ducation le sont aussi. N
dans une bonne famille russe, jeune officier du tsar en 1914, ralli au
rgime bolchevik, gnral vingt-cinq ans, c'tait lui qui, en 1920,
l'invasion de la Pologne, commandait l'arme qui marcha tmraire-
ment sur la Vistule. Les Soviets ne lui en ont pas voulu de cet chec.
Il leur faut des soldats, et, dans l'me, Michel Nicolaievitch en est un.
C'est un personnage de Guerre et Paix. On l'entend parler comme
l'entendaient Ingolstadt, pendant la guerre, ses compagnons franais
de captivit. Rapports et comments par M. Pierre Berland, corres-
pondant du Temps Moscou, ses propos sont tranges. Nous sommes
en 1915 ou 1916. Nicolas II rgne encore. Toukhatchevski s'exprime
en ces termes :
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 158
Il adore, en riant, Proun, le dieu slave de la guerre, injurie saint
Vladimir qui vanglisa la Russie et fait profession d'athisme. Il ad-
mire les grands personnages de l'histoire, surtout ceux qui ont foul
aux pieds les prjugs du vulgaire et subjugu les masses, Pierre le
Grand, Catherine II, Napolon. ses yeux, Nicolas Il n'est qu'un im-
bcile. Il faut un despote la Russie qui n'est pas faite pour un rgime
constitutionnel. Il veut tre un chef, il a soif d'hrosme. Ce qu'il re-
doute le plus, c'est une carrire morne et plate, tranquille et engourdis-
sante dans une garnison de province...
Que lui importe l'argent ? Comme la plupart des Russes, il n'a ja-
mais su compter. Les intrts des propritaires le laissent indiffrent.
Il se moque du partage des terres. Il est n pour dominer. Les rves les
plus ambitieux le sduisent. Il veut jouer un rle. La mdiocrit lui
donne la nause. Il mprise les morales d'esclaves, les socialistes, les
juifs et les chrtiens. Au fond, il est aristocrate et imprialiste russe.
Voil une esquisse qui n'est dj pas mal. La rvolution russe ar-
rive. La silhouette se dessine encore mieux : Toukhatchevski s'em-
porte contre Kerenski, cet imbcile. Il lui prfre les bolcheviks. Il
parle de tout avec violence :
Sa haine des Anglais clate. Ils ont voulu notre dbcle, dcla-
ra-t-il Pierre Fervacque. Ils rvent de nous dpecer. Les intrts de
la Russie et de la France sont identiques. Si votre pays voulait ! Pas
aujourd'hui, peut-tre. Aujourd'hui, nous ne comptons plus dans la
guerre. Mais, plus tard. La Grande-Bretagne a des points vulnrables,
l'gypte, les Indes, la Perse, l'Extrme-Orient... Mais vous ne voudrez
pas ! Alors, nous balaierons les poussires de civilisation occidentale
qui ternissent la Russie. Nous secouerons la Russie comme un tapis
sale et puis, nous secouerons le monde !...
On retrouve l l'ide sculaire de la mission historique du peuple
russe, peuple lu, qui doit apporter au monde la formule du salut.
Comme l'avait prvu Michelet, la Russie nous dit aujourd'hui : J e
suis le socialisme, comme hier, elle nous disait : J e suis le chris-
tianisme. Le Moscou communiste continue la troisime Rome pra-
voslave. Pour tous ceux qui, comme Toukhatchevski, ont compris
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 159
que, sous la diversit apparente des formules, le bolchevisme est im-
prgn de messianisme slave, l'adhsion la nouvelle foi tait logique
et invitable. Ds le dbut de 1917, il a moralement ralli le drapeau
rouge.
La suite est celle que nous avons dite, le retour en Russie, la bril-
lante carrire, enfin le marchalat. Toukhatchevski est au total un na-
tionaliste mystique, un panslaviste exalt, une sorte de Katkof, trs
officier russe, un peu fou, sympathique, champagne dans le piano ,
aptre, tout ce qu'on voudra. Et maintenant voici son portrait :
Toukhatchevski est dans la force de l'ge. L'instrument qu'il a for-
g, l'arme rouge, est bien au point. Son marchalat n'est point pour
lui le signe de la retraite, la rcompense des bons services qui ont fini
leur tche. Nul doute que le marchal d'aujourd'hui ne pense toujours
comme le petit sous-lieutenant d'Ingolstadt et ne rve encore aux glo-
rieuses aventures qui furent la hantise de sa jeunesse et que son ge
mr connatra peut-tre...
Si l'on comprend ce que parler veut dire, Michel Nicolaievitch est
un casse-cou, espce d'hommes dont les Soviets ont sans doute be-
soin. Ce besoin mme rend leur alliance singulirement dangereuse, et
si le mot aventures est venu pour conclure au bout de la plume de
M. Berland, c'est peut-tre par une inspiration naturelle et comme un
avertissement secret.
L'Action franaise, 4 fvrier 1936.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 160
1.60
L'intervention force
et l'intervention libre
L'Action franaise, 9 mai 1935.
Retour la table des matires
LA dernire fois que j'ai rencontr Thophile Delcass, peu de
temps avant sa mort, il me dit avec l'assurance des simplificateurs pas-
sionns : L'objet le plus prochain de notre politique doit tre d'ajou-
ter l'alliance de la Russie celle de la Pologne.
Eh ! quoi, lui rpondmes-nous, mme l'alliance de la Russie sovi-
tique ? Et, sovitique ou non, croyez-vous possible d'atteler Russes et
Polonais au mme char ?
Delcass n'en doutait pas, pour la raison qu'il le dsirait et le vou-
lait. Enfin, nous voici les allis des Soviets, et il ne s'agit plus de
conjurer mais de concilier cette alliance avec l'amiti de la Pologne.
Cette question conduit en poser une autre : les Slaves ont-ils plus ou
moins de querelles entre eux que le slavisme n'en a avec le germa-
nisme ?
C'est un aspect des choses sur lequel nous avons dj attir l'atten-
tion en parlant de la Tchco-Slovaquie, des dangers qu'elle court et
qu'elle nous fait courir du fait qu'elle est dsormais considre par
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 161
l'Allemagne comme la base de l'arme ou seulement de l'aviation so-
vitique.
Un observateur rflchi appartenant un pays neutre politique-
ment, mais sujet subir les rpercussions des grands heurts europens,
se demandait l'autre jour devant nous si les auteurs du pacte avec les
Soviets avaient bien vu toutes les consquences de l'opration. Acces-
soirement, disait-il, la guerre de 1914 a t un conflit entre Slaves et
Germains. Il s'est rsolu au profit des premiers. Le germanisme a per-
du les positions qu'il occupait depuis trois cents ans, depuis la dfaite
de la Bohme la bataille de la Montagne-Blanche. Est-il probable
qu'il se rsigne ce refoulement ? Et la France doit-elle tre obligatoi-
rement mle aux explications auxquelles il est vraisemblable qu'il
donne lieu ?
Le fait est qu'en 1914 l'Allemagne s'est crue assez forte pour cra-
ser, par le moyen d'une guerre gnrale, les peuples slaves redresss
depuis la guerre balkanique de 1912. Pour la cause et l'ide germani-
ques, la dfaite a t beaucoup plus grave dans l'Europe centrale et
orientale que du ct de l'Occident. L'Allemagne a tout refaire l'Est
en reprenant son lan de plus loin.
Cette considration ne demande pas, il me semble, que nous allions
nous introduire comme des hannetons dans les disputes de deux
grands groupements ethniques historiquement opposs. Si l'on veut
interprter d'une manire correcte la politique de Richelieu, si souvent
invoque, on se souviendra que le cardinal tait proccup de garder
pour la France le principe de l'intervention libre et son heure.
L'Action franaise, 9 mai 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 162
LA POLOGNE
2.1
Varsovie
L'Action franaise, 10 novembre1916.
Retour la table des matires
La Pologne libre par l'hritier de Frdric, c'est une des plus
grandes drisions de l'histoire. Mais l'histoire a aussi ses leons, ses
traits qui ne changent gure. Nous sommes trop accoutums voir,
d'Occident, la question polonaise sous une apparence sentimentale.
D'Orient, elle est conue avec un caractre politique. Dans la reconsti-
tution par la Prusse et par l'Autriche de l'ancien royaume de Polo-
gne, il y a une immense duperie. Les Polonais qui s'y laisseraient
tromper en seraient les victimes et ils seraient bien aveugles s'ils ne
voyaient pas, comme les voit tout le monde, les buts immdiats que
Guillaume II a viss. Quant traiter par le ddain la combinaison aus-
tro-allemande de l'autonomie polonaise, c'est peut-tre une impru-
dence. Le rtablissement d'un royaume de Pologne sous la surveil-
lance de la Prusse est un monument de fourberie et d'iniquit sans
doute. Mais il n'est nullement fatal que ces monuments-l s'croulent
d'eux-mmes, et, avant de tomber, ils peuvent servir aux fins secondes
pour lesquels ils ont t construits.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 163
Nous n'avons gure de chances de recomposer les projets et les ar-
rire-penses de l'ennemi qu'en essayant de nous mettre sa place et
dans sa tte, de voir la situation comme lui-mme la voit. Cette
guerre, Berlin, n'a jamais t conue avec le caractre que nous lui
avons attribu et, aux yeux des Hohenzollern, elle ne peut manquer
d'apparatre telle qu'elle est, d'ailleurs, en ralit, pour une large part :
une reprise agrandie de la guerre de Sept Ans, une nouvelle crise de
1'tat prussien. Regardez : quelques-uns des lments ont chang de
camp. Mais ce sont encore les mmes. En Orient, surtout, la situation,
du dix-huitime sicle au vingtime sicle, n'a pour ainsi dire pas
chang. Prusse, Autriche, Russie, d'une part, Pologne et Turquie de
l'autre, se retrouvent dans la mme juxtaposition et presque dans les
mmes rapports. Il est impossible que cette similitude n'ait pas frapp
l'esprit historique de Guillaume II et des hommes qui l'entourent.
Cette guerre-ci, par ses origines, est une guerre d'Orient, pose par
la question d'Orient. Cette guerre-ci a succd aux guerres de 1866 et
de 1870 parce que le rythme de la politique europenne veut que les
affaires orientales viennent suivre les affaires austro-allemandes.
Quand la guerre de Sept Ans fut finie, ce fut donc la crise orientale de
1769-1770 qui apparut. Pour l'Orient, l'Autriche et la Russie taient
sur le point d'entrer en lutte. Or il ne convenait Frdric ni de laisser
l'Autriche et la Russie aux prises, ni de prendre part au conflit. Ce fut
alors qu'il conut et qu'il fit triompher l'ide de la transaction polo-
naise. Pour rsoudre la difficult, un arrangement, impossible et in-
trouvable du ct de la Turquie, fut cherch et rencontr en Pologne.
Le premier partage de la rpublique polonaise, celui de 1772, fut, pour
ainsi dire, une transposition de la question d'Orient.
Qui sait si, aujourd'hui, Guillaume Il ne rve pas, pour sortir d'une
situation inextricable, d'une transposition et d'une quivalence sem-
blable ? Qui sait si cette autonomie de la Pologne qui semble l'loi-
gner de la Russie, ne doit pas, dans sa pense, l'en approcher et servir
de base des compromis futurs ? On fera bien d'y rflchir, et d'y r-
flchir temps.
L'Action franaise, 10 novembre1916.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 164
2.2
L'alerte de 1920
L'Action franaise, 29 juillet 1920.
Retour la table des matires
Nous en sommes la premire alerte polonaise. C'est un avertis-
sement. Pour cette fois, il sera peut-tre sans frais, encore rien n'est-il
moins certain. Mais c'est l'image de ce qui nous attend, la Pologne,
l'Europe et nous, dans un avenir rapproch.
L'Europe du trait de Versailles est constitue en dpit du bon
sens. Voil la vrit. C'est la maison sans fondations et sans escalier.
Regardez ce qu'ont fait les architectes de la Confrence. Le dsordre
de leurs ides se retrouve dans leur construction. Il tait facile de se
moquer des vieux principes de l'quilibre. Mais quand la construction
bascule dans le trou de l'Est, c'est la France qui est suspendue dans le
vide.
Les auteurs de la paix avaient cru combiner le principe des natio-
nalits avec le principe de l'quilibre. C'tait la thorie de la bar-
rire . Autour de l'Allemagne serait tendue une ceinture d'tats anti-
germaniques, qui, tous, au premier signal, feraient bloc avec les Al-
lis. O a t le bloc, quand la Pologne a t en pril ? Les nationalits
affranchies ont plus de jalousies, de rancunes, et mme de crainte les
unes l'gard des autres qu'elles n'en ont l'gard de l'Empire alle-
mand. Aux Polonais, les Lithuaniens prfraient le diable. Ils leur ont
prfr les bolcheviks. Lettons et Esthoniens, petits peuples baltiques
qui tremblent devant la Russie, se sont hts de faire leur paix avec les
Soviets : l'gosme est la loi des faibles. Tous ces dbiles tats sont
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 165
dans l'enfance, et cet ge est sans piti. Quant aux Tchco-Slovaques,
il y a dj longtemps qu'ils l'ont dit par la bouche de leur ministre, M.
Bens, qui, pendant la guerre, affirmait Paris qu'une Bohme libre
serait un rempart contre l'Allemagne : la neutralit est le devoir de la
Tchco-Slovaquie, sa ncessit vitale. Neutralit avec l'Allemagne,
neutralit avec la Russie. L'tat tchco-slovaque n'est-il pas presque
aussi allemand que slave ? Hostilit, d'autre part, pour la Pologne, la
voisine, la rivale, avec qui la contestation de Teschen entretient, de-
puis les premiers jours de la commune dlivrance, un haineux conflit
de mitoyennet. Qui oserait dire qu' Prague on ne s'est pas rjoui des
revers des Polonais ? Un bon Tchco-Slovaque brlerait l'Europe pour
avoir Teschen. Et combien de Teschen d'un bout l'autre du conti-
nent !
Est-ce sur l'Autriche qu'on peut compter pour fermer la boucle au-
tour de l'Allemagne ? Cette petite Autriche, pice dtache d'une
grande Germanie, n'en est que le satellite. Une Autriche indpendante
se comprenait, elle pouvait durer avec une Bavire, un Wurtemberg
indpendants. Telle quelle c'est une chaloupe de l'Empire allemand.
En attendant le moment de l'annexion pure et simple, qui achvera
l'unit allemande, l'Autriche rend dj des services la patrie germa-
nique. L'Alliance germano-russe, c'est peut-tre par Vienne qu'elle va
commencer. L'Autriche accueille un reprsentant des Soviets. C'est
elle qui s'offre pour faire le pont. Elle est faible, elle apitoie les Allis
sur sa misre. Et, en dessous, ses socialistes pangermanistes font les
affaires de la Prusse. J usqu' cette petite Autriche que nous avons
surveiller ds qu'elle ne meurt plus tout fait de faim !
Le jour o les choses se gteront pour de bon dans l'Europe orien-
tale, nous savons ce qui nous attend. Nous n'avons personne sur qui
nous puissions compter. Et la Pologne elle-mme sera plutt une
charge qu'un appui.
Aprs cette premire secousse, qui peut rpondre, d'ailleurs, de
l'avenir de l'tat polonais ? Il s'est pass en Pologne, ces jours-ci, des
vnements politiques qui sont au moins aussi inquitants que ses re-
vers militaires. J e laisse l-dessus la parole au correspondant du Times
Varsovie qui crivait, il y a huit jours : Au grand tonnement des
observateurs occidentaux, toute la journe a t occupe par des ngo-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 166
ciations pour la formation d'un nouveau ministre. Daghinski, un so-
cialiste fervent, sera ministre des Affaires trangres, comme tant
une personnalit plus convenable pour traiter avec les bolcheviks que
le prince Sapieha.
Cette demi-douzaine de lignes en dit long. Les observateurs occi-
dentaux de Varsovie ne sont pas les seuls tre effrays de ce temps
perdu des combinaisons politiques l'heure o la patrie est en dan-
ger. Nous connaissons ce rgime-l. Et la combinaison elle-mme,
comme elle est peu rassurante ! Nous avons parfaitement le droit, quoi
qu'on en dise, de nous occuper des affaires intrieures de la Pologne.
Nous payons assez pour cela. Eh bien ! il est alarmant de voir revenir
au gouvernement polonais, une heure pareille, des socialistes dou-
teux qui l'ont dj occup au dbut et dont la retraite et le remplace-
ment par des hommes srs avaient t accueillis en France avec sou-
lagement.
Il y a aussi des observateurs occidentaux qui ne rsident pas Var-
sovie et qui n'ont pas attendu le moment o nous sommes pour tre
inquiets. La Rpublique de Pologne est morte autrefois de ses dfauts
et de ses vices. C'tait une Rpublique aristocratique. La Rpublique
populaire de la Pologne ressuscite vaut-elle mieux ? Les patriotes
polonais peuvent trembler.
Le trait de Versailles ne s'est pas content de mettre porte d'une
grande Allemagne, hritire d'une organisation solide, de petits peu-
ples pauvres et nus. ces peuples, si exposs, il a donn le plus pri-
mitif, le plus prcaire, le plus instable des gouvernements. C'tait dj
une exprience dangereuse que de multiplier les tats et les nationali-
ts, en laissant survivre l'Allemagne unie. Les Allis ont ajout une
autre exprience : celle de la dmocratie pure applique des peuples
neufs, de faibles ressources, sans traditions politiques, et qui ont tout
crer chez eux. Nous commenons a voir comment cette double exp-
rience tournera.
L'Action franaise, 29 juillet 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 167
2.3
De l'alliance franco-russe
l'alliance franco-polonaise
L'Action franaise, 22 fvrier 1921.
Retour la table des matires
On a rendu publics les termes de l'accord qui a t sign samedi
entre M. Briand et le prince Sapieha. Voil la France et la Pologne
allies, aussi allies qu'on peut l'tre. Se concerter sur toutes les
questions de politique extrieure intressant les deux tats , se
concerter derechef au cas o l'un des deux pays serait attaqu, se
consulter avant de conclure de nouveaux accords intressant la politi-
que des deux tats en Europe centrale et orientale... Il n'y en avait pas
autant dans le contrat franco-russe.
Du moment qu'il existe une Pologne, elle doit tre notre allie. Il le
faut. C'est dans l'ordre. Seulement il faut bien savoir que l'alliance po-
lonaise n'est pas nouvelle dans notre histoire. C'est le type de l'alliance
que l'on soutient bras tendu. C'est ensuite le type de l'alliance qui
complique fatalement notre politique extrieure. Nos diplomates fe-
ront bien de relire le Secret du Roi.
L'cueil des alliances, c'est que chacune des parties croit vouloir la
mme chose que l'autre et ne s'intresse pas exactement tous les
mmes objets. Nous concevons notre accord avec la Pologne par rap-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 168
port l'Allemagne et la Russie bolcheviste. La Pologne le conoit
ncessairement par rapport l'Allemagne et la Russie tout court.
Bolcheviste ou non, la Russie sera toujours en antagonisme avec la
Pologne. Le jour o apparatrait pour nous la possibilit d'entretenir de
bons rapports avec un tat russe quelconque, l'alliance polonaise ne
serait pas sans inconvnients. C'est alors que l'on comprendrait le
secret du roi , qui tait n au XVIIIe sicle d'une situation et d'un
embarras exactement semblables.
Cela, c'est pour l'avenir. C'est en admettant que la Pologne rsiste
aux accidents et aux maladies du premier ge. Nous disons toujours la
mme chose parce que c'est toujours la mme chose. Tant qu'il n'y
aura pas un tat polonais organis, l'alliance polonaise sera fragile.
L'article 2 de l'accord dit que le relvement conomique est la
condition primordiale de l'ordre et de la paix en Europe et que les
deux gouvernements s'entendront cet gard en vue d'une action
solidaire et d'un mutuel appui . Mais le relvement conomique est
subordonn lui-mme, comme le reste, au relvement politique. Une
Pologne en anarchie, mme si cette anarchie prenait des formes d-
centes et moins scandaleuses que sous la vieille Rpublique polonaise,
une telle Pologne serait d'un faible secours. Ce n'est pas seulement
pour son relvement conomique qu'elle a besoin d'appui et de
conseils. Ces conseils, qui les lui donnera ? Et avec quelle autorit la
dmocratie franaise engagerait-elle la Pologne se mfier de la d-
mocratie ?
Nous saluons bien volontiers l'alliance franco-polonaise. Nous
souhaitons qu'elle se dveloppe. Nous ne croyons pas qu'elle suffise
l'quilibre de l'Europe ni notre scurit, ni mme notre tranquillit.
L'Action franaise, 22 fvrier 1921.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 169
2.4
Pologne et Turquie
L'Action franaise, 20 mai 1923.
Retour la table des matires
IL y a eu la confrence de Lausanne, agite par de novelles me-
naces de guerre grco-turque, un intermde reposant, quelque chose
comme une reconstitution historique. La Pologne et la Turquie, re-
montant le cours des ges, se sont livres des manifestations d'amiti
qui ne sont pas sans tonner le public.
Ismet pacha et le dlgu polonais ont cependant rappel que les
liens qui unissent les deux pays taient anciens. Rompus par le partage
et la destruction de la Rpublique en 1795, ces liens se renouent au-
jourd'hui, comme ressuscitent tant d'autres choses qu'on avait cru mor-
tes. Les Polonais tenaient beaucoup ce souvenir. Avant la guerre,
lorsque la libration et la renaissance de leur pays tait encore un rve,
leurs historiens aimaient ranimer ce pass. Ils rappelaient qu'aprs
chaque perscution et chaque dispersion, des Polonais avaient trouv
asile en Turquie et que ces deux peuples traditions militaires et che-
valeresques avaient su compatir leurs infortunes rciproques. De
leur ct, les Turcs, auxquels personne ne refuse de reconnatre de la
noblesse dans les sentiments, sont fiers de cette vieille camaraderie.
Aujourd'hui, ils ne sont pas fchs de le montrer l'Europe, ce qui est
en contradiction, et en contradiction heureuse, avec le systme de la
table rase et de ngation totale du pass qui est en honneur l'Assem-
ble d'Angora.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 170
Les Turcs et les Polonais se sont aims aprs s'tre beaucoup bat-
tus. Le nom de Sobieski reprsente une poque disparue, celle o le
Turc tait envahisseur et agressif, occupait Bude et assigeait Vienne.
Au dix-huitime sicle, tout avait chang. Une nouvelle puissance
tait apparue en Europe et menaait ses voisins. Cette puissance,
c'tait la Russie. La Turquie et la Pologne furent rapproches par le
mme pril.
Comme il n'y a plus de dlgu russe Lausanne, l'envoy des So-
viets n'a pas eu dissimuler une grimace devant cette reprise solen-
nelle des relations entre la Pologne et la Turquie. Mais si cette mani-
festation n'est pas purement thtrale, si elle a un sens, elle doit signi-
fier qu'un jour ou l'autre la Pologne et la Turquie uniront leurs forces
pour s'opposer de nouvelles tentatives de la Russie, tentatives d'ex-
pansion et de conqutes dont on ne peut fixer la date, mais qui se pro-
duiront coup sr car elles sont commandes par d'inluctables lois.
Les Turcs ne paraissent pas avoir encore bien compris ce qui les at-
tend de ce ct. Ils en sont toujours regarder les bolcheviks comme
des auxiliaires ventuels contre l'Occident, alors que, pour l'Occident,
la raison d'tre de la Turquie a t et sera encore de servir de prtexte
arrter une expansion russe. Ce n'est pas la peine de remmorer aux
Polonais des souvenirs historiques si l'on n'en tire pas les enseigne-
ments.
L'Action franaise, 20 mai 1923.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 171
2.5
La Pologne et la paix
L'Action franaise, 22 Mars 1925.
Retour la table des matires
LORSQU'EUT t dcid le premier partage de la Pologne, Frd-
ric Il crivit Voltaire des lettres d'une ironique dsinvolture. Qu'est-
ce, disait-il, que l'acquisition de quelques provinces dont on n'aper-
oit pas l'existence sur le globe gnral, et qui, des sphres clestes,
paratraient peine comparables un grain de sable ? Voil les mis-
res dont nous autres politiques nous nous occupons si fort... Mais,
quand on peut runir et joindre les domaines entrecoups pour faire un
tout de ses possessions, je ne connais gure de mortels qui n'y travail-
lassent avec plaisir. Notez toutefois que cette affaire s'est passe sans
effusion de sang et que les encylopdistes ne peuvent dclamer contre
les brigands mercenaires et employer d'autres belles phrases dont
l'loquence ne m'a jamais touch. Un peu d'encre l'aide d'une plume
a tout fait...
Que demain recommence un partage de la Pologne, et tout cela se
retrouvera vrai. Non moins vrai ce qui suit : J e sais que l'Europe
croit assez gnralement que le partage qu'on a fait de la Pologne est
une suite de manigances politiques qu'on m'attribue ; cependant rien
n'est plus faux. Aprs avoir propos vainement des tempraments, il
fallut recourir ce partage comme l'unique moyen d'viter une
guerre gnrale.
Si la Pologne est encore dissque, ce sera sous le mme prtexte,
celui de la paix europenne. On sait ce que, vingt ans plus tard, il en
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 172
advint. Albert Sorel a montr la relation des guerres rvolutionnaires
avec le partage (on a dit longtemps le crime ) de 1772.
Catherine II, de son ct, crivait alors, toujours Voltaire :
Nous n'avons point trouv d'autres moyens de garantir nos frontires
que de les tendre. L'argument sert encore. Il servirait dans les m-
mes conditions. Croit-on que, si l'Allemagne arrachait quelques plu-
mes l'aigle blanc de Pologne, la Russie ne demanderait rien de son
ct ? Voici un mmoire, dat de Vienne, qui est adress la Socit
des Nations par l'Association de l'Ukraine occidentale. Nous en res-
pectons le style. Il commence ainsi :
Les milieux dirigeants politiques de l'Europe occidentale viennent
de soulever dj - en vue d'un pacte de scurit conclure entre la
France, la Grande-Bretagne, la Belgique et l'Allemagne - le problme
d'une rvision des frontires occidentales de la Pologne, en attestant
par l mme que la domination actuelle de la Pologne sur les territoi-
res qui lui sont trangers au point de vue ethnographique, constitue
une menace pour la paix mondiale.
Cependant il s'impose de constater cette occasion qu'une rvi-
sion laquelle ne seraient soumises que les frontires occidentales de
la Pologne, ne saurait carter ce danger, et que ce sont plutt ses
frontires orientales qui - dans une mesure de beaucoup plus consid-
rable - nourrissent le germe des conflits mondiaux l'avenir.
Le sacrifice de la Pologne est le gage de la paix europenne. C'tait
l'argument de Frdric, de Catherine et de Marie-Thrse. Il revient. Il
trouve des dupes. Ne trouvera-t-il pas galement des complices ? Il n'y
a plus d'Autriche pour copartager . Qui sait si, fortes d'antiques tra-
ditions, la Rpublique allemande et celle des Soviets ne tenteraient
pas d'inciter M. Bens et les Tchco-Slovaques prendre la place de
la fille des Habsbourg qui pleurait mais n'en prenait pas moins ?
L'Action franaise, 22 Mars 1925.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 173
2.6
La Pologne puissance militaire
L'Action franaise, 13 juillet 1925.
Retour la table des matires
QUAND la Pologne, aprs la guerre, a retrouv son indpendance,
on s'est demand si, tant une nation, elle deviendrait un tat. Ses
amis ont pu craindre, ses ennemis esprer qu'elle ne s'organiserait ja-
mais. Ses dbuts ont donn des apprhensions et l'on entrevoyait une
rechute dans l'anarchie polonaise. La Pologne, c'est son loge, a tenu
dmentir ces pronostics fcheux. Ses progrs sont certains, et, dans
la Revue universelle du 15 juillet, Ren J ohannet en trace un tableau
qui donne l'ide de l'effort accompli et des rsultats obtenus. ce ta-
bleau, nous pouvons ajouter un trait important.
La Pologne avait tout crer aprs tre reste, pendant un sicle un
quart, dans une servitude pire que la mort puisque, divise entre trois
Empires, quatre de ses gnrations avaient vcu sous des lois diffren-
tes. La tche tait plus lourde que si elle avait eu tout tirer du nant.
Il fallait vaincre ou harmoniser des habitudes. Dans ces conditions
difficiles, elle a eu former une administration. Elle a d, en mme
temps, venir bout d'une crise financire qui semblait dsespre. Ce
n'est pas tout : elle a russi se donner une arme.
Le gnral Sikorski, ministre de la Guerre, vient de prsenter au
Snat de Varsovie un rapport sur l'tat de la dfense nationale. On y
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 174
voit, par des chiffres et des faits, que la Pologne n'est plus, au point de
vue militaire, un lment ngligeable. Ce n'est pas sur le papier qu'elle
a ses effectifs. Pour parer aux insuffisances du service de dix-huit
mois, le gnral Sikorski n'a pas recul devant des mesures qu'on
pourrait imiter ailleurs. Dans les bureaux militaires et les intendances,
il a mis des civils, n'enlevant ainsi personne l'instruction et l'en-
tranement.
Ce qui n'est pas moins intressant, c'est que la Pologne, ds au-
jourd'hui, est presque en tat de se suffire, en cas de guerre, pour le
matriel et les approvisionnements. Elle fabrique ses munitions, mme
celles de l'artillerie lourde, ses fusils, et commencera bientt se
fournir elle-mme d'armes automatiques. Enfin, pour l'aviation, la d-
fense contre la guerre chimique et bactriologique, le tlgraphe et le
tlphone, etc., elle se met en mesure de se passer de l'tranger.
Cet ensemble de crations est dirig par une ide politique intelli-
gente et juste. La Pologne est menace l'Est et l'Ouest. Elle le sait.
Elle sait aussi qu'elle a des alliances. Mais, pour qu'elle puisse comp-
ter sur ses allis, il ne faut pas qu'elle soit pour elles un poids mort.
Inscrire dans des traits ou des pactes que la France pourra venir au
secours de la Pologne n'est pas suffisant. Il faudra encore que la d-
mocratie franaise le veuille et qu'elle ne se dsintresse pas du sort
des peuples qu'elle connat peine de nom et qui sont bien loin. Beau-
coup de choses seront changes si la Pologne devient une force utile,
si, au lieu d'avoir besoin d'tre secourue, elle est capable de remplir
efficacement son rle d' allie de revers . C'est ce que le gnral
Sikorski a compris. Il convient de l'en fliciter.
L'Action franaise, 13 juillet 1925.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 175
2.7
Pilsudski et l'aristocratie polonaise
L'Action franaise, 6 avril 1926.
Retour la table des matires
LE marchal Pilsudski a eu rcemment Nieswiez avec plusieurs
reprsentants de l'aristocratie polonaise une entrevue qui a fait couler
beaucoup d'encre. Le bruit a couru qu'il se proposait de fonder une
monarchie. En tout cas, ce ne pouvait tre pour lui-mme. Pilsudski
est n rvolutionnaire. Et l'on a dit de lui spirituellement : Si jamais
il tait assis sur un trne, il serait le premier le faire sauter.
L'avantage de la monarchie hrditaire c'est que, dans un pays qui
sent le besoin d'un chef, le souverain est dsign par l'hrdit, ce qui
supprime les luttes et les comptitions entre les candidats. La Pologne
n'a malheureusement pas de dynastie historique dont les titres soient
incontestables. Il faudrait choisir, par exemple, entre les Poniatowski
et les Czartoryski. Et les controverses commenceraient.
Quant un prince tranger, on a vaguement parl quelquefois d'un
Anglais ou d'un Italien. Mais les expriences qui ont t faites dans le
pass ne sont gure encourageantes. La nationalit polonaise est trop
vivace pour qu'elle accepte aisment de recevoir une bouture royale
du dehors.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 176
Il y a un mouvement monarchiste en Pologne. Pilsudski a mme
deux monarchistes dans son ministre. Toutefois rien n'est mr pour
tablir un trne et l'entrevue de Nieswiez avait un autre objet.
Il s'agit, dans l'esprit de Pilsudski, de constituer avec l'aide des
grands propritaires fonciers un parti conservateur qui aurait, pour le
marchal, l'avantage d'affaiblir sinon de supprimer le parti national-
dmocrate, parti de la droite proprement dite, auquel il est peu sympa-
thique et qui a peu de sympathie pour lui. Le dessein du marchal - et
peut-tre son illusion - est d'avoir en Pologne trois partis bien organi-
ss, dfaut de deux, ce qui est partout l'idal des rgimes reprsenta-
tifs, afin d'en finir avec l'miettement des groupes qui rend si difficile
de gouverner. Dans sa conception, il y aurait des conservateurs, des
progressistes et des socialistes, rien de plus. Reste savoir si les tradi-
tions et les particularits polonaises se laisseront rduire ces trois
dnominations.
Le rapprochement de Pilsudski et de l'aristocratie terrienne n'en est
pas moins remarquable. C'est le signe que le partage des terres est une
ide dont on s'loigne, bien qu'elle reste thoriquement au programme
du parti populiste, qui est pilsudskiste aussi. C'est le signe surtout que
Pilsudski appelle les possdants collaborer avec lui une oeuvre na-
tionale. Il veut mettre la Pologne l'abri des cartels, des trusts et de
toutes les dominations financires qu'appelle et que favorise l'ta-
tisme. Pour cela, c'est sur le contraire du socialisme qu'il faut s'ap-
puyer. La grande proprit foncire, qui est l'lment le plus stable et
le plus libre la fois d'un pays, lui est apparue comme la force co-
nomique et sociale la plus propre le soutenir dans la ralisation de
ses projets. On voit que si Nieswiez il n'a pas parl avec les Radzi-
will et d'autres membres de l'aristocratie polonaise de fonder une mo-
narchie, il n'en a pas moins cherch prparer l'avenir sur des princi-
pes qui s'loignent fort de ceux de la dmocratie galitaire.
L'Action franaise, 6 avril 1926.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 177
2.8
Un trs grand changement
L'Action franaise, 4 mars 1927.
Retour la table des matires
RIEN ne vaut le fait qu'on existe. Avec les vivants, il faut toujours
compter. L'exemple de la Pologne le prouve aujourd'hui.
Il serait superflu, si ce n'tait pour la moralit de l'histoire, de rap-
peler que, d'une faon gnrale, les Anglais n'ont pas cru que la Polo-
gne ft viable. L'criture, raillait l'un d'eux, dit bien que Lazare a t
ressuscit. Tout de mme, il a fini par mourir pour de bon. La
croyance commune, de l'autre ct de la Manche, tait que jamais un
tat polonais ne parviendrait recoller ses trois tronons briss ni se
constituer solidement. On pensait que la Pologne, aprs une rappari-
tion phmre, tait condamne disparatre et que le plus tt serait le
mieux pour la restauration de l'Europe.
Cette doctrine n'tait, certes, pas officielle. Mais tout se passa en
1920 comme si elle l'et t. Car, lorsque l'arme rouge marcha sur
Varsovie, le gouvernement britannique crut l'effondrement du pa-
radoxe polonais . Il ne leva pas le petit doigt pour sauver la Pologne
qui, sans la France, et t compltement abandonne.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 178
Avec le temps et surtout avec les circonstances, les ides ont chan-
g Londres. Elles changeront peut-tre encore sur d'autres points et
il faut esprer que ce ne sera pas trop tard.
Depuis que le gouvernement britannique est en dlicatesse avec les
Soviets et qu'il a entrevu la possibilit d'un conflit, il n'est pas m-
content de trouver aux portes mmes de la Russie un tat sur lequel il
lui soit possible de compter. Nagure on levait les bras, Londres, en
parlant de la folie imprialiste de Pilsudski, rput pour son hostili-
t au bolchevisme. Qui sait si, depuis sa marche sur Kief, on ne trouve
pas le marchal bien modr et bien assagi ? Qui sait si on ne voudrait
pas lui voir reprendre un peu de feu sacr ?
Ce qui est certain, c'est la considration toute nouvelle que l'Angle-
terre marque pour la Pologne. Le changement s'est annonc par des
enqutes dont les conclusions ont t hautement favorables la vitali-
t, aux vertus et aux ressources du pays. En ce moment, on distingue
que la diplomatie anglaise est l'oeuvre pour rconcilier les Polonais
et les Lithuaniens. On dit mme que le plan, bien plus tendu, consis-
terait trouver un arrangement des frontires orientales satisfaisant
pour l'Allemagne et pour la Pologne la fois. C'est peut-tre beaucoup
trop embrasser. Et si la politique anglaise cherche former une vaste
coalition continentale pour mettre les Soviets hors la loi, elle peut s'at-
tendre, de la part de l'Allemagne, plus d'une trahison.
Quoi qu'il en soit, l'esprit nouveau qui anime les Anglais l'gard
de la Pologne est un signe. Cela veut dire au moins qu'ils ont des dou-
tes sur la justesse de la politique qu'ils ont suivie en Europe depuis
sept ans.
L'Action franaise, 4 mars 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 179
2.9
Vive la Pologne, monsieur !
L'Action franaise, 18 mars 1927.
Retour la table des matires
LA visite en France des parlementaires polonais aura t l'occasion
de faire sentir la diffrence des temps et des ides l'gard de leur
pays. C'est aussi important, ce n'est pas moins significatif pour eux
que pour nous.
Le culte de la Pologne a t jadis, en France, populaire et comme
inhrent la dmocratie. Si l'on nous permet de nous citer nous-
mmes, c'est ce que nous avons cherch rendre sensible par la fable
du savetier de J aco et Lori. Alors on aimait la Pologne comme le
symbole de la libert et de la rsistance l'oppression. On l'aimait sur-
tout contre le tsar tyran, vampire . C'est ainsi que, devant l'empe-
reur de toutes les Russies, Floquet lana voix sonore, selon la l-
gende, et soupira plutt, d'aprs les tmoins, son : Vive la Pologne,
monsieur !
Aprs 1871, le culte s'teignit. Avec l'Alsace-Lorraine, nous avions
la Pologne chez nous. Michelet tait la fois un attard et un prcur-
seur lorsqu'il confondait dans la mme condamnation le roi Guillaume
et l'empereur Alexandre et prophtisait l'entente ternelle de la Prusse
et de la Russie aux dpens de la Pologne. La cause polonaise s'effaait
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 180
des esprits et des coeurs et l'alliance russe mit sur elle le voile de l'ou-
bli. peine parlait-on de temps autre des perscutions allemandes
en Posnanie. La France ne faisait plus de propagande dmocratique en
Europe et le romantisme rvolutionnaire cdait de pnibles ralits.
C'est ainsi que la rsurrection de la Pologne a trouv le public
franais froid, ignorant et mme mfiant. Les uns doutaient qu'une
nation sortie du tombeau aprs plus d'un sicle pt vivre et disaient
que si Lazare avait t rendu la lumire il n'avait pas, au pralable,
t coup en trois tronons. Les autres, subissant des influences an-
glaises et allemandes, taient hostiles un pays, d'ailleurs catholique,
et qu'on reprsentait Londres et Berlin comme la cause de compli-
cations et mme de guerres futures.
Ces impressions ont chang peu peu. La Pologne s'est tout dou-
cement impose. Elle existe, c'est un fait. L'Angleterre, les Soviets,
l'Allemagne elle-mme comptent avec elle comme avec un fait. Non
seulement elle a prouv sa vitalit, mais encore elle a montr qu'elle
mrissait en sagesse politique. Et l'on s'est aperu peu peu que, si
elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, parce que rien ne la remplace-
rait comme lment d'quilibre dans l'Europe orientale.
Les parlementaires polonais, et ils pourront en apporter chez eux le
tmoignage, ont donc t reus comme les reprsentants d'un pays
naturellement ami de la France et indispensable l'hygine du corps
europen. Nos partis de gauche, aprs avoir reni leur antique tradi-
tion polonophile, se sont convertis eux-mmes l'alliance franco-
polonaise qui n'est plus fonde sur l'enthousiasme et le sentiment,
mais sur une rciproque utilit. Elle est plus solide ainsi.
L'Action franaise, 18 mars 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 181
2.10
Le Marchal Pilsudski
et le rgime parlementaire
L'Action franaise, 7 juillet 1928.
Retour la table des matires
On sait que le marchal Pilsudski a renonc aux fonctions de pr-
sident du Conseil. On savait aussi, mais assez vaguement, qu'il avait
expliqu les raisons pour lesquelles, sans cesser de servir son pays, il
se dmettait de cette charge. Le Messager polonais du 2 juillet a pu-
bli intgralement les dclarations du marchal Pilsudski. Elles sont
catgoriques, elles sont vives, elles sont mme brutales, mais elles
sont fort plaisamment images. Sur le rgime parlementaire, jamais,
croyons-nous, M. Mussolini en personne n'en a dit autant. Et c'est en
tout cas un document historique, tant donn que le marchal Pilsuds-
ki, ministre en exercice, s'adresse une Assemble qui a t rcem-
ment lue, dont les membres, ou du moins beaucoup d'entre eux, ont
invoqu son nom et son prestige et que la Constitution polonaise in-
vestit des pouvoirs les plus tendus.
Depuis Cromwell, jamais dictateur rpublicain n'avait trait un
Parlement avec plus de rudesse. quatre ou cinq reprises, comme un
refrain et une provocation, le marchal Pilsudski s'adressant la Dite
l'appelle Dite de catins . Mais il dveloppe ses motifs en les illus-
trant de toutes sortes d'images propres frapper l'esprit populaire.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 182
Il nous est impossible de tout citer. Il y a l les pages d'une ironie
et d'un mpris extraordinaires, lorsque, par exemple, il compare les
sances du Parlement aux travaux forcs inutiles et lorsqu'il dit
aux dputs que leurs discours font prir les mouches elles-mmes
d'ennui. C'est de l'humour anglais, du Carlyle de Past and Present
ou du Chesterton que l'on songera en lisant ceci :
Lorsque, le sourire aux lvres, je vois les petits enfants converser
gravement avec leurs poupes comme avec des tres vivants auxquels
ils commandent divers actes qu'ils accomplissent eux-mmes, comme
je le vois faire par mes fillettes qui, dner, aprs avoir plac leurs
poupes prs d'elles, approchent trs gravement la cuillre du visage
en porcelaine de la poupe, je trouve un tel jeu trs gentil, mais je me
sens incapable d'y participer.
Mais lorsque ces messieurs qui, en leur souverainet, font une hai-
neuse concurrence M. le prsident de la Rpublique et dfendent
jalousement des privilges nullement mrits, usent dans leur travail
des mthodes absolument insenses qui sont celles des petits enfants
approchant une cuillre pleine de soupe de la bouche d'une poupe,
alors vraiment je ne suis en tat ni d'couter ces choses, ni de les re-
garder. Le processus mme du travail, consistant uniquement en des
discours, c'est l l'invention la plus monstrueuse qui jamais ait pu na-
tre dans l'esprit d'un homme.
Et encore ce morceau sur les mthodes de travail au Conseil des
ministres :
la sance du Conseil, chez M. le prsident de la Rpublique, j'ai
affirm que les fonctions du chef du gouvernement taient ce point
pnibles du fait que le plus clair de son temps tait consacr s'occu-
per des nourrissons que tous lui mettaient dans les bras. Comme,
Wilno d'o je suis originaire, j'ai entendu souvent cette maldiction :
Puisses-tu lever les enfants des autres, c'est avec pouvante que
j'ai pens au sort d'un tel malheureux.
D'abord, voici venir messieurs les ministres au complet, mes chers
et aimables collgues du cabinet qui, soit ayant rencontr des obsta-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 183
cles dans leur travail, soit voulant faire des extras ou se livrer des
controverses, mettent dans les bras du chef du gouvernement les nour-
rissons, si gentils et choys, et qui souvent ne sont que d'affreux mori-
cauds dsavous par leurs parents. Le seul processus de ce qu'on ap-
pelle la mise d'accord , qui dans le fonctionnement des ministres
chez nous occupe une place si large et si prpondrante, ce processus
dure si dsesprment longtemps et absorbe tant de paperasserie que,
je l'avoue, bien que ce processus soit impos la machine de l'tat,
pas une seule fois je n'ai os toucher aux monceaux de feuilles rem-
plies de caractres dactylographis de peur d'aller dans une maison de
fous. Et cependant c'tait l mon strict devoir.
Citons encore ceci :
La passion pour la centralisation qui se manifeste chez nous d'une
faon ridicule, rend le travail improductif au point de vue lgislatif,
tant donn que les trois quarts de l'ordre du jour de chaque sance du
Conseil des ministres sont consacrs des questions telles que : la
modification des frontires des communes dans les rgions particuli-
res de l'tat ; l'autorisation d'achat des immeubles par les trangers ;
l'autorisation des citoyens particuliers d'entrer dans la Lgion tran-
gre en France ; des changements aux postes officiels des classes rela-
tivement trs infrieures ; toutes dcorations polonaises ou trangres
et enfin tout autre joli bibelot de notre bureaucratie. tout cela M. le
prsident du Conseil doit mettre la main et donner son assentiment.
Dans l'accomplissement consciencieux, dis-je, de ses fonctions l'om-
nipotence doit disparatre, noye dans un dluge de paperasseries, de
petites et minuscules circulaires qui ne prennent pas plus de trois mi-
nutes de temps, mais qui, l'homme se dbattant dans tout ceci, ne
laisse que la corde pour se pendre . ceci il convient d'ajouter la
vritable fureur de protection de tous ceux qui, avec une obstination
vraiment admirable, ne rclament au plus que trois ou cinq minutes
pour faire du chef du gouvernement, soit un avocaillon de leurs affai-
res prives, soit un juge et un expert en inventions (ce qui occupe g-
nralement une demi-heure de temps), soit satisfaire leurs dsirs qui
est de destituer un fonctionnaire d'tat, ou de nommer des postes
non existants de fort sympathiques jeunes gens ou bien encore de lib-
rer de toute responsabilit pour des abus de confiance des gens non
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 184
moins sympathiques qui, uniquement mal conseills et la suite
d'tranges machinations, ont mis la main dans le sac du Trsor.
Il faudrait d'ailleurs prolonger ces extraits et il est peu probable que
la presse des dmocraties occidentales fasse grand cho ce document
unique. Car enfin, l'auteur de cette satire n'est pas un thoricien de la
contre-rvolution. Ce n'est ni un doctrinaire ni un polmiste profes-
sionnel. Le marchal Pilsudski, comme du reste M. Mussolini, a fait
ses dbuts dans le socialisme. Et il est homme d'action, rest au centre
de l'action, personne ne disposant en Pologne de l'ascendant qu'il y
possde. On s'tonnera donc que les dclarations du marchal Pilsuds-
ki soient mises, chez nous, sous le boisseau. Quand ce ne serait que
pour la curiosit et la signification du fait, nos dmocraties devraient
en tre informes, tant donn surtout que Pilsudski continue nuire
aux vertus des rgimes dmocratiques dont il est port ne voir
qu'une caricature dans la Dite de catins qu'il fustige devant son
pays.
L'Action franaise, 7 juillet 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 185
2.11
La bataille de la Vistule
L'Action franaise, 15 octobre 1928
Retour la table des matires
LE commandant Larcher vient de traduire en franais, avec une
prface de M. le marchal Foch, l'important ouvrage du gnral Si-
korski sur la Campagne polono-russe de 1920. Le gnral Sikorski a
pris part aux oprations qui aboutirent la victoire de Varsovie et
l'expulsion des envahisseurs bolcheviks. Il commandait lui-mme la
Ve arme. Son livre est un historique clair et prcis des oprations.
Mais il a tir de ce rcit des conclusions politiques d'une haute porte.
On sait d'ailleurs que le gnral Sikorski, ancien ministre de la Guerre,
a cette intelligence tendue que donnent les grandes responsabilits.
Les causes d'une guerre sont essentielles quand on veut en com-
prendre la marche et en prvenir le retour. Le gnral Sikorski insiste
fortement sur la tentation que donna aux Soviets l'isolement de la Po-
logne au moment o, sortant du tombeau, venant peine de rassem-
bler ses trois tronons, elle avait tout faire pour organiser les pre-
miers linaments d'un tat.
Cet isolement tait tragique. Sauf la France, la Pologne tait entou-
re d'indiffrence et mme d'hostilit. Car ce n'tait pas seulement un
isolement moral : le transport du matriel fianais envoy en Pologne
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 186
tait refus par les travailleurs allemands de Dantzig et aussi par les
Tchques, les Autrichiens et les Belges .
Les Belges : vous, Vandervelde ! S'il n'avait tenu qu' ce chef so-
cialiste, hritier de la pense dmocratique du dix-neuvime sicle, la
Pologne, Michelet, Mickiewicz, et t crucifie de nouveau.
Ainsi, ce qui a provoqu cette guerre de 1920, c'est la conviction
o furent les Soviets que le moment tait venu d'en finir avec la Polo-
gne. La neutralit de l'Europe a fait couler le sang. Elle a failli tre
fatale l'Europe elle-mme. Car, le barrage polonais rompu, l'invasion
bolcheviste courait vers l'Occident.
Le gnral Sikorski indique, parmi les causes de la victoire polo-
naise, l'excs de confiance de l'arme rouge. Tout fait comme pour
l'arme allemande en 1914. Selon le mot profond du gnral
Weygand, la prsomption avait fait battre les gnraux de Guillaume
Il. Et, puisque nous nommons le gnral Weygand, le livre du gnral
Sikorski ne manque pas de mettre en lumire les services que rendit
la Pologne en 1920 le chef d'tat-major du marchal Foch. Il y ajoute
cet hommage : Nos camarades les officiers franais, au moment le
plus critique de la guerre, se trouvrent nombreux nos cts bien
qu'ils ne fussent pas protgs par la qualit de belligrants. C'est dit
sans insister. Ce n'en est que plus beau.
L'Action franaise, 15 octobre 1928
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 187
2.12
Les tapes
L'Action franaise, 29 dcembre 1930.
Retour la table des matires
L'effort politique de l'Allemagne est dirig contre la Pologne. C'est
public, patent, reconnu. En France, on ne le nie pas. On aime mieux
ne pas le savoir. En Allemagne, delenda est Polonia s'imprime ouver-
tement. Blessure ouverte au flanc de l'Europe , dit l'ancien chance-
lier Marx, dramatiquement. J adis, la cause de la Pologne, pch de
l'Europe , tait une cause librale et catholique. Le Centre allemand a
chang tout cela et il oriente les dmocrates chrtiens d'Occident
contre le polonisme tandis que les dmocrates lacs d'Allemagne font
un devoir de conscience tous les libraux de prendre parti contre les
oppresseurs polonais.
Dans notre livre les Consquences politiques de la paix qui date
de 1920, nous avions cit un article de la revue La Pologne, paru en
juillet de la mme anne, et qui annonait tout ce qui se droule
planmssig, selon le plan, selon une stratgie de Schlieffen applique
la politique. Cet article disait, il y a donc dix ans :
Le partage de la Pologne n'est pas un but loign et vague de la
politique allemande. Il est bien dfini et regard comme pouvant tre
ralis dans un temps trs rapproch. En observant la politique alle-
mande et les vnements en Europe orientale, on peut se rendre exac-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 188
tement compte du plan allemand. D'aprs ce plan, la politique alle-
mande doit procder par trois tapes : I le rtablissement des ancien-
nes frontires l'est ; 2 l'tablissement d'une hgmonie allemande
dans l'est de l'Europe, 3 la revanche du ct de l'ouest et l'hgmonie
allemande sur le continent europen.
L'excution de ce programme est conditionne par le rtablisse-
ment de la Prusse dans ses anciennes frontires, ce qui implique un
nouveau partage de la Pologne...
La russite d'un partage de la Pologne - malgr et contre les droits
des nationalits disposer d'elles-mmes, principe si hautement pro-
clam Versailles et accept par les Allemands qui ont compris bien
vite quel profit ils pourraient en tirer en Europe orientale - se base sur
les trois ordres de faits suivants : I le rtablissement d'une situation
politique qui, au dix-huitime sicle, a abouti aux partages de la Polo-
gne et a maintenu, au dix-neuvime sicle, une Pologne divise ; 2 la
situation intrieure de la Pologne et les tendances polonaises ; 3 la
neutralit des puissances occidentales telle qu'elle a exist pendant les
partages du dix-huitime sicle et telle qu'elle a persist pendant les
partages accomplis au dix-neuvime sicle.
Ainsi on peut quelquefois prophtiser, dans la mesure o l'avenir
se dduit de ce qui a t et de ce qui est. Actuellement, l'Allemagne
tend bien rtablir ses anciennes frontires l'est. Et ses libraux, ca-
tholiques, protestants, juifs ou sans confession ameutent l'opinion du
monde entier contre le rgime de Pilsudski, ce qui nous ferait croire
que ce rgime contrarie le plan en cours d'excution.
L'Action franaise, 29 dcembre 1930.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 189
2.13
Pierre prcieuse
L'Action franaise, 14 janvier 1931.
Retour la table des matires
Rien ne vaut un beau texte, et nous aurions envie, aujourd'hui, de
ne rien faire d'autre que de transcrire celui que nous avons dcouvert.
On peut discuter sans fin sur la maxime : Si tu veux la paix,
tiens-toi prt la guerre, puisqu'il y aura toujours des gens pour sou-
tenir que la meilleure faon de conserver la paix c'est de ne pas admet-
tre la guerre, mme en ide. Pratiquement, il s'agit de savoir si, dans
les circonstances prsentes, le dsarmement, que l'Allemagne conoit
d'ailleurs comme un droit gal aux armements, serait propre emp-
cher les conflits ou de nature les provoquer.
Il n'y a pas lieu de chercher des subtilits. La paix ne peut tre me-
nace que par les pays qui ont des traits dtruire, des frontires
rviser, une revanche prendre. Le point o le danger immdiat est le
plus visible, tout le monde le connat. Il est aux confins de l'Allema-
gne et de la Pologne.
Le Vorwrts de dimanche, aprs avoir dit qu'aucun Allemand ne
pouvait reconnatre la frontire orientale pour juste et raisonnable ,
concluait nanmoins par un appel au calme et donnait les raisons que
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 190
le Reich doit avoir de ne pas entreprendre une guerre contre ses voi-
sins de l'Est.
Premire raison, mais l'on ne peut pas dire que, pour le Vorwaerts
et ses lecteurs, ce soit la plus forte, car aucun mot n'y est soulign, il y
a la Socit des Nations, Locarno, Kellogg. L'Allemagne ne pourrait
faire la guerre sans une triple violation des pactes.
Mais la sanction n'est pas bien effrayante. Alors, seconde raison du
Vorwaerts, la principale, que nous traduisons littralement et que nous
voudrions voir grave en lettres d'or sur la porte de la confrence de
Genve :
En outre, nous ne pouvons pas faire la guerre la Pologne parce
que, tant donn la proportion actuelle des armements, nous per-
drions ncessairement n'importe quelle guerre.
Tel est le diamant que nous avons cueilli dans le journal so-
cial-dmocrate. Il est d'une inestimable valeur.
Ajoutons que, dans le texte original, le mot verlieren (perdre) est
soulign. Ainsi la crainte de la dfaite et des suites de la dfaite est
juge par les socialistes pacifiques du Vorwaerts plus persuasive que
la condamnation morale qui rsulterait de la violation des pactes. En-
fin, surtout, l'ingalit des armements, l'infriorit mme dont l'Alle-
magne se plaint aux quatre vents du ciel, voil le plus efficace des
freins. Ce n'est pas nous qui l'aurons dit.
Et nous disons aux autres : Si tu aimes la paix, conserve cette sa-
lutaire proportion actuelle. Oh ! conserve-la bien.
L'Action franaise, 14 janvier 1931.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 191
2.14
Le quatrime partage
L'Action franaise, 5 fvrier 1931.
Retour la table des matires
THODORE Wolff reprend sur le mode mineur et laque le thme
de Mgr Kaas. Les traits, c'est le pass. La France, qui l'Allemagne
ne demande rien que de renoncer au dogme de l'intangibilit, n'a pas
intrt s'endormir dans la contemplation de l'acte de Versailles.
Qu'elle adhre au principe de la rvision et elle aura la reconnaissance
du peuple allemand qui ne dsire pas autre chose.
Il est vrai que l'Allemagne n'aspire pas seulement au principe de la
rvision. Elle l'obtiendra pour s'en servir. Thodore Wolff lui-mme
ne nous fera pas croire que ce soit pour faire triompher la doctrine de
l'volution et de la vie sur le passisme et l'immobilit.
Mgr Kaas a t plus net lorsqu'il a dit, s'adressant aux Franais :
Votre frontire, nous ne prtendons pas y toucher. Nous la regar-
dons comme dfinitive. Entre vous et nous, c'est fini de la lutte et de la
contestation hrditaires. Si vous le voulez et condition que vous
fassiez le ncessaire. Cest si simple ! Cela vous cotera si peu ! Lais-
sez-nous rgler nos comptes avec la Pologne. Qu'est-ce que cela peut
vous faire ?
Il est assez fcheux que ce langage soit celui que M. de Schoen te-
nait au Quai d'Orsay en juillet 1914 lorsqu'il demandait la France de
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 192
laisser l'Allemagne rgler ses comptes avec la Russie. Mais le march
qu'on nous offre n'a pas toujours t refus. La premire Rpublique,
celle de la Rvolution, qui a t inimitable dans la forfanterie, avait
fort bien accept de se sauver aux dpens des Polonais. Les deux par-
tages de 1793 et de 1795 furent le prix du dsistement de la Prusse
aprs la canonnade de Valmy. La paix de Ble consacra le sacrifice.
Et cette histoire, qui est de l'histoire, a toujours t cache avec soin
aux petits enfants. Pas un Franais n'a pu apprendre l'cole l'exis-
tence de cette tache sur la vierge et glorieuse Rvolution.
Pourquoi ce qui s'tait fait alors ne pourrait-il se recommencer ?
Mgr Kaas et Thodore Wolff songent Brnswick. On laisse la
France une image d'pinal, les volontaires de la Rpublique mettant
l'ennemi en fuite rien qu'en agitant leur chapeau tandis que Goethe
crit : Une re nouvelle s'ouvre pour le monde. Et puis l'on va se
faire la main sur la Pologne, ce que Goethe trouve encore trs bien.
L'Action franaise, 5 fvrier 1931.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 193
2.15
La Pologne et ses amis
L'Action franaise, 24 octobre 1934.
Retour la table des matires
PLUSIEURS fois diffre, la visite Varsovie du gnral Goemb-
s a eu lieu avec une remarquable discrtion. Le chef du gouverne-
ment hongrois n'a pas voulu qu'il ft donn cette rencontre plus de
sens qu'elle n'en a par elle-mme. Il a t dcor de l'Aigle blanc. Il a
caus avec le marchal Pilsudski et le colonel Beck. On tait entre mi-
litaires et entre camarades.
De part et d'autre, la vieille amiti des deux pays est voque. Il est
sr qu'il n'y a pas, pour la Pologne, de sujets de dissentiment avec la
Hongrie, pas plus qu'il n'y en aurait pour la France elle-mme si, par
infortune, et depuis bien des annes, la Hongrie ne se trouvait toujours
dans l'ost oppos.
Il va sans dire que la politique polonaise, s'tant rapproche de la
politique allemande, se rapproche aussi de la politique hongroise. La
seule obscurit est de savoir jusqu' quel point la Pologne pouse le
rvisionnisme germanique et magyar. Il est, somme toute, original
qu'un pays ressuscit par les traits de 1919 s'associe aux ngateurs de
ces traits.
Nous comprenons fort bien que, dans son orientation nouvelle, la
Pologne a eu pour motif dterminant l'alliance de la France et des So-
viets. La Pologne n'a pas voulu tre serre entre l'corce russe et l'ar-
bre allemand ni servir de thtre une rencontre de l'arme rouge et
de la Reichsheer. Elle a recherch une sorte de neutralit. A-t-elle la
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 194
garantie que l'Allemagne, en change, garantit l'intgrit de son terri-
toire ?
Cette question en pose d'autres. Quels sont les desseins militaires
de l'Allemagne ? Quelle est la nature de notre accord avec l'U. R. S.
S. ? Est-ce une alliance dfensive ? Quels cas prvoit-elle ? Les pr-
voit-elle tous ?
Il en est un qui est tenu pour vraisemblable. Militaires et politiques
allemands ont beaucoup rflchi depuis 1918. Ils ont cherch les cau-
ses de leur dfaite. Ils les connaissent. On trouvera dans le livre rcent
du gnral Mordacq, les Leons de 1914 et la prochaine guerre, l'es-
sentiel de ces rflexions. Il y a des raisons de penser qu'une autre fois
l'Allemagne vitera de tomber dans les mmes fautes, qu'elle ne cher-
chera pas la guerre sur deux fronts et qu'elle rservera toutes ses for-
ces pour le principal adversaire. Ds lors, il est tout naturel que, dci-
de porter ses coups du ct de la France, elle neutralise la Pologne
qui a repouss le pacte oriental et se contenterait sans doute de monter
la garde devant la Russie, - si nous pouvons attendre de la Russie
rouge des services gaux ceux que la Russie blanche, en 1914, nous
a rendus.
En dfinitive, l'attitude de la Pologne renforce la prsomption
qu'un autre Schlieffen est l'oeuvre et prpare une attaque l'Ouest et
peut-tre contre la France seule. A cette fin, Hitler continue et doit
continuer Stresemann, selon la maxime du gnral Krauss cite par le
gnral Mordacq : Si l'on peut taler les apparences d'une politique
de paix, ce ne doit tre que comme un stratagme trompeur pour en-
dormir le peuple sur qui on a des vues et le surprendre endormi dans
l'imprvoyance.
Il est croire que la Pologne elle-mme aurait quelque chose tirer
de cet avis. Mais il n'est dj pas sr qu'en France on en saisisse l'utili-
t.
L'Action franaise, 24 octobre 1934.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 195
2.16
Le sjour de M. Goering en Pologne
et le problme de Memel
La Libert, 29 janvier 1935.
Retour la table des matires
LE gnral Goering, en costume de grand veneur, s'est rendu en
Pologne pour y chasser le lynx dans la fort profonde. Le lynx est un
curieux gibier. L'auroch serait un plus beau coup de fusil. Le temps de
le tirer n'est pas encore venu. L'auroch n'est pas point. Ce sera pour
une autre fois.
Le lynx s'appelle en lithuanien Klapeida et en allemand Memel.
Quant l'auroch, dont la poursuite et l'hallali sont diffrs, peut-tre
un jour se nommera-t-i1 tout simplement Pologne.
En attendant, la Pologne entretient des rapports intimes avec l'Al-
lemagne. Il faut savoir pourquoi. Ce rapprochement, qui et sembl
nagure incroyable, tient plusieurs raisons.
Il tient d'abord la politique que la France a faite elle-mme. Si la
collaboration de Berlin et de Varsovie semble bizarre, que dire de la
collaboration de Paris et de Moscou ? C'est par l que le relchement
des liens entre la Pologne et nous a commenc.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 196
*
* *
On n'est pas ami de tout le monde, comme le Sosie de Molire. Ce
n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Une amiti nouvelle en aline une
ancienne. On perd d'un ct ce qu'on gagne de l'autre. Ou bien il fau-
drait que le monde ft compos d'anges et de saints sans intrts ter-
restres, ce qui n'est pas.
Il y avait certainement Varsovie, avant notre rapprochement avec
Moscou, des partisans d'une entente troite avec l'Allemagne. Le co-
lonel Beck, aujourd'hui ministre des Affaires trangres, en tait. Ces
prfrences et ces sympathies, pour se traduire par des actes, ont eu
besoin d'un motif, au moins d'un prtexte. Motif ou prtexte sont ins-
crits sur la carte, cette carte de l'Europe de l'Est qu'on a tort de ne pas
mieux regarder quand on rve chez nous d'une nouvelle alliance russe.
L'Allemagne et la Russie n'ont plus de frontire commune. Qu'ar-
riverait-il donc si elles entraient en conflit ? Elles devraient se battre
sur le corps de la Pologne, qui ne tient pas redevenir champ de ba-
taille et qui se dit que le vainqueur, quel qu'il ft, refuserait de s'en
aller. La Pologne estime, tort ou raison, que son indpendance est
mieux protge par une entente avec l'Allemagne.
*
* *
En tout cas, s'il faut choisir, c'est l'Allemagne qu'elle choisit parce
que les chances hitlriennes lui semblent meilleures que les chances
sovitiques. C'est peut-tre encore tort ou raison. Mais, Varsovie,
on considre que le pouvoir du Fhrer est plus solide que l'Occident
ne le pense, tandis que l'heure est passe pour les ides socialistes et
dmocratiques sur le succs desquelles la politique franaise semble
encore compter. Le rsultat du plbiscite de la Sarre n'est pas de na-
ture changer sur ce point l'opinion du marchal Pilsudski et du colo-
nel Beck.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 197
Seulement, si notre pacte avec les Soviets est un douteux billet, ce-
lui de la Pologne avec l'Allemagne ressemble beaucoup aux pactes
qu'on signe avec le diable. La chasse au lynx en est tmoin. Les Polo-
nais ont de vieux griefs contre les Lithuaniens auxquels les Allemands
veulent reprendre Memel.
Que la Lithuanie soit dpece, qu'arrivera-t-il ensuite ?
De qui sera-ce le tour ? Nous craignons de le deviner - ou plutt,
tout le monde le devine.
La Libert, 29 janvier 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 198
2.17
Rapprochement avec l'Allemagne ?
La Libert, 4 avril 1935.
Retour la table des matires
M. Eden s'tant arrt Varsovie son retour de Moscou, M.
Pierre Laval est invit faire la mme halte pendant le mme itin-
raire. Il et t tout fait fcheux qu'il brlt la gare. Et l'on peut tre
assur qu'il sera reu avec les manifestations d'une amiti sincre.
Mais Louis Barthou avait dj t accueilli avec toutes les marques
de l'affection, ce qui n'avait rien chang l'tat des choses diplomati-
ques tel que l'accord de la Pologne et de l'Allemagne l'ont cr. Le
sentiment et la politique font deux.
Le systme des pactes n'est pas propre rassembler ces deux l-
ments, d'abord parce qu'il est obscur et ce qui est obscur ne donne ja-
mais confiance. Or, les amendements que M. Eden suggre d'apporter
aux pactes de l'Europe orientale font dsirer un peu plus de lumire.
On est alli ou bien on ne l'est pas ; on se doit rciproquement et l'on
s'apporte assistance en cas de danger ou bien il n'existe pas d'engage-
ments. Il n'y a pas de moyen terme.
Lorsque la Pologne s'est rapproche de l'Allemagne, elle a eu une
circonstance attnuante. Elle n'avait de garanties formelles nulle part
et elle devait, ses cts, choisir entre deux prils. Elle a modifi un
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 199
mot de sa devise clbre et elle en a ajout un autre : Dieu est trop
haut, la France trop bas, la Russie trop prs.
Il y a des Polonais qui craignent l'Allemagne plus que la Russie et
d'autres pour qui c'est le contraire. Cela fait chez eux comme dans la
Sude du temps jadis le parti des bonnets et le parti des chapeaux. Ce
qui est vrai, c'est que la Pologne est fort plaindre d'avoir deux pareils
voisins.
Peut-tre celui de l'Ouest se chargera-t-il lui-mme de montrer qu'il
est le plus dsagrable et que ceux qui, selon l'exemple donn jadis
par l'Autriche et l'Italie, s'allient avec lui pour ne pas se battre, ne sont
pas l'abri de ses convoitises. La dfinition de l'amiti, c'est vouloir
les mmes choses . L'Allemagne veut surtout certaines choses qui
sont la Pologne.
La politique polonaise a opt pour l'entente avec Hitler. Cela pas-
sera. Elle s'est loigne de nous. Cela reviendra et peut-tre mme
plus tt que nous ne le dsirons si la Pologne appelle au secours.
La Libert, 4 avril 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 200
2.18
Pilsudski
L'Action franaise, 14 mai 1935.
Retour la table des matires
Il meurt au moment mme o, l'un de nos ministres quittant Var-
sovie pour se rendre Moscou, la politique polonaise est, en France,
l'objet de discussions qui montrent qu'elle est pour nous aussi peu d-
finissable que l'original dictateur lui-mme.
Qu'tait Pilsudski ? Peut-tre un homme qui connaissait son pays,
c'est--dire la nature de l'histoire de son pays, qui se rappelait que, ja-
dis, l'indpendance de la Pologne avait succomb ce qu'on appelait
la dmocratie nobiliaire , remplace de nos jours par la dmocratie
parlementaire.
Ses partisans, ses interprtes nous ont souvent dit : Vous vous
tonnez de notre accord avec l'Allemagne. Vous en tes froisss. Te-
nez-vous compte, dans vos pactes, de notre situation ? Croyez-vous
que nous ne soyons pas meilleurs juges de nos propres intrts que
nos meilleurs amis ?
On oublie, un peu lgrement, qu'en 1920 la Pologne avait t en-
vahie par l'arme rouge et qu' peine sortie du tombeau elle avait failli
prir. Pilsudski remporta deux victoires de Varsovie, l'une, d'abord,
sur les Russes ; l'autre, en 1926, sur la vieille anarchie que dj Cathe-
rine favorisait.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 201
Le but de Catherine tait de perptuer et d'augmenter les dsor-
dres de la Pologne afin d'achever son ouvrage. Qu'on observe que la
Russie s'est constamment oppose ce que la Couronne de Pologne
devnt hrditaire, on apprciera mieux les motifs qu'elle fit enfin va-
loir pour consommer le dmembrement. Dans la nouvelle constitution
que l'influence russe et la violence firent adopter, les abus taient soi-
gneusement conservs. La forme du gouvernement resta toute rpu-
blicaine, le liberum veto fut remis en usage, la faiblesse du pouvoir
excutif assure et l'anarchie des dites perptue.
Ces choses, et d'autres plus nouvelles, taient prsentes l'esprit de
Pilsudski. Dans la biographie du marchal qui vient de paratre en
franais comme pour une oraison funbre, M. Paul Bartel rappelle,
sans commentaire, un fait perdu dans le tourbillon des vnements
contemporains. En 1920, le gnral Weygand et une lite de militaires
franais avaient apport le concours de leur savoir et de leur exp-
rience la Pologne, risquant le supplice s'ils tombaient prisonniers des
bolcheviks, puisqu'ils n'taient pas des belligrants rguliers. Mais si
la France avait prt quelques-uns des meilleurs de ses fils, d'o
taient venues les munitions au transport desquelles les socialistes de
certains pays occidentaux s'opposaient ? De Hongrie. Franaise et
hongroise, ce fut, sans que nous dsirions nommer les manquants,
toute l'assistance que la Pologne reut.
Et l'on est surpris qu'elle soit en dfiance non seulement contre la
Russie, mais contre certains autres voisins ! Le contraire seul serait
surprenant.
La dictature de Pilsudski, sur les caractres particuliers de laquelle
il y aurait beaucoup dire, tait minemment viagre. On voit mal ce
qui lui sera substitu. On voit trs bien le nombre des difficults aux-
quelles doit encore faire face la Pologne merveilleusement ressuscite
d'entre les morts.
L'Action franaise, 14 mai 1935.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 202
La Roumanie
3.1
Le cinquantenaire
de l'indpendance Roumanie
L'Action franaise, 11 Mai 1927.
Retour la table des matires
Au banquet qui a t donn avant-hier pour le cinquantenaire de
l'indpendance roumaine, M. Diamandy, reprsentant de la Roumanie
en France, a prononc un discours nourri d'ides et de faits, dans le-
quel il a retrac grands traits - mais ce sont des traits fortement buri-
ns - l'histoire de son pays. En l'coutant, nous songions aux pages o
Lon de Montesquiou a autrefois dgag la philosophie historique des
expriences du peuple roumain.
Dans un temps o ces ides ne sont pas la mode, M. Diamandy a
mis admirablement en lumire, ce qui aura peut-tre t une rvlation
pour quelques-uns de ses auditeurs, les services que l'institution mo-
narchique a rendus ces principauts danubiennes dont l'avenir
n'avait t devin que par des hommes d'une prescience rare, et qui
sont devenues un Etat et une nation, qui ont rsist aux crises de crois-
sance comme l'hostilit des Empires voisins, qui ont mme pu ache-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 203
ver leur unit territoriale partir du jour o elles ont eu l'unit du pou-
voir et la suite dans le gouvernement.
C'est une histoire curieuse que celle de ce rameau catholique d'une
famille allemande - celle des Hohenzollern ni plus ni moins - qui,
plant aux bords du Danube, dans un pays rattach Rome par l'es-
prit, Byzance par la religion, a grandi comme un arbre indigne. Se-
lon l'expression de M. Diamandy, l'instant mme o le prince
Charles posa le pied sur le sol roumain, il fut naturalis roumain, de
toute son me . Il en avait t de mme, quelques annes plus tt,
pour Lopold de Saxe-Cobourg devenu roi des Belges, comme, dans
un autre sicle, pour le duc d'Anjou devenu roi d'Espagne.
Pourquoi un peuple qui n'a pas de dynastie nationale va-t-il cher-
cher une dynastie trangre ? M. Diamandy l'a expliqu en termes
d'une clart saisissante : l'instabilit du pouvoir (c'est--dire les com-
ptitions pour le pouvoir), menaait la nation roumaine, encore
peine affranchie, de tomber dans l'anarchie, et, par l'anarchie, de re-
tomber dans la servitude :
Il tait ncessaire que le trne devnt le centre de gravit de l'tat
roumain, l'agent directeur et pondrateur qui maintient l'quilibre et
assure la continuit. Le besoin d'assurer la stabilit du trne a t
ressenti avec tant de force qu'il nous a tous rallis l'acceptation
d'une dynastie trangre. Vous pouvez en conclure combien les Rou-
mains ont jadis souffert de leurs continuels changements de rgime.
Un vestige de ce que fut, pour eux, cette exprience amre, s'est fix
dans un de leurs vieux proverbes qui, pour n'tre pas arabe, n'en est
pas moins clairvoyant : Changement des rgnes, joie des fous.
Cette leon de politique n'est pas la seule que M. Diamandy ait
donne. Il a montr par l'exemple de son pays que les lendemains de
victoire sont tragiques . Ayant, en [877, aid la Russie vaincre les
Turcs, la Roumanie, en rcompense, fut dpouille de la Bessarabie.
Et si, aprs la guerre de 1918, elle a retrouv cette province, les So-
viets la lui contestent encore. Telle est la morale, telle est la justice,
mme dans les guerres du droit .
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 204
Aprs cette constatation non pas amre, mais simplement raliste,
nous avons t un peu tonn d'entendre une apologie sans rserves du
principe des nationalits. M. Diamandy nous permettra-t-il de lui faire
remarquer que ce principe est double tranchant. Pareil au sabre de
M. Prudhomme, il sert fonder les units nationales et les dtruire.
Si la Roumanie en a eu le profit dans le pass, il n'y a plus gure qu'un
peuple en Europe qui puisse en attendre un bnfice. C'est l'Allema-
gne. Au nom du principe des nationalits, elle rclame la runion de
l'Autriche. Elle pourra encore rclamer maintes annexions ou ran-
nexions petites et grandes. Dans l'intrt de tous, mais surtout dans
celui des pays de la Petite-Entente, mieux vaudrait ne pas rouvrir cette
bote de Pandore.
L'Action franaise, 11 Mai 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 205
3.2
La mort de Ferdinand 1
er
L'Action franaise, 21 juillet 1927.
Retour la table des matires
LE roi de Roumanie est mort hier aprs une longue maladie, vri-
table calvaire. Sur son lit de mort, il a d encore rgler la succession
au trne et prparer la transmission de l'autorit roumaine au Conseil
de rgence. Il fallait en outre que le pouvoir ft entre des mains fer-
mes et sres. On dirait que Ferdinand 1er a rassembl assez de force
pour rsister son mal jusqu'au moment o les Bratiano ont t l.
Depuis les premiers jours de son histoire moderne, la Roumanie a
trouv cette famille d'hommes d'tat aux cts de la monarchie. Elle
la retrouve encore et c'est la garantie que tout se passera avec ordre et
rgularit. Lorsqu'un Bratiano a t de nouveau premier ministre, Fer-
dinand 1er a pens : Maintenant, je puis mourir.
La couronne nationalise ceux qui la portent. C'est une exprience
qui a t faite partout avec le mme succs, mais jamais peut-tre avec
la mme plnitude que par la dynastie roumaine. Ferdinand 1er tait
un Hohenzollern. Il tait n dans la petite principaut de Sigmaringen
d'o son oncle tait parti un jour pour rgner, malgr l'Europe, aux
bords du Danube. Toute sa jeunesse s'tait passe dans le prestige et
l'clat de l'empire allemand. Comme son oncle, il avait sans doute des
sympathies pour l'Allemagne, comme il avait des liens de famille avec
le roi de Prusse. Cependant, l'heure venue, en 1916, il n'hsita pas
entrer en lutte avec les deux empires du centre pour rpondre aux as-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 206
pirations de son pays et, dans une situation identique celle du roi
Victor-Emmanuel inclinant la balance en faveur de l'intervention,
achever l'unit roumaine.
Sombre pisode de la guerre, qui ne couvrit pas de gloire les Al-
lis, et o l'tat roumain abandonn et trahi faillit prir. Ferdinand 1er
ne changea pourtant ni de camp, ni d'ide, ni d'esprance. L'vne-
ment final lui donna raison. En 1918, la Roumanie trouvait toutes ses
frontires nationales. Et Ferdinand 1er, en refoulant ses sentiments
intimes, avait rempli sa mission.
Ou plutt, il n'en avait rempli que la premire partie. Il restait as-
similer les provinces qui venaient presque doubler l'ancien royaume.
Qu'on imagine la runion d'une Alsace-Lorraine aussi grande que la
France et dont la communaut, au lieu de remonter moins d'un
demi-sicle d'annexion, n'et rsid que dans de lointains souvenirs.
Voil pourtant comment s'est constitue une grande Roumanie, aussi
unie, aussi ordonne que l'ancienne, parce que - M. Diamandy, son
trs distingu reprsentant Paris le rappelait rcemment - elle a en-
core, dans sa dynastie, le point d'appui qui ne lui a jamais manqu de-
puis 1866.
Comme si les preuves taient rserves la Roumanie pour
qu'elle en triompht, ce sont des difficults dynastiques qui ont occup
les derniers jours de Ferdinand 1er. L aussi il a impos silence ses
sentiments. Il n'a cout que l'intrt de l'tat. Il a t jusqu'au bout
l'esclave du devoir professionnel. Chose rare : les Roumains savent et
reconnaissent les services qu'il leur a rendus. C'est la seule rcom-
pense du mtier de roi, comme le sacrifice de soi-mme en est la
condition.
L'Action franaise, 21 juillet 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 207
3.3
En Roumanie
L'Action franaise, 10 octobre 1927.
Retour la table des matires
Un voyage, un beau voyage, en Roumanie m'a fait dlaisser, durant
deux semaines, le devoir du commentaire quotidien. Puis-je jeter tou-
tes chaudes sur le papier, en descendant du train, quelques impres-
sions ?
A prs de 3 000 kilomtres de Paris, il est un pays de latinit, spa-
r de nous par plusieurs barrires, entour de voisins diffrents ou
hostiles, qui vit avec nous en ide, et qui se demande sans cesse :
Que devient la France ? Que pense-t-elle ? Que fait-elle ? Oui,
nous savons bien, en gros, que le peuple roumain est un peuple parent
et ami, dont les affinits naturelles et lectives sont franaises. Ceux
qui le savent le mieux ne le savent pas encore assez quand ils n'ont pas
vu et senti sur place le miracle d'un pays qui, aux bouches du Danube,
aux bords du Pont-Euxin, travers les sicles et les vicissitudes des
oppressions, a gard la conscience et la vitalit d'tre un rameau dta-
ch du monde occidental. Maurice Barrs aurait dit un bastion de
l'Est , le plus avanc et le plus expos des bastions.
Pays longtemps foul aux pieds, pays maintes fois sacrifi, pays
victime de plusieurs barbaries et encore menac, mais qui, de son in-
scurit mme, de sa raction dfensive contre le danger des invasions
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 208
tire les rgles de sa vie : la dfinition de la Roumanie tiendrait peut-
tre dans ces quelques mots. En tout cas, c'est de l que dcoulent les
principes essentiels de sa politique comme de sa spiritualit.
Regardez la carte. La Roumanie a six voisins. Trois sont hostiles :
la Russie, la Hongrie et la Bulgarie. Les trois autres, Yougoslavie,
Tchco-Slovaquie, Pologne, sont slaves, avec une nature, des sympa-
thies, des tendances divergentes. C'est encore avec les Polonais que
les Roumains auraient le plus de contact si, gographiquement, ce
contact n'tait si troit, rduit une si mince bordure, et si, d'autre
part, prise entre la Russie et l'Allemagne, la Pologne n'avait tant
faire pour se dfendre elle-mme.
De cet tat de vie, on peut dire, sans rien outrer, qu'il est terrible.
Auprs de lui, le ntre passera pour doux, et notre fragile scurit de
limitrophes des Allemands devient presque enviable. C'est ce qui d-
termine les deux ides par lesquelles est domine la Roumanie d'au-
jourd'hui, et sans lesquelles eue courrait le risque de prir : l'ide de
nationalit et l'ide d'ordre.
Alors on ne s'tonne pas des sympathies que trouvent chez les in-
tellectuels roumains les doctrines de l'Action franaise. On ne s'tonne
pas de l'emploi, je dirai mme de 1'adoption, qu'ils en ont faite. Qu'y
avait-il la base et l'origine de l'Action franaise ? Un nationalisme
dfensif, le sens d'un danger prochain, point de dpart pour une dfini-
tion des conditions du salut public. Toute l'histoire de la Roumanie
contemporaine traduit cette dfinition, depuis l'tablissement de la
monarchie hrditaire, il y a soixante ans, jusqu' la modification, par
raison d'intrt national, de l'ordre d'hrdit, l'institution royale tant
conue comme une fonction fonde sur l'utilit gnrale et dont les
droits quivalent des devoirs.
La Roumanie a besoin d'autorit. Selon le juste thme que M.
Mussolini dveloppait un jour, elle n'a pas les moyens de se payer le
luxe d'une dmocratie. Les hostilits qui l'entourent lui font un besoin
d'un gouvernement fort. D'autre part, le voisinage des Soviets cre
chez elle une rpulsion salutaire, et il est proverbial Bucarest de dire
que tout ce qui est mauvais, jusqu'au vent glac des steppes, vient de
Russie.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 209
Seulement, pour rsister tant de pressions et de pestilences, les
Roumains ont encore un besoin : celui de sentir une rsistance solide
l'extrme Occident. Leur vritable inquitude, faut-il la dire ? Elle
perce travers leurs propos et leurs questions. Contre le communisme,
la Roumanie tient. La France tiendra-t-elle ? C'est peut-tre le souci
majeur de ces Latins posts comme des sentinelles aux frontires de
l'Asie.
L'Action franaise, 10 octobre 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 210
3.4
En Roumanie
L'Action franaise, 21 mars 1928.
Retour la table des matires
LES manifestations de l'opposition en Roumanie sont juges par
les uns comme plus bruyantes que graves et, par les autres, comme la
menace d'un redoutable conflit. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne se
soucie mme pas assez de savoir, c'est entre qui le conflit a lieu et en
quoi il consiste.
Il faudrait lire, pour tre difi, un petit ouvrage, du reste fort ten-
dancieux, que publiait nagure M. J acques Ancel et qui annonait
les Balkans aux balkaniques par la constitution de partis et de
gouvernements paysans, l'exemple de ce que la Bulgarie a dj
connu. M. J acques Ancel dcouvrait les mmes symptmes en You-
goslavie et en Roumanie. Ces symptmes sont ceux d'un tat d'esprit
nouveau des masses agraires accdant la conscience politique et as-
pirant au pouvoir dans des pays gouverns, depuis qu'ils ont acquis
leur indpendance, par une oligarchie d'hommes clairs.
C'est bien ainsi que les choses se prsentent en Roumanie. Les
Transylvains, nouvellement runis aux provinces moldovalaques,
noyau de l'unit, jouent Bucarest le rle des Croates Belgrade, M.
Maniu celui de M. Raditch. La disparition presque simultane de J ean
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 211
Bratiano et de Pachitch ajoute la ressemblance. Les vieux chefs ex-
priments et de formation intellectuelle occidentale qui avaient dirig
si longtemps leur pays avec des ides o l'on reconnaissait notre Fa-
cult de droit et notre cole de la rue Saint-Guillaume, ces vieux chefs
s'en vont au moment o de nouvelles couches se lvent, et prcis-
ment dans les rgions libres du joug tranger par la politique de ces
hommes d'tat.
Le parti national paysan qui menace les libraux roumains d'une
insurrection n'est donc pas simplement un parti qui prtend, selon les
rgles du jeu parlementaire, en remplacer un autre. M. Maniu, M.
Voda Vovod, M. Sorga ont beau tre eux-mmes des hommes culti-
vs et des messieurs , ils ne sont tolrs la tte du mouvement
que comme chevaux de renfort, pareils ces bourgeois loquents, ins-
truits et mme riches qui se servent du socialisme et dont le socialisme
se sert jusqu' ce qu'il les rejette ou les dvore. Il s'agit bien en Rou-
manie d'une classe paysanne qui ne veut plus du gouvernement des
messieurs .
Nous voyons mal ce qu'on y gagnera et nous distinguons trs bien
ce qu'on aura y perdre. Les messieurs parlaient europen, c'est--
dire le plus souvent franais. Ils avaient institu un gouvernement aus-
si semblable que possible aux gouvernements occidentaux et acclima-
t le rgime constitutionnel rendu inoffensif par une fiction semblable
celle du rotativisme espagnol. Le gouvernement des paysans offrirait
tous les risques de la dmagogie inculte, plus ceux du nationalisme
aveugle. Si le pouvoir doit tre enlev aux messieurs qui avaient
l'ide de l'tat, on regrettera les messieurs .
L'Action franaise, 21 mars 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 212
3.5
Le testament cass
L'Action franaise, 9 juin 1930.
Retour la table des matires
CHARLES de Hohenzollern-Sigmaringen, grand-oncle du prince
Carol, ayant t lu prince rgnant de Roumanie, malgr l'Europe
mais avec l'appui secret de Napolon III, avait chapp la surveil-
lance autrichienne, s'tait embarqu avec un dguisement sur un des
bateaux qui descendent le Danube, puis tait entr tout tranquillement
dans son royaume. L'Europe aussitt le reconnut.
Cet incident eut des consquences historiques considrables. Lors-
que, quatre ans plus tard, un autre Hohenzollern fut lu au trne d'Es-
pagne, le gouvernement de Napolon III ne se contenta pas de sa re-
nonciation. Il exigea une garantie du gouvernement prussien parce
qu'on se souvenait Paris de la manire dont on avait aid Charles
braver la mme sorte d'interdiction. Tout le monde sait que la de-
mande de garantie fut l'occasion dont Bismarck se saisit pour provo-
quer la guerre de I870 d'o sortit l'Empire allemand.
Nous ne croyons pas que la rentre du prince Carol produise des
effets aussi tendus. C'est jusqu' prsent une affaire intrieure rou-
maine, purement roumaine. Carol Il a aujourd'hui trente-sept ans. Il
peut tre assagi, guri de ses garements et pchs de jeunesse et faire
son tour un trs bon roi.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 213
Vraisemblablement, le gouvernement de M. Maniu et du parti na-
tional-paysan, entr depuis quelques semaines dans des difficults as-
sez graves, s'est servi du prince Carol comme d'un bouclier. Lorsque
le roi Ferdinand avait exclu son fils de sa succession, les libraux
taient au pouvoir avec J ean Bratiano. Peut-tre (ce n'est qu'une hypo-
thse, mais elle nous parat satisfaisante) M. Maniu, qui s'est lui-
mme retir, a-t-il pens qu'il consoliderait son parti en opposant Ca-
rol II au parti que dirigent aujourd'hui M. Vintila Bratiano et M. Duca.
Mais qui sait si Carol roi gardera les rancunes du prince exhrd ?
On dit qu'il a pris modle sur le malheureux roi Charles rentrant en
Hongrie bord d'un avion. La voie des airs serait-elle le chemin des
trnes ? Qui sait si quelque jour, attendu Buda-Pest comme Carol
l'tait Bucarest, le prince Otto ne descendra pas aussi du ciel avec la
couronne de saint tienne sur la tte ?
Il y a du mouvement, il y a du nouveau dans une grande partie de
l'Europe. On casse des testaments royaux. On les brle comme des
bons A, B, C. Que d'autres choses, traits et constitutions, restent
casser et brler ! Nous avons comme une ide que l'vacuation de
Mayence donne beaucoup de gens l'ide de se drouiller les jambes.
L'Action franaise, 9 juin 1930.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 214
3.6
lections en Roumanie
L'Action franaise, 4 juin 1931.
Retour la table des matires
LE rsultat des lections roumaines est trs satisfaisant parce qu'il
prouve surtout que le pays n'a pas chang. Il y avait, dans la Chambre
prcdente, une norme majorit pour M. Maniu. Il y aura une norme
majorit pour M. J orga. Le systme rotatif fonctionne toujours.
C'est ainsi qu'il a fonctionn longtemps en Espagne. Il n'y en a pas
de meilleur pour corriger le rgime lectif comme, au jeu, se corrige le
hasard. Aussi il va sans dire que ces magnifiques rsultats ne s'obtien-
nent pas sans un certain contrle des urnes. Il y a en outre, en Rouma-
nie, une prime la majorit qui assure la totalit des siges, ou peu
s'en faut, au parti qui a le plus d'avance sur les autres. Mais du mo-
ment qu'un seul parti ne s'ternise pas au pouvoir, est-ce que le prin-
cipe n'est pas sauf ?
Dans la vraie doctrine du gouvernement reprsentatif, la majorit
est faite pour gouverner, la minorit pour contrler. Mais, avant de
contrler, il faut que l'on gouverne. Une majorit trs forte pour exer-
cer le pouvoir, une minorit faible peut-tre, mais compose de ttes
et de bonnes ttes pour surveiller et contrler le pouvoir, pour former
ce que les Anglais appellent le ministre de l'ombre , ce ne sont pas
de si mauvaises conditions. Les Cinq, au corps lgislatif du second
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 215
Empire, faisaient peut-tre une opposition plus efficace que deux
cents.
Seulement le fonctionnement rgulier du systme suppose d'abord
des partis bien organiss, de vritables machines, ensuite des lecteurs
dociles et qui ne tiennent que trs peu une opinion. C'est le parle-
mentarisme appliqu aux pays qui comptent une lite et beaucoup d'il-
lettrs. Ces conditions sont ralises en Roumanie o les mes-
sieurs du parti libral reviennent au pouvoir selon la norme tradi-
tionnelle. Nous serons ainsi trs heureux de retrouver M. Duca.
Ces conditions, elles taient ralises aussi en Espagne et la mo-
narchie parlementaire a dur aussi longtemps que les cadres des deux
partis, aussi longtemps en outre que les masses espagnoles se sont d-
sintresses de la politique et n'ont pas eu d'opinion. Tout s'est dtra-
qu quand les ides ont fait irruption comme des chiens dans un jeu de
quilles. On verra comment la Rpublique se tire du jeu fcond des
ides .
En Roumanie, les choses continuent comme elles taient. Beau-
coup de rumeurs alarmantes avaient t rpandues qui taient des ru-
meurs alarmistes. Il semble que la Roumanie ait fait deux conomies,
celle d'une rvolution et celle d'un coup d'tat. C'est beaucoup mieux
ainsi.
L'Action franaise, 4 juin 1931.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 216
3.7
Aprs le meurtre de Sinaa
L'Action franaise, 6 janvier 1934.
Retour la table des matires
UNE visite du roi de Bulgarie Bucarest devait succder sa vi-
site Belgrade. On annonce que ce voyage est contremand et ren-
voy sine die.
L'assassinat de J ean Duca est donn comme prtexte l'abstention
du roi Boris. C'est ce qui claire ce crime politique.
En effet, mme si l'on admet que la nouvelle de la visite annule
est tendancieuse, la tendance se voit distinctement. J ean Duca n'a pas
t frapp seulement parce qu'il avait dissous la ligue des Gardes de
Fer, mais parce qu'il tait fermement attach la Petite-Entente et la
France. Ou, ce qui revient au mme, il frappait cette association hitl-
rienne en raison de la ligne qu'il suivait, pour la politique extrieure de
la Roumanie, avec M. Titulesco.
En tuant J ean Duca, est-ce cette politique que l'on a voulu tuer ?
En tout cas, les lments qui aspirent placer la Roumanie dans le
cercle de l'influence allemande s'empressent d'interprter le meurtre
de Sinaa comme le point de dpart d'un changement d'orientation. Il
est trop certain que le rapprochement de la Bulgarie et de la Petite-
Entente gnait et offusquait beaucoup de monde. Sur les vritables
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 217
intentions du meurtrier, sur les desseins de ceux qui ont arm son bras,
on est rduit aux hypothses. Mais les commentaires ne laissent au-
cune incertitude. Ce n'est peut-tre pas cela que l'auteur de l'attentat a
voulu. C'est le parti qu'on cherche tirer de son action criminelle. De
mme les assassins de Franois-Ferdinand ne voulaient pas toutes les
consquences qui taient contenues dans leurs bombes, ce qui n'emp-
che pas que ces consquences en sont sorties.
L'indication ne peut donc pas tre nglige. Il y a dans la politique
europenne un endroit et un envers. Le Reich hitlrien observe
l'gard des puissances, et autant qu'il est en lui, les usages diplomati-
ques. Il prodigue mme les marques d'amiti. En ce moment prcis, sir
J ohn Simon et M. Mussolini cherchent (c'est--dire qu'ils ont dj
trouv) le moyen de lui donner satisfaction et bnissent l'accord parti-
culier dont le gouvernement franais, par pudeur, n'a pas voulu ou
feint de ne pas vouloir. Derrire ce rideau, l'ide hitlrienne se rpand
hors des frontires allemandes, fait des adeptes, agite et terrorise.
On comprend pourquoi Hitler tient avoir une arme. On l'a tou-
jours compris. On comprend encore mieux pourquoi il veut l'avoir
avec l'aveu des grandes puissances, auxquelles il demande surtout,
pour commencer, de lui livrer les petites.
L'Action franaise, 6 janvier 1934.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 218
3.8
La grande et la petite pointure
L'Action franaise, 5 octobre 1934.
Retour la table des matires
Il y a toujours eu, en Roumanie, des germanophiles. Mais s'il
existe un pays o la France soit aime pour elle-mme, c'est celui-l.
De temps en temps se livre une offensive des hommes et des partis
qui, pour une raison ou pour une autre, quelquefois par esprit de
contradiction, ou par dsir de se singulariser, prfrent l'Allemagne.
Nous venons d'assister l'une de ces offensives-l.
Ce n'est pas par hasard. La Roumanie est l'objet des sollicitations
et des tentations auxquelles la Pologne a dj succomb. La Yougo-
slavie est assige de la mme manire. Ainsi se dveloppent, aprs
les effets du pacte quatre, les effets de l'alliance avec les Soviets.
D'ailleurs le pacte quatre tait conclu avec l'Allemagne. L'Al-
liance avec les Soviets l'a t contre l'Allemagne. C'est mme l'unique
justification qu'on en donne. Ce qui n'empche pas qu' chaque fois
nous perdons un ami.
Si une contradiction manifeste existe entre les deux combinaisons
qui se sont succd si peu de distance, ce n'est pas ce qui importe le
plus. Le pacte quatre a subi le sort de tant d'autres. Il est oubli. Une
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 219
alliance, c'est plus srieux, et c'est pourquoi nous aimerions conna-
tre les engagements de la France l'gard des Soviets.
Mais il faut choisir entre les allis et aussi entre les dimensions
d'allis. En veut-on de grands, de moyens ou de petits ?
Si l'on opte pour les grands, il ne faut pas s'tonner que les moyens
et les petits rflchissent et se demandent s'ils ne seront pas mangs.
Ce n'est pas de la France qu'on peut avoir peur Belgrade ou Buca-
rest. C'est de l'Italie ou de la Russie.
Se rapprocher de l'Allemagne dans cette crainte, cela s'appelle se
mettre dans la gueule du loup. C'est possible. On le dira utilement
tous les intresss. Mais vous n'obtiendrez jamais que toutes les soci-
ts plaisent tout le monde.
L'Action franaise, 5 octobre 1934.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 220
La Turquie
4.1
Le pril asiatique
L'Action franaise, 5 janvier 1920.
Retour la table des matires
Il y a trois jours, le Times montrait que le bolchevisme flau asia-
tique, tendait vers la mer Caspienne pour soulever l'Asie centrale et
communiquer avec l'Asie Mineure, tandis que, d'autre part, il touche
la Mongolie. Et M. Winston Churchill vient de dire : De nouvelles
forces sont en train de surgir en Asie Mineure et, si le bolchevisme et
le nationalisme turc venaient se joindre, la situation serait grave pour
la Grande Bretagne.
Elle le serait en mme temps pour nous qui sommes chargs d'oc-
cuper la Cilicie et une partie de la Syrie. Des incidents sanglants se
sont dj produits Baalbek. Ce sont des symptmes. Mais on sait
autre chose. On sait que les forces nationales de Moustapha Kemal
chappent leur chef. Elles tournent l'tat de bandes et l'anarchie se
rpand travers la Turquie d'Asie. Il y a peu de semaines encore,
Moustapha Kemal tait le chef d'une arme organise et il tait possi-
ble de causer et de traiter avec lui. Nous n'en sommes plus l et il y a
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 221
lieu de croire que des officiers turcs passent au service des nationalis-
tes arabes de Syrie.
Tout cela prouve qu'il n'y a plus beaucoup de fautes commettre
en Orient. C'en est une d'avoir laiss courir Enver et Talaat et de ne
pas avoir exig qu'ils fussent livrs aux Allis au moment de l'armis-
tice. C'en est une autre de parler de chasser les Turcs de Constantino-
ple alors qu'il n'existe dj que trop de motifs de surexcitation dans le
monde de l'Islam. Les Allis n'ont pas tant de moyens leur disposi-
tion qu'ils puissent impunment accrotre les zones d'anarchie.
Ce qui a t vrai du tsar l'est du sultan et dans une mesure presque
gale. Le tsarisme, en Russie, reprsentait la seule forme connue de
gouvernement europen. Le gouvernement de Constantinople, par une
longue frquentation de l'Occident, s'tait europanis. Sa prsence
Constantinople exerait sur lui et sur les musulmans en gnral une
influence modratrice. Que gagnerons-nous, tous tant que nous som-
mes, Anglais aussi bien que Franais, ne plus avoir, au lieu des sul-
tans et de leurs vizirs, familiariss par des sicles de diplomatie, que
des tribus anarchiques, souleves par des passions nationales et reli-
gieuses et retombes dans la barbarie ?
Entre l'Europe et l'Asie, l'Empire tsariste et l'Empire ottoman for-
maient une transition. Tous deux permettaient, par des moyens divers,
aux puissances occidentales de dominer peu de frais les immenses
populations asiatiques. On reconnatra peut-tre bientt que le vieux
monde n'tait pas si mal organis pour la dfense de la civilisation.
Qu'on ne dtruise pas le peu qu'il en reste !
L'Action franaise, 5 janvier 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 222
4.2
Constantinople et la Russie
L'Action franaise, 24 septembre 1922.
Retour la table des matires
LE rsultat de la journe d'hier est trs satisfaisant. Nous esprons
qu'il ne sera pas gt par de nouveaux excs de langage, car il est dif-
ficile de ne pas se souvenir que la fameuse note Reuter date de huit
jours seulement. Ce rsultat obtenu avec l'assentiment de lord Curzon
peut se rsumer en ces quelques mots : la Turquie est rintgre en
Europe. C'est le principe que nous avons toujours soutenu ici.
Il a triomph grce la clairvoyance et la tnacit de Franais qui
auront eu ce succs une large part ; nous citerons parmi eux, et en
premire ligne, le gnral Pell, l'amiral Dumnil et le colonel Mou-
gin.
La Turquie tant redevenue puissance europenne, l'Europe re-
prendra aussi une figure qui nous tait connue. Les lments de la po-
litique se regroupent selon des rgles familires au milieu des nouvel-
les circonstances et des dplacements de forces que la guerre a crs.
La Turquie doit tre considre et traite dsormais comme une partie
du futur quilibre.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 223
Voyons donc les consquences de sa restauration par rapport au
pays en fonction duquel son existence comme tat europen a tou-
jours le plus compt : nous avons nomm la Russie.
La note arrogante , comme l'appellent les journaux de Londres,
que les Soviets ont envoye au gouvernement britannique au sujet de
la question d'Orient et des Dtroits n'a pas t donne en entier dans la
presse franaise. Elle est pourtant remplie de choses curieuses et
considrablement gnantes pour M. Lloyd George. Il est peine
croyable, en effet, que le cabinet de Londres ait poursuivi la fois une
politique de rapprochement avec les bolcheviks qui, de gr ou de
force, reprsentent la Russie, et qu'il ait tenu la Russie pour inexis-
tante quand il s'est agi de la question d'Orient qui, mme si le peuple
russe tait mort, le rveillerait du tombeau.
Le Manchester Guardian, toujours bien renseign sur Moscou, a
publi ces jours-ci une intressante correspondance o l'on voit que le
pouvoir bolcheviste a t la fois ravi et constern des victoires de
Moustapha Kemal. Au fond, c'est l'inquitude qui l'emporte. Une Tur-
quie dsespre, rvolte, hors la loi, pouvait tre une allie pour le
bolchevisme. Une Turquie satisfaite, une Turquie rentre en Europe,
n'a pas plus d'attrait pour le bolchevisme que le bolchevisme n'a d'at-
trait pour elle. La Turquie Constantinople redevient une rivale pour
la Russie. D'ailleurs, le prfr de Moscou, ce n'est pas Moustapha
Kemal, c'est Enver.
Si la politique anglaise restait dans la ligne de ses traditions, c'est
du ct de la Russie qu'elle regarderait en ce moment. C'est par rap-
port la Russie qu'elle envisagerait la paix de l'Orient. Cela, certains
Anglais le sentent et nous en voyons des signes dans la nombreuse
correspondance que reoivent et que publient, comme dans tous les
moments d'motion et de crise, les journaux anglais. Dans une de ces
lettres, reue par le Times, un lecteur crit en passant que la Russie
redevenue puissante poursuivra l'gard de Constantinople la mme
politique qu'au dix-neuvime sicle. C'est la vrit mme. C'est le trait
de lumire qui devrait frapper les hommes d'tat anglais.
La note des Soviets, la note arrogante dont nous venons de par-
ler, rappelle en effet l'Angleterre qu'aucune Russie ne souffrira que
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 224
le sort de Constantinople et des Dtroits soit fix sans elle. D'aprs le
Manchester Guardian, Tchitcherine, Gnes, aurait parl de Constan-
tinople M. Lloyd George qui aurait rpondu en se moquant de lui. Et
le passage le plus intressant du document moscovite, celui qui de-
mande tre cit en entier, fait prcisment allusion quelque chose
de voisin, sinon de semblable. Le diplomate bolcheviste reproche
amrement l'Angleterre de n'avoir pas voulu admettre la Russie lui
parler des Dtroits :
La Russie serait on ne peut plus dispose contribuer la fin d'une
guerre ruineuse pour la Grce et la Turquie. Mais ses efforts en ce
sens ont t repousss catgoriquement par la Grande-Bretagne. Deux
fois le gouvernement russe proposa que la Turquie ft invite la
Confrence de Gnes, mais la Grande-Bretagne et ses allis rejetrent
cette proposition. Pourtant la Confrence de Gnes, qui tait arrive
une dcision importante sous la forme d'un pacte de non-agression,
constituait une occasion tout fait convenable pour l'examen et le r-
glement possible du problme du proche Orient.
Nous avons ainsi le tmoignage qu'au moment o M. Lloyd
George travaillait un rapprochement avec les bolcheviks et ne ces-
sait de dire que ce rapprochement tait indispensable pour le rtablis-
sement de l'quilibre conomique, il excluait la Russie des affaires
orientales comme d'une chasse garde. La Confrence de Gnes s'est
ainsi double d'une Confrence de Berlin, d'une sorte de San Stefano
discret. Qu'est-ce dire, sinon que la position classique de l'Angle-
terre vis--vis des Russes n'a pas chang ?
Si l'Angleterre - et elle affirme n'en avoir jamais eu l'intention
-s'tait tablie Constantinople, elle aurait eu la Russie pour adver-
saire. Si c'est la Turquie, le Turc redeviendra l'ennemi naturel du
Russe. Il parat difficile qu'on ne voie pas ces choses--l Londres
comme nous les voyons Paris. Si on les voit, on doit reconnatre
aussi que le Turc est encore pour les Dtroits le meilleur occupant et
que c'est la France qui, par un vritable paradoxe, dfend, avec les
principes qui ont t et qui sont redevenus les siens, les vritables tra-
ditions de la politique anglaise. On a peut-tre plus de chances de re-
voir la France et l'Angleterre allis quand on dfend la cause des
Turcs que quand on l'attaque.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 225
L'Action franaise, 24 septembre 1922.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 226
4.3
Le gouvernement turc
aujourd'hui et demain
L'Action franaise, 5 novembre 1922,
Retour la table des matires
ON peut commenter l'infini la dchance de Mahomet VI. Pour
l'instant, le Sultan ne se montre pas trs affect. Il reste sous la protec-
tion du gnral Harington et des garnisons allies et, en somme, il r-
siste la volont de l'assemble d'Angora. Il a clbr le Selamlik
comme l'ordinaire et, jusqu' prsent, le Cheik-ul-islam, qui dispose
de son sort au point de vue religieux, demeure ses cts. Comment
se dnouera cette trange situation ?
L'ide des nationalistes d'Angora, qui est de laisser au califat le
pouvoir religieux et de lui enlever le pouvoir temporel, peut avoir des
rpercussions diverses. L'abolition du csaropapisme de Constan-
tinople, le remplacement du souverain politique par un pontife, ce
n'est pas nouveau dans l'histoire de l'Islam. Mais l'Islam n'est plus ce
qu'il tait jadis. Il compte d'normes masses humaines rpandues sur
deux continents. Il y a peut-tre dans le monde des populations mu-
sulmanes qui protesteront contre la suppression du pouvoir temporel.
Il y en a peut-tre d'autres qui seront plus accessibles un pouvoir
uniquement spirituel. C'est l'inconnu. Personne ne peut dire quelle
carte sera retourne.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 227
Pendant ce temps, l'Assemble d'Angora joue une autre partie. Elle
donne la Turquie nouvelle la plus fantaisiste des constitutions, une
constitution qui est une gageure. On dit de ce rgime, qui sera le gou-
vernement direct, le gouvernement du peuple par le peuple, qu'il n'a
d'quivalent nulle part, qu'il est original, qu'il ne ressemble rien. On
dit surtout qu'il ne ressemble pas aux Soviets. En effet, il est moins
bon, car les Soviets ont dur parce qu'ils nient la dmocratie et se fon-
dent sur l'autorit. Le rgime d'Angora peut tre ce qu'il veut. Turc ou
non turc, il est absurde.
En temps de crise et d'exaltation nationale, avec un chef militaire
victorieux qui est une sorte de dictateur, ces gouvernements ne ren-
contrent pas de difficults srieuses et n'importe quel gouvernement,
dans des circonstances pareilles, se tire d'affaire. Mais les Conven-
tions n'ont qu'un temps et, en gnral, un temps assez court. Dans une
Turquie o l'Assemble aura le pouvoir lgislatif et le pouvoir excu-
tif la fois, les nationalistes turcs ne tarderont pas voir qu'ils n'ont
pas invent quelque chose de nouveau ni quelque chose de fameux.
C'est inquitant au point de vue immdiat parce que les ractions
du peuple turc livr lui-mme sont imprvisibles. Dmocratie, na-
tionalit : ce mlange cre la frnsie et le favoritisme. Mais il cre
aussi l'anarchie et c'est plus rassurant pour demain parce que les insti-
tutions qui affaiblissent les chrtiens ne renforcent pas les musulmans.
Sans doute, les nationalistes turcs ne s'obstineront pas dans la d-
mocratie s'ils en voient les inconvnients et les dangers. Bonaparte
aussi avait commenc par le Souper de Beaucaire. Dans l'Orient r-
veill par les imprudences de l'Occident, nous ne sommes pas au bout
des surprises et il est probable que l'avenir est aux conqurants.
L'Action franaise, 5 novembre 1922,
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 228
4.4
L'expulsion du Calife
L'Action franaise, 6 mars 1924.
Retour la table des matires
LA suppression du califat donne lieu d'innombrables commentai-
res dans les journaux de tous les pays, mais on ne voit gure que les
connaisseurs des choses islamiques o les augures soient d'accord.
Si l'on examine la question d'un point de vue historique, la destitu-
tion d'Abdul-Medjid n'a rien de nouveau dans l'Islam o les rvolu-
tions ont t aussi frquentes que les dtrnements par la violence et
les assassinats. Pour pleurer sur la fin du padishah, il faut avoir des
larmes de trop. On compte, en effet, qu'Abdul-Medjid est le vingt-
quatrime calife auquel il arrive d'tre dpos. Encore n'y a-t-il pas eu
effusion de sang.
Aprs avoir aboli le pouvoir temporel des sultans, l'assemble
d'Angora vient d'abolir le pouvoir spirituel. Du csaro-papisme de
Constantinople, il ne restait plus que le papisme . Il est supprim
son tour. Car la rforme est radicale. Le nouvel tat turc extirpe de
lui-mme tout vestige de thocratie et se lacise compltement.
En quoi cette affaire nous intresse-t-elle ? Par les rpercussions
qu'elle peut avoir sur le reste des musulmans, et ce sont ces rpercus-
sions qu'il est bien difficile de calculer car, au fond, l'autorit des cali-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 229
fes sur l'ensemble du monde islamique tait assez faible, comme l'a
prouv l'chec de la guerre sainte, sur laquelle l'imagination de Guil-
laume II avait compt. L'Islam tait dj fort divis. Il se pourrait qu'il
le ft encore plus aprs l'expulsion d'Abdul-Medjid et la suppression
du califat. Nous n'aurions pas nous en attrister.
La principale considration pour nous, c'est celle de nos posses-
sions de l'Afrique du Nord, o d'ailleurs la situation est diffrente se-
lon qu'il s'agit de la Tunisie, de l'Algrie, du Maroc. Nous ne savons
pas si une dmocratie nationaliste et laque Angora ne deviendra
pas, pour les pays islamiques, un centre d'attraction beaucoup plus fort
et beaucoup plus dangereux que la thocratie qui sommeillait sur le
Bosphore. Le Destour tunisien doit nous faire rflchir cet gard.
L'Action franaise, 6 mars 1924.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 230
4.5
Le trait de Lausanne
et nos intrts en Orient
L'Action franaise, 5 mai 1924.
Retour la table des matires
PEU de jours avant la fin de la lgislature, on a distribu le rapport
du comte Stanislas de Castellane sur le trait de Lausanne. Le rappor-
teur, dont le travail abonde en vues remarquables, conclut la ratifica-
tion du trait et conseille des accords, aussi rapides que possible, avec
le gouvernement d'Angora sur les points rests en suspens.
Comment, sur quelles bases, sur quelle rencontre d'intrts, ces ac-
cords, destins sauver ce qui peut l'tre de notre vieux patrimoine
moral et matriel d'Orient, pourront-ils tre obtenus ? Il reste le d-
couvrir. M. de Castellane dit fort bien, et c'est ce qui domine tout :
Le trait de Lausanne dessaisit l'Europe de la question d'Orient envi-
sage sous sa forme ancienne et sculaire. Ce trait n'a t que la
constatation d'un fait que, de 1919 1923, l'Europe avait refus d'ad-
mettre. La Turquie nouvelle n'a plus rien de commun avec l'ancien
Empire ottoman. Pour les rapports reprendre avec elle, tout est in-
venter, tout est crer.
De mme que M. J acques Ancel dans son rcent Manuel historique
de la question d'Orient, M. de Castellane montre que nous ne sommes
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 231
pas les seuls dont les positions aient t renverses par l'avnement de
la dmocratie nationaliste en Turquie. L'Allemagne a t limine,
ainsi que la Russie. L'Angleterre a d renoncer ses vues sur Cons-
tantinople. Nous n'avons pas t mieux traits, mais le dommage est
peut-tre plus sensible pour nous parce que notre tradition excluait
tout tablissement territorial et mme toute vritable influence politi-
que en dehors de notre concours pour l'intgrit de l'Empire otto-
man . L'attribution la France du mandat sur la Syrie a peut-tre t
le plus grand coup de pioche que nous ayons port nous-mmes dans
cette tradition. Ni Franois 1er ni Louis XIV n'avaient pens s'instal-
ler Beyrouth. Sans doute nous n'tions pas libres de refuser la Syrie.
Mais, du jour du partage, nous dtruisions les Capitulations bien plus
srement qu'elles n'avaient t dtruites, le 9 septembre 1914, par
l'acte unilatral de la Turquie.
La fin des Capitulations, dit M. de Castellane, c'est, pour la
France, la fin d'un pass prestigieux, construit lentement, patiemment,
de rgne en rgne, de gnration en gnration, et le regret lgitime
qu'il laisse notre pays ne peut trouver sa compensation que dans une
politique d'entente et de conciliation avec la Turquie .
C'est la sagesse mme. Mais il faut se rappeler que l'ancienne poli-
tique turque de la France tait fonde sur le fait que l'Empire ottoman
et elle avaient en Europe les mmes ennemis. Or il n'y a plus d'Empire
ottoman et la Turquie est un canton asiatique. De plus, la France d'au-
trefois tait puissante dans la Mditerrane. Quant l'argent, pour
mettre en valeur la Turquie nouvelle, nous ne pouvons pas rivaliser
avec les dollars des tats-Unis. Pour reconstruire ce qui a t, ce sont
de bien grands changements.
L'Action franaise, 5 mai 1924.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 232
4.6
Les Turcs, les Soviets
et Constantinople
L'Action franaise, 26 dcembre 1925.
Retour la table des matires
Nous attendions avec curiosit de savoir ce que la presse anglaise
dirait de l'accord des Turcs et des Soviets. Mais les journaux de Lon-
dres sont encore plus sobres de commentaires que ceux de Paris. Ils
ont l'air de suggrer au public l'ide que c'est de deux choses l'une. Ou
bien le trait n'est qu'une oeuvre de tactique et de circonstance, il n'au-
ra pas de lendemain parce que les intrts des deux parties sont in-
conciliables, et il n'y a pas lieu de s'en proccuper ; ou bien c'est un
fait de la plus haute importance qui change tout l'aspect de la politique
orientale, et les gloses alarmistes sont superflues.
Cette rserve des grands organes anglais a autant de sagesse que de
dignit. Ils s'abstiennent galement d'insister sur l'chec que le gou-
vernement britannique vient de subir en Arabie par la victoire d'Ibn
Seoud et l'expulsion dfinitive de son protg Ali. Plutt que de souli-
gner les dfaites, mieux vaut essayer de les rparer.
On doit essayer aussi de prvoir. L'alliance turco-sovitique a-t-
elle, oui ou non, un avenir ? Il est difficile de croire une entente du-
rable entre la nation qui possde Constantinople et celle qui, sous tous
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 233
les rgimes, est attire par Sainte-Sophie. Il y a aussi une mitoyennet
litigieuse du ct du Caucase. Mais la Corne d'Or reste l'objet d'une
contestation historique.
On peut donc calculer que la nouvelle alliance de l'Orient manque-
ra de force, moins qu'un ou deux des lments d'une situation tradi-
tionnelle aient chang. Il est difficile de dire si Constantinople int-
resse moins la Russie depuis qu'elle est au rgime sovitique tempr
par l'influence croissante de la paysannerie. Mais il est sr que les
Turcs attachent la ville funeste beaucoup moins de prix qu'autre-
fois. Ils n'en ont plus voulu pour capitale. Ils en parlent presque avec
dtachement. Il ne semblerait pas absolument impossible qu'ils
consentissent sur Constantinople un arrangement satisfaisant pour la
Russie.
C'est alors que la face de l'Europe serait vraiment autre qu'avant, et
elle a commenc l'tre le jour o la Turquie, ne tenant plus l'Eu-
rope que par un lambeau, a rsolu de redevenir entirement asiatique.
On disait autrefois : La coupole de Sainte-Sophie et la flche de
Strasbourg dominent la politique europenne. C'est probablement
encore vrai aujourd'hui.
L'Action franaise, 26 dcembre 1925.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 234
4.7
L'enlvement de la Tchadra
L'Action franaise, 16 avril 1927.
Retour la table des matires
Lorsque, dans la Turquie kmaliste, il fut interdit sous peine de
mort de porter le fez, on ne peut dire quel point l'Occident fut ton-
n. Mais la mthode des rformateurs orientaux est partout la mme.
Ce qu'elle veut obtenir, c'est que les populations asiatiques cessent de
se concevoir diffrentes des Occidentaux, ce qui est le plus sr moyen
de faire apparatre comme injustifis et mme comme inexplicables
les privilges et droits spciaux de ceux-ci.
C'est pourquoi, aprs l'affaire du fez en Turquie, il y a celle du
voile dans le Turkestan russe. Aprs une priode de mnagements, les
Soviets ont pris l'offensive contre les usages musulmans. Ils s'atta-
chent particulirement l'mancipation des femmes.
Les Izvestia rendent compte avec complaisance des crmonies qui
ont eu lieu le mois dernier Samarcande et Tachkent, o de trs
nombreuses femmes uzbkes ont, en public, enlev la tchadra qui ca-
chait leur visage et la parandja qui dissimulait les formes de leurs
corps, tchadra et parandja tant des symboles de servitude.
Si les femmes musulmanes, dans les rpubliques annexes de
l'U.R.S.S., s'affranchissent avec un certain empressement, les hommes
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 235
rsistent le plus souvent et dfendent les vieux usages. On leur fait
passer le got du voile comme Moustapha Kemal a fait passer le got
du fez. Des maris rests rigoureux sur la tradition et qui avaient tu
leurs femmes parce qu'elles avaient montr leur visage ont t eux-
mmes condamns mort. On svit contre ceux qui sont seulement
coupables de s'opposer aux rformes et d'insulter les femmes qui se
montrent sans voile dans les rues. En somme, les Soviets ont dcid
de draciner l'Islam chez les allognes de leur fdration pour faire
des Uzbeks et de leurs compagnes libres des communistes purs.
Ce travail d'unification intellectuelle est parallle celui que la
propagande rvolutionnaire, renforce et prise en main par les agents
bolchevistes, a dj accompli en Chine. Il est facile aussi de s'aperce-
voir que le Turkestan russe communique par la province de Bokhara
avec l'Afghanistan, c'est--dire avec les portes des Indes. La double
menace contre l'Empire britannique, l'investissement politique et mo-
ral de ses possessions d'Asie, se rvle nettement. Quelque favorable
que soit le cours que les vnements ont pris en Chine depuis quel-
ques jours, on s'abuserait si l'on croyait que la lutte est finie et que les
Soviets y renoncent.
L'Action franaise, 16 avril 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 236
Finlande
Gorgie-Lettonie
5.1
L'indpendance de la Finlande
L'Action franaise, 9 janvier 1918.
Retour la table des matires
La France vient de reconnatre l'indpendance de la Finlande.
Mais il ne serait pas mauvais de connatre ce qu'on a reconnu. Quel est
donc ce nouvel tat qui se lve dans la constellation du Nord ?
Il s'agit d'une contre dont la superficie est presque gale celle de
la France et qui ne compte pourtant que 3 millions d'habitants, dont
400 000 Sudois, descendants des anciens matres du pays et groups
sur le littoral. Le reste de la population se compose de Finnois, parents
des Magyars, par la race, et qui ont leur nationalisme propre, aussi
oppos l'influence sudoise qu' l'influence russe. L'horoscope qu'on
tire au berceau de la Rpublique finlandaise annonce dj de beaux
conflits de nationalits. L'lment sudois, qui est en gnral le plus
instruit et le plus apte la conduite des affaires, peut s'attendre tre
cart du gouvernement. Heureux, s'il n'est pas perscut.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 237
Cette aristocratie a pourtant donn la Finlande la premire des
conditions qui lui permettront de vivre d'une existence libre : le dve-
loppement industriel et les ressources financires. Grce une admi-
nistration et une gestion imites du royaume voisin, la Finlande,
exactement comme la Sude, est un des rares tats dont on puisse dire
qu'ils sont riches comme des particuliers. Son actif excde son passif.
La dette finlandaise, comme la dette sudoise, est compense, et bien
au del, par la richesse du domaine public. Si les habitudes d'ordre qui
avaient persist, mme sous le protectorat russe, ne se perdent pas
sous le rgime nouveau, la Finlande a certainement devant elle un
avenir de prosprit.
L'ombre, c'est son organisation politique. Par un calcul qu'elle
avait galement appliqu la Bulgarie, la Russie tsarienne avait donn
au grand-duch de Finlande une constitution ultra-dmocratique,
comptant, par l, anantir l'aristocratie sudoise et assimiler plus ai-
sment les Finnois. La Russie n'a pas obtenu ce rsultat puisque la
Finlande l'a renie ds qu'a t proclame la libert russe. Mais la d-
mocratie intgrale subsiste. Et elle est pleine de dangers.
J usqu'ici, dans l'histoire, la Finlande a t dispute entre les Su-
dois et les Russes : Petrograd est une capitale impossible si sa fron-
tire est une heure de chemin de fer. La Finlande est-elle sre que
ces rivalits, prilleuses pour elle, ne se reproduiront pas ? Et puis, il y
a aujourd'hui, dans la Baltique, une puissance plus redoutable et plus
envahissante que les autres : c'est l'Allemagne. Les Allemands sont
dj les fournisseurs attitrs des Finlandais. L'influence allemande
pntre la Finlande jusqu'aux moelles. Si le nouvel tat veut tre autre
chose qu'une dpendance de Guillaume II, si la Rpublique d'Helsing-
fors ne veut pas tre l'Empire des Hohenzollern ce que la Rpubli-
que de Venise tait au Saint-Empire, il faut qu'elle trouve en elle-
mme et hors d'elle-mme des garanties.
Ces garanties, c'est une entente avec les royaumes voisins qui les
lui offre. Mais qui ne voit que la similitude des institutions rendrait
l'alliance du Nord plus solide ? Ce qui serait sage, peut-tre, pour la
Finlande, ce serait d'adopter une monarchie constitutionnelle qui lui
vaudrait une vie intrieure paisible et des relations sres avec les trois
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 238
tats monarchiques scandinaves. Qu'elle se souvienne de la Norvge
lisant Haakon VII, aprs son divorce avec la Sude.
Nous terminerons ces remarques par un voeu : c'est que la France
ne soit pas absente du nouvel tat. S'il y a, en Finlande, des germano-
philes, nous y avons aussi de nombreuses sympathies. Elles ne sont
pas exploites ou elles l'ont t de travers. Par un contresens assez
ridicule, l'appui de la dmocratie franaise allait nagure l'aristocra-
tie sudoise toute seule, ce qui nous mettait dos la fois la masse
des Finnois et des Russes. Il y a des Franais qui connaissent le pays,
qui y feraient, en ce moment, oeuvre utile. S'il se peut, leur place est
l-bas. Soyons srs que, pour leur part, les Allemands ne chment
point.
L'Action franaise, 9 janvier 1918.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 239
5.2
La victoire du Lappo
La Libert, 24 octobre 1930.
Retour la table des matires
Il y a des pays o, devant l'audace des partis rvolutionnaires, la
bourgeoisie se contente de gmir et de faire migrer son argent en at-
tendant d'migrer elle-mme. Il y en a o les petits propritaires votent
pour les socialistes dans l'ide d'tre dsagrables aux grands bour-
geois, ignorant que ceux-ci invitent dner les dlicieux marxistes.
Mais il y a d'autres pays o l'on se d-fend, peut-tre parce qu'on se
sent menac de plus prs, et o, pour mieux se dfendre, on attaque.
Tel est le cas au Nord de l'Europe, non loin de la Rpublique des
Soviets, c'est--dire du foyer de contamination. En Norvge, les lec-
tions viennent d'infliger une svre dfaite aux socialistes et aux
communistes entre lesquels les paysans norvgiens ne distinguent pas,
clairs, apparemment, par l'histoire instructive de Kerensky dont le
nom a des chances de rester immortel comme celui du social-
dmocrate qui ouvre les portes au bolchevisme, tel le chef du proto-
cole dont la mission est d'introduire les ambassadeurs.
En Finlande, aux portes mmes de la Sovitie, autres lections non
moins victorieuses pour les bourgeois. Plus un seul communiste la
Chambre ou Dite. Et soixante-six socialistes seulement, c'est--dire
un chiffre infrieur au tiers de l'assemble, ce qui permettra de prendre
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 240
des mesures constitutionnelles contre le retour des menes rvolution-
naires. Seulement ces rsultats n'ont pas t atteints tout seuls.
Dj, en 1918, la Finlande avait chapp au communisme parce
qu'un homme nergique, Mannerheim, s'tait lev pour faire la chasse
aux rouges, ne craignant pas de prendre le nom de blanc. Et puis, tout
doucement, la Finlande tait retombe dans l'ornire. De fil en ai-
guille, d'lection en lection, de dmocratie en socialisme et de socia-
lisme en communisme, elle retournait la situation de 1918, lorsque,
dans le bourg de Lappo, un paysan, Vihturi Kosola, dclara que c'en
tait assez. Ce fut l'origine du mouvement des paysans finlandais et de
leur marche sur Helsingfors o ils vinrent signifier, fortement, qu'ils
en avaient assez.
De ce moment date le redressement. Car, en Finlande, le commu-
nisme n'avait repris de l'audace qu'en raison de la complaisance que
lui montrait le socialisme lequel, de son ct, par des cartels et coali-
tions avec les hommes de gauche, tait influent dans le gouvernement.
Cette histoire est la mme un peu partout. Mais les paysans finlandais
qui ont pris pour signe de ralliement le nom du petit bourg de Lappo
ont compris la politique beaucoup mieux que certains banquiers, in-
dustriels et mme aristocrates, qui offrent du foie gras et du champa-
gne tous les futurs Kerensky.
La Libert, 24 octobre 1930.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 241
5.3
Du Caucase la Cour d'assises
La Libert, 8 juillet 1927.
Retour la table des matires
SHAMYL, hros du Caucase, a t pour nos pres l'objet d'un
grand enthousiasme. Est-ce que la libert gorgienne d'aujourd'hui
vaudrait moins que l'indpendance caucasienne d'autrefois ? Nous
avons le grand roman d'aventures et le romantisme porte de la main
dans l'anne mme o l'on clbre le centenaire de Victor Hugo, qui
chanta l'affranchissement de la Grce. Cependant, la cause de la
Gorgie, peuple martyr, vient chouer sur les bancs de la Cour d'assi-
ses et c'est peine si l'on se demande : La Gorgie, qu'est-ce que
c'est que a ?
La Gorgie est un admirable pays qui a eu trois malheurs. D'abord,
il est trop beau et trop riche : pour certaines contres, comme pour
certaines cratures, il y a ce que les Italiens appellent le don funeste de
la beaut. Ensuite, la Gorgie est voisine, trop voisine de la grande
Russie. Enfin, elle partage en politique les ides de MM. Pierre Re-
naudel, Ramsay Macdonald et Vandervelde. Aprs cela, ses infortunes
n'tonnent plus.
Nous n'exposerons pas les faits de la cause que le jury parisien doit
juger. Ce qui domine ces dbats, c'est la protestation de la Gorgie
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 242
socialiste contre la Russie communiste. Car il est incontestable que les
Soviets se sont comports avec ce pays de dmocratie sociale, qui
s'tait empress, en 1917, d'arborer le drapeau rouge, comme les puis-
sances imprialistes et les rapaces les plus caractriss de l'histoire ne
s'taient pas conduits depuis Gengis-Khan et Tamerlan. On ne trouve-
rait pas dans l'histoire moderne d'exemple d'une conqute plus brutale.
Par comparaison, Frdric II s'tait conduit en gentleman lorsqu'il
s'tait empar de la Silsie.
Dj conquise par les tsars, la Gorgie, qui avait produit de fameux
rvolutionnaires, s'tait crue libre par la chute du tsarisme. Elle
s'tait forme en jolie petite rpublique social-dmocrate, selon le
programme de la IIe Internationale, dont l'antimilitarisme n'est pas le
moindre article. Une milice suffirait dfendre le pays. Pourquoi,
d'ailleurs, le dfendre ? Et contre qui ? La Rpublique gorgienne ab-
horrait la guerre. Elle ne se connaissait pas d'ennemis. Elle avait un
pacte d'amiti avec les Soviets, un excellent Locarno. Seulement, elle
avait aussi des richesses, du ptrole qui faisait natre d'ardentes
convoitises, une situation gographique d'isthme qui a tent les So-
viets aprs les tsars. Un jour, l'arme rouge est entre par trahison. La
milice gorgienne, malgr le sacrifice d'hommes hroques, n'a pu r-
sister aux envahisseurs. La Gorgie s'est inscrite au martyrologe des
peuples opprims. Et, un jour, il y a eu un coup de revolver et un
crime Paris. Voil l'histoire.
Pauvre Gorgie ! Maintenant, c'est la milice de ses protecteurs qui
l'abandonne. Elle n'aura pour dfendre sa cause que M. Pierre Renau-
del, qui viendra dposer en sa faveur la Cour d'assises. M. Vander-
velde, ministre des Affaires trangres en Belgique, ne sait plus rien.
M. Ramsay Macdonald, chef de l'opposition de Sa Majest au Parle-
ment britannique, se tait. La IIe Internationale est muette. La Socit
des Nations, selon sa coutume, met un doigt sur ses lvres. Et les puis-
sances qui ont reconnu l'indpendance gorgienne la renient... Quelles
leons !
La Libert, 8 juillet 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 243
5.4
Renaissances
L'Action franaise, 20 novembre 1928.
Retour la table des matires
LE dixime anniversaire du 11 novembre a t celui des Lazares
sortis du tombeau. Cinq ou six nations ftent des Pques en ce mois
des morts. C'est pour elles le mois de la rsurrection.
Il y a dix ans qu'elles jouissent de leur seconde vie. C'est peu au
regard de leur long ensevelissement. C'est beaucoup par rapport aux
difficults qu'elles ont d vaincre. Car on se reprsente mal, dans un
pays ancien comme le ntre, ce que c'est que de crer de toutes pices
un tat et une administration. Nous sommes gns par un excs de
bureaucratie. Il est bien plus gnant de n'avoir aucun personnel, au-
cune tradition bureaucratiques.
Il faut admirer qu'une Pologne ait pu renatre aprs un sicle et
demi, ou peu s'en fallait, de servitude et de dispersion. Plus ancienne
encore tait pour les Tchcoslovaques la perte de leur indpendance
nationale. C'est au commencement du dix-septime sicle qu'avait
succomb le royaume de Bohme. Mais que dire de la Lettonie qui
vient aussi de clbrer son rveil d'entre les morts ? Il y avait plus de
six cents ans qu'elle avait cess d'exister, pitine tour tour par les
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 244
Allemands, les Sudois et les Russes et, sous toutes les dominations,
asservie celle des fameux barons baltes, ces croiss du germanisme.
Peu de peuples europens sont aussi originaux que le peuple letton.
C'est un pays pour Gobineau. Il y retrouverait l'Aryen pur. Ils sont l
deux millions qui parlent la langue la plus proche du sanscrit, et celui
qui saurait le letton aurait la clef de nos idiomes. Les Lettons ont gar-
d les moeurs pastorales de la race o pour dire la fille on disait la
trayeuse . Ils ont gard aussi l'honntet de l'ge d'or et l'on assure
que dans les campagnes lettonnes on ne sait pas ce que c'est qu'une
serrure.
Il a fallu aux Lettons beaucoup de volont, d'nergie et de qualits
pour renatre parmi les nations. Il leur faudra encore beaucoup de vigi-
lance pour garder leur indpendance reconquise. Telle quelle, leur re-
naissance est une des merveilles de ce temps. Elle prouve qu'il n'y a
pas de cration politique impossible et l'on ne sait pas pourquoi, par
exemple, une Autriche indpendante ne serait pas viable quand une
Lettonie prouve qu'elle l'est bien.
L'Action franaise, 20 novembre 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 245
Les effets
du sionisme
L'Action franaise, 20 dcembre 1920.
Retour la table des matires
L'Osservatore romano et la Semaine religieuse de Paris ont r-
cemment publi un ensemble de documents sur la situation de la Pa-
lestine. Le sionisme, soutenu par le cabinet de Londres, y apparat
comme une aventure, alarmante tous les points de vue. Dj les in-
cidents ont t nombreux. Ils sont d'abord, bien entendu, de nature
religieuse. Le sionisme, aux Lieux Saints, n'a pas l'impartialit des
Turcs. Il traite en intrus les reprsentants des communions chrtien-
nes. Le haut commissaire britannique, sir Herbert Samuel, se com-
porte comme un chef plus religieux que politique. Le prince
d'Isral , ainsi l'ont surnomm ses coreligionnaires, va prier, le jour
du sabbat, la grande synagogue, acclam par la population juive de
J rusalem. En revanche, le Saint-Spulcre est un lieu qui lui fait hor-
reur. Au mois de juillet dernier, visitant la basilique, sir Herbert Sa-
muel refusa d'entrer dans le sanctuaire du tombeau. Cette insulte aux
chrtiens fut releve. Le synode des Grecs orthodoxes dposa sur-le-
champ le patriarche Damianos en lui reprochant de n'avoir reu le
haut commissaire que pour essuyer cet affront.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 246
Un tel incident mrite une attention srieuse. Il montre quelles ri-
valits confessionnelles, susceptibles de dgnrer en luttes plus gra-
ves, le sionisme doit conduire. On regrette dj les Turcs, le seul
peuple tolrant , disait Lamartine qui, dans son Voyage en Orient, se
demandait, avec son gnie divinatoire, ce que deviendraient les Lieux
Saints lorsque leurs gardiens flegmatiques n'y seraient plus.
Le sionisme allumera sans doute en Palestine une hideuse guerre
de religion : encore un de ces progrs rebours que les traits auront
valu au genre humain. L'Osservatore romano signale, parmi les im-
migrants juifs qui arrivent en nombre, des fanatiques qui parlent de
dtruire les reliques chrtiennes. Ce n'est pas tout. Avec la guerre reli-
gieuse, le sionisme apporte la guerre sociale. Les juifs venus de Polo-
gne, de Russie, de Roumanie, rclament un partage des terres et l'ex-
pulsion des indignes. M. Nathan Strauss, le milliardaire amricain,
dit crment que les musulmans trouveront d'autres rgions pour vi-
vre . Admirable moyen de runir, en Asie Mineure et mme plus
loin, tout l'Islam contre l'Occident.
Il semble qu'en autorisant et en protgeant des expriences aussi
dangereuses le gouvernement britannique perde la tte. La proscrip-
tion du franais en Palestine (sir Herbert Samuel ne reoit plus aucune
rclamation dans notre langue) est-elle un avantage suffisant pour
compenser l'irritation et le soulvement du monde islamique ? Le lieu-
tenant J abotinsky, l'organisateur de la lgion juive, emprisonn par le
gnral Allenby et libr par le haut commissaire, dclarait rcem-
ment au Times : Le gouvernement juif en Palestine sera le symbole
de la coopration anglo-isralite et un centre d'influence pour les sen-
timents favorables aux intrts britanniques parmi tous les isralites
rpandus dans l'univers. Assurment, il y a cette ide-l dans la poli-
tique sioniste du cabinet de Londres. Quel plat de lentilles, si l'on
songe l'immense dommage qui rsultera pour l'Angleterre de l'hosti-
lit des peuples musulmans ! Les Grecs Smyrne, les J uifs J rusa-
lem : on a rarement, et avec autant d'imprudence, prpar plus vaste
incendie.
L'Action franaise, 20 dcembre 1920.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 247
L'Asie
Chine-Japon
7.1
L'Asie et l'Occident
L'Action franaise, 20 juillet 1925.
Retour la table des matires
M. Roman Dmovski, l'minent homme d'tat polonais vient de pu-
blier, dans la Gazette de Varsovie, une tude qui appelle quelques r-
flexions. Parlant des soulvements asiatiques, M. Dmovski demande
qu'on ne se trompe pas sur le rle des Soviets. Leur action, en Chine et
ailleurs, n'est pas douteuse. Mais elle ne s'exerce pas comme on le dit
et, surtout, elle ne pourrait pas s'exercer si le terrain n'tait pas prt.
Les bolcheviks n'ont pas eu de peine reconnatre que l'tat d'esprit
des Asiatiques commenait ressembler beaucoup celui de la Russie
la fin du dix-neuvime sicle.
Le tsarisme s'est dtruit lui-mme depuis Pierre le Grand en impo-
sant la civilisation occidentale au peuple russe qui n'en voulait pas. Il
fallut mme couper des ttes pour la lui faire accepter. On ne sait pas
assez, en effet, que, pendant deux sicles, le tsarisme a vraiment re-
prsent le progrs par en haut . Il en avait presque le snobisme.
Aucune hardiesse ne l'effrayait. Il ne se croyait jamais assez avanc.
Un peu avant 1870, un ministre d'Alexandre II, ayant ralis une r-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 248
forme agraire, se flicitait de s'tre inspir des principes de Karl Marx
et de les avoir mls aux traditions communistes du mir. Estimant que
l'avenir tait au socialisme, il annonait firement que la Russie future
serait l'tat parfait.
En occidentalisant la Russie, le tsarisme a obtenu surtout que
ses intellectuels rudimentaires ont pris dans les Universits d'Oc-
cident les ides rvolutionnaires, qui devaient leur tre les plus acces-
sibles tant les plus simples. C'est exactement ce qui se passe en Asie.
Le comte Sforza remarquait l'autre jour, dans une tude qui est le
pendant de celle de M. Dmovski, que le mouvement, chinois d'aujour-
d'hui clt juste l'heure o arrive la maturit une gnration qui a
profit d'une singulire erreur. Il signale que les tats-Unis ont, depuis
l'origine, employ les annuits de la clbre indemnit dite des Boxers
fonder des bourses pour tudiants chinois dans leurs universits.
Croyant faire des amis et des lves, ils ont fait des rvolts dont le cri
est : La Chine aux Chinois. Ainsi les millions des xnophobes
boxers ont aliment une xnophobie consciente .
Ce qui s'est pass, sous des formes analogues, en Russie et en Tur-
quie, recommence en Asie. M. Dmovski a raison de dire que l'Asie
n'en est d'ailleurs qu' la premire phase de la fermentation provoque
par des ides rapportes d'Europe bien qu'elles n'aient rien de particu-
lirement europen, et qui sont les seules assimiles parce qu'elles
sont les plus grossires, les plus comprhensibles pour des esprits
primitifs et parce qu'elles retrouvent en somme leur pays d'origine. M.
Dmovski a encore raison de dire que, sur des terrains diffrents, le
sentiment rvolutionnaire ne produira pas exactement les mmes ef-
fets en Chine et aux Indes qu'en Russie, de mme qu'il n'a pas produit
les mmes effets en Russie et en Turquie. En tout cas, il y a un trait
commun : la libration de l'Asie par rapport l'Europe. La suprmatie
laquelle l'Occident tait accoutum depuis le jour o J ean Sobieski
eut dfinitivement arrt la pousse des Turcs n'est plus ni reconnue ni
accepte par les Asiates. C'est un immense recul.
L'Action franaise, 20 juillet 1925.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 249
7.2
L'Asie qui fermente
La Libert, 31 mars 1927.
Retour la table des matires
ON a beaucoup dit que les Franais ignoraient la gographie. La
multiplicit des vnements, depuis quelques annes, se charge de la
leur apprendre. D'un bout l'autre de la plante, des mouvements
spasmodiques appellent tour de rle l'attention sur une nouvelle par-
tie du monde. Pour le moment, essayons d'avoir prsente l'esprit une
carte lmentaire d'Asie, tout simplement une de ces cartes comme on
en donne aux coliers.
Vous voyez o se trouve la Chine, tendue entre la Sibrie et les
Indes. Vous voyez aussi comment le continent asiatique se termine au
Sud-Ouest par le pain de sucre indien, au Sud-Est par le coquillage
indochinois. Entre les deux, descend une longue et mince bande de
terre, qui rappellerait assez l'Amrique centrale si elle ne finissait en
presqu'le, celle qui porte le nom de Malacca. Tout au bout se trouve
Singapour, port qui commande les dtroits des les de la Sonde et le
passage de l'Ocan Indien aux mers de Chine. Singapour est une de
ces clefs du monde que tiennent les Anglais. On sait mme qu'ils ont
entrepris d'y construire une grande base navale.
Supposons que les Anglais viennent perdre Singapour. Alors, les
possessions hollandaises, J ava, Sumatra, Borno, sont menaces. No-
tre Indochine est coupe de l'Occident. A ct d'elle, le Siam, qui a,
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 250
Dieu sait pourquoi, une arme et deux cent cinquante avions, vient la
prendre en sandwich. La plus belle de nos colonies est isole. Le ja-
pon, dans ses petites les, est lui-mme vou la solitude. Et que de-
viennent les Amricains aux les Philippines, o gronde dj l'insur-
rection ?
Il n'est donc pas ncessaire d'tre trs fort en gographie, il suffit
mme d'en savoir ce qu'on demande au certificat d'tudes primaires
pour comprendre l'importance de la presqu'le de Malacca. Et lorsque
les dpches de ce matin annoncent une grande agitation Singapour,
suite de l'entre des nationalistes Shangha et Nankin, le plan bol-
cheviste en Extrme-Orient se dcouvre tout seul. Il ne s'arrtera pas
au Fleuve Bleu, on peut en tre certain.
Cet branlement progressif de l'Asie, ce soulvement de la pte
jaune par le ferment bolcheviste est un phnomne grave. Il annonce
le recul des colonisations europennes, et mme de l'Europe tout
court. Ce danger est peine vu par les gardiens de la civilisation. Il
l'est aussi peu que l'tait, dans l'empire romain, celui des invasions
barbares la fin du quatrime sicle de notre re. On passait son
temps se quereller entre orthodoxes, ariens et donatistes quand les
Goths et les Vandales taient aux portes.
La Libert, 31 mars 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 251
7.3
Les rats bruns et les rats noirs
La Libert, 9 avril 1927.
Retour la table des matires
Ce qui se dgage de plus certain, dans l'norme confusion des af-
faires de Chine, c'est que, du moins jusqu' prsent, les pronostics op-
timistes ou simplement rassurants ont t constamment dmentis.
Nous nous sentons donc disposs n'accepter que sous bnfice d'in-
ventaire les explications rassurantes que l'on donne au sujet de l'Indo-
chine depuis que le Yunnan est pass aux mains des rvolutionnaires
cantonais.
On nous dit, par exemple : L'Annamite a une haine violente des
Chinois qui ont t jadis ses oppresseurs. Ce qui l'attache la France,
c'est qu'elle le protge contre la tyrannie chinoise. Nous avouons
nous mfier de ces formules. L'exprience montre qu'elles sont le plus
souvent rptes la faon des perroquets. C'est ainsi que nous avons
entendu dire bien peu de temps avant la rvolution russe : Le tsa-
risme n'a rien craindre parce que cent millions de moujiks vnrent
leur petit pre le tsar. Le petit pre le tsar pouvait compter l-
dessus !
Sir Austen Chamberlain a enfin prononc le grand mot : les So-
viets veulent dtruire l'Empire britannique, aprs quoi il leur devien-
dra facile de rpandre la rvolution dans le reste de l'Europe. Ils
considrent l'Angleterre comme la citadelle de l'ordre capitaliste et
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 252
bourgeois. Ils savent aussi que ce colosse a des pieds d'argile, car son
existence dpend de la circulation des marchandises et des richesses
travers le monde. Il suffirait d'atteindre la Grande-Bretagne dans deux
ou trois de ses principales sources de prosprit, en Chine, aux Indes,
en gypte, pour qu'elle ft profondment branle. Dj le dficit
s'installe dans son budget, ses exportations reculent. Elle a sans doute
de la marge devant elle. Mais on aurait ri au nez de celui qui aurait
prdit la fin de l'Empire colonial espagnol au temps o l'on disait de
Charles-Quint que, sur ses domaines, le soleil ne se couchait jamais.
Notre confrre Ludovic Naudeau a cit rcemment ces lignes,
vieilles de plus de vingt ans, et singulirement clairvoyantes, du gn-
ral Hamilton, attach militaire anglais pendant la guerre de Mand-
chourie : S'il n'tait pas contenu par nos forces militaires, le moins
que pourrait faire un Chinois, mme pacifiste, pour conserver le res-
pect de lui-mme, ce serait d'ordonner que tout bateau, tout conces-
sionnaire, tout marchand, tout missionnaire, tout globe-trotter dispa-
raisse, dans les vingt-quatre heures, de l'Empire du Milieu. Sous des
conditions de paix perptuelle o prvaudrait l'galit industrielle et
sociale de tous les hommes, le Chinois est aussi capable de dtruire le
travailleur blanc du type actuel et de le faire disparatre de la surface
du globe que le rat brun fut capable de dtruire et de chasser d'Angle-
terre le rat noir, moins nergique, moins dvorant, qui l'avait prc-
d.
Ludovic Naudeau ajoute avec raison : Comment les chefs com-
munistes occidentaux ne voient-ils pas qu'en faisant porter leur dra-
peau par des hordes asiatiques profondment ignorantes de toute
conception europenne et pousss seulement par des instincts bes-
tiaux, ils menacent, en somme, le travailleur d'Occident ? Il se peut
que les communistes ne le voient pas, parce que la btise n'est pas non
plus une hypothse exclue. Mais il y a peut-tre aussi chez eux cet
esprit de nihilisme, de destruction et de suicide qui est au fond de tous
les mouvements rvolutionnaires.
La Libert, 9 avril 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 253
7.4
En Chine
La Libert, 12 avril 1927.
Retour la table des matires
Les armes chinoises ne sont pas des armes, mais des troupes de
mercenaires et de figurants. J adis, en Chine, on montrait sur le front
des troupes des images de dragons affreux pour pouvanter l'ennemi.
Aujourd'hui, il suffit qu'un parti fasse mine d'attaquer l'autre pour que
la panique se mette au camp adverse. C'est la guerre dite en accor-
don , o l'on avance et o l'on recule tour tour.
Il se peut donc que les Cantonais perdent Shangha aussi facile-
ment qu'ils y taient entrs. Mais rien n'assure que les succs des Nor-
distes seront plus durables. A chacun de ses interrgnes, et en atten-
dant d'tre reprise par une main ferme, la Chine a connu de longs d-
sordres, des guerres interminables entre les factions, des alternatives
d'chec et de succs pour les unes comme pour les autres.
Un Chinois de la bonne tradition et de la vieille cole, mandarin un
peu sceptique, disait l'autre jour Paris : La Chine a dj eu sept fois
le communisme et elle s'en est toujours dbarrasse. C'est juste. Seu-
lement, le moment o cela arrive est trs dsagrable, surtout pour les
puissances qui ont des intrts en Asie. Autrement, les Chinois pour-
raient suivre les prceptes de Lnine ou ceux de Confucius que nous
ne nous en apercevrions mme pas.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 254
Avant la priode contemporaine, autrement dit avant l're indus-
trielle qui a commenc au dix-neuvime sicle, les moeurs et la lgi-
slation des pays lointains taient de simples objets de curiosit. Nos
chroniqueurs auraient trait les histoires de Nicolas II et de Lnine
comme ils ont racont celles de Boris Godounov et des faux Dm-
trius. Marco Polo aurait rapport de ses voyages en Chine les extraor-
dinaires aventures de Tchang Tso Lin ou de Sun Yat Sen. Et tout cela,
lu au coin du feu par des bourgeois franais ou par des gentilshommes
fermiers d'Angleterre, et t trs rcratif. Aujourd'hui, c'est bien dif-
frent. Il est peu de bourgeois franais qui ne possdent des fonds rus-
ses ou des Tramways de Shangha. Et l'Angleterre tire du commerce
avec la Chine une partie de son revenu national. Ce qui se passe chez
les peuples estranges , comme on disait au bon vieux temps, nous
intresse d'une faon directe.
A cause de cet enchevtrement gnral des intrts, on a dit quel-
quefois que les grands cataclysmes nationaux et sociaux n'taient plus
possibles. Les vnements prouvent le contraire. La guerre n'a pas t
empche pour cela, et elle n'a mme jamais pris une forme plus des-
tructive. Cependant, la Russie et la Chine ne sont nullement recon-
naissantes l'Occident d'avoir donn des tramways Moscou et
Shangha. Russes et Chinois considrent tout simplement les Occiden-
taux comme des usuriers et des exploiteurs. Alors, dans notre civilisa-
tion, on voit des gens qui avaient travaill toute leur vie pour assurer
le pain de leurs vieux jours et qui sont ruins parce qu'il a plu aux
moujiks et aux coolies de faire des rvolutions.
La Libert, 12 avril 1927.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 255
7.5
Aventures d'un chemin de fer
La Libert, 20 juillet 1929.
Retour la table des matires
LORSQUE le projet du Transsibrien fut conu et annonc, en
1889, il fut salu comme un gage de progrs pacifique et de rappro-
chement des peuples. Il tait dj entendu que les chemins de fer rap-
prochent les peuples et servent la cause de la paix, bien qu'ils puissent
servir aussi des transports et des concentrations de troupes. De
mme l'avion supprime les frontires dont il n'est pas de traces au ciel,
mais jette l'occasion des bombes.
Quarante ans ont pass et le Transsibrien a dj t cause d'une
guerre. Lorsque les Russes et les J aponais se furent trop rapprochs,
lorsqu'ils se trouvrent nez nez en Mandchourie, ils se battirent.
Guerre dsastreuse pour la Russie et pour l'Europe. Nous en avons
pay pour partie les consquences en 1914. Du moins avait-elle t
liquide aussi sagement que possible par la paix de Portsmouth et les
accords qui suivirent. On liquidait dj des guerres, avant l're nou-
velle, et il serait souhaiter qu'on les liquidt aussi bien dans l'Europe
d'aujourd'hui que dans l'Europe d'hier.
Un quart de sicle aura bientt pass sur la guerre russo-japonaise
et voici que, de nouveau, la Mandchourie, par ses chemins de fer, est
un sujet de discorde si elle n'est pas menace de redevenir un champ
de bataille. Et cette fois ce ne sont plus les armes du tsar et celles du
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 256
mikado qui se trouveraient en prsence. Ce seraient celles de la Rpu-
blique sovitique et de la Rpublique chinoise.
La Rpublique chinoise est plus nationaliste que le Cleste empire.
Nationaliste, l-bas, est mme synonyme de rpublicain. Pour la d-
mocratie chinoise, les bolcheviks ne sont pas des diables trangers
moins hassables que les Anglais ou les autres et les conventions qui
rgissent les chemins de fer de Mandchourie ne sont pas des traits
moins ingaux que ceux qui rgissent la concession de Shangha.
De leur ct, les bolcheviks n'ont pas rpudi le capital ferroviaire
qu'ils ont hrit du tsar, s'ils ont rpudi la dette tsariste, alors que les
chemins de fer, objet du litige actuel, ont t construits pour la plus
grande part avec des emprunts et de l'argent franais.
Maintenant, la Rpublique sovitique et la Rpublique chinoise se
battront-elles ? On se perd en considrations, hypothses et conjectu-
res sur les raisons qu'elles auraient d'esquiver le combat ou d'en venir
aux mains. Pour les empcher d'en arriver cette extrmit qu'invo-
quera-t-on ? La Socit des Nations ou le pacte Kellogg ? Abondance
de biens ne devrait pas nuire. Mais les Soviets n'appartiennent pas la
Ligue de Genve. Et, par un fait exprs, le pacte Kellogg n'entre en
vigueur que dans huit jours. Enfin, qu'on se serve d'un moyen ou d'un
autre, ou tout simplement d'une mdiation l'ancienne mode, il y a
une bonne chance de prvenir un conflit sanglant si aucun des deux
belligrants ventuels n'a, comme il se pourrait, la rsolution farouche
de se battre.
La Libert, 20 juillet 1929.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 257
7.6
L'impntrable avenir
L'Action franaise, 24 fvrier 1932.
Retour la table des matires
Pour tout ce qui est arriv entre 1914 et 1918, la gnration res-
ponsable a droit une excuse : elle ne savait pas, elle ne pouvait pas
deviner. Cette phrase-type de Ferrero traduit les regrets d'un conser-
vateur. Elle est trangre la question des responsabilits proprement
dites. Ferrero veut dire que personne n'avait prvu que la guerre qui-
vaudrait une grande rvolution. Ou du moins ceux qui en avaient
l'ide philosophaient inutilement dans un coin.
C'est, dit encore Ferrero, l'illusion de la guerre courte qui a t
cause du mal. Mais pourquoi la guerre a-t-elle t longue ? Ici, nous
sommes dans la contingence. L'Allemagne victorieuse en six semai-
nes, conformment son plan et ses calculs, tout changeait.
Dsormais, et, sans doute, jusqu' ce que cette image soit efface
dans les esprits par le cas oppos, on voit les Empires autoritaires et
militaires ruins par leurs propres entreprises belliqueuses et entra-
nant le monde dans leur ruine. Il y a en ce moment des prophtes (de
l'avenir ou du pass ?) qui annoncent que le J apon bolchevisera l'Asie
et se bolchevisera lui-mme par les aventures qu'il est all chercher en
Chine.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 258
Sera-ce cela ou le contraire, ou quelque chose de diffrent ? Ce
qui, par l'Allemagne, est arriv l'Allemagne, l'Europe et au monde,
se rptera-t-il pour le japon ? Il n'existe aucun lment qui permette
de le deviner.
Ce qui frappe les esprits, ce qui dtermine les opinions, les hypo-
thses ou les craintes, c'est que le J apon, comme l'Allemagne dans
l'Europe de 1914, reprsente, en Extrme-Orient, l'ordre et la stabilit
sociale. Le docteur Legendre, dans son livre l'Asie contre l'Europe,
vient de mettre face face, dans un relief saisissant, la Chine anarchi-
que et le J apon hirarchis. Les uns regardent le J apon comme seul
capable de mettre fin au chaos chinois et de refouler le bolchevisme,
dj matre des rgions du nord et qui se rpand peu peu jusqu'
Shangha. Les autres tremblent l'ide que les J aponais pourraient
fournir aux Soviets l'occasion de bolcheviser toute l'Asie, y compris
l'Empire du Soleil-Levant.
Ce sont encore des futurs contingents . Tout dpend peut-tre
pendant quelques journes d'un gnral ou d'un amiral nippon, et
l'avenir n'est pas plus pntrable en 1932 qu'en 1914.
L'Action franaise, 24 fvrier 1932.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 259
7.7
Une expulsion
L'Action franaise, 25 fvrier 1933.
Retour la table des matires
ON saura un jour quels calculs, quelles manoeuvres ont conduit la
Ligue de Genve expulser le J apon. Car ce n'est pas le J apon qui
sort. C'est la Ligue qui le chasse.
Dans une socit, dans des relations quelconques, le mme cas ne
prte pas au moindre doute. Vous avertissez que si telles assurances
ne vous sont pas donnes, que si tel engagement n'est pas pris, que si
telle condition n'est pas remplie, que si, enfin, telle mesure vous est
refuse ou se trouve dcide contre votre avis, votre prsence dans la
maison ne sera plus possible. Vous donnez vos raisons et toutes les
preuves de votre bonne foi. On passe outre. Qui a voulu la spara-
tion ?
C'est bien ce qui est arriv pour le J apon. M. Matsuoka, avant de
quitter la salle des sances, a encore dit que la Chine n'tait pas un
tat mais une anarchie et une anarchie xnophobe, ce qui est la cause
essentielle de la situation trouble de l'Extrme-Orient. Le parti pris
de la Socit des Nations en faveur du prtendu gouvernement de
Nankin est donc inexplicable. Car ni l'idologie, ni la sottise n'expli-
quent tout.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 260
Il y a eu une volont trop persvrante pour qu'elle ne rsultt pas
d'une intention. Ce qu'il fallait faire pour loigner le J apon de la Ligue
a t fait. On s'y est pris de loin, par degrs, d'une manire doucereuse
mais telle que l'effet tait certain. Il faut alors se demander si l'on n'a
pas cherch couper le J apon de l'Europe comme on avait dj dta-
ch de lui l'Angleterre, il y a dix ans, la confrence de Washington.
C'est une manoeuvre d'isolement qui prpare une manoeuvre d'encer-
clement. D'ores et dj le J apon est dsign comme agresseur.
Cette manoeuvre peut rpondre aux vues du gouvernement amri-
cain, ses ides sur la porte libre en Chine, sa crainte d'un
conflit du Pacifique. Qu'elle soit conforme aux intrts des puissances
europennes, assurment non. M. Matsuoka, avant de quitter la salle
des sances, a lanc la flche du Parthe lorsqu'il a rappel que les Chi-
nois avaient mis en sommeil leur campagne contre les traits in-
gaux depuis que l'affaire de Mandchourie tait voque par la Soci-
t des Nations.
Quant assurer la paix en Asie et dans les eaux qui l'avoisinent en
provoquant une rupture avec le J apon, ce n'est pas seulement une illu-
sion, ce n'est pas seulement une erreur. C'est une faute. On s'est pro-
nonc contre le seul adepte, tmoin et gardien de la civilisation occi-
dentale en Extrme-Orient. On a dgot les J aponais de leurs efforts
longs et mritoires pour garder le contact avec l'Occident. On le re-
grettera.
L'Action franaise, 25 fvrier 1933.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 261
Perse
Afghanistan
8.1
Les lois de l'imitation
L'Action franaise, 16 dcembre 1925.
Retour la table des matires
Il y avait, voil une vingtaine d'annes, dans une petite ville de
Perse, un jeune homme qui tait scribe dans un consulat tranger. Ce
jeune homme, qui s'appelait Riza, n'aimait pas la vie de bureau. Il en-
tra comme simple soldat dans les Cosaques persans. Il monta en
grade, prouva son nergie et son adresse et, en 1921, la tte de son
rgiment, il renversait le cabinet et obligeait le souverain prendre
pour premier ministre un rformateur. Riza reut le portefeuille de la
Guerre et le garda jusqu'au moment o, en 1923, il devint premier mi-
nistre son tour et le vritable matre de la Perse.
Le premier qui fut roi fut un soldat heureux. Par 257 voix
contre 3, l'assemble de Thran vient d'lire le sardar Sipah Riza
Khan shah de Perse et a rendu la couronne de Darius hrditaire dans
la famille de l'ancien petit employ de consulat avec cette clause que
la succession sera limite aux fils ns d'une mre persane.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 262
Cette rserve souligne le caractre national du changement de dy-
nastie. Les Kadjar, qui rgnaient depuis 1794, taient Turcomans
d'origine et leur statut familial ordonnait que l'hritier du trne ft issu
de la race royale. On reprochait ainsi aux Kadjar d'tre trangers,
comme on avait reproch, en Chine, la dynastie des Tsing (qui
n'avait qu'un sicle et demi d'anciennet de plus) d'tre mandchoue.
Riza Shah Pahlevi se vante d'tre un pur Aryen.
En dtrnant les Kadjar, la Perse a oubli les services qu'ils lui
avaient jadis rendus, car le fondateur de la dynastie, Aga Mohammed,
lui avait, il y a cent trente ans, restitu l'indpendance et l'ordre. Du
moins la Perse a-t-elle pris une assurance contre une rechute dans
l'anarchie. Elle n'a pas imit la Chine qui n'a renvers les Tsing que
pour tomber dans un chaos qui s'aggrave de jour en jour et dont on ne
voit pas la fin.
Cependant, l'anne dernire, au mois de mars, Riza lui-mme avait
proclam la rpublique. Les Persans n'en voulurent pas et Riza a trou-
v plus simple de prendre la couronne. La raison pour laquelle la
Perse a refus d'tre rpublicaine est d'ailleurs curieuse : c'est, dit le
Times, parce que la Turquie l'est devenue et que jamais un Persan ne
fera ce que fait un Turc. Cette explication rappelle un mot d'Alphonse
XIII aprs la chute du roi Manoel Lisbonne : Me voici solidement
assis sur le trne. Les Espagnols ne feront pas de rvolution aprs les
Portugais. Ne pas imiter le voisin, c'est encore, aurait dit Tarde, une
loi de l'imitation.
L'Action franaise, 16 dcembre 1925.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 263
8.2
Pierre Le Grand Kaboul
L'Action franaise, 26 janvier 1928.
Retour la table des matires
La rvolution des moeurs, le progrs et l' occidentalisation par
en haut, le despotisme clair, sont une tradition des pays d'Orient. En
ce moment mme, Moustapha Kemal modernise la Turquie, supprime
le fez et le Coran. Le roi Amanoullah est galement un novateur. R-
cemment il dclarait un envoy du Times que son pays devait tour-
ner le dos au pass. Encore un pays qui se rveille.
Le roi d'Afghanistan demande la France des modles de civilisa-
tion, puisque son fils tudie dans un de nos lyces. Il ne semble pas lui
demander des modles de politique. Les prfrences d'Amanoullah
vont aux gouvernements forts. L'exemple de Moustapha Kemal n'a
pas t sans agir sur lui, on dit qu'il a pour M. Mussolini une grande
admiration et c'est un fait qu'au Caire il a reu l'insigne fasciste des
mains du consul d'Italie. Il est vrai que si l'Afghanistan tait une d-
mocratie, le peuple afghan avancerait un peu moins vite que sous
l'impulsion brillante de ce nouveau Pierre le Grand.
Mais ce que nul ne peut prvoir, ce sont les consquences lointai-
nes de cet essor d'une autre nation la charnire de la Russie et de
l'Inde. Comme autrefois les J eunes-Turcs, comme Moustapha Kemal,
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 264
le roi Amanoullah a peut-tre mdit les pages o l'auteur de l'Intro-
duction l'histoire de l'Asie a rvl eux-mmes les touraniens.
Lon Cahun, dont le livre a rveill la conscience de ces peuples et
les a instruits de leur pass pour les tourner vers l'avenir, a montr
comment les victoires et les conqutes de Tchinguiz Khan, le roi au-
guste que nous nommons Gengiskhan, avaient t dues avant tout la
discipline exacte de ses armes, l'quipement et au matriel excel-
lents de ses troupes. En ce temps-l, c'est du ct de l'Asie que se
trouva la supriorit technique. Ainsi le Sira Ordou, Quartier imprial
d'or, dont les Russes ont fait la Horde d'Or, rgna sur ce qui est au-
jourd'hui le pays des Rpubliques sovitiques et qui avait dj t un
pays de rpubliques urbaines, de communisme villageois et d'anar-
chie... Un nouveau moyen ge. Qui sait comment le ntre finira si
Pierre le Grand est Kaboul et non plus Moscou ?
L'Action franaise, 26 janvier 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 265
8.3
Despotes clairs
L'Action franaise, 27 octobre 1928.
Retour la table des matires
De retour dans ses tats, aprs avoir visit l'Europe, le roi d'Afg-
hanistan a entrepris de moderniser ses sujets. Ou plutt son ardeur
les moderniser s'est accrue. Et, selon la mthode qui est employe
avec succs par son quasi voisin Moustapha Kemal, il procde par
voie d'autorit.
L'exemple vient de loin. Dans la mesure o la Russie participe de
l'Orient, Pierre le Grand avait dj donn l'exemple aux pays orien-
taux. Le roi Amanoullah rpte le tsar qui tait venu Saardam pour y
apprendre l'art de construire les vaisseaux. Il le rpte au point d'obli-
ger les vieux Afghans, comme le Romanov ses boards, couper leur
barbe et se vtir l'europenne sous peine de mort.
Ce qui marque la diffrence des temps, c'est l'inattention de l'Eu-
rope l'gard de ces efforts novateurs de l'Asie. Qu'on se souvienne
de la sensation que produisit Paris la visite de Pierre le Grand. La
littrature et la philosophie s'emparrent du rformateur. Il sortit de l
une thorie, celle du despotisme clair. Frdric en Prusse, J oseph Il
en Autriche, Pombal au nom du roi de Portugal se conformrent
l'image que les philosophes avaient trace d'aprs le modle de l'auto-
crate moscovite.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 266
Il se passe en ce moment dans le monde autant de choses dignes
d'tonner qu'au sicle qui s'admirait lui-mme de rpandre tant de lu-
mires. Seulement, il n'y a presque plus personne pour les remarquer.
La modernisation de la Russie dans le premier quart du dix-
huitime sicle eut pourtant un retentissement considrable sur l'Eu-
rope, et, par l'introduction d'un lment nouveau dans le rapport des
forces politiques, produisit des effets considrables et prolongs, bou-
leversant les mthodes et les traditions des chancelleries, altrant
l'quilibre et les alliances, bref changeant tout. L'apparition de la ques-
tion d'Orient et les partages de la Pologne, avec les suites qui en d-
coulrent, furent la consquence de la rnovation de la Russie. Albert
Sorel a dit admirablement cela.
Que sortira-t-il de ces rformes coups de hache qui s'accomplis-
sent en Asie ? Car, d'Angora Kaboul en passant par Thran, c'est
une chane de pouvoirs nergiques rsolus rompre avec le pass. La
Turquie, la Perse et l'Afghanistan renoncent leurs anciennes moeurs.
Ces pays ne sont plus ce qu'ils taient hier. Il parat difficile que l'on
ne s'en ressente pas, -- et l'on n'a pas beaucoup l'air de s'en douter.
L'Action franaise, 27 octobre 1928.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 267
8.4
Une victime du progrs
L'Action franaise, 16 janvier 1929.
Retour la table des matires
ON dirait une fable. Le roi Amanoullah, rformateur, est victime
du progrs. Il croyait trop aux ides modernes et mme aux complets-
vestons de coupe moderne. Ses sujets l'ont renvoy la Belle Jardi-
nire et la reine Souryah chez les couturiers.
Carlyle a fait dans le Sartor resartus la philosophie du costume. Il
est trange, en effet, que la plus forte passion des habitants de ce
globe, notre poque, soit de s'habiller tous de la mme faon. Quelle
que soit la condition, quelle que soit la contre, quelle que soit mme
la temprature, les hommes, ne pouvant tre tout fait gaux, veulent
au moins avoir l'air pareils. D'ici peu, la Congolaise aspirera au simili-
vison.
Et les despotes clairs, qu'a voulu copier Amanoullah, et dont
Pierre le Grand reste le modle, commencent toujours, pour abolir les
vieilles moeurs, par interdire l'ancien costume. Moustapha Kemal ne
conoit pas de cerveaux volus sous un fez. Les rvolutionnaires de
Nankin, pour initier les Chinois l'Occident, ont coup les nattes.
Les Afghans ont la faiblesse de tenir encore au turban des hommes
et au voile des femmes. Ce sont des symboles. La grande rforme
d'Amanoullah tait vestimentaire. C'est l qu'il a chou.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 268
Un jour viendra o les peuples de l'Afghanistan rougiront de rester
seuls dans le monde ne pas se coiffer de chapeaux mous et ne pas
porter d'impermables. Cependant, avec cette garde-robe, Amanoullah
prtendait leur imposer d'autres signes de la civilisation moderne qui
n'ont pas plu davantage ses sujets.
Si quelque monarque du pass pouvait revenir parmi nous, il ne
manquerait pas d'admirer un certain nombre de moyens de gouverne-
ment dont taient privs Philippe Il et Louis XIV. Amanoullah tait
venu d'un pays lointain comme du fond des ges. Avec une joyeuse
surprise, il avait dcouvert dans les dmocraties occidentales des ins-
truments de rgne dont il s'tait empress d'appliquer la recette ds
son retour Kaboul.
De ces instruments de rgne, la conscription est le plus sr. Faire
de chaque citoyen un soldat, le tenir sa disposition jusqu' la limite
de l'ge par le livret militaire et la feuille qui mobilise, c'est une des
plus belles inventions de l'art de gouverner. Les Afghans n'y ont pas
t sensibles, ou plutt ils en ont compris les inconvnients. La cons-
cription a t pour Amanoullah une des causes essentielles de sa
chute.
Mais aussi ne s'y tait-il pas bien pris. Avant de faire passer ses su-
jets sous la toise, il aurait d prendre la prcaution de leur annoncer
qu'ils taient libres. Il aurait fallu, avec la feuille de mobilisation, leur
donner le bulletin de vote. Il aurait fallu leur donner en outre la libert
de la presse, invention plus admirable encore que les autres, car elle a
cet effet que les peuples croient avoir pens eux-mmes ce que l'tat
veut qu'ils pensent.
Tout cela sera reprendre en Afghanistan et, n'en doutons pas, un
jour ou l'autre sera repris. L'chec d'Amanoullah est un rpit trs pr-
caire. On verra un peuple afghan que le progrs ,organisera et qui
pourra tre alors nationaliste, militariste et belliqueux comme il se
doit dans tous les pays qui passent de la barbarie la civilisation mo-
derne.
L'Action franaise, 16 janvier 1929.
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 269
8.5
Le fils du porteur d'eau
La Libert, 19 janvier 1929.
Retour la table des matires
On a reprsent jadis Paris l'aventure merveilleuse de Kismet,
popularise depuis par le cinma. Kismet, le vagabond de Bagdad
(Guitry le pre tait tonnant dans ce rle), pauvre hre le matin, ca-
life toute la journe, se retrouvait mendiant le soir. Cette ferie se joue
en ce moment Kaboul, ce qui prouve que les Mille et une Nuits ne
sont pas encore finies en Orient.
Lorsque fut la mille et deuxime nuit, Scheherazade put continuer
le fil de ses contes. Voici le dbut de son rcit : Il tait une fois le
fils d'un porteur d'eau... En effet, depuis que le roi Amanoullah a
abdiqu en faveur de son frre Inayatullah, celui-ci a dj t renvers
par le chef des rebelles Bacha Sekao qui bientt peut-tre sera pro-
clam roi. Et Bacha Sekao est le fils d'un simple porteur d'eau, profes-
sion qui a disparu Paris et c'est dommage puisqu'elle peut introduire
de si brillantes destines.
Dans cet Orient que l'on disait immobile, les changements les plus
prodigieux sont possibles. Dans ce pays de castes, rgne la vritable
galit, celle qui permet un portefaix de devenir padischah. Est-ce
que, dans le grand tat voisin de l'Afghanistan, en Perse, celui qui r-
gne aujourd'hui et qui s'asseoit sur le trne de Darius et de Chosros
n'tait pas, il y a quelques annes, petit commis des douanes ? C'est
justement le trait de gnie du fameux colonel Lawrence d'avoir com-
J acques Bainville, La Russie et la barrire de lEst (1937) 270
pris que, dans les pays orientaux, on pouvait tout faire, mme des rois.
Et son invention d'Hussein, de Fayal et d'Abdullah, qui paraissait
romanesque, n'tait pas tellement absurde. Elle l'tait mme srement
moins que la constitution parlementaire que nous avons donne la
Syrie.
Pour peu qu'Allah et le colonel Lawrence le veuillent, le fils du
porteur d'eau pourra devenir roi d'Afghanistan. Le restera-t-il ? C'est
une autre affaire. On savait jadis que dans les factions, comme dans
les combats, - du triomphe la chute il n'est souvent qu'un pas.
Amanoullah peut se rpter ces vers philosophiques.
Amanoullah ne perd pas l'espoir de reprendre son trne et de jeter
au fond d'un puits l'usurpateur, fils du porteur d'eau. Est-il vrai que le
souverain dchu compte sur l'aide et l'appui des Soviets ? Mais les
vnements de Moscou ne sont peut-tre pas si loin d'tre aussi mer-
veilleux et dramatiques que ceux de Kaboul. Dj nous avons vu la
grandeur et la dcadence de Trotsky. son tour, Boukharine connat
la chute aprs le triomphe. Une chose est sre, dans ces tnbreuses
rivalits, c'est que les bolcheviks n'en sont plus aux temps hroques
o ils se juraient de ne jamais se combattre entre eux et de ne pas re-
commencer la faute des rvolutionnaires franais, lorsque Robes-
pierre, envoyant Danton l'chafaud, prparait pour lui-mme la guil-
lotine.
La Libert, 19 janvier 1929.
Fin du livre.
Vous aimerez peut-être aussi
- La Russie en 1914-1917Document280 pagesLa Russie en 1914-1917nuitdesfees2041Pas encore d'évaluation
- Application Pour Tablette Philaplus Yvert Et TellierDocument2 pagesApplication Pour Tablette Philaplus Yvert Et TellierAnonymous j1FODscz5Pas encore d'évaluation
- Palissy CeramicaDocument490 pagesPalissy Ceramicaciudadano ciudadanoPas encore d'évaluation
- 37 Construction Cadran Solaire 8526342Document11 pages37 Construction Cadran Solaire 8526342esperance_fabienPas encore d'évaluation
- Delisle - Lecabinetdesmanu01deliuoftDocument600 pagesDelisle - Lecabinetdesmanu01deliuoftRaffy QuintoPas encore d'évaluation
- 1-Olivier Terre PailleDocument61 pages1-Olivier Terre PailleEmmanuel Edgard PEMBIPas encore d'évaluation
- Livret Expo Apollo VFDocument32 pagesLivret Expo Apollo VFmroyhyx501Pas encore d'évaluation
- Collection Henri Leblanc, Destinée À L'état. La Grande Guerre: Iconographie, Bibliographie, Documents Divers. t.1Document490 pagesCollection Henri Leblanc, Destinée À L'état. La Grande Guerre: Iconographie, Bibliographie, Documents Divers. t.1Michel BossonePas encore d'évaluation
- PaleographiemusicalDocument516 pagesPaleographiemusicalRené Matei100% (1)
- Nouveau Manuel Complet de Numismatique Ancienne. Ouvrage Accompagné D'un Atlas / Par J.B.A.A. BarthelémyDocument489 pagesNouveau Manuel Complet de Numismatique Ancienne. Ouvrage Accompagné D'un Atlas / Par J.B.A.A. BarthelémyDigital Library Numis (DLN)100% (1)
- Reclus Elisee & Onesime - L Empire Du Milieu - Le Climat Le Sol Les Races Les Richesses de La ChineDocument991 pagesReclus Elisee & Onesime - L Empire Du Milieu - Le Climat Le Sol Les Races Les Richesses de La Chinejeanpierre459Pas encore d'évaluation
- Suite de Fibonacci-4Document11 pagesSuite de Fibonacci-4MENYE Elie collinsPas encore d'évaluation
- Rosier GrimpantDocument10 pagesRosier GrimpantbillPas encore d'évaluation
- Fiche Nichoirs Oiseaux 2011 Rev5Document14 pagesFiche Nichoirs Oiseaux 2011 Rev5Gameof OrionPas encore d'évaluation
- Les Monnaies Dans Les Chartes de Brabant, Sous Les Règnes de Jean III Et de Wenceslas / (G. Cumont)Document52 pagesLes Monnaies Dans Les Chartes de Brabant, Sous Les Règnes de Jean III Et de Wenceslas / (G. Cumont)Digital Library Numis (DLN)Pas encore d'évaluation
- VERRIER Paul 1931 Le Vers Français 1 La Formation Du PoèmeDocument300 pagesVERRIER Paul 1931 Le Vers Français 1 La Formation Du PoèmeMatthieu_SeguiPas encore d'évaluation
- La Monnaie Dans L'antiquité 1 - François LenormantDocument358 pagesLa Monnaie Dans L'antiquité 1 - François LenormantYasef Bay100% (2)
- (ARCHAEOLOGY) (ANCIENT) Babelon & Blanchet - Catalogue Des Bronzes Antiques de La Bibliotheque Nationale 1895 PDFDocument830 pages(ARCHAEOLOGY) (ANCIENT) Babelon & Blanchet - Catalogue Des Bronzes Antiques de La Bibliotheque Nationale 1895 PDFAsafteiRoxanaPas encore d'évaluation
- Aux Spirites. Vérités Et Lumières, Nouvelles Révélations Dictées Par L'esprit D'allan Kardec (1898)Document256 pagesAux Spirites. Vérités Et Lumières, Nouvelles Révélations Dictées Par L'esprit D'allan Kardec (1898)digital_dollPas encore d'évaluation
- Train A Levitation MagnetiqueDocument7 pagesTrain A Levitation Magnetiqueedwardnightmare634Pas encore d'évaluation
- Histoire Et Theorie Du Symbolisme ReligieuxDocument782 pagesHistoire Et Theorie Du Symbolisme ReligieuxsantseteshPas encore d'évaluation
- Numismatique Liégoise: Notes Sur La Monnaie de Compte Dans La Principauté de Liège / Par Hubert FrèreDocument24 pagesNumismatique Liégoise: Notes Sur La Monnaie de Compte Dans La Principauté de Liège / Par Hubert FrèreDigital Library Numis (DLN)100% (1)
- Les Cadrans Solaires PDFDocument19 pagesLes Cadrans Solaires PDFSalmaPas encore d'évaluation
- Tout Ou Rien ?Document2 pagesTout Ou Rien ?FranckPas encore d'évaluation
- GlasgowDocument2 pagesGlasgowMahavashtar Amida RoméoPas encore d'évaluation
- A L'ouest Barbare de La Vaste Chine - David-N El, AlexandraDocument608 pagesA L'ouest Barbare de La Vaste Chine - David-N El, Alexandrabuchen-leserPas encore d'évaluation
- Hegel Peinture HenriotDocument91 pagesHegel Peinture HenriotDr. San bruno de la Cruz , Lisardo FermínPas encore d'évaluation
- Baudin, Louis - La Monnaie. Ce Que Tout Le Monde Devrait en SavoirDocument241 pagesBaudin, Louis - La Monnaie. Ce Que Tout Le Monde Devrait en SavoirdoudzoPas encore d'évaluation
- Bloch Capetiens PDFDocument141 pagesBloch Capetiens PDFtoopee1Pas encore d'évaluation
- Corpus Des Monnaies Arabo Musulmanes DesDocument24 pagesCorpus Des Monnaies Arabo Musulmanes DesHameed SaeedPas encore d'évaluation
- Adolf Hitler - La Plus Grande Histoire Jamais Racontee - Partie 1 Sur 3Document65 pagesAdolf Hitler - La Plus Grande Histoire Jamais Racontee - Partie 1 Sur 3Youssef AbdoulayePas encore d'évaluation
- Les Trois Horloges Astronomiques de La Cathedrale de StrasbourgDocument48 pagesLes Trois Horloges Astronomiques de La Cathedrale de Strasbourgsloane10Pas encore d'évaluation
- Électroculture. Comment Faire Des Tours en Basalte-CimentDocument5 pagesÉlectroculture. Comment Faire Des Tours en Basalte-CimentsyliusPas encore d'évaluation
- Les Étapes de La Momification PDFDocument3 pagesLes Étapes de La Momification PDFAnonymous KwAimG9J67% (3)
- Claude Brézinski Les Images de La TerreDocument301 pagesClaude Brézinski Les Images de La TerreMarie Jourdain de MuizonPas encore d'évaluation
- Electroculture. Le Basalte Tour D'horizon SurDocument13 pagesElectroculture. Le Basalte Tour D'horizon SursyliusPas encore d'évaluation
- L'Aiòli. - N°327 (Óutobre 1930)Document4 pagesL'Aiòli. - N°327 (Óutobre 1930)Chris BrennanPas encore d'évaluation
- Histoire Littéraire de HergéDocument4 pagesHistoire Littéraire de HergéSodomize The Insects100% (1)
- Medievales - Num 31 - Automne 1996Document164 pagesMedievales - Num 31 - Automne 1996Vetusta MaiestasPas encore d'évaluation
- ArcheDocument8 pagesArchedondegPas encore d'évaluation
- Fabriquer Cadran SolaireDocument1 pageFabriquer Cadran SolaireanihumPas encore d'évaluation
- Déserts Daltitude - Sarah MarquisDocument138 pagesDéserts Daltitude - Sarah MarquisbousbousPas encore d'évaluation
- Histoire Partiale Histoire Vraie Vol.04 by Guiraud, Jean, 1866-1953Document402 pagesHistoire Partiale Histoire Vraie Vol.04 by Guiraud, Jean, 1866-1953Jorge Candido da SilvaPas encore d'évaluation
- L'Aiòli. - Annado 09, N°308 (Juliet 1899)Document4 pagesL'Aiòli. - Annado 09, N°308 (Juliet 1899)Chris BrennanPas encore d'évaluation
- La Route Du TriskelDocument9 pagesLa Route Du TriskeljohnnybegoudePas encore d'évaluation
- Un Monde Sans Argent - Stop MensongesDocument7 pagesUn Monde Sans Argent - Stop MensongesSandrine KamedjuPas encore d'évaluation
- Inconnu - Recit D'un Pélerin Russe - EBOOKDocument162 pagesInconnu - Recit D'un Pélerin Russe - EBOOKDavid Josué Ndongo Nyama100% (1)
- 2014 Les Atlantes, Jadis - Claude SarrazinDocument27 pages2014 Les Atlantes, Jadis - Claude SarrazinjotowPas encore d'évaluation
- C.Delaunay - Cours Élémentaire D'astronomie PDFDocument634 pagesC.Delaunay - Cours Élémentaire D'astronomie PDFbelgam2Pas encore d'évaluation
- Revue Celtique No.1Document614 pagesRevue Celtique No.1Ronald Wilson100% (1)
- Ninfas No Azulejos de Adriana VarejãoDocument19 pagesNinfas No Azulejos de Adriana VarejãoRenata LimaPas encore d'évaluation
- Berthelot Les Origines de La Alchimie PDFDocument484 pagesBerthelot Les Origines de La Alchimie PDFroberto-martinsPas encore d'évaluation
- La Relativité Pour Les NulsDocument23 pagesLa Relativité Pour Les NulsAnonymous s9efktQPas encore d'évaluation
- Énigme Sacrée, L' - Baigent, Michael & Leigh, Richard & Lincoln, HenryDocument512 pagesÉnigme Sacrée, L' - Baigent, Michael & Leigh, Richard & Lincoln, HenryFatima LairechePas encore d'évaluation
- Arch I SerreDocument14 pagesArch I SerreLum_Lux_DatumPas encore d'évaluation
- Ebook Leonard Rosen - La Theorie Du ChaosDocument384 pagesEbook Leonard Rosen - La Theorie Du ChaosmfaglaPas encore d'évaluation
- 24-01-2016-Alignement Planétaire-Convergence Harmonique-La Paix MondialeDocument4 pages24-01-2016-Alignement Planétaire-Convergence Harmonique-La Paix MondialeSwissCIAfreedomPas encore d'évaluation
- Le Gnomon du Méridien Cassini: La méridienne à chambre obscure du Sanctuaire de N.D de la Visitation à PerinaldoD'EverandLe Gnomon du Méridien Cassini: La méridienne à chambre obscure du Sanctuaire de N.D de la Visitation à PerinaldoPas encore d'évaluation