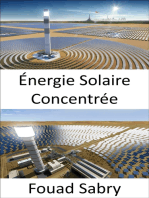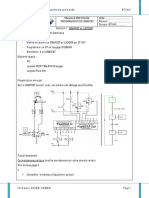Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Manuel Technicien Photovoltaique
Le Manuel Technicien Photovoltaique
Transféré par
Hou SsemCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Manuel Technicien Photovoltaique
Le Manuel Technicien Photovoltaique
Transféré par
Hou SsemDroits d'auteur :
Formats disponibles
3
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Avant-propos
L
exploitation des nergies renouvelables, en particulier de celle issue de lastre
solaire, aux fns dassurer un approvisionnement durale en services nerg-
tiques, sest considrablement accrue durant ces dernires dcennies.
Les quipements photovoltaques sont, au fl du temps, devenus fables. Par
ailleurs les installations sont plus durables grce notamment la qualit de la ra-
lisation des ouvrages mais aussi de leur maintenance. Il est donc important, afn
de prserver ces acquis, davoir des techniciens bien forms et dots de supports
pouvant les assister dans leurs travaux quotidiens.
Ainsi, ce manuel du technicien photovoltaque se veut un support qui accompagne
le technicien au cours de la mise en uvre des quipements, mais aussi des in-
terventions dentretien et de maintenance des installations.
Aprs avoir labor plusieurs supports de formation dans le cadre de multiples
enseignements que nous avons eu la charge de prodiguer, il nous a t donn
de constater un manque de manuel didactique destin aux techniciens de terrain.
Ce manuel est donc le fruit de plus de deux dcennies dexpriences lies la
formation des techniciens mais aussi leur suivi lors de la ralisation des tches
dinstallation et de maintenance.
Le manuel du technicien photovoltaque contient lessentiel de ce quil faut savoir
pour raliser une installation de qualit et une maintenance optimale. Nous lavons
voulu pratique et simple afn quil puisse constituer un guide du technicien aussi
bien dbutant quexpriment.
Il est constitu de 5 parties thmatiques :
La partie 1 : qui prsente les principes de base sur llectricit ;
La partie 2 : qui traite de la conversion photovoltaque en prsentant les carac-
tristiques fonctionnelles des diffrents sous-systmes ainsi que les conditions
Avant-propos
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
4
optimales de leur fonctionnement ;
La partie 3 : qui donne des prescriptions indispensables pour une installation des
quipements selon les normes ;
La partie 4 : qui fournit la dmarche pour une ralisation optimale des tches de
maintenance prventive des installations ; et
La partie 5 : qui donne la dmarche pour une recherche rapide des pannes cou-
rantes, ainsi que les mthodes pour remdier ces pannes.
Nous pensons ainsi, par la publication de ce manuel, pouvoir contribuer conso-
lider la fabilit des installations, en appuyant une formation de qualit mais aussi
en fournissant un support aux techniciens de terrain qui leur permette de rpondre
plus aisment aux diffrentes questions dentretien et de maintenance quils se
posent au quotidien.
Mansour Assani Dahouenon
Conseiller Technique en lectrifcation rurale
et nergies renouvelables
PERACOD
Avant-propos
5
Sommaire
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
6
6
Sommaire
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
7
1. Principe de llectricit courant continu
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
1. Principe de llctricit courant continu
1.1 Circuit lectrique
Un circuit lectrique est compos de gnrateur(s) et de rcepteurs relis entre
eux par des conducteurs. Par convention, le courant circule dans ce circuit des
bornes positives vers les bornes ngatives.
Schma 1-1
Circuit lectrique de base
Par convention, les signes sont
tablis selon la rgle suivante
UG > 0 // UR > 0 // I > 0
1.2 Gnrateurs
Les gnrateurs sont des appareils qui transforment de lnergie sous une forme
donne en nergie lectrique.
Exemple : Panneau solaire : transforme lnergie solaire en nergie lectrique
Groupe lectrogne : transforme lnergie mcanique en nergie lectrique
1.3 Conducteurs
Les conducteurs sont des matriaux qui permettent le passage du courant lec-
trique. Ces conducteurs relient les gnrateurs aux rcepteurs.
Exemple : Cble lectrique
1.4 Rcepteurs
Les rcepteurs sont des appareils dutilisation qui consomment de lnergie lec-
trique avec ou sans dissipation de chaleur.
8
1. Principe de llectricit courant continu
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Exemple : Lampes, radio ; radiocassettes, tlviseurs, moteurs
1.5 Dfnition
1.5.1 Tension lectrique
Pour que llectricit se propage dans les conducteurs (cbles) du gnrateur aux
rcepteurs, il faut quil existe une diffrence de niveau (potentiel) aux bornes du
gnrateur. Cette diffrence de niveau est appele tension lectrique. Le symbole
de la tension est U, lunit de mesure est le Volt V. Quand la tension lec-
trique U aux bornes dun gnrateur est constante, on dit que ce gnrateur
dlivre du courant continu. Quand la tension est changeante on dit que la tension
est alternative.
Schmas 1-2 et 1-3
Evolution de la tension en fonction du
temps (tension constante et tension
alternative).
1.5.2 Intensit de courant lectrique
Lintensit du courant lectrique est la quantit dlectricit qui circule en un temps
donn travers un conducteur. Le symbole de lintensit du courant lectrique est
I, lunit de mesure est lAmpre A.
1.5.3 Rsistance lectrique
Lopposition que prsente le conducteur au passage du courant lectrique est ap-
pele rsistance lectrique. Son symbole est R et lunit de mesure est lOhm ().
La rsistance dun conducteur dpend de la nature de ce conducteur soit sa rsis-
tivit (), de sa longueur (L) et de sa section (S).
9
1. Principe de llectricit courant continu
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Avec : R []
[.mm.m-1]
[.mm.m-1]
L [m]
S [mm]
Exemple : Un conducteur en cuivre mesure 10 mtres de longueur (L) et a une
section S de 2,5 mm2. Sa rsistivit est = 0,01786 .mm/m 25C.
La rsistance de ce conducteur est :
donc: R = 0,0714
1.5.4 Puissance lectrique
La puissance lectrique est le produit de lintensit de courant et de la tension.
Son symbole est P, son unit le Watt (W).
Avec : P en [W]
U en [V]
I en [A]
Exemple : Si un gnrateur dune tension de 12 Volts alimente un rcepteur qui
appelle un courant de 5 Ampres. La puissance dbite par
le gnrateur est :
P = U . I = 12 * 5 = 60 W
1.5.5 Loi dOhm
La loi dOhm exprime la relation entre la tension lectrique, lintensit de courant
et la rsistance lectrique. Cette loi peut sexprimer des faons suivantes :
Avec : U en Volt [V]
R en Ohm []
I en Ampres [A]
Connaissant deux de ces valeurs (R, U ou I), la troisime peut tre dduite par
lune des formules indiques ci-dessus.
Exemples :
10
1. Principe de llectricit courant continu
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
1.5.6 Circuit Parallle
Schma 1-4
Circuit parallle
Quand les rcepteurs sont placs en parallle, alors les caractristiques du cir-
cuit sont les suivantes :
I = I1 + I2 (Loi des nuds : la somme des courants arrivant
un nud est gale la somme des courants qui en sortent)
UG = UR1 = UR2
La tension rsultante est gale la tension aux bornes de cha-
cune des rsistantes.
1.5.7 Circuit Srie
11
1. Principe de llectricit courant continu
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
11 11
Schma 1-5
Circuit srie
Quand les rcepteurs sont placs en srie, alors les caractristiques du circuit
sont les suivantes :
Lintensit est la mme dans tout le circuit.
UG = UR1 + UR2
La tension rsultante est la somme des tensions aux bornes
des rsistantes
1.5.8 Energie Electrique
Lnergie lectrique est le produit de la puissance par le temps. Son symbole est
E et son unit est le Wattheure [Wh]
Avec : E en [Wh]
P en [W]
t en [h
Le courant continu peut tre transform en courant alternatif.
Pour cela on utilise un appareil appel onduleur qui transforme le
courant continu en courant alternatif
Cet appareil est donc aliment son entre par du courant continu.
On obtient sa sortie du courant alternatif qui permet dalimenter
des rcepteurs en courant alternatif
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
12
2. Conversion photovoltaique
2. Conversion photovoltaique
Malgr la grande distance qui le spare de la terre, le soleil lui fournit une nergie
importante. Cette nergie est disperse puisse que la dure densoleillement varie
dune rgion une autre de la terre. Cette nergie change aussi selon les saisons
et les caractristiques climatiques du site.
Le rayonnement solaire change en outre suivant les conditions mtorologiques
du moment (nbulosit, poussire, humidit, etc.) et la position du soleil dans le
ciel (heure).
On appelle ensoleillement ou rayonnement la puissance du rayonnement so-
laire reue par une unit de surface : Ensoleillement moyen annuel). Il sexprime
en Watt par mtre carr [W/m2].
On appelle irradiation lnergie reue pendant un intervalle de temps. Si cet in-
tervalle de temps est le jour, elle sexprime en Wattheure par mtre carr par jour
[Wh/m2/j].
Carte 2-1
Carte prliminaire de
lensoleillement moyen
(kWh/ m2/ j) du sngal
13
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
2.1 Leffet photovoltaque
Figure 2-2
Leffet photovoltaque
Leffet photovoltaque utilis dans les cellules solaires permet de convertir directe-
ment lnergie lumineuse (photons) des rayons solaires en lectricit, par le biais
du dplacement de charges lectriques dans un matriau semi-conducteur (le si-
licium).
Lorsque les photons heurtent une surface mince de ce matriau, ils transfrent
leur nergie aux lectrons de la matire. Ceux-ci se mettent alors en mouvement
dans une direction particulire, crant ainsi un courant lectrique.
Le matriau semi-conducteur comporte deux parties, lune prsentant un excs
dlectrons et lautre un dfcit en lectrons, dites respectivement dope de type n
et dope de type p.
Les lectrons en excs dans le matriau n diffusent dans le matriau p. La zone
initialement dope n devient charge positivement, et la zone initialement dope p
charge ngativement.
Il se cre donc entre elles un champ lectrique.
2.2 Les panneaux photovoltaques
2.2.1 La cellule photovoltaque
Les cellules photovoltaques sont des composantes lectroniques qui transfor-
ment les rayons lumineux du soleil en lectricit.
Ces cellules ont des puissances unitaires assez faibles (de lordre de 1 W).
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
14
2. Conversion photovoltaique
Figure 2-3
Cellule photovoltaque
2.2.2 Les modules photovoltaques
Association des cellules
Afn dobtenir des modules de puissances leves, les cellules sont associes en
srie ou en srie / parallle. Pour cela les connexions des ples ngatives situes
sur les faces avant des cellules sont connectes aux ples positifs situs sur les
faces arrire des cellules suivantes.
Figure 2-4
Association des cellules
Le module photovoltaque transforme lnergie solaire en nergie lectrique. Il joue
donc le rle de gnrateur dans le systme photovoltaque. Lnergie produite par
un module photovoltaque dpend du niveau de lnergie solaire. Ainsi, durant la
journe, lnergie produite va varier en fonction de la variation de lnergie solaire.
Le module photovoltaque est obtenu aprs association des cellules avec les l-
ments constitutifs ci-aprs :
Figure 2-5
Module photovoltaque
15
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Constitution dun module
Figure 2-6
Constitution dun module
photovoltaque
Un module est constitu des cellules associes en srie/parallle encapsules et
protges par :
En Face avant du module
La face avant du module doit tre en verre ayant les caractristiques suivantes :
bonne transparence
rsistance limpact et labrasion (grle, jet de pierres, vent de sable, net-
toyage au chiffon).
tanchit lhumidit.
Lenrobage des cellules ayant les caractristiques suivantes :
transparence ( lavant)
souplesse pour enrober les cellules et connexions.
adquation aux indices optiques du verre et des cellules.
Le matriau gnralement utilis est de lActate dthylne-vinil ( EVA ).
En Face arrire, un matriau ayant les caractristiques suivantes :
Protection mcanique contre le poinonnement et les chocs (risque de mise
nu et de bris des cellules).
tanchit lhumidit.
bonne vacuation de la chaleur.
La face arrire est gnralement ralise soit en verre (modules dits bi-verre)
soit en composite tedlar/alu/tedlar (plus fragile).
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
16
2. Conversion photovoltaique
Un Botier de connexion qui permet :
le reprage des sorties (+, -, ventuellement point milieu),
la connexion et le passage des cbles de liaison,
le logement des diodes de protection,
ltanchit lhumidit.
Un joint priphrique
Il vite les pntrations dhumidit entre la face avant et la face arrire.
Un cadre
Il permet le montage et la fxation mcanique, tout en participant si ncessaire
la rigidit du module. Il doit rsister la corrosion (inox, aluminium...) et la
visserie doit tre choisie afn dviter des problmes de corrosion.
Le cadre est gnralement en aluminium ou en aluminium anodis avec une
visserie en matriau inoxydable.
2.2.3 Protections des cellules : diodes by-pass et diode anti-retour
Deux types de protection sont gnralement indispensables au bon fonctionne-
ment dun module photovoltaque.
La protection par diodes parallles (ou by-pass) a pour but de protger une srie
de cellules dans le cas dun dsquilibre li la dfectuosit dune ou plusieurs
des cellules de cette srie ou dun ombrage sur certaines cellules.
La diode srie place entre le module et la batterie empche pendant lobscurit
le retour de courant vers le module. Elle est dans ce cas appele encore diode
anti-retour.
Figure 2-7
Protections des modules :
diodes by-pass et anti-retour
17
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Comme le montre la fgure ci-aprs, quand une cellule des 36 dun module est
masque, elle schauffe anormalement si le module nest pas quip de diodes
by-pass.
Figure 2-8
Illustration du comportement
dune cellule masque dans un
module sans diodes by-pass
Quand le module est quip de diodes by-pass la cellule masque est protge
contre lchauffement comme le montre la fgure ci-aprs :
Figure 2-9
Protection dune cellule mas-
que dans un module protg
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
18
2. Conversion photovoltaique
Par commodit, les cellules dun module sont protges par deux diodes places
dans la bote de connexion du module
Figure 2-10
Disposition des diodes by-
pass dans un module
Dans le cas de deux ou plusieurs modules branchs en parallle, les diodes s-
rie empchent le courant de traverser le module qui devient rcepteur (par dfaut
ou par occultation).
Figure 2-11
Diodes anti-retour
19
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
2.2.4 Paramtres principaux
La caractristique fonctionnelle dun module est illustre par sa caractristique
Courant-Tension ci-dessous.
Graphe 2-12
Caractristique courant-tension
dun module photovoltaque
Les principaux paramtres qui caractrisent un module sont :
le courant de court-circuit : Icc
la tension de circuit ouvert : Vco
le courant correspondant au point de puissance maximale : Im
la tension correspondant au point de puissance maximale Vm
Puissance crte : qui est la puissance maximale : P = Vm.Im: pour une temp-
rature des cellules Tj = 25C, un ensoleillement de 1000 W/m2 et une distance
optique AM 1,5
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
20
2. Conversion photovoltaique
La tension qui correspond la puissance maximale sous un enso-
leillement donn reprsente 75 90 % de la tension de circuit ouvert.
Elle diminue en fonction de la temprature.
Le courant maximal que peut dbiter un module (IM) reprsente 90
94 % du courant de court-circuit sous un ensoleillement donn
Le courant de court-circuit et le courant maximal en charge que peut
dbiter un module sont presque exclusivement dpendants de len-
soleillement.
2.3 Batteries daccumulateurs au plomb
2.3.1 Constitution et paramtres caractristiques
Figure 2-13
Elments constitutifs dune
batterie au plomb
Quatre lments sont indispensables pour le fonctionnement dune batterie au
plomb. Il sagit dune lectrode positive, dune lectrode ngative, dun lectrolyte
et dun sparateur :
21
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
llectrode ngative est constitue de plomb spongieux (Pb),
llectrode positive est constitue doxyde de plomb (PbO2),
llectrolyte est une solution dacide sulfurique (H2SO4),
le sparateur en matire poreuse isolante a les proprits suivantes :
* grande rsistivit lectrique,
* grande rsistance chimique lacide sulfurique,
* bonne porosit aux ions.
Le sparateur a pour but dviter un court-circuit interne entre deux lectrodes. En
effet, pour des raisons dencombrement et de rduction de la rsistance interne,
les plaques positives et ngatives dun accumulateur sont trs proches les unes
des autres (d 10 mm).
Llectrolyte est fabriqu partir de lacide sulfurique hautement concentr en le
versant dans de leau purife
La densit nominale de llectrolyte pour les accumulateurs au plomb est spcife
selon les applications par le fabricant de batterie et par rapport une temprature
nominale
Les caractristiques principales des batteries au plomb sont :
a) Tension nominale : multiple de 2 V (6, 12, 24 ...)
b) La capacit nominale de la batterie
La capacit dune batterie dtermine pendant combien de temps cette batterie
peut tre dcharge courant constant. Ainsi une batterie de 50 Ah peut tre d-
charge avec un courant constant de 5 A pendant 10 heures (5 A x 10h = 50 Ah).
La capacit C dune batterie est donc le produit du courant de dcharge I par le
temps de dcharge t.
C = I . t
[Ah] = [A] [h]
Exemple : Pendant combien de temps une batterie de 100 Ah peut-elle tre d-
charge avec un courant constant de 10 A ?
Si : C = I . t
C = 100 Ah
I = 10 A
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
22
2. Conversion photovoltaique
Une batterie de 100 Ah peut donc tre dcharge avec un courant constant de 10
A pendant 10h.
NOTE :
C
10
= Capacit (Ampres-heures) restitue lors dune dcharge en 10 heures.
C
100
= Capacit (Ampres-heures) restitue lors dune dcharge en 100
heures. Cette batterie est mieux adapte aux conditions de charge-d-
charge rencontres en utilisation photovoltaque
c) La densit de llectrolyte
d) Autodcharge
Lautodcharge est la perte de capacit en pourcentage de la capacit nominale
lorsque la batterie nest pas utilise.
e) Rendement nergtique
Le rendement est le rapport entre la quantit dnergie dbite la dcharge et la
quantit dnergie fournie lors de la charge.
Quelques dfnitions utiles :
La tension de fn de charge : Est la tension dun lment ou dune
batterie laquelle le processus de charge est arrt par la source
chargeante.
Tension de fn de dcharge : La tension dun lment ou dune bat-
terie laquelle la dcharge est termine. Cette tension dpend du
courant de dcharge.
Profondeur de dcharge : DOD : Quantit de charge restitue par
une batterie pleinement charge et exprime en pourcentage par
rapport la capacit nominale de la batterie.
Tension de Gassing : Tension laquelle senclenche le phnomne
de dgagement gazeux sur chaque lectrode de la batterie. Ce ph-
nomne est corrl la tension. La valeur de la tension de gassing
est elle-mme presque uniquement dpendante de la temprature.
Charge dgalisation : La continuation de la charge dune batterie
au del de la tension de fn de charge en vue dobtenir lgalisation
des charges des diffrents lments de la batterie.
23
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Quelques exemples de batteries les plus utilises pour les applica-
tions photovoltaques :
Batteries formes dlments stationnaires plaque positive tubu-
laire (2 V) et grande rserve dlectrolyte. Capacits courantes : de
100 3.000 AH. Ce type de batterie est le mieux adapt aux cycles
journaliers et saisonniers rencontrs dans les systmes PV.
Batteries formes dlments stationnaires plaques planes (2 V)
et grande rserve dlectrolyte. Capacits courantes : de 10 300
AH. Ces batteries sont moins performantes que celles ci-dessus en
nombre de cycles (dure de vie).
Batteries plomb tanche sans entretien (2, 6 et 12 V). Capacits cou-
rantes : 10 100 AH. Ces batteries ont une aptitude au cyclage beau-
coup moins leve et ne doivent donc tre spcifes que pour des
applications o la dure de vie nest pas primordiale par rapport au
cot initial.
NOTE : Les batteries dites de dmarrage (utilises pour les automo-
biles et les camions) et celles dite de traction (utilises par exemple
pour les chariots lvateurs) ne sont pas du tout adaptes un usage
photovoltaque.
2.3.2 Principe de fonctionnement
En dcharge
Au cours de la dcharge. Il y a formation de cristaux (sulfate de plomb) sur cha-
cune des lectrodes. La densit devient faible et ceci en fonction de la quantit
dcharge.
La densit de llectrolyte dcrot en fonction de la quantit dcharge.
La tension de fn de dcharge est fortement lie au courant de dcharge
En charge
Durant la charge, le sulfate de plomb est transform au niveau des plaques, en
plomb (Pb) pour llectrode ngative et en oxyde de plomb (PbO2) pour llec-
trode positive. Cette formation saccompagne de la formation dacide sulfurique.
La densit augmente.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
24
2. Conversion photovoltaique
La charge dune batterie dans un systme photovoltaque seffectue gnra-
lement selon la caractristique de charge IU. La premire phase seffectue
courant quasiment constant jusqu latteinte de la tension de fn de charge
partir de laquelle commence la deuxime phase de charge qui seffectue ten-
sion constante. Durant cette deuxime phase, le courant de charge sera rduit
niveau correspondant au maintien de la charge dans le but de conduire une
charge complte de la batterie.
Au cours de la charge de la batterie, on note :
Que la densit croit lentement en dbut de charge pour remonter brusquement
en fn de charge. Cette remonte brusque de la densit est le rsultat de lho-
mognisation de llectrolyse qui fait suite son bouillonnement caus par
lapparition dun dgagement gazeux.
Que le phnomne de dgagement gazeux appel gassing est li la tension
de charge qui est elle mme quasiment dpendante de la temprature selon la
formule :
(2) Vg = Vgt0 0,005XT
Vg = tension de gassing correspondant la temprature T
Vgt0 = tension de gassing T= 20C
T= temprature actuelle en C
Figure 2-14
Principe de fonctionnement
dune batterie au plomb
25
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
2.3.3 Prcautions dexploitation
Des caractristiques fonctionnelles des batteries au plomb prsentes ci-dessus
dcoulent certaines dispositions prendre qui sont indispensables au bon fonc-
tionnement de ces batteries:
La tension de fn de charge doit tre fxe en tenant compte de la temprature :
- Soit au niveau du rgulateur qui doit tre quip dun dispositif appel
compensateur de temprature qui fxe automatiquement la tension de fn
de charge en fonction de la temprature mesure.
- Soit en prvoyant une tension fxe calcule partir de la formule (2) En
utilisant une temprature maximale du site.
Il faudra veiller ce que la dure du gassing ne dpasse pas 10 heures par
mois.
La fxation du seuil de tension de fn de dcharge doit tenir compte du courant
moyen de dcharge
Des charges dgalisation doivent tre prvues au moins deux fois par an( si le
rgulateur ne dispose pas dune activation automatique de la charge dgalisa-
tion) pour viter la formation prolonge de sulfate sur les plaques des batteries.
2.3.4 Diffrentes causes de la dfaillance des batteries
a) Surcharge des batteries
Les surcharges des batteries engendrent non seulement la corrosion de ses
plaques positives, mais aussi un dgagement excessif de gaz pouvant arracher
des plaques, les matires actives qui se dposent aussi bien au fond du bac,
quentres les sparateurs et les plaques. Les surcharges des batteries gnrent en
outre une augmentation de la temprature de ces dernires, ce qui peut conduire
la destruction des plaques et des sparateurs.
b) Dcharges profondes
Les dcharges profondes sont, ct des surcharges, les premires causes de
la dtrioration dune batterie. Les rsultats des dcharges profondes prolonges
sont entre autre la diminution de la densit de llectrolyte, le dpt au fond du bac
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
26
2. Conversion photovoltaique
de sdiments fns de cristaux de sulfate de plomb et la dcoloration des plaques,
ainsi que leur sulfatation.
c) Sulfatation
La sulfatation consiste en la formation sur les plaques de larges cristaux de sul-
fates de plomb, en lieu et place des fns cristaux qui y sont normalement prsents.
Les causes de la sulfatation sont :
la non-utilisation de la batterie durant une longue priode, aprs sa charge com-
plte ou partielle,
le fonctionnement de la batterie durant des jours un tat de charge partielle,
sans charge dgalisation,
la variation de la temprature dans la batterie.
Les manifestations de la sulfatation sont laugmentation de la rsistance interne
de la batterie, ce qui entrane une diminution de la dcharge et une augmentation
de la tension de charge.
d) Courts-circuits
Les courts-circuits des lments sont gnrs par :
la destruction des sparateurs,
laccumulation excessive des sdiments au fond du bac,
la formation de structures arborescentes de plomb, de la plaque ngative vers
la plaque positive.
Les manifestations du court-circuit des lments sont les suivants :
une densit dlectrolyte faible, en dpit de la rception normale de charge,
une perte rapide de capacit aprs une pleine charge,
une tension vide faible.
e) Autres causes de la diminution de la dure de vie des batteries
Outres les phnomnes dcrits plus haut, dautres causes que nous prsentons
ci-dessous peuvent contribuer la diminution de la dure de vie des batteries.
27
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Il sagit :
des phnomnes de vibrations.
des salissures.
2.4 Rgulateur de charge
Le rgulateur de charge a pour fonction principale de protger la batterie contre
les charges excessives et les dcharges profondes.
Au plan fonctionnel, le rgulateur de charge :
Collecte les informations relatives ltat de charge de la batterie (tension,
tat de charge)
Compare ces informations aux seuils de rgulation pr-fxs :
Vmin : tension de dconnexion de la charge (utilisation) : protection
dcharge profonde.
Vmax : tension de dconnexion des modules : protection la sur-
charge.
Opre la protection de la batterie.
Le processus de rgulation est consign dans le tableau ci-dessous :
ETAT BATTERIE COMMANDE
Vb > Vmax Dconnecte les modules PV
Si 1) est vrai et Vb < Vt1 Reconnecte les modules
PV Vb < Vmin Dconnecte la charge (utilisation)
Si 3) est vrai et Vb > Vt2 Reconnecte la batterie la charge
Avec : Vt1 la tension de reconnexion des modules.
Vt2 la tension de reconnexion des rcepteurs (utilisation).
Vb la tension de la batterie.
Vmax : tension de fn de charge, Vmin : tension de fn de dcharge
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
28
2. Conversion photovoltaique
Exemple de processus de rgulation : cas du rgulateur LEO01 (25C) :
Tension de dconnexion modules 14,50 V
Tension de dconnexion utilisation 11,40 V
Tension de reconnexion utilisation 12,50 V
Le rgulateur Lo ne possde pas de seuil de reconnexion des modules. A
partir de la tension de dconnexion des modules, le courant des modules est
diminu jusqu la charge complte de la batterie.
2.4.1 Principaux types de rgulateur de charge
Il existe deux types de rgulateurs de charge dans les applications photovol-
taques.
a) Rgulateur parallle ou Shunt
Figure 2-15
Schma de principe dun
rgulateur parallle
Le rgulateur shunt rgule la charge de la batterie en linterrompant par un
court-circuit du gnrateur photovoltaque. Lutilisation dune diode srie est in-
dispensable entre la batterie et lorgane de commutation (transistor) afn dviter
un court-circuit simultan de la batterie.
Hors rgulation, la tension Vb de la batterie est infrieure la tension Vlim
correspondant la tension de fn de charge de la batterie. Dans ce cas V+ <
Vref, Vs = 0 et i = 0.
Le transistor est bloqu (Ir= 0), le module dbite et charge la batterie.
En rgulation, le dbut de la rgulation correspond la condition Vb > Vlim
.Dans ce cas V+ > Vref et Vs > 0. Le transistor T conduit Ir > 0 avec Ip = Ir + Ib.
Ir absorbe le courant de charge Ip, ce qui gnre la diminution de la tension Vb
de la batterie.
29
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Figure 2-16
Schma de principe dun
rgulateur parallle
Avantages du rgulateur shunt
Aucune chute de tension dans lunit de charge.
Consommation du rgulateur ngligeable durant la priode de non rgulation.
La dfectuosit du rgulateur nentrane pas linterruption de la charge de la
batterie.
Inconvnient
Ncessit dun dispositif de dissipation thermique adquat.
b) Rgulateur srie
Dans le cas du rgulateur srie, lorgane de commutation est en srie dans le cir-
cuit du gnrateur.
Figure 2-17
Schma de principe dun
rgulateur Srie
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
30
2. Conversion photovoltaique
Hors rgulation, la tension de la batterie Vb est infrieure la tension Vlim. Dans
ce cas, V < Vref ; Vs > 0 et i > 0. Dans ces conditions le transistor est satur. Le
module dbite et charge la batterie.
En rgulation, on a Vb > Vlim. Dans ce cas V > Vref et Vs = 0, i = 0, Ib = 0. Le
transistor ne conduit pas Ip = 0. La tension de la batterie diminue due labsence
de courant de charge. Lquilibre est atteint avec V = Vref et Vb = Vlim.
Avantages du rgulateur srie
La diode de blocage nest pas indispensable.
Inconvnients
Chute de tension dans lunit de charge.
Consommation du rgulateur durant la priode de non rgulation.
La dfectuosit du rgulateur entrane linterruption de charge de la batterie.
Figure 2-18
Caractristique de fonction-
nement dun systme avec un
rgulateur srie
25
20
15
10
5
0
66
Ensoleillement
Batterie
Charge
PV (V)
PV (A)
31
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Guide pour le choix dun rgulateur de charge
Pour le choix dun rgulateur, les caractristiques suivantes sont indispen-
sables :
La tension nominale : elle peut tre de 12 V, 24 V, 48 V etc. en fonction
de la tension du systme dans lequel il sera insr,
Le courant de court-circuit maximal du gnrateur photovoltaque,
Le courant de fonctionnement maximal du gnrateur photovoltaque,
Le courant de charge maximal continu de la charge (rcepteurs),
La tension de circuit ouvert maximale du gnrateur.
En outre, les critres suivants sont indispensables pour le choix dun rgu-
lateur de charge :
Rendement du rgulateur : le rendement caractrise les pertes au
niveau du rgulateur de charge. Le rendement dun bon rgulateur doit
tre le plus lev possible entre 90 et 95 %,
Protections : les protections suivantes doivent tre exiges :
- Protection contre la surtension : lentre du gnrateur doit tre
protge contre la surtension (atmosphrique),
- Inversion de polarit de la batterie : le rgulateur doit tre protg
contre linversion de polarit aux bornes de la batterie,
- Protection contre les courts-circuits : le rgulateur doit tre protg
contre les courts-circuits (exemple par des fusibles),
- Botiers : les botiers des rgulateurs, tout en permettant une bonne
dissipation de la chaleur, doivent tre assez tanches.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
32
2. Conversion photovoltaique
2.5 Groupement des modules et des batteries
Pour obtenir une tension et une puissance suffsante, il est ncessaire de connec-
ter plusieurs modules entre eux. Dans ce cas, plusieurs batteries doivent tre aus-
si connectes entre elles.
2.5.1 Montage des modules en srie
Schma 2-19
Schma de principe dun
rgulateur parallle
Pour obtenir une tension plus leve que celle dun seul module, on connecte
deux ou plusieurs modules en srie. Dans le cas de la connexion de deux modules
en srie, la borne positive (+) du premier module est connecte la borne ngative
(-) du deuxime module.
Ainsi, la tension totale est : Ut = U1 + U2
Le courant total est: It = I1 = I2
2.5.2 Montage des modules en parallle
Pour obtenir une puissance (un courant) plus leve que celle dun module, il faut
brancher deux ou plusieurs modules en parallle. Dans le cas de la connexion de
deux modules en parallle, la borne positive (+) du premier module est connecte
la borne positive (+) du deuxime module. Les bornes ngatives (-) sont relies
entre elles.
33
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Schma 2-20
Association de modules en
parallle
La tension totale du branchement est gale la tension dun module :
Ut = Um1 = Um2
Le courant total est gal la somme des courants des deux modules :
It = Im1 + Im2
2.5.3 Montage des modules en srie parallle
Les modules peuvent tre aussi connects en srie et les sries connectes en
parallle.
Ut = Um1 + Um2
= Um3 + Um4
It = Im12 + Im34
Avec : Ut = tension totale
Um1 = tension module 1
Um2 = tension module 2
It = courant total
Im1 = courant module 1
Im2 = courant module 2
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
34
2. Conversion photovoltaique
Schma 2-21
Association de modules en
srie-parallle
Exemple :
a) Connecter en srie deux modules A75
Courant de court-circuit dun module A75 = 4,80 A
Tension de circuit ouvert dun module A75 = 21 V
UcoT = UcoM1 + UcoM2
UcoT = 21 V + 21 V = 42 V
IccT = IccM1 = IccM2 = 4,80 A
b) Connecter en parallle deux modules A75
UcoT = UcoM1 = UcoM2 = 21 V
IccT = IccM1 + IccM2
IccT = 4,80 A + 4,80A = 9,60 A
c) Connecter quatre modules A75 en srie de deux modules et les deux
sries en parallle.
UcoT = UcoM1,M2 = UcoM3,M4
UcoT = 21 V + 21 V = 42 V
IccT = IccM1,M2 + IccM3,M4
IccT = 4,8A + 4,8 A = 9,60 A
35
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
2.5.4 Montage des batteries en srie
Pour augmenter la tension des batteries, une ou plusieurs batteries doivent tre
montes en srie. Dans le cas de deux batteries, la borne positive (+) de la pre-
mire batterie est connecte avec la borne ngative (-) de la deuxime batterie.
Schma 2-22
Montage des batteries en
srie
La tension totale Ut est gale UB1 + UB2.
La capacit en Ah reste la mme : Ct = CB1 = CB2
Exemple :
Monter en srie deux batteries de 12 V de capacit 150 Ah.
Ut = UB1 + UB2
Ut = 12 V + 12 V = 24 V
Ct = CB1 = CB2
Ct = 150 Ah
2.5.5 Montage des batteries en parallle
Pour augmenter la capacit Ah de deux ou plusieurs batteries, on les monte en
parallle. Dans le cas de deux batteries, la borne positive (+) de la premire bat-
terie est connecte avec la borne positive (+) de la deuxime batterie. La borne
ngative (-) de la premire batterie est connecte avec la borne ngative (-) de la
deuxime batterie.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
36
2. Conversion photovoltaique
Schma 2-23
Montage des batteries en
parallle
La tension reste la mme : Ut = UB1 = UB2
La capacit totale devient : Ct = CB1 + CB2
Exemple :
Monter en parallle deux batteries de 12 V de capacit de 150 Ah.
Ut = UB1 = UB2
Ut = 12 V
Ct = CB1 + CB2
Ct = 150 Ah + 150 Ah = 300Ah
2.5.6 Montage des batteries en srie-parallle
Plusieurs batteries peuvent tre montes en srie parallle.
Dans le cas de 4 batteries montes en srie-parallle, la tension totale est la ten-
sion obtenue par la mise en srie des batteries ; la capacit totale est la capacit
des batteries en parallle.
37
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Schma 2-24
Montage des batteries en
srie-parallle
Exemple :
4 batteries 12 V de capacit de 150 Ah chacune.
Ut = UB1 + UB2
Ut = UB3 + UB4
Ut = 12 V + 12 V = 24 V
Ct = CB1,B2 + CB3,B4
Ct = 150 Ah + 150 Ah = 330Ah
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
38
2. Conversion photovoltaique
Principes respecter pour les groupements des batteries
a) Les batteries monter en srie doivent :
tre de mme type (fabrication),
avoir les mmes capacits (Ah),
avoir une densit dlectrolyte gale (tat de charge gal).
b) Les batteries monter en parallle doivent :
tre de mme type (fabrication),
avoir la mme tension nominale,
avoir une densit dlectrolyte gale (tat de charge gal).
les capacits nominales des batteries ne doivent pas tre trop
diffrentes
Eviter de monter plus de deux batteries en parallle
2.6 Londuleur
Londuleur est aliment directement par la batterie et dbite sur des rcepteurs
en courant alternatif. Londuleur transforme la tension continue des batteries en
tension alternative qui alimente les rcepteurs en courant alternatifs : tlviseurs,
vido ou rfrigrateur.
Les onduleurs diffrent par la forme donde du courant lectrique quils dlivrent
: carre, sinus reconstitu,, la forme sinusodale tant la norme habituelle de
llectricit fournie par le rseau lectrique.
Les onduleurs onde non sinus gnrent des harmoniques qui peuvent en-
dommager dans les cas extrmes certains appareils lectriques. Un convertisseur
DC / AC peut tre coupl soit au rgulateur soit directement la batterie, il doit
alors tre muni dun dispositif anti-dcharge profonde.
39
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Les caractristiques principales dun onduleur sont les suivantes :
Puissance nominale 20C en VA.
Tension nominale dentre en Vcc.
Plage de la tension dentre en V.
Protection tension dentre basse en V.
Puissance de dmarrage admissible en %
Intensit maximale admissible en A.
Tension nominale de sortie en Vca.
Plage de tension de sortie.
Onde de sortie
Frquence nominale de sortie en Hz.
Rendement maximal, gnralement de lordre de 90%.
Figure 2-25
Gnrateur autonome DC/AC
2.7 Quelques exemples dapplications photovoltaques
Figure 2-26
systmes en courant continu
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
40
2. Conversion photovoltaique
Figure 2-27
systme en courant alternatif
avec onduleur Central
Figure 2-28
confguration dun systme
photovoltaque autonome sur
toit (hors rseau)
41
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
2. Conversion photovoltaique
Figure 2-29
Systme de pompage
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
42
3. Procdure dinstalla ion des systemes
3. Procdure dinstallation des systemes
Linstallation complte des systmes devra tre ralise de faon soigne.
Lesthtique visuelle de toutes les installations doit tre respecte :
Verticalit des cbles et / ou des composants (prises, interrupteur, rgulateur,
rglettes, etc.) fxs aux murs.
Rgularit et alignement des points de fxation,
Remise en ltat des murs aprs perage.
3.1 Module photovoltaque
Choix de lemplacement du module
Le panneau solaire ne fonctionnera pas correctement sil nest pas totalement
clair par le soleil durant toute la journe. Il faut donc viter que le panneau
reoive lombre porte dun obstacle quelconque (btiment ou arbre).
Pour cela, et avant toute installation, il est important de :
a) Choisir un emplacement provisoire,
b) Reprer et identifer tous les obstacles risquant de porter une ombre
sur cet emplacement, surtout entre 8h (le matin) et 17h (laprs-midi),
c) Pour chaque obstacle identif :
Mesurer la distance L qui spare lobstacle de lemplacement choisi.
Estimer (mesurer si possible) sa hauteur H par rapport lemplacement
choisi.
Mesurer son azimut a relatif (angle que fait la direction de lobstacle avec la
direction du Sud partir de lemplacement.
43
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
3. Procdure dinstalla ion des systemes
A partir des paramtres ainsi dtermins, utiliser le monogramme (fgure..)
dans le sens de laiguille dune montre.
A partir de la distance de lobstacle L et de sa hauteur H en mtres,
dterminer sa hauteur h en degr.
En fonction de son azimut a, dterminer sa hauteur effective.
Puis en fonction de la latitude du site dinstallation, dterminer la distance
effective de lobstacle.
Si la distance effective est infrieure la distance limite Dm, lobstacle en
question nest pas gnant.
Si au contraire la distance effective est suprieure Dm (partie hachure),
lobstacle est gnant. Il faut changer demplacement et reprendre la procdure
dcrite.
Figure 3-1
Coordonnes dun obstacle
a : azimut de lobstacle (degr)
H : hauteur de lobstacle (degr)
Si parmi tous les emplacements envisageables aucun nest prserv de lombre de
certains arbres, on peut envisager de tailler ces arbres, voire den couper un. Les
arbres qui portent ombrage au panneau seulement tt le matin (avant 8 heures)
ou tard laprs-midi (aprs 16 heures) ne sont pas gnants et ne doivent pas tre
coups.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
44
3. Procdure dinstalla ion des systemes
Figure 3-2
Monogramme de dfnition
des ombres portes
Source : lemoine-Folgelman
45
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
3. Procdure dinstalla ion des systemes
Orientation et inclinaison du module et Orientation du module.
Lorientation du module est la direction vers laquelle il est situ. Elle doit tre en
plein Sud pour les sites de lhmisphre Nord et en plein Nord pour les sites de
lhmisphre Sud.
Linclinaison (ou la pente) est langle que fait le module avec lhorizontale. Elle doit
tre gale la latitude du site 5 prs.
Au Sngal, les modules doivent tre orients
plein Sud avec une inclinaison de 15
Linclinaison du module peut tre dtermine :
A laide dune boussole.
A laide dune boussole, un gabarit et un niveau.
A laide dun inclinomtre (instrument de mesure dune pente).
Avant linstallation du panneau
Vrifer que les diodes by-pass et anti-retour sont bien installes. Si elles ne sont
pas installes, vrifer quelles se trouvent sur la face intrieure du couvercle de
la bote de jonction. Si elles y sont, les installer en suivant le schma, soit sur la
notice dutilisation, soit sur la face interne du couvercle de la bote de jonction.
Fixation des modules PV
En cas de montage sur toiture, une distance minimale de 0,1m doit tre respec-
te entre la face arrire du module et la toiture. La structure support du module
doit tre fxe sur le corps de charpente ou du btiment, et non sur la toiture
elle-mme. Un systme de haubanage doit tre prvu si ncessaire.
En cas de fxation murale, le support de modules doit tre fx au minimum en
2 points avec un systme de fxation traversant le mur (goujons et platine de
serrage).
En cas de structure au sol, le support doit tre install dans un lieu lcart des
zones de passage ; le(s) module(s) et le cblage doivent tre placs hors de
porte des enfants.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
46
3. Procdure dinstalla ion des systemes
Les pieds de la structure support doivent tre boulonns ou scells dans des
ancrages en bton couls dans le sol. Les dimensions minimales de ces plots
en bton arm seront de 300 mm x 300 mm x 300 mm. Une dalle unique en
bton arm de section 250mm x 250 mm chans sur sa longueur est une autre
option pouvant tre envisage.
Quel que soit le cas, le bton devra tre dos au moins 350 Kg. La hauteur du
gnrateur par rapport au sol devra tre rgle de sorte que le point le plus bas
soit au moins 3 m du niveau du sol. Les cbles seront fxs la structure au
moyen de brides en plastique livres cet effet.
Branchement du panneau
Les bornes + et - de la bote de jonction doivent tre relies aux bornes + et - du
rgulateur de charge avec un cble rsistant aux rayonnements ultraviolets 1 x 4
mm, pour une distance module-batterie nexcdant pas 5 mtres.
Option en faade
Schma 3-3
Options dinstallation
envisageables
Option au sol
47
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
3. Procdure dinstalla ion des systemes
3.2 Installation du rgulateur de charge
Le rgulateur doit tre install hauteur des yeux, soit peu prs 1,50 m du
sol afn que lutilisateur puisse bien voir les indications lumineuses (exemple :
batterie dcharge)..
Le rgulateur de charge doit tre install le plus prs possible de la batterie et
du panneau afn dviter des pertes inutiles (voir tableau de chute de tension).
Il doit tre protg du rayonnement direct du soleil et, bien entendu, de la pluie.
La polarit doit tre respecte lors du branchement des diffrentes compo-
santes.
Les diffrentes composantes seront branches aux bornes du rgulateur dans
lordre suivant :
1) Batterie
2) Module
3) Utilisation (charge)
Les diffrentes composantes doivent tre dbranches dans lordre suivant :
1) Utilisation (charge)
2) Module
3) Batterie
Aprs la connexion, vrifer les indicateurs de rgulateur de charges afn
didentifer les anomalies possibles dans le fonctionnement.
Si aucune indication ne confrme le fonctionnement du Rgulateur de
charge , vrifer que les connexions ont t bien ralises : inversion de
polarit probable.
Les connexions sur le rgulateur se feront au moyen de tourillons fourchette.
3.3 Installation de la batterie
Les batteries seront places dans un local ar en dehors des locaux o des per-
sonnes sont susceptibles de sjourner (bureaux, chambres coucher, etc.) labri
des enfants. La batterie sera installe sur un support ( en bois si possible enduit
dune protection contre lagression de lacide)
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
48
3. Procdure dinstalla ion des systemes
La batterie sera installe assez proche du rgulateur de charge.
La batterie sera connecte au rgulateur de charge avec un cble de section
adquate.
Les cosses des batteries seront protges par des capots les protgeant contre
toutes manipulations trangres.
Une charge pralable sera ralise conformment la procdure de la fche en
annexe 5 avant la mise en service des batteries.
Laration du local devra tre telle que les ouvertures du local assurent une
ventilation naturelle prsente une superfcie gale :
A : surface des ouvertures en cm
Q : volume dair en m3/h
Pour la batterie de 75 Ah installer, Q doit tre gal 15 m3/h
La surface des ouvertures du local doit tre 420 cm
3.4 Installations intrieures (cblage)
Schma 3-4
Cblage intrieur du btiment
Les cbles seront poss apparents le long des murs ou des structures des char-
pentes de toiture.
Les cbles seront fxs au mur au moyen dattaches adquates. On disposera 3
fxations par mtre. La connexion dans les botes de drivation se fera au moyen
de bornes.
49
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
3. Procdure dinstalla ion des systemes
Les fxations murales de cbles seront disposes intervalles gaux denviron 35
cm.
Les parcours de cbles sur les murs devront tre parfaitement horizontaux ou
verticaux.
Aux endroits de changement de direction, le rayon de courbure dun cble ne sera
pas infrieur 6 fois son diamtre extrieur.
Les spcifcations ci-aprs seront rigoureusement respectes :
La distance entre la bote de drivation et la lampe sera de 3 mtres.
La distance entre le botier de linterrupteur et les appareils lectriques (interrup-
teur ou prise de courant) sera de 1,5 m.
La distance entre un interrupteur, une prise, une bote de connexion, un rgu-
lateur et la plus proche attache de chacun des cbles qui y parvient sera gale
5 cm.
Toutes les connexions se feront par lintermdiaire de barrettes de connexions
incluses dans les appareils. Aucun domino ne devra tre apparent.
Les connections ou drivations par pissures sont interdites.
Toutes les connections devront tre lintrieur des botes de connexion ou
lintrieur des appareils lectriques.
Lentre du cble dans un appareil lectrique devra donc toujours se faire par
un presse-toupe dont les dimensions seront adaptes aux sections des cbles
qui passent.
Le cblage de tout lment situ lextrieur dun btiment : interrupteur, prise,
lampe, devra se faire en goutte deau. Lentre du cble devra se faire par la
partie horizontale infrieure.
Pour faciliter les oprations de dpannage, les couleurs des fls seront homo-
gnes dans toutes les installations avec un code de couleur standard pour le
positif et le ngatif.
Interrupteurs
On respectera, la rgle un interrupteur par point lumineux. Pour les portes
double battant, linterrupteur sera plac gauche en entrant, 20 cm de la porte
une fois rabattue contre le mur.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
50
3. Procdure dinstalla ion des systemes
Luminaires
Lorsque les rglettes seront fxes en position murale, et sauf spcifcations
contraires, leur milieu dans laxe vertical devra tre plac 1,80 m du sol. Ainsi, et
de faon gnrale, sauf indications contraires, toutes les rglettes non installes
dans un mme btiment devront tre fxes la mme hauteur par rapport au sol.
Boites de drivation
Pour alimenter, partir dune ligne principale, un nouvel quipement, il faut crer
une ligne secondaire en drivation. Pour le raccordement, on utilise une boite de
drivation.
Le principe de drivation est simple, sur chaque borne il arrive 1 fl et il en repart 2
(celui de la ligne principale et celui de la drivation).
Plusieurs lignes peuvent partir dune mme boite de drivation, condition que la
ligne principale ait une section suffsante.
Linstallation des boites de drivation respectera le principe du schma ci-aprs.
Lordre de connexion des boites doit tre scrupuleusement respect.
Les boites seront solidement fxes aux murs. Elles seront places suffsamment
haut, si possible environ 2,7 m du sol pour tre hors de porte des enfants.
Schma 3-5
Boites de drivation
Chutes de tension dans le systme
Les chutes de tension admissibles dans les diffrents tronons du systme ainsi
que les distances maximales correspondantes sont prsentes dans le tableau
ci-aprs :
51
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
3. Procdure dinstalla ion des systemes
Tableau 3-1
Chutes de tension admis-
sibles dans le systme
TRONON % V V
S
(MM2)
DISTANCE
MAXIMALE
Maximale
1. Panneau- Rgulateur 1,50% 0,18 4 4,68 m
2. Rgulateur-Batterie 1,00% 0,12 4 4 m
3. Rgulateur- Drivation n 3 3,00% 0,36 4 17,14 m
4. Bote drivation lampe
et mcanisme
1,00% 0,12 1,5 5 m
La longueur maximale ne pas dpasser pour une section donne peut
aussi tre vrife partir de la formule suivante :
Lmax <= U x S / 2x x I
U = chute de tension (voir tableau ci-dessus)
S = section cble = 4 mm
= rsistivit cble = 0,01786 pour le cuivre
I = Intensit de courant en Ampres
Installation onduleur : au cas o un onduleur est install on respectera les
prescriptions ci-aprs
Londuleur doit tre install dans un lieu sec et protg du rayonnement direct
du soleil des sources de chaleur et dhumidit.
Londuleur doit tre install dans un lieu assez ar.
Londuleur doit tre install une distance minimale de la batterie afn dviter
des chutes de tension excessives.
Londuleur doit tre si possible install dans un local diffrent du local des bat-
teries car le dgagement gazeux provenant des batteries peut avoir des effets
explosifs de corrosion.
Londuleur doit tre install en position verticale et fx au mur avec les dispo-
sitifs prvus cet effet.
Les cbles de raccordement doivent tre fxs au mur laide dattaches ad-
quats ou dembases colliers Colson adaptes.
Les cbles + et doivent tre clairement marqus.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
52
4. Mise en uvre des quipements
4. Mise en uvre des quipements
Les principes dassurance qualit permettent par la mise en uvre systmatique
daction planife de vrifcation de validation et conservation de traces, de matri-
ser la qualit de linstallation des systmes.
La mise en uvre des dispositifs dassurance qualit permet aux installateurs de
faire la preuve des prcautions prises pour assurer la qualit de leurs prestations
et de garantir une traabilit des actions menes au cours de linstallation des
systmes.
Les documents indispensables la mise en uvre du plan qualit au cours de
linstallation sont disponibles en annexe, ils sont lists ci-aprs :
Consigne de la charge pralable des batteries
Fiche dinstallation
Certifcat de rception quantitative individuel (pour les systmes individuels)
Certifcat de rception quantitative
La batterie est la composante dont la mise en service ncessite un soin parti-
culier. Nous dcrivons ci-dessous les diffrentes tapes de cette mise en
service.
4.1 Prparation de la batterie
Mesurer la densit de llectrolyte de remplissage.
Remplir les batteries jusquau niveau correspondant la partie infrieure du
marquage de niveau.
Attendre aprs remplissage au moins deux heures.
Ajuster si ncessaire llectrolyte son niveau nominal.
Aprs deux heures de repos :
Mesurer la tension de la batterie.
Mesurer la densit de llectrolyte.
Mesurer la temprature.
Si aprs un repos de deux heures les mesures montrent que :
53
4. Mise en uvre des quipements
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
La temprature de llectrolyte naugmente pas de plus de 5 C par rapport
la temprature initiale.
Ou que la densit de llectrolyte na pas diminu de plus de 0,02kg/l par rap-
port sa valeur initiale.
La charge pralable peut commencer.
Si la temprature de llectrolyte au cours du remplissage est suprieure
40 C, laisser reposer la batterie pendant au moins 12 heures ou reporter la
charge pralable au lendemain.
4.2 Droulement de la charge pralable
La source chargeante ( champ photovoltaque ou Groupe lectrogne) ne sera
pas quipe de dispositif de contrle de la charge (ceci afn dviter un arrt pr-
coce de la charge pralable).
Si la charge est ralise avec un module ( champ photovoltaque) , il sera connec-
t directement la batterie sans rgulateur de charge.
La batterie sera charge :
Dans une premire phase si possible courant constant jusquau gassing (la
dure du gassing sera dau moins 3 heures).
Aprs cette phase, le courant sera rduit une valeur correspondant la capa-
cit de la batterie .
Au cas o la procdure ci-dessus dcrite ne peut tre respecte, charger la
batterie pendant au moins 15 heures.
Mesurer par pas de 30 mn aprs lapparition du gassing, la tension, la densit
de llectrolyte.
La batterie sera considre comme compltement charge :
Lorsque, les valeurs de densit contenues dans le tableau 4-1 sont atteintes et
ne varient plus pendant 2 heures.
Lorsque la tension de la batterie de 12 V atteint 15,90 V et ne varie plus pendant
2 heures.
Dans tous les cas lorsque la temprature dpasse 45 C, la charge doit
tre arrte.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
54
4. Mise en uvre des quipements
Les grandeurs mesures seront consignes dans la fche en annexe. Lcart entre
les grandeurs mesures ne devra pas excder 0.005 V par lment pour la tension
et 0.01 kg/l pour la densit.
A la fn de la charge, le niveau dlectrolyte doit tre ajust au maximum dans
chaque lment.
Tableau 4-1
Valeurs de densit de llectrolyte avant
remplissage et aprs la charge pralable
DENSIT LECTROLYTE DE
REMPLISSAGE 20C[KG/L]
DENSIT FINALE 20 C [KG/L]
1,245 1,250 1,255
1,240 11,250 1,250
1,230 1,235 1,240
Les densits lues seront corriges par rapport la temprature comme dans
le tableau ci-aprs :
Les valeurs 20C sont les valeurs de rfrence
Tableau 4-2
Correction de la densit en
fonction de la temprature
Densit 20C[kg/l] Densit 25C [kg/l] Densit 35C [kg/l] Densit 45C [kg/l]
1,144 1,142 1,138 1,131
1,164 1,162 1,157 1,149
1,183 1,180 1176 1,168
1,203 1,200 1,194 1,168
1,213 1,210 1,204 1,187
1,223 1,220 1,214 1,197
1,233 1,230 1,224 1,216
1,240 1,237 1,231 1,223
1,244 1,241 1,234 1,226
1,250 1,247 1,240 1,232
1,255 1,252 1,245 1,236
1,266 1,263 1,256 1,247
55
4. Mise en uvre des quipements
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
La correction de la densit en fonction de la temprature peut aussi tre obtenue
laide de la formule suivante :
D20C = dT1 + 0,0007 . T
Avec : D20C : densit 20C
DT1 = densit mesure la temprature T1
T = T1 20C
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
56
5. Entretien et maintenance
5. Entretien et maintenance
Deux types dentretien seront raliss dans le cadre de lexploitation des quipe-
ments installs :
Lentretien trimestriel
Lentretien trimestriel seffectue tous les trois mois et a pour but de vrifer le bon
fonctionnement des quipements et de prendre des mesures pouvant assurer
leur bon fonctionnement. Cet entretien consiste principalement des actions de
contrle visuels et des mesures lgres.
Lentretien annuel
Lentretien annuel consiste en un entretien plus approfondi. Il couvre les actions
menes au cours des entretiens trimestriels mais aussi des actions de mesures
approfondies permettant dapprcier de faon plus prcise ltat de fonctionne-
ment des quipements
5.1 Entretien Trimestriel
Champ photovoltaque
Lentretien du champ consiste principalement en la vrifcation visuelle du champ:
Contrle visuel
Contrle de vue de la propret des modules : nettoyage frquent des mo-
dules renouveler les consignes au responsable du systme : nettoyage
des modules tt le matin ou tard le soir
57
5. Entretien et maintenance
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Faire le nettoyage le soir ou tt le matin quand les panneaux ne sont
pas exposs un fort ensoleillement.
Si les panneaux sont installs sur le toit, il faut une chelle pour y
accder.
On utilisera un chiffon doux et propre : mais pas deau.
On essuiera doucement la surface des panneaux en partant du haut
vers le bas.
On sassurera quil ny a plus de trace de poussire.
On vitera de marcher sur les panneaux ou de sy appuyer.
Contrles des fxations des modules : vrifcation de la visserie antivol en cas
de corrosion ou dinfraction : resserrer si possible et les enduire ci ncessaire
de dgrippant.
Contrle des botiers de jonction : prsence deau, ou dinsectes : vrifer
ltanchit des botiers si ncessaire resserrer les presse-toupe ou les rem-
placer.
Contrle de prsence dombre porte sur les modules : pour cela confr-
mer les risques laide de labaque de la fgure
Batterie
Contrle visuel de la propret du local des batteries
Contrles visuels des batteries:
- Des diffrences de couleurs
- De dpts de sdiments dans les cuves des lments,
- Vrifer les connexions des lments
- Fissures des lments.
- Les fuites dlectrolytes
Fuites dlectrolyte : avec un chiffon, nettoyer les dpts dlectrolyte sur les
bacs des lments. Pour ce faire, utiliser uniquement de leau propre exempte
de tout additif.
Les fuites dlectrolyte peuvent causer des dfaillances massives de bat-
terie lorsque le courant sortant dun lment passe dans llectrolyte dun
autre. La formation de dpts de matriaux conducteurs peut galement
causer des arcs lectriques et des explosions dlments.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
58
5. Entretien et maintenance
PRECAUTION : ne pas utiliser une grande quantit deau proximit des
cellules durant leur nettoyage, car leau est un conducteur
CORROSION DES BORNES ET DES CONNEXIONS: une des principales causes
de la mauvaise performance des batteries est la corrosion des bornes et des
connexions. La corrosion des connexions peut tre suivie de la dfaillance des
bornes ou dune rupture dlments.
En cas de corrosion des connexions, effectuer les oprations suivantes :
Isoler compltement la batterie de tous les branchements : branchement
au champ, branchement londuleur (rgulateur de charge).
Isoler llment ou les lments concerns (selon les prescriptions du
constructeur).
Nettoyer la connexion ou la borne corrode laide dune brosse mtal-
lique.
Appliquer une mince couche de graisse anti-corrosion haute temprature.
Raccorder llment et serrer les connexions (selon les prescriptions du
fabricant).
Rebrancher la batterie dans le circuit raccordement au rgulateur de charge
et londuleur.
CONTROLE DU NIVEAU DELECTROLYTE : Contrler le niveau dlectrolyte
dans chacun des lments. Si le niveau de llectrolyte dans un lment nest
pas au bon niveau, ajouter de leau distille jusquau niveau haut du marquage de
niveau
Comment ajouter leau distille ?
A laide dun quipement propre (entonnoir), ajouter lentement de leau dis-
tille dans llment jusquau niveau haut du marquage.
Enregistrer le numro de llment ainsi que la quantit deau ajoute.
59
5. Entretien et maintenance
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Comment conserver leau distille?
La conservation deau doit se faire dans des rcipients adquats.
Des rcipients adquats sont en verre, bonite, polythylne, po-
lypropylne, PVC ou autres matires plastiques. Les tubes doivent
tre composs de PVC, gomme ou polythylne.
Les rcipients mtalliques peuvent provoquer la dissolution dions
mtalliques et sont par consquent viter.
Les rcipients en verre peuvent provoquer la dissolution dalcalins
et de lacide silicique. Ceux-ci ne sont pas nuisibles et se trouvent
dans les rsidus dvaporation. Il est recommand de toujours gar-
der leau purife dans des rcipients tanche lair.
Vrifer la densit de llectrolyte
La densit de llectrolyte dun accumulateur au plomb donne une bonne ide de
son tat de charge. Ainsi pour apprcier lvolution de ltat de charge des batte-
ries, on effectuera des mesures trimestrielles prcises de la densit des batteries.
Procdure de mesure de la densit dlectrolyte :
Arrter le systme afn dviter une dcharge.
Dbrancher les modules.
Laisser reposer les batteries pendant une deux heures.
Mesurer la densit de chaque lment.
Mesurer simultanment la temprature de llectrolyte de chaque lment.
Mesurer la tension de chaque lment.
Inscrire les rsultats dans la fche en annexe.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
60
5. Entretien et maintenance
Mesure de la densit de lelectrolyte
1
Introduire le densi-
mtre dans llec-
trolyte dun lment.
Presser la poire et as-
pirer assez dlectro-
lyte pour que lindex
otte librement.
2
Noter la densit lue
au moyen du otteur
et de lchelle gra-
due.
3
Remettre llectrolyte
dans llment o on
la prleve en faisant
attention de ne pas en
verser hors de la bat-
terie.
Rpter la mme opration pour chaque lment et inscrire les rsultats sur la
fche disponible en annexe (ANNEXE 1)
Entretien du rgulateur de charge
Le rgulateur de charge est un quipement qui ncessite peu dentretien. On ef-
fectuera trimestriellement les oprations suivantes:
Vrifcation de la propret du rgulateur de charge.
61
5. Entretien et maintenance
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Vrifcation de laration du rgulateur de charge.
Vrifcation des connexions aux bornes du rgulateur.
Observation du bon fonctionnement des diffrents indicateurs du rgulateur de
charge.
Entretien de londuleur
Comme le rgulateur de charge londuleur ncessite peu dentretien. Les opra-
tions de vrifcations suivantes se feront trimestriellement :
Vrifcation de la propret de londuleur : prsence de poussire, prsence
dinsectes.
Vrifcation de laration de londuleur.
Inspection des cbles lectriques
Des cbles lectriques relient :
- Les modules au rgulateur de charge.
- Les batteries au rgulateur de charge.
- Les batteries londuleur.
- Londuleur aux rcepteurs.
On inspectera ces cbles chaque visite dentretien pour tre sr quils sont en
bon tat
Contrle des connexions aux bornes des batteries.
Suivre le cble de bout en bout chercher les dtriorations suivantes : coupure,
isolant us ou mang dnudant lme des conducteurs. Tout cble endommag
doit tre remplac.
Si on constate que les cbles sont rongs par des animaux, envisager de les
protger par un fourreau.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
62
5. Entretien et maintenance
5.2 Entretien annuel
Champ photovoltaque
Contrle visuel
Contrle de vue de la propret des modules : nettoyage frquent des modules
renouveler les consignes au responsable du centre : nettoyage des modules
tt le matin ou tard le soir .
Contrle de prsence dombre porte sur les modules : pour cela confrmer les
risques laide de labaque de la fgure .
Contrles des fxations des modules : vrifcation de la visserie antivol en cas
de corrosion ou dinfraction : resserrer si possible et les enduire si ncessaire
de dgrippant.
Contrle des botiers de jonction : prsence deau, ou dinsectes : vrifer ltan-
chit des botier, si ncessaire resserrer les presse-toupe ou les remplacer.
Inspection des dfauts sur les modules suivant la fche en annexe
Contrle des performances lectriques
Mesurer la tension de circuit ouvert du champ photovoltaque.
Mesurer le courant de court-circuit du champ photovoltaque.
Mesurer le courant de charge des batteries.
Mesurer la tension de charge des batteries.
Procdures suivre :
Mesure de la tension de circuit ouvert :
63
5. Entretien et maintenance
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
On fera la mesure vers midi un jour ensoleill
La tension de circuit ouvert est celle qui rgne entre les deux
bornes de sortie lorsque le panneau (module) ne dbite pas, on
devra donc dbrancher les panneaux (modules).
Aprs avoir dbranch les panneaux, on excute la mesure au ni-
veau des bornes de sortie correspondante.
Les mesures effectues, on refait le branchement.
Pour effectuer la mesure de la tension de circuit ouvert on utilisera
un multimtre ou un voltmtre en courant continu. Mettre le multi-
mtre sur mesure de tension continue (DC).
Slectionner la plage de mesure pour quelle contienne la tension
laquelle on sattend. Par exemple pour les modules des systmes
de tension vide de 22,1 V on choisit la plage 0 - 30 V.
On enfche les fches de lappareil dans les prises convenables et
vrifer que la fche ngative (noire ou-) est bien dans la prise n-
gative (ou commune ) et que la fche positive (rouge ou +) est
bien dans la prise positive.
Vrifer que le multimtre est sur marche et quil est muni de
piles charges.
Mettre en contact les pointes des fches avec les bornes entre les-
quelles on veut mesurer la tension. Bien veiller ne pas mettre ces
bornes en court-circuit en les touchant ensemble avec la mme
sonde, car on crera un courant important qui peut endommager
les composants.
Lire la valeur affche et inscrire cette valeur sur la fche en annexe.
Mettre lappareil sur Arrt aprs la mesure pour ne pas vider
la pile.
Noter la temprature des modules : la tension de circuit- ouvert
diminue quand la temprature augmente.
Comparer la valeur obtenue la valeur de la fche technique des
modules.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
64
5. Entretien et maintenance
Mesure du courant de court-circuit :
Le courant de court-circuit est celui dbit au niveau des bornes de
sortie lorsque celles-ci sont relies par le multimtre.
On fera la mesure vers midi, un jour bien ensoleill et cours dune
longue priode densoleillement non fuctuante.
Pour faire la mesure on dbranche les modules du rgulateur de
charge.
Aprs avoir dbranch les modules on effectue la mesure au niveau
des bornes correspondantes.
La mesure effectue, on refait les branchements.
On utilise un multimtre ou un ampremtre pour mesurer le cou-
rant de court-circuit.
Mettre le multimtre sur mesure dintensit.
Slectionner la plage de mesure pour quelle contienne lintensit
laquelle on sattend.
ATTENTION : pour les systmes composs de 4 modules de cou-
rant de court-circuit de 5A branchs en parallle. Le courant total
peut atteindre 20 A.
Choisir dans ce cas la plage de 0- 20A.
Enfoncer les fches de lappareil dans les prises convenables et
vrifer que la fche ngative (noire ou -) est bien dans la prise
commune et que la prise positive (rouge ou +) est bien prise din-
tensit convenable.
Mettre en contact les pointes des fches avec les bornes + et du
panneau.
Lire la valeur affche par le multimtre et noter la valeur sur la fche
en annexe
65
5. Entretien et maintenance
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
Batteries
Les contrles et oprations suivantes dj dcrites pour lentretien trimestriel se-
ront raliss :
Vrifcation de fuites dlectrolyte et nettoyage des batteries.
PRECAUTION : ne pas utiliser une grande quantit deau proximit des
cellules durant leur nettoyage, car leau est un conducteur.
Vrifcation de la corrosion des bornes et connexions: En cas de corrosion des
connexions, effectuer les oprations dcrites pour les entretiens trimestriels cor-
respondantes.
Contrler le niveau dlectrolyte dans chacun des lments. Si le niveau de
llectrolyte dans un lment est bas, ajouter de leau distille jusquau niveau
haut du marquage de niveau.
Contrler la prsence ventuelle de fssures au niveau des bacs. Des fssures
peuvent apparatre sur les bacs des batteries au cours de leur fonctionnement.
Vrifer laration du local des batteries.
Outres ces oprations dj effectues trimestriellement, des mesures pr-
cises de densit et de la tension vide des lments seront effectues an-
nuellement.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
66
6. Recherche et rparation des pannes
6. Recherche et rparation des pannes
Avant de commencer la recherche dune panne on doit sassurer :
Quon dispose du schma global de linstallation.
Quon identife sur le schma assez clairement chacun des composants.
Quon dispose des fches dintervention permettant de consigner les interven-
tions effectues.
Recherche de la panne
Dans cette partie du manuel, on indique ce quil faut faire pour identifer les pannes
principales pouvant subvenir dans un systme et comment remdier ces pannes.
Note : pour des raisons de commodit, le processus de recherche de panne et de
dpannage est ici appliqu un systme (avec onduleur) et sur des lampadaires
solaires . Nanmoins les instructions donnes pour la rparation sont exprimes
dans un souci de gnralisation aux systmes les plus communs.
Il est important :
Dtre sr davoir correctement identif les symptmes du dfaut.
Davoir toujours commenc par la premire tape inscrite sous chaque symp-
tme et davoir continuer dans lordre vers chaque tape.
6.1 Symptmes de dysfonctionnements courants
SYMPTMES
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE
PANNE CORRESPONDANT
Aucun rcepteur nest aliment, londuleur
ne dbite pas .
Diagramme 1
Les rcepteurs fonctionnent le soir pendant 1
ou 2 heures et londuleur sarrte.
Diagramme 2
67
6. Recherche et rparation des pannes
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E Londuleur ne dbite pas mais lindicateur de
fonctionnement clignote.
Diagramme 3
Londuleur indique une baisse de tension
prmature.
Diagramme 4
Londuleur ne peut pas dmarrer ou sarrte
au bout de quelques minutes de fonctionne-
ment.
Diagramme 5
Londuleur indique une surtension. Diagramme 6
Le lampadaire ne sallume pas. Diagramme 7
Le lampadaire sallume quelques heures et
steint.
Diagramme 8
6.2 Diagrammes de recherche de pannes
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 1
Symptmes : aucun rcepteur nest aliment. (londuleur ne dbite pas)
CAUSES PROBABLES
N DE PROCDURE
SUIVRE
Alimentation coupe 1
Tension aux bornes de londuleur faible 2
Circuit batterie- onduleur interrompu 3
Batterie dcharge ou dfectueuse 6
Panneau solaire ne dbite pas 4
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 2
Symptmes : les rcepteurs fonctionnent le soir pendant une deux heures et
londuleur sarrte
CAUSES PROBABLES
N DE PROCDURE
SUIVRE
La charge a augment D1 5
Batterie profondment dcharge D2 6
Batterie dfectueuse D3 6
Module ne dbite pas correctement D4 4
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
68
6. Recherche et rparation des pannes
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 3
Symptmes : londuleur ne dbite pas mais lindicateur de fonctionnement cli-
gnote.
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Charge la sortie trop faible pour tre d-
tecte
7
Lalimentation de certaines charges inter-
rompue ou dfaillante
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 4
Symptmes : londuleur indique une baisse de tension prmature.
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Cble dentre onduleur trop long 8
Batterie pas assez charge ou dfectueuse 6
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 5
Symptmes : londuleur ne peut pas dmarrer ou sarrte au bout de quelques
minutes de fonctionnement.
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Charge trop importante 5
Chute de tension importante lentre de
londuleur
8
Batterie pas assez charge ou dfectueuse 6
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 6
Symptmes : londuleur indique une surtension.
69
6. Recherche et rparation des pannes
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Seuil de rgulation modif 9
Raccordement Batterie-Rgulateur (ondu-
leur) dfaillant
3
Rgulateur dfaillant 9
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 7
Symptme : Le lampadaire ne sallume pas.
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Le temps maximum programm est termin 10
Lnergie disponible est puise 11
La batterie ne se charge pas correctement 12
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 8
Symptmes : Le lampadaire sallume quelques heures et steint.
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Le temps maximum programm est termin 10
Lnergie disponible est puise 11
La batterie ne se charge pas correctement 12
DIAGRAMME DE RECHERCHE DE PANNE N 9
Symptmes : Le lampadaire ne sallume pas avant le lever du jour.
CAUSES PROBABLES N DE PROCDURE SUIVRE
Lnergie disponible est puise 11
La batterie ne se charge pas correctement 12
Le commutateur pour enclencher le sys-
tme nest pas activ
15
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
70
6. Recherche et rparation des pannes
6.3 Procdures dopration de dpannage
PROCEDURE DOPERATION N1 : Lalimentation est coupe
Symptme du dfaut :
Aucun rcepteur nest aliment, londuleur ne dbite pas
Comment confrmer cette panne ?
Londuleur est quip dun disjoncteur magntothermique son entre; londu-
leur nest pas aliment quand le disjoncteur est ouvert.
Rparation faire
Vrifer que le disjoncteur est ouvert.
Sil est ouvert, refermer.
Observer le comportement de londuleur.
PROCEDURE DOPERATION N2 : Tension aux bornes de londuleur faible
Symptme du dfaut :
Aucun rcepteur ne fonctionne, londuleur ne dbite pas
Comment confrmer cette panne ?
Dans certains cas ,les batteries sont directement connectes londuleur qui en
assure la protection contre les dcharges profondes. Quand la tension de la bat-
terie de 12 V est infrieure 11,4 V (tension de dconnexion de la charge Vmin)
londuleur coupe les rcepteurs. Vrifer si lindication de dcharge profonde est
active : Si oui, la batterie est dcharge et ceci explique larrt de londuleur. Si
non, vrifer la tension de la batterie 12 V. Si elle est suprieure 11,4 V, le seuil
de coupure de londuleur est peut tre drgl.
Comment rparer cette panne ?
Si la tension de la batterie est infrieure 11,4 V, cas normal de dlestage des r-
cepteurs, laisser recharger les batteries et suivre leur comportement. Si la tension
de la batterie est suprieure 11,4 V, vrifer le seuil de dlestage de londuleur. Si
un onduleur de rechange est disponible essayez-le. Si le dfaut se confrme faites
remplacer londuleur dfaillant.
71
6. Recherche et rparation des pannes
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
PROCEDURE DOPERATION N3 : Circuit batterie-onduleur interrompue,
Connexion batterie interrompue
Symptme du dfaut :
Aucun rcepteur ne fonctionne londuleur ne dbite pas
Comment confrmer ce dfaut ?
Les connexions des batteries peuvent tre endommages cause de la corro-
sion. Dans ce cas les batteries nalimentent plus londuleur qui affche une tension
basse et ne peut pas dbiter.
Comment rparer ce dfaut ?
Vrifer toutes les connexions des batteries ainsi que le circuit entre les batteries
et londuleur. Si une dconnection est identife, rparer la connexion et observer
le fonctionnement de londuleur.
PROCEDURE DOPERATION N4 : Les modules ne dbitent pas
Symptme du dfaut :
Aucun rcepteur ne fonctionne, londuleur ne dbite pas
Comment confrmer ce dfaut ?
Si les modules ne dbitent pas convenablement, les batteries ne seront pas char-
ges. Vrifer que les modules sont bien nettoys.Si oui, vrifer les connexions
des modules, vrifer les tensions de circuit ouvert et les courants de court-circuit.
Si la tension de circuit ouvert est faible, vrifer les diodes by-pass de chacun des
modules.
Comment rparer la panne ?
Si les modules sont sales, les nettoyer et suivre la charge des batteries.
Si les connexions sont dfaites, les rtablir. Si les tensions de circuit ouvert sont
faibles (environ la moiti de la tension totale par module) et que certaines diodes
by-pass sont dfectueuses, les changer, ou les enlever en vue dun futur rempla-
cement.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
72
6. Recherche et rparation des pannes
PROCEDURE DOPERATION N5 : La charge a augment : dautres rcep-
teurs que ceux prvus ont t branchs.
Symptme du dfaut :
Les rcepteurs fonctionnent une deux heures et sarrtent
Comment confrmer ce dfaut ?
Les charges prvues pour tre alimentes par les systmes communautaires sont
prdtermines. Si dautres charges sont branches sur le systme, il sarrtera
plus tt que prvu.
Comment rparer ce dfaut ?
Vrifer si dautres rcepteurs nont pas t branchs. Si dautres rcepteurs ont
t branchs, demander lusager de les dbrancher et suivre le comportement
du systme.
PROCEDURE DOPERATION N6 : Batteries souvent dcharges ou dfectueuses
Symptme du dfaut :
Les rcepteurs fonctionnent une deux heures et sarrtent
Comment confrmer ce dfaut ?
Dbrancher les batteries des modules et de londuleur et laisser reposer au moins
pendant une heure. Mesurer la densit de chaque lment, sa temprature et sa
tension. Vrifer ltat de charge de chaque lment en vrifant le lien entre la
densit et la tension de la batterie laide de la formule suivante :
U = d + 0,85
O : U tension de llment
D sa densit
Si U est infrieure 1,85 V (11,1V), les batteries sont dcharges profondment.
Comment rparer ce dfaut ?
Effectuer une charge dgalisation. A cet effet les rcepteurs doivent tre dcon-
nects pendant une priode qui permet une pleine charge des batteries. Aprs la
charge dgalisation, faites un test de dcharge sur la batterie le soir sans charge.
Il sagira de mesurer le comportement de la tension de la batterie avec des niveaux
de charge volutifs ( 1 lampes , 2 lampes etc). Si la tension diminue trop vite la
batterie est dfectueuse.
73
6. Recherche et rparation des pannes
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
PROCEDURE DOPERATION N7 : Charge la sortie trop faible pour tre
dtecte
Symptme du dfaut :
Londuleur ne dbite pas mais lindicateur de fonctionnement clignote
Comment confrmer ce dfaut ?
Si londuleur est dot dun dispositif de Stand-by en mode automatique, il
steint quand il ny a aucune charge. Il ne redmarre que quand il dtecte une
charge. Si la sensibilit prfxe ne permet pas de dtecter la charge alimente, il
ne dmarrera pas. Augmenter la charge et suivre le comportement de londuleur.
Comment rparer la panne ?
Si londuleur dmarre aprs laugmentation de la charge, diminuer progressive-
ment la charge afn de dtecter la charge minimale de dmarrage de londuleur. Si
cette charge minimale est frquente, modifer la sensibilit du seuil de dmarrage.
PROCEDURE DOPERATION N8 : Cble dentre onduleur trop long
Symptme du dfaut :
Londuleur indique une chute de tension prmature
Comment confrmer ce dfaut ?
Une chute de tension importante lentre de londuleur peut tre due au dimen-
sionnement de la section du cble dalimentation et de la distance entre la batte-
rie et londuleur. Vrifer la section du cble install. Vrifer la distance entre les
batteries et londuleur. Vrifer la chute de tension maximale admissible en tenant
compte du courant maximal :
- Soit laide de la formule : U = 2 . . I . L/S
Avec : U = chute de tension maximale
S = section cble actuelle
= rsistivit du cble (= 0,01786 pour le cuivre)
I = Intensit de courant en Ampres
L = Longueur actuelle du cble
- Soit laide de labaque de la fgure 5-1.
Si la chute de tension constate est suprieure 3 %, rapprocher les batteries de
londuleur. Si le rapprochement nest pas possible augmenter la section du cble.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
74
6. Recherche et rparation des pannes
Tableau 5-1
Abaque pour la dfnition des
chutes de tension
La chute de tension lentre de londuleur peut tre grande si la charge est trop
importante (donc le courant lentre lev) bien que le cble lentre ne soit
pas trop long.
Vrifer quune charge trop importante nempche pas le dmarrage de londu-
leur. Cette vrifcation se fera en mesurant ou en valuant le courant en fonction
de la charge et en utilisant labaque ci-dessus.
75
6. Recherche et rparation des pannes
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
PROCEDURE DOPERATION N9 : Rgulateur dfaillant
Symptme du dfaut :
Londuleur indique une surtension
Comment confrmer ce dfaut ?
Le rgulateur de charge assure la protection en surcharge de la batterie.Il arrte
la charge de la batterie quand la tension de celle-ci dpasse un seuil maximal. Si
la tension lentre de londuleur est suprieure la tension maximale de fn de
charge, le rgulateur est peut tre dfaillant. Mesurer la tension aux bornes des
batteries. Mesurer la tension aux bornes batterie du rgulateur de charge. Si
ces tensions sont suprieures la tension de fn de charge (fonction de la temp-
rature), le rgulateur ne rgule pas.
Comment rparer ce dfaut ?
Si lon dispose dun rgulateur de rechange, remplacer le rgulateur. Si ce rgula-
teur limite la tension, le rgulateur dorigine est dfectueux.
PROCEDURE DOPERATION N10 : Le temps maximum programm est
termin ou non slectionn
Symptme du dfaut :
Le lampadaire ne sallume pas
La dure dclairage la tombe de la nuit et au lever du jour est programme
sur le rgulateur. A lexpiration de la dure programme, la lampe steint.
Comment confrmer ce dfaut ?
La slection de la dure dclairage la tombe de la nuit est programme par le
slecteur A du panneau de contrle. La slection de la dure au lever du jour est
programme par le slecteur B. Vrifer si la dure dclairage est bien slection-
ne sur le panneau de contrle, position du slecteur diffrente de 0. Si la dure
prvue est bien conforme la dure prvue, le dfaut nest pas li la program-
mation de la dure.
Comment rparer ce dfaut ?
Si la dure programme nest pas conforme la dure prvue, reprogrammer la
dure prvue et observer le comportement du lampadaire.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
76
6. Recherche et rparation des pannes
PROCEDURE DOPERATION N11 : Lnergie disponible est puise
La dure de fonctionnement du lampadaire dpend de la quantit dnergie stoc-
ke par la batterie. Si la quantit dnergie disponible nest pas suffsante, les
rcepteurs ne seront plus aliments.
Comment confrmer ce dfaut ?
Quand lnergie stocke nest pas suffsante, la batterie sera profondment d-
charge aprs une utilisation pralable. Vrifer si la LED4 est teinte. Si elle est
teinte, la batterie est dcharge et la sortie de la consommation est dsactive.
Mesurer la tension de la batterie : si elle infrieure 11,50 V la batterie est profon-
dment dcharge.
Comment rparer ce dfaut ?
Si la batterie est dcharge et que la sortie de la consommation est dsactive,
laisser recharger la batterie un deux jours et observer le comportement du lam-
padaire.
PROCEDURE DOPERATION N12 : La batterie ne se charge pas correcte-
ment
Symptme du dfaut :
Le lampadaire ne sallume pas
Si la batterie est souvent dcharge, elle nest peut tre pas correctement char-
ge.
Comment confrmer ce dfaut ?
Si le module ne charge pas la batterie, il est peut tre sale ou dconnect du r-
gulateur. Vrifer que la LED5 est allume : si elle est allume le module charge
la batterie. Vrifer que le panneau est bien nettoy. Vrifer les connexions entre
le module et la batterie il est probable quun problme de fxation dconnecte mo-
mentanment le module de la batterie.
Comment rparer ce dfaut ?
Si la LED5 nest pas allume, vrifer la connexion entre le module et la batterie.
Si la LED5 est allume, vrifer que le module est bien propre. Sil nest pas propre,
le nettoyer et mesurer le courant de charge en fonction de lensoleillement, Enfn
vrifer les connexions entre le module et la batterie. Les resserrer si ncessaire.
77
6. Recherche et rparation des pannes
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
PROCEDURE DOPERATION N13 : Linterrupteur crpusculaire est d-
faillant
Symptme du dfaut :
Le lampadaire ne sallume pas
Linterrupteur crpusculaire permet denclencher lallumage du lampadaire la
tombe de la nuit. Ainsi, le lampadaire ne sallumera pas si linterrupteur crpus-
culaire est dfaillant.
Comment confrmer ce dfaut ?
Recouvrir la cellule de linterrupteur pour simuler lobscurit. Si le lampadaire sal-
lume, linterrupteur nest pas dfaillant. Si la lampe ne sallume pas, vrifer le
dispositif lectronique damorage de linterrupteur.
Comment rparer ce dfaut ?
Si linterrupteur crpusculaire est dfaillant, le remplacer.
PROCEDURE DOPERATION N14 : Le rcepteur est dfaillant
Symptme du dfaut :
Le lampadaire ne sallume pas
Comment confrmer ce dfaut ?
Dmonter la lampe fuorescente et la vrifer. Si une lampe de rechange est dispo-
nible, la remplacer et observer le fonctionnement du lampadaire. Si le lampadaire
ne fonctionne pas, la lampe nest peut tre pas dfaillante.
Comment rparer ce dfaut ?
Si la lampe fuorescente est dfaillante, la remplacer et observer le fonctionnement
du lampadaire.
L
e
m
a
n
u
e
l
d
u
T
E
C
H
N
I
C
I
E
N
P
H
O
T
O
V
O
L
T
A
I
Q
U
E
78
6. Recherche et rparation des pannes
PROCEDURE DOPERATION N15 : Le Rgulateur-temporisateur ou le dis-
positif de commutation est dfaillant
Symptme du dfaut :
Le lampadaire ne sallume pas
Le rgulateur gre la charge et la dcharge de la batterie, contrle le fonctionne-
ment de linterrupteur crpusculaire. Le dispositif de commutation gre les dures
de fonctionnement.
Comment confrmer ce dfaut ?
Si aucune des recherches prcdentes na t concluante, ces dispositifs sont
peut tre dfaillants.
Comment rparer ce dfaut ?
Remplacer le dispositif de commutation et observer le comportement du lam-
padaire. Si le lampadaire ne fonctionne toujours pas, remplacer le rgulateur et
observer le comportement du lampadaire.
79
80
81
82
83
84
85
86
Vous aimerez peut-être aussi
- Energie Solaire Photovoltaïque - Anne Labouret PDFDocument155 pagesEnergie Solaire Photovoltaïque - Anne Labouret PDFNathan James75% (4)
- QualiPV 2 Gisement SolaireDocument20 pagesQualiPV 2 Gisement Solairejfmagan-1Pas encore d'évaluation
- Exemple de Projet PVsystDocument71 pagesExemple de Projet PVsystRania Jalyl100% (2)
- Dimensionnement Et Etude D'une Installation Photovoltaïque Pour Une Habitation DomestiqueDocument97 pagesDimensionnement Et Etude D'une Installation Photovoltaïque Pour Une Habitation Domestiquethamer belgacem100% (1)
- Maintenance Installation PhotovoltaïqueDocument8 pagesMaintenance Installation PhotovoltaïqueArsène Millogo50% (2)
- Cours Photovoltaïque PDFDocument102 pagesCours Photovoltaïque PDFDocteur-Naim Hocine95% (37)
- Les Installations Photovoltaïques: Louis-Paul Hayoun & Aurian ArrigoniDocument25 pagesLes Installations Photovoltaïques: Louis-Paul Hayoun & Aurian ArrigoniEl Mime MohamedPas encore d'évaluation
- Systèmes PV Raccordés Au RéseauDocument91 pagesSystèmes PV Raccordés Au RéseauHAMDI100% (2)
- Dimentionnement de L'installation PV CorrigéDocument29 pagesDimentionnement de L'installation PV CorrigéPanneau solaire100% (1)
- OnduleurDocument17 pagesOnduleurGrine Salah Eddine100% (1)
- 3 PaireDiff Final 2015Document29 pages3 PaireDiff Final 2015Mohamed El OuahdaniPas encore d'évaluation
- Photovoltaïque | pas à pas: Le guide pratique pour débutants pour la conception d'une installation PVD'EverandPhotovoltaïque | pas à pas: Le guide pratique pour débutants pour la conception d'une installation PVPas encore d'évaluation
- L'énergie solaire: Survit facilement grâce à l'énergie solaire hors réseauD'EverandL'énergie solaire: Survit facilement grâce à l'énergie solaire hors réseauPas encore d'évaluation
- L'électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IID'EverandL'électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IIÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La révolution technologique qui va bientôt nous surprendreD'EverandLa révolution technologique qui va bientôt nous surprendrePas encore d'évaluation
- L'Électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IVD'EverandL'Électricité - Découvreurs et Inventeurs: Tome IVÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- Cours Photovoltaique 2009-2010Document78 pagesCours Photovoltaique 2009-2010DG BORISPas encore d'évaluation
- Installations Photovoltaïques AutonomesDocument171 pagesInstallations Photovoltaïques AutonomesBookard100% (14)
- Dimensionnement Dune Installation Photovoltaique AutonomeDocument12 pagesDimensionnement Dune Installation Photovoltaique AutonomeMehdi Bahassi100% (6)
- Cours PhotovoltaiqueDocument11 pagesCours PhotovoltaiqueBasile Ks100% (4)
- Système Photovoltaïque Connecté Au RéseauDocument18 pagesSystème Photovoltaïque Connecté Au Réseaudalila AMMAR0% (1)
- Cata PhotovoltaiqueDocument24 pagesCata PhotovoltaiqueBessem Younes0% (1)
- Formation PhotovoltaiqueDocument128 pagesFormation PhotovoltaiqueHadrich Med Amin100% (1)
- Installation Photovoltaique Pour La BébliothéqueDocument126 pagesInstallation Photovoltaique Pour La Bébliothéquezeroo85Pas encore d'évaluation
- Photo Voltai QueDocument42 pagesPhoto Voltai QueBessem Younes100% (4)
- Ue Dimensionnement Des Systemes Photovoltaiques 2 PDFDocument87 pagesUe Dimensionnement Des Systemes Photovoltaiques 2 PDFBoniface MENDOU100% (1)
- Installation Photovoltaique Autonome EE2 3Document11 pagesInstallation Photovoltaique Autonome EE2 3Mustapha El Metoui100% (2)
- Rapport Stage Conception Et Dimensionnement Photovoltaique Dorothee Micheau 2010Document67 pagesRapport Stage Conception Et Dimensionnement Photovoltaique Dorothee Micheau 2010Dramanuss198483% (6)
- Cours Installation Solaire PhotovoltaiqueDocument66 pagesCours Installation Solaire PhotovoltaiqueOussama KhouribachePas encore d'évaluation
- QualiPV 1 Marche Du PVDocument24 pagesQualiPV 1 Marche Du PVjfmagan-1100% (1)
- Polycope CoursDocument62 pagesPolycope CoursHichem HamdiPas encore d'évaluation
- Photovoltaique Raccorde ReseauDocument64 pagesPhotovoltaique Raccorde ReseauAdelCh100% (1)
- Dimensionnement SolaireDocument73 pagesDimensionnement SolaireN.NASRI Matlablog100% (25)
- Cours 2 Dimensionnement Site IsoléDocument21 pagesCours 2 Dimensionnement Site IsoléAchraf HamdiPas encore d'évaluation
- Calculer Le Nombre de Batteries Pour Une Installation Solaire PhotovoltaïqueDocument6 pagesCalculer Le Nombre de Batteries Pour Une Installation Solaire PhotovoltaïqueDjehad Bnf100% (2)
- QualiPV 3 Cellules Modules Systeme PVDocument40 pagesQualiPV 3 Cellules Modules Systeme PVjfmagan-1100% (1)
- Guide Installation Des Systemes PhotovoltaiquesDocument128 pagesGuide Installation Des Systemes PhotovoltaiquesClovis BounouPas encore d'évaluation
- Pompage SolaireDocument48 pagesPompage SolaireMonssif Najim100% (2)
- Les Installations Photovoltaïques Raccordées Au Réseau PDFDocument29 pagesLes Installations Photovoltaïques Raccordées Au Réseau PDFYoucefChaabnaPas encore d'évaluation
- TP Energie RenouvelableDocument57 pagesTP Energie Renouvelablewalid100% (1)
- Energie Photovoltaique Chap1Document44 pagesEnergie Photovoltaique Chap1younes ghenamPas encore d'évaluation
- Présentation PhotovoltaiqueDocument14 pagesPrésentation PhotovoltaiqueOmarNsirPas encore d'évaluation
- PV Exercices Installation Solaire PhotovoltaiqueDocument12 pagesPV Exercices Installation Solaire Photovoltaiquebadreddine100% (1)
- Exemple de Dimensionnement Pour Le Choix Des Onduleurs PVDocument9 pagesExemple de Dimensionnement Pour Le Choix Des Onduleurs PVJad ElaroPas encore d'évaluation
- Exposé Sur Le Dimensionnement D'un Système Solaire PhotovoltaïqueDocument19 pagesExposé Sur Le Dimensionnement D'un Système Solaire PhotovoltaïqueAmadou DiawaraPas encore d'évaluation
- Effet PhotoVoltaiQue - Energie SolaireDocument14 pagesEffet PhotoVoltaiQue - Energie SolaireMokr AchourPas encore d'évaluation
- Guide de Pompage SolaireDocument17 pagesGuide de Pompage SolaireAbdou Elmokhtary67% (3)
- Methodes de Detection Des Dysfonctionnements Électriques Sur Installations PhotovoltaiquesDocument76 pagesMethodes de Detection Des Dysfonctionnements Électriques Sur Installations Photovoltaiqueseric_leysens9093Pas encore d'évaluation
- Centrale Photovoltaique AutonomeDocument106 pagesCentrale Photovoltaique AutonomeBassoma Ibtissam100% (1)
- Électrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsD'EverandÉlectrotechnique | Pas à Pas: Bases, composants & circuits expliqués pour les débutantsÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Énergie Solaire Concentrée: Utilisation de miroirs ou de lentilles pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteurD'EverandÉnergie Solaire Concentrée: Utilisation de miroirs ou de lentilles pour concentrer la lumière du soleil sur un récepteurPas encore d'évaluation
- Projet Sur OnduleurDocument60 pagesProjet Sur Onduleurtanweer100% (1)
- Guide System e Energie ElectriqueDocument143 pagesGuide System e Energie ElectriqueSikafouè Premier100% (2)
- Support Cours Accu OkDocument184 pagesSupport Cours Accu OkDjouweinannodji Yves100% (1)
- 1 EEP - GM 2020 - Chap1&2 PDFDocument30 pages1 EEP - GM 2020 - Chap1&2 PDFO ZPas encore d'évaluation
- OnduleurquattroDocument10 pagesOnduleurquattroAPLOGANPas encore d'évaluation
- Pompage - Photovoltaique Et Suiveur SolaireDocument38 pagesPompage - Photovoltaique Et Suiveur SolaireSoungari KAMBOUPas encore d'évaluation
- Chap - 5 - Deux - Siecles - Energie - Electrique - Version - Courte - CORRECTIONDocument4 pagesChap - 5 - Deux - Siecles - Energie - Electrique - Version - Courte - CORRECTIONHoda AMENZOUPas encore d'évaluation
- Transformateur de Puissance - WikipédiaDocument110 pagesTransformateur de Puissance - WikipédiaNassirou TchaniPas encore d'évaluation
- Annuaire Telephonique Gss 2018Document4 pagesAnnuaire Telephonique Gss 2018بلال حسينيPas encore d'évaluation
- THOR GRIP C2S2 - Fiche TechniqueDocument3 pagesTHOR GRIP C2S2 - Fiche Techniquerroma_1983Pas encore d'évaluation
- Votre Site PHP Presque Complet Architecture MVC Et Bonnes PratiquesDocument54 pagesVotre Site PHP Presque Complet Architecture MVC Et Bonnes PratiquesMeHdi LaPas encore d'évaluation
- 199 Modele CV LuxembourgDocument2 pages199 Modele CV Luxembourgadegbegilles68Pas encore d'évaluation
- Hatz 1B20 1B30 1B40 1B50 70252943 FRDocument8 pagesHatz 1B20 1B30 1B40 1B50 70252943 FRFranck MonnierPas encore d'évaluation
- FR Mitsubichi FR-D700Document4 pagesFR Mitsubichi FR-D700Mohamed SomaiPas encore d'évaluation
- Fiche Technique - HighBay-ACCESS 3Document2 pagesFiche Technique - HighBay-ACCESS 3dugue.p100% (1)
- PDF CoursDocument8 pagesPDF CoursAhmed MohamedPas encore d'évaluation
- CM-133.17-24Les Propriétés Acoutiques Des BétonsDocument8 pagesCM-133.17-24Les Propriétés Acoutiques Des BétonsBeddek AmirouchePas encore d'évaluation
- SLCI ResumeDocument8 pagesSLCI ResumeKarim Fathi100% (1)
- Sigmatic 201 Manuel FrancaisDocument126 pagesSigmatic 201 Manuel FrancaisMohamed Amine TaytayPas encore d'évaluation
- KiddyGuard-800 Owner Manual US CADocument16 pagesKiddyGuard-800 Owner Manual US CALascal Ltd.Pas encore d'évaluation
- (French) Centre Gustave Eiffel - Licence Pro Projeteur Projeteuse BIM - Avril 2021 (DownSub - Com)Document4 pages(French) Centre Gustave Eiffel - Licence Pro Projeteur Projeteuse BIM - Avril 2021 (DownSub - Com)Aissa 2TECPas encore d'évaluation
- c3d Content France Doc French 2015Document162 pagesc3d Content France Doc French 2015Gérard Claude EssomePas encore d'évaluation
- Arduino AvancéeDocument36 pagesArduino AvancéeImed ElMottakelPas encore d'évaluation
- TP3 Version 4Document4 pagesTP3 Version 4Virginie BoussaudPas encore d'évaluation
- Instructions 6809Document2 pagesInstructions 6809Antonio SabaPas encore d'évaluation
- A JustementDocument6 pagesA Justementكورة عالمية- Kora newsPas encore d'évaluation
- FT Ecobati Foamglass t4 FRDocument2 pagesFT Ecobati Foamglass t4 FRsoprano361Pas encore d'évaluation
- Methode GranDocument29 pagesMethode GranASMAA KherrazPas encore d'évaluation
- TP 3 MDFDocument5 pagesTP 3 MDFNesrine NesrinePas encore d'évaluation
- Produit 3541788 Sans PrixDocument2 pagesProduit 3541788 Sans PrixsipoksinaPas encore d'évaluation
- Ibbsrapfra 20 Aan 22Document125 pagesIbbsrapfra 20 Aan 22Ferdaousse LrhomariPas encore d'évaluation
- Calcul Assemblage Poutre À Treillis Sur PoteauDocument20 pagesCalcul Assemblage Poutre À Treillis Sur Poteaudouera16100% (2)
- RLIDocument332 pagesRLIbetbet00Pas encore d'évaluation
- Portes Fen Menui 2014Document32 pagesPortes Fen Menui 2014Unes JrdPas encore d'évaluation
- TP3mod13 G7Act1Document5 pagesTP3mod13 G7Act1Achref MmaPas encore d'évaluation
- Nekeb Helmi Sidaoui Med Ali: Projet: Etude de Fondation ProfondeDocument9 pagesNekeb Helmi Sidaoui Med Ali: Projet: Etude de Fondation ProfondeSidaoui Med AliPas encore d'évaluation
- Parois MouleesDocument6 pagesParois MouleesRachad BouarourouPas encore d'évaluation














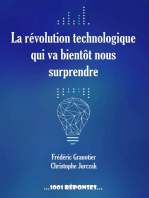














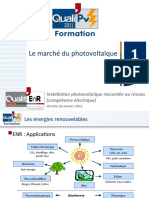




















![Technologies Émergentes En Électronique [French]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/series/590453133/149x198/c3f0e87400/1718261313?v=1)