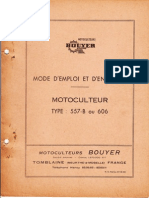Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
L'orphisme Et Ses Écritures. Nouvelles Recherches: Présentation
L'orphisme Et Ses Écritures. Nouvelles Recherches: Présentation
Transféré par
Tiffany BrooksTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
L'orphisme Et Ses Écritures. Nouvelles Recherches: Présentation
L'orphisme Et Ses Écritures. Nouvelles Recherches: Présentation
Transféré par
Tiffany BrooksDroits d'auteur :
Formats disponibles
Claude Calame
Philippe Borgeaud
Andr Hurst
Lorphisme et ses critures. Nouvelles recherches : Prsentation
In: Revue de l'histoire des religions, tome 219 n4, 2002. L'orphisme et ses critures. Nouvelles recherches. pp.
379-383.
Citer ce document / Cite this document :
Calame Claude, Borgeaud Philippe, Hurst Andr. Lorphisme et ses critures. Nouvelles recherches : Prsentation. In: Revue
de l'histoire des religions, tome 219 n4, 2002. L'orphisme et ses critures. Nouvelles recherches. pp. 379-383.
doi : 10.3406/rhr.2002.5203
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhr_0035-1423_2002_num_219_4_5203
,1
PHILIPPE BORGEAUD;
Universit de Genve :
CLAUDE CALAME
Universit de Lausanne
ANDR HURST
Universit de Genve
L'orphisme et ses critures.
Nouvelles recherches
Prsentation
Orphe, pour, toute une tradition qui remonte en particulier Diodore de Sicile, apparat comme un initiateur gnraliste, un adepte du
comparatisme en ce qui concerne les cultes mystre. L'historien sici
lien le situait au cur d'un dispositif reliant entre elles les sagesses bar
bares,
dans leurs rapports aux sagesses grecques. Issu de Thrace, il le
montrait passant par l'Egypte avant de se rendre Thbes en Botie,
emportant dans ses bagages la thologie d'un Osiris trs * proche du ;
Dionysos des Discours sacrs en 24 Rhapsodies.
Ses pouvoirs de . magicien et de ; musicien :- font du >- thologien
Orphe, du point de vue mythique, celui qui est capable d'tablir des
relations avec les dieux et l'au-del tout , en assurant, : chez les, brutes,
qui Tcoutent ici-bas, la concorde sociale ; Orphe cependant, le nonviolent, l'ascte . un peu chaman, quoiqu'il faille bien sr se mfier, de
cette catgorie ' difficilement importable en Grce,' reste lui-mme sur
les ^ marges de ; la- socit dont il favorise le bon fonctionnement. Il ?
demeure part . Cette position marginale d'anti-hros explique en
partie le statut" particulier dont a- pu (jouir, jusque .* dans :* le christia
nisme,cette figure issue d'une pense alternative. En partie, car. ce qui
joue aussi, c'est une srie d'assonances providentielles et de malenten
dus
productifs : les hymnes attribus Orphe semblent faire cho auxRevue de l'histoire des religions. 219 - 4/2002. p. 379 383
380
PHILIPPE BORGEAUD, CLAUDE CALAME, ANDR HURST
psaumes de David ; lai nature charme et apaise par. le, musicien;
thrace voque le motif du paradis terrestre d'Adam, et peut-tre celui
de l'arche de No. Le thologien des mystres enfin, le sage barbare
pre de Muse, devient dans interpretatio judaica puis christiana,, un
disciple de Mose le lgislateur, autre barbare, tout aussi prestigieux1.
Chez les pres de l'glise, de l'Orphe classique des Hellnes on;
aura trs bonne mmoire, mme si cette mmoire; c'est bien normal,
tend tre slective. On rappellera surtout la musique de ce barbare,
sa thologie, son rle de fondateur des < mystres. L'Orphe chrtien p
demeure musicien, thologien* et initiateur... Cela ^ alors mme qu'ont
oublie, bien sr, les textes dont il est cens tre l'auteur. Ces textes, ce
sont au contraire les rsistants au christianisme, les noplatoniciens de
l'cole d'Athnes, qui s'efforcent d'en maintenir la mmoire.
La transmission jusqu' nous des doctrines attribues Orphe,
son enseignement, passe par le dossier clat et trs austre des Orphica, ,
savoir quelques monolithes tranges (cosmogonie des. Oiseaux chez
Aristophane, pome des Argonautiques, Hymnes orphiques) et de trs
nombreux fragments textuels attestant l'incessante rcriture de cosmog
onies complexes, fragments dcouvrir trs souvent, prcisment, chez
les philosophes noplatoniciens. Ce sont quelques pices de ce dossier
de base, ainsi qu'un tmoin original de la rception chrtienne du mythe
d'Orphe, qui font ici l'objet d'un nouvel examen.
Pendant longtemps et rcemment encore, le rapport qu'Orphe et
les abstinents qui s'en rclament entretiennent avec le sacrifice et le
meurtre, et indirectement, parce biais, avec l'institution de la cit, a
suscit d'admirables tudes, notamment en Italie et en France2. On sait
que certaines questions, devenues traditionnelles, sur l'orphisme ancien
ont connu rcemment des dveloppements remarquables. La connais
sance
de ce courant marginal certes, mais trs influent dans i toute l'histoire de ; la pense occidentale, a t nourrie notamment par - la
rflexion qu'a suscite la publication, toujours partielle en1 grec (1982),
mais :. devenue intgrale dans , une remarquable , traduction ; anglaise
1. Cf. J. B. Friedman, Orphe au Moyen /ge,- Paris-Fribourg, 1999, avec
l'appendice de J.-M. Roessli, De l'Orphe juif l'Orphe cossais : bilan et pers
pectives 2.' D:
, Sabbatucci,
p. 285-345: Saggio sul misticismo greco, Rome, 1965 (trad, franc, de
J.-P. Darmon, Essai sur le mysticisme grec, Paris, 1982) ; M. Dtienne, Les che
mins, de la dviance: orphisme, dionysisme et pythagorisme , dans Orfismo in
Magna Grecia. Atti del quattordicesimo convegno > di studi sulla Magna Grecia
( Tarante, 1974), NapohV 1975; p. 49-79 ; cf. id., Dionysos mis mort, Paris, 1977, .
p. 163-207; cl L'criture d'Orphe, Paris,. 1989; p.: 101- 132.
L/ORPHISME ET. SES CRITURES. NOUVELLES RECHERCHES
381
(1997),. d'un fameux papyrus ; trouv en 1 962 Dervni non loin >. de
Thessalonique. Ce . texte * miracul, dcouvert . dans : les restes : d'un .
bcher funraire, date du * IVe sicle ; avant - notre re:. Il s'agit : du plus ancien : papyrus grec. Il donne le commentaire allgorique de : textes
orphiques remontant au Ve, sinon au VIe sicle. Il en dcoule que toute
l'histoire de la tradition orphique tait rcrire. Cela a t entrepris
dans des - recherches savantes et; fcondes, notamment de Walter Burkert et de Martin. West. Sur l'ensemble des dossiers * orphiques, la;
recherche progresse trs vite3. Claude Calame, dans son introduction
ce volume, dresse de manire incisive l'tat des lieux actuel,' . tout en :
mettant en garde contre les ; risques ; inhrents : une ' analyse ; souvent >
trop marque par les prsupposs culturels ou \ religieux modernes. Il
propose aussi deux pistes de recherche, l'une sur la figure d'Orphe,
l'autre sur ; les : manifestations *. littraires : de , l'orphisme, montrant f
l'importance de l'clairage que pourrait donner une tude attentive ;
la potique des textes orphiques.
Il } reste .'. encore ; refaire : le r corpus de ces textes, . c'est--dire '
reprendre : l'entreprise : jadis ; ralise par Otto i Kern, . celle . de runir;
l'ensemble des fragments ; orphiques4. Un eminent philologue; auquel -.
on doit dj une . dition des fragments : de ; la posie pique, Alberto
Bernab, s'en est charg. L'dition qu'il va bientt publier est attendue
avec impatience par tous ceux et celles que cette question passionne.
L'tude qu'il prsente ici est construite partir d'une reconstitution de
l'volution du systme : cosmogonique orphique * dans son ensemble.
Elle concerne l'anthropologie orphique et en particulier le mythe de la
cration de l'homme, tel qu'on le trouve attest chez le noplatonicien.
Olympiodore. Alberto Bernab montre comment cette version tardive-
3. Cf. entre autres travaux rcents : W. Burkert, Da Omero ai Magi. La tradizione orientale nella culture greca, Venezia, 1999,' p. 59-86 ; Tra Orfeo e Pitagora:
Origini e Incontri di Culture nell'Antichit. Atti dei Semini Napoletani 1996-1998,
a cura di M. Tortorelli Ghidini, A. Storchi Marino e A^-Visconti, Naples, 2000,
p. 1 1-282.' . Voir la < mise au < point et * les ; rfrences donnes par C. Calame,
Orphik, Orphische Dichtung , dans Der Neue Pauly : Enzyclopadie der Antike,
IX, Stuttgart-Weimar, 2000,' col. 58-69. Et aussi R. Sorel, Orphe et l'Orphisme,
Paris, 1994, ainsi que les tudes de Luc Brisson cites, infra; n: 4.
4. Cf. O. Kern, Orphicorum fragmenta, Berlin, 1922 ; une traduction franaise
partielle se trouve dans Orphe, Pomes magiques et cosmologiques, postface de
L. Brisson, Paris, 1993. Le recueil d'Otto Kern doit tre complt, en particulier,
par le papyrus de Dervni : cf. A. Laks et G. W. Most (d.), Studies on the Derveni Papyrus, Oxford, 1997. Trs commodes, en franais, diverses tudes de Luc
Brisson ont t runies en un volume : Orphe et l'orphisme dans l'Antiquit grcoromaine, Aldershot, 1995.
382
PHILIPPE BORGEAUD, CLAUDE CALAME, ANDR HURST
ment < explicite - s'inscrit de manire ; parfaitement cohrente dans ^ une
tradition dj trs ancienne: II fait mme allusion dans son tude un
mythe msopotamien dont le rapport la version orphique avait fait
nagure l'objet d'une valuation critique de la^part de Jean Bottro5.
Grand : praticien \ des espaces o se croisent ; le ; mythe et; la * philo
sophie;
Luc Brisson reprend ; le dossier, de Cronos chez : Proclus; . pour
dboucher, lui > aussi sur, l'examen du ; rcit '. anthropogonique orphique,
dont il ', prsente une interprtation i diffrente . de celle ; d'Alberto Bernab:. Il 1 analyse : cette ' question ? . la ' lumire , d'une : reconstitution , du
pome thogonique connu sous le titre de Discours sacrs en 24 rhap
sodies,
reconstitution : qui ne peut ; se : faire qu'en tenant compte, , trs ;
prcisment; du contexte dnonciation noplatonicien.
Aucun domaine : n'a. suscit autant de nouvelles dcouvertes et:
rflexions que celui des lamelles d'or dont certains osent aujourd'hui .
nouveau affirmer, aprs combien d'hsitations, qu'elles sont bel et bien:
le, reflet d'une doctrine et; d'une pratique1 rituelle non; seulement
bachique, mais aussi (et simultanment) orphique. Christoph'Riedweg,.
dont : on ' dcouvrira . ici ; une tude ; programmatique," reprend actuell
ement
l'ensemble de ce dossier?. Dans la contribution qu'il nous offre,- il
s'efforce de reconstruire, sur, la base des textes conservs sur ces feuil
lesd'or, la* structure du rituel dont elles sont solidaires..
Autre domaine," autre corpus,- les Hymnes orphiques ont t souvent
ngligs ou mme mpriss. Sous l'impulsion de Jean Rudhardt7, on en a .
cependant redcouvert l'intrt thologique et le caractre authentiquement orphique. Ces textes ont fait tout rcemment l'objet de la splendide
dition critique, avec une traduction italienne et un trs riche commenta
ire,
de Gabriella Ricciardelli; qui avait gnreusement prsent le fruit
de ses recherches lors du sminaire qui est l'origine du prsent recueil8.
5. L'anthropogonie msopotamienne et l'lment divin en l'homme, dans
Ph. Borgeaud (d.), Orphisme et Orphe en l'honneur de Jean Rudhardt, Genve,
1991; p. 211-225.
6. Cf. Initiation-Tod-Unterwelt : Beobachtungen zur Kommunikationssituation * und narrativen Technik f der orphisch-backhischen . Goldblttchen , dans
F. Graf (d.), Ansichten griechischer Ritule. Geburtstags-Symposiumftr Walter Burkert: Castelen bei Basel 15. bis 18. Marz 1996, Stuttgart-Leipzig, 1998, p. 359-398.
7. J. Rudhardt, Quelques : rflexions < sun les Hymnes Orphiques , dans
Ph. Borgeaud (d.), Orphisme et Orphe, en l'honneur de Jean Rudhardt, Genve,
1991, p. 263-289.
8. Inni Orfici, a cura di G. Ricciardelli, Fondazione Lorenzo Valla; Milano,
2000. Une bonne et utile traduction franaise tait parue quelques annes aupara
vant
: La prire.: Les Hymnes d'Orphe, traduits et prsents par. P. Charvet (pr
face de P. Veyne), Paris, 1995.
L/ORPHISME ET SES CRITURES. NOUVELLES RECHERCHES
383
Anne- France Morand; prsente elle aussi, dans cette mme rencontre,
vient de publier une importante tude sur ces hymnes9. Dans la contribu
tion
trs originale qu'il propose ici, Jean Rudhardt nous introduit une
forme de pit particulire qui s'exprime notamment, dans les Hymnes,
par la reprsentation s des diffrentes naissances de Dionysos. . JeanMichel Roessli aborde enfin un dossier concernant la rception du mythe
d'Orphe, comparant les positions de deux penseurs ecclsiastiques, Cl
ment d'Alexandrie et Eusbe de Csare qui interprtent, chacun sa;
manire, le chant d'Orphe dans son rapport au Verbe chrtien;
Les tudes regroupes dans ce numro thmatique de la Revue de
l'histoire des religions ont t rdiges dans le prolongement d'un smi
naire postgrade et doctoral en sciences de l'Antiquit qui s'est tenu en
mars 2000 Chteau-d'x dans les Alpes vaudoises, sous la direction
des trois signataires de cette prsentation et sous l'gide de la Comm
ission
, romande des 3e cycles de Lettres. . Ces tudes trouvent , donc
leur, origine dans les contributions qui furent prsentes cette occa
sion, parmi d'autres, par quelques-uns des meilleurs spcialistes actuels
de la question. Le lecteur y trouvera une information mise jour sur
les perspectives qui s'ouvrent- aujourd'hui ceux qu'intresse la ques
tion orphique dans l'Antiquit;
Philippe. Borgeaud@lettres.unige.ch,
Claude.Calame^iasa.unil.ch :
Andre.Hurst(a4ettres.unige.ch
9. A.-F. Morand, tudes sur les Hymnes orphiques, Leiden-Boston-Kln, 2001
(Religions in the Graeco-Roman World, vol. 143).
Vous aimerez peut-être aussi
- Aide Mémoire de ProbabilitésDocument8 pagesAide Mémoire de ProbabilitésHanina mamiPas encore d'évaluation
- MP Guide L'Univers Plus SVT 1AC-1Document74 pagesMP Guide L'Univers Plus SVT 1AC-1MustaphaFoulfoule67% (3)
- Tableau Codes Défauts - Moteur DV6CDocument13 pagesTableau Codes Défauts - Moteur DV6CemanuelliPas encore d'évaluation
- Exo KanbanDocument3 pagesExo KanbanJabir ArifPas encore d'évaluation
- FrigorifiqueDocument15 pagesFrigorifiqueAnonymous jmFTK5TPas encore d'évaluation
- Dionysos Chez Homere Ou La Folie DivineDocument23 pagesDionysos Chez Homere Ou La Folie Divinemegasthenis1Pas encore d'évaluation
- SINEUX Amphiaraos-Guerrier-Devin-Et-Guerisseur PDFDocument4 pagesSINEUX Amphiaraos-Guerrier-Devin-Et-Guerisseur PDFmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Apollon Le Scorpion Et Le Frene A ClarosDocument29 pagesApollon Le Scorpion Et Le Frene A Clarosmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- CABANES Institution Des Monarchies Au IV SiecleDocument29 pagesCABANES Institution Des Monarchies Au IV Sieclemegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Le Mythe de Jason Et MedeeDocument3 pagesLe Mythe de Jason Et Medeemegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Le Bouclier D Achille Et La Poesie de L IliadeDocument49 pagesLe Bouclier D Achille Et La Poesie de L Iliademegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Bouvier Le Sceptre Et La LyreDocument3 pagesBouvier Le Sceptre Et La Lyremegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Jan N Bremmer, Greek Religion and Culture The BibleDocument3 pagesJan N Bremmer, Greek Religion and Culture The Biblemegasthenis1Pas encore d'évaluation
- The Wedding in Ancient AthensDocument5 pagesThe Wedding in Ancient Athensmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Les Dieux Dansent Chez ProclusDocument8 pagesLes Dieux Dansent Chez Proclusmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Le Dionysos OraculaireDocument14 pagesLe Dionysos Oraculairemegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Artemis Orthia Et La Flagellation Des Ephebes SpartiatesDocument13 pagesArtemis Orthia Et La Flagellation Des Ephebes Spartiatesmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Laffineur (Ed) ThanatosDocument5 pagesLaffineur (Ed) Thanatosmegasthenis1Pas encore d'évaluation
- Support Physico Chimie Des SolutionsDocument159 pagesSupport Physico Chimie Des SolutionsWiem GaraiPas encore d'évaluation
- Pocan B3235000000Document4 pagesPocan B3235000000OumaimaPas encore d'évaluation
- La Balançoire TexteDocument1 pageLa Balançoire Texteyouness10100Pas encore d'évaluation
- 77 PDFDocument92 pages77 PDFÃh ŁämPas encore d'évaluation
- DS Fonctions DeriveesDocument1 pageDS Fonctions DeriveesKarim NdahoqPas encore d'évaluation
- Challenge 2 G1Document21 pagesChallenge 2 G1juvetbeni.ibovy02Pas encore d'évaluation
- 2eme Annee Chap 2 Les Series NumériquesDocument11 pages2eme Annee Chap 2 Les Series Numériquessoutien104Pas encore d'évaluation
- Calcul Du Basculement Avec La Force MotriceDocument10 pagesCalcul Du Basculement Avec La Force MotriceLiebherrPas encore d'évaluation
- BFC MUT COG Tome2 V3.7 PDFDocument104 pagesBFC MUT COG Tome2 V3.7 PDFHassan AboulkacemPas encore d'évaluation
- 1ac Test DiaDocument2 pages1ac Test DiaSennahPas encore d'évaluation
- ChisinauDocument4 pagesChisinauDoina PlatonPas encore d'évaluation
- Vocabulaire Amazigh de La Terre Et de La MerDocument1 pageVocabulaire Amazigh de La Terre Et de La MerD.MessaoudiPas encore d'évaluation
- Coloscopie VirtuelleDocument79 pagesColoscopie VirtuelleLola ValentinPas encore d'évaluation
- Aiguille Magnum PDFDocument1 pageAiguille Magnum PDFChinigami MhPas encore d'évaluation
- Introduction Réseau Topologies - Protocoles Architectures en Couches (Modèles OSI, IEEE, TCP - IP) PDFDocument184 pagesIntroduction Réseau Topologies - Protocoles Architectures en Couches (Modèles OSI, IEEE, TCP - IP) PDFGreg Morris100% (1)
- CCNP VoIP Bande Passante Par CommDocument9 pagesCCNP VoIP Bande Passante Par Commmacao100Pas encore d'évaluation
- NjipoolDocument5 pagesNjipoolmnawarPas encore d'évaluation
- Cours Thermo - Equilibre Entre PhasesDocument17 pagesCours Thermo - Equilibre Entre PhasesDoua BensalemPas encore d'évaluation
- Synthèse Du Dualisme 1956 - Jacques DUCHESNE-GUILLEMINDocument9 pagesSynthèse Du Dualisme 1956 - Jacques DUCHESNE-GUILLEMINhelabzPas encore d'évaluation
- Voici LalchimieDocument13 pagesVoici LalchimieA JPas encore d'évaluation
- Exposé Terre Armée Groupe 12Document14 pagesExposé Terre Armée Groupe 12Alassane DABOPas encore d'évaluation
- TD-Physique Tle D N°8Document2 pagesTD-Physique Tle D N°8GANDEMAPas encore d'évaluation
- Manuel Transmetteur Txblock Usb 4 20ma v10x M FRDocument5 pagesManuel Transmetteur Txblock Usb 4 20ma v10x M FRPEKOZPas encore d'évaluation
- Bouyer 557B Et 606Document11 pagesBouyer 557B Et 606Laurent Enfield TricassesPas encore d'évaluation
- Physique 1 CNC MP 2009 ÉnoncéDocument12 pagesPhysique 1 CNC MP 2009 Énoncéelhaffarisoumia123Pas encore d'évaluation