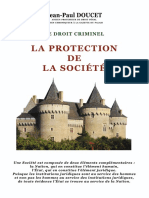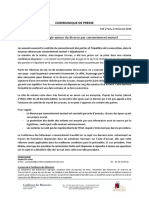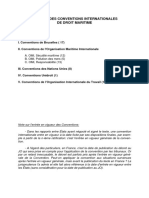Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Révolution Française
Révolution Française
Transféré par
Arnaud RomaricTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Révolution Française
Révolution Française
Transféré par
Arnaud RomaricDroits d'auteur :
Formats disponibles
6.
La Rvolution franaise
Les mots en gras sont dfinis dans le glossaire.
Crise de lAncien Rgime
La Rvolution franaise trouve son origine dans les conflits entre les classes sociales et dans la crise conomique qui marque la fin du XVIIIe sicle en France. La crise sociale est provoque par lopposition grandissante contre laristocratie, dtentrice de privilges. Deux classes se dressent contre laristocratie : une bourgeoisie enrichie mais qui arrive difficilement se faire valoir, et une paysannerie qui supporte mal laccroissement des droits fodaux. Le tiers tat reprsente 25,5 millions de personnes en France la fin du XVIIIe sicle. La noblesse et le clerg, qui comptent respectivement 400 000 et 115 000 membres, y sont donc minoritaires. Pourtant, ces deux groupes sociaux dtiennent la majeure partie des privilges et des richesses du pays. Du reste, chacune de ces classes est elle-mme profondment divise. Dans laristocratie, la noblesse dpe, cest--dire de trs ancienne ligne, mprise la noblesse de robe, une classe anoblie par dcret royal. Il existe aussi une noblesse de province, qui est compose de petits seigneurs souvent appauvris et des parlementaires des villes. La noblesse de province accuse laristocratie de cour daccaparer les avantages et les finances publiques. Il y a galement des divisions au sein de lglise. Le haut clerg (archevques, vques) soppose au bas clerg (congrganistes, curs, vicaires, religieux), dont les membres sont issus du tiers tat, souvent misrable. Le tiers tat est quant lui constitu dune immense majorit de paysans, mais aussi dartisans et de bourgeois. Ainsi, la fin du XVIIIe sicle, la longue dpression qui frappe lconomie franaise et le pitre tat des finances du Royaume attisent les tensions. Au XVIIIe sicle, la bourgeoisie franaise tente de moderniser lconomie. Mais la noblesse freine ses ardeurs en refusant tout changement. Certes, il nest pas encore question dabolir lAncien Rgime. Cependant, le souffle libral des Lumires attise les espoirs de transformations des structures du Royaume. On soppose notamment labsolutisme royal. Les ides librales des philosophes des Lumires et leur concrtisation par la Rvolution amricaine alimentent fortement cette contestation. La faiblesse du souverain permet dailleurs ces antagonismes sociaux de se concrtiser sous la forme dides politiques.
La dmocratie dans lhistoire
Page 31 de 51
Texte de Gaston Lavergne publi sur le site Internet de lEsplanade www.esplanade.org/democratie
Louis XVI manque effectivement dautorit. Ses ministres sont favorables une plus juste rpartition des impts. Malgr tout, face la banqueroute des finances publiques, Louis XVI nose pas adopter les rformes claires quils lui proposent. De leur ct, le Parlement et les assembles de notables repoussent toute remise en cause de lexemption fiscale des privilgis. Appuys par le peuple, les parlementaires sont lorigine de rvoltes souvent violentes. Pour tenter de mettre un terme au mcontentement, le roi convoque, le 8 aot 1788, les tats gnraux pour le 1er mai 1789. Les tats gnraux souvrent plutt le 5 mai 1789, pour dmanteler plus tard, en quelques semaines, lAncien Rgime. Les dputs du tiers tat forment alors des demandes, quils inscrivent dans des cahiers de dolances . Ils rclament de profondes rformes du systme, dont une constitution qui limite les pouvoirs du roi et qui dfinit ceux du peuple. Ils veulent galement labolition des privilges de la noblesse et du clerg. Le roi refuse toutes leurs demandes. Le 17 juin 1789, les dputs du tiers tat se proclament donc Assemble nationale. Le 9 juillet 1789, lAssemble nationale se dclare constituante. Elle se fixe alors comme but de rdiger une nouvelle constitution.
Fin de lAncien Rgime
La nation est dsormais dpositaire de la souverainet. Le 14 juillet 1789, le peuple sempare de la forteresse royale de la Bastille, symbole de labsolutisme. Cette prise de la Bastille oblige le roi accepter la dcision des Parisiens de crer une garde nationale et une municipalit. Aussi, les habitants des campagnes, secous par la faim et la misre, sont en proie la Grande Peur, ne en juillet 1789. Les paysans refusent dacquitter les droits fodaux. Cest pourquoi ils prennent dassaut les chteaux afin de brler les documents lgaux. Pour apaiser la rvolte, les dputs votent labolition des privilges le 4 aot 1789, ce qui met fin lAncien Rgime. Les droits fodaux sont alors supprims et les Franais deviennent gaux devant le fisc, ladministration charge de percevoir les impts. Ils peuvent briguer tous les emplois, peu importe leur classe. Le 6 octobre, une foule de Parisiennes en colre contraint le roi et sa famille quitter Versailles pour la capitale.
La dmocratie dans lhistoire
Page 32 de 51
Texte de Gaston Lavergne publi sur le site Internet de lEsplanade www.esplanade.org/democratie
chec de la monarchie constitutionnelle (aot 1789 - aot 1792)
De lt 1789 lt 1791, lAssemble constituante pose les bases du systme politique de la France nouvelle. La Dclaration des droits de lhomme et du citoyen, vote le 26 aot 1789, proclame la souverainet de la nation. Elle accorde aux citoyens les liberts fondamentales, savoir la libert de pense, de se runir et de critiquer. De plus, elle garantit notamment le respect de la proprit de mme que lgalit devant la loi et le fisc. Adopte le 3 septembre 1791, la nouvelle Constitution instaure un suffrage censitaire, qui rserve le droit de vote 4 millions de citoyens actifs. Pour rpondre aux problmes financiers hrits de la royaut, la Constituante confisque les biens du clerg, quelle vend comme biens nationaux. Elle rforme lglise, dont les membres doivent dsormais prter serment la nation, tre rmunrs par ltat, en plus davoir t lus. Le pape rejette cette Constitution civile du clerg, ce qui divise profondment lglise de France. Le 21 juin 1791, le roi et sa famille tentent de fuir Paris pour rejoindre les migrs Varennes et pour organiser une conspiration contre-rvolutionnaire avec laide de souverains trangers. Reconnu puis arrt, Louis XVI est ramen Paris. Cette tentative de fuite radicalise ou intensifie la lutte contre la monarchie. Beaucoup demandent le jugement du roi et la proclamation de la Rpublique. Paris, pendant que lagitation des sans-culottes saccrot, le roi espre toujours une intervention trangre pour restaurer son pouvoir. Le 20 avril 1792, lAssemble lgislative dclare la guerre lempereur Franois II dAutriche. Les armes autrichiennes envahissent aussitt la France et, le 11 juillet 1792, lAssemble proclame ltat de guerre. Les prix montent, le grain manque et le peuple gronde. Celui-ci attribue ses difficults la trahison du roi. Cest ainsi que, le 10 aot 1792, le peuple en armes sempare du palais des Tuileries. Louis XVI se rfugie alors dans le btiment o se runit lAssemble lgislative, qui, sous la menace des sans-culottes, lenferme la prison du Temple. Lemprisonnement du roi quivaut sa dchance.
La dmocratie dans lhistoire
Page 33 de 51
Texte de Gaston Lavergne publi sur le site Internet de lEsplanade www.esplanade.org/democratie
Les dbuts de la Rpublique (septembre 1792 - juin 1793)
Le 20 septembre 1792, larme franaise remporte la victoire sur lenvahisseur autrichien Valmy. Ds le lendemain, la Convention nationale, un gouvernement rvolutionnaire, abolit la royaut. Cette nouvelle Assemble est lue au suffrage universel. Aussi, le 22 septembre, la Rpublique est proclame. La persistance de lagitation populaire cre cependant une tension qui provoque des divisions au sein de la Convention. Les girondins sopposent aux montagnards, qui sont favorables des mesures radicales pour ce qui concerne les affaires nationales comme extrieures. Dabord majoritaires, les girondins ne parviennent plus rsister aux Montagnards, quils accusent de vouloir instaurer une dictature. Ils doivent accepter de soumettre le roi un jugement. Le 11 dcembre 1792, on dresse lacte daccusation de Louis Capet, dernier roi de France, qui est guillotin le 21 janvier 1793. En mars de la mme anne, les paysans de Vende, royalistes et catholiques, se soulvent contre le gouvernement, tandis quen juin 1793 une insurrection des sans-culottes oblige la Convention nationale faire arrter les Girondins. partir de ce moment, les luttes sociales se radicalisent.
La dictature du salut public (juin 1793 - juillet 1794)
Les Montagnards, devenus matres du pouvoir, appliquent leurs ides en instaurant une dictature par les comits de la Convention nationale. En plus de diriger la politique gnrale de la Rpublique, la Convention organise une rpression, cest--dire quelle mne une lutte contre les ennemis de la Rvolution. Dans tous les dpartements, les lus sont remplacs par des agents fidles au rgime. Cest ainsi que dans les villes naissent des comits de surveillance et une arme rvolutionnaire. Le 5 septembre 1793, la Convention nationale institue un rgime de terreur. Cette pratique touche lensemble de lactivit conomique du pays puisque le gouvernement soumet le peuple un rationnement. Elle perturbe galement la vie religieuse, cause des attaques rptes contre les prtres rfractaires et la religion elle-mme. Dailleurs, le calendrier religieux est remplac par un calendrier civil et le culte religieux, par le culte de la raison. La terreur a aussi une porte politique par la cration, le 10 mars 1793, dun tribunal rvolutionnaire. ce propos, un accusateur public est dsign pour envoyer la guillotine les ennemis de la Rvolution, tels que Marie-Antoinette et les adversaires des Montagnards. Le nombre des victimes de ce chtiment est valu 40 000. Lyon, on massacre les suspects, tandis que la guerre qui fait rage en Vende crase les royalistes. partir de 1794, la Rvolution franaise drape. Robespierre, principal agitateur du gouvernement rvolutionnaire, fait rgner la grande terreur. La loi des suspects, qui entre en vigueur au printemps 1794, permet dornavant de condamner et dexcuter un individu dnonc sur un simple
La dmocratie dans lhistoire
Page 34 de 51
Texte de Gaston Lavergne publi sur le site Internet de lEsplanade www.esplanade.org/democratie
soupon. La grande terreur npargne pas les Montagnards. En effet, Robespierre fait excuter Danton et Camille Desmoulins pour les avoir jugs trop indulgents. Se sentant menacs, les conventionnels (membres de la Convention) dcident de faire arrter, le 27 juillet 1794, Robespierre et ses amis, qui sont excuts le lendemain. Aussi, pendant que les armes trangres, vaincues, sont poursuivies, les royalistes de Vende sont crass avec 150 000 morts.
Lchec de la Rpublique modre (juillet 1794 - novembre 1799)
Les vainqueurs de thermidor rorganisent ltat. En mettant fin la terreur, ils doivent faire face la famine de 1794 1795, puis la terreur blanche, dclenche par les aristocrates. En 1795, les premires journes de prairial (les 20, 21, 22 et 23 mai) marquent les derniers jours des sans-culottes. Pendant ce temps, les thermidoriens lgitiment leur pouvoir avec la Constitution de lan III, qui fonde le Directoire, un rgime destin empcher tout retour la dictature dun homme ou dune Assemble. Selon ce rgime, seuls les citoyens les plus riches, ceux qui paient un impt, ont le droit de vote. En outre, le pouvoir lgislatif est partag entre deux assembles : le Conseil des cinq cents, qui propose les lois, et le Conseil des anciens, qui les votent. Quant au pouvoir excutif, il est exerc par cinq directeurs. Mais en sparant les pouvoirs, la Constitution prive le rgime dune vritable autorit. Aucun texte ne prvoit de solution en cas de dsaccord entre les pouvoirs. De plus, la Rpublique est sans cesse menace par des complots ou des insurrections. Ces projets sont forms par le peuple affam ou par des royalistes qui veulent profiter de la faiblesse du pouvoir. Face aux complots, larme franaise, trs populaire, apparat comme un arbitre. Bientt, elle semble la seule force relle de la Rpublique. Dailleurs, elle continue remporter des victoires clatantes. Le gnral Bonaparte est le plus populaire des gnraux du Directoire. En 1797, il russit vaincre les Autrichiens en Italie et, en juillet 1799, il dfait les Turcs Aboukir. Aussi, laube du XIXe sicle, il prpare un coup dtat avec laide du directeur Sieyes. Le 18 brumaire (le 9 novembre 1799), Napolon Bonaparte oblige, sous la menace de ses armes, les Conseils lui remettre le pouvoir. Lvnement met un terme la Rvolution. La Constitution de lan VIII, qui entre en vigueur le 24 dcembre 1799, instaure le C o n s u l a t . Ce gouvernement est fait sur mesure pour Napolon, qui devient ainsi premier consul.
La dmocratie dans lhistoire
Page 35 de 51
Texte de Gaston Lavergne publi sur le site Internet de lEsplanade www.esplanade.org/democratie
Bilan de la rvolution franaise
Les dix annes que durent la Rvolution franaise apportent les fondements de la modernit des institutions publiques franaises daujourdhui. De 1789 1799, la nation est souveraine car chacun peut exprimer son vote grce au suffrage universel. En outre, la Constitution garantit lexercice du pouvoir dmocratique en empchant linstauration dune autorit absolue par la sparation des trois pouvoirs. Les liberts fondamentales sont garanties par labolition de lAncien Rgime de mme que, plus particulirement, par la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen. cette poque, on reconnat galement le libralisme politique et conomique ainsi que la sparation de lglise et de ltat. Le systme politique mis en place au cours de cette priode accorde une prpondrance la bourgeoisie. Pendant la Rvolution franaise, cette classe sociale fait triompher les idaux issus du sicle des Lumires : la primaut des personnes, la suppression des privilges, lgalit devant la loi et le libralisme conomique et social. La Rvolution franaise a des consquences immdiates dans de nombreux domaines. Par exemple, un dcret de la Convention nationale en 1794 entrane labolition de lesclavage. Une autre consquence de la Rvolution est la prminence de la France en Europe au dbut du XIXe sicle. En effet, les guerres rvolutionnaires ont permis dagrandir son territoire. Aussi, malgr la terreur et les conflits internes, les Franais sont plus nombreux en 1799 (28 millions) quau dbut de la Rvolution (26 millions).
La dmocratie dans lhistoire
Page 36 de 51
Texte de Gaston Lavergne publi sur le site Internet de lEsplanade www.esplanade.org/democratie
Vous aimerez peut-être aussi
- L' Occupation Américaine D'haïtiDocument6 pagesL' Occupation Américaine D'haïticlaro leger100% (3)
- Loi N° 69-00 CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICSDocument8 pagesLoi N° 69-00 CONTROLE FINANCIER DES ETABLISSEMENTS PUBLICSImane Salmi67% (3)
- Rah. UDocument296 pagesRah. UpisterbonePas encore d'évaluation
- Révolution SDocument55 pagesRévolution SLecreurPas encore d'évaluation
- PL 3666Document172 pagesPL 3666meinne ahmedPas encore d'évaluation
- Jugement Ta de NantesDocument6 pagesJugement Ta de NantesBreizh Info100% (1)
- H1 La Revolution FrancaiseDocument9 pagesH1 La Revolution FrancaiseAnthony Jean-denisPas encore d'évaluation
- Exigences RéglementairesDocument7 pagesExigences RéglementairesNizar EnnettaPas encore d'évaluation
- Crétineau-Joly Jacques - L'église Romaine en Face de La Révolution - Tome 2 PDFDocument552 pagesCrétineau-Joly Jacques - L'église Romaine en Face de La Révolution - Tome 2 PDFluciola123100% (1)
- Affaire Bozano C. FranceDocument26 pagesAffaire Bozano C. FranceStefania-Iulia PopescuPas encore d'évaluation
- Les Ruines de La Monarchie Française 2Document771 pagesLes Ruines de La Monarchie Française 2domi347347100% (1)
- Droit Criminel La Protection de La Société de Jean Paul DoucetDocument609 pagesDroit Criminel La Protection de La Société de Jean Paul DoucetPalo AzrielPas encore d'évaluation
- Code Des Investissements HaitiDocument26 pagesCode Des Investissements HaitiSheenider Jn JosephPas encore d'évaluation
- Histoire 1re Éd 2019 Manuel Numérique PREMIUM Élève - 9782401058767Document1 pageHistoire 1re Éd 2019 Manuel Numérique PREMIUM Élève - 9782401058767MaxPas encore d'évaluation
- CP Divorce Par Consentement MutuelDocument1 pageCP Divorce Par Consentement MutuelGaëlle MARRAUD des GROTTESPas encore d'évaluation
- Manuel Apostille HAGA - HBF PDFDocument140 pagesManuel Apostille HAGA - HBF PDFD.M.Pas encore d'évaluation
- Le Figaro Histoire N 2 - Juin-Juillet 2012 PDFDocument132 pagesLe Figaro Histoire N 2 - Juin-Juillet 2012 PDFgerardo2d.2lacPas encore d'évaluation
- Taine Origine t4 Gouv RevDocument670 pagesTaine Origine t4 Gouv RevAndré BernardesPas encore d'évaluation
- Parit en RDC IiDocument7 pagesParit en RDC IiOdimbaPas encore d'évaluation
- Archives Marocaines Vol.15Document486 pagesArchives Marocaines Vol.15Youn80Pas encore d'évaluation
- Protocole de New-York 1967Document14 pagesProtocole de New-York 1967Josue OuattaraPas encore d'évaluation
- Robespierre - Sur Les Principes de Morale PolitiqueDocument25 pagesRobespierre - Sur Les Principes de Morale PolitiquePaulaPas encore d'évaluation
- La Gestion Des AssociationsDocument54 pagesLa Gestion Des Associationsisslah100% (1)
- Convention Collective Du Personnel de Service en Vol D'air CanadaDocument292 pagesConvention Collective Du Personnel de Service en Vol D'air Canadascfp4091Pas encore d'évaluation
- C0BD1Document202 pagesC0BD1Eric AGBANGBATINPas encore d'évaluation
- 6 Fructidor de Lan II 23 Aout 1794Document2 pages6 Fructidor de Lan II 23 Aout 1794Etienne EtiennePas encore d'évaluation
- Conventions Internationales de Droit MaritimeDocument12 pagesConventions Internationales de Droit MaritimeBEFOUROUACK Hermod Jessia100% (1)
- Thucydide II 37 Et Le Préambule de La Constitution EuropéenneDocument8 pagesThucydide II 37 Et Le Préambule de La Constitution EuropéenneGlaydson José da SilvaPas encore d'évaluation
- Études Sur Les Roland, Tome 2 / Par Claude Perroud Réunies Et Mises en Ordre Par Georges Fénoglio Le GoffDocument468 pagesÉtudes Sur Les Roland, Tome 2 / Par Claude Perroud Réunies Et Mises en Ordre Par Georges Fénoglio Le GoffGeorges Louis Le GoffPas encore d'évaluation
- TextesDocument16 pagesTextesDOULEZEROPas encore d'évaluation