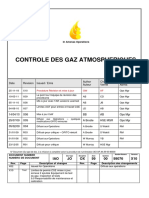Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
rt2005 Version09102006
rt2005 Version09102006
Transféré par
artoche81Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
rt2005 Version09102006
rt2005 Version09102006
Transféré par
artoche81Droits d'auteur :
Formats disponibles
direction gnrale de lUrbanisme de lHabitat et de la Construction
RGLEMENTATION THERMIQUE 2005
DES BTIMENTS CONFORTABLES ET PERFORMANTS
Des
enjeux
pour lavenir
Un enjeu plantaire
Lutter contre leffet de serre
majeurs
Les Accords de Rio et de Kyoto fixent des objectifs de limitation des missions de gaz effet de serre. La France sest notamment engage rduire la consommation dnergie des btiments qui contribuent, pour plus du quart, la production des gaz effet de serre. Le Plan Climat 2004 dcrit entre autres les mesures transposant la directive europenne du 16 dcembre 2002 qui traite de la performance nergtique des btiments. Il spcifie clairement les objectifs de la rglementation thermique des constructions neuves : - une amlioration de la performance nergtique de la construction neuve dau moins 15%, pour un objectif de 40% en 2020, - une limitation du recours la climatisation, - la matrise de la demande en lectricit.
2000 -15% -40% 2005 2010 2015
2020
volution de la consommation moyenne des btiments neufs par rapport aux btiments RT 2000
Un enjeu social
Matriser les loyers et les charges
Pour que chacun puisse trouver un logement correspondant ses capacits financires, le ministre de lemploi, de la cohsion sociale et du logement reste attentif la matrise du cot global des logements, charges financires et dexploitation comprises. Les proccupations actuelles dconomie dnergie intgrent elles aussi cet aspect. La RT 2005 devrait ainsi permettre de rduire la facture nergtique dau moins 15% par rapport aux btiments construits selon la prcdente rglementation RT 2000, contribuant ainsi diminuer les charges.
Un enjeu conomique
Encourager les systmes et les techniques constructives performants
La RT 2005 rpond la stratgie nergtique nationale nonce par la loi de programme fixant les orientations de la politique nergtique du 13 juillet 2005 : elle permet dune part de contribuer lindpendance nergtique nationale et dautre part de favoriser la comptitivit conomique de lingnierie, des techniques et des produits franais sur le march intrieur et lexportation.
2 3
Rpartition moyenne des dperditions dans une maison individuelle neuve
Aration, ventilation : 15%
Toiture : 10%
Mur : 20%
Fentres : 15%
Ponts thermiques : 20%
Plancher bas : 20%
ISOLATION Les pertes de chaleur par les parois tant considrables, il est fondamental de sassurer du pouvoir isolant des toitures, des planchers (bas et hauts), ainsi que des murs, portes et parois vitres.
PONTS THERMIQUES Il sagit dune discontinuit dans lisolation qui est due la structure du btiment et qui peut reprsenter jusqu 40% des dperditions.
VENTILATION Si le renouvellement dair doit tre suffisant du point de vue de lhygine, il doit en revanche tre minimal pour limiter les dperditions thermiques.
PERMEABILITE A LAIR Il sagit de limiter les infiltrations parasites dair frais lintrieur du bti.
CONCEPTION BIOCLIMATIQUE Les apports passifs permettent de rduire la production et par consquent la consommation des quipements de chauffage et de refroidissement.
PROTECTION SOLAIRE La protection solaire doit permettre dviter les inconforts dblouissement et de surchauffe.
ENERGIES RENOUVELABLES Les sources dnergie renouvelable sont inpuisables et propres pour lenvironnement.
ECLAIRAGE DES LOCAUX Il sagit de limiter les consommations dnergie utilises pour lclairage.
Lapplication de la rglementation dans la continuit de la RT 2000
La rglementation thermique :
- sapplique aux btiments neufs rsidentiels et tertiaires ( lexception de ceux dont la temprature normale dutilisation est infrieure ou gale 12C, des constructions provisoires (dune dure dutilisation infrieure deux ans), des btiments dlevage ainsi que des btiments chauffs ou climatiss en raison de contraintes lies leur usage), - concerne les projets dont le dpt de la demande de permis de construire est postrieur au 1er septembre 2006, - est dfinie par les articles L.111-9, R.111-6 et R.111-20 du Code de la construction et de lhabitation et leurs arrts dapplication.
La RT 2005 sinscrit dans la continuit de la RT 2000. Elle en reprend la structure rglementaire ainsi que les principes qui permettent au matre douvrage de choisir la solution la plus conomique pour atteindre la performance exige. Celui-ci dispose ainsi de deux modalits daction pour faire respecter les exigences introduites par la RT 2000 et renforces par la RT 2005.
Trois conditions respecter pour le btiment construire
Lconomie dnergie
La consommation globale dnergie du btiment pour les postes de chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, auxiliaires, ainsi que dclairage dans le cas dun btiment tertiaire, doit tre infrieure la consommation de rfrence de ce btiment. Celle-ci correspond la consommation quaurait ce mme btiment pour des performances imposes des ouvrages et des quipements qui le composent. La rglementation laisse donc au concepteur la possibilit dutiliser des quipements ou matriaux de performance infrieure la rfrence, dans la limite des garde-fous, et sous rserve dtre plus performant que la rfrence dans les autres postes de dperdition. La RT 2005 introduit galement une limite suprieure de consommation pour les logements. La consommation dnergie de ces btiments pour le chauffage, le refroidissement et leau chaude sanitaire doit en effet tre infrieure une valeur limite qui dpend du type de chauffage et du climat.
Le confort dt
La temprature intrieure conventionnelle atteinte en t doit tre infrieure la temprature de rfrence.
Les garde-fous
Des performances minimales sont requises pour une srie de composants (isolation, ventilation, systme de chauffage). Introduites par la RT 2000, ces performances minimales ont t renforces par la RT 2005, notamment au niveau des dperditions par les ponts thermiques. Au fil des rglementations, la consommation nergtique des btiments neufs a baiss de plus de 50% !
1974 - 1re tape
Pour rpondre rapidement laugmentation du prix de lnergie, une isolation thermique performante pour les parois et une bonne gestion de la ventilation sont demandes aux logements neufs.
Les exigences disolation relatives au chauffage lectrique sont actualises un niveau plus lev dans les annes qui suivent.
Deux modalits daction au choix des acteurs
Le matre douvrage sengage lors de sa demande de permis de construire appliquer les rgles de construction et donc la rglementation thermique. Il doit pouvoir justifier du respect de la RT 2005 :
- soit
au moyen dune tude thermique
La consommation dnergie Cep et la temprature intrieure conventionnelle Tic sont alors calcules au moyen de logiciels dapplication. Le matre douvrage doit dans ce cas pouvoir fournir une synthse dtude thermique.
-
soit sans calcul laide de solutions techniques
Agres par le ministre charg de la construction et de lhabitation, elles dcrivent des solutions qui garantissent le respect des valeurs de rfrence, tant en termes dconomie dnergie que de confort dt.
Rfrences Rfrences Exigences Exigences minimales ou minimales ou garde-fous-fou garde
Lapplication
de la rglementation les nouveauts de la RT 2005
Une meilleure lisibilit de la performance nergtique Prise en compte et valorisation de la conception bioclimatique
ea u
es an re ita fro ire id iss em au en xil t iai re s c la (si ira te ge rt
ch au ffa ge
ch au d
Principe de compensation entre les postes de dperdition
iai r
e)
La rglementation thermique affiche dsormais les consommations dnergie par mtre carr de surface, ce qui offre une meilleure lisibilit des performances nergtiques.
La rglementation thermique sattache dsormais permettre le calcul et la valorisation des outils de la construction bioclimatique tant pour diminuer les besoins de chauffage et de refroidissement que pour assurer un meilleur confort dt.
1976
1re rglementation pour le secteur non rsidentiel.
1980
Lancement du 1er label, le Label haute isolation Pour inciter dpasser lexigence rglementaire et prparer les volutions suivantes, 140 000 logements ont reu le label.
1982 - 2me tape
Les niveaux disolation du Label haute isolation deviennent obligatoires pour tous les logements. Fait nouveau : les apports solaires sont dduits des dperditions pour calculer les besoins de chauffage.
Un garde-fou sur la consommation en rsidentiel
Est introduite, pour les logements, une limite de consommation maximale (par mtre carr de surface) pour les consommations de chauffage, de refroidissement et de production deau chaude sanitaire. Cette limitation est dcline par zones climatiques et par nergies de chauffage.
Consommation maximale exprime en nergie primaire pour les consommations de chauffage, refroidissement et production deau chaude sanitaire
Zone climatique * H1 H2 H3
Combustibles fossiles 130 kWh primaire/m2/an 110 kWh primaire/m2/an 80 kWh primaire/m2/an
Chauffage lectrique (y compris pompes chaleur) 250 kWh primaire/m2/an 190 kWh primaire/m2/an 130 kWh primaire/m2/an
* les zones climatiques sont dfinies dans larrt (H1 : nord, H3 : zone mdittrranenne)
Incitation au recours aux nergies renouvelables
Paralllement, la RT 2005 encourage le recours aux nergies renouvelables. Ainsi, la rfrence des chaudires bois est cale aux bonnes pratiques du march et, pour certains btiments rsidentiels, une part de production deau chaude sanitaire solaire est introduite en rfrence.
Limitation du recours la climatisation
Pour ce qui est des consommations de refroidissement, elles sont intgres dans les mthodes de calcul. Sauf cas particuliers o la climatisation est absolument indispensable (zones de bruit, tablissements sanitaires...), un btiment climatis naura pas le droit de consommer plus quun btiment identique non climatis.
Labels
Le principe de labels Haute Performance nergtique est reconduit. Les labels HPE et THPE peuvent tre attribus aux constructions dont les consommations conventionnelles sont respectivement infrieures de 10% et 20% aux consommations de rfrence. Dautres niveaux de labels intgreront par ailleurs ce dispositif, afin notamment didentifier les constructions qui recourent aux nergies renouvelables et les btiments basse consommation.
Un renforcement des exigences RT 2005 ds 2008
La RT 2005 verra ses exigences renforces ds 2008, notamment en ce qui concerne la climatisation ( partir du 1er janvier 2008) et la performance des chaudires ( partir du 1er juillet 2008).
1983
Lancement des labels Haute Performance nergtique (HPE) et Solaire Quatre niveaux de performance sont proposs pour donner davantage de lisibilit
aux efforts damlioration des performances du secteur de la construction. Le programme H2E85 (Habitat conome en nergie lhorizon 1985) en est laboutissement.
1988 - 3me tape
1er renforcement de la rglementation pour le secteur non rsidentiel : progression des labels HPE et Solaire Cette tape correspond au renforcement des performances exiges, au niveau 2 du Label HPE.
Une ncessaire prise en compte des contraintes nergtiques ds la conception
Le niveau dexigences requis par la RT 2005 impose dans la plupart des cas, pour obtenir les moindres surcots, une prise en compte des contraintes nergtiques ds la conception. Ainsi, si le concepteur travaille en amont la conception de son btiment, le surcot dun btiment construit selon la RT 2005 par rapport un btiment construit selon la RT 2000 sera vraiment rduit : il sera en moyenne de lordre de 2%, pourcentage quil faut comparer aux conomies dnergie qui seront dau moins 15% par rapport un btiment construit selon la RT 2000. Le concepteur devra notamment porter une attention particulire la compacit de lenveloppe, limplantation et lorientation du btiment, lorientation et la surface des baies vitres, au choix des matriaux, ainsi qu certains dispositifs constructifs.
de la rglementation : les principaux points de la RT 2005
Rpartition moyenne des consommations dnergie par poste, en rsidentiel (en rgion parisienne)
Auxiliaires 10%
Lapplication
e clairage 10%
Chauffage 60%
c
Eau chaude e sanitaire 20%
CHAUFFAGE Les quipements de chauffage (production, distribution, mission) sont des points de consommation nergtique matriser. REFROIDISSEMENT
EAU CHAUDE SANITAIRE Afin de produire, maintenir et distribuer leau une certaine temprature, les quipements et rseaux deau chaude sanitaire consomment de lnergie.
De mme que les quipements de chauffage, les quipements de refroidissement sont des points de consommation nergtique matriser.
Lexigence rglementaire porte dsormais sur la consommation C, somme des besoins en chauffage corrige des rendements des systmes de chauffage ou deau chaude sanitaire. Le niveau dexigence du secteur tertiaire est rehauss et certaines exigences sont ajoutes en matire de rgulation-programmation, de ventilation et de climatisation.
RT 2000
Renforcement de la RT 1988 : introduction dune exigence en termes de confort dt Cette tape correspond notamment la mise en application des engagements de la France au niveau international (Accords de Rio et de Kyoto).
Pour satisfaire la rglementation, le btiment doit dsormais rpondre trois exigences fondamentales en termes dconomie dnergie, de confort dt et de performances minimales des composants. Les acteurs de la constructions ont leur disposition deux modalits daction pour faire respecter ces exigences : ils peuvent effectuer des calculs ou appliquer des solutions techniques.
La RT 2005, fruit de la concertation
Pendant prs de trois ans, le ministre de lemploi, de la cohsion sociale et du logement a pilot un programme dtudes avec lappui du Centre Scientifique et Technique du Btiment, en concertation avec les organisations professionnelles et les experts du secteur. Cette coopration entre les pouvoirs publics et les professionnels a permis daboutir une convergence des points de vue. Le niveau des performances exigibles des ouvrages et des quipements est fix en fonction des pratiques actuelles et des objectifs de progrs envisags. Ces performances ont t retenues comme base pour le calcul des rfrences. Un accord a galement t trouv pour arrter le niveau de performance des ouvrages et quipements en dessous desquels il convient de sinterdire de les utiliser en construction neuve : ce sont les exigences minimales respecter, ou les garde-fous.
Les prochaines
tapes
Au-del de ces lments, permettant damliorer la performance nergtique de la construction courante et de prparer la prochaine tape rglementaire (RT 2010), les professionnels doivent prparer les solutions techniques qui permettront la ralisation de btiments basse consommation. Cest pourquoi le gouvernement a mis en place un grand programme de recherche sur les conomies dnergie dans le btiment. Le protocole instituant ce programme de recherche dnomm PREBAT a t sign le 25 avril 2006. Il prvoit de mobiliser des financements hauteur de 62 millions deuros sur trois ans. Les recherches viseront dvelopper des solutions techniques permettant : la ralisation de btiments neufs consommant moins de 50 kWh/m2, la rnovation banalise de btiments avec une performance nergtique aussi proche que possible de celle des btiments neufs, la ralisation de btiments nergie positive. Par ailleurs, la Fondation Btiment nergie, qui runit les financements de ltat et dentreprises (Arcelor, EDF, Gaz de France et Lafarge) a lanc un appel projets sur le thme des solutions de rnovation dans la maison individuelle existante.
Les textes
rglementaires
Dcret n2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractristiques thermiques et la performance nergtique des constructions (JO du 25 mai 2006) Arrt du 24 mai 2006 relatif aux caractristiques thermiques des btiments nouveaux et des parties nouvelles de btiments (JO du 25 mai 2006) Sites internet (consultation des textes dans leur intgralit) : http://www.logement.gouv.fr., Rubrique Performance nergtique http://www.legifrance.gouv.fr
Les contacts
Directions Dpartementales et Rgionales de lquipement (DDE et DRE) Direction Gnrale de lUrbanisme, de lHabitat et de la Construction Bureau de la qualit technique et de la prvention Tl. : 01 40 81 21 22 - http://www.logement.gouv.fr Centre Scientifique et Technique du Btiment Tl. : 01 64 68 82 82 - http://www.cstb.fr
R G L E M E N TAT I O N THERMIQUE
2005
Vous aimerez peut-être aussi
- HydrauliqueDocument11 pagesHydrauliqueMed MaxPas encore d'évaluation
- ExercicebDocument18 pagesExerciceb10011100% (1)
- Rapport de Stage AILLOULDocument32 pagesRapport de Stage AILLOULAmine AniberPas encore d'évaluation
- Résumé de GéopolitiqueDocument5 pagesRésumé de GéopolitiqueLaila AmouragPas encore d'évaluation
- Chimie Analytique Collection Sciences de L Ingenieur - SommaireDocument24 pagesChimie Analytique Collection Sciences de L Ingenieur - Sommairengae50% (2)
- Enpc Rar 2009 PDFDocument335 pagesEnpc Rar 2009 PDFkhadija eddahbyPas encore d'évaluation
- Cours Chapitre II Dynamique L1PCSM 2020-2021Document9 pagesCours Chapitre II Dynamique L1PCSM 2020-2021sallfatima2003Pas encore d'évaluation
- Tpe DR ABOLODocument16 pagesTpe DR ABOLORaoul officielPas encore d'évaluation
- Etude de La Spéciation Des Métaux LourdsDocument148 pagesEtude de La Spéciation Des Métaux Lourdsakesse.keplerPas encore d'évaluation
- 02 Nature Et CultureDocument2 pages02 Nature Et Culturedahaw865Pas encore d'évaluation
- Sperber1967 - Edmund Leach Et Les AnthropologuesDocument16 pagesSperber1967 - Edmund Leach Et Les AnthropologuesmattdelezPas encore d'évaluation
- FrancioniDocument8 pagesFrancionikenzatazi2007Pas encore d'évaluation
- Philo Tle - L8 - Progrès Et Bonheur PDFDocument10 pagesPhilo Tle - L8 - Progrès Et Bonheur PDFJean Yvan KouamePas encore d'évaluation
- Chimie 7ème AnnéeDocument7 pagesChimie 7ème AnnéeME CISSÉ92% (12)
- Mouvement Des Satellites Et Des Planetes Cours LatexDocument5 pagesMouvement Des Satellites Et Des Planetes Cours LatexSaif Yassine TouilPas encore d'évaluation
- Chapitre VIDocument14 pagesChapitre VIAchiaou FahdPas encore d'évaluation
- Les Reactions D Oxydo Reduction Cours 1Document6 pagesLes Reactions D Oxydo Reduction Cours 1mouna elPas encore d'évaluation
- TP9 - Variations de La BiodiversitéDocument7 pagesTP9 - Variations de La BiodiversitéNathan LAFONPas encore d'évaluation
- Thermochimie Chapitre3Document14 pagesThermochimie Chapitre3Arno NanfackPas encore d'évaluation
- Calcul de La Pression Corrigée Du Gaz SF6 PDFDocument7 pagesCalcul de La Pression Corrigée Du Gaz SF6 PDFSalah Boukeffa0% (1)
- 3 Fin Chap Énergie Semaine 3Document3 pages3 Fin Chap Énergie Semaine 3Yoman Arthur verdier Assui100% (1)
- Échangeurs de ChaleurDocument27 pagesÉchangeurs de Chaleurbertrand_0123456789100% (1)
- Iso 14001 PDFDocument48 pagesIso 14001 PDFMehdi FalloulPas encore d'évaluation
- Charbon Actif PorositéDocument17 pagesCharbon Actif PorositéFay Rouz Taleb EpTahri100% (1)
- Mémoire-Final-KADDOURI ALIDocument64 pagesMémoire-Final-KADDOURI ALIAli KaddouriPas encore d'évaluation
- Procedure FRDocument20 pagesProcedure FRprince ghostePas encore d'évaluation
- Mémoire de Master (IET), Amélioration Des Performances D'un Système Éolien Par L'introduction Dune Sorce SolaireDocument63 pagesMémoire de Master (IET), Amélioration Des Performances D'un Système Éolien Par L'introduction Dune Sorce SolaireBéma COULIBALYPas encore d'évaluation
- Metier IngenieurDocument2 pagesMetier IngenieurRIAD HILALPas encore d'évaluation
- Etude Et Conception Dun Systeme Dinterco PDFDocument65 pagesEtude Et Conception Dun Systeme Dinterco PDFمسعود دزايرPas encore d'évaluation
- Cours de Mic-Env Partie 1 2021Document9 pagesCours de Mic-Env Partie 1 2021Nardjis BoulifaPas encore d'évaluation