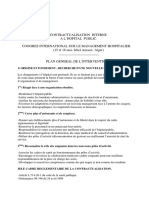Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Un Italien À Paris: Vers La Sculpture (1906-1913) : Modifier Modifier Le Code
Un Italien À Paris: Vers La Sculpture (1906-1913) : Modifier Modifier Le Code
Transféré par
damsia-1Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Un Italien À Paris: Vers La Sculpture (1906-1913) : Modifier Modifier Le Code
Un Italien À Paris: Vers La Sculpture (1906-1913) : Modifier Modifier Le Code
Transféré par
damsia-1Droits d'auteur :
Formats disponibles
Un Italien à Paris : vers la sculpture (1906-1913)[modifier | modifier le code]
Le nom de Modigliani reste associé à Montparnasse9 mais il a aussi beaucoup fréquenté Montmartre, quartier
encore mythique de la bohème. Frayant en toute indépendanceN 16 avec ce que la capitale incontestée des avant-
gardesK 6 compte d'artistes venus de l'Europe entière, il cherche bientôt sa propre vérité dans la sculpture sans
délaisser totalement les pinceaux. Bien que soutenu par sa famille, le dandy orgueilleux vit dans une pauvreté qui,
conjuguée à l'alcool et à la drogue, altère son état de santéM 25.
De la bohème à la misère[modifier | modifier le code]
Dans le jardin de la Ruche fin 190610.
Loin de la stabilité matérielle et morale à laquelle il aspirait peut-être, Modigliani devient selon son ami Adolphe
Basler le dernier bohémien authentiqueK 7.
Début 190611, comme à son habitude dans une nouvelle ville, le jeune Italien se choisit un bon hôtel, près de la
MadeleineM 26. Il court les cafés, les antiquaires, les bouquinistesP 22, arpentant les boulevards en costume de velours
côtelé noir et bottines lacées, foulard rouge « artiste » et chapeau à la Bruant12. Pratiquant le français depuis
l'enfance il crée aisément des liensN 17, et dépense sans compter, quitte à laisser croire qu'il est fils de banquierP 23.
Inscrit durant deux ans à l'académie ColarossiK 8,g, il hante le musée du Louvre et les galeries qui exposent les
impressionnistes ou leurs successeurs : Paul Durand-Ruel, Clovis Sagot, Georges Petit, Ambroise VollardN
17
, Berthe Weill, Bernheim-JeuneP 23.
Le maquis de Montmartre vers 1900.
Ayant en quelques semaines plus qu'écorné le pécule tiré des économies de sa mère et du legs de son oncle mort
l'année précédente, Modigliani prend un atelier rue CaulaincourtM 28, dans le « maquis » de Montmartreh,K 7. Chassé
par les travaux de réhabilitation du quartier, il passe de pensions en garnisP 24 avec comme adresse fixe le Bateau-
Lavoir, où il fait des apparitionsN 18 et bénéficie un temps d'un petit localP 25. En 1907 il loue au pied de la butte, place
Jean-Baptiste-Clément, une remise en boisM 29, qu'il perd à l'automne. Le peintre Henri Doucet l'invite alors à
rejoindre la colonie d'artistes qui, grâce au mécénat du Dr Paul Alexandre et de son frère pharmacien, occupe une
vieille bâtisse de la rue du Delta où sont organisés aussi des « samedis » littéraires et musicauxN 18 : rebelle à la vie
communautaireP 26, l'Italien profite de cet environnement actifN 19 sans s'y fixer vraimentM 30, mais ses œuvres
accrochées partout semblent avoir suscité quelques jalousiesA 7.
À partir de 1909, expulsé parfois pour loyer impayéN 20, il habite alternativement Rive gauche (la Ruche, Cité
Falguière, boulevard Raspail, rue du Saint-Gothard) et Rive droite (rue de Douai, rue Saint-Georges, rue
Ravignan)M 31. Chaque fois il abandonne ou détruit certaines toiles13, déménageant dans une charrette sa malle, ses
livresM 32, son matériel, des reproductions de Carpaccio, Lippi ou MartiniN 17, et son tub14. Très tôt donc, malgré les
mandats d'Eugénie, débute l'errance de son fils en quête de logement sinon de nourriture : certains y ont vu la
cause, d'autres la conséquence de ses addictionsM 29.
Même s'il est alors répandu dans les milieux artistiquesA 8, le haschich coûte cher et Amedeo en prend peut-être
plus que d'autres, quoique jamais en travaillantM 33. Il s'est surtout mis au vin rougeP 25 : devenu alcoolique en
quelques annéesM 34, il trouvera un équilibre dans le fait de boire par petites doses régulières quand il peint, sans
jamais envisager semble-t-il de désintoxicationi,M 15. Contestant la légende du génie jailli du pouvoir exaltant des
droguesM 32, la fille du peintre effleure plutôt les ressorts psychophysiologiques de son ivrognerie : organisme déjà
altéré, timidité, isolement moral, incertitudes et regrets artistiques, anxiété de « faire vite »M 15. Alcool et stupéfiants
l'aideraient en outre à atteindre une plénitude introspective propice à sa création car révélatrice de ce qu'il porte en
luiA 9.
Dès son arrivée, Modigliani noue beaucoup d'amitiés Au Lapin Agile (cliché de 1905)N 16.
La réputation de « Modi » à Montmartre puis à Montparnasse tient en partie au mythe du « bel italien »M 35 : racé,
toujours rasé de frais, il se lave, même à l'eau glacée, et porte ses vêtements élimés avec des allures de prince,
recueil de vers en poche15. Fier de ses origines italiennesN 21, et juives bien qu'il ne pratique pasP 27, il est altier et vif.
Sous l'effet de l'alcool ou des stupéfiants, il peut devenir violent : autour du jour de l'an 1909, rue du Delta, il aurait
balafré plusieurs toiles de ses camarades et provoqué un incendie en faisant brûler du punchP 28. Cachant sans
doute un certain mal-être derrière son exubérance16, il a l'ivresse spectaculaire et finit parfois la nuit dans une
poubelle17 ou au commissariat de policeP 29.
Au Dôme ou à La Rotonde, Modigliani s'impose souvent à la table d'un client pour faire son portrait, qu'il lui vend
quelques sous ou échange contre un verre18,P 30 : c'est ce qu'il appelle ses « dessins à boire »19. Il est connu par
ailleurs pour ses accès de générosité, ainsi quand il laisse tomber son dernier billet sous la chaise d'un rapin plus
démuni que luiM 36 en s'arrangeant pour qu'il le trouve20. De même, le compositeur Edgard Varèse se souvient que
son côté « ange » autant qu'ivrogne lui valait la sympathie des clochards et des miséreux dont il croisait le chemin21.
Vous aimerez peut-être aussi
- Manuel Du Conducteur de Culte 2015-2016Document12 pagesManuel Du Conducteur de Culte 2015-2016Cécé Charles Kolié82% (17)
- Sémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFDocument28 pagesSémiotique Figurative Et Sémiotique Plastique PDFvelhobiano67% (3)
- DSS 172 0333Document21 pagesDSS 172 0333damsia-1Pas encore d'évaluation
- (L) Goethe - Mémoires 1855 PDFDocument423 pages(L) Goethe - Mémoires 1855 PDFdamsia-1Pas encore d'évaluation
- Kovacs EszterDocument303 pagesKovacs Eszterdamsia-1Pas encore d'évaluation
- Edutheque Louis Xiv Roi de France Antoine BenoistDocument3 pagesEdutheque Louis Xiv Roi de France Antoine Benoistdamsia-1Pas encore d'évaluation
- Le Comique PDFDocument54 pagesLe Comique PDFdamsia-1Pas encore d'évaluation
- Reflexion Sur Le Style Néo Mauresque en AlgérieDocument53 pagesReflexion Sur Le Style Néo Mauresque en AlgérieMARWA BOUPas encore d'évaluation
- Cours Droit Des Stes CommercialesDocument82 pagesCours Droit Des Stes CommercialesMohamed Moudine100% (1)
- BIOLOGIE1TD3groupes3 4 5et6L1Geo21Document4 pagesBIOLOGIE1TD3groupes3 4 5et6L1Geo21aqua FishPas encore d'évaluation
- Correction SERIE EXERCICES TP3Document5 pagesCorrection SERIE EXERCICES TP3Khlifi AyoubPas encore d'évaluation
- JNGG 2012 519 PDFDocument8 pagesJNGG 2012 519 PDFFaci AliPas encore d'évaluation
- 2021 03 Metro Sujet1 ExoB BoissonHydratation 5pts CorrectionDocument6 pages2021 03 Metro Sujet1 ExoB BoissonHydratation 5pts CorrectionYoram JdlPas encore d'évaluation
- Le Colonel Si Sadek Est Mort Le Matin DZDocument3 pagesLe Colonel Si Sadek Est Mort Le Matin DZxeres007Pas encore d'évaluation
- Sujet Certification Octobre 2015 Validé 2Document5 pagesSujet Certification Octobre 2015 Validé 2fatoutraore2345Pas encore d'évaluation
- Programmation Linéaire en Nombres Entiers Pour L'ordonnancement Modulo Sous Contraintes de Ressources.Document75 pagesProgrammation Linéaire en Nombres Entiers Pour L'ordonnancement Modulo Sous Contraintes de Ressources.Med GasPas encore d'évaluation
- Méthodes de Recherche en Management by ImihiDocument618 pagesMéthodes de Recherche en Management by ImihiSalma Nouni100% (3)
- La Trame Se Soigner Par Lénergie Du Monde (French Edition) (Patrick Burensteinas) (Z-Library)Document96 pagesLa Trame Se Soigner Par Lénergie Du Monde (French Edition) (Patrick Burensteinas) (Z-Library)Rahman100% (1)
- Emeka Et Le Vieil Homme - Nwanne Felix-EmeribeDocument14 pagesEmeka Et Le Vieil Homme - Nwanne Felix-EmeribeSara CANO CARRATALÁPas encore d'évaluation
- 3 - DéglutitionDocument17 pages3 - DéglutitionouazzanyPas encore d'évaluation
- Bodies York Rite Structure GlufmmmoscDocument6 pagesBodies York Rite Structure GlufmmmoscMatthieu LUBOYAPas encore d'évaluation
- TD Dualité 2021Document2 pagesTD Dualité 2021AYMANE JAMAL100% (1)
- Les Yowlè - Recherche GoogleDocument1 pageLes Yowlè - Recherche Googlekouameulysse0Pas encore d'évaluation
- Fiche MethodeDocument3 pagesFiche MethodeLoundou ortegaPas encore d'évaluation
- DS Elec n1Document4 pagesDS Elec n1Zac RajayiPas encore d'évaluation
- Spasmocalm 80mgDocument4 pagesSpasmocalm 80mgSmile ForeverPas encore d'évaluation
- Plaquette Des EnseignementsDocument17 pagesPlaquette Des Enseignementsabdul.rahmanprivate.box2022Pas encore d'évaluation
- (Aristote) de La G?n?ration Des AnimauxDocument461 pages(Aristote) de La G?n?ration Des AnimauxFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- Management HospitalierDocument4 pagesManagement HospitalierAli Lemrabet0% (1)
- M2 - Mémoire - SR ModifDocument121 pagesM2 - Mémoire - SR ModifSandra RebolledoPas encore d'évaluation
- Macadabre OdtDocument2 pagesMacadabre Odtjean reuhPas encore d'évaluation
- Enon SuitesDocument26 pagesEnon SuitesLOUNDOU orthegaPas encore d'évaluation
- 1 Rapport de SSTDocument3 pages1 Rapport de SSTAbdellahPas encore d'évaluation
- Rendu Approche Documentaire BRUN Tom CARNIAUX FabienDocument8 pagesRendu Approche Documentaire BRUN Tom CARNIAUX FabienFafabi ibafaFPas encore d'évaluation
- La Bénédiction Du Sel Et de L'eauDocument2 pagesLa Bénédiction Du Sel Et de L'eauThamai100% (1)