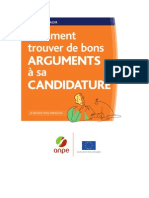Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ias 19 PDF
Ias 19 PDF
Transféré par
nawalTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ias 19 PDF
Ias 19 PDF
Transféré par
nawalDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiche de synthèse – IAS 19 Avantages du personnel
DEFINITIONS
Les avantages du personnel sont classés en 4 catégories :
Avantages à court terme
Les avantages à court terme, autres que les indemnités de fin de contrat de travail, sont des prestations
payables pendant l’emploi du salarié et qui sont dus intégralement au plus tard dans les douze mois suivant la
fin de l’exercice pendant lequel les membres du personnel ont rendu les services correspondants.
Autres avantages à long terme
Les autres avantages à long terme désignent des avantages qui ne sont pas dus intégralement dans les douze
mois suivant la fin de l’exercice pendant lequel les membres du personnel ont rendu les services
correspondants.
Indemnités de fin de contrat de travail
Les indemnités de fin de contrat de travail désignent les avantages à accorder à un membre du personnel du
fait :
soit de la résiliation par l'entreprise du contrat de travail du membre du personnel avant l'âge normal de
départ à la retraite ;
soit de la décision du membre du personnel de partir volontairement en échange d’indemnités dans le cadre
d’une offre.
Avantages postérieurs à l’emploi
Les avantages postérieurs à l’emploi sont les avantages payables après la cessation de l’emploi du salarié.
Tableau synthétisant les différentes catégories d’avantages du personnel : Avantages payables aux salariés
Pendant l'emploi Après l'emploi
Au moment de la
cessation de l'emploi Lors du départ ou
Avantages à court Avantages à long
après le départ à la
terme terme
retraite
- salaires et - absences - indemnités de - retraites (sous
appointements, rémunérées de licenciement ou de forme de rentes ou
- congés payés annuels longue durée, départ volontaire, de capital),
et congés maladie, - médailles du travail, - indemnités de - couverture
- primes, congés sabbatiques préretraite médicale,
- avantages en nature et jubilés, - assurance-vie,
(dont couverture - rente d'incapacité - avantages en
Type médicale) si payables ou invalidité, nature maintenus
d'avantages totalement moins de 12 - participation, primes aux retraités
concernés mois après la fin de la et autre rémunération
période d'acquisition différée si payables
des droits 12 mois ou plus après
- participation si versée la fin de la période
à un fonds externe à d'acquisition des
l’entreprise droits
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 1/24
Avantages postérieurs à l’emploi – Distinction entre régimes à cotisations définies et
régimes à prestations définies
Classement fondé sur l’analyse économique des régimes : détermination des parties qui supportent les
obligations liées au régime, et notamment, les risques actuariels et de placement
Régimes à cotisations définies Régimes à prestations définies
Mode de gestion Gestion externe : Gestion interne :
cotisations versées à un organisme l’entité gère elle-même des fonds qui lui
distinct et reversées aux salariés permettront de payer ses engagements futurs.
augmentées de leur rendement. Gestion externe :
l ’entité verse des fonds à un tiers qui les gère
et qui paiera les engagements futurs.
Obligation Obligation juridique ou implicite de Obligation de payer les prestations
l’entité se limite au montant qu’elle convenues aux membres de son personnel
s’engage à payer au fonds. en activité et aux anciens membres de son
personnel.
Risque actuariel et Incombent aux membres du Incombent à l’employeur
risque de placement
personnel Risque actuariel : risque que les prestations
Risque actuariel : risque que les coûtent plus cher que prévu.
prestations soient moins importantes Risque de placement : risque que les actifs
que prévu. investis ne soient pas suffisants pour faire face
Risque de placement : risque que les aux prestations prévues.
actifs investis ne soient pas suffisants
pour faire face aux prestations prévues.
Comptabilisation Charges = Cotisations Charges ne correspondent pas aux cotisations
Pas de provision au titre du régime au Eventuelle provision au titre du régime au bilan
bilan
Avantages postérieurs à l’emploi – Régimes à prestations assurées
Les entreprises peuvent faire appel à un organisme externe pour limiter leur risque ou pour financer un régime à
prestations définies.
Si la compagnie d’assurance assume les risques actuariels et de placement liés au régime, l’entreprise
comptabilise le régime comme un régime à cotisations définies.
En revanche, si la compagnie d’assurance n’assume pas les risques actuariels et de placement, l’entreprise
reste responsable de ces risques, malgré le versement des cotisations. Le régime est comptabilisé par
l’entreprise en tant que régime à prestations définies. Les cotisations sont comptabilisées comme des flux de
trésorerie d’un régime à prestations définies. Les sommes versées à la compagnie d’assurance peuvent, en
général, être considérées comme des actifs du régime.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 2/24
AVANTAGES A COURT TERME
Evaluation et comptabilisation des avantages à court terme
Comptabilisation immédiate et évaluation sur une base non actualisée (hypothèse actuarielle non
nécessaire, d’où pas d’écart actuariel).
Comptabilisation du montant au titre des obligations
− en charges sauf si une autre norme IFRS impose ou autorise l’incorporation de ces avantages
dans le coût d'un actif (exemple IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles)
− au passif
Après déduction d’éventuels montants déjà payé Charges à payer
Si montants payés > Valeur non actualisée Charges constatées d’avance si le
des obligations paiement d’avance aboutira par exemple à :
- une réduction des paiements futurs,
- un remboursement en trésorerie.
Deux catégories de droits à absences rémunérées à court terme : les droits
cumulables, les droits non cumulables
Absences rémunérées cumulables Absences rémunérées non cumulables
Utilisation des droits - Peuvent être utilisés lors des - Droits non reportables d’une période à une
exercices futurs si les droits de autre,
l’exercice ne sont pas intégralement - Droits perdus si non utilisés.
utilisés.
- Peuvent générer :
- des droits acquis (payables lors
d’un départ de la société),
- ou ne pas en générer (non
payables lors d’un départ de la
société).
Comptabilisation Lorsque les membres du personnel Lorsque les absences se produisent.
- en charges rendent des services qui augmentent
- au passif leurs droits à des absences rémunérées
futures.
Evaluation A hauteur du montant supplémentaire à A hauteur des absences constatées.
payer du fait du cumul des droits non
utilisés à la date de clôture.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 3/24
Evaluation et comptabilisation des obligations relatives aux plans d’intéressement et
primes
Comptabilisation du coût attendu des paiements si
− l'entreprise a une obligation actuelle, juridique ou implicite, d'effectuer ces paiements au titre
d'événements passés, et
− une estimation fiable de l'obligation peut être effectuée.
Une obligation actuelle existe si et seulement si l'entreprise n'a pas d’autre solution réaliste que de payer.
Evaluation d’une obligation juridique ou implicite en vertu d’un plan d’intéressement ou de primes est fiable
si
− les termes formels du plan contiennent une formule de calcul du montant de l’avantage,
− ou l’entreprise calcule les montants avant l’approbation des comptes,
− ou encore les pratiques passées fournissent une preuve claire du montant de l’obligation implicite
de l’entreprise.
Informations à fournir
La norme IAS 19 n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les avantages à court terme.
Toutefois, d’autres normes IFRS peuvent imposer la présentation de certaines informations. Par exemple, la
norme IAS 24 Information relative aux parties liées requiert de fournir des informations sur les avantages
accordés aux principaux dirigeants. La norme IAS 1 Présentation des états financiers requiert d’indiquer en
annexe le montant total des avantages du personnel passés en charges de l’exercice.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 4/24
AVANTAGES POSTERIEURS A L’EMPLOI – REGIMES A COTISATIONS DEFINIES
Caractéristiques des régimes à cotisations définies
Analyse de la réalité économique du régime qui ressort de ses principaux termes et conditions
conclus avec l’entité collectrice de fonds.
Dans les régimes à cotisations définies :
l'obligation juridique ou implicite de l'entreprise se limite au montant qu'elle s'engage à payer au
fonds,
le montant des avantages postérieurs à l'emploi versés aux membres du personnel est déterminé par
le montant des cotisations et par le rendement des placements effectués avec ces cotisations.
Le risque actuariel et le risque de placement incombent au membre du personnel. Les prestations
d’avantages postérieurs à l’emploi peuvent être inférieures à celles prévues initialement.
Evaluation et comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi à cotisations
définies
Evaluation des obligations Montant des cotisations non actualisé sauf si elles sont
exigibles plus de douze mois après la fin de l’exercice au cours
duquel les services correspondants sont effectués par les
membres du personnel.
Comptabilisation durant l’exercice au cours duquel les services sont rendus par le personnel
− en charges sauf si une autre norme impose ou autorise l’incorporation des avantages dans le coût
d'un actif (IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles)
− au passif
Après déduction d’éventuels montants déjà payés Charges à payer
Si montants payés > cotisations dues au titre Charges constatées d’avance si le
des services rendus par paiement d’avance aboutit à :
le personnel - une réduction des paiements futurs,
-un remboursement en trésorerie.
Informations à fournir
La norme IAS 19 requiert d’indiquer en annexe le montant des cotisations comptabilisées en charges pour les
régimes à cotisations définies.
Par ailleurs, la norme IAS 24 Informations relatives aux parties liées requiert des informations sur les charges au
titre des régimes à cotisations définies dont bénéficient les principaux dirigeants.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 5/24
AVANTAGES POSTERIEURS A L’EMPLOI – PRESTATIONS DEFINIES
Caractéristiques des régimes à prestations définies
Obligation de payer les prestations convenues aux membres de son personnel en activité et /ou anciens
membres de son personnel qui sont à la retraite.
Le risque actuariel et le risque de placement incombent à la société.
L’obligation de la société est majorée, si les prestations coûtent plus chères que prévu ou si le rendement
des actifs est inférieur aux prévisions.
Evaluation de la valeur actuelle de l’obligation dans les régimes à prestations définies –
Méthode rétrospective
Valeur actuelle de Montant des droits Probabilité qu’a Facteur
l'obligation accumulés par le l’entreprise de verser d’actualisation
(E)
= personnel
x ces droits
x (A)
(Engagement brut) (D) (P)
Quantité de Salaire de fin de Probabilité Probabilité
droits carrière d’être en vie d’être présent
accumulés à la (S’) (PM) dans
date de clôture n l’entreprise
S’ = S x (1+t)
(Q) (PR)
A l’âge de départ à la retraite
Principe de comptabilisation de la charge au compte de résultat
Coûts des services rendus au cours de l'exercice
Charge au compte de résultat
Coût financier
+
Rendement attendu des actifs du régime et de tous les droits aux
- remboursements
Ecarts actuariels (si comptabilisés en produits ou en charges)
+/-
Coût des services passés
+/-
Effet de toute réduction ou liquidation de régime
-
Total de la charge à constater au compte de résultat à moins qu’une autre norme impose de comptabiliser
certains coûts relatifs aux avantages du personnel dans les coûts d’actifs (IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations
corporelles).
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 6/24
Coût des services rendus : désigne l’accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des
prestations définies résultant des services rendus au cours de l’exercice.
Coût financier : désigne l’accroissement au cours d’un exercice de la valeur actuelle de l’obligation au titre
des prestations définies résultant du fait que l’on s’est rapproché d’un exercice de la date de règlement des
prestations.
Rendement des actifs du régime : désigne les intérêts, dividendes, et autres produits tirés des dits actifs
ainsi que les profits ou pertes réalisés ou latents relatifs à ces actifs, après déduction des coûts
d’administration du régime et de l’impôt à payer par le régime.
Ecarts actuariels : incluent les ajustements liés à l’expérience (effets des différences entre les hypothèses
actuarielles antérieures et ce qui s’est effectivement produit) et les effets des changements d’hypothèses
actuarielles.
Coût des services passés : désigne l’accroissement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des
prestations définies pour les services rendus au cours d’exercices antérieurs, résultant de l’introduction d’un
nouveau régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou de changements apportés au cours de l’exercice à un
tel régime (positif, si de nouveaux avantages sont introduits ou des avantages existants améliorés, négatif si
des avantages existants sont réduits).
Effets de toute réduction ou liquidation de régime : sont des profits ou des pertes enregistrés au titre de
la réduction ou de la liquidation d’un régime à prestations définies au moment où se produit la réduction ou
la liquidation (changements de la valeur actuelle de l’obligation, changements de la juste valeur des actifs
du régime en résultant, et tous les écarts actuariels correspondants ou coûts des services passés non
comptabilisés antérieurement).
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 7/24
Principe de comptabilisation au bilan des avantages postérieurs à l’emploi
Montant comptabilisé au passif au titre Valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations
de prestations définies définies à la clôture
Profits ou pertes actuarielles non comptabilisés
+/-
Coût des services passés non encore comptabilisé
-
Juste valeur à la date de clôture des actifs du régime
-
Schéma d’enregistrement comptable des opérations relatives au régime à prestations définies avec
cotisations à un fonds qui remplit la définition d’un actif du régime :
Comptabilisation de la charge au compte de résultat et au passif du bilan
DÉBIT CRÉDIT
Charge de retraite (compte de résultat) X
Provisions X
Comptabilisation du flux de trésorerie relatif aux cotisations versées au fonds gérant les actifs de régime
DÉBIT CRÉDIT
Charges constatées d’avance y
Banque y
Compensation au 31/12/N au bilan du cumul des cotisations versées durant la période diminuant la
provision
DÉBIT CRÉDIT
Provisions z
Charges constatées d’avance z
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 8/24
PRESTATIONS DEFINIES – VALEUR ACTUELLE DE L’OBLIGATION : COÛT DES
PRESTATIONS DES SERVICES RENDUS AU COURS DE L’EXERCICE ET COÛT
FINANCIER
Valeur actuelle de l’obligation au titre des régimes à prestations définies
Evaluation de la valeur actuelle de l'obligation au titre des avantages postérieurs à l'emploi et du coût des
services rendus au cours de l'exercice : 3 étapes
appliquer une méthode d'évaluation actuarielle,
attribuer les droits à prestations aux périodes de service, et
déterminer des hypothèses actuarielles.
Valeur actuelle de l’obligation au titre de prestations définies : désigne la valeur actualisée, avant déduction
des actifs du régime, des paiements futurs attendus qui sont nécessaires pour éteindre l'obligation résultant des
services rendus au cours de l’exercice et des exercices antérieurs.
Détermination de la valeur actuelle de l’obligation – Méthode des unités de crédit
projetées
Utilisation de la méthode des unités de crédit projetées
Chaque période de service donne lieu à une supplémentaire de droits à prestations.
Evaluation séparément de chacune de ces unités pour obtenir l’obligation finale.
Principe d’attribution des droits à prestations aux périodes de service
La méthode des unités de crédit projetées impose qu’une société affecte les droits à prestations à l’exercice en
cours pour déterminer le coût des services rendus au cours de l’exercice, et à l’exercice et aux exercices
antérieurs pour déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies.
Coût des services rendus :
- nbre d’années jusqu’à la date de la retraite
= droits accumulés au cours de l’exercice x (1 + taux actualisation)
Coût financier :
= valeur actuelle de l'obligation au titre des années antérieures x taux actualisation
Attribution des droits aux prestations aux exercices dans le cas de régimes à prestations définies
incluant des droits à prestations conditionnées par un emploi futur
− Cas de régime à prestations définies incluant des droits à prestations conditionnées par un emploi
futur :
• les années de service antérieures à la date d’acquisition génèrent une obligation implicite.
En effet, à chaque clôture successive, le nombre d’années de service futur qu’un membre
du personnel devra effectuer avant d’avoir droit aux prestations diminue.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 9/24
• évaluation de l’obligation au titre des prestations en tenant compte de la probabilité qu’un
certain nombre de personnes ne remplissent pas les conditions requises pour l’acquisition
des droits.
− Régimes postérieurs à l’emploi avec prestations dues lors de la survenance d’événements
spécifiés : il convient de tenir compte de la probabilité de survenance de ces événements pour
l’évaluation de l’obligation de la société (exemple : assistance médicale postérieure à l’emploi).
Principes d’attribution des droits à prestations aux périodes de service
− Principe général :
Attribution des droits à prestations aux périodes de service en fonction de la formule de calcul des
prestations établie par le régime.
− Si les services rendus au cours d'exercices ultérieurs aboutissent à un niveau de droits à
prestations > de façon significative à celui des exercices antérieurs
Affectation des droits à prestations sur une base linéaire.
• Date de départ de l’étalement linéaire : date à laquelle les services rendus par le
membre du personnel ont commencé à générer des droits à prestations en vertu du
régime, que ceux-ci soient ou non conditionnés par des services ultérieurs.
• Date de fin de l’étalement linéaire : date à laquelle les services rendus par le membre
du personnel ne généreront pas un montant significatif de droits à prestations
supplémentaires en vertu du régime.
Ces principes sont applicables à l’attribution des droits à prestations au coût des services rendus et au coût
des services passés le cas échéant.
Attribution des droits à prestations définies en pourcentage du salaire de fin de carrière aux
périodes de service
Le montant du droit à prestations affecté à chaque exercice représente une proportion constante du salaire
auquel est liée la prestation.
Dans ce cas, les augmentations de salaire futures auront un impact sur le montant requis pour éteindre
l’obligation au titre des services rendus avant la date de clôture, mais ne généreront pas une obligation
supplémentaire.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 10/24
PRESTATIONS DEFINIES – HYPOTHESES ACTUARIELLES
Définition
Hypothèses actuarielles Meilleures estimations faites par l’entreprise des variables qui
détermineront le coût final des avantages postérieurs à l’emploi.
Catégories d’hypothèses actuarielles : hypothèses démographiques et financières
Des hypothèses démographiques
− relatives aux caractéristiques futures du personnel retraité et actif, et des personnes à leur charge
réunissant les conditions requises pour bénéficier des avantages.
Elles portent sur :
− la mortalité, pendant et après l'emploi,
− la rotation du personnel, l'incapacité et le départ en retraite anticipée,
− la proportion des membres affiliés au régime et des personnes à leur charge réunissant les
conditions requises pour avoir droit aux prestations,
− les taux de demandes d'indemnisation en vertu des régimes médicaux.
Des hypothèses financières
Elles portent sur les éléments suivants :
− le taux d'actualisation,
− les niveaux futurs des salaires et des avantages du personnel,
− dans le cas de prestations médicales, les coûts médicaux futurs et notamment, s'ils sont
importants, le coût d'administration des demandes et du versement des prestations, et
− le taux de rendement attendu des actifs du régime et des droits à remboursement.
L’évaluation de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l'emploi est à réaliser sur une base
reflétant les variations telles que les augmentations de salaires futures, en tenant compte de l'inflation,
l’ancienneté, la promotion et de divers autres facteurs comme l'offre et la demande sur le marché de
l'emploi.
Par ailleurs, il est tenu compte des changements futurs estimés du niveau des prestations payées au titre
des régimes généraux et obligatoires affectant les prestations à payer au titre d'un régime à prestations
définies si ces changements ont été adoptés avant la date de clôture ou si l’expérience passée et d’autres
indications fiables démontrent une évolution prévisible.
Lorsque les avantages postérieurs à l’emploi concernent des coûts médicaux, il convient de tenir compte,
pour l’évaluation du coût des services médicaux, de la probabilité d’avoir recours à l’assistance médicale
multipliée par le coût de satisfaction de ces demandes.
Caractéristiques
Les hypothèses actuarielles doivent être objectives (ni imprudentes, ni d’une prudence excessive) et
mutuellement compatibles (traduisent les rapports économiques existant entre certains facteurs tels que
l'inflation, les taux d'augmentation des salaires, le rendement des actifs du régime, et les taux d'actualisation).
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 11/24
Hypothèses actuarielles – Taux d’actualisation
Taux d’actualisation Taux à la clôture des obligations d’entreprises de première
catégorie, ou, dans les pays où ce type de marché n'est pas actif,
le taux à la clôture des obligations d'Etat
La monnaie et la durée des obligations doivent être cohérentes avec la monnaie et la durée estimée des
obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi.
Le taux d'actualisation :
− reflète le calendrier estimé de versement des prestations,
− traduit la valeur temps de l'argent mais il ne traduit ni le risque actuariel ni le risque de placement. Ce taux
d'actualisation ne traduit pas le risque de crédit spécifique à l'entreprise auquel s'exposent ses créanciers ; il
ne traduit pas non plus le risque d’écarts entre les réalisations futures et les hypothèses actuarielles.
Définition des écarts actuariels
Ils incluent :
les effets des changements des hypothèses actuarielles,
et
les ajustements liés à l’expérience (effets des différences entre les hypothèses actuarielles antérieures et
ce qui s’est effectivement produit).
Principes de comptabilisation des écarts actuariels
La norme IAS 19 propose les approches suivantes pour la comptabilisation des écarts actuariels :
La comptabilisation (en produits ou en charges), en utilisant l’approche du corridor, d’une fraction
minimale, ou selon toute autre méthode conduisant à la constatation plus rapide des écarts actuariels en
résultat que cette fraction minimale.
La comptabilisation en capitaux propres, si l’entreprise décide de reconnaître ses écarts actuariels
immédiatement et en totalité l’année où ils sont générés, alors elle a la possibilité de les comptabiliser
directement par capitaux propres plutôt que par le résultat.
Quelle que soit la méthode retenue pour la comptabilisation des écarts actuariels, elle doit être appliquée à
l’ensemble des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 12/24
Comptabilisation en charges ou en produits d’une fraction minimale des écarts actuariels
− Principe du corridor
Ecarts actuariels à l’extérieur Ecarts actuariels dans le corridor Ecarts actuariels à l’extérieur
du corridor Pas d’obligation de du corridor
Comptabilisation d’une comptabilisation en produits Comptabilisation d’une
fraction en produits ou en ou en charges fraction en produits ou
charges en charges
Comptabilisation obligatoire d’une fraction des écarts actuariels en produits ou en charges
si les écarts actuariels cumulés non comptabilisés à la fin de l’exercice précédent (N-1)
excèdent la plus grande des deux valeurs suivantes (limites du corridor) :
10 % de la valeur actuelle de 10 % de la juste valeur des
l’obligation actifs du régime
au titre des prestations définies à à la date de clôture N-1
la date de clôture N-1 avant
déduction des actifs du régime
Option pour la comptabilisation en capitaux propres de la totalité des écarts actuariels
− Totalité des écarts actuariels − Comptabilisation immédiate en capitaux propres,
en résultats accumulés non distribués, au cours
de la période durant laquelle ils sont générés.
− Pas d’étalement de la comptabilisation des écarts
actuariels,
− Pas de comptabilisation ultérieure au compte de
résultat.
− Conditions d’application :
• application de cette méthode à l’ensemble des écarts actuariels et aux ajustements
provenant du plafonnement des actifs nets relatifs aux régimes sur-financés (se référer au
cas particulier de ce module de formation),
• de façon permanente d’un exercice à l’autre,
• sans possibilité d’utiliser l’approche du corridor,
• même méthode pour l’ensemble des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi
prestations définies.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 13/24
Comptabilisation des écarts actuariels générés par la différence entre le rendement
attendu et le rendement effectif des actifs du régime ou des droits à remboursement
Différence entre rendement attendu et Même principe de comptabilisation que
rendement effectif des actifs du régime / l’ensemble des écarts actuariels :
droits à remboursement
− comptabilisation en résultat d’une fraction des
écarts actuariels cumulés selon l’approche du
corridor (comptabilisation du minimum requis
selon la norme IAS 19) ou selon une méthode
plus rapide,
− comptabilisation de la totalité en capitaux
propres.
PRESTATIONS DEFINIES – ACTIFS DU REGIME
Comptabilisation de la juste valeur des actifs du régime en diminution du passif au titre
du régime à prestations définies correspondant
Les actifs du régime sont à déduire du passif enregistré au bilan au titre du régime à prestations définies
correspondant. En principe, les actifs du régime sont à déduire pour leur juste valeur, c’est-à-dire leur valeur de
marché.
Si valeur de marché disponible Evaluation à la juste valeur (valeur de marché).
Si valeur de marché non disponible Estimation de la juste valeur.
Lorsque les actifs du régime incluent des polices d’assurance éligibles correspondant exactement, par leurs
montants et leurs échéances, à tout ou partie des prestations payables en vertu du régime, la juste valeur
des polices d’assurances est égale au montant de la valeur actuelle de l’obligation correspondante.
Si les actifs du régime sont gérés par un fonds, il convient de déduire :
− les éventuelles cotisations impayées par l’entreprise,
− les instruments financiers non cessibles émis par l’entreprise et détenus par le fonds,
− les passifs du fonds ne se rapportant pas aux avantages du personnel tels que les dettes
fournisseurs, les autres créances et les passifs provenant d’instruments financiers dérivés.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 14/24
Comptabilisation du rendement attendu des actifs du régime en diminution de la charge
d’un régime à prestations définies
Le rendement des actifs du régime désigne :
− les intérêts, les dividendes et autres produits tirés des dits actifs,
− les profits ou les pertes réalisés ou latents relatifs à ces actifs,
− après déduction des coûts d’administration du régime et de l’impôt à payer par le régime.
Rendement attendu des actifs du régime A comptabiliser au compte de résultat en
diminution de la charge du régime à prestations
définies.
Différence entre rendement attendu et Même principe de comptabilisation que
l’ensemble des écarts actuariels :
rendement effectif des actifs du régime
− comptabilisation au compte de résultat d’une
fraction de tous les écarts actuariels selon
l’approche du corridor ou selon toute autre
méthode plus rapide,
− comptabilisation en capitaux propres de la
totalité des écarts actuariels.
Comptabilisation à l’actif du bilan des droits à remboursement
Ces droits à remboursement ne sont comptabilisés en tant qu’actifs distincts que si et seulement si il est
quasiment certain que cette autre partie remboursera soit en partie, soit en totalité, les dépenses
nécessaires au règlement d’une obligation de prestation définie. Dans tous les autres cas, un traitement
similaire à celui des actifs du régime doit être appliquée aux droits à remboursement.
Comptabilisation des droits de A l’actif à leur juste valeur (pas en tant que
remboursement (ne constituant pas des diminution des passifs au titre des prestations
actifs du régime) définies).
Comptabilisation du rendement En diminution de la charge totale du régime à
attendu sur les droits à remboursement prestations définies au compte de résultat.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 15/24
PRESTATIONS DEFINIES – COUTS DES SERVICES PASSES
Principe de comptabilisation
En charges et étalement selon un mode linéaire sur la durée moyenne restant à courir jusqu’à ce que
les droits correspondants soient acquis au personnel.
Ce plan d’étalement des coûts des services passés ne peut pas être modifié ultérieurement, sauf en cas de
réduction ou de liquidation de régime.
Si les droits à prestations sont déjà acquis lors de l'adoption du régime à prestations définies ou de sa
modification, l'entreprise doit comptabiliser immédiatement le coût des services passés.
Modifications de la valeur actuelle de l’obligation exclues du coût des services passés
Les variations des hypothèses actuarielles
Les estimations des améliorations des prestations issues de profits actuariels
L’accroissement des avantages acquis en l’absence de nouvelles ou meilleures prestations
L’effet de modifications apportées au régime constituant une réduction du régime
PRESTATIONS DEFINIES – REDUCTIONS ET LIQUIDATIONS
Définition d’une réduction ou d’une liquidation d’un régime d’avantages postérieurs à
l’emploi à prestations définies
Une réduction intervient dans deux situations :
soit l’entité peut démontrer qu’elle s’est engagée à réduire de façon significative le nombre de personnes
bénéficiant d’un régime,
soit l’entité change les termes d’un régime à prestations définies de sorte qu’une partie significative des
services futurs des membres du personnel actuels ne leur donnera plus de droits à prestations ou ne leur
donnera que des droits réduits.
Il y a liquidation lorsqu’une entreprise conclut une transaction éliminant toute obligation juridique ou implicite
ultérieure pour tout ou une partie des prestations prévues par un régime à prestations définies.
Principe de comptabilisation
Comptabilisation des profits ou pertes Au moment où se produit la réduction ou la
enregistrés au titre de la réduction ou de la liquidation.
liquidation
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 16/24
Eléments constitutifs du profit ou de la perte résultant de la réduction ou de la
liquidation
tout changement de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies en résultant,
tout changement de la juste valeur des actifs du régime en résultant,
tout écart actuariel correspondant non comptabilisé antérieurement,
et tout coût des services passés correspondant non comptabilisé antérieurement.
Lorsque la réduction concerne uniquement certains membres du personnel bénéficiaires du régime ou
lorsqu’une partie seulement d’une obligation est éteinte, un prorata des écarts actuariels et du coût des services
passés non comptabilisés est à inclure dans le profit ou la perte de réduction du régime. Ce prorata est
déterminé sur la base de la valeur actuelle de l’obligation avant et après la réduction ou la liquidation, à moins
qu’une autre base ne soit plus rationnelle.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 17/24
PRESENTATION DANS LES ETATS FINANCIERS INFORMATIONS A FOURNIR EN
ANNEXE SUR LES REGIMES D’AVANTAGES POSTERIEURS A L’EMPLOI A
PRESTATIONS DEFINIES
Principe de comptabilisation
Compensation obligatoire d’un actif lié à un régime et un passif lié à un autre régime si et seulement si :
l’entité détient un droit juridiquement exécutoire d’utiliser l'excédent d'un régime pour éteindre les
obligations d'un autre régime,
elle a l’intention d’éteindre les obligations sur une base nette ou de réaliser l'excédent dégagé sur un
régime et d’éteindre simultanément son obligation en vertu de l’autre régime.
Présentation au bilan et au compte de résultat
Distinction entre actifs et passifs courants et non courants
Aucune précision sur la nécessité de distinguer la partie courante et la partie non courante des actifs et des
passifs résultant des avantages postérieurs à l'emploi.
Présentation au compte de résultat des composantes de la charge/produit
Aucune précision sur la nécessité de constater au compte de résultat le coût des services rendus au cours
de l’exercice, le coût financier, et le rendement attendu des actifs comme des composantes d’un même
élément de produit ou de charge dans le compte de résultat.
Informations à fournir en annexe sur les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à
prestations définies
Les informations suivantes sont à fournir en annexe (liste non exhaustive) :
Réconciliation de la valeur actuelle de l’obligation au titre des régimes à prestations définies entre
l’ouverture et la clôture de l’exercice,
Réconciliation de la juste valeur des actifs du régime et des droits à remboursement enregistrés en tant
qu’actif entre l’ouverture et la clôture de l’exercice,
Réconciliation de la valeur actuelle de l’obligation et de la juste valeur des actifs du régime et des droits à
remboursement enregistrés en tant qu’actif avec les actifs et passifs comptabilisés au bilan,
Informations relatives à la charge totale comptabilisée au compte de résultat,
Montants comptabilisés en capitaux propres relatifs aux écarts actuariels de la période et cumulés au titre
des périodes antérieures, et à l’impact du plafonnement des actifs dans le cas de sur-financement du
régime, lorsque l’entité a opté pour l’option de comptabilisation des écarts actuariels directement en
capitaux propres,
Informations relatives à la sensibilité des coûts des régimes médicaux,
Informations au titre de l’exercice et des quatre années précédentes.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 18/24
AUTRES AVANTAGES A LONG TERME
Principe de comptabilisation et d’évaluation
Comptabilisation et évaluation des Similaires aux avantages postérieurs à l’emploi
autres avantages à long terme
Seule différence : écarts actuariels et coût des
services passés comptabilisés immédiatement
au compte de résultat
Les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement en résultat sans appliquer l’approche du corridor et
sans aucun étalement.
L’ensemble du coût des services passés est comptabilisé immédiatement au compte de résultat.
Comptabilisation au compte de résultat et au bilan
Comptabilisation au compte de résultat
Sauf si une autre norme impose ou autorise leur incorporation dans le coût d’un actif, une entité doit
comptabiliser en charges ou en produits :
− le coût des services rendus au cours de l’exercice,
− le coût financier,
− le rendement attendu des actifs du régime et de tout droit à remboursement comptabilisé en tant
qu’actif,
− les écarts actuariels qui doivent être comptabilisés immédiatement et en totalité,
− le coût des services passés, qui doit être comptabilisé immédiatement et en totalité,
− l’effet de toute réduction ou liquidation.
Comptabilisation au bilan
Le montant comptabilisé au passif est égal :
− à la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies à la date de clôture,
− diminuée, le cas échéant, de la juste valeur à la date de clôture des actifs du régime utilisés
directement pour régler l’obligation.
Cas particulier d’autres avantages à long terme : les incapacités longue durée
Si le niveau de l’indemnité dépend de la durée du service, une obligation est générée lorsque le service est
rendu. L’évaluation de cette obligation reflète la probabilité qu’un règlement sera effectué, et ce, sur une certaine
durée.
Si le niveau de l’indemnité est le même pour tous les membres du personnel frappés d’incapacité quelle que soit
la durée de leur service, le coût attendu de cet avantage est comptabilisé lorsque l’événement à l’origine de
l’incapacité à long terme se produit.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 19/24
Informations à fournir
La norme IAS 19 n'impose pas de fournir des informations spécifiques sur les autres avantages à long terme.
Cependant d’autres normes peuvent imposer que l’entité fournisse des informations sur ces avantages.
INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL
Fait générateur de comptabilisation des indemnités de fin de contrat de travail
Comptabilisation des indemnités de fin de contrat de travail, au passif et en charges, si et seulement
si une entité est manifestement engagée :
− soit à mettre fin au contrat de travail d'un ou de plusieurs membres du personnel avant l'âge
normal de leur départ à la retraite
Nécessité de l’existence d’un plan formalisé et détaillé de licenciement sans possibilité réelle de
rétractation et mentionnant au minimum :
• l’implantation, la fonction et le nombre approximatif de personnes pour lesquelles il doit
être mis fin au contrat de travail,
• les indemnités de fin de contrat de travail prévues pour chaque fonction ou classification
professionnelle,
• la date à laquelle le plan sera mis en œuvre. La mise en œuvre doit débuter dès que
possible et sa durée doit être telle que des changements importants du plan ne soient pas
probables.
− soit à accorder des indemnités de fin de contrat de travail suite à une offre faite pour encourager
les départs volontaires.
Evaluation
Lorsque les indemnités de fin de contrat de travail si Actualisation à la date de clôture
exigibles > 12 mois après la date de clôture
Taux d’actualisation : déterminé par référence à un taux de marché à la date de clôture fondé sur les
obligations d’entreprises de première catégorie.
Dans les pays où ce type de marché n’existe pas : prendre le taux des obligations d’Etat.
La monnaie et l’échéance doivent être cohérentes avec la monnaie et l’échéance de paiement des
indemnités de fin de contrat du travail.
Lorsque les indemnités de fin de contrat résultent d’une offre faite pour encourager les départs
volontaires, l’évaluation des indemnités doit tenir compte du nombre attendu de personnes qui accepteront
l’offre.
Cas particulier – distinction entre avantages postérieurs à l’emploi et indemnités de fin de contrat de
travail
Certaines prestations sont à payer quelle que soit la raison du départ de l’employé, leur paiement est
certain, sous réserves d’éventuelles conditions d’acquisition des droits ou de service minimum, mais la date
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 20/24
de leur paiement est incertaine.
Du fait que ces prestations sont à payer quelle que soit la raison du départ du salarié, ce sont, en
substance, des prestations postérieures à l’emploi et non des indemnités de fin de contrat de travail.
Cependant, en cas de rupture involontaire par le salarié de son contrat de travail, si le montant des
prestations payées par l’entreprise est plus élevé que dans le cas d’une résiliation à l’initiative du salarié,
alors :
− le montant équivalent à l’indemnité à payer en cas de départ volontaire est, en substance, un
avantage post-emploi,
− l’indemnité complémentaire payée du fait de la résiliation non volontaire est une indemnité de fin de
contrat de travail.
Informations à fournir
La norme IAS 19 n’impose pas d’information spécifique sur les indemnités de fin de contrat de travail. Toutefois,
d’autres normes peuvent requérir des informations sur les indemnités de fin de contrat de travail.
Par exemple, la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, requiert des informations sur
les passifs éventuels à moins que l’éventualité de la perte soit peu probable. Ainsi, il pourrait être approprié de
donner des explications lorsqu’il y a des incertitudes sur le nombre de personnes qui accepteront une offre
d’indemnités de fin de contrat de travail.
La norme IAS 1 Présentation des états financiers requiert des informations si la charge comptabilisée au titre
des indemnités de fin de contrat est significative. De même, la norme IAS 24 Information relative aux parties
liées, impose de fournir des informations sur les indemnités de fin de contrat dues aux principaux dirigeants.
REGIMES SUR-FINANCES – ACTIF PLAFONNE
Principes de comptabilisation
Situation
Un actif peut être généré
− lorsqu'un régime à prestations définies a été sur-financé,
− ou, lorsque des gains actuariels sont comptabilisés.
Rappel du montant comptabilisé au passif :
P = + Valeur actuelle de l'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture,
+ Profits actuariels ou - des pertes actuarielles non comptabilisés,
- Coût des services passés non encore comptabilisés,
- Juste valeur à la date de clôture des actifs du régime (s’ils existent) utilisés directement pour
éteindre les obligations.
Lorsque P est négatif Reconnaissance possible d’un actif si :
− existence d’une ressource contrôlée = capacité à utiliser l’excédent pour générer des avantages
futurs,
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 21/24
− contrôle résulte d’événements passés = cotisations versées par l’entreprise et services rendus par
le personnel,
− avantages économiques futurs attendus sous la forme d’une diminution de ses cotisations futures
ou d’un remboursement, soit directement soit indirectement par affectation à un régime en déficit.
Plafond de l’actif
Actif à comptabiliser = Montant le plus faible entre
P Somme de
(1) (2)
− Pertes actuarielles nettes Valeur actualisée de tout
cumulées non + avantage économique sous
comptabilisées forme de remboursements du
régime ou de diminutions des
− et du coût des services
cotisations futures au régime.
passés non comptabilisé
Limitations à la comptabilisation d’un actif d’un régime à prestations définies
Interdiction de :
comptabiliser un profit résultant uniquement d’une perte actuarielle ou des coûts de services
passés au cours de l’exercice, ou
comptabiliser une perte résultant uniquement d’un profit actuariel au cours de l’exercice.
Si l’actif comptabilisé résulte de la somme suivante, donc du plafonnement de l’actif :
(1) (2)
− Pertes actuarielles nettes cumulées Valeur actualisée de tout avantage
économique sous forme de
non comptabilisées +
remboursements du régime ou de
− et du coût des services passés non diminutions des cotisations futures au
comptabilisé régime.
Alors comptabilisation immédiate au compte de résultat :
la partie des pertes actuarielles nettes de l’exercice en cours et du coût des services passés de l’exercice en
cours excédant la réduction de la valeur actualisée des avantages économiques (2),
la totalité des pertes actuarielles nettes de l’exercice en cours et du coût des services passés pour l’exercice
en cours, si la valeur actuelle des avantages économiques augmente ou si elle reste inchangée.
la partie des profits actuariels nets de l’exercice en cours après déduction du coût des services passés de
l’exercice en cours excédant l’augmentation de la valeur actualisée des avantages économiques (2).
la totalité des profits actuariels de l’exercice en cours et du coût des services passés pour l’exercice en
cours, si la valeur actuelle des avantages économiques diminue ou si elle reste inchangée.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 22/24
REGIMES MULTI-EMPLOYEURS
Caractéristiques
Les régimes multi-employeurs sont des régimes autres que les régimes généraux et obligatoires qui sont
soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies, et qui :
− mettent en commun les actifs apportés par différentes entreprises qui ne sont pas sous contrôle
commun,
et
− utilisent ces actifs pour accorder des avantages au personnel de plusieurs entreprises avec des
niveaux de cotisations et d’avantages calculés sans tenir compte de l'identité de l'entreprise qui
emploie les membres du personnel en question.
Classement et comptabilisation d’un régime multi-employeurs
Classement des régimes multi-employeurs en tenant compte des obligations juridiques et implicites
en :
Régime à cotisations définies Régime à prestations définies
Non
Comptabilisation comme s’il s’agissait Informations suffisantes disponibles sur
le régime ou sur la part de l’entité dans
d’un régime à cotisations définies.
le régime ?
S’il existe un accord entre le régime
multi-employeurs et les participants au
régime déterminant comment l’excédent
ou le déficit éventuel du régime sera
affecté aux participants Comptabilisation comme un régime à
prestations définies pour la part de
Comptabilisation actif/ passif et l'obligation au titre des prestations
produit/charge définies, des actifs du régime et des
coûts associés au régime.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 23/24
Informations à communiquer en annexe sur les régimes multi-employeurs
Régimes multi-employeurs à prestations définies
Informations en annexe identiques aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies.
(se référer à la partie Présentation au bilan du présent module)
Régime multi-employeurs à prestations définies comptabilisés comme un régime à cotisations
définies
Indication en annexe :
− qu’il s’agit d’un régime à prestations définies,
− la raison de l’absence d'informations suffisantes pour le comptabiliser comme un régime à
prestations définies,
− si un excédent ou un déficit du régime peut affecter le montant des cotisations futures, indiquer :
• toute information existante sur l’excédent ou le déficit,
• la base ayant servi à déterminer le montant de l'excédent ou du déficit, et
• les conséquences éventuelles pour l'entreprise.
Informations sur les passifs éventuels
(selon la norme IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels)
REGIMES GROUPE
Evaluation et comptabilisation des régimes à prestations définies dont les risques sont
partagés entre différentes entités sous contrôle commun
Ne sont pas des régimes multi-employeurs.
Evaluation
Evaluation du régime sur la base des hypothèses applicables au régime dans son ensemble.
Comptabilisation
Comptabilisation des régimes dans les comptes individuels des entités sous contrôle commun.
− Si contrat ou politique de répartition − Affectation des montants du régime
prévoyant la répartition du coût net du aux entités selon ce contrat ou cette
régime à prestations définies entre les politique.
entités
− En l’absence de contrat ou de politique de − Montants relatifs au régime affectés à
répartition l’entité gestionnaire du régime.
− Les autres entités du groupe
comptabilisent un coût égal à la
cotisation facturée pour la période par
cette entité gestionnaire du régime.
© Éd. Francis Lefebvre / PricewaterhouseCoopers 24/24
Vous aimerez peut-être aussi
- Annexe 2 Rapport Amazon France Logistique PS 2019Document170 pagesAnnexe 2 Rapport Amazon France Logistique PS 2019L DVH100% (2)
- Bulletin de SalaireDocument1 pageBulletin de Salairetabit100% (1)
- La Motivation Du Personnel Et Son Impact Sur La PerformanceDocument29 pagesLa Motivation Du Personnel Et Son Impact Sur La PerformanceMohamed Alaoui100% (6)
- Ias 37 PDFDocument13 pagesIas 37 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 36 PDFDocument18 pagesIas 36 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 19 PDFDocument24 pagesIas 19 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Bonnes Pratiques Manageriales 2018Document66 pagesBonnes Pratiques Manageriales 2018ArmandBobiPas encore d'évaluation
- Ifrs 2 PDFDocument19 pagesIfrs 2 PDFnawal100% (1)
- Ias 39 PDFDocument28 pagesIas 39 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ifrs 5 PDFDocument9 pagesIfrs 5 PDFnawalPas encore d'évaluation
- IAS 38 IMMOBILISATIONS INCORPORELLESpdf PDFDocument20 pagesIAS 38 IMMOBILISATIONS INCORPORELLESpdf PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 18 PDFDocument4 pagesIas 18 PDFnawalPas encore d'évaluation
- IAS 21 Effets Des Variations Des Cours Des DevisesDocument12 pagesIAS 21 Effets Des Variations Des Cours Des DevisesSimo Simo100% (1)
- Ias 24 - Informations - Relatives - Aux - Parties - Liees PDFDocument4 pagesIas 24 - Informations - Relatives - Aux - Parties - Liees PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 27 PDFDocument16 pagesIas 27 PDFnawalPas encore d'évaluation
- Ias 20 PDFDocument4 pagesIas 20 PDFnawalPas encore d'évaluation
- MAITRISER L'ESSENTIEL DES IAS IFRS - SALUSTRO Berkani PDFDocument108 pagesMAITRISER L'ESSENTIEL DES IAS IFRS - SALUSTRO Berkani PDFnawalPas encore d'évaluation
- Le Recrutement PDFDocument20 pagesLe Recrutement PDFGhizlane GhazalPas encore d'évaluation
- Argumenter CandidatureDocument16 pagesArgumenter CandidatureStill Bligha100% (3)
- 1270-Article Text-4461-1-10-20230502Document21 pages1270-Article Text-4461-1-10-20230502Fahd MejdoubiPas encore d'évaluation
- Livre - Blanc - Lingenieur de Demain Interdisciplinarite Numerique Et EnvironnementDocument21 pagesLivre - Blanc - Lingenieur de Demain Interdisciplinarite Numerique Et EnvironnementfeukamPas encore d'évaluation
- Etude Le Licenciement Pour Motif Economique Les Points Cles A Connaitre Pour Securiser Au Mieux L OpDocument6 pagesEtude Le Licenciement Pour Motif Economique Les Points Cles A Connaitre Pour Securiser Au Mieux L OpSarah agoPas encore d'évaluation
- Ed6018 Vibration Et Mal de DosDocument34 pagesEd6018 Vibration Et Mal de DosMichael BledPas encore d'évaluation
- Guide Admission 2016-2017Document68 pagesGuide Admission 2016-2017CegepAndreLaurendeauPas encore d'évaluation
- Préaccord 2022 - 2023 TMCVDocument2 pagesPréaccord 2022 - 2023 TMCVMaximePas encore d'évaluation
- M Hygiene Et Securite Dans Les Chantiers BTPDocument57 pagesM Hygiene Et Securite Dans Les Chantiers BTPmehdi89% (9)
- Voc Anglais 2 q1Document9 pagesVoc Anglais 2 q1helena.dethierPas encore d'évaluation
- DEESAD - Janvier 2016 - SujetDocument14 pagesDEESAD - Janvier 2016 - SujetNatacha OzannePas encore d'évaluation
- 09 A A 001Document2 pages09 A A 001MOMO25Pas encore d'évaluation
- TP2 PLSQL Avec Correction PDFDocument3 pagesTP2 PLSQL Avec Correction PDFkhalid moussaid100% (1)
- Rapport Final Cote Divoire 0Document287 pagesRapport Final Cote Divoire 0Djè Alain-CharlesPas encore d'évaluation
- Corrige Module 1 LTC Prepa 2022Document5 pagesCorrige Module 1 LTC Prepa 2022kone.zana712100% (1)
- Cours GRH 2Document23 pagesCours GRH 2ABDELMOUMENE CHAOUFIPas encore d'évaluation
- ED6231 Réussir L'acquisition D'une Machine Ou D'un Équipement de Travail PDFDocument20 pagesED6231 Réussir L'acquisition D'une Machine Ou D'un Équipement de Travail PDFAurelien100% (2)
- 1 PBDocument8 pages1 PBBouchra KtamiPas encore d'évaluation
- La Politique de RemunerationDocument12 pagesLa Politique de RemunerationAyoub BrchPas encore d'évaluation
- Pilotage SocialeDocument25 pagesPilotage Socialewiame67% (3)
- Gestion Des Ressources HumainesDocument11 pagesGestion Des Ressources HumainesmouadPas encore d'évaluation
- Tendances A2 U3 L1Document2 pagesTendances A2 U3 L1Nguyễn HoanPas encore d'évaluation
- Travail EmploiDocument24 pagesTravail EmploiYosra BaazizPas encore d'évaluation
- 2023 2 230305RM20591240001Document2 pages2023 2 230305RM20591240001soph-69Pas encore d'évaluation
- Cas Gpec 2021 PDFDocument16 pagesCas Gpec 2021 PDFZoomPas encore d'évaluation
- Sarah MémoireDocument44 pagesSarah MémoireKou KittaPas encore d'évaluation