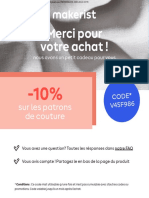Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
GARCIA, Introduction PDF
GARCIA, Introduction PDF
Transféré par
mauTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
GARCIA, Introduction PDF
GARCIA, Introduction PDF
Transféré par
mauDroits d'auteur :
Formats disponibles
INTRODUCTION
Dans la “Grande transformation” Karl Polanyi présente une analyse remarquable du caractère unique du
monde moderne ; d’après cet auteur c’est l’apparition du “système de marchés formateurs de prix”,
l’institutionnalisation du “marché autorégulateur” comme un mécanisme autonome qui impose des
contraintes spécifiques à tous les autres domaines d’activité humaine (comme le domaine religieux ou le
politique), qui caractérise le mieux la spécificité de la société contemporaine. Son travail est consacré à
étudier les origines de cette innovation institutionnelle. Polanyi signale que les marchés locaux et les marchés
de longue distance (les “marchés internationaux”) ont existé à différentes époques et dans différentes
sociétés, mais la création des marchés nationaux, corrélative de la construction des Etats libéraux, a engendré
une interdépendance entre les échanges marchands dans des lieux les plus différents et à différents moments
qui n’avait jamais été connue auparavant. C’est l’interdépendance entre les négociations réalisées dans une
multiplicité d’endroits qui fonde la conception du “marché autorégulateur” comme un système indépendant.
La création des économies nationales est ainsi un objet privilégié pour penser le travail de construction de
nouveaux liens sociaux caractéristiques de l’époque contemporaine.
La formation du Brésil est directement liée à la production de biens destinés aux marchés européens,
comme la culture de la canne à sucre depuis le XVIe siècle ; le rapport entre les marchés locaux et les
“marchés mondiaux” est constitutif de la nouvelle collectivité. Mais la construction d’une économie nationale
est bel et bien une oeuvre accomplie au XXe siècle, tout particulièrement après 1930. L’interdépendance entre
les activités économiques des différentes régions du territoire national date de l’implantation du parc
industriel dans le pays, processus qui a doté la collectivité nationale d’un dynamisme sans précédent. Une
véritable mutation s’est produite au XXe : en gros la population a été multipliée par 10 et le PIB par 100.
Entre 1930 et 1980 toutes les branches industrielles caractéristiques des pays européens et des Etats-Unis ont
été implantées et le sort de chacune est strictement lié au destin de toutes les autres ; l’Etat a joué un rôle
majeur pour assurer la coordination des investissements pour donner existence à des entreprises les plus
diverses. Les changements en profondeur ne sont pas limités au seul domaine de l’économie : la création des
universités, la construction d’un système d’enseignement unifié pour tout le pays, l’implantation du marché
éditorial, la création du système de moyens modernes de communication (radio, télévision, téléphone, etc.)
sont autant d’exemples des transformations qui ont atteint le domaine de l’éducation et de la culture et qui
contribuent à la compréhension de l’essor de la croyance dans “l’émergence d’une culture authentiquement
nationale”. C’est également après 1930 que se constitue un espace public sur des bases proprement
nationales.
La réflexion sur ces processus qui ont bouleversé la société brésilienne sera l’objet de différents ateliers
qui réuniront des scientifiques brésiliens et français pendant la Semaine Brésil 2000, organisée par un
ensemble d’institutions de recherche des deux pays sous la coordination de la Maison des Sciences de
l’Homme et le haut patronage des Ministères de l’Education Nationale et de la Recherche des deux pays, qui
se réalisera du 16 au 20 octobre au Carré des Sciences à Paris. Ce numéro des Cahiers du Brésil
Contemporain vise à apporter des subsides à l’ensemble de ces débats ; il présente des séries statistiques qui
essayent de couvrir, dans la mesure de nos possibilités, l’ensemble du XXe siècle et doit contribuer à la
réflexion sur les principales transformations morphologiques. L’idée de ce numéro revient à Ignacy Sachs ; la
conception, le recueil et la critique des informations sont le fruit du travail d’Afrânio Garcia, de Vassili
Rivron et de Patrick Bouvier. La mise en forme pour les Cahiers a été faite par Dominique Duchanel. Nous
Cahiers du Brésil Contemporain, 2000, n° 40
Brésil : le siècle des grandes transformations
tenons à remercier de leur précieuse contribution Ignacy Sachs (CRBC/EHESS) ; Hervé Théry (ENS) ; Odaci
Luís Coradini (UFRGS) ; Ana Maria de Almeida (UNICAMP) ; Gustavo Sorá (UERJ) ; Hélgio Trindade
(UFRGS) ; Márcio Garcia (PUC-RJ) ; Marcelo Motta Rezende (PUC-RJ) ; Marcelo Abreu (PUC-RJ) et Teresa
Cristina de Araujo (IBGE).
Nous avons pensé aussi à l’intérêt des doctorants de pouvoir disposer de données sur la longue période
pour mieux préciser le sujet étudié dans leurs thèses. Nous présenterons une version plus étendue des séries
publiées dans ces Cahiers sur notre site web (www.ehess.fr/crbc). Nous espérons que ce travail
d'objectivation des légats de l'histoire récente contribuera aussi à éclairer les conditions de possibilité des
différents avenirs inscrits dans le présent.
Afrânio GARCIA
Vous aimerez peut-être aussi
- Benacquista, Tonino - Tout A L'egoDocument79 pagesBenacquista, Tonino - Tout A L'egolaghboulePas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Meditel PDFDocument20 pagesRapport de Stage Meditel PDFYassineMalekiPas encore d'évaluation
- Projet 2Cn v1Document22 pagesProjet 2Cn v1yassine.oualiPas encore d'évaluation
- Brioche Pour Machine À Pain - Recette de Brioche Pour Machine À Pain - MarmitonDocument8 pagesBrioche Pour Machine À Pain - Recette de Brioche Pour Machine À Pain - MarmitondfoundoukPas encore d'évaluation
- DR Baichi Intro Economie de Sante 1Document28 pagesDR Baichi Intro Economie de Sante 1Billy05 BillyPas encore d'évaluation
- 103 L'AntéchristDocument8 pages103 L'AntéchristDaniel Bénis ToutiPas encore d'évaluation
- 2006-03-03ven - Le Monde Des LivresDocument12 pages2006-03-03ven - Le Monde Des LivresFranck de la MataPas encore d'évaluation
- UntitledDocument130 pagesUntitledEcole monprofesseurdepianoPas encore d'évaluation
- TE Les Etats-Unis, Un Territoire Dans La MondialisationDocument1 pageTE Les Etats-Unis, Un Territoire Dans La MondialisationEnzo DechouPas encore d'évaluation
- GeotechniqueDocument22 pagesGeotechniqueAllou AchrafPas encore d'évaluation
- 65 - Trouble Délirant Persistant.Document2 pages65 - Trouble Délirant Persistant.TinaPas encore d'évaluation
- Universite Hassan Ii Casablanca: L'importance de La Gestion de Trésorerie Dans Une PMEDocument28 pagesUniversite Hassan Ii Casablanca: L'importance de La Gestion de Trésorerie Dans Une PMEIsmail Ait SalhPas encore d'évaluation
- Statistique Descriptive & Probabilités: DR: Najat Moradi FSTHDocument47 pagesStatistique Descriptive & Probabilités: DR: Najat Moradi FSTHValhala aPas encore d'évaluation
- Fre Sub g13 Notes Conflit de Generation Mrs JuggessurDocument6 pagesFre Sub g13 Notes Conflit de Generation Mrs Juggessurndiayemoise92Pas encore d'évaluation
- Linux - TP 2Document2 pagesLinux - TP 2Omaf Aluoy100% (1)
- Beret Babs Patron de Couture - Made by Oranges Francais - 2128508Document9 pagesBeret Babs Patron de Couture - Made by Oranges Francais - 2128508Nizar SilliniPas encore d'évaluation
- UntitledDocument535 pagesUntitledIbtissam NaimPas encore d'évaluation
- Strategie de Developpement Du Sous Secteur UrbainDocument297 pagesStrategie de Developpement Du Sous Secteur Urbainstephane100% (1)
- Non À L'occidentalisation de L'école !Document7 pagesNon À L'occidentalisation de L'école !Mohamed DahmanePas encore d'évaluation
- Ia1cm 24kv 50aDocument2 pagesIa1cm 24kv 50aTAPSOBA LASSANEPas encore d'évaluation
- Apostila Est HíbridoDocument195 pagesApostila Est HíbridoEduardo NagelPas encore d'évaluation
- 5.71.SA 23 (Antey 2500) PDFDocument3 pages5.71.SA 23 (Antey 2500) PDFFábioPas encore d'évaluation
- Présentation Pdu Dakar Horizon 2025Document67 pagesPrésentation Pdu Dakar Horizon 2025Fabrice PassalePas encore d'évaluation
- Lumiere Du Thabor 23Document27 pagesLumiere Du Thabor 23Paul LadouceurPas encore d'évaluation
- AUGUST - 1992 - 38!1!50 Nouveaux Sermons de Saint Augustin Pour La Conversion Des Païens Et Des Donatistes IIIDocument30 pagesAUGUST - 1992 - 38!1!50 Nouveaux Sermons de Saint Augustin Pour La Conversion Des Païens Et Des Donatistes IIINovi Testamenti FiliusPas encore d'évaluation
- Discussion WhatsApp Avec WIEUX FDocument24 pagesDiscussion WhatsApp Avec WIEUX FWIEUXPas encore d'évaluation
- Ufed User Manual CellebriteDocument397 pagesUfed User Manual CellebriteDam LanPas encore d'évaluation
- Cours Electrocinetique - L1 ElmDocument41 pagesCours Electrocinetique - L1 ElmMarine100% (1)
- Activité 4 - Traduire Un Problème Par Une Inéquation (Élève)Document2 pagesActivité 4 - Traduire Un Problème Par Une Inéquation (Élève)PROJET PROPas encore d'évaluation
- Exercices Etude Dune Installation Solaire PhotovoltaïqueDocument3 pagesExercices Etude Dune Installation Solaire PhotovoltaïqueAymen HssainiPas encore d'évaluation