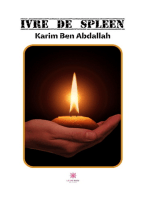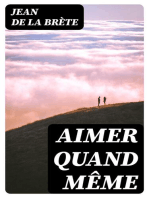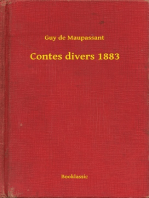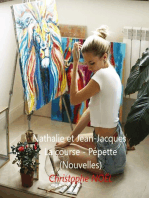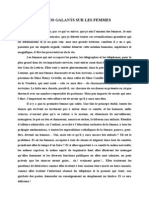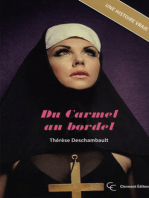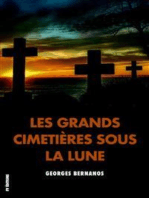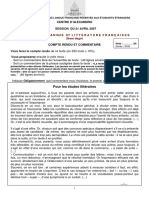Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Résumé C
Transféré par
Jack Adanho0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
85 vues4 pagesTitre original
résumé c
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
85 vues4 pagesRésumé C
Transféré par
Jack AdanhoDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
1E-mail
Jean RACINE, dramaturge classique français faisait dire à son personnage
dans Phèdre, « C’est Vénus toute entière à sa proie attachée » ; qu’il me permette de
le paraphraser et de soutenir concernant ce roman : « C’est Sidonie toute entière à sa
proie attachée. » Et c’est effectivement le cas de le signaler ; le personnage éponyme
de l’œuvre de MBAZOO-KASSA, enlacera, embrassera, étreindra, étouffera jusqu’à
inhumation, sa victime.
Le roman, composé de 12 chapitres, laisse percevoir de temps en temps,
quelqu’évasion poétique : Eric-Joël BEKALE, écrivain gabonais, parlerait d’Elévations
poétiques. Il part d’une lassitude exprimée par un monsieur bien sous tous rapports : il est
marié, architecte, deux enfants, belle maison, belle voiture et jusqu’alors, son épouse n’a rien
de particulier à signaler le concernant, et lui pour son épouse, non plus d’ailleurs.
Mais c’est malheureusement ce train-train quotidien que lui renvoie sa vie qui le poussera un
soir, à la sortie du travail, à s’arrêter dans un bar de quartier au nom évocateur, qui le fait
d’ailleurs sourire :’’Le Divorce’’. Curieux nom pour attirer des clients, se le dit – il. Il ne sait
certainement pas que les symboles ont plus d’impact dans nos vies que l’on voudrait bien le
croire.
Mais dans ce bar, l’antithèse est flagrante, agressive, violente. Il n’est pas dans son
milieu et l’alentour le voit. Ainsi se présente-t-il comme une étoile dans un ciel sombre. Et
l’essentiel de l’humanité rêve d’atteindre l’astre lumineux, y compris, et même surtout, la
pulpeuse serveuse de ce bar qui sait bien qu’il existe plusieurs moyens de se sortir de la
misère dans laquelle on croupit quotidiennement. Et lorsqu’elle met ses atouts physiques en
valeur ; lorsque le regard du fonctionnaire croise ses yeux, « agressé par la beauté de la
serveuse » (p.5), tout est dit. L’essentiel des actes que nous posons prend racine dans le
regard que nous projetons.
Pendant quelques instants, sa conscience lui demande de réfléchir à ce qu’il va faire.
Paradoxalement, il est persuadé que la relation qu’il a envie de créer lui apportera « un
cortège de problème ». Mais il extermine expéditivement sa lucidité en se convainquant que
sa femme n’en saurait rien : « Comment le saurait – elle ? C’est la première et la dernière
fois. » p.7
La suite va relativement vite : il l’attend jusqu’à fermeture du bar ; l’entraîne, avec son
consentement, dans un motel. Et après un contexte qui émerveille la serveuse ; après un
dîner qui fait entrevoir à l’une des parties, que le monde meilleur existe, après une mélodie
qui envoûte les protagonistes, la serveuse se donne entièrement, au propre comme au figuré
d’ailleurs. Si elle sait s’y prendre, se le dit-elle, peut-être pourra-t-elle espérer qu’il oublie son
épouse. Et dans cette relation où tout se transmet, l’homme constate effectivement la
différence : « Depuis quand n’avait-il plus éprouvé cette sorte d’ivresse »(p.13).
C’est, cependant, dans cet échange de corps de sueur et de sang, que
subrepticement, à doses homéopathiques, s’incruste Sidonie, la jumelle, le côté
obscur de la serveuse. D’autant plus que cette relation sexuelle s’est pratiquée sans
aucune forme de précaution. Cet homme est cadre, l’on peut alors supposer qu’il est
instruit. Mais l’on se demandera toujours comment il est possible que sur une telle
relation il n’ait pas songé à se protéger. Du coup, il n’a respecté aucune de la
triptyque abstinence, fidélité préservatif.
Or il ne faut pas plus d’une seconde pour qu’un épiphénomène se transforme en
drame du siècle. Ainsi basculera dans l’horreur, la vie de ce père de famille qui un
soir, a voulu se changer les idées, qui n’avait rien de particulier à reprocher à son
épouse. Qui a voulu entretenir une relation extra-conjugale. La femme d’ailleurs, ne
comprendra jamais les raisons d’un tel acte lorsqu’elle en parlera à son amie. Cette
anaphore soutenue sous un registre lyrique traduit parfaitement son désespoir
(p.76) :
« Que veulent-ils à la fin, ces hommes ? Aucun sacrifice n’est assez élevé pour venir à
bout de leur inconstance. Aucune beauté assez parfaite pour les apprivoiser. Aucune
maternité suffisamment généreuse pour les contenter. Aucune intelligence capable de les
impressionner. Quoi qu’on fasse, qui que l’on soit, finalement, ils éprouvent toujours le besoin
d’aller chercher à l’extérieur ce qu’ils peuvent avoir à l’intérieur. Mais pour qui se prennent-ils
donc ? »
La médiocrité de cet homme le pousse d’ailleurs à mentir à son épouse. Il faut
qu’il voie son amante, et ainsi son épouse légale et légitime devient – elle
secondaire.
Sidonie, pourrait se lire comme un euphémisme, voire une périphrase ou une allégorie.
Le personnage masculin qui à aucun moment n’est nommé, ne réussira jamais à s’en défaire,
ni à se défaire d’elle. Et la narration présente effectivement Sidonie tel un personnage à part
entière, qui discute, qui échange avec le fonctionnaire. Elle est d’ailleurs le seul personnage
cité nommément. Les deux amis de l’homme sont appelés D.A et P.A. comme si en
nommant, on trahissait un secret, on exhumait un tabou. Et Sidonie le comprend puisqu’elle
finit par s’exclamer : « A présent, je veux que le monde entier sache que j’existe aussi » (p.21)
Si le mal évolue aussi rapidement en lui, c’est bien parce que lorsqu’il se rend compte de sa
nouvelle situation, il ne veut en parler à personne et nous le savons : « Un homme seul est
toujours en mauvaise compagnie ». Il ne veut consulter aucun centre médical de peur que
cela se sache ; et pourtant à ce niveau nous lisons comme une volonté de suicide de Sidonie,
ou alors est-ce parce qu’elle se sait incurable ; puisque c’est elle qui prend souvent la
décision d’aller rendre visite à ce qu’elle appelle par périphrase, sa famille ; en fait un centre
médical spécialisé. Mais à aucun moment, il n’acceptera. : « Arrivé à la Maison Sidonie, il
baisse les yeux – Tu entres un moment ? - Je ne veux pas, tu le sais »(p23). Ce refus de
lutter est assez paradoxal pour quelqu’un qui aime autant ses enfants, comme il est si
clairement mentionné dans l’œuvre. Il s’agit très certainement du fameux regard de l’autre si
influent dans nos vies. Que vont dire les autres s’ils l’apprenaient ? Et pourtant cet homme ne
remplit que trop parfaitement ce que disait Janis OTSIEMI dans son roman, Tous les
chemins mènent à l’Autre, « L’enfer c’est moi sans l’Autre. »
Ce n’est que lorsqu’il sentira sa mort imminente et irréversible, qu’il prendra
le courage d’en parler à son épouse qu’il aura, bien malgré lui, entraînée dans son
abîme. Mais à la différence de l’époux, la femme décidera de combattre. Lorsqu’il
meurt, après avoir plus ou moins assuré leur avenir financier, « Lorsque Sidonie la
terrible [finit] par avoir raison de lui » (p.111), les deux enfants ont quinze et dix ans.
La femme résistera 20 ans à la maladie, trouvant la force de lutter dans l’éducation
de ses enfants qu’elle voudrait parfaite. Elle sera médecin, et lui, architecte. Au soir
de sa vie, et lorsque viendra la fatale Sidonie, l’épouse pourra jouir du devoir
accompli et se dire comme Victor HUGO dans Les contemplations : « J’ai bien assez
vécu ».
Le constat de deux entités totalement différentes dans le même monde, dans
le même univers, est aisément perceptible : si le mari a eu une aventure extra
conjugale, la femme n’en a jamais eu. Si le mari est aussi faible au point de laisser la
maladie l’envahir sans à aucun moment songer à lutter contre elle, à renier son
caractère fatal, la femme, quand elle prend conscience de son état, se rend dans
une unité sanitaire et surtout lutte pendant 20 ans, démontrant si besoin en était que
Le Mal du Siècle n’est pas une fatalité. Si le mari ne se confie quasiment jamais ;
lorsqu’il lui apprend de quoi il souffre, dans son désespoir, la femme se confie à une
amie, elle se confie par la suite à sa mère qui lui donnera la force de pardonner.
De manière très globale, l’homme se présente comme une exemple à fuir, et
la femme, un modèle à suivre.
Finalement, le problème qui se pose reste certainement de savoir à qui incombe la
responsabilité et de quoi d’ailleurs ? Est-ce au mari qui n’a pas su se préserver et qui a pensé
qu’ailleurs valait mieux qu’ici ? A l’épouse ? le reproche lui est adressé en tant que symbole
de la femme mariée : « Le principal reproche que je fais aux femmes, c’est qu’une fois faites
épouses ou mères, elles renoncent à séduire »(p.117) ; ou lorsque son époux parle d’elle :
« Elle ne fait plus naître en moi cette faim que toi seule sait provoquer et apaiser »(p.14) ; à la
serveuse de bar ? Il faut l’écouter pour que l’on se fasse une opinion : « Pourquoi n’ai-je pas le
droit de vivre confortablement {…} Dieu est-il si injuste qu’il privilégie d’avance certains et
condamne d’autres à la précarité, à la mendicité, à la misère ? »(p.10)
L’auteur en profite également pour stigmatiser certains comportements sociaux. Le
roman dénonce non seulement, la justice populaire, cette capacité à vouloir se rendre justice,
qui n’est en fait pour l’auteur qu’une tentative désespérée d’une certaine classe sociale
défavorisée, d’expurger son mal, sa haine envers les autres ; mais aussi la vente de son
corps par la jeune fille, dans l’optique d’une ascension sociale ; le cas est livré par une jeune
fille qui a pensé que seule la fin justifiait les moyens. Elle le dit d’ailleurs : « L’argent n’a ni
couleur, ni odeur[…] Le paradis est sur terre et nulle part ailleurs »(p.48) ; on peut encore
ressortir la dénonciation des nominations par copinage ou par tribalisme. En fait, le texte de
MBAZOO KASSA se veut une sorte de fresque de la société gabonaise et pourquoi pas,
africaine.
Le roman évolue quasi essentiellement sur une tonalité tragique ; mais en
l’achevant sur « Les retrouvailles », le dernier chapitre, l’auteur démontre parfaitement
la présence d’une vie après la vie : ‘’Lieu enchanté’’ ; toutes les joies’’ ; ‘’existences
bienfaisantes’’ ; ‘’merveilleux’’ ; ‘’Eldorado’’, etc. ; voilà le lexique particulièrement
mélioratif que nous retrouvons, aux dernières pages, et dans le dernier chapitre,
intitulé : « Les retrouvailles », dans la description de ce monde féerique, idéal,
paradisiaque.
On pourra débattre à volonté, mais il reste un fait patent. S’il est vrai que le
roman s’inscrit dans la modernité en échappant à l’habituelle thématique gabonaise,
il y est encore nettement ancré par la capacité, la force incroyable qu’a l’auteur
gabonais d’exterminer ses personnages. Ici encore, comme dans La mouche et la glu,
de Okoumba Nkoghé; comme dans Les Matinées sombres, de Narcisse EYI ; comme
dans Tous les chemins mènent à l’Autre, de Janis OTSIEMI : comme dans Un étrange
week-end à Genève, de Eric-Joël BEKALE, etc. les personnages meurent pour
différentes raisons. Or on ne saurait oublier que les meilleurs exemples sont vivants.
Il faut espérer qu’en les faisant vivre ailleurs, Chantal-Magalie MBAZOO-KASSA nous
oriente déjà dans la tentative de les faire vivre, tout simplement. Ce qui serait
considéré comme un nouveau départ, finalement plus optimiste, de la littérature
gabonaise.
Vous aimerez peut-être aussi
- Capteurs AtlantesDocument70 pagesCapteurs AtlantesUngandiz100% (7)
- Sherlock Hem'los - Le Train A Sifflé Deux FoisDocument1 pageSherlock Hem'los - Le Train A Sifflé Deux FoisyimhjPas encore d'évaluation
- Le Demon Et Mademoiselle Prym Paulo Coelho FrenchPDFDocument531 pagesLe Demon Et Mademoiselle Prym Paulo Coelho FrenchPDFAmal Ben100% (1)
- Les Principaux Connecteurs Logique en AnglaisDocument8 pagesLes Principaux Connecteurs Logique en AnglaisLIMAN KAOYE Madahan Bien-aiméPas encore d'évaluation
- 477 Mauriac Le Noeud de ViperesDocument11 pages477 Mauriac Le Noeud de ViperesPedroLemosPas encore d'évaluation
- Le réveillon du jeune tsar: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLe réveillon du jeune tsar: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- François Mauriac - MilanDocument3 pagesFrançois Mauriac - MilanmilanPas encore d'évaluation
- Corpus "En Quête de L'extraordinaire"Document7 pagesCorpus "En Quête de L'extraordinaire"stanic jeremyPas encore d'évaluation
- Document de ??? ?'??? ????Document2 821 pagesDocument de ??? ?'??? ????aissatouseck376Pas encore d'évaluation
- Demon Et Mademoiselle Prym, Le - Paulo CoelhoDocument22 pagesDemon Et Mademoiselle Prym, Le - Paulo Coelholourdes1976Pas encore d'évaluation
- L'Adversaire - Emmanuel CarreDocument4 pagesL'Adversaire - Emmanuel CarreEllasperaPas encore d'évaluation
- 9782246003663Document58 pages9782246003663Ngoor JuufPas encore d'évaluation
- Comment Preparer Un SermonDocument9 pagesComment Preparer Un SermonEtima0% (1)
- TX Oe 4 Roman 1sti 22:23Document3 pagesTX Oe 4 Roman 1sti 22:23Louane MorreneauPas encore d'évaluation
- L'heritage du démon et autres cauchemars vampiriquesD'EverandL'heritage du démon et autres cauchemars vampiriquesPas encore d'évaluation
- Nathalie et Jean-Jacques: La course - Pépette (Nouvelles)D'EverandNathalie et Jean-Jacques: La course - Pépette (Nouvelles)Pas encore d'évaluation
- 4° Exercices Récit 02Document9 pages4° Exercices Récit 02martyludo100% (1)
- Les Infortunes de La Vertu (Sade, Marquês De)Document131 pagesLes Infortunes de La Vertu (Sade, Marquês De)prof eliPas encore d'évaluation
- 12 Octobre 2019 - Il N'y A Que Les Femmes Qui Savent AimerDocument10 pages12 Octobre 2019 - Il N'y A Que Les Femmes Qui Savent AimerGérard BejjaniPas encore d'évaluation
- Sade-La Philosophie Dans Le BoudoirDocument264 pagesSade-La Philosophie Dans Le Boudoiranna50% (2)
- Octave Mirbeau, Propos Galants Sur Les FemmesDocument4 pagesOctave Mirbeau, Propos Galants Sur Les FemmesAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Mémoires de mes putains tristes: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandMémoires de mes putains tristes: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Lange Du Crepuscule Version Finale MargeDocument395 pagesLange Du Crepuscule Version Finale Margemudiboelikya26Pas encore d'évaluation
- Recapitulatif Sequence 1 LE ROMAN 2023-2024Document5 pagesRecapitulatif Sequence 1 LE ROMAN 2023-2024habis.stephaniePas encore d'évaluation
- Maintenant qu'ils ne sont plus là: Le deuil après une agonie, un suicide ou une euthanasieD'EverandMaintenant qu'ils ne sont plus là: Le deuil après une agonie, un suicide ou une euthanasiePas encore d'évaluation
- Panaït Istrati - L'homme Qui N'adhere A RienDocument6 pagesPanaït Istrati - L'homme Qui N'adhere A RienTioboby TomPas encore d'évaluation
- Pourquoi L'amour Fait Mal - L'Expérience Amoureuse Dans La Modernité (PDFDrive)Document348 pagesPourquoi L'amour Fait Mal - L'Expérience Amoureuse Dans La Modernité (PDFDrive)Leonnel YannickPas encore d'évaluation
- NBFDocument102 pagesNBFloriane coquittePas encore d'évaluation
- Bye bye les machos: La virilité sans le virilismeD'EverandBye bye les machos: La virilité sans le virilismePas encore d'évaluation
- Camus Albert Mythe de SisypheDocument55 pagesCamus Albert Mythe de SisypheMukoma33% (3)
- Dieu N'a Pas Besoin de Ce MensongeDocument54 pagesDieu N'a Pas Besoin de Ce Mensongekibondo20083806Pas encore d'évaluation
- La Sorcière de Portobello - Paulo CoelhoDocument527 pagesLa Sorcière de Portobello - Paulo CoelhoJacob MoholeaPas encore d'évaluation
- SOUMAORODocument4 pagesSOUMAOROIs'haq JallowPas encore d'évaluation
- LA CLEF DES 150 PSAUMES DE DAVID - Paix Et JoieDocument7 pagesLA CLEF DES 150 PSAUMES DE DAVID - Paix Et JoieGiraud Ekanmian100% (1)
- Mimi Pinson 4Document2 pagesMimi Pinson 4axboPas encore d'évaluation
- La Boîte À Chansons - Damien Saez - Jeune Et ConDocument1 pageLa Boîte À Chansons - Damien Saez - Jeune Et ConGauthier TisserantPas encore d'évaluation
- 2nde Francais Les Caracteristiques Du Genre PoetiqueDocument7 pages2nde Francais Les Caracteristiques Du Genre PoetiqueJean-Eudes SINGNONPas encore d'évaluation
- André Gide, La Symphonie PastoraleDocument11 pagesAndré Gide, La Symphonie PastoralemostafaPas encore d'évaluation
- Les Fameux Theories de La TraductionDocument22 pagesLes Fameux Theories de La Traductionimen khelifiPas encore d'évaluation
- Exposé Complet Sur Le Soleil Des IndépendancesDocument6 pagesExposé Complet Sur Le Soleil Des IndépendancesParfait KABORE80% (5)
- Resume - Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) : Acte I, Scène 1Document6 pagesResume - Les Fausses Confidences, Marivaux (1737) : Acte I, Scène 1MANIKKUGE SAVITHMIPas encore d'évaluation
- Commentaire de TexteDocument2 pagesCommentaire de Texteann 'Pas encore d'évaluation
- APPRENDRE LE LACHER PRISE (2 Pages - 75 Ko)Document2 pagesAPPRENDRE LE LACHER PRISE (2 Pages - 75 Ko)nsombiPas encore d'évaluation
- Préparation À L'écrit 3am P2S2Document3 pagesPréparation À L'écrit 3am P2S2Khadidja KebirPas encore d'évaluation
- Frances Bibliografia 2021 2022Document6 pagesFrances Bibliografia 2021 2022Michael SaxosusPas encore d'évaluation
- Aos Warscroll Aetheric Navigator FRDocument1 pageAos Warscroll Aetheric Navigator FRThomas GuillePas encore d'évaluation
- Sujet Fran L B 01 2020Document1 pageSujet Fran L B 01 2020Fatou seckPas encore d'évaluation
- Verbs 'A' NounDocument3 pagesVerbs 'A' NounRuchiPas encore d'évaluation
- M09/2/ABENG/HP1/ENG/TZ0/XX/QDocument10 pagesM09/2/ABENG/HP1/ENG/TZ0/XX/QMiriam LópezPas encore d'évaluation
- Sequence 3Document6 pagesSequence 3Rachid OmariPas encore d'évaluation
- Le Recueil Ouvert - L'Épique Dans Les Recherches Universitaires Au Cameroun. Corpus Et MéthodesDocument5 pagesLe Recueil Ouvert - L'Épique Dans Les Recherches Universitaires Au Cameroun. Corpus Et MéthodesJulien KemlohPas encore d'évaluation
- Passé Simple Ou ImparfaitDocument2 pagesPassé Simple Ou ImparfaitAhmad EllouzePas encore d'évaluation
- 2AS La Nouvelle D'anticipation Composotion 1.-ConvertiDocument2 pages2AS La Nouvelle D'anticipation Composotion 1.-ConvertiSpíritum SanctumPas encore d'évaluation
- Déroulement de La Séance DE PODocument6 pagesDéroulement de La Séance DE POMaroua MitalPas encore d'évaluation
- Article 6853Document2 pagesArticle 6853Walter ChennevieresPas encore d'évaluation
- Etude Nouvelle Nantas ZolaDocument16 pagesEtude Nouvelle Nantas ZolaSYLVIE R.100% (1)
- Université DJ BMDocument2 pagesUniversité DJ BMSe FarPas encore d'évaluation
- S4 - Histoire Des Idees Et de L'art - XXe SiecleDocument21 pagesS4 - Histoire Des Idees Et de L'art - XXe SiecleFāţ Ïmä100% (1)
- Moustache 2Document3 pagesMoustache 2Everyman EleanyaPas encore d'évaluation
- Lecture Cursive 1Document5 pagesLecture Cursive 1CléoPas encore d'évaluation