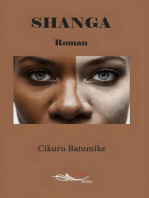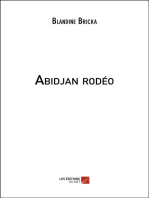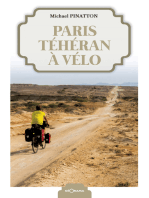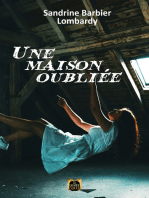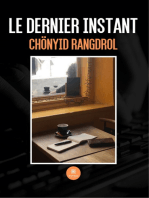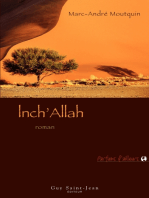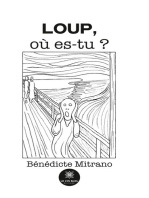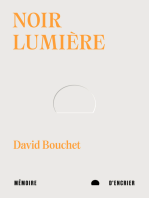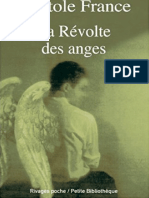Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fantôme
Transféré par
HéloïseCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fantôme
Transféré par
HéloïseDroits d'auteur :
Formats disponibles
Document généré le 6 août 2023 01:25
Liberté
Le fantôme affamé
Mélanie Vincelette
Volume 40, numéro 6 (240), décembre 1998
URI : https://id.erudit.org/iderudit/32116ac
Aller au sommaire du numéro
Éditeur(s)
Collectif Liberté
ISSN
0024-2020 (imprimé)
1923-0915 (numérique)
Découvrir la revue
Citer cet article
Vincelette, M. (1998). Le fantôme affamé. Liberté, 40(6), 51–54.
Tous droits réservés © Collectif Liberté, 1998 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/
51
MÉLANIE VINCELETTE
LE FANTÔME AFFAMÉ
Singapour, marché des voleurs, tombée de la nuit.
Mes mains se rafraîchissent, plongées dans des morceaux
de soie de couleur or et safran. L'encens parfume les
ruelles étroites et donne des teintes bleutées à l'air
stagnant. Son odeur me rappelle celle des pagodes du
Laos. Des femmes aux gestes pressés se procurent des
bols à aumône argentés, des feuilles de bananier et des
liasses de fleurs d'indigotier. Elles se préparent pour le
festival des fantômes affamés qui doit durer trois jours.
Cette cérémonie transforme les rues en bazar féerique où
des dragons urbains dansent au rythme des gongs. Les
Chinois de Singapour posent, pendant ces journées, des
plats remplis de riz et de canard rôti sur les trottoirs
devant leur porte. Ces plats sont des offrandes à leurs
ancêtres qui doivent voir leur faim apaisée afin de calmer
leur ressentiment ou les élans momentanés d'une
vengeance restée inexprimée pendant leurs jours sur
terre. Pendant ces journées carnavalesques, les chats
errants se prennent pour des ancêtres lointains et se
retrouvent devant un buffet éternel à chaque coin de rue.
Le dos courbé et les yeux à l'affût des voyeurs, ils se
régalent d'offrandes, alors que la ville a le dos tourné.
Dans les semaines qui suivent le festival, les femmes des
différentes familles se vantent respectueusement, lors des
52
parties de maajons, où le thé vert coule à flot, de l'appétit
de leurs ancêtres qui ont tout avalé. Ce qui leur portera
chance.
Dans ce marché qui était anciennement un endroit où
les pirates venaient vendre de l'opium, de l'or rose et des
soieries, j'observe les femmes parler. J'envie leur can-
deur. Je voudrais nourrir mes fantômes et me vanter de
leur appétit. Mais je suis Blanche et je marche dans des
rues inconnues que j'ai trop bien appris à connaître. Je
marche devant les éventaires et je te regarde. Tu es là,
près de moi et je t'aime. Je t'aime de loin. En silence. Ta
peau est blanche comme la mienne. Un homme essaie de
me vendre un canard pékinois glacé au miel. Il le tient
suspendu par les pieds au bout d'un crochet rouillé. Toi,
tu regardes un match de boxe thaï avec quelques
marchands regroupés autour d'une télévision. Je me
demande comment tu peux à la fois t'intéresser à la boxe
et aux conversations enflammées à propos des vers de
Césaire, des romans de Kundera et des autres auteurs
dont je suis amoureuse. Une vieille femme, assise par
terre, à côté d'immenses paniers en osier remplis de fruits
à l'ècorce brunâtre, me propose un spécial si j'en fais
l'achat d'un kilo. Un chat maigre et sale est affalé sur le
pavé à ses côtés, il bâille comme seuls les chats savent le
faire avec élégance, la bouche ouverte vers le ciel.
Dans le ciel, il y a Orion. Des marchands font griller
du satay sur des braises. Je voudrais que parfaite soit la
nuit dans laquelle nous nous enfonçons. Je voudrais
étreindre ton corps et entendre le battement de l'hélice du
ventilateur fixé au plafond de notre chambre. Je voudrais
que tu m'aimes dans cette chambre qui donne sur la rue.
Je voudrais que tu m'aimes, nos corps plongés dans les
bruits du festival. Nos corps découverts, nus. Le bruit de
la ville près de nous, si près qu'on entendrait son frotte-
ment contre le bois des volets. Je toucherais ton corps
dans ce bruit, ce passage. Un enfant me propose des
53
limes vertes, je les refuse. Il me montre les jaunes. Je suis
en train de rejeter mon corps comme on rejette un
poumon fraîchement greffé. J'ai le spleen de Singapour
car je t'aime, N. J'ai honte. J'ai honte car je sais qui tu es.
Je sais que tu es mon ami depuis quelques années. Je sais
que tu es aussi l'ami le plus fidèle de celui que je vais
épouser. Tu m'accompagnes dans les rues de Singapour,
tu m'accompagneras à travers la Malaisie, la Thaïlande et
le Laos où celui avec qui je me marierai m'attend. Nous
attend. Tu seras à la cérémonie de mon mariage. Tu
porteras un sarong tissé de fil vert empereur et tu te
plaindras, comme d'habitude dans les cérémonies boud-
dhistes, d'avoir à t'asseoir en position de prière. Tes
jambes en souffrent. Depuis quelques semaines, nous
traversons les paysages célestes de Java dans des tuk-tuk,
des autobus, des trains bondés de jeunes hommes
fraîchement sortis des jungles de Sumatra, de Hollandais
qui se croient toujours au temps de la colonie, de
Japonais en vacances et de moines en robe orange qui
fixent mes cheveux blonds. Tu m'accompagnes et moi,
lorsque je lis un passage d'amour dans un roman, je
pense à toi en silence.
Il y a six jours, dans le train entre Borubudur et
Jakarta nous dormions ensemble sur la même banquette,
et ton bras a enveloppé mon corps dans l'égarement du
sommeil. J'ai pleuré. J'ai pleuré sans faire de bruit
jusqu'à ce que les fenêtres du train projettent sur ma
cornée inondée des images filantes et impressionnistes.
Des images de rizières ensoleillées peuplées de paysans,
la faux à la main. Ma tristesse est importée des hauts-
plateaux du Laos où celui que je dois épouser est ton
frère, sauf que ses yeux sont noirs et allongés comme la
feuille du bambou. Parfois je veux que tu le trahisses, en
oubliant le Laos, et en m'emmenant, au lieu, vers la mer
de la Chine du Sud. Cette mer que personne ne connaît,
où l'eau bleue engloutit quelques îles malaises alourdies
54
par les plantations de caoutchouc. Là-bas, nous pour-
rions aimer le sable. Un homme me fait goûter à un petit
pain rond et sucré qu'il appelle d'une voix forte moon
cake. Nous sommes ici, dans le quartier chinois de
Singapour et ce soir, dans notre chambre, le ventilateur
me volera mon sommeil. Je me consolerai car je sais que
nous vivons une histoire d'amour comme Platon le
voulait et que notre amitié surpasse celle de plusieurs
amants. Quand tu touches à ma main brièvement, dans
les marchés bondés de l'Orient qui nous emporte, c'est
comme si tu me faisais l'amour. Sauf qu'on ne se lassera
jamais l'un de l'autre. Hier dans le port, alors que tu étais
à la recherche d'un talisman en jade pour envoyer à ta
mère, j'ai lu une nouvelle de Marguerite de Navarre
intitulée De deux amants par désespoir d'être mariés ensemble
se rendirent en religion : l'homme à saint François, et la fille à
sainte Claire. Je sais que notre union nous protège de ce
sort. Demain, je poserai un plat sur le seuil de notre porte
et je ne saurai jamais si mes ancêtres sont venus, car je
serai dans un autobus, entre Johor Bahru et Kuala
Lumpur, à la recherche de la candeur et de l'oubli.
Vous aimerez peut-être aussi
- Conversation Avec Ma Vieille Honda: Serge BouchardDocument3 pagesConversation Avec Ma Vieille Honda: Serge BouchardKouam kamguaingPas encore d'évaluation
- Pour Se Raconter IIDocument186 pagesPour Se Raconter IIdayanna oteroPas encore d'évaluation
- Au Coeur Des Himalayas Le Népal (David-Néel, Alexandra) (Z-Library)Document61 pagesAu Coeur Des Himalayas Le Népal (David-Néel, Alexandra) (Z-Library)crmm1961Pas encore d'évaluation
- Extrait de La PublicationDocument22 pagesExtrait de La PublicationNadia moussaddakPas encore d'évaluation
- MirbeauDocument9 pagesMirbeauPhilippe LouchePas encore d'évaluation
- Histmss 072609Document248 pagesHistmss 072609Marc-Olivier MarcottePas encore d'évaluation
- Extrait Le Coeur Des Enfants LéopardsDocument18 pagesExtrait Le Coeur Des Enfants LéopardsAdina DinuPas encore d'évaluation
- Chraibi Driss La Civilisation Ma MerepdfDocument28 pagesChraibi Driss La Civilisation Ma MerepdfKhaoula OUARDANEPas encore d'évaluation
- Poemes Lire Et Ecouter Du 03 Mai 22Document16 pagesPoemes Lire Et Ecouter Du 03 Mai 22Terens SotiriPas encore d'évaluation
- LALOY Louis, Miroir de La Chine. Présages, Images, MiragesDocument321 pagesLALOY Louis, Miroir de La Chine. Présages, Images, MiragesGuimvsPas encore d'évaluation
- Voyage de La Grèce PDFDocument539 pagesVoyage de La Grèce PDFspéculairePas encore d'évaluation
- PDFDocument45 pagesPDFHitomi50% (2)
- Tant Que Fleuriront Les Citronniers (Zoulfa Katouh) (Z-Library)Document335 pagesTant Que Fleuriront Les Citronniers (Zoulfa Katouh) (Z-Library)Noor Soltan100% (2)
- Laloy Miroir de La ChineDocument313 pagesLaloy Miroir de La ChineGera Janka100% (1)
- Invitation Au Voyage Séance 1Document5 pagesInvitation Au Voyage Séance 1jimmyPas encore d'évaluation
- Birago Diop: Un Conteur D'afrique NoireDocument32 pagesBirago Diop: Un Conteur D'afrique NoireFallouPas encore d'évaluation
- L'inscription Des Valeurs Dans L'odeur Du Café de Dany LaferrièreDocument5 pagesL'inscription Des Valeurs Dans L'odeur Du Café de Dany LaferrièreGain NetPas encore d'évaluation
- Les Contes Provençaux Contes (... ) Mistral Frédéric bpt6k7487rDocument540 pagesLes Contes Provençaux Contes (... ) Mistral Frédéric bpt6k7487ry.azPas encore d'évaluation
- Le Marchand de VeniseDocument173 pagesLe Marchand de Veniselouisjeandavid508Pas encore d'évaluation
- Extrait de La PublicationDocument20 pagesExtrait de La PublicationAudreyPas encore d'évaluation
- La Cerise Sur Le GâteauDocument6 pagesLa Cerise Sur Le GâteauHank VogelPas encore d'évaluation
- Benjamin Gastineau - La Vie en Chemin (La Vida en Ferrocarril) 1861 PDFDocument148 pagesBenjamin Gastineau - La Vie en Chemin (La Vida en Ferrocarril) 1861 PDFJaviPas encore d'évaluation
- LSDM V5N3Document33 pagesLSDM V5N3babar7777100% (2)
- LSDM V3N3bDocument31 pagesLSDM V3N3bHeka KheperaPas encore d'évaluation
- GERVEREAU Laurent, Halte Aux Voleurs D'avenir !Document50 pagesGERVEREAU Laurent, Halte Aux Voleurs D'avenir !GuimvsPas encore d'évaluation
- Virgil MazilescuDocument3 pagesVirgil MazilescuXavier MoralesPas encore d'évaluation
- Pu Tawadayik Jinaf Berik (À Mon Frère Le Paysan)Document9 pagesPu Tawadayik Jinaf Berik (À Mon Frère Le Paysan)Marjorie Waldstein100% (1)
- Pronoms Personnels Complément BACHILLERATODocument11 pagesPronoms Personnels Complément BACHILLERATOandreaPas encore d'évaluation
- Brouillon Dissert BaudelaireDocument7 pagesBrouillon Dissert BaudelaireaPas encore d'évaluation
- Francuski - B1 23.05.16Document9 pagesFrancuski - B1 23.05.16hsiao-yun LeePas encore d'évaluation
- Casablanca Finance CityDocument1 pageCasablanca Finance CityJoseph BuckleyPas encore d'évaluation
- RCI BEPC 2016 Zone3 OrthographeDocument1 pageRCI BEPC 2016 Zone3 OrthographeDiabel DiopPas encore d'évaluation
- Présentation Commerciale Plan de Projet Pour Société Géométrique Jaune Et BlancDocument18 pagesPrésentation Commerciale Plan de Projet Pour Société Géométrique Jaune Et BlancBayrem HarbaouiPas encore d'évaluation
- BAMBERG, Anne, La Pénitence Et L'onction Des Malades, Études Autour de CanonsDocument22 pagesBAMBERG, Anne, La Pénitence Et L'onction Des Malades, Études Autour de CanonsThomas MicheletPas encore d'évaluation
- Listes Thèses DoctoratDocument82 pagesListes Thèses DoctoratyosefPas encore d'évaluation
- Gestion Juridique Fiscale Et Sociale PDFDocument23 pagesGestion Juridique Fiscale Et Sociale PDFAli BenPas encore d'évaluation
- PME Invest 2021 - EurazeoDocument17 pagesPME Invest 2021 - EurazeoiphonetaziPas encore d'évaluation
- Les 100 Penseurs Des Sciences Humaines - Sciences Humaines Magazine PDFDocument172 pagesLes 100 Penseurs Des Sciences Humaines - Sciences Humaines Magazine PDFliris100% (1)
- Question de Cours MicroDocument5 pagesQuestion de Cours MicroLucas BerlinotPas encore d'évaluation
- Elaboration Et Suivi de Manuel de ProcéduresDocument122 pagesElaboration Et Suivi de Manuel de Procéduresmekdis100% (5)
- Modele de Facture Auto Entrepreneur GratuitDocument1 pageModele de Facture Auto Entrepreneur GratuitEmmanuelle SavaryPas encore d'évaluation
- Les Connecteus Logiques Dans Production Ecrite DELFDocument5 pagesLes Connecteus Logiques Dans Production Ecrite DELFLinhPas encore d'évaluation
- 3 Solutions Pour Durer Plus Longtemps Au LitDocument9 pages3 Solutions Pour Durer Plus Longtemps Au LitDurer Plus LongtempsPas encore d'évaluation
- Caherine de RussieDocument9 pagesCaherine de Russiemichel kowalevskyPas encore d'évaluation
- Droit International de Lenvironnement (Roland Seroussi)Document224 pagesDroit International de Lenvironnement (Roland Seroussi)Lescoue LovePas encore d'évaluation
- La Phrase Interrogative PDFDocument15 pagesLa Phrase Interrogative PDFMihaela Vintilă100% (1)
- 2 Special NégociantDocument12 pages2 Special NégociantTedPas encore d'évaluation
- Cours de Microéconomie Sur Les MarchésDocument71 pagesCours de Microéconomie Sur Les MarchésAbdoulaye Ndong100% (1)
- 15 CVDocument2 pages15 CVYaya Hamid LonyPas encore d'évaluation
- 25 La Feinte Mystique PDFDocument10 pages25 La Feinte Mystique PDFDulce DedinoPas encore d'évaluation
- La Révolte Des Anges (1914) (Anatole France - Anatole France-)Document219 pagesLa Révolte Des Anges (1914) (Anatole France - Anatole France-)fernando ravagnaniPas encore d'évaluation
- CDET - E - Généralités Codap - V1Document19 pagesCDET - E - Généralités Codap - V1alassanePas encore d'évaluation
- SI-BD SERIE4 Corrigé CompletDocument4 pagesSI-BD SERIE4 Corrigé CompletRihab ToudjiPas encore d'évaluation
- 748 - DMI-BASE-DC - Formulaire 11-MODIFICATION ETAT CIVIL TITRE DE SEJOUR-202109Document3 pages748 - DMI-BASE-DC - Formulaire 11-MODIFICATION ETAT CIVIL TITRE DE SEJOUR-202109tidiani diopPas encore d'évaluation
- Christian Dior CoutureDocument10 pagesChristian Dior CoutureKamal DekariPas encore d'évaluation
- L'histoire de L'aviationDocument65 pagesL'histoire de L'aviationCHAIMAE KACEMI100% (1)
- English ProverbsDocument6 pagesEnglish ProverbsBaba diawPas encore d'évaluation