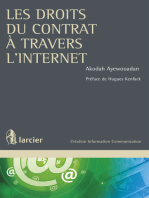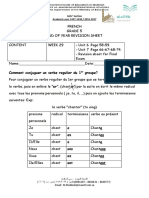Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
021rja 21 La Preuve Numerique Enm
Transféré par
Marc MbentyCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
021rja 21 La Preuve Numerique Enm
Transféré par
Marc MbentyDroits d'auteur :
Formats disponibles
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
LA PREUVE NUMÉRIQUE,
ENTRE CONTINUITÉ ET CHANGEMENT DE PARADIGME
Par
Étienne VERGÈS
Professeur à l’Université Grenoble Alpes
La preuve numérique constitue-t-elle une nouveauté dans le paysage judiciaire ? Bouleverse-t-elle la
physionomie du droit de la preuve et la pratique juridictionnelle ? Voici deux questions qui traversent
toutes les contributions à ce dossier consacré au traitement de la preuve numérique par les
magistrats. La réponse à ces questions est nécessairement nuancée. C’est pour cette raison que nous
évoquerons, dans l’ouverture de ce dossier, deux idées contradictoires, mais qui coexistent. D’un
côté, la preuve numérique s’inscrit dans une continuité. Elle ne présente pas de différence de nature
avec les preuves classiques et son régime n’est pas dérogatoire au droit commun de la preuve. En ce
sens, le recours à la technologie numérique constitue bien une spécificité, mais il ne provoque pas de
changement majeur dans les règles de droit et dans la manière de traiter ces preuves en justice. D’un
autre côté, certaines techniques probatoires particulières introduisent dans le système judiciaire et
dans la manière de rendre la justice, des problématiques tout à fait nouvelles, auxquelles le juge est
confronté, et qu’il doit résoudre dans une certaine solitude. En effet, de nouvelles techniques
probatoires sont apparues en pratique et certaines ont été reconnues par le législateur, mais ce
dernier n’a pas donné aux juges et magistrats du parquet les outils pour résoudre les difficultés
juridiques engendrées par ces nouveaux modes de preuve. Plus encore, le législateur a créé des
difficultés supplémentaires dans le traitement de ces preuves. Par conséquent, les juges sont
confrontés à un véritable changement de modèle, qui se traduit principalement par le caractère
inintelligible de ces nouveaux modes de preuve. Nous faisons ici allusion aux écrits et aux signatures
électroniques, ainsi qu’à leurs modes de conservation et de certification.
Dans cette contribution, nous tenterons d’aborder ces deux aspects (la continuité et le changement
de paradigme) sous l’angle du régime juridique de la preuve et celui de la mise en œuvre pratique de
ce régime. Mais avant cela, il nous paraît important de préciser ce que recouvre le concept de preuve
numérique et les différentes catégories qu’il contient.
Preuves numériques classiques et nouvelles
La preuve numérique n’est pas un concept défini par le droit. Le code civil parle bien de l’écrit
électronique1 et de la signature électronique2, mais le concept général de preuve numérique est
absent des textes et de la jurisprudence. La catégorie correspond donc à ce que l’on veut bien mettre
dedans et ce contenu est hétérogène. Il est possible de distinguer deux grands ensembles de natures
très différentes. Le premier est constitué par des preuves classiques qui ont été numérisées. Il en est
ainsi des photographies, des vidéos ou des sons, que l’on recueillait précédemment sous une forme
analogique3 et qui sont aujourd’hui numérisés. Il en est encore ainsi de procédés qui ont changé sous
l’effet de la technologie, mais dont la fonction ne diffère pas. Par exemple, la localisation d’un
individu dans une enquête pénale peut se faire au moyen d’une filature, d’un témoignage ou d’une
géolocalisation. La technologie apporte une grande richesse à la preuve. On peut géolocaliser une
1
Art. 1366 du code civil.
2
Art. 1367 du code civil.
3
Des photographies argentiques, des bandes-son ou des vidéos gravées sur différents supports analogiques (bandes
magnétiques, disques vinyles, etc.).
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
personne en temps réel ou reconstituer ses déplacements grâce aux traces laissées par son
téléphone portable, mais ce que dit le mode de preuve est identique. Il indique où se trouve une
personne à un moment donné. Le raisonnement est le même s’agissant des courriels (qui ne sont
que des correspondances), du portrait-robot génétique (qui possède la même fonction que le
portrait-robot dessiné) etc.
Ces preuves que l’on qualifie de "numériques", car elles ont recours à un procédé de numérisation,
font, en réalité, partie d’une catégorie plus vaste de preuves qui sont obtenues avec l’aide d’une
technologie. En cela, elles apparaissent comme nouvelles et donc différentes des preuves classiques.
La question se pose de savoir si elles le sont réellement.
D’un point de vue pratique, les différences entre preuves classiques et numériques sont nombreuses
et évidentes. Les technologies numériques se répandent à très grande vitesse. D’une part, les acteurs
de la justice (la police judiciaire, les magistrats, les experts, les avocats) ont recours à un nombre de
plus en plus grand de technologies. Cette évolution est apparue assez nettement à partir des années
80. Ce fut d’abord l’avènement de la photocopie, en matière de preuve documentaire4, puis les
méthodes technologiques de recueil et d’établissement de la preuve ce sont multipliées en matière
pénale : empreintes génétiques, interceptions de correspondances, sonorisation, captation d’image,
géolocalisation, constitution de fichiers de police et utilisation des logiciels de rapprochement de ces
fichiers. Cette évolution n’a pas de limite. Aujourd’hui ce sont les tests d’odeurs et le portrait-robot
génétique qui sont en cours de développement. D’autre part, les acteurs extérieurs à l’institution
judiciaire possèdent leurs propres preuves numériques qu’il s’agisse des contenus de téléphone
portable détenus par les parties, mais également des images de vidéoprotection, que les communes,
la SNCF et d’autres personnes publiques détiennent et produisent sur réquisition. Ces preuves
peuvent être produites par les parties ou les tiers au procès, de façon volontaire ou sur réquisitions
et saisies. De façon plus générale encore, en matière civile, toutes les données stockées dans les
systèmes informatiques des entreprises sont susceptibles d’être communiquées en justice,
notamment sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile5. Sur autorisation d’un
juge, un huissier et un expert en informatique peuvent saisir des données, cloner des disques durs,
accéder aux téléphones portables des employés, etc. Ces nouvelles preuves, issues de la technologie
numérique, démultiplient les possibilités probatoires. Elles permettent d’obtenir des informations de
façon plus simple, plus variée et en plus grand nombre. Cela est significatif en matière pénale. Même
pour des délits de moyenne gravité, le volume des preuves numériques contenues dans un dossier
s’est considérablement accru ces dernières années.
D’un point de vue juridique, la transformation est beaucoup moins évidente. Si les preuves
numériques créent de nouveaux défis, elles posent les mêmes questions que les preuves
traditionnelles. En premier lieu, la preuve est-elle licite ? C’est-à-dire respecte-t-elle les principes
généraux du droit de la preuve ? En second lieu, l’élément recueilli est-il probant ? C’est-à-dire
apporte-t-il une information intelligible et fiable au juge ? Ces deux questions se posent exactement
dans les mêmes termes à propos des preuves classiques et nouvelles, qu’elles soient numériques ou
de toute autre forme. C’est en ce sens que nous parlons de continuité (I). Toutefois, dans un domaine
particulier, les choses se présentent différemment. Il s’agit de l’écrit électronique, de son usage et de
la force probante qui lui est accordée. La reconnaissance de cet écrit par le législateur transforme de
façon substantielle la manière de contester et de vérifier l’authenticité de cet écrit. Plus récemment,
l’irruption de la technologie blockchain, pose des questions plus aiguës encore. Sur ce terrain, le juge
se trouve confronté, non pas à une preuve dont il perçoit la teneur, mais à une boîte noire. Se profile,
alors, un véritable changement de paradigme.
4
Qui a motivé l’adoption de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980, relative à la preuve des actes juridiques.
5
Cf. notamment la mise en œuvre de ces mesures en relation avec le secret des affaires, décret n° 2018-1126 du 11
décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires.
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
I. La continuité : les questions posées par les preuves numériques ne sont pas nouvelles
De façon générale la théorie de la preuve n’a pas été bouleversée par le développement des preuves
numériques. Au contraire, la multiplication de ces nouvelles techniques a souvent conduit la Cour de
cassation à réaffirmer l’existence de principes ancrés dans le système juridique depuis de
nombreuses années et à en densifier le contenu.
L’un de ces principes est le droit au respect de la vie privée appliqué à la matière probatoire. Ce
principe est apparu dans la jurisprudence dès les années 70, à propos du constat d’adultère6. Mais sa
véritable émancipation date du célèbre arrêt Nikon, dans lequel la Cour de cassation a jugé illicite la
production en justice par l’employeur de courriels personnels échangés par des salariés7. Par la suite,
le principe a été appliqué de la même manière à des preuves classiques (des rapports d’enquêteurs
privés)8 et à des fichiers numériques9. En matière pénale, la première application du droit au respect
de la vie privée pour écarter une preuve date de 2007. Il s’agissait en l’espèce de photographies10,
mais l’arrêt ne dit pas si les photos prises par les enquêteurs étaient numériques ou argentiques !
Cette information était d’ailleurs indifférente, car l’atteinte à la vie privée provenait du fait que les
enquêteurs avaient photographié l’intérieur d’une propriété privée non visible de l’extérieur. Par la
suite, la vie privée en matière pénale a été utilisée, tant à l’égard de preuves classiques11 qu’en
matière de sonorisation et de fixation d’image12.
Le constat est le même à propos de la loyauté de la preuve. La Cour de cassation utilise ce principe
pour contrôler l’usage des preuves numériques. Tel est le cas à propos d’images issues d’une caméra
de surveillance13, de SMS qui s’affichent sur un téléphone portable14 ou de la production de messages
téléphoniques vocaux15. Mais la haute juridiction est tout aussi regardante à l’égard du témoignage
d’un tiers qui relate le contenu d’une conversation téléphonique16. Encore une fois, ce n’est pas la
nature de la preuve (numérique ou non) qui est en cause dans ces affaires, mais la manière de
recueillir cette preuve (à l’insu de la personne ou au moyen d’un stratagème). En matière pénale,
l’affaire la plus célèbre relative à la loyauté de la preuve concerne la sonorisation d’une cellule de
garde à vue. La déloyauté du procédé a été posée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation17.
Dans cette affaire, les juges ont censuré un détournement de la procédure de sonorisation, qui
constituait, à leurs yeux, un procédé déloyal. Mais la chambre criminelle a utilisé le même
raisonnement à propos d’un stratagème qui visait à contourner la procédure de l’interrogatoire de
première comparution. En l’espèce, des OPJ18 avaient consigné dans un procès-verbal de
constatation les aveux de la personne mise en examen, alors qu’ils la conduisaient à la maison
d’arrêt19. Ainsi, que l’aveu soit obtenu par un procédé numérique ou classique importe peu. La Cour
de cassation s’attache uniquement à regarder la manière dont le procédé probatoire a été mis en
place. Elle s’interroge ainsi sur le fait de savoir s’il y a eu stratagème et tentative de détournement
des règles du code de procédure pénale qui protège la personne mise en cause.
6
Cass. civ. 1, 6 févr. 1979, n° 77-13.463.
7
Cass. soc. 2 oct. 2001, n° 99-42.942.
8
Cass. civ. 2, 3 juin 2004, n° 02-19.886.
9
Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-28.649, fichiers contenus dans une clé USB.
10
Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-89.444.
11
Cass. crim, 22 février 2017, n° 16-82412, pénétration dans un domicile suivant une autorisation de comparution sous la
contrainte.
12
Cass. crim, 6 janvier 2015, n° 14-85448, exigence d’une motivation spéciale.
13
Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-19.482.
14
Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-43.209.
15
Cass. soc. 6 févr. 2013, n° 11-23.738.
16
Cass. soc. 16 mars 2011, n° 09-43204, la cour de cassation a jugé que ce témoignage avait été obtenu de façon déloyale.
17
Cass. ass. plén. 6 mars 2015, n° 14-84.339.
18
Officiers de police judiciaire.
19
Cass. crim., 5 mars 2013, n° 12-87.087.
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
Cette démonstration s’applique à d’autres principes du droit de la preuve. Ainsi, la multiplication des
preuves numériques n’a pas modifié l’application du principe du contradictoire ou des droits de la
défense. Elle n’a pas changé le principe de liberté de la preuve, ni même le pouvoir d’appréciation
souveraine des juridictions du fond. Tous ces principes demeurent solidement inscrits dans le
système juridique et les nouveaux modes de preuves doivent s’y conformer, au risque de se voir
exclus du dossier ou d’être jugés non probants.
Cette tendance générale à la continuité des règles de droit et à la stabilité du socle juridique qui
régissent les preuves ne doit pas masquer l’apparition de zones de turbulences. Lorsque la preuve est
numérisée, le juge se trouve parfois confronté à une véritable difficulté : celle de l’intelligibilité de la
preuve, qu’il s’agisse de son contenu ou de sa fiabilité.
II. Le changement de paradigme : le juge face à une boîte noire
Le juge se trouve face à une boîte noire, lorsqu’on lui présente une preuve qui est le résultat d’un
processus technologie invisible on non intelligible. Par exemple, on lui présente un écrit électronique
illisible ou encore une signature électronique qui ne présente pas la forme d’une signature classique.
On se trouve alors face à un changement de paradigme, car la représentation de la preuve est
radicalement modifiée. Il ne s’agit plus d’une image, d’un son, ou de la localisation d’un individu. Il
s’agit simplement d’une suite de chiffres ou de symboles qui n’ont pas de signification immédiate. Ce
phénomène est illustré depuis une vingtaine d’années par la signature électronique et plus
récemment par la blockchain.
La signature électronique : un bouleversement porteur d’insécurité juridique
En 2000, lorsque le législateur a souhaité mettre en conformité le droit de la preuve avec l’apparition
du commerce électronique20, il a introduit dans le code civil la notion d’écrit et de signature
électronique. L’objectif était de créer une équivalence entre le support électronique et le support
papier. Cette équivalence devait s’exprimer, tant en termes d’admissibilité de la preuve électronique,
qu’à l’égard de sa force probante. Pour ce faire, la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 a d’abord
proposé une définition très générale de l’écrit, pouvant englober le support papier et électronique21.
Elle a ensuite posé une double condition à la reconnaissance de la valeur juridique de l’écrit
électronique. Il doit être possible d’identifier la personne dont il émane et il doit être établi et
conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Enfin, pour rendre l’écrit parfait, et
lui permettre de prouver l’existence d’un acte juridique (généralement un contrat), il doit être
signé22. Exprimées de façon abstraite, ces conditions ne semblent présenter aucune spécificité. On
pourrait même croire à une neutralité parfaite de la loi sur le terrain de la preuve. Toutefois, le
législateur – suivant les prescriptions de la directive européenne – a ajouté une présomption de
fiabilité du procédé d’identification inhérent à la signature électronique23. Cette présomption de
fiabilité n’existe pas pour la signature manuscrite. Au contraire, la signature manuscrite est
particulièrement fragile au regard de la procédure de contestation d’écriture. L’article 287 du code
de procédure civile prévoit que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas
reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge doit ordonner une vérification d’écriture. De
20
Et avec plusieurs directives européennes : la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre
1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et
du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du
commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »).
21
Article 1365 du code civil. Il s’agit d’une « suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles
dotés d'une signification intelligible ».
22
Article 1367 du code civil.
23
Cette présomption s’applique désormais à la signature dite « qualifiée ». Cf décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que cette mesure d’instruction s’impose au
juge24. Un juge serait ainsi mal inspiré de considérer qu’une dénégation d’écriture n’est pas sérieuse
et de refuser le droit à la mesure d’instruction. Sa décision serait automatiquement censurée. La
fragilité de la signature manuscrite découle de ce régime juridique, puisqu’il suffit à une partie de
dénier toute valeur à la signature qu’on lui oppose, pour se débarrasser de la charge de la preuve et
renvoyer au juge le soin de la vérification. Par ailleurs, la procédure de vérification d’écriture est
classique. Elle repose, d’une part, sur la confrontation d’écrits et d’autre part, sur une procédure
classique d’expertise en écriture.
Le régime de la signature électronique est tout autre. Si le procédé est conforme à l’article 1367 du
code civil, elle est présumée fiable et donc opposable à son auteur. Le procédé en question a recours
à l’intervention d’un tiers de confiance, qui a en charge d’identifier le signataire, de lui fournir un
moyen technique de signature et enfin de vérifier l’intégrité du document25. Ce tiers de confiance
utilise une procédure, en grande partie informatique, pour certifier que la signature électronique
remplit les conditions légales. Ce procédé est externalisé. Le tiers de confiance ne connaît pas le
signataire. Il ne l’a pas rencontré. Il s’agit d’un prestataire privé. Les moyens informatiques qu’il met
en œuvre ne sont pas, en eux même intelligibles. S’il devait expliquer à un juge sa méthode de
certification, il devrait user de schémas et d’explications complexes pour traduire des lignes de Code.
Mais l’intégrité de l’opération elle-même est faillible.
Le code civil attribue une présomption de fiabilité à ce mécanisme complexe de certification, qui se
déroule à l’extérieur du tribunal et également à l'écart des parties. Mettons-nous à présent dans la
peau d’un justiciable, à qui l’on oppose sa signature électronique présumée fiable pour lui réclamer
le payement d’une créance. Imaginons que celui-ci estime ne rien devoir, car il n’a rien signé. Sa clé
numérique peut avoir été subtilisée. Il peut l’avoir confiée à un collaborateur. Son réseau peut avoir
été piraté. Imaginons donc tout un ensemble d’évènements susceptible de perturber l’ensemble du
mécanisme, sans même remettre en cause la confiance que l’on place dans le tiers certificateur26. La
question se pose de savoir ce que peut faire ce justiciable pour renverser la présomption. Il ne peut
pas dénier son écriture, car cela ne produira juridiquement aucun effet. Il doit apporter une preuve
contraire, mais l’ensemble du processus s’est fait sans son intervention. Il ne dispose d’aucun moyen
de preuve pour démontrer que la clé a été subtilisée, mal utilisée, ou encore qu’il est victime d’un
piratage. Il sera donc contraint de solliciter en justice une mesure d’instruction. Ici, une nouvelle
difficulté va surgir : quelle sera la mesure d’instruction pertinente ? Plus précisément, où doit-on
chercher le dysfonctionnement ? Faut-il réaliser des investigations chez le justiciable ou chez le
prestataire de service qui certifie la signature ? Peut-on demander à ce dernier de produire des
pièces permettant d’avoir l’assurance qu’il a respecté les normes de sécurité ? Et en définitive, dans
quelle mesure le juge va-t-il saisir et maîtriser la complexité du processus informatique que le tiers a
mis en œuvre pour certifier la signature ?
Aucune de ces questions n’a pour l’instant été résolue. Comme l’indique Jean-François Le Coq27, la
signature électronique a été peu utilisée depuis l’entrée en vigueur de la loi. Plus encore, cette
signature n’arrive que très rarement devant la Cour de cassation. Le cadre juridique qui lui est
applicable demeure, près de 20 ans après sa mise en place, toujours aussi flou. Les procédés
techniques de signature électroniques se sont diversifiés. Certains utilisent des clés USB pour
s’identifier. D’autres, après avoir constaté visuellement l’identité des parties, utilisent un code
transmis par SMS pour valider la procédure de signature (acte contresigné par avocat, contrats
conclus par des assureurs). D’autres encore, comme les notaires, utilisent une signature manuscrite
24 ère
Cass. civ. 1 , 7 avr. 1999, n° 97-13.476.
25
Nous renvoyons à l’étude très claire de Jean-François LE COQ publiée dans ce dossier, et consacrée à la signature
électronique.
26
Celui-ci peut aussi commettre des erreurs.
27
Dans cette revue.
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
par stylet sur un écran électronique. Enfin, certains acteurs font signer électroniquement divers
contrats (des contrats d’auteurs), par un simple échange de clics dans des mails.
La question se pose à nouveau de savoir comment un juge peut reconnaître un procédé présumé
fiable parmi toutes ces techniques. La simple lecture des textes (loi, décrets, arrêtés) ne permet pas
de saisir les conditions exactes d’application de cette présomption. Par exemple, l’usage d’un stylet
sur une tablette électronique est bien un procédé manuscrit, mais il est numérisé en temps réel et
l’identité de l’individu est constatée au moment de la signature par le notaire qui assure l’efficacité
de l’acte. Doit-on alors considérer que la signature est électronique, qu’elle est manuscrite, ou
encore qu’elle ne suit aucun procédé reconnu par le code civil ?
L’écrit électronique, et la signature électronique qui en est la condition de perfection, constituent de
véritables bombes à retardement. Nul ne peut dire aujourd’hui quels seront les procédés reconnus
comme probants par la Cour de cassation et, lorsque la présomption sera reconnue à certaines
signatures, quelle sera la méthode procédurale pour la combattre. Autant d’incertitude ne convient
certainement pas à l’exigence de sécurité juridique qui domine le droit des contrats. Cette insécurité
pourrait être sensiblement accrue avec l’irruption récente de la technologie blockchain.
La blockchain : une preuve numérique équivoque
La blockchain est un procédé numérique qui sert à conserver la preuve d’informations de toutes
natures. À l’origine, elle n’a pas été créée dans le but d’être intégrée dans un cadre légal. Au
contraire, elle fonctionne dans un réseau de personnes qui opèrent des transactions en dehors d’une
reconnaissance juridique. Le cas le plus typique est celui du bitcoin, qui est un système à la fois de
monnaie, de transactions, mais également de stockages d’informations de toutes natures. En
pratique, il est possible de stocker dans une blockchain, des informations relatives à contrat, mais
aussi tout autre contenu (ex. une œuvre littéraire, le descriptif d’un savoir-faire), pourvu qu’il puisse
être codé dans un format numérique. Le document numérique passe dans un processus de
« haschage » et il ressort sous la forme d’une « empreinte », c’est-à-dire d’une suite de chiffres.
Cette empreinte est inscrite dans un bloc qui contient de nombreuses empreintes et ce bloc prend sa
place dans une chaîne de blocs28.
Sans entrer dans la description technique de ce processus, on peut en retracer diverses
caractéristiques en prenant l’exemple d’un contrat qui serait ainsi intégré dans une blockchain :
- le contenu du contrat n’est pas enregistré sur cette blockchain ; seule son empreinte l’est ;
- l’empreinte ne permet pas de reconstituer le contenu du contrat et donc d’en connaître la teneur ;
- la fiabilité de l’opération d’archivage n’est pas confiée à un prestataire de service de confiance
certifié. La blockchain fonctionne grâce à un réseau d’acteurs privés, qui détiennent des serveurs
informatiques et réalisent des opérations mathématiques ésotériques pour certifier les
transactions29. La confiance dans ce système repose sur la masse de ces acteurs qui authentifient
l’opération contractuelle. Mais certains réseaux d’acteurs font déjà l’objet de luttes de pouvoirs pour
détenir la majorité des votes d’authentification, ce qui permet de douter de la fiabilité du système
dans son principe même ;
- l’identité de celui qui enregistre le contrat n’est pas connue, car celui-ci opère au moyen d’un
pseudonyme.
Toutes ces caractéristiques rendent l’usage de la blockchain peu compatible avec les règles de preuve
et les pratiques juridictionnelles en la matière. Pour autant, cette technologie se développe à grands
pas et nombreux sont les acteurs qui défendent son utilisation comme preuve dans les revues
juridiques30. Les juristes, quant à eux, demeurent sur la réserve31. Malgré cela, on a tout de même
28
Une suite de registres d’informations numériques.
29
Ils résolvent des problèmes mathématiques complexes pour être mis en concurrence.
30
Bien que ces acteurs ne soient pas toujours juristes. Cf par ex. Clément BERGÉ-LEFRANC, « La blockchain est une
technologie très efficace pour se préconstituer une preuve », entretien in Revue Lamy Droit civil, n° 150, 1er juillet 2017.
31
Cf, notamment, les opinions émises par les auteurs du dossier « Preuve et blockchain », Dalloz IP/IT, 2019, p. 73 et suiv.
cf également l’étude de Thibault DOUVILLE, « Blockchains et preuve », Recueil Dalloz, 2018, p. 2193.
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
LE TRAITEMENT DE LA PREUVE NUMÉRIQUE DANS LES PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET PÉNALES
trouvé des parlementaires assez imprudents pour proposer que les opérations effectuées au sein
d’une blockchain soient assimilées à des actes authentiques32. La force probante de la blockchain
repose, en réalité, sur la structure du système de confiance qui existe sur le réseau. Le procédé de
cryptographie qui permet d’introduire les éléments dans la blockchain, puis le système de validation
par une majorité de plus de 50% des acteurs de ce réseau donne à ce processus de nombreux
attraits. Toutefois au regard du cadre juridique français, il pose de nombreuses questions.
D’une part, sur le terrain de la preuve des actes juridiques, la blockchain ne remplit pas les conditions
d’admissibilité posées par le code civil. D’abord, le procédé est loin d’être intelligible33. Ensuite,
aucun élément ne permet d’identifier le signataire de l’acte. Seule l’existence de l’acte est inscrite
dans la blockchain par une personne utilisant un pseudonyme. Cette personne peut introduire dans
la blockchain n’importe quelle transaction, sans même que les parties désignées dans l’acte n’en
soient informées. Enfin, le prestataire de service de confiance est absent du processus de la
blockchain. Dès lors, la blockchain ne présente pas les caractéristiques d’une preuve électronique
dont la signature serait présumée fiable. On peut même lui dénier le caractère d’écrit sous seing
privé, puisque la signature n’est pas un élément intrinsèque à l’inscription d’un contrat dans une
blockchain. Ainsi, quelle que soit la confiance qu’elle inspire aux acteurs économiques, sa valeur
juridique demeure faible.
Dans un système de preuve libre, les choses sont différentes. Le juge n’a aucune raison de rejeter a
priori un document issu d’une blockchain. Toutefois, ce document n’est pas intelligible en lui-même.
Il s’agit d’une empreinte numérique issue d’une procédure de codage d’un document et cette
empreinte ne permet pas de remonter jusqu’au document. En effet, le codage ne peut avoir lieu que
dans un sens. Le document produit l’empreinte et l’empreinte ne produit rien. Pour retrouver le
document, il faut réaliser une opération complexe. Celui qui prétend avoir archivé le document doit
détenir une « clé » (un code secret) et une copie du document dont il se prévaut en justice. Avec
cette copie et cette clé, il doit procéder à un nouveau codage de la copie dans la blockchain. Si ce
codage génère une empreinte identique à celle qu’il possède déjà, cela signifie que la copie du
document est conforme à l’original dont il se prévaut. La copie peut être produite en justice et être
jugée conforme à l’original. Ce processus est loin d’être simple et il ne peut être réalisé qu’avec l’aide
d’un huissier ou au moyen d’une mesure d’expertise judiciaire. Pour le juge, le processus se déroule à
l’aveugle. Il ne voit pas le document qui a été archivé dans la blockchain et ne peut rien déduire de
l’empreinte qu’on lui présente. Il doit simplement reconnaître à l’issue du processus que la copie
qu’on lui présente est conforme à l’original qui a été codé et archivé dans la blockchain.
À l’issue de ce processus probatoire qui nécessite l’intervention d’un auxiliaire traditionnel de la
justice (un huissier, un expert), le juge peut finir par être convaincu qu’une copie produite en justice
est conforme à l’original. La blockchain n’a donc pas une force probante intrinsèque. Cette force est
dépendante de modes de preuves traditionnels. De surcroît, sa valeur probante dépend de la
capacité du juge à comprendre le processus de stockage et de déstockage du document. Elle dépend
également de la confiance que le juge souhaite accorder à ce processus et à la blockchain elle-même.
Présentée comme économiquement peu coûteuse et comme technologiquement très fiable, la
technique de préconstitution des preuves par blockchain remet en cause les principes essentiels de la
preuve, en particulier lorsqu’il s’agit de prouver un acte juridique. Elle constitue un véritable
changement de paradigme, car elle contient en elle-même un bouleversement des pratiques
juridictionnelles. Elle demande au juge de croire ce qu’il ne peut pas voir, de faire confiance en
l’absence d’un tiers de confiance, et de reconnaître l’identité d’un signataire qui a utilisé un
pseudonyme. Autant de bouleversements qui nécessiteront, à l’avenir, l’intervention du législateur,
pour donner à la blockchain un statut juridique spécifique si l’on souhaite qu’elle accède à la fonction
probatoire à laquelle elle prétend.
32
Cet amendement est cité par Mustapha MEKKI, in « Les mystères de la blockchain », Recueil Dalloz, 2017, p. 2160.
33
En ce sens, déjà, Mustapha MEKKI, précit.
Justice actualités n° 21 / Juin 2019
Vous aimerez peut-être aussi
- Le droit de la régulation audiovisuelle et le numériqueD'EverandLe droit de la régulation audiovisuelle et le numériquePas encore d'évaluation
- OBS Monde Cybernétique 201711Document11 pagesOBS Monde Cybernétique 201711bobPas encore d'évaluation
- Registre RGPD BasiqueDocument7 pagesRegistre RGPD BasiqueyannPas encore d'évaluation
- Le Cyber-Harcèlement: Lorsque Le Harceleur S'Introduit Dans Votre Ordinateur.D'EverandLe Cyber-Harcèlement: Lorsque Le Harceleur S'Introduit Dans Votre Ordinateur.Pas encore d'évaluation
- La DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalyseD'EverandLa DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalysePas encore d'évaluation
- Risque-Informatique Web FR v3Document48 pagesRisque-Informatique Web FR v3gbegbePas encore d'évaluation
- SLA Marche A Suivre PDFDocument10 pagesSLA Marche A Suivre PDFIbrahim BekkaliPas encore d'évaluation
- Le Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l’entrepriseD'EverandLe Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l’entreprisePas encore d'évaluation
- Procédure de Mise en Rebut OkDocument8 pagesProcédure de Mise en Rebut OkwasoldoPas encore d'évaluation
- Le Data Protection Officer: Une fonction nouvelle dans l'entrepriseD'EverandLe Data Protection Officer: Une fonction nouvelle dans l'entreprisePas encore d'évaluation
- Plan de Continuite Dactivite Premier MinDocument80 pagesPlan de Continuite Dactivite Premier MinPape Mignane FayePas encore d'évaluation
- Em2 Pca Iso - 22301Document4 pagesEm2 Pca Iso - 22301Faress RabiPas encore d'évaluation
- Les Six Pilliers de La Gestion Des Identites Et Des AccesDocument22 pagesLes Six Pilliers de La Gestion Des Identites Et Des AccesdjoneillPas encore d'évaluation
- Politique Sur La Sécurité de L'informationDocument12 pagesPolitique Sur La Sécurité de L'informationFrédéric GagnonPas encore d'évaluation
- Démarche MehariDocument5 pagesDémarche MehariZela TahirePas encore d'évaluation
- Générateur de Guides D'audit (Tutoriel)Document7 pagesGénérateur de Guides D'audit (Tutoriel)Ammar SassiPas encore d'évaluation
- Menaces InfoDocument4 pagesMenaces InfoAli KarambéPas encore d'évaluation
- Charte Utilisation Ressources InformatiquesDocument7 pagesCharte Utilisation Ressources InformatiquesPatrick ROBSON ANDRIANARIMANGA0% (1)
- Procedures Operationnelles Pour Les Technologies de L'Information Et Des CommunicationsDocument3 pagesProcedures Operationnelles Pour Les Technologies de L'Information Et Des CommunicationsNYONGOPas encore d'évaluation
- SMSI-CH-RFO-01-Charte S+® Curit+® PrestataireDocument14 pagesSMSI-CH-RFO-01-Charte S+® Curit+® PrestataireFouad EL YOUBIPas encore d'évaluation
- Risk Assessment Checklist FRDocument11 pagesRisk Assessment Checklist FRanis100% (1)
- 3 - Télétravail - Risques Et PréventionDocument22 pages3 - Télétravail - Risques Et PréventionEric CourtinPas encore d'évaluation
- Politique D'utilisation Acceptable v2.10Document15 pagesPolitique D'utilisation Acceptable v2.10Nono Bon2018Pas encore d'évaluation
- Expose Sur Le PRA Et PCADocument22 pagesExpose Sur Le PRA Et PCANdongo Fall100% (1)
- Itil Gestion CapaciteDocument6 pagesItil Gestion CapaciteKanza ElrhaliPas encore d'évaluation
- 2014 - 07 - 09 - 10 - 38 - 41 - FichePratique - PRA - PCA - WEB (1Document6 pages2014 - 07 - 09 - 10 - 38 - 41 - FichePratique - PRA - PCA - WEB (1chokriPas encore d'évaluation
- FRA Classification Des DonneesDocument24 pagesFRA Classification Des DonneesYassine Samah100% (1)
- Cnil Pia Captoo FR PDFDocument38 pagesCnil Pia Captoo FR PDFMirela Vlasica100% (1)
- Canevas Pour La Redaction D Une Politique de Securite Version Ixarm Du 2012-02-16Document3 pagesCanevas Pour La Redaction D Une Politique de Securite Version Ixarm Du 2012-02-16Ibrahima SembenePas encore d'évaluation
- Projetcloudscurit 150409043744 Conversion Gate01Document34 pagesProjetcloudscurit 150409043744 Conversion Gate01hossamPas encore d'évaluation
- g2 008 FraDocument13 pagesg2 008 FraiterumPas encore d'évaluation
- LMPS AUSIM Livre Blanc Classification Des DonnéesDocument20 pagesLMPS AUSIM Livre Blanc Classification Des DonnéesSucitu EmanuelPas encore d'évaluation
- Modèle de Politique de Sécurité Des DonnéesDocument10 pagesModèle de Politique de Sécurité Des DonnéesNath PePas encore d'évaluation
- RG00044-Charte de L'utilisateur Des Outils NumériquesDocument14 pagesRG00044-Charte de L'utilisateur Des Outils NumériquesHamza OuhedeniaPas encore d'évaluation
- Nouveau Référentiel Publié Par l'ANSSIDocument59 pagesNouveau Référentiel Publié Par l'ANSSIimedPas encore d'évaluation
- 2008 05 23 PSSI DirDocument26 pages2008 05 23 PSSI DirBerrezeg MahieddinePas encore d'évaluation
- Gestion Des Risques Informatiques-1Document2 pagesGestion Des Risques Informatiques-1Salah Eddine BouchenialPas encore d'évaluation
- PASSI Referentiel-Exigences v2.1Document44 pagesPASSI Referentiel-Exigences v2.1Soufiane AlamiPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges Relatif À La Mise en Place D'un Dispositif de VeilleDocument7 pagesCahier Des Charges Relatif À La Mise en Place D'un Dispositif de VeilleFatnassi KaisPas encore d'évaluation
- Gestion Des RisquesDocument25 pagesGestion Des RisquesSoukaina TadlaouiPas encore d'évaluation
- Non ConformiteDocument2 pagesNon ConformitealleyPas encore d'évaluation
- PSSIDocument15 pagesPSSIPatrick CloarecPas encore d'évaluation
- PCA - Définition, Enjeux Et Mise en Place Du Plan de Continuité de L'activité - CadremploiDocument1 pagePCA - Définition, Enjeux Et Mise en Place Du Plan de Continuité de L'activité - CadremploiFarid GnonlonfounPas encore d'évaluation
- LB - Smile - Guide Open Source-2014 PDFDocument316 pagesLB - Smile - Guide Open Source-2014 PDFPrince Godasse Okitembo100% (1)
- Memoire PSSIDocument58 pagesMemoire PSSIJokebed Grace EbenezerPas encore d'évaluation
- CV Nge 2019Document2 pagesCV Nge 2019Anonymous mENoLX100% (1)
- 00 - Plaquette Formations Vf7 07.02.23Document65 pages00 - Plaquette Formations Vf7 07.02.23Formation Comptabilite100% (1)
- La Législation en Centre D'appelsDocument2 pagesLa Législation en Centre D'appelsLADRECPas encore d'évaluation
- PCI DSS Glossary v3-2 FR-FRDocument30 pagesPCI DSS Glossary v3-2 FR-FRmeryem7rachadPas encore d'évaluation
- Pci Dss Saq Navigating DssDocument60 pagesPci Dss Saq Navigating DssYounes Younes100% (1)
- Cybersecurity Incident Management Guide FRDocument44 pagesCybersecurity Incident Management Guide FRPape Mignane FayePas encore d'évaluation
- Oncf JdudDocument24 pagesOncf Jdudkhalid benzarPas encore d'évaluation
- CLUSIF 2011 Gestion Des Incidents PDFDocument60 pagesCLUSIF 2011 Gestion Des Incidents PDFBrahim KhizranePas encore d'évaluation
- Guide Homologation de Securite en 9 EtapesDocument80 pagesGuide Homologation de Securite en 9 EtapesyezzynPas encore d'évaluation
- Métier RSSIDocument2 pagesMétier RSSILeflej MouradPas encore d'évaluation
- ETUDE ET PROTECTION DES ACTIFS INFORMATIONNELS DANS UNE (Enregistrement Automatique)Document22 pagesETUDE ET PROTECTION DES ACTIFS INFORMATIONNELS DANS UNE (Enregistrement Automatique)Arsene YoutchPas encore d'évaluation
- Donnees PersonnellesDocument38 pagesDonnees PersonnellesnangaayissiPas encore d'évaluation
- Togo Loi 2012 18 Communications Electroniques PDFDocument24 pagesTogo Loi 2012 18 Communications Electroniques PDFSidick GrdPas encore d'évaluation
- Cobit 2Document2 pagesCobit 2Jean BonPas encore d'évaluation
- DiprDocument2 pagesDiprMarc MbentyPas encore d'évaluation
- 45elevesDivRegieFinancieresBFr PDFDocument6 pages45elevesDivRegieFinancieresBFr PDFMarc MbentyPas encore d'évaluation
- AFFAIRE STE SAPI SCI Contre (MINDCAF) ET ARNO PDFDocument84 pagesAFFAIRE STE SAPI SCI Contre (MINDCAF) ET ARNO PDFMarc MbentyPas encore d'évaluation
- 2 - Article - Anaba - FridolinDocument22 pages2 - Article - Anaba - FridolinMarc MbentyPas encore d'évaluation
- 1037252ar PDFDocument14 pages1037252ar PDFMarc MbentyPas encore d'évaluation
- 044139ar PDFDocument36 pages044139ar PDFMarc MbentyPas encore d'évaluation
- 02 1985 p091 105 PDFDocument15 pages02 1985 p091 105 PDFMarc MbentyPas encore d'évaluation
- Projet PFE01Document127 pagesProjet PFE01soukaPas encore d'évaluation
- Trading Price Action TRENDSDocument53 pagesTrading Price Action TRENDSKOUASSI KOFFI JEAN DE CAPISTRANPas encore d'évaluation
- La Motivation Des Élèves de Formation ProfessionnelleDocument22 pagesLa Motivation Des Élèves de Formation ProfessionnelleOlsen MalagaPas encore d'évaluation
- Sujet 2022Document4 pagesSujet 2022baha brahmiPas encore d'évaluation
- Colle 02Document2 pagesColle 02Hamed TraorePas encore d'évaluation
- Antoche 1497Document21 pagesAntoche 1497Flynders PetryePas encore d'évaluation
- Cours No 10-Ostèologie (Suite)Document7 pagesCours No 10-Ostèologie (Suite)Feriel FerielPas encore d'évaluation
- Registre D'élevage Gratuit Plateforme Du MielDocument12 pagesRegistre D'élevage Gratuit Plateforme Du Mielmas.eric34Pas encore d'évaluation
- Exposé Réorganisation Du CapitalfinalDocument30 pagesExposé Réorganisation Du CapitalfinalAdil BentalebPas encore d'évaluation
- Ystème NerveuxDocument4 pagesYstème NerveuxRabab Tamouh0% (1)
- Exercices Is LM BPDocument6 pagesExercices Is LM BPDachka Ridore100% (1)
- Pont Mixte FINALDocument26 pagesPont Mixte FINALĐíßMohammedRiadPas encore d'évaluation
- 2les NavigateursDocument2 pages2les NavigateursImane TlmPas encore d'évaluation
- JumiaDocument3 pagesJumiakhalidPas encore d'évaluation
- PédopsyDocument3 pagesPédopsyTASMINE HAMZAPas encore d'évaluation
- 425 914 1 SMDocument10 pages425 914 1 SMkami ouachemPas encore d'évaluation
- Le Marketing Digital Pour Les NulsDocument453 pagesLe Marketing Digital Pour Les NulsAMINEPas encore d'évaluation
- Osp 1168-35-4 La Notion de Projet en Psychologie de L OrientationDocument13 pagesOsp 1168-35-4 La Notion de Projet en Psychologie de L OrientationMus OubPas encore d'évaluation
- Les Points Clé Pour Bien Écrire.Document60 pagesLes Points Clé Pour Bien Écrire.HanKethyaneth100% (1)
- Fiche ROME BrasseurDocument5 pagesFiche ROME BrasseuryannplmrPas encore d'évaluation
- Convention PFE EntrepriseenTunisieDocument3 pagesConvention PFE EntrepriseenTunisieChaima BelhediPas encore d'évaluation
- NXO 5v7ds7NU PDFDocument69 pagesNXO 5v7ds7NU PDFChristophe GarnierPas encore d'évaluation
- Fonction Convertir Machines Synchrones Triphases CoursDocument5 pagesFonction Convertir Machines Synchrones Triphases CoursdddddPas encore d'évaluation
- Ingénierie - Le Cycle en VDocument3 pagesIngénierie - Le Cycle en VbommobPas encore d'évaluation
- La Création de ValeurDocument68 pagesLa Création de Valeursene seydina mouhamedPas encore d'évaluation
- French Gr5 Final RevDocument5 pagesFrench Gr5 Final Revezzeldin3khaterPas encore d'évaluation
- Cours 4 Introduction À La Génomique 2021Document10 pagesCours 4 Introduction À La Génomique 2021fsxnsstoaehkbhlzygPas encore d'évaluation
- Les Produits D EntretienDocument3 pagesLes Produits D EntretienSandrine CharinPas encore d'évaluation
- Cps TraverséDocument77 pagesCps TraverséYoussefChariPas encore d'évaluation
- Théorie Des MachinesDocument20 pagesThéorie Des MachinesJeanne Varenne EmvutouPas encore d'évaluation