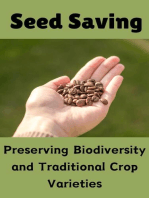Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Bâ Durabilité System Pro
Bâ Durabilité System Pro
Transféré par
Patrick EbaDescription originale:
Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Bâ Durabilité System Pro
Bâ Durabilité System Pro
Transféré par
Patrick EbaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Culture du bananier plantain et durabilité des systèmes
de productio n
T LESCOT Plantain production and sustainable production systems .
Cirad-Flho r
ABSTRACT
IICA
Apartado 71 1 INTRODUCTION . Plantain is a staple food for people in humid tropical countries . However, with
Saint-Domingu e the increase in demand; growing sufficient plantain sustainably poses certain problems . THE PLANT .
République dominicaine Plantain, a natural hybrid, is a large perennial herbaceous plant . It is often cultivated in regions
beyond its natural ecological niche . HOME CONSUMPTION: HISTORICAL BASIS OF PRODUCTION . The
crop is mainly grown for home consumption, although increasing quantities of plantain ar e
being sold on the market . TILE MARKETS. The major development of a market for plantain puts pres-
sure on producers to modify their production methods . TILE PRODUCTION CYCLE . There is little varia-
tion in the natural cycles of the different cultivars of the plant . Managing production so that th e
harvests of the different cultivars coincide is only possible in the year the crop is planted .
However, in regions where there is a dry season, the harvest period tends to coincide more mar-
kedly. SMALLHOLDER PRODUCTION STRATEGIES . Production systems are varied and sometimes com-
plex. They range from subsistence farming systems with intercrops to intensive monoculture s
that produce bananas for export . THE CROPPING SYSTEM . The growing techniques that defin e
these systems are less varied . The use of inputs is rare and is linked to low levels of profitabi-
lity . The degree of sustainability depends on soil quality . CONCLUSION : RISK CONTROL AND INTEN-
SIFICATION . It would be easier to intensify production by growing compatible intercrops than b y
increasing the use of inputs .
KEYWORDS
Musa (plantains), farm managment, sustainability .
Culture du bananier plantain et durabilité des systèmes de production .
RÉSUM É
nvtlODUCFION . La banane plantain est un aliment de base des populations des zones intertropicales
humides. Cependant, sa culture a des difficultés à maintenir une production durable et suffisante ,
face à l'accroissement de la demande . LA PLANTE . Le bananier plantain, hybride naturel, est une
grande plante herbacée et vivace. Son extension agricole dépasse souvent le cadre de ses exi -
gences écologiques . L'AUTOCONSOMMATION : BASE HISTORIQUE DE IA PRODUCTION . L 'autoconsommation
est le principal débouché de la culture, mais la part de la production marchande tend à aug-
menter . LES MARCHÉS . Le développement important d'un système marchand a tendance à
contraindre les producteurs de plantain à modifier leurs processus de production . LE CALEN-
DRIER DE PRODUCTION . Le cycle naturel de la plante, tous cultivars confondus, varie peu . Un
regroupement de la période de production n'est possible que l'année de plantation. Cependan t
-dans leszones à-saison -sèche, la-tendance au regroupement est plusmarquée . LES STRATÉGIES PAY-
SANNES DE PRODUCTION. Les systèmes de production sont variés et parfois complexes, ils vont de s
productions de subsistance en cultures associées aux cultures monospécifiques intensives de typ e
Reçu le 15 octobre 1996 banane d 'exportation . LE SYSTÈME DE CULTURE . Les actes techniques définissant les systèmes d e
Accepté le 10 juillet 1997 culture sont moins variés, l'utilisation d'intrants est peu fréquente et souvent liée à une faible valo-
risation des productions . Les degrés de durabilité sont fortement dépendants de la qualité de s
sols . CONCLUSION : CONTRÔLE DES RISQUES ET INTENSIFICATION. L'intensification de la production
passerait plus facilement par la complémentarité de cultures associées que par la consommatio n
d'intrants .
Fruits, 1997, vol 52, p 233-245
® Elsevier, Pari s MOTS CLÉS
RESUMEN $PAÑOL, p 245 Musa (plantain), gestion de l'exploitation agricole, durabilité .
Fruits, vol 52 (4) 233
LESCOT
introduction dit des plantains, le plus important en termes
de production-consommation et d'écono-
mie locale. Ce sous-groupe se distingue net -
Le bananier plantain fait partie intégrante tement des autres par quelques caractéris-
du paysage agricole de la zone intertropi-
tiques essentielles, bien que les apparence s
cale humide et plus particulièrement e n
puissent faire penser le contraire .
Afrique et en Amérique latine-Caraïbes. Bie n
que sa production revête une grande impor- Le bananier plantain est une plante herbacée
tance parmi les produits de base de l'ali- vivace de grande dimension — de 3 à 7 m d e
mentation des populations locales, ce n'es t hauteur —, composée d'une tige souterraine ,
que depuis une dizaine d'années que les de feuilles et d'une inflorescnce .
organismes de recherche et de développe -
ment s'intéressent à sa culture . Pourtant de La tige souterraine est appelée bulbe, souche
réels problèmes existent pour maintenir un e ou rhizome . Ce bulbe porte sur son pour-
production durable et suffisante, face à u n tour latéral des oeilletons qui se dévelop-
accroissement permanent de la demande . pent en rejets . Il émet, en outre, jusqu'à l a
floraison, un grand nombre de racines peu
Si, dans le cadre des politiques d'autosuffi- lignifiées, de 30 cm à 3 m de longueur, qu i
sance alimentaire, les autres production s restent le plus souvent groupées dans le s
vivrières telles que les tubercules, les hari- trente premiers centimètres du sol .
cots, le maïs ou le riz bénéficient d'une
volonté d'appui, en matière de recherche e t Au sommet de chaque gaine se développ e
développement, de la part des pouvoirs poli - le pétiole qui se prolonge par la nervur e
tiques, la banane plantain, culture semi- centrale et supporte le limbe . L'enroulement
pérenne difficilement classable, ne fait pa s des gaines les unes dans les autres forme
l'objet de la même attention . Pourtant, ell e le pseudotronc.
est confrontée à des difficultés grandissante s Lorsque le bananier a formé une quaran-
de stabilisation des activités et des revenus , taine de feuilles, le bourgeon terminal d u
de dégradation du capital agro-écologique — bulbe se développe, monte dans le faux -
problème du maintien des fertilités, pres-
tronc et donne l'inflorescence qui sort a u
sion parasitaire, etc —, de valorisation éco- centre du bouquet foliaire et se retourne
nomique de ces productions ou d'intensifi- vers le bas : c'est la formation du régime .
cation-modernisation . Ce régime allonge son axe ou hampe . Il se
compose de fleurs femelles » qui donnen t
les fruits et les fleurs « mâles » groupées dan s
le bourgeon mâle . Les fleurs femelles son t
la plante groupées en mains composées de doigts o u
bananes .
La distinction ancienne entre les bananes à
cuire et celles qui sont consommées crues , Les fleurs sont stériles, les fruits sont par-
dites douces ou dessert », n'est pas absolue . thénocarpiques, ils ne produisent pas d e
Cependant, elle est grossièrement utile pou r graine . La diversité variétale existante et cul -
bien marquer les deux types d'utilisation . tivée est issue de mutations somatique s
La banane vivrière, source importante de fixées par le processus de multiplicatio n
produits amylacés énergétiques et consom- végétative et amplifiées par une pressio n
mée après diverses sortes de cuisson ; produit de sélection millénaire appliquée -par-les-
des quantités considérablement plus impor- agriculteurs .
tantes que la banane douce consommée
Les exigences écologiques de la culture d u
localement ou exportée vers les région s bananier plantain correspondent à celles d e
froides du globe . la forêt équatoriale sempervirente . Cepen-
Comme pour la banane douce où plusieur s dant, son extension agricole dépasse c e
variétés sont utilisées par le commerce inter- cadre ; elle est limitée par :
national, de nombreuses variétés de bana- —une pluviométrie annuelle inférieure à
niers produisent des fruits utilisés de préfé- 1 000 mm ;
rence après cuisson . Pour plus de commodité, —des saisons sèches sévissant plus de troi s
nous nous limiterons à un « sous-groupe », mois ;
234 Fruits, vol 52 (4)
CULTURE DU BANANIER PLANTAIN
— des températures inférieures A. 16 °C ; duction autoconsommée s'étend, culturelle -
— des risques élevés de vents violents, d e ment, à la famille élargie, voire au voisinage ,
cyclones, par exemple ; et à la main-d'oeuvre agricole associée, per -
— des sols lourds, peu drainants, très acides , manente et/ou saisonnière ; elle a donc u n
dont le pH est inférieur à 5, ou à faible rôle social.
réserve cationique et teneur en matière orga-
nique inférieure à 1 % . Dans cette économie d'autosubsistance, le s
agriculteurs ou/et agricultrices — puisque le s
Botaniquement, le sous-groupe des plan- femmes constituent le pilier de l'agricultur e
tains (SlatuoNDS, 1962), est issu d'un hybrid e vivrière en Afrique — dédient une partie de l a
naturel entre deux espèces de Musa : Musa surface exploitée à la culture du bananie r
acuminata x M balbisiana, AAB . Si l'ori- plantain, comme ils le font pour les autres
gine de ces espèces parentales, l'Asie d u productions, telles que les tubercules, l e
Sud-Est, est bien identifiée, l'origine du sous - haricot, le maïs et parfois le riz, qui forment
groupe est beaucoup plus difficile à établir . la base de leur alimentation .
Il existe une grande diversité de formes et
de variétés : plus de 60 formes ont été recen- La parcelle, malgré la diversité des système s
sées en Afrique centrale forestière, uniqu e de conduite de la culture, est exploitée d'un e
zone de diversification secondaire ; elles ont manière semi-pérenne à pérenne, et un e
production, la plus régulière possible tou t
été caractérisées et mises en collection dan s
les parcelles expérimentales du CRBP 1 au au long de l'année, est attendue ou recher-
chée . Cette régularité est d'autant plus diffi-
Cameroun . Trois types ont été définis : le
' french » présente des régimes de six à plus cile à atteindre que la (ou les) saison s
de dix mains de nombreux doigts courts , sèche(s) sont importantes.
qui peuvent atteindre plus de 40 kg, l e Les volumes consommés dans les régions
,< faux-corne a des régimes de quatre à sept tropicales humides sont, pour des raison s
mains de quelques doigts gros et longs et essentiellement culturelles, très variables :
une inflorescence terminale incomplète , ils vont de quelques kilos par an et par habi-
pouvant atteindre 18 kg et le ,, vrai-corne u a tant dans les zones frontières les plus sèche s
des régimes de un à trois mains de quelques ou plus froides A. plus de 100 kg dans le s
doigts gros et longs, sans inflorescence ter- zones rurales d'Afrique centrale, comme a u
minale, pouvant atteindre 10 kg (TÉZENAS D U Cameroun (TEMPLE, 1995), ou d'Amériqu e
MONTCEL, 1985) . latine, comme en Colombie (BELALCAzAR ,
La diversité au travers de l'homogénéité d u 1993), et peuvent dépasser 30 % de la ratio n
sous-groupe a des effets importants sur le s calorique .
techniques de culture . Les diverses tolé- Les excédents produits sont irrégulièremen t
rances et sensibilités à divers prédateurs e t proposés à la vente, entraînant un flu x
parasites sont relativement mal connues . continu, mais irrégulier, d'approvisionne-
Plusieurs variétés sont souvent plantée s ment des marchés à l'échelle de la région . Il
ensemble, au sein d'une même parcelle pa r n'existe donc pas, réellement, de calendrie r
les agriculteurs . d'approvisionnement, que ce soit pour l'au-
toconsommation alimentaire ou pour le s
marchés .
l'autoconsommation : Aujourd'hui, le développement des marché s
urbains et villageois entraîne l'essor de cette
base historiqu e production marchande et fait de la banane
plantain une des principales sources régu-
de la productio n lières de trésorerie dans les zones rurales .
Elle permet d'attendre la récolte de la cultur e
Traditionnellement, dans la quasi-totalité d e principale constituée par le café ou le caca o
la zone intertropicale humide, le principa l et de compenser les fluctuations, souven t
objectif de la culture du bananier plantain importantes, des revenus issus de la vente d e
est de fournir à l'agriculteur et à sa famill e ces produits ; elle permet, aussi, d'assurer CRBP : Centre régional
un produit de base qu'il utilise quotidien- une grande partie des dépenses courante s bananiers et plantains ,
nement dans son alimentation . Cette pro - du ménage et même une partie des coût s Douala, Cameroun .
Fruits, vol 52 (4) 23 5
LESCOT
variables des cultures de rente . De ce fait, le liée à l'augmentation importante des popu-
démarrage et la stabilisation de l'activité agri - lations des zones productrices . Cette évolu-
cole dans de nombreuses régions sont prin- tion est cependant atténuée par une ten -
cipalement dus au plantain . dance A. la baisse de la consommation d e
bananes plantain dans les zones urbaine s
Dans la pure tradition africaine, chaque eth-
en pleine expansion . Les marchés citadins ,
nie de la zone intertropicale humide cul -
qui offrent régulièrement une plus grand e
tive et consomme plus de trois cultivars . gamme de produits, entraînent un change -
Chaque variété a une signification particu-
ment dans les habitudes alimentaires . Il n' a
lière et est liée à une culture de mythes e t
été reporté que rarement des situations d e
symboles ancestraux, que ce soit dans l e
surproduction (Côte-d ' Ivoit~e : KUPERMINC ,
cadre de l'activité agricole — plantation d'un e
1985 et KoUADIO, 1986) .
variété particulière liée à une naissance par-
ticulière, par exemple — ou dans celui d e L'essor des marchés villageois et citadins ,
la consommation — préparation culinaire concernant ce produit, ne semble pas forte -
d'une variété spécifique lors de repas d e ment modifier la localisation des grande s
funérailles . zones de production . Grossièrement deux
types de localisation géographique des pro-
ductions peuvent être identifiés ; l'une, rela-
tivement stable, et dite traditionnelle, cor -
les marché s respond à des zones à fort potentiel agro -
écologique s'apparentant à la notion d e
La production annuelle mondiale de banan e . terroir . : elle comprend la zone caféière
plantain est évaluée à environ 15 Mt (ANO- des llanos orientales de la Colombie, le su d
NYME, 1992 ; INIBAP2 , 1994 ; données per- du lac de Maracaibo au Venezuela, la régio n
sonnelles pour l'Amérique latine). Cette esti- de Rivas au Nicaragua, celles de Pantano et
mation reste, cependant, peu précise du fai t Progreso en Honduras, Moka en Républiqu e
de l'importance de l'autoconsommation e t dominicaine, le pays bamiléké au Came-
des intégrations possibles d'autres bananes roun, etc ; l'autre type de localisation, beau-
de consommation domestique . Production coup plus mouvante — voire itinérante —, es t
alimentaire de base, la banane plantain entr e liée à l'activité agricole des fronts pionniers
peu dans les échanges commerciaux entr e des zones forestières où les migrants utilisent
pays ; en revanche, elle fait l'objet d'un com- le bananier plantain comme première cul-
merce traditionnel déterminant pour le ravi- ture de valorisation de la fertilité initiale de s
taillement des campagnes et des centre s sols et comme coproduit des cultures d e
urbains de la majorité des zones intertropi- rente constituées par le café, le cacao, etc ;
cales, au même titre que la pomme de terre la période de permanence de la parcell e
en Europe . dépend alors de la vitesse de dégradatio n
Avec la zone latino-américaine, dont l a du capital agroécologique après déforesta-
Caraïbe, l'Afrique se partage la grande majo - tion : bassin amazonien de l'Équateur, d u
rité de cette production, l'Asie tropical e Pérou et de la Bolivie, zones forestières des
pays d'Amérique centrale et d'Afrique, tel s
consommant essentiellement divers type s
de bananes u dessert v . Seulement 1,5 % de la que le sud-ouest du Cameroun (TEMPLE ,
production totale fait l'objet d'un commerc e 1995) ou la Côte-d'Ivoire (RuF, 1987) . Dans
international qui s'effectue entre la zon e ce type de productions peu stables, de s
latino-américaine à influence bava ïière et zones périurbaines où plusieurs expé-
l'Amérique du Nord ou l'Europe occiden- riences ont été tentées sans grand succès —
tale, en utilisant le même circuit commer- peuvent être incluses, ainsi que quelques
cial que la banane dessert, dont le transport zones à forte saison sèche, comme au Nica-
maritime . La quasi-totalité de la productio n ragua, où l'utilisation de l'irrigation a ét é
est donc destinée aux consommations tentée .
domestiques nationales .
2 INIBAP : International
L'importance croissante de la part de la pro-
Network for the Improvemen t
L'évolution de ces productions est, globale - duction marchande entraîne l'émergence e t
of Banana and Plantain, ment, régulièrement en hausse du fait d e l'essor d'un groupe d'acteurs spécialisés dans
Montpellier, France. l'augmentation constante de la demande , les processus de mise en marché et de com-
236 Fruits, vol 52 (4)
CULTURE DU BANANIER PLANTAI N
rnercialisation . Le niveau d'organisation rela - les autres cultures, café et cacao entre autres
tivement récent de cet espace u intermédiaire (N ' DA ADopo, 1992 ; GAUER, 1993) –, mais
entre producteurs et consommateurs est sou - relativement élevées, par manque de moye n
vent faible, n'impliquant généralement pa s d'écoulement, dans d'autres pays produc-
de structures définies . Les acteurs et leurs teurs comme en Côte-d ' Ivoire (KUPERMINC ,
champs d'action sont néanmoins bien défi- 1988) ou en Bolivie (observations person-
nis, mais mouvants . Cette organisation se nelles) .
caractérise par sa souplesse vis-à-vis de s
variations au sein de la filière (CRBP, 1993) . Le produit consommé, vendu frais, donc
vert, ou mûr, alors jaune, est périssable, mai s
Le développement de la filière entraîne u n il peut attendre jusqu'à 2 semaines aprè s
comportement d'attirance et de dépendanc e récolte avant d'être consommé, bien que sa
des producteurs et les oblige A. modifier e n qualité diminue .
partie leur processus de production : pro-
duire plus, plus régulièrement, à moindr e La part de la production entrant dans u n
coût et, plus récemment, de meilleure qua - processus de transformation, dans la fabri-
lité . En d'autres termes, l'émergence d'un e cation de „ chips » principalement, es t
production, concentrée dans une zone don - minime, car inférieure à 1 %, mais elle est e n
née, entraîne l'apparition d'un groupe d'agent s progression. Les possibilités de transforma-
spécialisés dans l'écoulement de la produc- tion sont encore très limitées (MARCRAL, 1990)
tion et sa mise en marché, qui, en retour, e t faute d'investissement dans des structures –
sous forme de . feed-back », demandent au x même artisanales –, mais aussi à cause d e
producteurs d'orienter leurs productions ou difficultés techniques concernant l'éplu-
leurs livraisons selon leurs critères . chage, le séchage, le conditionnement et l a
conservation du produit . Pourtant, elle per-
Le développement important d'un systèm e
mettrait de participer à la satisfaction de s
marchand a donc tendance à imposer de s
contraintes aux producteurs de banane s besoins croissants des consommateur s
plantain, les poussant A. modifier leurs pro - urbains et, ainsi, d'enrichir la filière, et par-
cessus de production . Ces contraintes peu - ticiperait à la stabilisation des activités d e
vent être différentes selon les spécificité s production (N ' DA Aoopo, 1991) .
agroécologiques et socioculturelles de s Le stockage est souvent rudimentaire et l e
régions et dépassent donc la qualité intrin- conditionnement pratiquement absent :
sèque du produit et ses déterminants phy- l'unité de vente de la production est géné-
siologiques . ralement le régime, mais peut être aussi u n
Les accès aux marchés, facteur important , nombre de « doigts remplissant un sac o u
mais non essentiel, du développement d e un petit camion . La pesée est rarement uti-
la culture, sont dépendants soit de l'agricul- lisée ; suivant la grosseur du régime, l e
teur lui-même, car liés aux faibles distance s nombre de ses mains et de ses doigts ou
des plantations et à la localisation des mar- l'aspect extérieur – donc, l'apparence d u
chés villageois locaux, soit des intermédiaire s produit, évaluée par l'acheteur qui est u n
pour ce qui concerne les grandes distances , intermédiaire –, un beau régime en vaudr a
les marchés de distributions ou les marché s deux ou trois autres de moindre qualité .
urbains . Cependant, l'essor d'un marché spécialisé, lié
à une distribution citadine de qualité e n
—Les Moyens de transport sont très variés - du super-marché, entraîne peu à peu le recours
dos d'homme au camion réfrigéré en pas- au poids .
sant par la pirogue fluviale –, mais, d e
manière générale, assez rustiques . Le s Le prix de vente peut varier fortement pou r
réseaux de communication, principalemen t chaque type de banane plantain – french ,
routiers, sont, en général, vétustes et peu faux-come et corne –, ainsi que pour chacu n
entretenus, sauf aux abords des grande s des nombreux cultivars, à cause des diffé-
villes . Les pertes de production son t rences de forme, donc de poids, mais, e n
variables – faibles au Cameroun et liées a u général, chaque bassin de production, o u
manque de main-d'oeuvre, pour la récolte , . terroir », met en marché un à deux cultivars .
lors des périodes de grands travaux pour Cela doit être relié au fait que le consom -
Fruits, vol 52 (4) 237
LESCOT
mateur sait reconnaître chaque type ou cul - pluies, le développement physiologique de
tivar pour des utilisations culinaires précises . la plante est ralenti en saison sèche et il s'ef-
fectue une reprise de végétation en débu t
Il existe souvent, à l'échelle des régions, un e
de saison humide . Certains pays bénéficient
instabilité des prix de mise en marché a u
d'une complémentarité d'offre expliquée par
cours de l'année ; elle est essentiellement
une production de plantain issue de diffé-
liée aux phénomènes de saisonnalité dans l a
rentes zones productrices aux saisons sèche s
production . et humides décalées .
La notion de compétitivité entre producteurs
Les pratiques culturales sont très raremen t
ou entre zones de production pour la mis e effectuées de façon à orienter la production ,
en marché est souvent absente ou estom-
mais elles cherchent à l'étaler le plus pos-
pée par le poids de l'autoconsommation , sible tout au long de l'année afin de satisfaire
par rapport à celui de la consommation exté -
les besoins d'autoconsommation, la péren-
rieure . Elle pourrait évoluer si une dyna-
nité du marché ciblé et assurer la stabilité
mique de la demande se structurait plus for -
de la vente qui permet d'assurer une tréso-
tement par rapport à l'offre .
rerie permanente . Dans les régions à forte
En général, la dynamique de marché n'ap- saisonnalité de la production – et donc de s
paraît pas clairement ; s'il existe une dyna- prix du marché – et dans le cadre d'une cul-
mique de l'offre, celle de la demande n'es t ture péri-urbaine, quelques rares produc-
pas évidente . Tout laisse croire à un consom- teurs s'orientent vers des productions d e
mateur . résigné . . contre-saison, avec l'appui d'itinéraires tech-
niques particuliers : date de plantation, oeille-
tonnage orienté, irrigation, etc, qui nécessi-
tent des moyens financiers et techniques
le calendrier supérieurs (Côte-d'Ivoire, Nicaragua) .
Dans le cadre des cultures en association ,
de production telles que plantain–café ou plantain–cacao ,
le calendrier des récoltes peut être entravé ,
D'une zone traditionnelle de production A. périodiquement, par le manque de main-
une autre, le cycle naturel de la plante, tous d'oeuvre mobilisée alors par des travau x
cultivars confondus, varie peu : l'intervalle importants sur l'autre culture .
entre la plantation et la première récolte es t
de 12 à 15 mois . Les basses températures
des zones marginales d'altitudes élevées –
1 000 à 2 000 m – et celles des latitudes sub-
tropicales augmentent ce cycle .
les stratégies
Seule la première année de mise en culture , paysanne s
en général homogène, permet un regrou-
pement de la période de production à de production
l'échelle de la parcelle . Au fil des années ,
et du fait du système de rejetonnage régulie r La diversité des cultures due aux traditions
à partir du pied-mère, la production s'étal e rurales, celle des paysages déterminée pa r
dans le temps sur l'exploitation et dans l a l'agroécologie et celle des relations aux mar-
région ; les cycles annuels naturels ou forcés chés et de leur évolution dans letemp s
par l'oeilletonnage sont enchaînés en cycle s entraînent une grande variété des système s
pluriannuels par les replantations partielles de production . Leur typologie peut êtr e
ou générales des parcelles. basée sur des stratégies de production dif-
férentes et peut être extrapolée d'une des-
S'il n'existe pas de regroupement saisonnier cription faite au Cameroun (TEMPLE, 1993) .
de la production dans les zones à pluvio-
métrie importante et répartie le long de l'an-
née, la tendance au regroupement est plus la stratégie de subsistanc e
marquée dans les zones à saison sèche plu s La stratégie de subsistance est développée
ou moins marquée où les plantation e t sur des exploitations de petite taille, d e
replantation se font en début de saison des superficie inférieure à 3 ha, basées sur un e
238 Fruits, vol 52 (4)
CULTURE DU BANANIER PLANTAI N
(ou des) culture(s) traditionnelle(s) de rente , faible densité entre les souches et les tronc s
le café et le cacao, principalement . Mais , d'arbre, sans intrant . L'importance des ren-
pour des raisons d'épuisement du capita l dements alors obtenus est attribuée d'une
agroécologique ou/et de baisse des cour s part, à une bonne nutrition minérale – miné -
de vente, elle ne permet pas de dégager u n ralisation de grandes quantités de matièr e
revenu suffisant pour assurer l'approvision- organique, en particulier les deux ou trois
nement alimentaire extérieur, nécessaire A. premières années du fait du capital agro -
la famille . La priorité devient alors d'aug- écologique – et d'autre part, à de faibles
menter la production vivrière pour garanti r pressions du parasitisme tels que charan-
l'autosuffisance alimentaire et, si possible , çons et nématodes, par exemple . Ces pro-
de dégager un surplus commercialisable . La ductions dépassent rapidement l'autosuffi-
culture du bananier plantain est conduite A. sance alimentaire familiale.
faible densité – moins de 300 pieds-
touffes/ha –, elle est associée à la cultur e le plantain « associé »
de rente, dont le niveau d'entretien dépend
Dans le mode plantain associé, une partie d e
des cours internationaux, et à d'autres cul-
l'exploitation est préparée pour la cultur e
tures vivrières, telles que tubercules, maïs ,
de rente, le cacao principalement, et l'inter -
haricot, riz, etc . Elle ne reçoit pratiquemen t
ligne est alors réservé aux cultures vivrières ,
pas d'intrants et une technicité minimale A. la
telles que manioc, haricot, maïs, etc, ains i
hauteur des faibles moyens financiers e t
qu'au bananier plantain qui sert d'ombrag e
humains des exploitations . La culture d u
aux jeunes cacaoyers . La récolte est com-
bananier plantain est menée, en général, de
mercialisée . Selon la nature des sols et leu r
manière extensive par rapport à la terre . Sui-
fertilité initiale, leur dégradation est plus o u
vant la nature du sol et la vitesse de dégra-
moins rapide – elle va de 5 à 8 ans –, obli-
dation de la fertilité initiale, le bananier plan-
geant l'agriculteur à mettre en culture
tain est souvent remplacé par le manioc ,
d'autres parties de sa concession . En géné-
plante moins exigeante, mais qui accélèr e
ral, le système d'exploitation est conduit d e
le processus de dégradation de la fertilité ,
manière extensive par rapport à la superficie
limitant la durabilité du système productif
disponible .
et obligeant donc l'agriculteur et sa famille à
se déplacer et à exploiter ailleurs dans de s
conditions souvent similaires . la stratégi e
de production pérenn e
la stratégie pionnière La stratégie de production pérenne est mis e
La stratégie pionnière est développée prin- en oeuvre par des planteurs qui veulent
cipalement dans les zones où la surfac e pérenniser leurs productions sur des terres à
forestière reste importante ; elle se concentre potentiel agronomique relativement élevé ,
sur les fronts pionniers qui constituent jusqu' à telles que les sols volcaniques de Colom-
55 % de l'offre nationale, au Cameroun. Elle bie, du Nicaragua, du Cameroun ou d u
concerne des planteurs migrants qui ont Rwanda, les vertisols de la République domi-
pour objectif l'accroissement des cultures nicaine, ou les sols d'alluvions riches de s
de rente . Le plantain est la première cultur e berges des nombreuses rivières de la zon e
de colonisation de la forêt. La superficie cul- intertropicale humide . La culture du bananie r
tivée, de 4 à 20 ha, est alors plus important e plantain peut être la production principal e
que lors des cultures de subsistance ; l'appel dans le cas de conditions agronomiques e t
à une main-d'oeuvre temporaire extérieur e d'accès aux marchés favorables, ou, et c'est
est fréquent . Le bananier plantain est cul- le cas le plus général, d'autres productions
tivé soit selon le mode ., forestier ", soit selo n sont A. la base de l'exploitation . Les revenu s
le mode „ associé u . issus de la vente de la banane plantain sont
importants, puisqu'ils assurent des rentrée s
d'argent régulières qui permettent l'achat
le plantain « forestier »
d'intrants et le paiement du salaire de l a
Dans le mode plantain forestier, bananiers e t main-d'oeuvre essentiellement dirigée vers
cultures vivrières, après une défriche par- la (ou les) culture(s) principale(s) . Les par-
tielle par abattis et brûlis, sont plantés A. celles de bananiers plantain sont alor s
Fruits, vol 52 (4) 239
LESCOT
conduites en association ou en plantatio n et médicinales . Les performances en pro-
monospécifique . Un itinéraire technique plus ductivité et durabilité y sont souvent excep-
ou moins élaboré est conduit par l'agricul- tionnelles et liées au maintien d'un hau t
teur, ou l'agricultrice en Afrique, et a pou r niveau de fertilité par des apports organique s
but de conserver, le plus longtemps pos- des déchets ménagers et des cendres, prin -
sible, un bon état productif des bananiers . cipalement . L'impact du parasitisme, mêm e
Un accent particulier est donc mis sur le s'il est élevé, est compensé par un déve-
maintien de la fertilité, par une gestion de l a loppement végétatif important de la plante ,
matière organique et un renouvellement de s lié à une très bonne nutrition .
exportations par l'apport d'engrais, ainsi qu e
sur le contrôle de l'enherbement, sur l'oeille -
tonnage et sur le contrôle du parasitisme ,
lorsqu'il n'est pas trop important (limite éco- le système de culture
nomique) . La taille de l'exploitation es t
variable, mais a tendance à baisser avec l a Suivant la situation géographique, sociale ,
pression démographique, qui entraîne un e culturelle ou économique dans laquelle se
saturation foncière, et avec la division du trouve l'agriculteur et sa famille, celui-ci rai-
patrimoine par le biais des successions . En sonne et conçoit la culture du bananier plan-
culture associée, les densités de bananier tain de manière très différente : de manière
plantain sont en général faibles, mais l'en -
extensive – le plus souvent – ou intensiv e
semble du système d'exploitation est mené par rapport à la terre, itinérante ou durabl e
de manière intensive, car les production s en fonction du potentiel initial et des possi-
annuelles, en terme de kilo-calories/hectare , bilités de maintien de la fertilité, monospé-
sont importantes, voire très élevées . cifique ou associée à d'autres cultures :
pérennes dans le cadre du marquage d u
la stratégie d'investissemen t foncier ou vivrières avec des niveaux d'or-
ganisation et de production très importants .
La stratégie d'investissement, stratégie mar- Cela implique une diversité dans les itiné-
ginale souvent associée aux activités agri- raires techniques – donc les système de cul -
coles périurbaine ou ., ceinture verte est ture – utilisés . Cette production est souven t
mise en oeuvre par des propriétaires ayan t considérée indispensable au démarrag e
une activité principale non agricole, et pou r et/ou à la pérennité de l'activité agricol e
lesquels l'exploitation agricole devient u n dans la plupart des situations .
investissement . Le meilleur profit à moyen ,
mais, quelquefois, à court terme, est visé . Les actes techniques se répartissent en quatr e
L'exploitation est gérée comme une entre - grandes catégories :
prise . La notion de durabilité n'est pas prio- – la préparation de la parcelle, plantation ,
ritaire, ce qui explique leur disparition fré- replantation : débroussaillage, obtention e t
quente . Leur taille est variable . L'écoulemen t préparation des rejets, trouaison, plantation ,
de la production est ciblé. Le niveau de tech- drainage ;
nicité est lié au niveau de connaissance d u – l'entretien : désherbage, fertilisation, oeille -
gérant . Ici, la culture du bananier plantain tonnage, effeuillage ;
est, en général, menée de manière intensiv e – le contrôle des parasites et ravageurs : cer-
selon le type de la banane d'exportation, et cosporiose noire, charançon, nématode e t
monospécifique, rarement en association . divers_;
– la récolte : coupe, transport, stockage .
Bien qu'il ne soit pas possible de la situer
dans une des stratégies mentionnées ci-des - L'organisation de ces actes techniques es t
sus, car elle peut être observée parallèle - largement tributaire du régime des pluies ,
ment dans chacune d'elles, la culture d u des conditions édaphiques, de la disponi-
plantain ' de case ,, africain est un cas parti - bilité en main-d'oeuvre – qu'elle soit fami-
culier qui mérite d'être cité . Il s'agit de micro - liale, permanente ou temporaire, elle es t
parcelles, situées aux abords de l'habitatio n principalement liée aux calendriers de s
principale, dont la production ne sert qu'à l a autres cultures –, de la disponibilité en maté-
consommation domestique au même titre riel végétal performant donc en rejets d e
que les arbres fruitiers, plantes aromatiques qualité, et, enfin, des moyens financiers dis -
240 Fruits, vol 52 (4)
CULTURE DU BANANIER PLANTAI N
ponibles permettant l'achat d'intrants – pied-mère tout au long du cycle, après avoir
engrais, herbicides et insecticides principa- choisi le (ou les) rejet(s) les plus vigoureu x
lement . et les mieux orientés par rapport à l'organi-
sation de l'espace dans la parcelle . Ces rejets
dit « successeurs u ou « fils „ assurent la péren-
la plantatio n nité et donc la durabilité de la culture (MELIN ,
Pour les travaux de préparation de terrai n 1976) . Cette sélection permet de canalise r
et d'entretien, l'utilisation de machines es t le flux végétatif pour une production de
très rare . L'essentiel des travaux se fai t qualité de deux à trois régimes . Sans cette
manuellement . L'évolution vers la mécani- technique, plus de trois rejets se dévelop-
sation ne paraît pas d'actualité . pent sur le pied-mère et donnent donc plu-
sieurs régimes de petite taille . Leur poid s
Si la plante n'apprécie pas les périodes d e diminuerait au fil des années, en fonctio n
sécheresse de plus de trois mois, elle n'ap- du potentiel nutritionnel du sol, jusqu'à par -
précie pas non plus les excès d'eau . Les pro -
venir à des plants ne produisant plus . Il est
ducteurs le savent et évitent les sols lourd s courant de voir une parcelle où les bana-
des bas-fonds, par exemple, et, en zone s
niers poussent librement en n touffe u repré-
planes à forte pluviométrie (> 3 000 mm/an) , sentée par trois à six pseudotroncs produc-
ils mettent en place et entretiennent u n
teurs, issus du même pied-mère ; cel a
réseau de drains ouverts . conduit à une diminution de la qualité, mais
Un des facteurs limitants non négligeabl e une augmentation du nombre de régime s
pour le développement et la productivité de produits par unité productive .
cette culture est la disponibilité en matérie l
de plantation de qualité et en quantité suf- L'utilisation d'engrais est essentiellement lié e
fisante . Traditionnellement, le producteur s e soit à la culture principale – même si le s
procure ce matériel à partir de sa ou ses deux cultures, ou plus, ne sont pas associée s
propres parcelles ou du proche voisinage . La sur la même parcelle –, soit à l'influence de
qualité de ce matériel est, en général , l'agro-industrie bananière (zones d'influence) .
médiocre : rejets infestés de charançons, d e Les réponses de la culture aux engrais chi-
nématodes, ou, plus rarement, de champi - miques sont très variées, car en relation ave c
gnons et de bactéries pathogènes . Les tech - la diversité physicochimique des sols et du
niques de désinfection sont soit lourdes soi t complexe d'échange cationique principale -
coûteuses, à cause de l'emploi des pesti- ment . Utilisée modérément, soit à moins de
cides, et n'apportent pas une garantie sani- 200 g/pied/an d'azote et de potassium, pa r
taire suffisante . La technique de parage, qui exemple, la fertilisation a des effets positif s
consiste en un décorticage soigné du bulbe , modérés sur la croissance et sur la produc-
associée à un tri sévère du matériel de plan- tion de la plante . Mais, dans la plupart des
tation diminue fortement les problèmes d'in - cas, la nature et les doses de l'engrais ne cor-
fection, mais reste très peu utilisée ou ma l respondent pas aux besoins sol–plante e t
réalisée : il est difficile de se résigner à jete r peuvent avoir des effets négatifs sur la crois -
un rejet. sance ou la production . Parfois, l'acidifica-
tion à long terme de la parcelle, voire de
Le coût d'un nouveau matériel issu des bio - l'exploitation, et même de la région, résulte
technologies, le vitroplant, relativemen t de l'utilisation intensive d'engrais acidifiants ;
généralisé dans l'agro-industrie bananière c'est, par exemple, le cas dans la caféicul-
et récemment d sponiDie pour cette cultur e ture colombienne-associée à la banane plan-
du bananier plantain, n'est pas à la porté e tain (observations personnelles) .
économique de la grande majorité des pro-
ducteurs . D'une manière générale, les observations e t
les études, par enquêtes régionales, sur le s
pratiques paysannes, qui ont été effectuée s
l'entretien de la culture par le Cirad-Flhor au Cameroun de 1991 à
L'oeilletonnage est une technique cultural e 1994, en Côte-d'Ivoire en 1988 et en Colom -
importante ; elle consiste à supprimer, à la bie de 1990 à 1993, ont montré le peu d e
machette, une partie des nombreux rejet s recours qu'il était fait aux intrants ; ceux qui
qui se développent autour et à la base du sont ponctuellement utilisés sont l'urée e t
Fruits, vol 52 (4) 241
LESCOT
le chlorure de potassium en engrais, le para - vaux des autres cultures . C'est donc très sou-
quat et glyphosate en herbicides, et le car- vent l'ensemble des cultures vivrières ou de
bofuran en insecticide-nématicide . rentes, qui détermine les choix et les degrés
d'intervention dans la culture du bananie r
Dans les zones d'influence de 1'agro-indus -
plantain et influence, ainsi, la durabilité de la
trie bananière, la réponse des plantains à
parcelle . La conduite des cultures vivrière s
l'application des doses utilisées pour le bana - associées, telles que le macabo, le taro ,
nier a souvent été jugée comme négligeable .
l'igname, le haricot, le maïs, le manioc, l e
Quelques études – enquêtes diagnostic o u riz, la courge ou le niébé, permet un trè s
essais en champs – ont montré qu'ils don-
bon contrôle de l'enherbetnent, une aéra-
naient, en particulier, une meilleure répons e tion superficielle du sol, du fait du travail
aux apports organiques divers – maintie n
de préparation du sol, et une bonne incor-
d'un niveau de matière organique dans l e
poration des résidus de culture – matière
sol supérieur à, 3 % – qu'à la fertilisatio n
organique, réserve azotée –, sans réel pro -
minérale avec de l'azote et du potassium , blème de compétition (DUCRET et GRANGE-
principalement, alors que l'inverse es t RET, 1986) . Ce type complexe d'association ,
observé pour la culture de la banane dessert .
rencontré au pays bamiléké du Cameroun ,
Il semble donc que le bananier plantain pré - implique une présence quasi permanent e
fère une mise à disposition lente des élé-
des acteurs sur le site, de type jardin potager.
ments minéraux ce qui est assuré par l a
minéralisation de la matière organique . La
culture génère une énorme quantité d e le parasitism e
matière végétale : 20 kg de matière sèche/ L'impact des maladies et ravageurs est trè s
plant en moins d'un an, soit 3 à 50 t/ha . variable, que ce soit à l'échelle de la par -
Cette biomasse est toujours laissée e n celle ou à celle de l'exploitation ou de l a
décomposition naturelle au champ . Cette région, mais, d'une manière générale, la cul-
restitution influe positivement sur la dura- ture associée semble mieux préservée que l a
bilité de la culture . culture monospécifique du fait de la réduc-
Le contrôle des adventices est indispensable tion des pressions d'inoculum, de la pré-
pendant les cinq ou six premiers mois de la sence d'équilibres biologiques, etc . Le
culture ; ensuite, l'ombrage provoqué par le recours à la lutte chimique, qui est prati-
développement de la culture ou des cultures quement la seule lutte efficace à court terme ,
associées suffit à limiter leur expansion . n'est pas à la portée économique de l a
grande majorité des producteurs . L'abandon
Le contrôle des adventices est un des élé- momentané de la culture est souvent la seul e
ments les plus importants pris en compt e solution en cas d'infestation grave .
par l'agriculteur dans son choix stratégique
de l'association de cultures, et dans celui d e Comme pour la plupart des cultures, l'éta t
la composition de cette association définie à sanitaire de la parcelle est étroitement li é
partir de productions vivrières et/ou d e aux disponibilités nutritionnelles pour l a
rente . Cette complémentarité concerne cha- plante, qui dépendent de la zone pédocli-
cune des cultures associées . matique : la vigueur compense souvent le s
dégâts causés par les parasites, charançon
Dans la stratégie pionnière, la taille de l a du bulbe ou nématodes sur racines, pa r
parcelle à mettre en culture est souvent déci- exemple ; c'est le cas pour les plantains d e
dée par l'agriculteur, en fonction de sadis- case . Les techniques culturales n ' intervien -
ponibilité en main-d'oeuvre – familiale ou/e t nent qu'au second plan .
extérieure –, pour la tâche importante du
désherbage en début de culture .
Dans la plupart des stratégies de produc-
tion décrites, et dans le cadre de culture s la récolt e
associées, la rusticité de la culture du bana -
nier plantain, qui produit de façon satisfai- et la mise en march é
sante avec un minimum de soins par rap -
port aux autres cultures, permet à l'agri- Si les critères, visuels, de détermination d u
culteur de privilégier le calendrier des tra - stade de récolte sont bien connus et per-
242 Fruits, vol 52 (4)
CULTURE DU BANANIER PLANTAI N
mettent une certaine latitude, qui oscill e
entre 10 et 15 j, l'assurance de l'écoulement
conclusion :
de la production ne détermine pas toujours contrôle des risque s
la programmation de la coupe . La récolte
est acheminée aux abords des axes routiers et intensification
ou fluviaux les plus proches et les plus fré-
quentés, et elle est offerte aux acheteurs , Le système de culture de type extensi f
qui sont des intermédiaires de la filière com - semble satisfaire les producteurs pour valo -
merciale, possédant un moyen de transport . riser le capital agroécologique dont ils dis-
L'acheminement par le producteur, ou s a posent, au travers d'associations polycultu-
famille, de la récolte au marché ou sur le s rales évolutives . Dans la plupart de s
sites de regroupement les plus proches est situations de ce type, les problèmes de l a
assez fréquent. Le regroupement des pro- durabilité de la culture du plantain ne son t
ducteurs est peu développé, quoique e n pas posés par les agriculteurs par rapport à
progression en Amérique latine . cette culture particulière, mais par rappor t
à l'ensemble du système de production e t
des stratégies qui le sous-tendent : marquage
Les rendements par hectare, dans pratique -
du foncier, création d'un capital d'exploita-
ment tous les types de production décrits , tion, etc . Au demeurant, les systèmes basé s
sont faibles – de 5 à 12 t –, alors que la limit e sur les associations de cultures ont l'avan-
biologique et technique de production es t tage, dans la plupart des cas, de ne pas per -
estimée à 30 t (CHAMPION, 1967) – à titre de turber complètement les fonctionnement s
comparaison, celle de la banane dessert es t des agrosystèmes et les équilibres biolo-
de 70 t/ha . Le choix de cultivars à faibl e giques, ce qui limite la prolifération de s
poids de régime, comme le sont ceux d u ennemis des cultures et la dégradation de s
groupe des - faux corne », les faibles densi - sols .
tés de plantation adoptées dans le cas des
Cependant, les possibilités d'accès aux zone s
cultures associées, par exemple, des soin s
forestières, très favorables à l'installation de s
minimaux apportés à la culture et des pres- ces systèmes complexes, se restreignent d e
sions parasitaires faiblement contrôlées expli- plus en plus : raréfaction, mise en place de
quent, en partie, ces faibles niveaux de pro- politiques de protection des ressources fores-
duction. Cependant, la notion de rendemen t tières, éloignement des fronts pionniers par
n'a qu'une valeur très relative pour la grand e rapport aux marchés de consommation . S'i l
majorité des producteurs . Leur activité es t est encore plus avantageux d'approvision-
surtout basée sur la recherche d'un e ner les villes en plantain à partir des front s
meilleure productivité possible de la terr e pionniers que d'importer du riz, il n'est pas
et du travail de leur exploitation, dans leu r sûr que des systèmes de culture du plantain
contexte socioéconomique . Ils se satisfont puissent être mis au point, qui, dans l a
donc des résultats qu'ils enregistrent avec l e durée, permettraient de mettre sur le march é
bananier plantain, car ces productions son t des produits compétitifs par rapport au ri z
obtenues A. faibles coûts de production e t importé . En effet, les pratiques actuelles de
avec peu de travail, par rapport aux culture s culture itinérantes sur abattis-brûlis de recrû s
de rente ou aux autres cultures vivrières . forestiers atteignent rapidement leur limit e
sur les sols tropicaux acides – ultisols et oxy-
sols -, dès lors 0e-les temps de jachère s e
La faible valorisation des productions, dan s
réduisent et que les agriculteurs n'ont pa s
la quasi-totalité des stratégies de production
les moyens financiers et matériels d'accéde r
observées, ne permet pas, en général, un e
aux méthodes de cultures intensives . Le s
grande marge de manoeuvre sur les coût s phénomènes bien connus de baisse de s
de production . Dans ces stratégies de pro- réserves organiques et minérales des sols ,
duction, la productivité et la durabilit é de dégradation physique et chimique e t
dépendent beaucoup plus des condition s d'acidification ne peuvent être enrayés par
pédoclimatiques que des itinéraires tech- des itinéraires techniques à la portée d'agri-
niques employés ou des pressions parasi- culteurs sans grandes ressources . Dans ce s
taires . conditions, la baisse de productivité de l a
Fruits, vol 52 (4) 243
LESCOT
terre entraîne ces exploitants à modifier leurs Chataigner J (1988) Recherche socio-économique
systèmes, soit en adoptant des culture s sur les conditions de la production de bananes
plantain en Afrique de l'Ouest. Fruits 43 (1) ,
moins exigeantes, soit en pariant sur de s 25-2 8
productions valorisant mieux leur travail :
cultures maraîchères ou fruitières, élevage , Ducret G, Grangeret 1(1986) Quelques aspects des
etc . L'intensification de la production pas - systèmes de culture en pays Bamiléké . Came-
roun, Centre universitaire de Dschang, 33 p
serait plus facilement par la complémentarit é
de cultures associées que par la consom- Gauer O (1993) Mise en place d'une structure d'in -
mation d'intrants . formation permanente sur la filière plantain .
L'observation des marchés. Plantainfo (CRBP,
Par ailleurs, dans les zones à potentiel agro - Cameroun )
écologique plus élevé où les agriculteur s Kouadio T (1986) Les conditions d'adaptation de s
ont des stratégies de production pérenne , systèmes vivriers traditionnels à l'approvision-
l'intensification de la production se heurt e nement d'une population urbaine croissante .
aussi à des difficultés dues au manque de Le cas de la Côte-d'Ivoire et de la banane plan-
tain . Montpellier, France, USTL, doctorat, 214 p
connaissances sur les besoins réels de la cul-
ture et sur les effets cumulatifs des intrants – Kuperminc 0 (1985) La filière banane plantain dan s
engrais et pesticides – que les agriculteur s le centre-ouest de la Côte-d'Ivoire, Montpellier,
France, USTL, mémoire de DAA, 77 p
utilisent.
Kuperminc 0 (1988) Saisonnalité et commerciali-
Pour assurer, à terme, le développement d e sation de la banane plantain en Côte-d'Ivoire .
la production de plantain, il semble auss i Fruits 43 (6), 359-368
nécessaire de mieux repérer les objectifs e t
Marchai J (1990) Contraintes post-récoltes et pers-
les pratiques des producteurs et de leur four- pectives d'amélioration de la manipulation, d u
nir d'autres techniques raisonnables, com- stockage et de la transformation du plantain e t
patibles avec leurs moyens et leurs straté- autres bananes en Afrique de l'Ouest . Fruits
gies . Cependant, en l'état actuel de s 45 (5), 439-44 5
connaissances sur l'élaboration du rende - Melin P, Tézenas du Montcel H (1976) Influence d u
ment des plantains, ou des associations dan s mode de conduite du bananier plantain sur l'in-
lesquelles ils entrent, cela n'est pas facile . tensification de la culture . Fruits 31 (11), 669 -
67 1
Enfin, une autre piste à suivre, pour assu-
N'Da Adopo A (1991) Résultats des tests de conser-
rer une meilleure valorisation de la produc-
vation et analyse socioéconomique préliminaire .
tion au bénéfice des producteurs, pourrai t Rapport intermédiaire FAO . Rome, Italie, Fao,
consister en une participation plus active d e 14 p
ceux-ci à la mise en marché au travers d e
N'Da Adopo A (1992) Réduction des pertes aprè s
groupements . récolte des bananes Plantains. FAO, rappor t
André Mayer. Rome, Italie, Fao 119 p
Robert M (1992) Le sol, ressource naturelle à pré-
server pour la production et l'environnement.
références Cahiers Agricultures 1, 20-34
Ruf F (1987) Éléments pour une théorie sur l'agri-
Anonyme (1993a) Plantainfo. Douala, Cameroun , culture des régions tropicales humides . De l a
CRBP (Centre régional bananiers et plantains) , forêt, rente différentielle, au cacaoyer, capita l
No 1,2, 3 travail . Agronomie tropicale 42 (3), 218-23 1
Anonyme (1.993_b) La situation mondiale de l'ali- Simmonds NW (1962) The Évolution-of the Bana -
mentation et de l'agriculture . Rome, Italie, Col- nas . Londres, Royaume-Uni, Longman, 169 p
lection FAO Agriculture, 306 p
Temple L (1993) Les systèmes de production d u
Anonyme (1994) Annual report 1993. Montpellier, plantain et les perspectives d'intensificatio n
France, INIBAP (International Network for th e dans le sud-ouest du Cameroun . Fruits 48 (2) ,
Improvement of Banana and Plantain), 72 p 119-12 3
Belalcazar S (1990) El cultivo del Plátano en el tro- Temple L (1995) Les conditions du développemen t
pico. Cali, Colombie, ICA, 375 p. d'un marché vivrier, le cas de la banane plantai n
dans la zone forestière du Cameroun . Mont-
Champion J (1967) Notes et documents sur les pellier, France, doctorat, USTL, 302 p
bananiers et leur culture . 1. Botanique et géné-
tique des bananiers . Paris, France, Ifac, Setco , Tezenas du Montcel H (1985) Le bananier plantain.
214 p Paris, France, Maisonneuve et Larose, 143 p
244 Fruits, vol 52 (4)
CULTURE DU BANANIER PLANTAI N
Cultivo del plátano de América y durabilidad de los sistemas de producción .
RESUME N
INTRODUCCIÓN. El plátano de América es un alimento básico de las poblaciones de las regione s
intertropicales húmedas . No obstante, su cultivo tiene dificultades para mantener una produc-
ción a largo plazo y suficiente frente al incremento de la demanda . IA PLANTA. El plátano de Amé -
rica, híbrido natural, es una gran planta herbácea y vivaz . Su extensión agrícola supera a
menudo el marco de los requisitos ecológicos . EL AUTOCONSUMO : BASE HISTÓRICA DE IA PRODUCCIÓN .
El autoconsumo es la principal salida del cultivo, pero la parte de la producción comercial
tiende a aumentar . Los MERCADOS . El gran desarrollo de un sistema mercante tiene tendencia a
obligar a los productores bananeros a modificar sus procesos de producción . EL CALENDARIO
DE PRODUCCIÓN. El ciclo natural de la planta, incluidos todos los cultivares, varía poco y una agru-
pación del periodo de producción es posible solamente el año de plantación . Sin embargo, e n
las regiones de estación seca, la tendencia a la agrupación es más marcada . LAS ESTRATEGIA S
CAMPESINAS DE PRODUCCIÓN . Los sistemas de producción son variados y, a veces, complejos ,
yendo desde las producciones de subsistencia en cultivos asociados hasta los cultivos mono-
específicos intensivos del tipo plátano de exportación. EL SISTEMA DE CULTIVO . Los actos técnico s
que definen los sistemas de cultivo son menos variados y el empleo de insumos es poco frecuente
e incluso suele estar vinculada a una baja valorización de las producciones. Los grados de
duración dependen en gran medida de la calidad de los suelos . CONCLUSIÓN : CONTROL DE RIES-
GOS E INTENSIFICACIÓN . La intensificación de la producción sería más fácil si pasara por la com-
plementaridad de los cultivos asociados que por el consumo de insumos .
PALABRAS CLAVES
Musa (platano), manejo de fincas, sostenibilidad .
Fruits, vol 52 (4) 245
Vous aimerez peut-être aussi
- L'Analyse Des Risques Et Le Plan Directeur de Validation (PDV) - FinalDocument75 pagesL'Analyse Des Risques Et Le Plan Directeur de Validation (PDV) - Finalabdelhakim ougaida100% (1)
- Copie de HM Module 2 - Gammes de Maintenance PreventiveDocument95 pagesCopie de HM Module 2 - Gammes de Maintenance PreventiveHanin BouzianePas encore d'évaluation
- Banana Tissue CultureDocument28 pagesBanana Tissue CultureNiks ShindePas encore d'évaluation
- IntercroppingDocument32 pagesIntercroppingDr. Muhammad Arif100% (2)
- SCI - Pragati-Koraput Millet Article 10-17Document7 pagesSCI - Pragati-Koraput Millet Article 10-17Luna PandaPas encore d'évaluation
- Micro GreensDocument3 pagesMicro GreensCarl RodríguezPas encore d'évaluation
- WatermelonDocument4 pagesWatermelon19aqilatalitahufaidaPas encore d'évaluation
- Inter & Mono-CroppingDocument15 pagesInter & Mono-CroppingJada HartPas encore d'évaluation
- What Is The Difference Between Agriculture and FarmingDocument12 pagesWhat Is The Difference Between Agriculture and FarmingdycmelbournebgPas encore d'évaluation
- Handouts CS10 Chapter 3Document13 pagesHandouts CS10 Chapter 3Jimhar A. AmarilloPas encore d'évaluation
- 203 NotesDocument215 pages203 NotesRahul S RajputPas encore d'évaluation
- Monoculture: AgricultureDocument5 pagesMonoculture: AgricultureadPas encore d'évaluation
- Guidelines For Growing Microgreens ECO City FarmsDocument3 pagesGuidelines For Growing Microgreens ECO City FarmsBtsibandaPas encore d'évaluation
- RationaleDocument3 pagesRationale042790042790Pas encore d'évaluation
- The Three SistersDocument12 pagesThe Three SistersEric Jolen FrankPas encore d'évaluation
- Field CropsDocument215 pagesField CropsGary Bhullar100% (2)
- Our Seeds: Lessons From The Drought. Voices of Farmers in ZimbabweDocument14 pagesOur Seeds: Lessons From The Drought. Voices of Farmers in ZimbabweOxfamPas encore d'évaluation
- Alley Cropping-Understanding AgroforestryDocument2 pagesAlley Cropping-Understanding AgroforestryDavid AnthonPas encore d'évaluation
- Green and White Plants Science BrochureDocument2 pagesGreen and White Plants Science BrochureDenice Natalie RepiquePas encore d'évaluation
- Push Pull Climate-SmartDocument8 pagesPush Pull Climate-SmartkerateaPas encore d'évaluation
- Riparian Buffers-Understanding AgroforestryDocument2 pagesRiparian Buffers-Understanding AgroforestryAlexandraPas encore d'évaluation
- Cropping Systems and Soil Fertility Management in The Humid and Subhumid Tropics With Special Reference To West AfricaDocument12 pagesCropping Systems and Soil Fertility Management in The Humid and Subhumid Tropics With Special Reference To West AfricayitayhPas encore d'évaluation
- Model Farming: Rice Ratooning: A Technology To Increase ProductionDocument3 pagesModel Farming: Rice Ratooning: A Technology To Increase ProductionJONATHAN CACAYURINPas encore d'évaluation
- Handout 1 CRPT1-Weed ComponentDocument21 pagesHandout 1 CRPT1-Weed ComponentAllizon Grace DorosanPas encore d'évaluation
- EN Print IYS FoodDocument2 pagesEN Print IYS FoodAllah DittaPas encore d'évaluation
- Malina OrganicDocument20 pagesMalina OrganicStefan Bozinoski0% (1)
- Age19403-Lec 2Document33 pagesAge19403-Lec 2AKALYA P (RA2171002010003)Pas encore d'évaluation
- Govardhan Eco Village Newsletter January 2011Document5 pagesGovardhan Eco Village Newsletter January 2011Tushar VoraPas encore d'évaluation
- Submitted To:-Presented By:-: Dr. K.K. Agrawal Associate ProfessorDocument33 pagesSubmitted To:-Presented By:-: Dr. K.K. Agrawal Associate ProfessorAakash MouryaPas encore d'évaluation
- Crop Rotation HandoutDocument15 pagesCrop Rotation HandoutSolomon MbewePas encore d'évaluation
- Weeds - Introduction BiologyDocument10 pagesWeeds - Introduction BiologySolomon MbewePas encore d'évaluation
- Bananier CultureDocument13 pagesBananier CultureChescoPas encore d'évaluation
- Env 2Document19 pagesEnv 2Anto GarcíaPas encore d'évaluation
- A Exercise 8Document7 pagesA Exercise 8Khent TermoorPas encore d'évaluation
- Agriculture, Ecnomy and EnviornmentDocument20 pagesAgriculture, Ecnomy and EnviornmentLaiba SadafPas encore d'évaluation
- WT Info Alley CroppingDocument2 pagesWT Info Alley Croppingvipin1991Pas encore d'évaluation
- Cover Cropping For Pollinators and Beneficial InsectsDocument16 pagesCover Cropping For Pollinators and Beneficial Insectsyosefe9900Pas encore d'évaluation
- Practica Furaje IarbaDocument6 pagesPractica Furaje IarbaCătălina Nicoleta BoițeanuPas encore d'évaluation
- Integration of Shade-Tolerant Forage Legumes Under Enset (Ensete Ventricosum (Welw.) Cheesman) Plants in South-Western EthiopiaDocument11 pagesIntegration of Shade-Tolerant Forage Legumes Under Enset (Ensete Ventricosum (Welw.) Cheesman) Plants in South-Western EthiopiaSol InvictusPas encore d'évaluation
- Peter Angelo GDocument7 pagesPeter Angelo GNexon Rey SantisoPas encore d'évaluation
- Grunebergetal 2009 ADocument49 pagesGrunebergetal 2009 Aaiz cabalticaPas encore d'évaluation
- Geography Development of Agriculture in The WorldDocument155 pagesGeography Development of Agriculture in The WorldHasifa KonsoPas encore d'évaluation
- GK Book General Knowledge GK in English: Chapter 13 AgricultureDocument10 pagesGK Book General Knowledge GK in English: Chapter 13 AgricultureAnand ShandilyaPas encore d'évaluation
- Studies On Micropropagation and Plant Regeneration of Sweet Potato (Ipomoea Batatas)Document48 pagesStudies On Micropropagation and Plant Regeneration of Sweet Potato (Ipomoea Batatas)MamathaMPillaiPas encore d'évaluation
- 2020 Tearfund Footsteps 110 Farming For The Future enDocument19 pages2020 Tearfund Footsteps 110 Farming For The Future enYNOUSSAPas encore d'évaluation
- Conservation AgricultureDocument8 pagesConservation AgricultureNasrudin Mamaluba AsiPas encore d'évaluation
- Module 2 - Lesson 2 ActivityDocument5 pagesModule 2 - Lesson 2 ActivityKirstelle SarabilloPas encore d'évaluation
- Lucern Booklet EnglishDocument28 pagesLucern Booklet EnglishThabo SewelaPas encore d'évaluation
- Agroforestry Innovation by Smallholders Facing Uncertainty. The Case of Clove-Based Cropping Systems in MadagascarDocument11 pagesAgroforestry Innovation by Smallholders Facing Uncertainty. The Case of Clove-Based Cropping Systems in MadagascarMarta PANCOPas encore d'évaluation
- Crop Guide Growing Olives - Haifa GroupDocument20 pagesCrop Guide Growing Olives - Haifa GroupAja ASPas encore d'évaluation
- 5th Liquid Filter GreenhouseDocument47 pages5th Liquid Filter GreenhouseChristopher SojournerPas encore d'évaluation
- Cotton Presentation 3Document9 pagesCotton Presentation 3Izukanji kayoraPas encore d'évaluation
- MiscanthusDocument2 pagesMiscanthusLisa FosterPas encore d'évaluation
- Cropping Systems: What Is A Cropping System?Document4 pagesCropping Systems: What Is A Cropping System?Daniel DowdingPas encore d'évaluation
- MicropropagationDocument2 pagesMicropropagationnida khanPas encore d'évaluation
- Ice Cream Making by NOVIE F. EVASCO, MBADocument83 pagesIce Cream Making by NOVIE F. EVASCO, MBAEvasco Novie FontelarPas encore d'évaluation
- Improve Your Post Harvest FertilizationDocument8 pagesImprove Your Post Harvest FertilizationharleyPas encore d'évaluation
- Review On Postharvest Handling Practices of Root and Tuber Crops.Document9 pagesReview On Postharvest Handling Practices of Root and Tuber Crops.Premier PublishersPas encore d'évaluation
- Taro StemDocument10 pagesTaro StemSheenaPas encore d'évaluation
- The Importance of Informal Seed Sector and Its Relation With The Legislative FrameworkDocument16 pagesThe Importance of Informal Seed Sector and Its Relation With The Legislative FrameworkSaroj KumarPas encore d'évaluation
- Food ResourcesDocument40 pagesFood ResourcesKrish AgarwalPas encore d'évaluation
- Seed Saving : Preserving Biodiversity and Traditional Crop VarietiesD'EverandSeed Saving : Preserving Biodiversity and Traditional Crop VarietiesPas encore d'évaluation
- Revenu AgriculteurDocument9 pagesRevenu AgriculteurPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Manque Terres XxieDocument6 pagesManque Terres XxiePatrick EbaPas encore d'évaluation
- Agriculture NumeriqueDocument4 pagesAgriculture NumeriquePatrick EbaPas encore d'évaluation
- AnceDocument8 pagesAncePatrick EbaPas encore d'évaluation
- Protection PhytosanitaireDocument13 pagesProtection PhytosanitairePatrick EbaPas encore d'évaluation
- Stockage Pdts Aricoles Agrodok31Document84 pagesStockage Pdts Aricoles Agrodok31Patrick EbaPas encore d'évaluation
- Calendrier Agricole Pour La Campagne 2022 VDocument58 pagesCalendrier Agricole Pour La Campagne 2022 VPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Trad - Stockage AméliorationDocument38 pagesTrad - Stockage AméliorationPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Avrailiren17avril2019 LbourgeoisDocument1 pageAvrailiren17avril2019 LbourgeoisPatrick EbaPas encore d'évaluation
- L'art Subtil de S'en Foutre - Mark MansonDocument1 pageL'art Subtil de S'en Foutre - Mark MansonPatrick EbaPas encore d'évaluation
- PNAAE908Document287 pagesPNAAE908Patrick EbaPas encore d'évaluation
- Un Petit Pas Peut Changer Votre Vie Robert MaurerDocument1 pageUn Petit Pas Peut Changer Votre Vie Robert MaurerPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Bâ Hormonage RejetonnageDocument8 pagesBâ Hormonage RejetonnagePatrick EbaPas encore d'évaluation
- Alt° Animale BananierDocument2 pagesAlt° Animale BananierPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Rotations Des CulturesDocument4 pagesRotations Des CulturesPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Amoureux de La ChineDocument788 pagesDictionnaire Amoureux de La ChinePatrick EbaPas encore d'évaluation
- Ba ConservationDocument14 pagesBa ConservationPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Notions Amélioration PlantesDocument4 pagesNotions Amélioration PlantesPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Notes From A Friend Anthony RobbinsDocument1 pageNotes From A Friend Anthony RobbinsPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Raymond de Saint-LaurentDocument22 pagesRaymond de Saint-LaurentPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Lagroecologie Au Service de La Diversite AlimentaireDocument72 pagesLagroecologie Au Service de La Diversite AlimentairePatrick EbaPas encore d'évaluation
- Sté Impériale AgricultureDocument7 pagesSté Impériale AgriculturePatrick EbaPas encore d'évaluation
- TilapiasDocument4 pagesTilapiasPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Charcuterie Artisanale 21Document3 pagesCharcuterie Artisanale 21Patrick EbaPas encore d'évaluation
- Aquaculture PiscicultureDocument4 pagesAquaculture PisciculturePatrick EbaPas encore d'évaluation
- TaroDocument12 pagesTaroPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Nvlle Calédonie - FruitsDocument22 pagesNvlle Calédonie - FruitsPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Eco TamarinierDocument8 pagesEco TamarinierPatrick EbaPas encore d'évaluation
- Schéma Électrique DOOSAN B15R 5Document1 pageSchéma Électrique DOOSAN B15R 5arda100% (1)
- TD 1 Communication NumeriqueDocument3 pagesTD 1 Communication NumeriqueSalhi AzizePas encore d'évaluation
- CiatDocument7 pagesCiatlahcen_bahassouPas encore d'évaluation
- A11 Descente D EauDocument1 pageA11 Descente D Eau何旭Pas encore d'évaluation
- Les Bulles Finissent Mal en GénéralDocument1 pageLes Bulles Finissent Mal en GénéralPaul VaccaPas encore d'évaluation
- Droit Penal Partie 2Document22 pagesDroit Penal Partie 2Cédric Ny Avo RahPas encore d'évaluation
- Lois Frottement Solide FinalDocument27 pagesLois Frottement Solide FinalpirjgfeiorPas encore d'évaluation
- Dossier PedagogiqueDocument12 pagesDossier PedagogiqueMahama KaborePas encore d'évaluation
- MotivationDocument53 pagesMotivationSarra miaPas encore d'évaluation
- Etude de Programmation Linéaire Dans Un Environnement Incertain - EL-ADAMI LaylaDocument75 pagesEtude de Programmation Linéaire Dans Un Environnement Incertain - EL-ADAMI LaylaAshley ImkePas encore d'évaluation
- ETUDE ET MODELISATION DES CRUE - BENNANI Nada - 1501Document53 pagesETUDE ET MODELISATION DES CRUE - BENNANI Nada - 1501Karim El MorabitiPas encore d'évaluation
- Chap Iii Mat GC2Document15 pagesChap Iii Mat GC2Tina HarryPas encore d'évaluation
- Les Pronoms DémonstratifsDocument3 pagesLes Pronoms Démonstratifskaarthikeya yeluryPas encore d'évaluation
- Mavérick, Jean - La Medecine Hermetique Des Plantes (XXXX)Document172 pagesMavérick, Jean - La Medecine Hermetique Des Plantes (XXXX)NunoCardoso100% (1)
- Compréhension Des Écrits-B2Document12 pagesCompréhension Des Écrits-B2Alexis ZentenoPas encore d'évaluation
- Instruction Sur Les Caracteristiques Geometriques Des Routes de Rase Campagne AnnexesDocument67 pagesInstruction Sur Les Caracteristiques Geometriques Des Routes de Rase Campagne AnnexesSoraya BenabouPas encore d'évaluation
- Memento FRDocument2 pagesMemento FRMichael PetitPas encore d'évaluation
- Francis KERE FinalDocument16 pagesFrancis KERE FinalYE Yavé JuniorPas encore d'évaluation
- Révision Nasales Et Découpage SyllabiqueDocument11 pagesRévision Nasales Et Découpage SyllabiqueCatalina GutiPas encore d'évaluation
- Activite 9Document5 pagesActivite 9Kaled MRASSIPas encore d'évaluation
- Chapitre 7Document32 pagesChapitre 7Karim Ahmed BetkomPas encore d'évaluation
- OJLF - Clasa A 11a Normal - BAREMDocument2 pagesOJLF - Clasa A 11a Normal - BAREMSORINPas encore d'évaluation
- Corre Ex2Document9 pagesCorre Ex2Kheria ZitouniPas encore d'évaluation
- Bernard Wolfe, Uncle Remus and The Malevolent Rabbit (1949)Document14 pagesBernard Wolfe, Uncle Remus and The Malevolent Rabbit (1949)jqnguyenPas encore d'évaluation
- Le Miel Est AmerDocument156 pagesLe Miel Est AmerPaulus100% (1)
- Exercices Corrigés - Nombres Complexes - Différentes ÉcrituresDocument12 pagesExercices Corrigés - Nombres Complexes - Différentes Écriturespharel bleue100% (1)
- Exercises 4Document1 pageExercises 4Arno NanfackPas encore d'évaluation
- Master SIAD DS 20202021Document2 pagesMaster SIAD DS 20202021Cirhuza CibanguPas encore d'évaluation