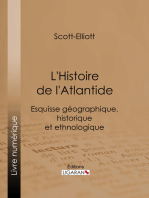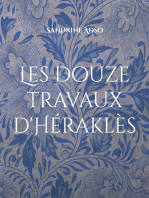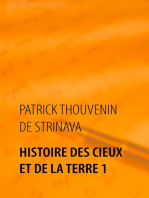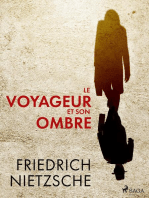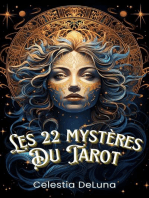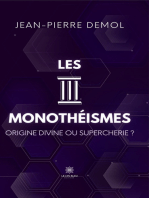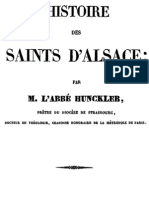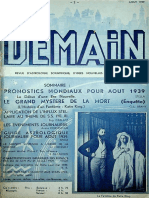Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lois de Manu
Lois de Manu
Transféré par
Galoot38Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lois de Manu
Lois de Manu
Transféré par
Galoot38Droits d'auteur :
Formats disponibles
Muse Guimet (Paris). Annales du Muse Guimet. 1893.
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numriques d'oeuvres tombes dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur rutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n78-753 du 17 juillet 1978 : *La rutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la lgislation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La rutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par rutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits labors ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accder aux tarifs et la licence
2/ Les contenus de Gallica sont la proprit de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code gnral de la proprit des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis un rgime de rutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protgs par un droit d'auteur appartenant un tiers. Ces documents ne peuvent tre rutiliss sauf dans le cadre de la copie prive sans l'autorisation pralable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservs dans les bibliothques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signals par la mention Source Gallica.BnF.fr / Bibliothque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invit s'informer auprs de ces bibliothques de leurs conditions de rutilisation.
4/ Gallica constitue une base de donnes, dont la BnF est producteur, protge au sens des articles L341-1 et suivants du code la proprit intellectuelle. 5/ Les prsentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont rgies par la loi franaise. En cas de rutilisation prvue par un autre pays, il appartient chaque utilisateur de vrifier la conformit de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage respecter les prsentes conditions d'utilisation ainsi que la lgislation en vigueur, notamment en matire de proprit intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prvue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute dfinition, contacter reutilisation@bnf.fr.
MINISTRE
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
ANNALES DU
MpaE f''-'i)
GUIMET ,, 'tOTBIBLlOTlOCE .D'TUDES)
TOME
DEUXIME
DU
MME
AUTEUR
Mdhava
et Mlat, vabhoti, traduit avec Prface
en dix actes et un prologue de Bhadu Sanskrit et du Prkrit, par G. STREHLY, de A. BERGAIGNE. Leroux, 1885. drame
drame en quatre actes avec un prologue et un interPriyadarsik, traduit du Sanskrit et du Prkrit, mde de Srharchadva, par G. STREHLY. Leroux, 1888.
CHALON-SUR-SAONE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU IMPRIMERIE FRANAISE
MNAVA
DHARMA
STRA
LOIS
DE
MANOU
TRADUITES
DU PAR
SANSKRIT
G.
STREHLY
NORMALE SUPRIEURE ANCIEN LVEDE L'COLE AU LYCEMONTAIGNE PROFESSEUR
ERNEST.
LER^J-X^DITEUR 28 28, RUE BONAPARTE, 1893
PRFACE
livre sanskrit est le premier Le Code des Lois de Manou Ds la fin du dans une langue europenne. qui ait t traduit une Jones en donnait en 1794, Sir William sicle dernier, o se trouvait l'tat imparfait traduction anglaise qui, malgr est une oeuvre d'un trs grand alors la philologie sanskrite, sont impului reprocher mrite. Les dfauts qu'on pourrait luio elle a t crite, tables l'poque plutt qu' l'auteur de rester la base de tous les mme, et ne l'ont pas empche Dharma Sstra. En concernant le Mnava travaux postrieurs publiait 1833, un savant franais, Loiseleur-Deslongchamps, son tour une traduction du Code de Manou, la seule qui ait ce jour. Elle est gnralement jusqu' paru en notre langue et d'une erreurs de dtail, exacte et fidle^ part quelques du texte y sont allure lgante mme les difficults ; parfois On pourrait rendues avec un rare bonheur d'expression. non des lecteurs souhaiter seulement pour la commodit ft faciobscurs des passages indianistes, que l'intelligence Cette lite par un commentaire plus suivi et plus abondant. de la ciren 1850, a disparu 1, bien que rdite publication Le de se la procurer. et il est difficile culation, aujourd'hui fur vergleichende Jolly a donn dans la Zeitschrift professeur 1. L'dition de 1833, que nous n'avons pas eue sous les yeux, a t reproduite en 1841 dans la collection des Livres sacrs de l'Orient publie par Pauthier, Paris, Firmin Didot. La 2e dition a paru dans la nouvelle collection des Moralistes anciens publie par Lefvre, "V. Lecou, Paris, 1850.
VI
PREFACE
une version allemande du (vol. Rechtswissenschqft III), livre VIII et du dbut du livre IX (vers 1-102). Ces dernires annes ont vu clore encore deux tranouvelles ductions en langue La premire a paru dans la anglaise. Trbner's Oriental Sries en 1884. Elle est due M. Arthur Coke Burnell a malheureusement de que la mort empch mettre la dernire son ouvrage. main Ce soin a t confi M. Edward W. Hopkins, en traduisant qui l'a complt les cinq derniers livres. les inconvnients d'une colMalgr laboration devoir l'unit nuire de posthume, qui semble celle-ci n'en est pas moins rendre de l'oeuvre, appele ' services ; le texte est serr de trs prs et traduit prcieux avec une fidlit et une concision extrmes. D'autre part, en a publi une traduction dans la collection 1886, M. Bhler Max Mller et connue sous le nom dirige par le professeur de Sacred Books of India , Oxford, Clarendon-Press.Comme il fallait de la part d'un indianiste aussi minent, s'y attendre ce travail est un chef-d'oeuvre, tant par la nettet et l'lgance d'une interprtation riche et impeccable, que par l'rudition varie du commentaire perptuel qui l'accompagne. suscits Aprs tant d'excellents ouvrages par le livre de c'tait le cas de rpter un mot clbre : Tout est Manou, et les dit, il ne reste plus rien qu' glaner aprs les anciens habiles d'entre les modernes. Aussi lorsque mon matre et ami M. Regnaud de l'Universit 1, le savant professeur lyonde la part de M. de Millou d'insrer dans naise, me proposa les Annales du Muse Guimet une nouvelle traduction du Mnava Dharma destine remplacer celle de LoiseSstra, d'abord me charger de cette leur-Deslongchamps, j'hsitai tant par une juste dfiance de mes propres entreprise, forces, lutter contre que parce que je sentais que j'aurais toujours 1. Je suis lve du regrett A. Bergaigne, mais je dois aussi beaucoup aux excellents conseils de M. Regnaud.
PREFACE
VII
le bien dire de mes devanciers, et que mme si je russissais faire une oeuvre peu prs satisfaisante, je n'aurais jamais'que le mrite secondaire d'avoir suivi sans m'garer la voie qu'ils m'avaient si magistralement trace. Mes scrupules ont cd suivantes. Le Code des Lois de aux considrations pourtant Manou d'un caractre universel et en est un de ces livres quelque Trudit, mritent pas seulement qui n'intressent le philologue, les questions l'indianiste; qu'il traite d'attirer du grand public. Le philosophe l'attention des matriaux des ides mopeut y chercher pour l'histoire rales dans l'antiquit des ; le jurisconsulte peut lui demander sur la conception du droit civil et criminel renseignements humanitaire, dans sorte
le pays qui passe pour avoir t le berceau des races 1. Or, comme de Loiseleuron l'a dit, l'ouvrage europennes est ds longtemps et malgr les mDeslongchamps puis, rites rels de sa traduction, il y a lieu, aprs celles qui ont de faire autre chose qu'une simple rimpression paru depuis, de l'dition de 1850. D'autre en langues part, les traductions trangres, accessibles connaissance apercevoir en affaiblit excellentes ne sont pas soient, pour qu'elles aux personnes de ces langues qui n'ont qu'une voire mme nulle, et ne laissent imparfaite, un double dcalque, ce qui l'original qu' travers encore davantage traduction l'impression. On a donc pens profit les
nouvelle mettant qu'une franaise, rsultats d'un commentaire acquis et accompagne explicatif un peu moins sobre que celui de Loiseleur-Deslongchamps,
obtenir un accueil favorable pourrait auprs du grand public. Voici les principes de mon qui m'ont guid dans l'excution travail. Voulant avant tout que mon interprtation ft intel tous, j'ai vit autant d'mailler le ligible que possible texte franais de mots sanskrits, bien qu'il soit parfois plus
1. Cette opinion a t fortement battue en brche dans ces derniers temps. b
VIII commode un terme
PREFACE
et simplement et plus sr de transcrire purement 1 de de droit ou spcial religion que de lui chercher et en notre un quivalent d'tre inexact qui risque langue insuffisant. Tout en serrant de fort prs le texte de Manou, il sa dsesprante m'a fallu remdier constamment presque concision et des paraphrases tires du par des explications l'original ces additions sont indihindou; de parenthses. Enfin, pour ne pas drouques par l'emploi ter le lecteur, dans la transcription des noms j'ai adopt ou autres un systme propres qui n'est pas l'abri de la criDans le texte mme de tique et que je crois devoir justifier. commentaire ma la plus simple et la je me sers de la graphie c'est--dire le son tradicelle qui reproduit plus naturelle, tionnel ! de la lettre sanskrite il y a lieu, et ne tiens quand l'alphabet aucun des phonmes hindou, compte propres le ntre ne possde Ainsi pour lesquels point d'quivalents. 3 et non transcris richi et non Soudra rshi, je dra, Tchndla et non Cndala, Vichnou et non Vishnu. Par contre, dans les notes, qui ont un caractre plus savant et o j'ai t amen titre d'claircissement des mots et des parfois reproduire traduction du texte ou du commentaire sanskrits, expressions fallu recourir au systme artificiel gnralement la transcription Il en rsulte orthographes il m'a bien admis pour
des caractres en lettres latines. dvangaris le mme verra mot figurer avec deux qu'on suivant diffrentes, lgrement qu'il se trouve
1. Par exemple le mot putrik dsigne une fille qu'un pre sans enfant mle prend au lieu de fils, en tant qu'il revendique pour fils le fils de celle-ci. Je rends ce terme par substitue ou dlgue, ce qui n'est qu'un peu prs : il et t plus ais et moins compromettant de garder le "mot sanskrit. 2. La valeur vritable de toutes les lettres sanskrites n'est pas toujours bien connue. 3. J'cris Soudra et non Sodra, parce qu'en franais il n 'est pas d'usage de distinguer par l'criture les deux sons de ou, et que d'ailleurs ce mot reparat constamment.
PRFACE dans la traduction
IX
ou dans une citation faite en note. On me cette apparente contradiction dont je pardonnera, je l'espre, donne par avance la raison. Les notes qui accompagnent pas pas la traduction tantt fournissent les notions mytholon'tre pas connues de tous et pour le comgiques qui peuvent on pourra recourir au Dictionnaire de plment desquelles Dowson tantt {Classical Dictionary ofhinduMythology), des explications et des exemples au apportent emprunts clbre hindou Koullouka dont j'ai presque exgte toujours suivi l'interprtation. faire profiter dans une Enfin, pour certaine mesure le lecteur des travaux de mes devanciers, dans tous les passages (et ils sont nombreux) qui admettent en regard de celui que j'adopplusieurs sens, j'ai reproduit suivies tais, les diverses interprtations par les autres traducteurs Il me rsumer 1. reste dire quelques mots du Livre des Lois et brivement la question des origines et de la date du Mnava Dharma telle qu'elle a t pose probable Sstra, et rsolue savants par les divers qui s'en sont occups. M. Max Mller, M. Fr. Johoentgen dans un travail intitule Ueber das Gesetzbuch des Manu M. Bur(Berlin, 1863), nell et surtout M. Bhler, dans l'important et instructif Mmoire dont il a fait prcder sa traduction, ont runi en un faisceau tous les arguments et extrinsques intrinsques qui clairer cette obscure question. Il faut bien l'avouer, pouvaient aucun de ces arguments pris part n'est tout fait premptoire et de nature apporter mie certitude mais absolue; leur runion donne aux hypothses de ces savants un caracde vraisemblance arrivs par des voies tre d'autant un peu plus acceptable, qu'ils sont diverses des conclusions assez
1. Je dsigne en abrg dans les notes par L. la traduction de LoiseleurDeslongchamps, par B. celle de Bhler, et par B.H. celle de Burnell et Hopkins.
X analogues, surtout
PRFACE en ce qui concerne les sources de l'ou-
vrage. Loin de nous fournir aucun sur son vrirenseignement table le Mnava Dharma Sstra dbute auteur, par une attribution tout fait fantaisiste du livre au Crateur luimme. Il est dit en effet dans le prambule que les grands richis ou sages vont trouver fils de Svayambhou, Manou, l'tre existant et le prient de leur exposer en par lui-mme, dtail la loi des quatre castes. Manou consent leur requte, et aprs avoir trac dans les cinquante-sept vers premiers de cosmogonie, il cde la parole au grand sage a appris de sa bouche le livre rvl lui Bhrigou, lequel Manou par Brahm, et va le leur rciter en entier. Sans voir dans cette attribution bien conforme aux habimythologique, tudes et aux traditions de l'Inde, une intention arrte de des lecteurs, on ne peut s'empcher la crdulit surprendre de constater donner une origine surnaqu'elle contribuait une place part lui assurer turelle une oeuvre humaine, la et imposer d'autres compositions analogues, parmi des peuples un trait qui d'abord n'avait universelle croyance eu d'autorit religieuse. reconnaissait que dans le cercle assez Dj du reste le commentateur restreint hindou d'une secte Medhtithi une sorte
introduction et que que le dbut n'est qu'une rellement au livre IL commence l'ouvrage de lois ne manquent Les Manuels pas dans la littrature nous ont sanskrite 1, et ct de celui de Manou plusieurs Les noms de Ydjnavalkya, de t conservs. d'Apastamba, de Baudhyana, de Nrada de Brihaspati, et Vichnou, d'autres cole dont la liste brahmanique serait a t nous prouvent longue, de donner proccupe que chaque ses secta-
1. Consulter ce sujet l'article de Stenzler dans le volume II des Indischo Studien de Weber, p. 232 sqq.
PREFACE
XI
teurs des guides et dtaills de la loi religieuse et prcis morale. A l'origine il a exist un certain nombre de Traits crits en prose aphoristique des diverses par les prcepteurs coles vdiques trs circonscrite dans laquelle pour l'usage de leurs lves et dont l'autorit ne dpassait pas les limites mmes de la secte ils taient Ces Manuels enseigns. appels Soutras n'taient en gnral considrs des que comme humaines, compositions purement malgr leur prtention se rattacher aux doctrines du Vda. C'taient les institutions dans les anciens livres parses sacrs, fragmentaires, que les Brahmanes de leur enarrangeaient pour la commodit en enfilades et qui, ou Soutras, seignement d'aphorismes outre les six sciences accessoires du Vda ou Vdngas, et grammaire, phontique, mtrique, tymologie encore la Loi sacre 1. Les princiastronomie, comprenaient traites dans les Dharma-Soutras sont les pales questions la suivantes : les rgles de conduite, les rgles de pnitence, dcision des procs, l'administration de la justice, et inci2 des rois et du demment les principes de la politique gouvernement. dont l'antiquit est assez recule Ces Soutras (M. Max Mller leur assigne comme limites entre 600 et 200 avant ont servi de base aux Manuels versifis ou J.-C.) rituel, relativement qui sont d'origine plus momtriques, tant le caractre des doctrines derne, ainsi que le prouvent et la forme de l'exposition, du sloka ou distique que l'emploi ne parat dans la littrature sanskrite pique dont l'apparition une date trs ancienne. Chacun tre reporte pas devoir des Manuels versifis repose vraisemblablement sur un Soutra 1. Les Soutras relatifs aux rites domestiques et aux sacrements s'appellent Grihya Soutras. La Bibliotheca Indica a imprim les Grihya Soutras d'Asvalyana. 2. Les ouvrages qui traitent spcialement de la politique s'appellent NtiSstras. Smritis
XII antrieur
PREFACE
dont il reproduit la doctrine, et qui avait t compos pour servir de manuel telle ou telle cole religieuse. coles vdiques, nous savons qu'il y Or, parmi les anciennes formant en avait une connue sous le nom de Mnavas une de la secte Maitryanya dont les disdes six subdivisions du Yadjour-Vda Noir. Notre Mnava ciples taient adhrents un rifacimento Dharma Sstra ne serait donc qu'une refonte, d'un Mnava Dharma le oues remanieurs, soit pour Soutra; l'univerlui donner plus d'autorit et le rendre obligatoire salit des Aryas, soit qu'ils crussent rellement aux origines l'ont mis dans un cadre lgendaire; et sacres de l'oeuvre, de l'attril'on voit en mme temps l'avantage qui rsultait 1 Manou. du livre au demi-dieu En effet, ds les bution de l'anctre Manou, primordial temps, le mythique premiers Vurmensch comme diraient les Allemands, tait l'humanit, le comme le fondateur de l'ordre social et moral, considr et des maximes des rites religieux rvlateur lgales ; et outre sont dont les Hindous cela, une supercherie tymologique, son nom dans de retrouver coutumiers, permettait Dharma et d'entendre driv Mnava, par Mnava l'adjectif Sstra le Code de Manou aussi bien que le Code des Mnavas 5. en peu de mots, la thse de M. Max Telle est, rsume et que sans contestation thse aujourd'hui admise Mller, d'une en l'appuyant a reprise M. Bhler pour son compte assez argumentation la certitude si solide et si serre qu'il lui a donn presque d'un fait historique. Que le Livre des Lois de d'un ousoit un remaniement Manou sous sa forme actuelle c'est ce qui clate aux yeux du lecteur mme vrage antrieur,
1. Proprement le richi Manou. 2. Il n'est pas impossible toutefois que l'cole des Mnavas tirt' son nom de Manou et prtendit se rattacher tout particulirement lui. Quant la thorie de Manou pre de l'humanit, elle est plutt philologique que brahmanique.
PREFACE le moins
XIII
tant par les dfauts de composition et les prvenu, du plan, que par les hors-d'oeuvre la rigueur qui nuisent chaque doctrines contradictoires pas et qui s'y heurtent dont le dsaccord mal dans une oeuvre de s'expliquerait premier jet. On a dj fait remarquer que l'attribution mytrahir du dbut semblait la proccupation de thologique donner une autorit une composition surnaturelle purement humaine la croyance universelle des et par l de l'imposer dans les Dharmade pareil ne se trouve Or, rien ryas. Tout ou Manuels des coles vdiques. Soutras, particuliers ce qui est dit dans le premier livre au sujet de la cration du de l'origine des castes, ainsi que l'espce de table des monde, matires assez maladroitement est une addiqui le termine tion postrieure, au vritable trangre sujet 1. Ce caractre est mme si sensible qu'il n'a pas laiss d'inspirer quelques des commentateurs indiens ordinairement scrupules ports envisager toutes ces traditions avec les yeux mythologiques d'une foi aveugle. Autant en dire du livre XII, pourrait-on un long expos philosophique bas sur les docqui renferme trines enseignes dans les coles Snkhya, Yoga et Vdnta. La classification des actions humaines sous trois chefs relatifs aux qualits de Bont (sattva), de Passion (rajas) et d'Obscurit (tamas), ainsi que la longue traitant de la proraison et de la batitude une digresfinale, forment transmigration sion fort un Manuel intressante de lois coup proprement la politique et au gouvernement consacr au plan plus directement qu'il se rattache dans sr, mais assez dplace dit. Le livre VII lui-mme, des rois, bien gnral, pourrait
1. A un certain point de vue pourtant on pourrait trouver que cette cosmogonie est assez en sa place dans un ouvrage qui a la prtention d'tre une sorte d'encyclopdie philosophique, morale et religieuse, embrassant tout ce qui concerne le commencement et la fin des choses, et rendant compte de l'arrangement universel.
XIV
PREFACE les matires qu'il traite un Niti Sstra {Manuel aux conSstra. Quant de au cours fourmillent
un hors-d'oeuvre, bien tre encore se trouvant plus leur place dans de Politique) que dans un Dharma tradictions, non seulement elles
cte cte, sans mais encore parfois elles s'talent l'ouvrage, entre la peine de les concilier elles, ou prenne que l'auteur de nous indiquer tout au moins qu'il quelle est la thorie Ainsi la vente au livre III, des filles interdite approuve. au livre VIII, v. 204. Mme incertiv. 51-54, est autorise ou des des femmes en ce qui concerne l'autorisation tude veuves (livre avoir IX, des enfants Dans avec d'autres le chapitre faute une srie d'expiations voyons imposer pour la mme tant reli au terme de l'numration diffrentes, chaque aucunepar un simple ou bien , qui ne laisse prcdent C'est comme une ment apercevoir la prfrence de l'auteur. de chtiments, d'une extrme gradation qui va parfois Il parat vraisem une indulgence assez commode. rigueur blable en prsence de doctrines d'poque qu'on se trouve un relchement successif dans la svrit attestant diffrente, des expiations aux pcheurs ; car il serait primitive imposes entre des ainsi l'alternative qu'on propost peu admissible si diffrentes, le choix ne pouvant tre douteux et pnalits devant ncessairement incliner vers la pnitence la plus douce. srie On serait mme tent d'en infrer d'un qu'il premier conservs les uns ct des droitement placs ou du moins au livre de Manou une pluet par suite, d'attribuer autres, Mais ce serait aller trop loin dans la ralit de composition. fait remarquer voie de l'induction. En effet, M. Bhler que ces oppositions, mdiocrement dont les commentateurs peuvent embarrasss, ne se montrent pas d'une faon s'expliquer de remaniements successifs y a eu l une malatexte, v. 57 sqq.)leurs qu'avec des pnitences poux nous
PREFACE trs naturelle;
XV
un usage commun chez les suivant l'auteur, diverses cours, et Hindous, opinions ayant place en regard des donne en dernier lieu la sienne, qui est une rfutation les ncessits et la forme concise du mtriques prcdentes, sloka ne lui permettant pas de marquer plus explicitement celle qu'il prthorie nonce est justement que la dernire nous fournielle-mme sanskrite conise. Enfin la littrature rait au besoin tions du Code rdacle tmoignage qu'il a exist plusieurs un de Manou. Outre qu'il est fait allusion
Brihan Manou (le grand Manou) et un Vriddha Manou (le vieux Manou), on connat aussi la tradition laquelle d'aprs le Livre des Lois aurait exist originairement en 100,000 vers, 12,000 rduits en 1,080 chapitres, successivement arrangs notre fils de Bhrigou, et 4,000 par Soumati, par Nrada Cette tradition texte lui-mme n'ayant que 2,685 slokas. un fonds probable cache sous ses extravagantes exagrations Sanhit sous indiquer que la Manou anneau et le plus parfait actuelle serait le dernier et de remaniements de recensions successives d'une chane d'tad'un texte primitif, sans qu'il soit possible progressifs est d un seul blir avec certitude si le rifacimento dfinitif ou s'il porte la trace de ce qui est vraisemblable, remanieur, de vrit; sa forme elle semble faites par des mains diverses. retouches plusieurs part a conquis une place Le Mnava Dharma Sstra de lois dont la littrature hindoue tous les Manuels parmi est si riche, et les raisons de cette prminence sont aises du livre Manou ait t l'effet dterminer. Que l'attribution d'un ait du n t la faveur publique, ou qu'elle gagner confusion t le rsultat involontaire entre le nom hros mythologique et celui de l'cole religieuse o tait le Mnava Dharma en un mot que la lgende ait Soutra, tout d'une pice, ou qu'elle se soit forme petit fabrique pour d'une habile calcul
XVI petit,
PREFACE
la vnration l'anctre justement qui s'attachait de l'humanit a rejailli sur l'oeuvre dont on lui primordial attribuait la paternit. Les lgendes qui de bonne heure se sont groupes autour de son nom et se sont de plus en plus avec le temps, la popularit dont le dveloppes expliquent Code de lois a joui parmi les Hindous. Les accessoires mythologiques qui y ont t rattachs aprs coup, tout en nuisant la rgularit du plan, ne considrer les choses qu'au point de vue purement littraire et humain, devaient en imposer au public brahmanique, taient pour lequel toutes ces lgendes de foi, et qui admettait des articles leur autorit sans la discuter. et L'esprit religieux qui anime les pages du dbut celles de la fin donne l'ouvrage un caractre de grandeur sereine et majestueuse le respect du croyant qui commandait et faisait de l'ouvrage non pas seulement un livre entier mais le livre par excellence. quelconque, Ajoutons que d'autres mrites concouraient lui assurer la particuliers faveur son arje veux dire son caractre gnrale, complet, son intelligibilit, et, dans une certaine rgulier, rangement son esprit et son bon sens pratique, bien mesure, juridique au point de vue du droit, que M. Bhler le dclare infrieur, et de Nrada. Ce fait aux traits analogues de Ydjnavalkya selon lui par cette hypothse que la Manou Smriti s'explique de une poque o le traitement a t rdige systmatique pas encore les progrs atteint un grand degr a faits une poque plus rcente dans les que cette science Enfin le livre de Manou a pour coles juridiques spciales. un intrt tout spcial, nous autres que parce Europens thocramieux que tout autre il reflte la vieille civilisation et philosophique du monde l'esprit religieux tique de l'Inde, la vie sociale et morale de la race hindoue ; et brahmanique, la science du droit avait mais n'avait commenc, ni ralis de perfection,
PREFACE l'on n'a pas de peine
XVII
croire, M. Burnell comme l'atteste l'administration encore (Introd., p. xvi), que de nos jours de l'Inde anglaise avec les judiciaire essaye dans ses rapports de se baser sur le Code surann de Manou, tel que indignes l'a fait connatre au sicle dernier la traduction de Sir William Jones. Quelle est l'poque de la composition du Mnava probable Dharma Sstra? Ici encore des conjecon en est rduit les hypothses se restures, et toutes que l'on peut former sentent de la dsesprante incertitude qui rgne dans toute la chronologie Sir William hindoue. Jones lui attribuait une trs antiquit (entre 1200 et 500 avant J.-C). Chzy et inclinent dans le mme sens. Mais Loiseleur-Deslongchamps il y a une tendance ramener les proaujourd'hui gnrale ductions de la littrature hindoue des dates beaucoup plus de notre et celles Sir rapproches poque, que propose William Jones nous paraissent M. Bhler se inadmissibles. basant sur l'emploi du sloka pique, indique comme terminus a quo l'poque des grandes du Mahbhpopes indiennes l date de ce pome flotte elle-mme rata. Malheureusement a tabli que le Mahbhrata tait dans le vague. M. Weber connu de Dion Chrysostome dans la deuxime moiti du sicle de notre re et que Mgasthne qui tait dans premier l'Inde en 315 avant J.-C. n'en parle point; tirant un argument il en conclut de cet auteur, que la date probable du Mahbhrata doit tre place entre les deux. D'autre incontestable des traits de Ydjnavalkya part la postriorit ad quem, et de Nrada donnerait selon M. Bhler le terminus qu'il fixerait vers 500 de notre re. Le commentaire un de l'exMedhtithi fournit gte hindou assez prcieux. Ce savant vivait, 1. Cet argument est assez peu probant. encore selon de repre point toute vraisemblance, du silence' haute
XVIII
PREFACE les leons frquemment dont quelquesprdcesseurs, . Ce de trs anciens qualit trop aventure que d'admettre il cite
au IXe sicle de notre re, et et les opinions varies de ses uns sont mentionns avec la n'est donc pas une hypothse avec M. Bhler que ceux de trois
de la sorte devaient qu'il dsigne tre antrieurs ou quatre cents ans. Si donc au VIe ou Ve sicle de notre re le texte de Manou tait dj 1 assez obscurci des gloses et des commenpour ncessiter et si les interprtes ne s'accordaient taires, plus entre eux on peut en infrer sans trop sur le sens de certains passages, lui-mme une date remontait l'original faites Enfin' certaines mentions sensiblement plus ancienne. ou Grecs), dsignant celle des Yavanas (Ines par Manou, sans doute les Grco-Bactriens, des successeurs sujets des Sakas et des Pahlavas, dont le d'Alexandre, (Scythes) de Parthavas, nom indigne nom serait une corruption des dterminent M. Bhler, dont nous rsumons ici la Parthes, assigner savante comme limite la plus haute discussion, tmrit que du Mnava Dharma Sstra le troisime sicle l'antiquit avant notre re. C'est donc dans une poque flottant entre 200 avant J.-C. et 200 aprs, que se placerait la composition du Code de Manou. un peu diffrents, Par des arguments M. Burnell est arriv assez analogues des conclusions celles qu'on vient d'noncer. Toutefois il serait port rapprocher encore des temps modernes les limites entre le Mnava Dharma lesquelles Sstra date aurait t crit. Il a mme essay avec une prcision plus rigoureuse; d'en dterminer la mais les preuves de
1. Les gloses ne prouvent pas toujours que l'obscurit d'un texte rsulte de son anciennet. La concision inhrente l'emploi du sloka les rendait ncessaires, et elles peuvent trs bien avoir t contemporaines du texte. 2. Ces arguments perdent de leur valeur si on admet la thorie des rdactions successives.
PREFACE sur
XIX
il s'appuie ont un caractre lesquelles beaucoup trop considrer comme conjectural pour qu'on puisse acquis l'histoire les rsultats il est parvenu. Voici les prinauxquels : nous avouons qu'elle ne cipaux points de son argumentation nous a gure convaincu. Les doctrines de philosophiques Manou sont directement du fameux systme athiste inspires attribu au sage Kapila. aurait Snkhya Or, cette doctrine fleuri 1 entre 100 avant J.-C. et 700 de notre re, poque elle fut supplante Vdnta. D'autre laquelle par le systme de Medhtithi part le tmoignage prcdemment rapport donne supposer au Ve ou au que le texte de Manou existait VIe sicle de notre re. L'addition du chapitre VII concernant la politique et la conduite des rois, qui forme un accessoire tranger aux anciens Dharma Soutras, que prouverait le livre a t compos de manuel un roi, et pour servir quelque vraisemblablement roi puissant et protecteur des Les troubles lettres. l'Inde au premier sicle qui dsolrent rejeter aprs cette poque la date de la du Dharma Sstra et la placer entre 100 et composition 500 aprs J.-C. tablissant alors un rapprochement entre la de Mnava porte par une des coles religieuses dnomination du Yadjour-Vda des sectateurs Noir et le titre de Mnavya des sur les inscriptions les rois de la dynastie que prennent Tchloukyas, et l'inspirateur le fondateur M. mme Burnell oeuvre de cette serait d'une port voir le protecteur telle que le Code de Manou dans Poulaks ou Polaks, de notre re forcent
et les que solides, conclusions sont beaucoup trop aventures de les adopter sans scrupour qu'il soit possible 500 aprs J.-C. est une date bien rcente pour pule. D'ailleurs ingnieuses aboutissent 1. Cela n'est pas absolument sr.
vers qui florissait Ces hypothses
500 aprs sont plus elles auxquelles
dynastie, J.-C.
XX un trait testable.
PREFACE
un cachet d'archasme inconqui porte par endroits Il est plus prudent de se rsigner une indication des deux termes extrmes entre lesquels approximative peut se placer la rdaction de notre texte, sans vouloir en dterminer la date avec une prcision avec l'absence incompatible absolue La plupart des arguments historiques. qu'on invoque pour obtenir un point de repre chronologique a silentio sont des arguments dont la valeur est toujours contestable. Ainsi nulle part Manou ne mentionne expressment le Bouddhisme, moins qu'on ne veuille considrer la de nstika d'un autre monde, qualification athe) (ngateur de Skyacomme spcialement dirige contre les sectateurs Mouni. Si l'on voulait tirer une consquence de cette omisde documents Dharma Sstra en conclure sion, on pourrait que le Mnava comme est antrieur au Ve sicle avant J.-C. (en admettant 477 avant notre re). date probable de la mort de Bouddha M. Johoentgen le remarque (p. 84, op. cit.) : Jusqu'au d'Asoka (263 avant J.-C.) les Bouddhistes temps une des nombreuses sectes avec lesconstituaient seulement avaient lutter. Il serait orthodoxes quelles les Brahmanes donc plus que tmraire de rejeter au Ve ou au VIe sicle avant notre re toute oeuvre de la littrature indienne qui ne mentionne pas les Bouddhistes. Sous sa forme actuelle le texte de Manou renferme d'assez nombreuses obscurits. Les ncessits l'obligation mtriques, du dans les limites troites de renfermer chaque prcepte Mais comme donnent parfois la pense une concision distique, sante. Aussi de bonne heure ce texte a-t-il suscit mme de nombreux ancien commentateurs commentateur dont 1. le nom nous soit parLe plus embarrasdans l'Inde
1. Du reste l'usage des commentaires est constant dans l'Inde pour tous les ouvrages de mme nature, lors mme qu'ils sont d'une clart relative.
PRFACE venu est Medhtithi
XXI
d'un Manufils de Vrasvmin, auteur 900 et de Manou), bhshya (commentaire qui vivait entre du Dekhan, 1000 aprs J.-C. M. Burnell le croit originaire comme tandis que M. Bhler incline lui donner le Kachmir fort tendu lui avait valu le surnom Son savoir lieu natal. de On s'accorde louer la richesse de sans-pareil (asahya). la diffusion, son rudition, tout en lui reprochant choisir entre et aussi une certaine indcision contradictoires qu'il cite. l'obscurit les opinions
auteur d'une fils de Mdhava, Aprs lui vient Govindardja Manutk est inconnue. la date ( tk = bhshya ), dont M. Jolly suppose qu'il vivait au XIIe ou au XIIIe sicle de notre re. dont la date est difficile dterminer, mais qui Nryana n'a certainement pas d crire plus tard que dans la deuxime moiti du XIVe d'un est l'auteur commentaire sicle, intitul Manvarthavivrti des significations de (lucidation ou Manvarthanibandha de Manou) (Trait des significations Manou). Mais le Koullouka des exgtes du Dharma Sstra est plus fameux auteur de (Kullka-bhatta 1) fils de Divkara, la Manvarthamuktvali (Collier de perles des significations de Manou). Il tait Bengali de naissance et crivit son oeuvre Bnars au XVe sicle. ; on place son existence (Vrnas) Le texte tabli par lui aussi bien que le commentaire qui et jouissent encore dans l'Inde d'une Pourtant M. Jolly estime que son popularit exceptionnelle. oeuvre n'est que la rdition de celle de Govindardja. Suivant M. Bhler, une des principales raisons qui ont contribu la rendre populaire, c'est qu'elle a t crite et approuve la ville sainte et le grand littraire des centre Bnars, l'accompagne 1. Bhatta est un titre honorifique port par les savants. ont joui
XXII Hindous. devancier Aprs logique candrik Ce savant Medhtithi. Koullouka
PREFACE le proclame d'ailleurs infrieur son
se placent encore dans l'ordre chronod'une Manvarthaauteur Sarasvat, Rghavnanda de Manou) qui suit (Clair de lune des significations la Manvarthamuktvali le place vers simplement (M. Bhler la fin du XVIe ou le commencement du XVIIe sicle) ; et d'une oeuvre toute moderne et sans enfin Nandana, auteur valeur. dans un certain Le Mnava Dharma Sstra a t conserv de caracvarits nombre de manuscrits crits en plusieurs tres. C'est, nous l'avons dit, Koullouka qui a tabli le premier dans notre sicle. ditions Il a paru plusieurs textusreceptus. Les principales sont : 1 L'dition 1813. de l'Hindou Bab-Rm, publie Calcutta, d'une Jones.
2 Celle de Sir G.-C.
reproduction Le Muse 3 Celle de Loiseleur-Deslongchamps, 1830-1833. Guimet la copie du texte, crite de la main mme possde de ce savant, d'excution qui est une merveille calligraphique. 4 Celle de Jbnanda ou Jvnanda, dans la collection des Dharma 1874. Cette dition a le mrite Calcutta, Sstras, de reproduire in-extenso le commentaire de Koullouka. Malheureusement l'excution laisse un peu typographique tant au point de vue de la nettet dsirer, que de la correction. 5 Celle de M. Jolly, publie dans la Trbner's Oriental autant par le soin critique avec Sries, 1887, recommandable et la beaut lequel le texte a t tabli, que par la correction de l'excution matrielle. C'est le texte de M. Jolly que nous
1825, accompagne Haughton, de la traduction de Sir William anglaise
PREFACE avons
XXIU
suivi dans notre traduction, sauf en deux ou trois passages o nous avons prfr la leon autorise ; par Koullouka nous avons eu soin d'ailleurs de signaler en note ces infractions la rgle que nous nous tions propose. Enfin YAnnual de la Socit de Bengale Report asiatique diannonce dans son numro de fvrier 1892 une nouvelle tion du Mnava Dharma Sstra Bhma Sena par le Pandit d'une longue et importante introduction Sarman, prcde explique crite en sanskrit et en hindi, ses o l'auteur raisons pour republier de Manou, et promet de l'ouvrage jeter beaucoup dans son commentaire. de lumire nouvelle Sept fascicules ont dj paru et le Pandit en est encore au milieu de son introduction dans laquelle il discute l'iden tit de Manou, la date laquelle il a d crire, du l'objet Livre des Lois et autres questions de ce genre . Malheude notre travail reusement tait dj trop avanl'impression du ce lorsque nous avons eu connaissance de la dissertation savant indien, d'en profiter. pour qu'il nous ait t possible Un index 1 plac la fin de ce volume permettra au lecteur toutes les indications dont il pourrait de retrouver facilement de cet index se rapportent aussi avoir besoin ; les renvois bien aux notes 2 qu'au texte mme de la traduction. 1. On trouvera avant l'index une liste, heureusement peu tendue, d'errata qui nous ont chapp dans la correction des preuves. 2. Les numros des notes correspondent ceux des vers.
TABLE
DES
MATIRES
Pages LIVRE I. LIVRE II. LIVRE III. LIVRE IV. La Cration. Rsum des matires contenues dans l'ouvrage Fondement de la Loi. Sacrements ; initiation, noviciat Le Matre de maison ; Mariage et Devoirs religieux Les Devoirs du Matre de maison ; Subsistance, tude du Vda, devoirs moraux, aliments permis ou dfendus Aliments ou dfendus ; Causes permis et Purifications d'impuret ; Devoirs. des femmes l'Ascte L'Ermite, Le Roi Lois civiles et criminelles Devoirs des poux ; L'Hritage ; Suite des Lois civiles et criminelles Castes mles ; Occupations des castes ; Temps de dtresse Pnitences et Expiations des Ames ; Batitude finale Transmigration 1-20 21-55 57-95
97-131
LIVRE V.
LIVRE LIVRE LIVRE LIVRE
VI. VIL VIII. IX.
133-156 157-170 171-200 201-255 257-304 305-323 325-363 365-383
LIVRE X. LIVRE XI. LIVRE XII.
LES
LOIS
DE
MANOU
LIVRE Rsum des
PREMIER dans
La Cration. matires contenues
l'ouvrage.
1. Manou tait les absorb dans la mditation; assis, Grands Sages s'approchrent de lui, et l'ayant dment salu, lui tinrent ce langage : 2. Bienheureux ! Daigne nous exposer exactement et de toutes les castes (principales) et des par ordre les devoirs castes intermdiaires. 1. Manou : ce nom dsigne quatorze anctres mythologiques de l'humanit, dont chacun gouverne la terre pendant une priode de 308,720,000ans, dite Manvantara (un ge de Manou). Le plus ancien de ces Manous est Svyambhuva issu de Svayambh (l'tre existant par lui-mme). C'est ce premier de tous les Manous qu'est attribu le Livre des Lois. Absorb dans la mditation : mot mot ayant une seule fin , qui est l'identit du moi avec l'me suprme. Les Grands Sages : le nom de rshi (sage) dsigne les personnages inspirs auxquels les hymnes vdiques ont t rvls. Il y en a plusieurs classes parmi lesquels on distingue les Grands Sages ou Maharshis au nombre de sept.Dment : on peut aussi rattacher cet adverbe au verbe suivant. Avant ce premier verset, certains manuscrits en insrent un autre dont voici le sens : Ayant ador le Brahme existant par luimme, dont le pouvoir est sans bornes, je vais dire les diverses lois ternelles promulgues par Manou. J'emploie la forme Brahme pour traduire brahman, mot neutre qui dsigne le dieu suprme impersonnel, l'absolu, et Brahmpour traduire brahman, mot masculin qui dsigne le crateur de l'univers. 2. Les castes principales : c'est--dire Brahmanes, Kchatriyas, Vaisyas et Soudras. Les castes intermdiaires sont celles qui sont issues du mlange 1
LES LOIS DE MANOU
tu connais les effets, la 3. Toi seul en effet, Seigneur, et le but de cet ordre universel vraie nature (tabli par) l'tre et insondable. existant de lui-mme, inconcevable 4. Ainsi dment interrog par eux, Celui dont le pouvoir tous ces Sages magnaest sans bornes, aprs avoir rendu : coutez ! nimes leurs salutations, rpondit sans rien 5. Ce (monde) tait obscurit, inconnaissable, au raisonnement et la perception, de distinctif, chappant comme compltement dans le sommeil. lui qui n'est tre existant 6. Alors l'auguste par lui-mme, cet (univers) sous la forme des dveloppant pas dvelopp., son nergie, lments et autres, parut ayant dploy grands les tnbres. pour dissiper sans seul peut percevoir, 7. Cet (tre) subtil, que l'esprit renfermant en soi toutes les cradistinctes, ternel, parties tures, incomprhensible, parut spontanment. des autres. Les trois premires castes sont appeles doija, deux fois nes, c'est--dire rgnres par le sacrement de l'initiation. Cette qualification dsigne quelquefois plus particulirement la caste brahmanique. 3. On peut aussi faire de Svayambhuvah un adjectif se rapportant vidhnasya : le sens est alors ce systme universel existant par lui-mme . C'est ainsi que traduit Loiseleur. [Je dsignerai par L. la traduction de Loiseleur, par B. celle de Bhler et par B. H. celle de Burnell et Hopkins; parKull. le commentaire de Kullka.] L'tre existant par lui-mme: c'est-dire Brahm. 4. L'adverbe dment peut aussi tre rapport au verbe qui signifie vnrer. 5. Tamobhutam : consistant en tnbres . Les commentateurs s'accordent expliquer tamas par mlaprakrti, la nature comme cause primordiale de tout ce qui est, conformment au systme Sankhya. Ce dernier reprsente une des six coles philosophiques de l'Inde et a t fond par le sage Kapila. Sur les doctrines philosophiques des Hindous, consulter les Essais de Colebrooke. 6. On peut aussi runir mahbhtdi vrttaujh et en faire un seul compos de dpendance : le sens serait alors : Ayant dploy son nergie sur les grands lments et les autres (principes) par grands lments il faut entendre les cinq suivants : terre, eau, feu, air, ther. 7. Parut sous la forme du monde sensible . Svayam udbabhau (que L. traduit par dploya sa propre splendeur ) semble un jeu de mots tymologique pour expliquer Svayambh, par une confusion volontaire des racines bh briller et bh tre.
LES LOIS DE MANOU
il tirer de son corps les diverses 8. Voulant cratures, et y dposa sa les eaux, d'abord par la pense produisit semence. devint un oeuf d'or, aussi brillant 9. Cette (semence) que le soleil, dans lequel il naquit lui-mme (sous la forme de) le pre originel de tous les mondes. Brahm, car elles sont filles de 10. Les eaux sont appeles Nrs, il en Nara; comme elles ont t son premier sjour (ayana), a pris le nom de Nryana. 11. De cette cause renindistincte, ternelle, (premire) fermant en soi l'tre et le non-tre, est issu ce Mle connu dans le monde sous le nom de Brahm. 12. Dans cet oeuf le bienheureux demeura toute une anne; il divisa de sa seule pense, puis, de lui-mme, par l'effort l'oeuf en deux. 13. De ces deux moitis il fit le ciel et la terre, et entre les deux l'atmosphre, et les huit points et l'ternel cardinaux, sjour des eaux. 8. Par la pense, c'est--dire rien qu'en le voulant . On peut aussi entendre abhidhyya par aprs avoir mdit . L. traduit : Ayant rsolu dans sa pense de faire maner, etc. . Sa semence ou bien d'une faon plus gnrale une semence, un germe . 9. Lui-mme ou encore spontanment . Svayam fait allusion au nom de Svayambh dont Brahm est l'incarnation premire. On peut aussi traduire dans lequel naquit spontanment Brahm. Tous les mondes ou suivant L. tous les tres . 10. Explication par un jeu de mots du nom de Nryana (qui a pour sjour les eaux). Nara, l'homme, dsigne ici l'homme par excellence, le prototype de l'humanit, Brahm. Dans les anciennes lgendes thogoniques connues sous le nom de Purnas, ce surnom dsigne ordinairement Vichnou. 11. Ce mle, Purusha : allusion l'hymne Purusha attribu Nryana, Rig Vda, 10, 90. Suivant les commentateurs, la cause premire c'est l'Ame suprme, le Paramtman. 12. Le bienheureux : terme de vnration d'un emploi fort gnral : il s'applique non seulement aux divinits telles que Vichnou, etc., mais aussi des mortels ayant un caractre de saintet. Suivant Kull. il faut entendre ici par le mot anne une anne de Brahm. Sur la dure de celle-ci cf. le v. 72 du mme livre. c'est--dire les quatre principaux, N., E., 13. Les huit points cardinaux: S., 0., et les quatre intermdiaires N.-E., S.-E., N.-O., S.-O.
LES LOIS DE MANOU
en soi l'tre il tira l'Esprit, renfermant 14. De lui-mme il tira le sentiment du moi qui et de l'Esprit et le non-tre, et qui est matre ; de la personnalit a conscience 15. Et aussi le grand (principe), l'me, et tous les (objets) les cinq et successivement les trois qualits, qui possdent matrielles. des sens qui peroivent les.choses organes subtiles de ces six (principes) des particules 16. (Prenant) avec des ldont le pouvoir est illimit, (et les) combinant il en cra tous les tres. ments (tirs) de lui-mme, subtiles 17. Et parce que ces six (sortes de) particules (maentrent nes) du corps de Brahm (cri) dans ces (cratures), les Sages ont appel sa forme visible corps (arra). avec les grands lments 18. C'est ce (corps) que pntrent subainsi que l'Esprit par (ses) particules (leurs) fonctions, cre tous les tres. tiles, lui qui perptuellement 14. De lui-mme: toujours le double sens de tman qui est la fois un substantif signifiant l'me, le moi et un pronom rflchi, ipse. L. traduit ici par l'me suprme (?) L'pithte de sadasadtmakam, dj employe au v. 11 est obscure ; suivant B. qui est la fois rel et non rel. B. H. qui est et qui n'est pas . L. qui existe par sa nature et n'existe pas (pour les sens) . Abhimantar est traduit dans le Dictionnaire de Saint-Ptersbourg par celui qui dsire. B. H. traduit gouverneur. L. moniteur. 15. La grand principe, le mahat est appel aussi l'intelligence (buddhi). Du reste on pourrait rapporter mahntam tmnam, le grand tman . Suivant Kull. le mahat est appel l'me parce qu'il est produit par l'me ou bien parce qu'il rend service l'me . Les trois qualits sont celles qui sont numres au livre XII, v. 24: sattva, la bont, rajas la passion, et tamas l'obscurit. 16. Ces sise principes sont, suivant Kull., l'ahankra ou sentiment du moi et les cinq tanmtra ou lments subtils qui produisent en se transformant les lments plus grossiers, tels que l'ther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Peut-tre, comme le remarque B. H., ces six principes sont-ils tout simplement le manas ou sens interne combin aux cinq grands lments. 17. Jeu de mots tymologique sans aucune valeur, comme tous ceux qui maillent le texte de Manou : ri et arra n'ont aucun rapport. La forme visible mrti. Je traduis par cette priphrase dfaut d'un synonyme de corps. B. H. traduit : Comme les lments subtils des formes corporelles de cet un dpendent de ces six, les sages... etc.. L. : Et parce que ces six molcules imperceptibles manes de la substance de cet tre suprme, pour prendre une forme, se joignent ces lments et ces organes des sens . 18. Les grands lments ou tout bonnement les lments .
LES LOIS DE MANOU
de ces sept prin19. Des particules constitutives subtiles nat ce (monde) cipes tout-puissants (sorti) de prissable l'imprissable. 20. Chacun d'eux acquiert la qualit de celui qui le pret possde, de quacde immdiatement un nombre dit-on, lits proportionnel son rang dans la srie. du 21. Dans le commencement il rgla d'aprs les paroles de chaque chose Vda le nom, la fonction et la condition individuellement. 22. Et le Seigneur cra la troupe subtile des dieux dous de vie, dont la nature consiste dans l'action et des Sdhyas, ainsi que le sacrifice ternel. 23. Du feu, du vent et du soleih il exprima pour l'accomdu sacrifice le les trois Vdas ternels, plissement appels le Yadjour-Vda et le Sma-Vda, Rig-Vda, 24. Le temps, les divisions du temps, les stations lunaires, 19. Les sept principes : le texte porte purusha mle ou esprit , c'est-dire ici principe crateur. Ces sept purusha sont d'aprs le commentaire: le manas ou sens interne, l'ahakra ou sentiment du moi et les cinq tanmtra ou lments subtils, cf. v. 16. 20. Chacun d'aux : c'est--dire de ces lments; ce vers signifie que dans la srie des lments, le premier a une qualit, le second la mme qualit plus une autre, etc. Ainsi l'ther n'a qu'une qualit, le son; l'air a deux qualits, le son et la tangibilit; le feu en a trois, son, tangibilit, couleur; l'eau en a quatre, son, tangibilit, couleur, saveur; la terre enfin, les quatre prcdentes, plus l'odeur. 22. Subtile, c'est--dire qu'on ne peut percevoir parles sens, invisible . Karmtmanm, expression obscure. Peut-tre faut-il prendre karman au sens de sacrifice, ainsi que le remarque B.; le compos signifierait alors dont la nature est le sacrifice , ou dont la divinit dpend de l'accomplissement du sacrifice, qui ne subsistent que par le sacrifice . Les Sdhyas sont une classe de divinits infrieures ; ils personnifient les rites et prires des Vdas et habitent avec les dieux ou dans la rgion intermdiaire entre le ciel et la terre. Leur nombre varie suivant les autorits : il est de douze ou de dix-sept. 23. Il exprima : dudoha signifie littralement traire. Les trois Vdas; il y en a un quatrime qui n'est pas mentionn ici, l'Atharva-Vda ; ce dernier est d'origine plus rcente. On voit que les Vdas sont des espces d'entits divines. Suivant un autre mythe, ils sont ternels et sortis de la bouche de Brahm chacun des ges successifs (kalpa) de la cration.
LES LOIS DE MANOU
les plaines, les fleuves, les mers, les montagnes, les plantes, les lieux accidents, le dsir, la colre ; et la parole, le plaisir, 25. L'asctisme, ces tres, il cra cette dans son dsir de donner l'existence cration. il spara le juste de les actions, 26. Mais pour distinguer ces conditions et donna aux cratures opposes deux l'injuste, deux, telles que le plaisir et la peine, etc. des cinq (lments) 27. Mais avec les atomes prissables a t form dans l'ordre tout cet (univers) dont on a parl, rgulier. laquelle le Seigneur a attach 28. La fonction chaque est aussi celle que cet (tre) a spontanment (tre) l'origine cr. prise au fur et mesure qu'il tait de nouveau ou inofensif, doux ou cruel, 29. Le caractre nuisible chaque ou mchant, vrai ou faux, qu'il a assign vertueux s'est imprim en spontanment (tre) lors de la cration, celui-ci subsquentes). (lors des crations des saisons celles-ci 30. De mme que dans la succession d'elles-mmes leurs attributs ainsi distinctifs, prennent des existences) les (tres) dous d'un (dans la succession chacun leurs fonctions propres. corps (prennent) des individus il fit sortir 31. Mais pour la multiplication de sa bouche, de ses bras, de ses cuisses et de ses pieds le le Kchatriya, le Vaisya et le Soudra. Brahmane, 26. Le juste et l'injuste: dharma, adharma, ou si on prfre, le devoir et le non-devoir, la vertu et le vice. La plaisir et la peina, etc. .rmunration complte comporterait encore l'amour et la haine, la faim et la soif, le froid et le chaud, et ainsi de suite. 27. Prissables. Suivant Kull. cette pithte fait allusion la transformation des lments subtils (tanmtra) en lments grossiers ou grands lments (mahbhta) : c'est cause de ce changement qu'ils sont appels prissables. 30. Dous d'un corps (dehin), c'est--dire les cratures animes ; les fonctions (karman), c'est--dire que chacun accomplit les actes ou les fonctions qui conviennent spcialement la forme sous laquelle il renat. 31. La multiplication des individus : c'est--dire pour propager l'espce
LES LOIS DE MANOU 32. Divisant son propre devint corps en deux, le Seigneur moiti mle,moiti dans cette (femelle) il engendra femelle; Virdj. des Dvidjas, 33. Mais sachez, les meilleurs que ce mle avoir pratiqu les austrits., me cra spontaVirdj, aprs moi le crateur de tout cet (univers). nment, 34. A mon tour, dsireux de produire des tres, aprs avoir pratiqu de trs rudes austrits, dix je crai d'abord Grands des cratures, Sages seigneurs 35. Martchi, KraAtri, Poulaha, Anguiras, Poulastya, et Nrada. tou, Pratchtas, Vasichtha^ Bhrigou 36. Ceux-ci crrent de splensept autres Manous pleins les demeures des dieux et les Grands deur, les dieux, Sages dous d'une puissance illimite, 37. Les Yakchas, les Rkchasas, les Pistchas, les Ganles Apsars, les AsouraSj les Ngas et les Sarpas, les dharvas, et les diverses classes des Mnes. Souparnas
humaine , moins qu'il ne faille entendre avec B. pour la prosprit des mondes . La subordination des castes hindoues a pour fondement cette provenance des diverses parties du corps de Brahm. 32. Moiti mle : c'est--dire qu'une des moitis du corps devint un mle, l'autre moiti une femelle. 36. Deodnikyn : B. entend par l les classes des dieux . On pourrait aussi en faire un compos possessif : ceux qui ont leur demeure parmi les dieux. Les sept Manous. Les Manous, c'est--dire les crateurs successifs dans les divers manvantaras sont au nombre de quatorze, et celui qui rgne actuellement est le septime. Sur la priode dite Manvantara,cf. v. 79. 37. Yakchas, sortes de gnies au service du dieu des richesses Kouvera. Les Rkchasas et les Pistchas sont des dmons qui hantent les cimetires, troublent les sacrifices, tourmentent les ermites et se repaissent de chair humaine. Les Gandharvas sont les musiciens clestes. Les Apsars sont les nymphes du paradis d'Indra, leur nom qui signifie qui se meut dans les eaux rappelle le mythe grec d'Aphrodite. D'aprs le Rmyana et les Pournas, elles sortirent de la mer que les dieux et les dmons barattaient pour obtenir l'ambroisie ; elles jouent souvent le rle de tentatrices auprs des asctes que leurs austrits ont rendus redoutables aux dieux mmes. Les Asouras sont les dmons ennemis des dieux, comparables aux Titans des Grecs. Les Ngas et les Sarpas sont des demi-dieux ayant la face d'un homme, la coiffe et le corps d'un serpent, qui peuplent la rgion infernale appele Ptla. Leur roi est Vasouki. Les Souparnas, sortes d'oiseaux
LES LOIS DE MANOU
les arcs-en-ciel le tonnerre et les nuages, 38. Les clairs, les mtores, les et les arcs-en-ciel complets, incomplets lumineuses de les comtes et les apparitions tourbillons, toutes sortes, les divers les singes, les poissons, 39. Les Kinnaras, et les carles hommes le btail., les btes sauvages, oiseaux, de dents, d'une double range nassiers pourvus les poux, 40. Les vermisseaux, les vers, les sauterelles, ails qui piquent et mouches et punaises, tous les insectes toutes les espces d'tres privs de mouvement. 41. C'est ainsi que, sur mon ordre, ces Sages magnanimes de leurs austrits tout cet ensemble crrent par la vertu d'tres anims et inanims, chacun selon ses actes. 42. Je vais vous dire maintenant quel est l'acte propre assiainsi que leur classement des cratures gn ici-bas chacune leur mode de naissance. d'aprs 43. Le btail, les carnassiers les btes sauvages, pourvus d'une double range de dents, les Rkchasas, les Pistchas et les hommes naissent d'une matrice. 44. Naissent d'un oeuf les oiseaux, les serpents, les crocoles poissons, les tortues et autres diles, espces qui vivent sur terre ou dans l'eau. mythiques dont le chef est Garouda. Les Mnes ou Pitris sont les anctres des dieux, des gnies et du genre humain (cf. III, 192). mais ce nom dsigne aussi les anctres dcds (les Mnes des Latins) auxquels on offre des sacrifices funraires consistant en boulettes de riz et libations d'eau. 38. Rohitendradhanshi : les commentateurs voient dans ce mot un compos copulatif et distinguent deux sortes d'arc-en-ciel. Rien n'empcherait d'ailleurs de prendre rohita comme une pithte de remplissage applique l'arc-en-ciel et de traduire simplement par les arcs-en-ciel . 39. Les Kinnaras sont des musiciens clestes habitant le paradis de Kouvera :il sont reprsents avec un corps d'homme surmont d'une tte de cheval. 41. Yathkarma veut dire, suivant le commentaire de Medhtithi, conformment ses actes dans une autre existence . C'est en vertu de ses actes antrieurs que tel ou tel tre nat parmi les dieux, les hommes ou les animaux. On pourrait aussi entendre cette expression dans un autre sens : ayant telle ou telle forme selon l'oeuvre laquelle ils sont destins . 44. La distinction entre les animaux ns d'une matrice et ceux ns d'un
LES LOIS DE MANOU ails les insectes chaude De l'humidit proviennent et punaises les poux, mouches ; ils sont engenqui piquent, ainsi que tous les autres de mme espce. drs par la chaleur de 46. Toutes les plantes proviennent par germination annuelles : (il en est ainsi) des plantes ou de boutures graines et portent en avec la maturit de leurs fruits, (qui) prissent abondance fleurs et fruits. de fleurs 47. Les (vgtaux) qui ont des fruits sans avoir des forts sont appels princes ; ceux qui ont la fois fleurs et fruits sont appels ai-bres. et de buissons, 48. Mais les diverses sortes de broussailles et les plantes les (diverses) rampantes espces de gramines, aussi de graines ou de boutures. proviennent grimpantes multiforme en punition 49. Enveloppes d'une obscurit ont une conscience ces (cratures) de leurs actes (antrieurs), et sont sensibles au plaisir ou la peine. interne 45.
oeuf est purement superficielle, puisque omne animal nascitur exovo. D'une manire gnrale on peut remarquer que toute cette classification naturelle est sans valeur scientifique. 46. Au lieu de taravah du texte de Jolly, L. a adopt la leon sthvarh les corps privs de mouvement . Boutures, proprement tiges (krida) mises, en terre pour repousser, opposes aux graines (bja). 47. Distinction entre vanaspati et vrksha : tels par exemple le sapin oppos au pommier. Ubhayatah, littralement des deux cts , par suite la fois , sens autoris par le commentaire. B. H. traduit : ceux qui ont des fleurs et aussi ceux qui portent des fruits (sont) tous deux appels arbres , et L. soit qu'ils portent aussi des fleurs ou seulement des fruits, ils reoivent le nom d'arbres sous ces deux formes. 48. Guccha, gulma : distinction encore plus artificielle que la prcdente. Le dsaccord des commentateurs entre eux justifie le vague de ma traduction buissons et broussailles . Peut-tre l'auteur en employant deux termes synonymes, a-t-il voulu simplement dsigner toute espce de broussailles. Je ne saisis pas bien la nuance marque par L. les arbrisseaux croissant soit en buisson soit en touffe . B. H. les plantes une tige et plusieurs tiges . Suivant Medhtithi, il s'agit de plantes une ou plusieurs racines . B. traduit : les plantes plusieurs tiges croissant d'une ou plusieurs racines . 49. Ces cratures : suivant B. le dmonstratif ete dsigne seulement les plantes : mais je crois qu'il vaut mieux l'entendre des plantes et des animaux. Multiforme : l'explication de ce terme se trouve au livre XII,
10
LES LOIS DE MANOU
50. Telles sont les (diverses) conditions (des tres), com Brahm dans cette et aboutissant aux (vgtaux), menant succession d'existences terrible et perptuellement toujours changeante. 51. Aprs avoir ainsi cr tout cet (univers) et moi-mme, celui dont le pouvoir est incomprhensible se rsorba de en lui-mme, nouveau une priode remplaant par une autre. 52. Quand le Divin s'veille le monde se meut : quand il dort en repos., alors tout (l'univers) sommeille. 53. Or quand il dort en repos, les tres corporels, dont la consiste dans l'action, nature leurs fonctions et suspendent tombe dans l'inertie. l'Esprit 54. Quand tous en mme s'absorbent dans cette temps dans me., alors cette me de tous les tres repose grande une douce quitude. 55. Mais quand cette (me) est retourne dans l'obscurit, elle demeure unie aux organes des sens sans longtemps sa fonction de sa forme ; alors elle se dpouille accomplir corporelle. 56. Lorsque, devenant revtue d'lments elle subtils, v. 42 sqq. Les existences infrieures sont le produit de l'obscurit, une des trois qualits fondamentales de la matire, et cette obscurit se manifeste sous plusieurs formes. 51. En lui-mme : Je ne puis admettre le sens de L. absorb dans l'Ame suprme . Une priode par une autre : c'est--dire la priode de cration srshtikla par la priode de destruction pralayakla. 52. Sommeille : nimlati signifie littralement ferme les yeux . L. traduit, se dissout . 55. Obscurit: Voici en quels termes Kull. commente ce vers : Entrant dans l'obscurit (c'est--dire) la cessation de la connaissance, pendant longtemps elle reste unie aux organes des sens, mais sans accomplir ses fonctions propres, telles que l'expiration et l'inspiration (de l'air) et autres : alors elle sort de sa forme corporelle (c'est--dire) de son premier corps pour aller dans un autre. 56. Revtue d'lments subtils : anumtrika. Suivant Sananda cit par Kull. ces lments subtils consistent dans le puryashtaka, mot qui dsigne les huit parties constituantes, savoir bhta, les principes lmentaires, indriya les organes des sens, manas l'esprit ou sens interne, buddhi l'intel-
LES LOIS DE MANOU entre
11
alors unie ( ou animale, dans une semence vgtale elle reprend une forme corporelle. ceux-ci) l'teret en dormant 57. Ainsi en s'veillant (tour tour) nel anime et dtruit toute cette (collection perptuellement mobiles et immobiles. d'tres) 58. Aprs avoir compos ce Livre (des lois) il me l'enseigna lui-mme selon la rgle, et moi je l'ai enseign ( d'abord, mon tour) Maritchi et aux autres Sages. 59. Bhrigou ce livre d'un bout que voici vous rcitera car ce Sage l'a appris en entier de moi. l'autre, le grand 60. Ainsi interpell Sage, Bhrigou par Manou, ! charm dans son coeur, dit tous ces Sages : coutez existant 61. De ce Manou issu de l'tre par lui-mme et trs puissants, six autres Manous descendent magnanimes des cratures, qui ont chacun produit le glorieux 62. Svrotchicha, Auttami, Tmasa, Raivata, Tchkchoucha et le fils de Vivasvat. et les 63. Ces sept Manous tout-puissants, Svyambhouva et protg sa priode, autres, ont, chacun produit pendant mobiles et immobiles. tout ce (monde d'tres) nimchas font une kchth, 64. Dix-huit (clins d'oeil) kals font un moutrente trente kchths font une kal, d'un jour et font l'espace et autant de mouhortas horta, d'une nuit. la division du jour et de la nuit pour 65. Le soleil marque des les dieux et pour les hommes ; la nuit est pour le sommeil de leurs fonctions. tres, le jour pour l'accomplissement un jour 66. Pour les Mnes, un mois (humain) reprsente : la et il se divise en deux quinzaines et une nuit; (lunaires) ligence, vsan les ides, karma les actes, vyu le souffle vital, avidy l'ignorance. 62. Vivasvat est le nom du Soleil : le septime Manou est appel vaivas. vata, c'est--dire fils du Soleil. 63. Cette priode est ce qu'on appelle un manvantara ou ge de Manou. 65. Pour les dieux et pour les hommes : mot mot : le jour et la nuit divins et humains . 66. Le mois lunaire des Hindous est divis en deux quinzaines (paksha,
12
LES LOIS DE MANOU
noire est (pour eux) le jour destin aux actions, (quinzaine) blanche la nuit rserve au sommeil. et la (quinzaine) 67. Pour les dieux, une anne (humaine) une reprsente : la marche nuit et un jour, et voici quelle en est la division du soleil vers le Nord fait le'jour, la marche du soleil vers le Sud fait la nuit. est la 68. Maintenant en peu de mots quelle apprenez et de chaque ge dure d'une nuit et d'un jour de Brahm du monde, suivant l'ordre : 69. Quatre mille annes forment, dit-on, (divines) l'ge Krita : le crpuscule est d'autant de cen(qui le prcde) le crpuscule taines d'annes, et pareillement (qui le suit). et suivis chacun 70. Dans les trois autres ges, prcds d'un crpuscule, il y a une diminution de un sur progressive le chiffre des mille et des cents. 71. Les quatre d'tre menqui viennent ges (humains) formant un total de douze mille ans, s'appellent un tionns, ge des dieux. 72. Mais sachez que mille ges des dieux additionns ensemble font un jour de Brahm, et que sa nuit est d'gale dure. littr. aile) : la quinzaine blanche finit avec le jour de la pleine lune, et la quinzaine noire avec le jour de la nouvelle lune. 68. Les ges du monde (yuga) sont au nombre de quatre, krta, tret, dvpara, kali, et correspondent aux quatre ges de la mythologie classique. 69. Dit-on : on reprsente l'autorit des Sages qui ont rvl la loi. Autant de centaines, c'est--dire quatre. 72. Voici en chiffres le tableau comparatif de ces diverses dures : : 400 + 4.000 + 400 = 4.800 ans. Age krta : 300 + 3.000 + 300 = 3.600 ans. Age tret Age dvpara : 200 + 2.000 + 200 = 2.400 ans. : 100 + 1.000 + 100 = 1.200 ans. Age kali 12.000 ans. Ces 12.000 annes divines reprsentent 4.320.000annes humaines, puisque l'anne humaine est l/360e de l'anne divine. Un jour de Brahm se compose donc de 4.320.000.000d'annes humaines au bout desquelles commence la nuit de Brahm, c'est--dire la dissolution (pralaya) du monde.
LES LOIS'DE
MANOU
13
73. Ceux qui savent finit que le saint jour de Brahm avec mille ges (des dieux), et que sa nuit est d'gale dure, ceux-l la (vritable des jours (seuls) connaissent division) et des nuits. 74. A l'expiration de ce jour, et de cette nuit, Lui, qui tait endormi, se rveille, et en se rveillant il cre l'Esprit renfermant en soi l'tre et le non-tre. 75. Pouss par le dsir de crer (qui est en Brahm), l'Eset produit l'ther prit opre la cration auquel on reconnat du son. la proprit 76. L'ther en se transformant donne naissance l'air, vhicule de toutes les odeurs, pur, puissant, auquel on attribue la proprit de la tangibilit. 77. Puis l'air en se transformant donne naissance la lumire les tnbres : on lui brillante, qui claire et dissipe reconnat la proprit de la couleur. 78. La lumire en se transformant naissance (donne ) l'eau qui a pour proprit la saveur; de l'eau (provient) la terre l'odeur : telle est la cration qui a pour proprit l'origine. 79. Cet ge des dieux, dont il a t parl plus haut, (soit) douze mille (annes multipli divines), par soixante-onze, est ce qu'on appelle ici-bas une priode de Manou. 80. Innombrables de Manou, les cra(sont) les priodes tions et les destructions : comme en se jouant, (du monde) l'Etre suprme les rpte indfiniment. 81. Dans l'ge Krita, a quatre la Justice pieds et elle est la Vrit ne bien pour les hommes aucun entire, aussi; drive de l'injustice. 74. Suivant Kull. manas peut s'entendre ici de deux manires : ou bien Brahm fait maner son propre esprit (svyam nianah srjati) et l'applique la cration du monde ; ce manas n'avait pas cess d'exister (anashta) pendant la destruction intermdiaire du monde (avntara pralaya) ; ou bien le mot manas dsigne le grand principe intellectuel, le mahat. 75. On comme au v. 69 dsigne les Sages. 81. Quatre pieds : il est dit au livre VIII, v. 16, que la Justice, Dharma,
14
LES LOIS DE MANOU
82. Mais dans les autres (ges) par suite du gain (illicite), la Justice est successivement d'un pied : par le vol, prive le mensonge et la fraude, la Justice est graduellement diminue d'un quart (dans chacun d'eux). de maladies, obtiennent l'ac83. (Les hommes), exempts de tous leurs voeux, et vivent cents complissement quatre ans dans l'ge Krita : dans l'ge Tret et les suivants, leur diminue d'un quart. vie est successivement telle qu'elle est mentionne dans 84. La vie des mortels, les bndictions des (bonnes) le Vda, oeuvres, (rsultant) des tres corporels, en ce et le pouvoir (surnaturel) portent avec les ges. monde des fruits en rapport dans l'g Krita, sont les devoirs des hommes 85. Autres dans l'ge autres dans l'ge Tret et l'ge Dvpara, autres de ces ges. Kali, en raison de la dcroissance comme (la l'austrit est considre 86. Dans l'ge Krita, dans l'ge Tret, vertu) suprme; (c'est) la science (divine); et dans l'ge dans l'ge Dvpara, on dit que c'est le sacrifice, seule. Kali, la libralit le Trsde toute cette cration, 87. Pour la conservation distinctes aux (tres) Resplendissant assigna des occupations et de ses de sa bouche, de ses bras, de ses cuisses sortis pieds. et l'tude il assigna 88. Aux Brahmanes renseignement le sacrifice et de diriger (du Vda), (le droit) de sacrifier de donner et de recevoir d'autrui, (les aumnes); est un taureau. Ces quatre pieds sont une allgorie : ils dsignent suivant le commentaire, soit les quatre vertus fondamentales (tapojnayajnadnam) : austrit, science, sacrifice et libralit, ou bien les quatre castes. 82. D'un quart : pda signifie la fois pied et quart. Le mot dharma signifie tout ensemble la justice, le devoir, la loi sacre, la vertu, les mrites spirituels : nous n'avons pas d'quivalent en franais. 84. Mentionne dans le Vda, veut dire suivant Kull. une vie de cent annes . Des oeuvres, c'est--dire l'accomplissement des sacrifices. En rapport aoec les ges, veut dire que ces fruits sont soumis une dcadence graduelle comme les ges du monde eux-mmes.
LES LOIS DE MANOU
15
il assigna 89. Aux Kchatriyas la protection des peuples, le sacrifice, le don (des aumnes), l'tude (du Vda) et le des plaisirs dtachement sensuels; 90. Aux Vaisyas la garde des troupeaux, le (il assigna) le sacrifice, don (des aumnes), l'tude le com(du Vda), et l'agriculture. merce, le prt d'argent 91. Mais le seul devoir que le Seigneur ait impos aux c'est de servir humblement ces (trois autres) Soudras, castes. 92. L'homme est dclar plus pur (dans les parties situes) : voil pourquoi au-dessus du nombril l'tre existant par luimme a dit que sa bouche est ce qu'il y a de plus pur en lui. 93. Parce qu'il est sorti del partie suprieure (de Brahm), et parce qu'il possde le Vda, le Brah- parce qu'il est l'an, de toute cette cration. mne est de droit seigneur 94. Car c'est lui que l'tre existant par lui-mme, aprs s'tre livr aux austrits, cra d'abord de sa propre bouche, les offrandes aux Dieux et aux Mnes et pour faire parvenir la conservation de tout cet (univers). pour (assurer) 95. Quel tre serait suprieur celui par la bouche duquel les habitants des cieux et les Mnes consomment sans cesse les offrandes destines aux uns et aux autres? 96. Parmi les tres, on considre comme ceux suprieurs ceux qui subsistent parmi les (tres) anims, qui sont anims, les intelligents les hommes, par l'intelligence, parmi parmi les hommes les Brahmanes, 97. Parmi les Brahmanes ceux qui sont instruits (dans le ceux qui sont instruits, ceux qui connaissent Vda), parmi 89. Au lieu de sanidiat il assigna , une autre leon porte samsatah en un mot. 91. Humblement, sans murmurer. L. sans dprcier leur mrite. 95. Les offrandes destines aux dieux s'appellent havya, celles destines aux Mneskavya : les deux mots sont souvent lis ensemble. Par la bouche duquel : quand le prtre sacrificateur mange le beurre clarifi de l'offrande aux dieux, ces derniers sont censs le manger par sa bouche. 97. Qui connaissent leur devoir : krlabuddhayah signifie proprement qui ont pris une ferme rsolution (Dictionnaire de Saint-Ptersbourg) ;
16 leur
LES LOIS DE MANOU
leur devoir, ceux ceux qui connaissent devoir, parmi ceux qui parmi ceux qui l'accomplissent, qui l'accomplissent, annoncent la Sainte-criture. est une ternelle 98. La naissance mme du Brahmane incarnation de la Loi sacre : car il est n pour (l'accomplis l'absorption en sement de) la Loi sacre et il est destin Brahme. 99. Car un Brahmane en naissant nat au premier rang sur cette terre, de toutes la les cratures, seigneur (prpos) garde du trsor de la Loi sacre. dans le monde est la proprit du 100. Tout ce qui existe de son origine il a droit Brahmane : en effet par l'excellence tout. se nour101. C'est de son propre (bien) que le Brahmane : c'est par la gnrosit et fait l'aumne du rit, s'habille Brahmane subsistent. que les autres hommes 102. Pour dterminer les devoirs du Brahmane et ceux des autres suivant leur ordre, le sage Manou, issu (castes) de l'tre existant ce livre. par lui-mme, composa 103. Un Brahmane instruit doit l'tudier avec soin et ses disciples, exactement mais nul autre l'enseigner (n'a ce droit). 104. Un Brahmane qui tudie ce livre et qui est fidle ses voeux, n'est jamais souill d'aucun en pch en pense, parole ou en action. mais le commentaire autorise l'interprtation que nous avons suivie. Ceux qui annoncent la Sainte-Ecriture, traduit brahmavdinah (texte de Jolly) : mais il y a une autre leon qui porte vedinah, suivie par B. et B. H. ceux qui connaissent le Vda. L. traduit : ceux que l'tude des livres saints conduit la batitude. 98. L'absorption en Brahme ou dlivrance finale (moksha) est le but suprme o l'me arrive aprs une srie de transmigrations : le suicide religieux usit dans l'Inde a pour but de hter cette dlivrance. 100. Il a droit tout : Kull. ajoute sarvagrahanayogyo bhavati , il est autoris tout prendre, ce qui semble impliquer que le vol n'existe pas pour le Brahmane. 104. Samitavratah est traduit.par B. qui accomplit fidlement les devoirs
LES LOIS DE MANOU
17
105. Il sanctifie l'assemble (o il se trouve), sept de ses et sept de ses descendants anctres et mrite seul (la possession de) toute la terre. 106. Ce (livre) est une excellente (source de) bndictions, il accrot il donne et longue l'intelligence, vie, il gloire la dlivrance (assure) suprme. 107. Dans ce (livre) est expose en entier la Loi, ainsi que le bien et le mal des actions, et la rgle ternelle de conduite des quatre castes. 108. La rgle de conduite est la loi suprme, (elle est) et ia Tradition: aussi un Dvidja par la Rvlation enseigne qui dsire le bien de son me doit-il toujours y tre attentif. ne 109. Un Brahmane de la rgle de conduite qui s'carte du Vda; mais celui qui observe recueille la pas le fruit obtient une rcolte complte. rgle de conduite, 110. Ainsi les Sages, voyant que la Loi drive de la rgle de conduite, ont pris la rgle de conduite pour base principale de toute austrit. (prescrits en ce livre). Mais le sens ordinaire de vrata est voeu religieux . Il faut lire, je crois, samita de la racine + sam et non amsita de la racine ams (leon adopte par Jolly). 105. La pense contenue dans ce vers est dveloppe au livre III, v. 183 sqq. De mme que la prsence de certaines personnes est une souillure pour une assemble, ainsi celle d'un Brahmane instruit efface la souillure contracte par l'admission de personnes indignes. Par assemble il faut entendre une runion de gens l'occasion d'une solennit, d'un repas funraire, d'un sacrifice. 106. On peut rapporter excellent livre. 107. Le bien et le mal des actions : Kull. explique ainsi : Le fruit bon ou mauvais des actions suivant qu'elles sont permises ou dfendues. Pour les Hindous, la rcompense des actions est insparable de leur caractre moral. 108. La rgle de conduite (cra) comprend un ensemble d'usages et de pratiques, tels que rincement de la bouche, onctions avec du beurre, etc., dont il sera question plus loin. Au livre II, v. 10, ces termes de Rvlation et de Tradition sont expliqus : la ruti c'est le Vda, la Smrti c'est le Code des Lois. tmavn qui dsire le bien de son me . cette traduction est justifie par le commentaire tmahitecchuh . 2
18
LES LOIS DE MANOU
111. L'origine du monde, la rgle des Sacrements, l'observance des voeux, la conduite (du disciple envers le matre) et l'excellente du bain, prescription 112. Le choix d'une la description (des diverses pouse, le rituel des (cinq) grands sacrifices et sortes) de mariages, les rites ternels des sacrifices funraires, 113. La description des (divers) les d'existence, moyens devoirs du Sntaka, les aliments et dfendus, la permis des personnes et celle des objets, purification 114. Les rglements concernant les femmes, la condition d'arriver le d'ascte, (les moyens finale, ) la dlivrance au monde, tous les devoirs renoncement d'un roi, la dcision des procs, 115. La rgle pour interroger les tmoins, les devoirs du mari et de la femme, la loi de partage (des successions), (les lois sur) le jeu et l'loignement des tres nuisibles, 116. (Les rglements la conduite des Vaisyas concernant) et des Soudras, des castes mixtes, la loi pour toutes l'origine les castes en cas de calamit, et la rgle des pnitences, 117. Les trois sortes de transmigrations, rsultant des actions ou mauvaises), d'arriver (bonnes (les moyens ) la dlivrance finale "et l'examen du bien et du mal dans les actions, 118. Les lois ternelles des (diverses) des castes, contres, 111. L'lve en thologie contracte des voeux, est astreint certains devoirs envers le matre spirituel, et son temps d'tudes termin, prend un bain religieux aprs lequel il est dit sntaka (qui s'est baign). 115. L. traduit : Les statuts qui concernent le tmoignage et l'enqute . Mais c'est plus naturel, comme le fait d'ailleurs le commentaire, de considrer skshiprana comme un compos de dpendance. tres nuisibles : littr. les pines ; l'loignement des pines est une mtaphore pour dire le chtiment des criminels . 117. Les trois sortes de transmigrations sont expliques tout au long dans le livre XII : aprs la mort, les mes suivant les qualits dont elles sont doues (bont, passion, obscurit), passent dans une existence suprieure, intermdiaire ou infrieure. 118. Cette numration du v. 111 au v. 119 forme un sommaire des ques-
LES LOIS DE MANOU
19
des familles, les lois des hrtiques et (celles) des associaa tions (de marchands ou autres), (voil ce que) Manou expos dans ce livre. 119. Comme ma demande, a expos le Manou jadis, contenu de de ce livre, votre tour maintenant apprenez-le moi-mme. tions traites dans l'ouvrage de Manou. Elle et t mieux place au dbut mme du livre.
LIVRE
DEUXIEME de la Loi. noviciat.
Fondement Sacrements
: initiation,
1. Apprenez les hommes instruits cette Loi que suivent dans leur coeur les gens (dans les Vdas), que reconnaissent de haine et de passion. vertueux, toujours exempts 2. L'amour de soi n'est point louable, et pourtant le dtachement de soi-mme car l'tude du n'existe point ici-bas; Vda et l'accomplissement des actes prescrits par le Vda ont pour mobile l'amour de soi. 3. En effet le dsir (des rcompenses) a pour racine l'esdans ont leur origine ; les sacrifices poir (d'un avantage) et les observances ; les voeux (religieux) l'espoir asctiques, tout cela est reconnu comme de l'espoir (d'un provenant avantage). 1. Que reconnaissent dans leur coeur : hrdayenbhyanujfita. Le sens de cette expression est obscur. L : (devoirs) qui sont gravs dans les coeurs . B. H. (loi) qui est reconnue par l'esprit. 2. L'amour de soi : kmtmat est comment par phalbhilshalatvam : la tendance dsirer une rcompense c'est--dire agir par intrt. B. H. dans une note fait remarquer justement que dans l'ancienne religion vdique l'espoir d'une rcompense matrielle, d'un avantage immdiat est le but avou du sacrifice dont la devise est : donnant, donnant . 3. Sankalpamla est une expression difficile : sankalpa signifie rsolution et l'on pourrait entendre ainsi : le dsir est la racine de la rsolution (d'agir) . Mais le commentaire explique sankalpa par anena karman idam ishtam phalam sdhyata iti , etc. : c'est l'ide qu'on se fait que tel avantage dsir peut tre obtenu par telle action . Sankalpa est donc
22 ' 4. Nulle
LES LOIS DE MANOU
on ne voit une action quelconque part ici-bas sans dsir : car tout ce qu'on fait (accomplie) par un homme a pour mobile le dsir. 5. Celui qui accomplit exactement ces (actes prescrits par et (mme) ici-bas les livres saints) entre dans l'immortalit, de tous ses dsirs tels qu'il les a obtient (l'accomplissement) conus. 6. La base de la Loi c'est le Vda tout entier, ainsi que la et la bonne conduite de ceux qui le connaissent, Tradition et les coutumes des gens vertueux et le contentement intrieur. 7. Tous les devoirs qui ont t assigns par Manou sont exposs dans le Vda : car (Manou) possde l'omchacun niscience. examin tout ce (systme) 8. Aprs avoir entirement l'homme instruit conforavec l'oeil de la science, devra, l'autorit de la Rvlation, s'attacher son mment devoir. 9. Car l'homme la Loi tablie qui se conforme par la Rvlation et la Tradition ici-bas une bonne renomacquiert me, et aprs la mort la flicit suprme. 10. Par Rvlation il faut entendre le Vda et par Tradide tion le Livre des lois ; tous deux doivent tre au-dessus sur n'importe toute discussion car c'est d'eux quel point, le devoir. que procde l'espoir d'un avantage. Les voeux, par exemple ceux d'un tudiant brahmane. Yamadharma, mot mot rgle de rpression (des dsirs sensuels) . L. de l'esprance (d'un avantage) nat l'empressement . B. H. l'gosme a sa racine dans l'espoir d'une rcompense . 5. Amaraloka, l'immortalit c'est--dire l'absorption en Brahm ou la dlivrance finale . (Kull.) 6. La bonne conduite : la suivant Govindarja, c'est la suppression de l'affection et de la haine , suivant Kull. treize qualits composent la bonne conduite, telles que l'amiti pour les Brahmanes, la pit envers les Dieux et les Mnes, la douceur, etc. .cra les coutumes , telles que porter une couverture ou un vtement d'corce . (Kull.) Le contentement intrieur, c'est--dire la conscience qui guide les actions.
LES LOIS DE MANOU
83
11. Tout Dvidja qui s'appuyant sur le rationalisme mdoit tre chass par les gens de bien prise ces deux sources, comme athe et contempteur du Vda. 12. Le Vda, la Tradition, la coutume des gens vertueux de soi-mme, voil ce qu'on dclare tre et le contentement manifestement le quadruple de la Loi. fondement 13. La connaissance de la Loi est prescrite pour ceux qui : pour ceux qui sont dtachs des richesses et des plaisirs suveulent connatre la Loi, la Rvlation est l'autorit prme. 14. Mais en cas de divergence entre deux textes sacrs, tous deux sont reconnus comme Loi : car tous deux ont t dclars par les Sages avoir force de Loi. 15. (Par exemple) le texte vdique dit qu'on peut accomplir en tout temps, le sacrifice avant aprs le lever (du soleil), son lever, ou lorsque ni soleil ni toiles ne sont visibles. 16. Personne n'est qualifi pour (l'tude autre, sachez-le, les crmode) ce livre, que celui pour lequel on accomplit celle des funnies, depuis celle de la conception jusqu' avec rcitation des formules sacres. railles, 11. Dvidja rgnr , signifie un homme des trois premires castes, rgnr par l'investiture du cordon sacr : le Brahmane est souvent dsign par la priphrase le meilleur des dvidjas . Le dogme n'admet aucune discussion, il exige une foi aveugle. 12. Manifestement peut tre rapport on dclare . Fondement : lakshana signifie proprement signe distinctif, caractristique . 13. Pour ceux qui sont dtachs, etc., et non pour les autres, parce que, dit Kull., n pour ceux qui par dsir des richesses et des plaisirs, et dans le but de gagner des avantages terrestres, obissent la loi, les oeuvres sont sans fruits . 15. Le sacrifice : l'Agnihotra ou sacrifice du feu, dsign par ce vers, consiste dans deux sries d'offrandes, dont l'une a lieu le matin, l'autre le soir. Le moment o ni le soleil ni les toiles ne sont visibles c'est le crpuscule; samaydhyushite signifie proprement quand (le soleil) est moiti lev . Nous avons suivi la paraphrase de Kull. 16. Les crmonies auxquelles il est fait ici allusion ne sont pratiques que pour les hommes des trois premires castes : aussi la lecture de ce livre est interdite aux Soudras.
24
LES LOIS DE MANOU
17. La rgion cre par les Dieux, qui s'tend entre les deux rivires divines la Sarasvat et la Drichadvat s'appelle Brahmvarta. dans 18. La coutume qui s'est perptue par transmission ce pays, parmi les (quatre) et les castes castes (principales) est ce qu'on appelle la coutume des gens vertueux. mixtes, 19. La rgion desKourous, (celle) des (celle) des Matsyas, et (celle) des Sorasnakas, Pantchlas voil (ce qui forme) en effet le pays des Brahmarchis, venant immdiatement aprs le Brahmvarta. 20. (C'est de la bouche) d'un Brahmane de ce originaire sur terre doivent apprendre leurs pays (que) tous les hommes us et coutumes respectifs. 21. Le pays situ entre l'Himavat et le Vindhya, l'est de Vinasana et l'ouest de Prayga Madhyadesa. s'appelle la mer Occidentale, 22. De la mer Orientale entre ces la rgion deux montagnes (s'tend que) les Sages appellent ryvarta. 23. Le pays o erre taches naturellement l'antilope noires doit tre considr comme propre l'accomplissement : (le pays) au del est la rgion des Mletchchas. du sacrifice 17. Cre par les dieux : devanirmita est traduit par L. digne des dieux et par B. H. fixe par les dieux . La Sarasvat (aujourdhui Sarsouti) descend de l'Himalaya et se perd dans les sables du dsert. Comme divinit c'est la Minerve de l'Inde, la desse de l'loquence et du savoir, l'inventrice du Sanskrit et de l'criture dite Devangar. La Drichadvat est probablement le Kgar avant sa jonction avec la Sarsouti. 19. Les Brahmarchis sont des Sages de caste brahmanique. 21. Himavat = Himalaya. Le Vindhya est une chane qui spare l'Inde centrale du Dekhan. Vinasana signifie disparition, perte (de la Sarasvat) . Cette rgion est situe au N. O. de Delhi. Prayga, aujourd'hui Allahbad, au confluent de la Djemna et du Gange. Madhyadesa, signifie pays du milieu . 22. ryvarta signifie contre des Aryens. 23. La rgion des Mletchchas : qui n'est pas propre au sacrifice , ajoute Kull. Ce mot dsigne les trangers, les barbares, mot mot : ceux qui baragouinent . Cf. pour le sens le grec fipapo = lat. balbus et le russe niemetz allemand, tranger , tir de l'adjectif niemo, muet.
LES LOIS DE MANOU 24.
25
dans ces pays ; rsident de prfrence Que les Dvidjas au Soudra, quant press par les besoins de la vie, il peut habiter o. n'importe de la Loi et 25. On vous a expos succinctement l'origine la naissance de tout cet (univers) : apprenez (maintenant) les devoirs des castes. 26. Pour les Dvidjas, (c'est) avec les saints rites prescrits tre accomplies (les crmonies par le Vda (que) doivent telles que celle de) la conception et autres sacrements, qui et dans sanctifient le corps et le purifient dans ce monde l'autre. 27. Par les offrandes la grossesse, au feu pendant par la crmonie qui suit la naissance, par par (celle de) la tonsure, du cordon sacr d'herbe est (celle de) l'investiture moundja, effac chez les Dvidjas le pch dans la contract) (originel semence (du pre) et le sein (de la mre). 28. Par l'tude (du Vda), par les voeux, par les offrandes au feu, par (le voeu d'tudier) les trois Vdas, par les offrandes (aux Dieux, aux Sages et aux Mnes), par (la proet par sacrifices des enfants, cration) par les (cinq) grands en les (autres) rites, le corps devient de l'absorption digne Brahm. on doit accomplir 29. Avant de couper le cordon ombilical, le rite de la naissance pour un (enfant) mle ; on doit lui faire goter (dans une cuiller d') or du miel et du beurre clarifi, sacres. les formules tout en rcitant ou s'il est absent ) fasse ac30. Que le pre ( accomplisse, ou de l'imposition du nom, le dixime complir la crmonie ou en un jour lunaire le douzime (jour aprs la naissance), 28. Les voeux : les pratiques asctiques telles que l'abstention de miel, de viande, etc. . (Kull.) 29. Le rite de la naissance ou jtakarman. Le texte dit qu'on doit faire goter l'enfant de l'or, du miel et du beurre . Il est vident qu'il faut entendre par l que le miel et le beurre ont t mis en contact avec un objet en or, par exemple une cuiller, une pice de monnaie, un anneau, etc. 30. Le texte dit simplement qu'il fasse accomplir krayet : nous avons
26
LES LOIS DE MANOU
un moment sous une heureuse constelfavorable, propice, lation. 31. Que (la premire du) nom exprime, pour un partie Brahmane une ide de faveur propice, pour un Kchatriya une ide de force ; pour un Vaisya une ide de richesse; pour un Soudra une ide d'abaissement. du nom) exprime, 32. Que (la deuxime partie pour un une ide de flicit; une ide Brahmane pour un Kchatriya de protection; ; pour pour un Vaisya une ide de prosprit un Soudra une ide de servitude. 33. Que (le nom) d'une femme soit facile prononcer, rien de dur, ait un sens clair, soit agrable, (n'exprime) proune parole pice, termin par une voyelle longue, renfermant de bndiction. 34. Au quatrime mois il faut accomplir la pour l'enfant au sixime de la premire) sortie de la maison, (crmonie alimentation avec du riz, ou celle de la premire) (mois, tout autre rite propice de ) la exig par ( les traditions famille. 35. La crmonie de la tonsure doit pour tous les Dvidjas se faire, conformment la loi, dans la premire ou la troisime anne, d'aprs les prescriptions de la Rvlation. 36. La huitime anne aprs la conception doit avoir lieu l'initiation d'un Brahmane, la onzime (celle) d'un Kchatriya, la douzime (celle) d'un Vaisya. suppl comme en maint autre endroit le commentaire entre parenthses. L'imposition du nom, en sanskrit nmadheya. 31. Nomen omen dit un proverbe latin.La premire partie : les noms hindous sont presque toujours des composs. 32. L. traduit pushti, prosprit, par libralit (?) Cette rgle pour le choix des lments composants du nom, comme le remarque B. H., a fini par tomber en dsutude. 34. La premire de ces deux crmonies s'appelle nishkramana, la seconde annaprana : anna signifie en gnral aliment et en particulier riz . 35. La crmonie de la tonsure, cdkarman, consiste raser le crne en laissant une touffe de cheveux. 36. L'initiation, upanyana ; cette crmonie est marque par l'investiture
LES LOIS DE MANOU 37. (L'initiation) la science sacre d'un Kchatriya celle d'un Vaisya huitime. 38. Jusqu' la deuxime pour
27
d'un Brahmane qui aspire exceller dans celle doit se faire dans la cinquime anne, la puissance dans la sixime, qui souhaite dsireux en ce monde dans la (de richesses)
la vingtseizime anne pour un Brahmane, un Kchatriya, la vingt-quatrime pour un de la communication n'est de) la Svitr (l'poque Vaisya, point passe. 39. (Mais) ce terme expir, les (hommes des) trois (castes) des exqui n'ont pas t initis en temps voulu deviennent des ryas. exclus de la Svitr et mpriss communis, 40. Avec ces gens, non purifis selon les rites, le Brahmane ne devra en aucun cas, mme en dtresse, contracter aucun du Vda, soit par mariage. lien, soit par (l'enseignement) 41. Les novices suivant l'ordre (de leur caste) doivent de dessus) des peaux d'antilope noire, porter (pour vtement de dessous des toffes de gazelle et de bouc, et (pour vtement de lin et de laine. de) chanvre, 42. La ceinture d'un Brahmane doit tre faite d'un triple cordon d'herbe unie et douce; moundfa (celle) d'un Kchatriya d'une corde en herbe morv; (celle) d'un Vaisya de fil de chanvre. 43. A dfaut de l'herbe les ceinmoundja (et des autres, du cordon sacr et de la ceinture, cf. v. 169, et par la communication de la prire dite Svitr, cf. v. 77. 38. La seizime anne aprs la conception . 39. Excommunis, vrtyas. Des ryas : c'est--dire des honntes gens . 40. Comme le remarque B. H., la crmonie appele vrtyastoma permet ces parias de rentrer dans le giron del communaut aryenne. 41. Novice, brahmacrin : c'est la premire priode de la vie d'un Dvidja qui vient de recevoir l'initiation ; ensuite il passe l'tat de grhastha ou matre de maison. Suivant l'ordre de leur caste : cela veut dire que le Brahmane porte une peau d'antilope, le Kchatriya une peau de gazelle, le Vaisya une peau de bouc, etc. 42. Moundja, Saccharum mufija ; morc, Sanseveria Roxburghiana. 43. Kousa, Poa cynosurodes; asmntaka, Spondias mangifera; balbadja,
28
LES LOIS DE MANOU
en balen asmntaca, tures) devront tre faites en kousa, badja, triples, avec un seul noeud, ou avec trois, ou avec cinq. doit tre en coton, 44. Le cordon sacr d'un Brahmane droite et triple, enroul sur (l'paule) (celui) d'un Kchatriya en fil de chanvre, (celui) d'un Vaisya en fil de laine. doit (porter) un bton de 45. Suivant la loi, un Brahmane vilva ou de palsa, un Kchatriya ou de (un bton) de vata un Vaisya (un bton) de pilou ou d'oudoumbara. khadira, 46. Le bton d'un Brahmane doit tre assez long pour ses cheveux, d'un Kchatriya doit s'lever atteindre (celui) au niveau de son front, d'un Vaisya au niveau de (celui) sonnez. 47. Que tous les btons soient sans dfaut, d'un droits, sans rien qui inspire la terreur aux gens, aspect agrable, garnis de leur corce, non entams par le feu. 48. Ayant pris le bton dsir, aprs avoir ador le soleil et tourn autour du feu (sacr), de gauche droite, (le novice) la rgle, demander l'aumne. ira, suivant 49. Un initi Brahmane en demandant l'aumne ( une Saccharum cylindricum. La premire de ces trois herbes est pour le brahmane, la deuxime pour le kchatriya, la troisime pour le vaisya. Avec un seul noeud, ou avec trois ou avec cinq : Suivant les usages de la famille . (Kull.) Triplas, c'est--dire en trois cordes. 44. rdhvavytam signifie littralement port sur le haut (du corps) . Mais Kull. l'explique par dakshinvartitam. La traduction de B. tordu vers la droite est un peu vague : j'ai suppl paule . 45. Vilva, Mgle marmelos ; palsa, Butea frondosa ; vata, Ficus indica ; khadira, Mimosa catechu ; pilou, Careya arborea ou Salvadora persica ; oudoumbara, Ficus glomerata. 46. Atteindre ses cheveux : par cette expression un peu vague, il faut entendre la touffe qui est au sommet du crne, puisque videmment le bton du Brahmane doit tre le plus long des trois. 48. Le bton dsir : uktalakshanam, avec les marques particulires susmentionnes , ajoute le comm. de Kull. Il ne me parait pas exact de traduire par un bton son choix , le choix du bton n'tant pas libre ainsi qu'on vient de le voir. Aprs avoir ador le soleil, ou simplement s'tant plac en face du soleil . 49. A une femme : le vers suivant montre en effet que l'initi doit demander l'aumne une femme. Voici suivant Kull. les trois formules : Madame,
LES LOIS DE MANOU
29
au commencement (de sa femme) mettra le mot madame un (initi) au milieu, un (le mettra) requte), Kchatriya (initi) Vaisya la fin. 50. Qu'il demande d'abord sa mre, ou sa l'aumne soeur de sa mre, ou (toute autre soeur, ou la propre femme) qui ne le rebutera point. assez d'aumnes 51. Aprs avoir ramass pour ses besoins, son prcepteur, et en avoir fait la dclaration sincre qu'il vers l'Est, s'tant mange la face tourne purifi en se rinant la bouche. la face tourne 52. En mangeant vers l'Est, (il s'assure) une longue vie; vers le Midi, la gloire; vers l'Ouest, la prosvers le Nord (la rcompense prit; de) la vrit. 53. S'tant rinc la bouche, que le Dvidja prenne toujours sa nourriture dans le recueillement; son repas termin, qu'il se rince la bouche convenablement, et asperge d'eau les trous (de son visage). 54. Qu'il honore toujours sa nourriture et la mange sans sa vue; se rassrne, et ddain; qu'il se rjouisse qu'il souhaite d'en avoir toujours autant. 55. Car la nourriture honore force donne qu'on toujours et virilit : celle qu'on sans l'honorer dtruit ces mange deux choses. 56. Qu'il ne donne ses restes personne; qu'il ne mange l'intervalle pas dans (des repas qu'il ne rglementaires); fasse aucun excs de nourriture, et qu'il n'aille nulle part, sans avoir fait ses ablutions (aprs le repas). donnez-moi l'aumne. Donnez-moi, Madame, l'aumne. Donnez-moi l'aumne, Madame . 52. La vrit : s'il dsire le fruit de la vrit, qu'il mange la face tourne vers le nord. (Kull.) 53. Les trous : c'est--dire les yeux, les oreilles, les narines. 54. Qu'il souhaite d'en avoir toujours autant : explication du commentaire ; le texte porte simplement pratinandet, qu'il s'en rjouisse. 56. Tathntar dans l'intervalle , c'est--dire suivant Kull. entre les deux repas, celui du matin et celui du soir.
30 57. L'excs
LES LOIS DE MANOU
de nourriture est contraire la sant, la lonun vice, et il de parvenir) au ciel ; c'est gvit (et empche est blm parmi les hommes; on doit donc l'viter. de la 58. Que le Brahmane fasse toujours le rincement ou Brahme, bouche avec la partie de la main consacre avec celle qui est consacre Ka ou aux trente (Dieux), mais aux Mnes. jamais avec celle qui est consacre 59. On appelle consacre Brahme la partie situe la base du pouce; consacre Ka celle qui est situe la base du (petit) doigt; consacre aux Dieux, celle qui est au bout aux Mnes, celle qui est en dessous (des doigts) ; consacre de ces deux (entre le pouce et l'index). 60. Qu'il commence trois fois de l'eau, puis par ingurgiter et (enfin) qu'il asperge d'eau qu'il essuie deux fois sa bouche, les trous (de son visage), sa poitrine et sa tte. 61. Celui qui connat la loi et qui tient la puret devra ni de l'eau qui ne soit ni bouillante toujours (employer) mousseuse, pour se rincer la bouche, de) la (en se servant la face dans un lieu cart, partie de la main (prescrite), tourne vers l'Est ou le Nord. 62. Un Brahmane est purifi par l'eau qui descend jusqu' un Kchatriya sa poitrine, sa gorge, un par (celle) qui atteint un Soudra par Vaisya par (celle) qu'il prend dans sa bouche, (celle) qu'il touche du bout (de sa langue et de ses lvres). 57. Empche de parvenir au ciel, parce qu'il empche d'accomplir les sacrifices et autres devoirs pieux en vue de mriter le ciel . (Kull.) Apunyam signifie suivant L. cause l'impuret , suivant B. empche, (l'acquisition du) mrite spirituel. 58. Sur la diffrence de Brahme et Brahm cf. la note du v. 98, I. Ka ou Pradjpatidsigne le Seigneur des cratures, le crateur. 59. Tayoradhah en dessous de ces deux , expression vague : Kull. la la prcise en ces termes angushthapradeinyor madhye. 60. Sa poitrine : tman signifie ici le sige de l'me , c'est--dire la poitrine ou le coeur. 62. Qui descend jusqu' sa poitrine : le texte dit hrdgbhih, mais je pense qu'il faut traduire ici par poitrine plutt que par coeur : on voit en effet que suivant la caste la purification s'opre par une absorption plus ou moins avance de l'eau.
LES LOIS DE MANOU 63.
31
Un Dvidja est appel Oupavtin quand sa main droite est leve, Prtchnvtin et Niotin quand c'est sa gauche, quand le cordon pend son cou. la peau (qui lui sert de manteau), 64. La ceinture, son bton, son cordon sacr, son pot eau, il doit les jeter l'eau en rcitant et en prendre d'autres quand ils sont dtriors, les formules sacres. de la) tonsure 65. La (crmonie est fixe la seizime un Brahmane, la vingt-deuxime anne pour pour un et pour un Vaisya Kchatriya, (elle doit se faire) deux (ans) plus tard. 66. Toute cette srie (de crmonies) doit tre accomplie en vue de purifier leur corps, dans le temps pour les femmes et dans l'ordre mais sans (accompagnement voulus, de) formules sacres. 67. La crmonie du mariage est reconnue rem(comme la conscration les devoirs plaant) vdique pour la femme, la rsidence qu'elle rend l'poux (comme remplaant) (du du matre les soins domestiques novice) auprs spirituel, l'entretien du feu sacr. (comme remplaant) le rite de l'initiation 68. Ainsi (vous) a t dcrit d'un et qui purifie : Dvidja, qui symbolise (sa seconde) naissance maintenant les devoirs imposs ( l'initi). apprenez le prcepteur 69. Aprs avoir initi le disciple, spirituel lui enseignera d'abord (les rgles de) la puret, (celles de) la bonne conduite, du feu (sacr) et les dvotions l'entretien du matin et du soir. 63. Quand sa main droite est leve : et que le cordon sacr ou son vtement, passant sous l'aisselle droite, repose sur l'paule gauche (Kull.); inversement dans le cas suivant; dans le troisime cas le cordon ne passe sous aucun des deux bras. 65. La tonsure : Kenta dsigne la touffe de cheveux qu'on laisse au sommet de la tte en rasant le reste. La seizime anne aprs la conception . 66. Formules sacres ou prires, mantras. 69. Ces dvotions sont appeles sandhys, et ont lieu, comme l'indique le nom, au crpuscule.
32
LES LOIS DE MANOU
70. Mais un (novice) au moment d'tudier (le Vda) devra la bouche se rincer suivant et (les prescriptions du) livre, recevra sa leon, le visage tourn vers le Nord, aprs avoir fait un salut respectueux au Vda, des vtements portant et matre de ses sens. propres, 71. Au commencement et la fin (de la lecture) du Vda, il ne manquera les pieds de son prcepteur, pas de toucher en joignant et il tudiera les mains : car c'est l ce qu'on au Vda. appelle l'hommage 72. Avec les mains croises, qu'il prenne'les pieds de son de la (main) le (de manire prcepteur ) toucher gauche et de la (main) droite le (pied) droit. (pied) gauche, 73. Sur le point de commencer la rcitation, le prceplui dira : Oh! rcite. (Quand teur, toujours infatigable, le prcepteur s'arrtera. dira) : Repose-toi , (le disciple) la syllabe OM au commence74. Qu'il prononce toujours ment et la fin (de la rcitation) du Vda ; car (la leon) qui n'est pas prcde de la syllabe OM s'efface ; si elle n'en est pas suivie, elle ne laisse pas de traces. 75. Assis sur (des brins d'herbe dont les pointes kousa) sont tournes l'Est, purifi d'herbe kousa par des brins et purg (tenus dans ses deux mains) par trois suspensions il est digne de prononcer la syllabe OM. d'haleine, le Seigneur 76. Les sons A,U,M, des cratures les a exprims des trois Vdas, ainsi que les mots Bhoh, et Bhouvah Svah. 70. Le livre, stra, dsigne les lois de Manou. Ce salut appel anjali consiste incliner lgrement la tte en rapprochant l'une de l'autre les paumes des mains, et en les levant la hauteur du front. 71. L'hommage au Vda Brahmnjali; Brahman est synonyme de Vda. 74. La syllabe OM ou mieux AUM (o = A+ U) est un monosyllabe sacr qui prcde toutes les invocations : les trois lettres qui la composent symbolisent les trois Vdas. Plus tard elle a figur la Trimorti ou Trinit hindoue : A = Vichnou, U = iva, M = Brahm. 75. Pavitraih kuaih karadvayastbaih pavitrikrtah s'tant purifi par des moyens de purification (qui sont) des brins d'herbe kousa tenus dans les deux mains . Kull. La suspension d'haleine, prnyma est une pratique d'asctisme usite dans l'Inde. 76. Ces trois mots signifient terre, atmosphre, ciel : on les appelle vibrtis.
LES LOIS DE MANOU 77. habite
33
Des trois Vdas aussi le Seigneur des cratures qui au plus haut des cieux a trait, stance cet par s tance, la Svitr. par tad (appel) hymne qui commence 78. Un Brahmane dans les Vdas, instruit qui aux deux murmure cette syllabe de crpuscules, (OM) et cet (hymne la Svitr), prcd des (trois) mots (Bhoh Bhouvahet Svah), (tous) les mrites (la rcitaacquiert spirituels que procure tion des trois) Vdas. 79. Un Dvidja qui rcite mille fois (par jour) dans un lieu cart cette triple (invocation) est absous au bout d'un mois mme d'une grande de faute, comme le serpent (est dlivr) sa dpouille. le Kchatriya 80. Le Brahmane, et le Vaisya qui ngligent et (l'accomplissement) cette invocation en temps voulu des rites qui leur sont propres, le blme des gens encourent vertueux. 81. Sachez que les trois grandes paroles imprissables, de la syllabe OM et (suivies) trois de la Svitr prcdes sont la bouche (mme) du Vda. stances, 82. Celui qui pendant trois ans rcite sans relche tous les jours cette (invocation) ira rejoindre la divinit suprme, d'un corps thr. lger comme l'air et revtu 83. Le monosyllabe les divinit, (OM) est la suprme d'haleine la plus parfaite mais rien austrit; suspensions n'est suprieur la Svitr vaut mieux ; la vrit que le silence. 77. A trait : mtaphore consacre. Qui habite au plus haut des cieux : parameshthin. Hymne, va, d'o le nom de Rig Vda. Tad : pronom dmonstratif neutre qui commence l'invocation (Rig Vda, III. 62, 10). La Svitr est aussi appele Gyatr : C'est une invocation au soleil considr comme Savitar, vivificateur. Stance par stance. B. traduit un pied (pda) de chaque (Vda) , il y a en effet trois pdas. 79. Dans un lieu cart : mot mot en dehors du village . 81. Bouche du Vda : brahmano mukham, c'est--dire le moyen le plus sr d'arriver la flicit suprme. L. : la partie principale du Vda . B. le portail du Vda et la grille conduisant l'union avec Brahman . 82. La divinit suprme : Brahman. 3
34
LES LOIS DE MANOU
84. Tousles rites vdiques, et (les (telsque)l'offrandeaufeu, sacrifices mais sachez que la syllabe (OM) est autres) passent; et le Seigneur cls cratures. imprissable: (elle est) Brahme 85. L'offrande consistant dans la prire murmure est dix fois plus efficace que le sacrifice rcite (la prire) rgulier; assez bas pour n'tre l'est cent fois plus ; (la pas entendue l'est mille fois plus. prire) mentale 86. Les quatre sacrifices des domestiques accompagns sacrifices tous ensemble ne valent pas la seizime rguliers, consistant dans la prire murmure. partie du sacrifice 87. Il est hors de doute qu'un Brahmane la peut arriver batitude rien que par la prire murmure ; qu'il accomplisse ou non les autres (rites), un Brahmane est appel l'ami (de toutes les cratures). 88. Que le sage s'efforce de rfrner ses organes gars dans les sductions des objets des sens, comme un cocher ses chevaux. 89. Les onze organes que les anciens sages ont nomms, comme il convient, et dans exactement, je vais les numrer : l'ordre 90. Les oreilles, la peau, les yeux, la langue et le nez cinles parties les mains, les pieds et l'anus, sexuelles, quime, de) la parole dixime. (l'organe 84. Passent, svarpatah phalataca en ce qui concerne leur forme et leurs rsultats . (Kull.) Jeu de mots sur aksharam signifiant la fois la syllabe om et imprissable . Il est vident que la leon de Kull. akshayam, quoique donnant le mme sens, doit tre rejete, puisqu'elle supprime le jeu de mots. 86. Les quatre sacrifices domestiques, les pkayajnas sont parmi les cinq grands sacrifices, les quatre autres que le brahmayajna, savoir le vaivadevahoma, le balikarman, le nytiarddha et l'atithibhojana. (Kull.) Les sacrifices rguliers sont ceux tels que celui de la nouvelle et de la pleine lune, etc. . (Kull.) 87. Maitro brhmana ucyate : On peut aussi construire, comme le fait B. : Lui qui est l'ami (de toutes les cratures) il est dclar (tre un vrai) Brahmane. L. : Il est dit (justement) uni Brahme. En n'offrant pas de sacrifice il 'immole pas de victimes, et par suite ne fait aucun mal aux cratures.
LES LOIS DE MANOU 91.
35
Il y en a cinq, l'oreille et ceux qui suivent (qu'on et ceux qui suivent, appelle) organes des sens; cinq, l'anus qu'on appelle organes de l'action. 92. Sachez que le onzime est le sens interne (ou esprit) tient de la nature des deux (catgories qui par sa qualit ces deux catgories de cinq nonces); quand il est dompt, sont (aussi) domptes. des organes 93. Par l'attachement sensuels) (aux plaisirs se met en tat de pch, tandis il est hors de doute qu'on on parvient la batitude. qu'en les matrisant nullement des 94. Le dsir ne s'teint par la jouissance il ne fait que crotre davantage, comme le feu objets dsirs; (sur lequel on rpand) du beurre clarifi. 95. (Comparez) un homme toutes ces qui obtiendrait et un homme sensuelles) qui renoncerait (jouissances tous les plaisirs des sens est prftoutes : le renoncement rable leur satisfaction. 96. Ces (organes) attachs la sensualit ne sauraient tre aussi bien rfrns (aux plaisirs sensuels) par le renoncement de la connaissance. constante que par la (recherche) la libralit, 97. (L'tude les sacrifices, les des) Vdas, les austrits, ne conduiront observances pieuses, jamais la flicit suprme celui dont le coeur est corrompu. 98. L'homme touche, voit, gote ou sent, qui entend, sans prouver ni plaisir ni peine, peut tre considr comme ayant dompt ses sens. 99. Mais quand parmi tous les organes un seul s'chappe, alors la sagesse de l'homme ainsi que l'eau par le s'chappe, trou d'une outre. 92. Comme le remarque B. H. ces onze organes des sens et de l'action, en y joignant les deux principes de l'intelligence et de la conscience, constituent les treize instruments de connaissance de la doctrine Snkhya . 99. Prajn sagesse ou suivant Kull. tattvajnnam, connaissance de la vrit . Pdt d'une outre (?); pda signifie pied : faut-il lire ptrt d'un vase ? Le commentaire du reste est prcis : rien que par un seul trou le liquide s'chappe d'un rcipient eau fait d'une peau. Pda dsigne peut-tre un des pieds de la peau de chvre formant l'outre.
36 100. Celui
LES LOIS DE MANOU
de ses organes, et qui tient en bride l'ensemble tous ses dsirs, qui dompte son sens interne, peut atteindre sans mortifier sa chair par l'asctisme. du matin qu'il murmure 101. Au crpuscule la Svitr debout jusqu' du soleil; celui du soir (qu'il la l'apparition assis jusqu' ce que toutes les toiles soient murmure) visibles. 102. En murmurant debout au crpuscule du (la Svitr) il efface les pchs de la nuit : (en la murmurant) matin, assis au crpuscule du soir, il efface la souillure contracte le jour. pendant 103. Celui qui ne (fait pas sa prire) debout le matin et assis le soir, doit tre exclus comme un Soudra de toutes les crmonies des Dvidjas. 104. Observant la rgle journalire (de la prire) qu'il dans le voisinage d'un cours d'eau, rpte mme la Svitr ses sens et recueilli. retir dans une fort, domptant du Vda, 105. Pour (l'tude des) traits complmentaires on ne doit tenir aucun ou pour la rcitation journalire, non plus que des rgles d'interruption, pour les compte au feu. l'offrande formules (accompagnant) la (rcitation) 106. Il n'y a point d'interruption pour l'oblation du Vda ; le car elle est appele journalire, 100. L. : Doit vaquer ses affaires sans macrer, etc. , me parait inexact ; artha signifie l'objet qu'on a en vue . 102. Il s'agit des fautes commises sans le savoir, ajnakrtam. (Kull.) 104. Mme : Ce mot api est clairci par le commentaire : Quand il n'est pas en tat de rciter d'autres textes vdiques. 105. Les traits complmentaires sont appels Vedngas (membres du Vda) ; ils sont au nombre de six et traitent les matires suivantes : phontique, mtrique, grammaire, tymologie, astronomie et crmonial religieux. Les rgles d'interruption ou de suspension de la lecture vdique sont expliques au livre IV, 101 sqq : les clairs, le tonnerre, les mtores sont des causes de suspension. 106. L'oblation du Vda : Brahmasattra. B. le perptuel sacrifice offert Brahman. La fin de ce vers est obscure. Vashat est l'exclamation qui annonce la fin du sacrifice ; cela revient dire : Quand la lecture est
LES LOIS DE MANOU sacrifice
37
o le Vda sert d'offrande est mritoire (mme) une interruption de lecture l'exclamation remplace quand vachat . 107. Pour de ses sens, pratique celui qui pur et matre selon la du Vda) un an la rcitation pendant (journalire le beurre le lait doux, le lait aigre, toujours rgle, coulent clarifi et le miel. le feu sacr, 108. Le Dvidja qui a t initi doit entretenir son vivre dormir sur le sol, et complaire d'aumnes, de la crmonie du) prcepteur jusqu' (l'accomplissement retour la maison. 109. Selon la loi sacre dix (sortes de personnes) peuvent tre admises tudier un (le Vda) : le fils du prcepteur, une science, docile, celui qui communique (jeune homme) celui qui observe la loi, celui qui est pur, celui qui est dvou, celui qui est capable, celui qui est celui qui fait des prsents, honnte, (enfin) un parent. sans tre ni 110. On ne doit point parler interrog, une question ; le sage, mme quand il (rpondre) dplace dans le monde comme sait, doit se conduire (s'il tait) un simple 111. d'esprit. De deux personnes dont l'une rpond d'une manire
suspendue, ce qui quivaut la fin du sacrifice. Voici du reste les diverses interprtations des traducteurs : L. mme lorsqu'il est prsent dans un moment o la lecture des livres sacrs doit tre interrompue . B. (mme) quand (des phnomnes naturels exigeant) une cessation de l'tude du Vda prennent la place de l'exclamation Vashat . B. H. : le sacrifice du Vda, est mritoire avec (le mot) Vashat qui ne devrait pas tre prononc. Le sens gnral me parat tre celui-ci : Le Brahmasattra garde ses mrites indpendamment des causes accidentelles qui ncessitent l'interruption de la lecture du Vda. 107. Coulent toujours la lait doux,.etc.: c'est--dire ses offrandes sont agres par les Dieux et les Mnes, et ceux-ci lui accordent l'accomplissement de tous ?es dsirs . 108. Cette crmonie s'appelle Samvartana. 109. Dvou; pta signifie suivant B. une personne unie par le mariage ou l'amiti . 111. L'une : c'est--dire celle qui a manqu la loi, et dans le cas o
3S
LES LOIS DE MANOU
d'une manire l'une et l'autre interroge illgale, illgale, ou encourra l'inimiti mourra (de l'autre). ni l'obis112. L o l'on ne trouve ni vertu, ni richesse, on ne doit point semer la science (sacre) non sance requise, plus que le bon grain dans une terre strile. du Vda meure avec sa science, 113. Qu'un interprte plutt que de la semer sur un sol strile, (ft-il) mme dans dtresse. une extrme et lui dit: 114. La Science sacre alla trouver un Brahmane ne me donne Je suis ton trsor, pas un garde-moi, de la sorte je serai toute-puissante. dtracteur; 115. Si tu connais un disciple pur et matre de ses sens, comme un gardien ce Brahmane, vigilant enseigne-moi de (ce) trsor. sans permission le Vda de 116. Mais celui qui acquiert de vol du Vda, et sera quelqu'un qui le rcite, est coupable en enfer. prcipit saluer celui dont on reoit la science 117. On doit d'abord des choses du mon de, du Vda ou de l'tre suprme. matre de ses passions, ne st-il que la 118. Un Brahmane celui qui possdant les trois Vdas est suprieur Svitr, n'est pas matre de ses passions, qui mange de tout et trafique de tout. sur une couche ou sur un 119. On ne doit point s'asseoir et quand on est install sur sige occup par un suprieur, une couche ou sur un sige, on doit se lever ( l'approche d'un suprieur) et le saluer. les deux ont manqu la loi, toutes deux seront punies. L'inimiti de l'autre : ou peut-tre plus gnralement l'inimiti parmi les hommes . 115. On peut prendre brahmacrin disciple comme un adjectif = chaste. 116. L'enfer : le naraka un des trente-six enfers numrs par Manou. 117. dhytmikam est suivant Kull. brahmajfinam, la connaissance de Brahme, de l'Etre suprme. On : c'est--dire le novice, l'tudiant. 118. Qui mange de tout : c'est--dire qui ne s'abstient pas des aliments prohibs. 119. Un suprieur dsigne ici surtout un guru ou matre spirituel : la pre-
LES LOIS DE MANOU
39
120. Car les esprits vitaux d'un jeune homme montent en l'air (comme pour s'exhaler de son corps) l'approche d'un et en le saluant, vieillard il ; en se levant (respectueusement) les retient. 121. Celui qui a coutume de saluer et d'honorer toujours les personnes crot en quatre ges, (choses) : longvit, force. science, gloire, 122. Aprs (la formule du) salut, un Brahmane qui aborde de plus g doit dcliner son nom en disant : Je quelqu'un suis un tel, 123. Aux personnes qui ne comprennent pas (le sens) du du nom, le sage doit dire : salut (accompagn) de la dclaration C'est moi , et (il doit faire) de mme toutes les femmes. 124. Dans la salutation, il doit prononcer aprs son nom le mot Ho ! ; car les sages dclarent de que la nature Ho ! est la mme que celle des noms propres. 125. Puisses-tu avoir une longue vie, mon cher ! C'est la salutation d'un Brahen ces termes qu'il faut rpondre de la fin de son nom, avec la lettre mane, et la voyelle qui doit tre prononce prcde, longue. 126. Le Brahmane de qui ne connat pas la manire un salut, ne mrite salu par l'homme rpondre pas d'tre instruit ; il est comme un Soudra. mire partie du vers peut tre entendue diffremment : On ne doit point s'asseoir sur une couche ou un sige l'approche d'un suprieur . 120. Le commentaire dit que les esprits vitaux du jeune homme dsirent sortir de son corps l'approche d'un vieillard, sans indiquer la raison de ce phnomne. 123. Qui ne comprennent pas, par ignorance du sanskrit . (Kull.) 124. Ho I en sanskrit bhoh ; c'est--dire que bhoh reprsente le nom des personnes interpelles. 125. Mon cher : saumya signifie littralement doux comme le soma . La voyelle a oues autres . (Kull.) D'aprs le commentaire de Nand. et de Nr. B. traduit ainsi : la voyelle a doit tre ajoute la fin du nom (de la personne interpelle), la syllabe prcdente tant allonge de manire durer trois temps ; ainsi Devadatta se prononcerait Devadatt 3 a. J'ai suivi la leon qui spare plutah de prvksharah au lieu de runir en un seul mot prvksharaplutah. (Edit. Jolly.)
40 127. prit, affaires En abordant un Kchatriya, ; (enfin on
LES LOIS D'E MANOU un Brahmane de.sa sant, demandera) de sa proson s'informera de l'tat de ses un Vaisya, un Soudra s'il n'est pas
malade.. 128. On ne doit point interpeller par son nom celui qui a ft-il plus t initi (pour l'accomplissement d'un sacrifice), en la loi lui adressera la parole jeune : celui qui connat . commenant par Ho ! ou Seigneur 129. En parlant une femme qui est l'pouse d'un autre, ou qui n'est pas sa parente par le sang, il doit dire Madame ou chre soeur . 130. A ses oncles maternels et paternels, son beau-pre, des prtres officiants, ses matres il doit dire : spirituels, Je suis un tel , en se levant ( leur approche, alors mme qu'ils seraient) plus jeunes que lui. 131. Une tante maternelle, la femme d'un oncle maternel, doivent tre honores une belle-mre, et une tante paternelle comme la femme d'un matre spirituel ; elles lui sont gales. 132. Chaque aux pieds de la jour on doit se prosterner aux femme d'un frre, si elle est de la mme caste; quant c'est femmes des (autres) parents par le sang ou par alliance, au retour d'un voyage qu'on doit embrasser (seulement) (leurs pieds). 133. Envers la soeur de son pre ou de sa mre, envers sa soeur ane, on doit se comporter comme envers une mre : une mre est plus vnrable (cependant) qu'elles. 134. L'galit entre concitoyens, est(limite par mie diff127. Les quatre formules sont kuala, anmaya, kshema, rogya. 128. Les mots bhoh et bhavat. 129. Madame : bhavati. 130. Prtre officiant, rtvij. Le mot guru dsigne non seulement le matre spirituel, le prcepteur, mais encore toute personne vnrable un titre quelconque, par exemple par sa science, ses austrits, etc. 132. Jfiti et sambandba, parent par le sang et parent par alliance; ou bien, suivant Kull., parents du ct du pre et parents du ct de la mre . 134. Cela veut dire que deux concitoyens sont considrs comme gaux
LES LOIS DE MANOU
41
rence d'ge) de dix ans ; entre de cinq ans ; entre artistes, Brahmanes de trois ; entre-parents instruits, par le sang (elle est limite) par une trs petite (diffrence d'ge). 135. Sachez qu'un Brahmane de de dix ans et un Kchatriya cent ans sont (l'un par rapport l'autre comme) un pre et un fils ; seulement de ces deux, c'est le Brahmane qui est,le pre. 136. La richesse, et la parent,l'ge, les actes (religieux) la science le voil les cinq choses sacre, qui commandent chacune d'elles, respect; (en commenant par) la dernire, est plus vnrable (que celle qui prcde). 137. L'homme des trois (premires) castes qui est le mieux et en degr, mrite pourvu de ces cinq choses en quantit d'y tre honor; et mme un Soudra entr dans la dixime (dcade de son ge). 138. Il faut cder le pas une personne en voiture, un un malade, un homme d'un fardeau, nonagnaire, charg une femme, un Brahmane ses tudes, un qui a termin un mari. prince, elles 139. Parmi ces (personnes), sont (toutes) quand en mme temps, runies (c'est) le Brahmane ayant termin ses tudes, et le prince (qui) doivent tre honors (de prfrence) ; de ces deux derniers, (c'est) le Brahmane (qui) a droit tre honor par le roi. 140. Le Brahmane lui qui, aprs avoir initi un disciple, le Vda ainsi que la rgle du sacrifice et la doctrine enseigne est appel son prcepteur. sotrique, pourvu qu'il n'y ait pas plus de dix ans de diffrence d'ge entre eux. Brahmane instruit, rotriya ; on verra plus loin la valeur exacte de ce terme. 137. Y : (atra) c'est--dire parmi ces castes. 138. Nonagnaire : mot mot celui qui est dans la dixime dcade. Un Brahmane qui a termin ses tudes : un Sntaka, celui qui a pris le bain final. -7- Un prince : rjan est peut-tre un simple synonyme de kchatriya. 139. Honors : c'est--dire qu'on doit leur cder le pas. L. entend la fin du vers autrement : le Brahmane doit tre trait avec plus de respect que le kchatriya. 140. La rgie du sacrifice, kalpa la doctrine sotrique, c'est--dire les
42
LES LOIS DE MANOU
seulement 141. Mais celui qui pour gagner sa vie enseigne une portion du Vda, ou les parties accessoires du Vda, est appel le sous-prcepteur. suivant la rgle la cr142. Le Brahmane qui accomplit et qui donne ( l'enfant) monie de la conception et les autres, la (premire) est appel le matre nourriture, spirituel. 143. Celui qui ayant t choisi accomplit (pour un autre) et l'entretien du feu les oblations domestiques (sacr), son prtre et autres est appel sacrifices, l'Agnichtoma officiant. 144. Celui qui remplitvritablementlesdeux oreilles (d'un doit tre considr lve) avec le Vda, (par lui) comme un pre et comme une mre; (l'lve) ne doit jamais l'offenser. est dix fois plus vnrable 145. Le prcepteur que le sousla mre le pre cent fois plus que le prcepteur, prcepteur, mille fois plus que le pre. 146. De celui qui vous a donn le jour et de celui qui vous est le pre le a donn (la connaissance du) Vda, le dernier : car la naissance que le Vda (spirituelle) plus vnrable et dans un Dvidja est ternelle en ce monde communique l'autre. Upanishads. L'objet de ces traits est d'tablir le sens mystique du texte vdique ; ils discutent aussi certaines questions de mtaphysique, telles que l'origine de l'univers, la nature de la divinit et de l'me. 141. Les parties accessoires sont les Vedgas le sous-prcepteur updhyya, et au vers prcdent, le prcepteur crya. 142. Cette crmonie s'appelle Garbhdhna ou Nisheka. Nourriture : spcialement le riz. 143. L'Agnydheya est l'acte d'allumer le feu sacr les pkayajnas, mot mot les sacrifices de cuisson . Agnishtoma signifie louange d'Agni. 146. Brahmajanman : B. traduit : car la naissance en vue du Vda (assure) une ternelle (rcompense) dans cette (vie) et aprs la mort. On a dj expliqu le sens de dvidja rgnr par l'initiation, n une seconde fois . Le vers 146 est en contradiction avec le v. 145. Faut-il accepter l'explication de Kull. d'aprs laquelle l'crya dsigne ici celui qui aprs l'initiation enseigne la Svitr et rien dplus , ou plutt n'est-il pas probable, comme le remarque B., que ces deux opinions en contradiction sont places ici cte cte, parce que toutes deux sont bases sur d'anciennes traditions ?
LES LOIS DE MANOU
43
147. Il faut considrer comme une existence (purement matrielle celle qu'a reue l'enfant) quand son pre et sa mre et qu'il est n de l'ont engendr affection, par leur mutuelle la matrice (de sa mre). 148. Mais la (seconde) naissance sachant qu'un prcepteur tout le Vda lui communique, suivant la loi, par la Svitr, est la vraie ; (elle est) exempte de vieillesse et de mort. 149. Qu'il sache que l'homme le qui lui a communiqu bienfait du Vda, (que cet avantage est soit) petit ou grand, son pre spirituel, cause du bienfait appel en ce (trait) du Vda. (de la communication) 150. Le Brahmane la naissance qui a donn (spirituelle) ses devoirs, parle Vda, et celui qui enseigne ( quelqu'un) ft-il un enfant, la loi, le pre (de celui-ci), est, suivant pour g qu'il soit. 151. Kavi fils d'Anguiras tout jeune enseigna ses parents en les prenant il leur disait : plus gs; (comme lves), Enfants! en vertu de (la supriorit de) sa science. 152. Pleins de colre ils consultrent les Dieux ce sujet, et les Dieux s'tant dirent : L'enfant a parl assembls, comme il faut. 153. L'ignorant celui qui enseigne est en effet un enfant, le Vda est un pre ; car (les Sages) ont appel l'ignorant un et celui qui enseigne le Vda un pre. enfant, ni par les cheveux 154. Ce n'est ni par les annes, blancs, ni par les richesses, ni par la parent ; (qu'on est suprieur) les Sages ont fait cette loi : Celui qui a appris (le Vda en entier) est grand parmi nous. 149. En ce trait: le texte dit seulement iha, ici comment par castre. En gnral, dans Manou, iha signifie ici-bas par opposition l'autre vie. 151. Pitfn, mot mot ses pres c'est--dire ses parents qui avaient l'ge d'tre ses pres, ou bien, suivant Kull., ses oncles maternels, les fils de ceux-ci, etc. . Parigrhya les prenant (comme lves) signifie d'aprs Nand. parce qu'il les surpassait en science (jnnena) . Anguiras est l'un des sept grands Richis et un des dix anctres primordiaux de l'humanit. 153. Ce vers peut-tre mis dans la bouche des Dieux. 154. Le Vda en entier : c'est--dire les Vdas et les Angas.
44 155.
LES LOIS DE MANOU
Chez les Brahmanes (qui) constitue (c'est) la science la supriorit ; chez les Kchatriyas (c'est) le courage ; chez en grains les Vaisyas (et autres biens) ; (c'est) la richesse chez les Soudras l'ge. (c'est) seulement 156. On n'est pas g parce que l'on a des cheveux gris ; le dans le Vda, les Dieux celui qui jeune encore est instruit comme g. considrent en un lphant est comme 157. Un Brahmane ignorant bois ou un daim en cuir ; tous trois ne portent que le nom. avec les femmes, est improductif 158. Comme un eunuque comme une vache est strile avec une vache, comme un don ne porte point de fruits, ainsi un Brahmane fait un ignorant est inutile. des hymnes sans (la connaissance) (vdiques) aux crasans brutalit 159. Il faut procder pour donner en vue de leur bien; le (matre) tures l'instruction qui dsire douces et des paroles la loi doit employer (respecter) aimables. 160. Celui dont le langage et la pense sont toujours purs, tous les fruits que et constamment gards avec soin, recueille le Vdnta. procure montrer de mauvaise 161. On ne doit jamais humeur, offenser mme quand on a du chagrin ; on ne doit point autrui en actions ni en penses ; on ne doit point profrer d'entrer au ciel. une parole blessante et qui vous empcherait les honneurs comme fuie toujours 162. Qu'un Brahmane l'gal de l'amle mpris du poison ; qu'il recherche toujours broisie. 156. Ag, et par suite vnrable. 158. Inutile : parce qu'il est priv des fruits que procurent les sacrifices prescrits par la ruti et la Smrti . (Kull.) 160. Par Vdnta (fin du Vda, texte formant la conclusion d'un Vda) il faut entendre ici les Upanishads et la doctrine thologico-philosophique qu'ils renferment. 161. Alokya signifie extraordinaire, inconvenant, dplac. Kull. l'explique par svargdiprptivirodhin, empchant d'obtenir le ciel et le reste . 162. L'ambroisie, amrta, est le breuvage des Dieux donnant l'immortalit. Suivant une lgende clbre les Dieux et les Dmons (Asouras) se runirent
LES LOIS DE MANOU
45
et il s'endort le coeur lger 163. Car (quoique) mpris, le coeur lger en ce monde; s'veille le coeur lger, il marche tandis que le contempteur prit. de crmo164. Un Dvidja sanctifi par cette succession se chez son prcepteur, demeure nies, doit, qu'il pendant (l'aux austrits livrer progressivement qui prparent tude du) Vda. doit tudier le Vda tout entier avec la 165. Un Dvidja de cette doctrine tude) (en accompagnant sotrique, d'austrit et d'observances diverses prescrites pratiques par les rgles. doit l'asctisme 166. Un Brahmane qui veut pratiquer du Vda est consiconstamment tudier le Vda, car l'tude des austrits dre comme la plus excellente pour un Brahmane en ce monde. il pratique la plus parfaite des austrits 167. Certes, le Dvidja bout des ongles, que portant qui, bien jusqu'au l'tude du une guirlande de fleurs, s'adonne journellement de ses moyens. Vda dans la mesure l'tude du Vda met son 168. Un Dvidja qui, ngligeant de son vivant mme, dans ailleurs, tombe bientt, application d'un Soudra, ainsi que sa postrit. la condition de sa naissance d'un Dvidja lui vient 169. La premire de la ceinture d'herbe de l'investiture mre, la deuxime de l'initiation la troisime pour le sacrifice, d'aprs moundja, du texte rvl. la dclaration est sym170. Parmi ces (trois), la naissance par le Vda de la ceinture d'herbe bolise par l'investiture moundja; dans celle-ci, la Svitr est (est dite) la mre, et le prcepteur dit le pre. pour baratter la mer : le mont Mandara leur servit de moulinet et le serpent Vsouki de corde pour le mettre en mouvement. De cette opration sortit l'amrta que les Dieux et les Asouras se disputrent ; il finit par rester la proprit des premiers. 165. Doctrine sotrique: cf. v. 140, note. 169. En gnral il n'est question pour un Dvidja que de deux naissances.
46 171.
LES LOIS DE MANOU
Le prcepteur est appel le pre (du novice), parce le Vda; car avant la prise de la ceinqu'il (lui) communique ture d'herbe aucun acte pieux ne lui est permis. moundja 172. (Jusqu' la crmonie de l'investiture), il ne doit rciter texte dans les rites fu(aucun) vdique, except nbres ; car il n'est un Soudra, tant pas suprieur naissance qu'il n'a pas pris une seconde par le Vda. 173. Une fois initi, on exige qu'il s'astreigne aux observances et qu'il apprenne le Vda, en se progressivement aux rgles. conformant 174. La peau de bte, le cordon la ceinture, le (sacr), bton ainsi que les vtements au prescrits (pour le novice moment de l'initiation, tre renoutous) ces (objets doivent des voeux. vels) dans (l'accomplissement) 175. Voici les observances un novice que doit pratiquer en rfrnant tous ses qui habite chez son matre spirituel, son austrit. organes pour augmenter 176. Chaque jour, aprs s'tre baign et purifi, il offrira aux Dieux, aux Sages et aux Mnes, il honorera des libations le combustible les divinits , et mettra (dans le feu sacr). de miel, de viande, 177. Qu'il s'abstienne de parfums, de de femmes, de toutes d'essences, guirlandes, (substances) des cratures, aigries, ainsi que de tous svices l'gard 178. D'onguents, de collyre pour les yeux, de porter des de dsirs souliers et une ombrelle, de colre, cle sensuels, de danser, de chanter ou de jouer d'un instrucupidit, ment, 179. Du jeu, des querelles, de la calomnie et du mensonge, ou de toucher de regarder une femme, ou de frapper le prochain. 180. Qu'il couche toujours seul, qu'il ne rpande jamais 174. Cf. ce qui a t dit dans les vers 41-47. La fin du vers est trs obscure : l'ide de renouvels est supple par le commentaire : navni karttavyni. B. traduit: Le mme crmonial (doit tre usit de nouveau) (l'accomplissement) des voeux.
LES LOIS DE MANOU
47
sa semence; car celui qui volontairement (volontairement) son voeu. sa semence, rpand rompt involontairement sa 181. Le Dvidja novice qui a rpandu adorer le soleil, et rpter semence en songe, doit se baigner, moi, etc. trois fois la formule : Revienne 182. Qu'il apporte un pot d'eau, des fleurs, du fumier de de l'herbe kousa autant vache, de l'argile, qu'il en faut ( son et qu'il aille chaque jour demander l'aumne. prcepteur), 183. Le novice, tant ira demander pur, chaque jour l'aumne dans les maisons des gens qui ne ngligent pas les sacrifices et qui sont renomms vdiques pour (la manire dont ils remplissent) leurs devoirs. 184. Qu'il ne mendie de son prceppas chez les parents teur, ni chez ceux de son pre ou de sa mre ; mais s'il ne dans les maisons peut rien obtenir trangres (qu'il s'adresse eux), en vitant de commencer par les premiers. 185. A dfaut de ceux qui ont t mentionns prcdemtout le village, tant pur et retenant ses ment, qu'il parcoure paroles ; mais qu'il vite les gens accuss (dpchs mortels). 186. Ayant rapport d'un lieu loign le combustible, qu'il il alimente le feu sacr, le mette l'air, et que soir et matin se lasser. sans jamais il nglige 187. Si, sans tre malade, sept jours pendant et d'alimenter le feu sacr, il devra d'aller chercher l'aumne faire la pnitence (prescrite) pour un novice qui a viol le voeu de chastet. 181. Punar mm etu indriyam : revienne moi ma force. (TaittiryaAranyaka, I, 30.) 184. Les parents de son pre ou de sa mre : ou bien peut-tre les parents et allis . Voici comment Kull. commente la fin du vers : d'abord il demandera aux parents maternels (bandhu); s'il n'obtient rien chez eux, aux parents paternels (jnti) ; s'il n'obtient rien chez eux, (il demandera) mme aux parents du guru. 186. Vihyasi, l'air signifie suivant Kull. sur le toit . B. : n'importe o, except sur le sol . 187. La pnitence pour celui qui a viol son voeu de chastet (avakrnin) est spcifie au livre XI, v. 119.
48 188.
LES LOIS DE MANOU
Le novice doit constamment subsister d'aumnes et sa nourriture d'une seule (personne); ne pas recevoir pour subsister d'aumnes est dclar un novice, de l'quivalent jener. en l'honneur des Dieux 189. S'il est invit une crmonie ou des Mnes, il peut manger son gr (la nourriture donne ses voeux, autant que le permettent par une seule personne), et ( condition comme un ascte ; (en cela) il de) se conduire n'enfreint pas ses voeux. seule190. Les Sages ont prescrit cette rgle de conduite au Kchatriya elle n'est pas impose ment pour le Brahmane; et au Vaisya. ou non de son prcepteur, 191. Qu'il en ait reu l'ordre l'tude, et faire ce qui doit s'appliquer toujours (l'lve) son matre. peut tre agrable son corps, sa parole, ses organes des sens 192. Disciplinant la il doit se tenir les mains jointes et son esprit, regardant face de son prcepteur. le bras (droit) libre, 193. Qu'il ait toujours qu'il ait une et qu'il soit bien couvert ; quand on lui dit : bonne tenue, vers son Asseyez-vous le visage tourn , qu'il s'asseye, prcepteur. il doit toujours de son prcepteur, avoir 194. En prsence infrieurs des habits, des ornements une nourriture, ( ceux il doit se lever avant lui et se coucher du matre), aprs lui. ni converser 195. Il ne doit pas rpondre ( son prcepteur) ou debout avec la face assis, mangeant (avec lui) tantcouch, d'un autre ct. tourne 189. Comme un ascte : rshivat mot mot comme un Sage : cet adverbe a l'air de faire plonasme avec vratavat. 193. Libre, mot mot dcouvert . Droit est fourni par le commentaire. Il y a une autre leon susamyatah recueilli au lieu de susamvrtah bien couvert ; bien couvert: c'est--dire vtu dcemment . 195. Je runis tishthan a parnmukbah. B. distingue les deux ides : ni debout, ni la face dtourne . Mais alors on ne voit pas bien quelle position doit prendre l'lve s'il n'est ni couch, ni assis, ni debout .
LES LOIS DE MANOU 196.
49
Il doit le faire debout est (le prcepteur) quand en l'abordant il est debout, en allant sa assis, quand rencontre en courant quand il s'approche, aprs lui quand il court, 197. En se plaant en face de lui quand il a le visage tourn d'un autre ct, en allant auprs de lui quand il est vers lui quand il est couch ou qu'il loign, en se penchant est arrt prs de lui. 198. Son lit ou son sige doivent tre bas, quand toujours il est en prsence de son prcepteur ; la porte des yeux de son prcepteur il ne doit point s'asseoir son aise. 199. Il ne doit point prononcer le nom de son (prcepson dos, ni contrefaire sa teur) tout court, mme derrire son langage, ses gestes. dmarche, 200. Si son matre est quelque part l'objet d'une mdisance se bouche les oreilles, ou qu'il ou d'une calomnie, qu'il (quitte) la place pour aller ailleurs. 201. Celui qui mdit de son prcepteur devient ne (dans une autre vie) ; celui qui le calomnie devient chien ; celui qui devient vit sur le bien (de son prcepteur) ver, celui qui en insecte. est envieux (devient) saluer le (prcepteur 202. Il ne doit point, tant distance, d'une autre personne) ni tant en colre, par l'intermdiaire ni en prsence d'une femme : s'il est en voiture ou sur un pour lui adresser la parole. sige, qu'il descende 197. Nidee ca eva tishthatah peut s'entendre diffremment en rapportant nidee l'lve : l'lve doit se tenir proximit quand le matre est debout. B. traduit : lorsque le matre est couch ou qu'il est une place plus basse, ce qui justifie le fait de se pencher vers lui. Malheureusement nidee n'a gure ce sens. Kull. l'explique par nikate proximit. 199. Tout court: sans y ajouter unepithte honorifique. (Kull.) 201. La diffrence entre krmi ver, et kta insecte, est un peu vague. Suivant le commentaire le second mot dsignerait un insecte plus gros. 202. tant distance : Kull. ajoute : mais s'il est dans l'impossibilit de venir lui-mme, il est exempt de blme. 4
50 203. le vent
LES LOIS DE MANOU
contre avec son prcepteur Il ne doit point s'asseoir ou sous le vent, ni dire quoi que ce soit hors de la porte des oreilles du prcepteur. dans une voiture avec son prcepteur 204. Il peut s'asseoir sur une des chameaux, trane par des boeufs, des chevaux, sur une sur une pierre, sur du gazon, sur une natte, terrasse, dans un bateau. planche, est prsent, de son prcepteur 205. Si le prcepteur qu'il son (propre) se comporte prcep(avec lui) comme si c'tait il ne peut de son prcepteur, teur; mais sans la permission saluer ses propres qui ont droit son respect. (parents) sa conduite constante doit tre 206. Telle galement la science (sacre), envers ses envers ceux qui lui enseignent du pch envers les gens qui le dtournent parents paternels, de bons conseils. ou qui lui donnent il doit toujours se comporter ses suprieurs 207. Envers et de mme envers les fils de comme envers son prcepteur, de la mme s'ils sont ns de femmes son prcepteur, caste, de son prcepteur. et envers les parents soit plus jeune, soit du mme 208. Le fils du prcepteur dans (la science de) l'accomplissege (que lui), soit tudiant 203. Kull. explique ainsi prativta et anuvta : contre le vent, c'est quand le vent vient de l'endroit o est le prcepteur l'endroit o est le disciple, et sous le vent, quand le vent vient de l'endroit o est le disciple l'endroit o est le prcepteur. 204. Gason : prastara est traduit par B. : un lit de gazon ou de feuilles , par L. et B. H. un endroit pav . Certaines ditions ont srastara, litire. 205. Qui ont droit son respect : tels que la mre, le pre, l'oncle paternel, etc. . (Kull.) 206. Ceux qui lui enseignent la science autres que le prcepteur, tels que le sous-prcepteur, etc. . (Kull.) Svayonishu : parents, tels que l'oncle paternel, etc. 207. Suprieurs : les gens minents en science et en austrit . (Kull.) ryeshu : rya signifie noble, ou qui appartient aux trois premires castes. Kull. explique par samnajtishu, de mme caste . L. traduit s'ils sont respectables par leur ge . Parents par le sang tels que l'oncle paternel, etc. . (Kull.) 208. Je fais dpendre yaj fiakarmani de ishyo, ce qui me parat la construction la plus naturelle. Mais Kull. explique diffremment : il a droit
LES LOIS DE MANOU
51
ment du sacrifice, ( la place quand il donne l'enseignement de son pre), a droit aux mmes hommages que le prcepteur. les membres du 209. (L'lve) ne doit point frictionner ni l'aider se baigner, ni manger ses fils de son prcepteur, restes, ni lui laver les pieds. ont droit aux mmes hom210. Les pouses du prcepteur si elles sont de la mme caste; mais si mages que lui-mme, des castes diffrentes, il doit les honorer elles appartiennent en se levant et en saluant. (seulement) de servir dans le bain, de fric211. (Le soin de) parfumer, du prcepteur ne le regarde de coiffer la femme tionner, point. 212. (L'lve) et qui distingue le qui a vingt ans rvolus, bien du mal, ne doit point saluer la jeune femme de son prses pieds. cepteur (en touchant) les des femmes de faire pcher 213. Il est dans la nature aussi les Sages ne s'abandonnent-ils hommes ici-bas; point aux femmes. 214. Car les femmes peuvent garer en ce monde non seulement l'ignorant, mais mme l'homme instruit, (en le renet de la colre. dant) esclave de l'amour 215. On ne doit point tre assis l'cart avec une mre, une soeur, une fille; car la troupe des sens est puissante, et entrane mme l'homme instruit. 216. Mais un jeune (lve) peut son gr se prosterner terre devant les pouses (encore) jeunes de son prcepteur, conformment la rgle, en disant : Je suis un tel. 217. Au retour d'un voyage, il doit toucher les pieds des femmes de son prcepteur, et les saluer chaque jour, en observant les pratiques des gens vertueux. aux hommages comme un guru, quand il assiste un sacrifice, soit comme prtre officiant, soit sans avoir cette dernire qualit (c'est--dire comme simple assistant). A la place de son pre : le commentateur Nand. entend ainsi : quand le pre est occup un sacrifice . 214. On peut entendre ainsi la fin du vers : lorsque celui-ci est sujet la luxure et la colre .
52 218. Comme
LES LOIS DE MANOU
arrive avec une bche un homme creusant la science docile parvient l'eau, ainsi un (lve) jusqu' renferme dans son prcepteur. ou en toupet ; 219. Qu'il ait les cheveux rass ou tombants ni ne se lve sur lui (dorque jamais le soleil ne se couche mant) dans le village. est 220. Si le soleil se lve ou se couche qu'il pendant il ou involontaire, endormi, (que sa faute) soit volontaire voix basse (la Svitr). devra jener un jour en rcitant 221. Car celui que le soleil son lever ou son coucher un encourt trouve et qui ne fait pas pnitence, endormi, grand pch. en un rinc la bouche, tant pur et recueilli, 222. S'tant lieu sans souillure, presjour les prires qu'il rcite chaque conformment la rgle. crites, aux deux crpuscules, ou si un Soudra fait un (acte) quel223. Si une femme (aussi) au) bien (suprme), conque (tendant qu'il s'y applique ainsi qu' (tout autre acte) o son esprit trouvera avec ardeur, plaisir. icibien (consiste) 224. (Les uns) disent que le souverain bas dans la vertu et la richesse d'autres, ; (suivant (runies) il consiste et la richesse, ou dans la vertu dans) le plaisir seule ; mais l'opinion seule, ou dans la richesse juste (est qu'il de ces trois (choses). consiste dans) l'union 225. Un prcepteur, un pre, une mre, un frre an ne surtout doivent avec irrvrence, par un point tre traits et-il t offens par eux. Brahmane, 220. B. H. et L. traduisent ainsi : si son insu le soleil se lve ou se couche pendant qu'il est endormi volontairement . 221. L. traduit : celui qui se couche et se lve sans se rgler sur le soleil , ce qui fait supposer qu'au lieu de sryena il a lu en deux mots srye na. 223. Tout autre acte : permis par la loi . (Kull.) 224. La vertu : ou le devoir dharma, ou (l'acquisition du) mrite spirituel. (B.) 225. Kull. place le vers 226 avant le vers 225.
LES LOIS DE MANOU 226.
53
est l'image de Brahme, un pre (Car) un prcepteur du Seigneur des cratures, une mre l'image de la l'image un propre frre l'image de vous-mme. terre, 227. Le mal que se donnent un pre et une mre pour mettre au monde un enfant ne saurait tre compens mme d'annes. par des centaines 228. On doit toujours faire ce qui est agrable ceux-ci, ainsi qu'au prcepteur ces trois (personnes), ; en contentant on gagne tout (le prix des) austrits. 229. L'obissance ces trois (personnes) est dclare la des austrits, et sans leur permission, on ne plus parfaite doit accomplir aucun autre acte pieux. 230. Car ils sont les trois mondes, ils-sont les trois ordres, ils sont les trois Vdas, ils sont appels les trois feux sacrs. 231. Le pre en effet est dclar tre le feu Grhapatya, la mre le feu Dakchina, le prcepteur le feu havanya ; cette triade de feux est trs vnrable. 232. (Celui qui devenu) matre de maison ne nglige pas ces trois, conquiert les trois mondes, et dans un corps rayonla flicit dans le ciel. nant, pareil un Dieu, il gotera 233. Par la pit envers sa mre il obtient ce (bas) monde ; le monde intermpar la pit envers son pre (il obtient) diaire ; mais par l'obissance son prcepteur, il parvient au monde de Brahm. 234. En respectant ces trois (personnes) on remplit tous ses 230. Les trois mondes : la terre, l'atmosphre, le ciel. Les trois ordres : il y a quatre ordres ou degrs dans l'existence du Brahmane, tudiant, matre de maison, ermite et ascte mendiant. Par les trois ordres le commentaire entend ou bien les trois premiers, en commenant par celui d'tudiant et en exceptant celui d'ascte, ou bien les trois derniers, en commenant par celui de matre de maison et en exceptant celui d'tudiant. Les trois feux (cf. le v. suivant) sont le feu grhapatya ou feu entretenu par le matre de maison, le feu dakshina ou feu de l'autel, plac vers le Sud, et le feu havanya, ou feu du sacrifice qui doit recevoir les oblations et qui est plac vers l'Est. 233. Le monde intermdiaire : l'atmosphre situe entre le ciel et la terre. Le monde de Brahm dsigne le ciel.
54 devoirs oeuvres 235.
LES LOIS DE MANOU
les ; mais pour celui qui ne les honore pas, toutes pies sont striles. Aussi longtemps sont en vie, que ces trois (personnes) aucun autre (devoir religieux de sa propre qu'il n'accomplisse une soumission ; qu'il leur tmoigne constante, impulsion) de faire ce qui leur est agrable et utile. heureux de tout ce qu'il fait avec 236. Qu'il les tienne au courant en vue de l'autre leur consentement en pense, en monde, parole et en action. 237. (En honorant) ces trois (personnes), toutes les obligad'un sont remplies tions homme le ; c'est l videmment devoir par excellence ; tout autre devoir est dclarsecondaire. 238. Un croyant un enseignement peut recevoir pur mme d'un homme de caste infrieure, la loi la plus haute mme de (l'tre) le plus vil, la perle des femmes mme d'une famille basse. un bon 239. On peut tirer l'ambroisie mme du poison, mme d'un une (rgle conduite conseil enfant, de) bonne de l'or mme d'une (gangue) mme d'un ennemi, impure. les femmes, les perles, la science, 240. On peut recevoir la la puret, un bon conseil, et les (connaissance du) devoir, divers arts de n'importe qui. il est enjoint le Vda 241. En cas de ncessit, d'apprendre aussi longtemps que dure (mme) d'un autre qu'un Brahmane; on doit servir (un tel) prcepteur et lui obir. l'instruction, la flicit ne doit 242. Un novice qui aspire suprme la fin de sa vie chez un prcepteur jusqu' point demeurer non Brahmane, ou mme chez un Brahmane non instruit des Vdas). (dans la totalit 238. Un homme de caste infrieure : un Soudra. L'tre le plus vil : par exemple un cndla . (Kull.) 240. Au lieu de les femmes et les perles Kull. entend striyo ratnni par les femmes perles, ce qui est en effet plus conforme au vers 238. 241. En cas de ncessit : c'est--dire quand on n'a pas un instituteur Brahmane . (Kull.) 242. La flicit : moksha ou la dlivrance finale. La totalit des Vdas : c'est--dire le Vda et les Aneas.
LES LOIS DE MANOU 243.
55
s'il dsire la fin de ses Toutefois demeurer jusqu' jours dans la maison de son prcepteur, qu'il le serve avec ce qu'il soit dlivr de son corps. zle jusqu' la 244. Le Brahmane jusqu' qui sert son prcepteur de son corps directement dans la demeure dissolution entre ternelle de Brahme. 245. Celui qui connat son devoir ne doit faire aucun cadeau son prcepteur avant (son retour la maison); mais quand, il est sur le point de prendre congdi par son prcepteur, le bain (final), qu'il lui offre un prsent suivant ses moyens, 246. Un champ, de l'or, une vache, un cheval, un parasol, des sandales, un sige, du grain, des lgumes, des vtements, afin d'tre agrable son prcepteur. il servira le fils de celui-ci 247. Si son prcepteur meurt, ou sa veuve, ou son parent (le (pourvu qu'il soit) vertueux, comme si c'tait plus proche) jusqu' la sixime gnration, le prcepteur lui-mme. 248. Si aucun de ceux-ci n'est en vie, qu'il prenne la le sige et les occupations demeure, (de son prcepteur), au service du feu (sacr) et se rende digne de qu'il s'applique l'union avec Brahm. sans 249. Le Brahmane ainsi son noviciat, qui accomplit enfreindre ses voeux, arrive la condition et ne suprme renat plus sur cette terre. 245. Le bain final : Snna d'o son nom de sntaka. 247. Vertueux : vidydigunayukte, ayant la science et les autres qualits . (Kull.) Le parent jusqu' la sixime gnration (inclusivement) : le sapinda.Ceci est dit de l'lve qui veut passer sa vie dans le noviciat, rester dans la maison de son prcepteur. 248. Vers un peu obscur. Sthnsanavihravant peut tre considr comme renfermant trois substantifs dtermins par le suffixe vant, ou bien on peut prendre, ainsi que le fait B. : vihravant comme un adjectif occup dterminant les deux substantifs prcdents sthna la position debout sana la position assise. D'o la traductionde B. : Il devra servir le feu sacr debout (le jour), assis (la nuit) et ainsi finir sa vie. Deham sdhayet, mot mot qu'il perfectionne son corps , c'est--dire, qu'il rende l'me unie son corps propre l'union avec Brahm . (Kull.)
LIVRE Le Matre de maison
TROISIME : Mariage et Devoirs religieux.
1. Le voeu (d'tudier) les trois Vdas (dans la maison) du doit tre observ durant trente-six ou la prcepteur ans, moiti ou le quart de ce temps, ou bien jusqu' ce qu'on les possde fond. 2. Celui qui a tudi dans l'ordre voulu les (trois) Vdas, ou deux Vdas ou un seul Vda, et n'a jamais enfreint les du noviciat, dans l'ordre de de matre rgles peut entrer maison. 3. Renomm de ses devoirs, pour (l'accomplissement) ou spirituel) du ayant reu de son pre (charnel l'hritage et assis sur un lit de Vda, il devra, orn d'une guirlande d'une vache (et d'un repos, tre honor d'abord (du prsent) de miel et de lait suri). mlange 4. Aprs avoir, avec l'assentiment de son prcepteur, pris le bain final et accompli suivant la rgle la crmonie du retour la maison, une femme de que le Brahmane pouse mme caste ayant les signes (qui prsagent la prosprit). 5. (Une personne) sixime qui n'est pas parente jusqu'au 2. Matre de maison : grhastha. L. d'aprs le commentaire de Medh. traduit : Aprs avoir tudi dans l'ordre une branche (kh) de chacun des Livres sacrs, ou bien de deux, ou mme d'un seul. 3. De son pre : ou de son prcepteur qui est pour lui comme un pre spirituel.D'abord, c'est--dire, avant son mariage.Le madhuparka ou don de miel, est un mlange de miel et de lait suri ou de beurre que l'on offre un hte ; le mot dsigne aussi la crmonie de la rception accompagne de l'offre de ce plat. 4. Cette crmonie s'appelle samvartana. Le texte dit seulement tant retourn la maison . On appelle lakshana certains signes sur le corps, qui sont considrs comme de bon augure.
58
LES LOIS DE MANOU
degr de sa mre, et n'appartient pas la famille de son pre, unDvidja (voil celle) qu'on recommande (de choisir) pour le mariage et l'union conjugale. 6. Mme quand elles seraient et riches en vaches, grandes voici les chvres, brebis, (de toutes grains et biens sortes), dix familles en s'unissant une pouse : qu'il doit viter, les sacrements, celle o il n'y a 7. Celle o l'on nglige mle, celle o l'on n'tudie pas d'enfant pas le Vda, celle o le systme est trop dvelopp, celle o rgnent les pileux la phtisie, la dyspepsie, la lpre hmorrodes, l'pilepsie, blanche et l'lphantiasis. 8. Il n'pousera une jeune fille rousse, un point ayant de trop, maladive, membre bavarde trop peu ou trop velue, ou (ayant les yeux) rouges, 9. Ni celle dont le nom est tir d'une d'un arbre, toile, d'un fleuve, ou qui porte un nom barbare, un nom de monde serpent, ou un nom d'esclave, ou un nom tagne, d'oiseau, la terreur. inspirant de 10. La femme qu'il pouse doit avoir le corps exempt un nom de bon augure, la dmarche d'un fladifformits, mant ou d'un le duvet et les cheveux fins, les lphant, dents petites et les membres dlicats. 11. Un homme sens n'pousera point une (fille) sans frre cas d'pouou de pre inconnu, (dans le premier par crainte cas, de contracter ser) une fille substitue, (dans le second une union) illicite. 9. Un nom barbare, antya est remplac dans le commentaire par mleccha mais antya signifie exactement : le dernier. On peut donc entendre par l : un nom d'une basse caste. 10. Un nom de bon augure : ou bien un nom agrable . La comparaison avec le flamant ou l'lphant veille une ide de grce et de beaut fminine chez les Hindous. 11. Le texte est d'une concision extrme : putrik dharma ankay, par crainte de la loi relative la putrik putrik fille substitue , c'est une fille qu'un pre sans enfant mle prend la place d'un fils, dans l'espoir qu'elle aura un enfant mle, et avec l'intention d'adopter ce dernier en lieu et place de fils propre, cf. IX, 127. Notre traduction, qui suit Tinter-
LES LOIS DE MANOU 12. Aux une femme
59
en premier lieu Dvidjas il est enjoint d'pouser de mme caste; mais pour ceux que l'amour l'ordre voici suivant (des mariage), pousse ( un second castes) les (femmes) qui doivent tre prfres. 13. Il est dclar qu'un Soudra qu'une (ne peut pouser) ou une (personne) un Vaisya une Soudra (femme) Soudra, de sa propre caste, un Kchatriya (peut choisir dans) les deux ou dans sa propre caste, un Brahmane (castes) prcdentes dans toutes ces trois (castes) et dans la sienne propre. femme 14. En aucune il n'est racont histoire qu'une ou Soudra (soit devenue la premire) pouse d'un Brahmane d'un Kchatriya, mme en cas de ncessit. une femme de la 15. Les Dvidjas qui par folie pousent dernire caste, font bientt tomber leur famille et leurs descendants la condition de Soudras. 16. Selon Atri et (Gotama) fils d'Outathya, celui qui de sa caste) ; dchoit pouse une Soudra (immdiatement la naissance d'un fils, suisuivant Saounaka, (il dchoit) vant Bhrigou, lorsque ce (fils) a un enfant (mle). prtation de Kull., spare putrikdharma en putrik -f adharma, compos copulatif : putrik se rapporte au premier cas, la fille sans frre, et adharma, pch, chose illicite, au deuxime, la fille d'un pre inconnu, qui pourrait tre par exemple parente ou issue d'une union illicite. 14. En aucune histoire : par histoire, il faut entendre ici quelque rcit mythologique pouvant autoriser une pareille drogation. En cas de ncessit, c'est--dire dfaut d'une femme de mme caste. 16. Atri, un des six seigneurs de la cration engendrs par Manou, et aussi un Richi auteur de plusieurs hymnes vdiques : il est cit ici comme lgislateur. Gotama ou Gaoutama auteur d'un Dharma-stra (dit par Stenzler) o se trouvent des rgles relatives au mariage. Bhrigou est aussi un des six seigneurs de la cration, et c'est dans sa bouche mme qu'est mis le rcit des lois de Manou ; il est curieux qu'il se cite ici la troisime personne. Voici comment B. entend la fin du vers : Suivant Bhrgu, celui qui a un rejeton (mle) d'une (femme Soudra seulement) . Tadapatyatay, littralement par la qualit de celui-ci d'avoir une progniture (celui-ci se rapporte au fils, suta, prcdemment nonc). Suivant Kull., la premire rgle s'applique spcialement un Brahmane, la deuxime au Kchatriya, la troisime au Vaisya, de sorte que la dchance serait plus ou moins immdiate selon la caste.
60 17.
LES LOIS DE MANOU
Le Brahmane va en qui met dans son lit une Soudra s'il a d'elle un fils, il est dchu enfer; de sa qualit de Brahmane. 18. Les Dieux et les Mnes ne mangent pointles (offrandes) de celui qui se fait assister par une (femme Soudra) dans les rites en l'honneur des Dieux, des Mnes et des htes, et luimme ne va point au ciel. 19. Pour celui qui boit l'cume des lvres d'une Soudra, ou qui en a un fils, auqui a t au contact de son haleine, cune purification n'est prescrite. 20. Apprenez maintenant en peu de mots les huit (modes) aux quatre ou fude mariage castes, (propres) prospres nestes en ce monde et dans l'autre. des Dieux, des 21. (Ce sont les modes dits) de Brahm, des mauvais du Seigneur de la cration, Saints, Esprits, des Dmons, et enfin le huitime et le des Musiciens clestes, plus vil, celui des Vampires. 22. Quels sont ceux qui sont autoriss caste, pour chaque et les dfauts de chacun d'eux, (c'est quels sont les qualits ainsi que les ce que) je vais vous expliquer compltement, des enfants bonnes ou mauvaises qualits (qui en naissent). dans l'ordre sont auto23. Sachez que les six (premiers) les quatre derniers riss pour un Brahmane, pour un Kchasauf le rite des Dmons, pour un Vaisya triya, les mmes, et un Soudra. 24. Suivant de (certains) l'opinion sages, les quatre preun seul, le rite des Dmiers sont permis un Brahmane, et le rite des mauvais un mons, un Kchatriya, Esprits ou un Soudra. Vaisya 17. Le Brahmane, qui nglige d'pouser une femme de sa caste, et qui, soit par le destin, soit par amour, pouse une Soudra . Kull. 20. On peut dtacher str de vivhn : mariages avec des femmes des quatre castes. 21. Rites Brhma, Daiva, rsha, Prjpatya, Asura, Gndharva, Rkshasa, Paica. Cf. pour tous ces noms I, 37. 24. Le texte dit potes et le commentaire connaisseurs, sages . Comme le fait observer B., malgr les efforts des commentateurs pour
LES LOIS DE MANOU
61
trois sur les cinq (derniers), 25. Mais ici (dans ce trait), : le rite des Vamet deux illgitimes sont dclars lgitimes tre ne doivent jamais Esprits pires et celui des mauvais usits. 26. les deux rites prcdemment soit runis, Soit spars, et celui des Dmons, clestes celui des Musiciens noncs, sont dclars lgitimes pour un Kchatriya. et vtue 27. (Quand un pre) donne sa fille, aprs l'avoir instruit dans le un homme honore (par des cadeaux), ce Vda et vertueux, invit, (c'est qu'il a volontairement qu'on) appelle le mode de Brahm. 28. (Quand un pre) ayant par sa fille, la donne au cours le dment officiant d'un sacrifice un prtre qui accomplit rite, (c'est ce qu'on) appelle le mode des Dieux. la rgle, aprs 29. (Quand un pre) donne sa fille suivant un taureau avec une vache, ou deux avoir reu du prtendant d'un sapour (l'accomplissement) couples (de ces animaux) crifice, (c'est ce qu'on) appelle le mode des Saints. formule : sa fille avec cette 30. (Lorsqu'un pre) donne Pratiquez ensemble tous deux vos devoirs , et avec les le mode du Seigneur honneurs (dus, c'est ce qu'on appelle) de la cration. rconcilier ces opinions contradictoires, on voit qu'il y a divergence de vues sur les diffrents rites permis du mariage. 26. v Si entre une femme et un homme il existe au pralable un lien d'affection rciproque (rite Gndharva), et que l'pouseur s'empare de la (jeune fille) par un combat ou autre moyen analogue et l'enlve (rite Rkshasa), alors il y a runion des deux rites. Kull. 27. Certains commentateurs rapportent arcayitv ayant honor au fianc. 28. Dans ce cas, remarque B. H., le prtre qui accomplit le sacrifice reoit la jeune fille comme une partie de ses honoraires. 29. Dharmatah est rendu diffremment par les divers traducteurs : B. H. lgalement ; L. pour l'accomplissement d'une crmonie religieuse ; B. pour l'accomplissement de la loi sacre . Kull. explique ainsi : dharmrtham ygdi siddhaye, en vue de la loi sacre, pour l'accomplissement d'un sacrifice ou autre . II faut entendre par l que ce n'est pas une gratification que le pre reoit : cf. III, 53.
62
LES LOIS DE MANOU
31. (Quand le prtendant) aux parents aprs avoir donn et la jeune fille des cadeaux ses moyens, proportionns le reoit sa fiance de son plein gr, (c'est ce qu'on appelle) mode des mauvais Esprits. 32. L'union volontaire d'un jeune homme et-d'une jeune fille doit tre regarde comme le mode des Musiciens clestes : elle nat du dsir, et a pour but final le plaisir sexuel. 33. Le rapt, avec effraction, blessures ou meurtre (des parents), malgr les pleurs et les cris de la jeune fille, s'appelle le mode des Dmons. 34. Quand (un homme) se rend matre par surprise d'une ivre ou folle, c'est le mode des Vamjeune fille endormie, le huitime et dernier et le plus excrable pires, (de tous). 35. Pour les Brahmanes, le don d'une fille (prcd de lid'eau est le plus approuv : pour les autres castes, (la bations) crmonie se fait) au gr de chacun. 36. coutez Brahmanes, maintenant, l'expos complet a attribues que je vais vous faire des qualits que Manou de ces (modes) de mariage. chacun 37. S'il est vertueux, le fils d'une femme marie suivant le mode de Brahm dlivre du pch dix de ses anctres, dix de ses descendants, et lui-mme vingt et unime. 38. De mme le fils d'une femme pouse suivant le mode des Dieux (dlivre) et sept descendants ; le fils sept anctres d'une femme pouse suivant le mode des Saints, trois (anle fils d'une femme ctres) et trois (descendants); pouse suivant le mode du Seigneur de la cration, six (anctres) et six (descendants). 39. Les quatre (premiers modes de) mariage dans l'ordre 31. De son plein gr : et non comme dans, le mode rsha, pour se conformer aux prescriptions de la loi sacre. (Kull.) Ce mode implique une sorte d'achat de la fiance. 32. C'est l'union libre dont on voit un exemple fameux dans la pice de Sakountal. 35. Au gr de chacun : ou bien par (l'expression) du consentement mutuel . (B.)
LES LOIS DE MANOU nonc, naissance
63
donnent commencer de Brahm, par le mode des des enfants qui brillent par la connaissance et sont estims des gens de bien, Vdas, de beaut et de bont, 40. Possdant les qualits riches, et qui trs vertueux dans les plaisirs, renomms, nageant vivent cent annes. de mariage 41. Mais des (quatre) autres (modes) blmables du Vda et ennemis naissent des enfants cruels et menteurs, de la Loi sacre. une 42. D'un mariage sans reproche nat pour les hommes sans reproche, et d'un (mariage) (nat rprhensible postrit une postrit) ; on doit donc viter les (modes rprhensible entachs de blme. d'union) crmonie de la Prise est prescrite 43.'La de la main caste (que leurs maris) ; (sont) de mme (quand les) femmes voici le rite (qu'on doit suivre) dans les mariages avec des d'une caste diffrente. femmes 44. En pousant un homme de caste suprieure, une Kchaun aiguillon, une doit tenir une flche, une Vaisya, triya Soudra le bord d'un vtement. sa femme doit toujours 45. (Un mari) attach l'approcher et il peut l'approcher l'poque favorable, (en tout autre l'exception des jours sexuel, temps) par dsir du plaisir en observant cette interdiction. lunaires dfendus, de la femme 46. On appelle poque naturelle seize (jours avec quatre et seize) nuits (par mois) autres jours, dsappar les gens vertueux. prouvs 43. Cette crmonie s'appelle pnigrahana. 44. L'poux doit tenir l'autre bout del flche ou de l'aiguillon . (Kull.) 45. A l'poque favorable : suivant Kull. cette poque, caractrise par l'apparition des rgles, est propre la fcondation de la femme . Les jours lunaires dfendus ou Parvans sont les huitime, quatorzime et quinzime jour de chaque quinzaine. Cf. IV, 128. Tadvrata signifie, suivant Kull., dsireux de lui plaire . 46. Chez les Hindous on compte par nuits : voil pourquoi dans l'expression seize nuits il faut comprendre les jours. Ces jours sont compts partir de l'apparition des rgles, onitadarant prabhrti.
64
LES LOIS DE MANOU
ainsi 47. Mais parmi ces (seize nuits) les quatre premires sont dfendues, les autres sont que la onzime et la treizime recommandes. dans on engendre des garons, 48. Dans les nuits paires des filles ; aussi, quand on dsire un fils, les nuits impaires sa femme dans les (nuits) paires l'poque doit-on approcher favorable. c'est un fils qui 49. Si la semence de l'homme prdomine, de la femme prdomine, c'est une fille ; nat ; si la semence ou il nat un eunuque, s'il y a galit (entre les semences) ou insuffisance s'il y a faiblesse une fille et un garon; (dans les deux), au contraire (il n'y a pas conception). les nuits dde femmes 50. Celui qui s'abstient pendant huit autres est (l'gal en chastet et pendant fendues, d')un novice, en quelque ordre qu'il vive. 51. Un pre connaissant (son devoir) ne devra pas accepter la moindre (pour le don) de sa fille ; en acceptant gratification une gratification, il serait le marchand de sa fille. par cupidit 52. Les parents qui dans leur folie vivent sur le bien d'une les voitures ou les vtements d'une femme (et s'approprient) femme (sont) coupables (et) vont en enfer. ont dit que (le prsent) d'un taureau et 53. Quelques-uns suivant d'une vache (fait) un (mariage) le rite des Saints tait une gratification, ou petite, (mais) tort ; (car) grande toute gratification (accepte par le pre) serait un march. 54. Quand les parents ne prennent pas (pour eux) le cadeau (fait la jeune fille), ce n'est pas un march ; il n'y a l qu'une d'honneur et d'affection envers la jeune pouse. marque 47. Cf. IV, 40, o Manou dfend le cot l'apparition des menstrues. Il y a dans ces prescriptions minutieuses une certaine confusion. 49. Ce vers contredit le prcdent, puisqu'il attribue le sexe de l'enfant non l'influence du jour de la procration, mais la prdominance de la semence du pre ou de celle de la mre ; cette explication n'a du reste pas plus de valeur que l'autre. Eunuque, ou, suivant B. hermaphrodite. 50. Ordre, c'est--dire qu'il soit matre de maison, ou anachorte, ou mendiant; les novices sont tenus la chastet.
LES LOIS DE MANOU 55.
65
Les femmes tre honores doivent et pares par leurs s'ils dsirent une grande pres, frres, maris et beaux-frres, prosprit. 56. L o les femmes sont honores, les dieux sont contents ; l o elles ne le sont pas, tous les sacrifices sont striles. 57. Une famille o les femmes sont malheureuses dprit trs rapidement tou; celle o elles ne le sont pas, prospre jours. 58. Les maisons maudites qui n'ont pas t par les femmes honores de fond en comble, comme (comme il faut) prissent dtruites par enchantement. 59. C'est pourquoi les hommes soucieux de leur prosprit doivent les femmes honorer aux jours de fte et toujours dans les crmonies, des parures, des vte(en leur offrant) ments et des friandises. 60. Dans une famille o le mari se complat avec sa femme et la femme avec son mari, la prosprit ne peut manquer d'tre durable. 61. Car si la femme ne brille pas (par sa parure), elle ne son poux, et d'autre part si le mari n'prouve peut charmer il ne nat point de postrit. aucun charme, 62. Quand la femme brille (par sa parure), toute la famille ; mais si elle ne brille pas, tout est sans clat. resplendit des msalliances, 63. Contracter les rites, ne pas ngliger les Brahmanes, tudier le Vda, outrager (voil ce qui fait) les familles. dchoir le ngoce, 64. Les mtiers, d'enfants rien (la procration) le (trafic) des chevaux, du btail qu'avec des femmes Soudrs, et le service du roi, et des voitures, l'agriculture 61. Par sa parure : vastrbharandin, par les vtements, les parures, etc.. (Kull.) B. traduit : Si la femme n'est pas radieuse de beaut , et B. H. : Si la femme ne se complat pas avec son poux ; rocate a aussi le sens de se complaire. 64. Les mtiers tels que la peinture, etc. . L ngoce tel que l'usure . (Kull.) 5
66
LES LOIS DE MANOU
65. Les sacrifices (offerts) pour des personnes indignes, l'incrdulit les rcompenses des (en ce qui concerne futures) bonnes oeuvres, les familles (voil ce qui) dtruit rapidement o l'tude du Vda est nglige. 66. Mais les familles riches de la connaissance du Vda, de biens, sont comptes les familles quoique pauvres parmi honorables et acquirent une bonne rjDutation. 67. Avec le feu sacr nuptial le matre de maison devra suivant la rgle accomplir les rites les cinq domestiques, sacrifices et la cuisson (grands) quotidienne (des aliments). 68. Le matre de maison a cinq instruments de destruction le foyer, la meule, le balai, le mortier, le (des tres anims), il est li (au pch). pot eau, par l'emploi desquels 69. Pour expier dans l'ordre (les pchs encourus par l'emles grands Sages ontpresploi de) tous ces (cinq instruments), critau matre de maison les cinq grands sacrifices quotidiens. du Vda est le sacrifice Brahme, l'offrande 70. La lecture et d'eau est le sacrifice aux Mnes, l'offrande au de gteaux aux Dieux, l'offrande de nourriture feu est (le sacrifice) (est des devoirs d'hosle sacrifice) aux tres, l'accomplissement aux hommes. est le sacrifice pitalit 71. Celui qui dans la mesure de ses moyens ne nglige pas n'est pas souill par les pchs ces cinq grands sacrifices, les cinq instruments de destruction, en employant) (commis dans sa maison. demeurant toujours quoique 67. Les rites domestiques : les offrandes du soir et du matin prescrites .par les grhyastras (stras relatifs au culte domestique) . (Kull.) 68. Sna signifie littralement abattoir ; les cratures dtruites par ces instruments sont naturellement les petits insectes. 70. La lecture du Vda, la rcitation et l'enseignement du Vda. Le sacrifice Brahme, ou peut-tre aussi le sacrifice au Vda : brahman = Vda. L'offrande de gteau et d'eau, appele tarpana est destine contenter les Mnes : elle correspond aux inferise des Latins. L'offrande au feu, homa, consiste rpandre dans le feu le beurre clarifi. L'offrande de nourriture dite bali consiste jeter les restes du repas du matin et du soir la porte de la maison avec quelques formules adresses aux dieux infrieurs.Les tres ou Esprits, bhtas.
LES LOIS DE MANOU 72.
67
Celui qui ne nourrit pas ces cinq (sortes de personnes), les Dieux, les htes, les gens sous sa dpendance, les Mnes et lui-mme, bien qu'il respire, ne vit pas. 73. On appelle encore ces cinq sacrifices : Ahouta, Houta, et Prsita. Prahouta, Brhmya-Houta est la prire le Houta est l'of74. L'Ahouta murmure, frande au feu, le Prahouta est l'offrande de nourriture aux est le respect envers les Brahmanes tres, le Brhmya-Houta et le Prsita est l'offrande aux Mnes. 75. (Le matre de maison) doit tre constamment appliqu la lecture du Vda et (l'accomplissement) des sacrifices aux Dieux ; car celui qui est exact ( offrir) des sacrifices aux Dieux soutient (tout) ce (monde) anim et inanim. convenablement 76. L'offrande jete dans le feu parvient la pluie ; la pluie engendre la au soleil ; le soleil engendre les cratures animes. nourriture (subsistent) par laquelle 77. De mme que toutes les cratures subsistent par l'air, ainsi tous les (autres) ordres vivent par le secours du matre de maison. aux trois (autres) 78. Parce que les individus (appartenant) du matre de maison des ordres reoivent quotidiennement et en nourriture, secours en instruction religieuse (l'ordre du) de tous. matre de maison est le plus minent 79. Quiconque dsire une (flicit) imprissable (au) ciel ici-bas doit soutenir et un bonheur constant avec zle (les soutenir les gens sans devoirs de) cet (ordre) que ne peuvent empire sur leurs organes. 74. Huta dsigne d'une faon gnrale une offrande; ahuta signifie nonoblation, c'est--dire adoration sans offrande. L'explication de brhmyahuta repose sur une quivoque, brhmya signifiant la fois relatif Brahman et relatif aux Brahmanes. Prita signifie littralement chose mange. 75. Le vers suivant explique en quoi celui qui offre le sacrifice soutient le monde anim et inanim : les animaux se nourrissent des vgtaux, les vgtaux sont engendrs par la pluie, la pluie par le soleil, et le soleil luimme subsiste des oblations faites dans le feu. 79. Durbalendriyaih signifie littralement dont les organes sont faibles ; mais Kull. commente durbala par asamyata non refrn .
68
LES LOIS DE MANOU
80. Les Saints, les Mnes, les Dieux,les tres et les htes du matre de maison (les offrandes ; c'est pourquoi) rclament celui qui connat doit faire pour eux (ce qu'ils (son devoir) demandent). 81. Qu'il honore suivant la rgle les Saints par la rcitation du Vda, les Dieux par les oblations au feu, les Mnes par les offrandes les humains et les funraires, par des aliments tres par l'offrande (dite) bali. 82. Il doit chaque faire une offrande funraire jour avec du riz ou autre ou avec de l'eau, ou bien (aliment), avec du lait, des racines et des fruits, les pour contenter Mnes. 83. Qu'il nourrisse au moins un Brahmane (dans la crdes Mnes qui fait partie des cinq grands monie) en l'honneur sacrifices il n'en nourrisse aucun ; mais qu' cette occasion au (sacrifice) adress tous les Dieux runis. 84. Chaque doit faire, dans le feu jour un Brahmane la rgle, avec la nourriture suivant domestique, prpare de tous les Dieux runis, une oblation l'intention aux divinits suivantes : et tous deux au Feu et la Lune (sparment) 85. D'abord Dhanconjointement, puis tous les Dieux runis, ensuite vantari, 82. L'offrande funraire s'appelle rddha. 83. A cette occasion atra, litt. : l. L'objet de la seconde partie de ce vers, comme le remarque B., est de dfendre que deux sries de Brahmanes soient nourries au rddha quotidien, comme cela se fait au Prvana rddha, cf. v. 125 . 84. Un Brahmane : suivant une remarque de Kull. cette prescription s'applique aux trois castes suprieures. On peut aussi faire dpendre le gnitif vaivadevasya de grhye' gnau dans le feu domestique (employ) pour prparer la nourriture tous les dieux . 85. Le feu Agni ; la lune Soma (soma dsigne aussi le nectar des dieux).' Vive devh, tous les Dieux runis, dsigne des divinits d'ordre infrieur, au nombre de dix dont voici les noms : Vasu, Satya, Kratu, Daksha, Kla, Kma, Dhjti, Kuru, Pur-Ravas, Mdravas. Dhanvantari est le mdecin des dieux, produit au barattement de l'Ocan, le pre de la mdecine, l'auteur suppos de l'yur Vda, ouvrage mdical considr parfois comme un supplment de l'Atharva Vda.
LES LOIS DE MANOU
69
86. A Kouho, Anoumati, au Seigneur des cratures, au Ciel et la Terre enfin au Feu du bon conjointement, sacrifice. 87. Aprs avoir ainsi offert exactement l'oblation (dans le feu), qu'il (aille) vers chacun des points cardinaux, (de l'Est) et adresse vers le Sud, bali Indra, Yama, (l'offrande) Varouna, et Soma ainsi qu' leurs suivants. 88. En disant : (Adoration) aux vents, il rpandra aux (l'offrande) prs de la porte ; en disant : (Adoration) eaux , il la rpandra dans l'eau; en disant : (Adoration) aux arbres , il la jettera sur le pilon et le mortier. Sr, 89. Au chevet (de son lit) qu'il fasse (une offrande) au pied (de son lit) Bhadrakl; au centre de sa demeure qu'il adresse une (offrande) bali la fois Brahm et au Dieu de la maison. en l'air une (offrande) bali pour tous 90. Qu'il lance les Dieux runis ; (qu'il en fasse une le jour) pour les Esprits le jour, et (la nuit) pour les Esprits qui errent la qui errent nuit. 91. Qu'il fasse au sommet de la maison une (offrande) bali, de tous les tres, et qu'il jette tout le reste pour la prosprit du Sud pour les Mnes. dans la direction 86. Kuh est la desse de la nouvelle lune. Anumati desse de l'amour et de la gnration ; c'est aussi une des phases de la lune. Agni Svishtakrt est le Feu considr comme le dieu qui accomplit heureusement le sacrifice. 87. Indra, chef des dieux et roi du ciel, le Jupiter indien ; son arme est le tonnerre. Yama, le Pluton ou le Minos indien. Varuna (Ouranos) personnification du ciel qui embrasse tout. Soma ou Indu sont des noms de la lune, divinit du genre masculin chez les Indous. Kull. fait remarquer qu'il doit se tourner l'Est pour Indra, au Sud pour Yama, l'Ouest pour Varuna, et au Nord pour Soma . 89. ri ou Lakshm, pouse de Vichnou et desse de la prosprit. Bhadrakl ou Durg, nom de l'pouse de iva. Le dieu de la maison Vstoshpati. B. H. entend diffremment: On doit faire (cela) au Nord-Est ri; au Sud-Ouest Bhadrakl, mais au milieu d'une demeure brahmanique on doit faire l'offrande aux deux seigneurs . On peut en effet couper le compos brahmavstoshpatibhym. 91. La prosprit de tous les tres : B. personnifie Sarvtmabhti .
70 92.
LES LOIS DE MANOU
terre doucement Il devra rpandre (une part) pour les chiens, les hommes dchus de leur caste, les tres vils, les de maladies et les insectes. graves, les corneilles gens atteints ainsi perptuellement 93. Le Brahmane tous qui honore les tres va tout droit, revtu d'un corps glorieux, au sjour suprme. 94. Aprs avoir ainsi accompli l'oblation bali, il doit donner d'abord manger son hte et faire suivant la rgle l'aumne un mendiant et un novice. 95. Autant le (disciple) qui offre suivant la rgle une vache son prcepteur, acquiert, de mrite pour sa bonne action, en acquiert en donnant autant le Dvidja matre de maison l'aumne. 96. Qu'il donne suivant la rgle l'aumne ou un pot plein d'eau, aprs l'avoir orn (de fleurs et de fruits) un Brahmane connaissant le vritable sens du Vda. aux Dieux et aux Mnes faites par des 97. Les offrandes sont striles, si, dans leur folie, les donateurs gens ignorants (en) offrent (une part) des Brahmanes qui ne sont que des cendres. 98. (Mais) une oblation au feu (qui est) la bouche d'un riche en savoir et en austrits, Brahmane dlivre de l'infortune, et mme d'un pch grave. il faut lui offrir un sige et de 99. Ds qu'un hte arrive, 92. Les tres vils : vapac signifie littralement cuiseur de chiens (?) et dsigne une catgorie d'tres vils assimils aux Cndlas. Atteints de maladies graves , ou bien atteints de maladies en punition de leurs pchs (papa) antrieurs . 94. On peut runir les deux derniers termes un novice mendiant . 96. Phalapushpdinsatkrtya: l'ayant garnide fruits, fleurs, etc. . (Kull.) Mais satkrtya pourrait aussi avoir pour complment le Brahmane l'ayant honor dment . Au reste un peu plus loin Kull. ajoute que l'offrande doit tre accompagne d'une formule de salutation. 97. Brahmanes qui ne sont que des cendres : parce qu'ils sont dpourvus de l'clat que donne la connaissance du Vda . (Kull. ) 98. Mot mot : dans la bouche-feu ; la bouche du Brahmane convi manger l'offrande est compare au feu dans lequel on jette l'offrande. 99. Arrive: ade son propre mouvement. (Kull.) Comme au vers 96
LES LOIS DE MANOU
71
suivant ses moyens, aprs l'avoir l'eau, ainsi que des aliments honor selon la rgle. 100. Un Brahmane qui n'a pas t honor (dans la demeure des bonnes d'un matre de maison) emporte tout (le mrite) mme s'il (ne vit que) d'pis glans et oeuvres de celui-ci, offre les cinq grands feux. 101. Herbe, terre, eau et bonne parole, (voil) quatre choses (qui) ne font jamais dfaut dans la maison des gens de bien. 102. Un Brahmane une (seule) nuit est appel qui demeure un hte (atithi) ; il est nomm ainsi parce qu'il ne reste pas perptuellement (anityam-sthita). 103. Un Brahmane qui habite le mme village, ou qui vient ne doit pas tre considr comme un pour passer le temps, hte, mme quand il arrive dans une maison (dont le matre) a une pouse et (entretient) les feux sacrs. 104. Les matres de maison assez insenss pour accepter la nourriture en punition de cette (faute) deviennent d'autrui, de ceux qui leur ont donn des aprs leur mort les bestiaux et autres telles (choses). aliments 105. Le matre de maison ne doit point renvoyer le soir un hte amen par le (coucher en temps du) soleil ; qu'il vienne ou non, il ne faut pas qu'il reste dans la maison opportun sans nourriture. sans en faire manger 106. Il ne doit rien manger lui-mme envers les htes procure la richesse, la son hte ; le respect gloire, une longue vie et le ciel. satkrtya peut signifier ayant honor son hte , ou bien ayant garni la nourriture d'ornements et autres accessoires . 100. Il rie vit que d'pis glans. Cf. IV, 5. Les cinq grands feux sont, outre les trois numrs au livre II, 231 : Grhapatya, Dakshina, Ahavanya, l'vasathya et le Sabhya. 101. Herbe: A dfaut d'autres aliments ; terre, un endroit pour se reposer et eau, pour se laver . (Kull.)Ne font jamais dfaut: un hte trouve toujours cela. 102. Il est superflu de remarquer que l'tymologie d'atithi, hte, n'est pas celle que donne Manou : a privatif et sth demeurer. 103. Qui vient pour passer le temps : Kull. commente ainsi : qui gagne sa vie raconter des histoires merveilleuses ou amusantes.
72 107.
LES LOIS DE MANOU
au dpart, soin chambre, lit, politesse Sige, servir, (tout cela) doit tre suprieur pour les (htes) suprieurs, modeste pour les (htes) humbles, gal pour les (htes) d'gale condition. 108. L'offrande tous les Dieux runis si un termine, on lui donnera des aliments suivant ses nouvel hte arrive, mais sans renouveler l'offrande bali. moyens, ne doit point proclamer sa famille et sa 109. Un Brahmane des aliments; celui qui fait parade race pour (se faire donner) de ces (choses) pour (se faire donner) des aliments est appel de vomissement . par les Sages mangeur 110. Mais un Kchatriya d'un dans la maison (venant) n'est pas considr Brahmane comme un hte, non plus qu'un un Soudra, un ami, des parents, un prcepteur. Vaisya, 111. Mais si un Kchatriya arrive dans la maison (d'un en qualit de la maison) d'hte, Brahmane) (le matre peut son gr, aprs que les Brahmanes aussi lui donner manger mentionns plus haut sont rassasis. 112. Mme quand un Vaisya et un Soudra arrivent dans la maison en qualit d'htes, il peut les faire manger avec ses en leur tmoignant de la bont. domestiques, 113. Quant aux autres (personnes) telles que ses amis, etc., venues chez lui par affection, il doit les faire manger avec sa suivant ses moyens les aliments. femme, aprs avoir prpar 114. Qu'il n'hsite mme avant ses pas servir d'abord, les malades, les femmes htes, les jeunes pouses, les enfants, enceintes. 110. Parce que le Kchatriya et les autres sont d'un rang infrieur, les amis et les parents sont la mme chose que lui-mme, et le prcepteur est suprieur. (Kull.) 111. On peut construire diffremment : Si un Kchatriya arrive comme hte dans la maison, aprs que les susdits Brahmanes ont mang. A son gr : kmam peut se rapporter au matre de la maison, ou l'hte : autant que celui-ci le dsire, discrtion. L'expression atithidharmena indique que l'hospitalit est un devoir strict. 113. Prakrtya signifie peut-tre comme plus haut satkrtya : aprs les avoir reus avec bont .
LES LOIS DE MANOU 115. L'insens
73
avant d'avoir servi ces qui mange le premier ne se doute pas, pendant qu'il mange, qu'il (diverses personnes) servira (aprs sa mort) de pture aux chiens et aux vautours. les serviteurs 116. Aprs que les Brahmanes, les parents, ont dn, le matre de maison et son pouse peuvent manger ensuite ce qui reste. les hommes, 117. Aprs avoir honor les Dieux,les Saints, le matre de la maison, les Mnes et les Divinits tutlaires de maison.mangera ensuite ce qui reste. 118. Il ne mange (des que du pch celui qui prpare du aliments pour lui seul) ; en effet les aliments qui restent des gens de bien. sacrifice sont prescrits pour la nourriture de miel un roi, un 119. Qu'il honore par une offrande est termin, un le noviciat un tudiant-dont officiant, prtre un gendre, un beau-pre, un oncle maternel, prcepteur, de nouveau aprs une anne rvolue. (lorsqu'ils viennent) au instruit 120. Un roi et un (Brahmane) qui arrivent moment de la clbration d'un sacrifice doivent tre honors par une offrande de miel, mais non s'il n'y a point de sacrifice (clbr) ; telle est la rgle. 121. L'pouse doit faire le soir avec la nourriture prpare sacre ; car une offrande bali, sans (rciter) aucune formule dite tous les Dieux runis est prescrite (l'oblation) pour le soir et pour le matin. 122. Aprs avoir accompli le sacrifice aux Mnes, un Brahmane qui entretient un feu (sacr) doit tous les mois, la nouvelle lune, offrir le repas funraire appel Pindnvhryaka. 118. Vidhyate sont prescrits ou peut-tre simplement sont appels . 119. Une offrande de miel, le madhuparka. Un tudiant : un sntaka qui a pris le bain final. 120. Un Brahmane instruit : un rotriya. Kull. ajoute : mais un gendre et les autres, au bout d'une anne, mme sans qu'il y ait de sacrifice, doivent tre honors par un madhuparka . 122. Le repas funraire : le rddha; les crmonies accomplies en l'honneur des parents dcds ont pour but d'assurer leur flicit dans l'autre monde. Le repas pindnvhryaka, c'est--dire le repas funbre o l'on offre des gteaux appels pinda.
74
LES LOIS DE MANOU
123. Les Sages ont appel Anvhrya l'offrande funraire aux Mnes ; elle doit tre faite soigneusement mensuelle avec les viandes prescrites. 124. Je vais dire exactement on doit quels Brahmanes inviter en cette (solennit), quels sont ceux qu'on doit exclure, en quel nombre, et avec quels aliments (on doit les traiter). en l'honneur 125. On doit en traiter deux la crmonie des Dieux, trois la crmonie en l'honneur des Mnes, ou bien un seulement chacune des deux ; mme quand on est une nombreuse riche, on ne doit pas rechercher compagnie. 126. La nombreuse dtruit ces cinq (choses, compagnie : l'accueil honorable savoir) (fait aux htes, l'opportunit) de lieu et de temps, la puret de Brahmanes et la runion comaussi ne doit-on nombreuse (vertueux); pas dsirer pagnie. aux 127. La crmonie des morts le sacrifice appele lune est renomme; Mnes, (quia lieu) au jour del nouvelle cette crmonie des morts prescrite procure par la tradition sans cesse des prosprits celui qui est exact la (clbrer). 128. Les oblations aux Dieux et aux Mnes ne doivent tre donnes instruit ; par celui qui les offre qu' un Brahmane ce qu'on donne ce Brahmane trs mritant porte de grands fruits. 129. Rien qu'en invitant un seul homme instruit ( la en l'honneur des Dieux, (et celle) en l'honneur crmonie) des Mnes, on obtient une belle rcompense, (qu'en plutt mme un grand nombre nourrissant) qui ne (de personnes) connaissent point le Vda. 123. Kull. explique ainsi ce nom : parce qu'elle a lieu aprs (l'offrande des) gteaux . 126. B. H. : la prosprit des Brahmanes ; B. la slection de vertueux Brahmanes comme htes; L. : la faveur de recevoir des Brahmanes . Le sens est qu'une compagnie nombreuse est forcment mlange. 127. Laukiki est expliqu par smrtik fonde sur la tradition, sur la smrti . Le verbe eti est d'une concision obscure. Suivant l'explication de Kull., une rcompense consistant en fils et petit-fils vertueux, en richesses, etc. , revient celui qui accomplit cette crmonie.
LES LOIS DE MANOU
75
mme (sur les ascendants) 130. On doit s'enqurir reculs d'un Brahmane qui a achev l'tude du Vda ; un tel homme est un digne rceptacle des offrandes aux Dieux et aux Mnes ; un hte. c'est (vraiment) mme un millier 131. Quand d'hommes des ignorants livres saints prendraient un seul part ( un repas funraire), dans le Vda, (s'il est) satisfait homme instruit (de l'accueil qu'on lui a fait) les vaut tous, suivant la loi. 132. Les offrandes aux Dieux et aux Mnes doivent tre donnes une personne par son savoir ; car les distingue de sang ne se purifient mains souilles pas dans le sang. 133. Autant un ignorant du Vda avale de bouches dans un sacrifice aux Dieux ou aux Mnes, autant (celui qui donne le repas) avalera et de aprs sa mort de javelots, d'pieux balles de fer incandescents. 134. Certains l'tude, d'autres Brahmanes se consacrent aux austrits, d'autres aux austrits et la lecture du Vda, aux oeuvres pies. d'autres 135. Les offrandes aux Mnes doivent tre soigneusement donnes ceux qui se consacrent l'tude; mais les offrandes aux aux Dieux tre donnes) comme il convient (peuvent quatre (catgories) qu'on vient de mentionner. (personnesdes) 136. (Supposez) un fils ayant tudi le Vda jusqu'au bout, 130. Suivant Kull. il faut examiner la puret de lignage du pre, du grand-pre, etc. . C'est l vraiment un hte : parce qu'il fait obtenir de grandes rcompenses . (Kull.) 131. Littralement qui ne possdent pas les rcas , c'est--dire les hymnes sacrs. Dharmatah, suivant la loi , ou bien dharma utpdanena, par la production du mrite spirituel . (Kull.) 132. Les offrandes, c'est--dire la nourriture consacre. Cette comparaison veut dire, suivant Kull.: les mains souilles de sang ne se lavent pas dans le sang, mais bien dans l'eau pure ; ainsi la faute encourue, en donnant manger un sot, n'est pas efface en donnant manger un autre sot, mais un homme instruit . 134. Aux oeuvres pies : c'est--dire l'accomplissement des rites sacrs. 135. Yathnyyam : conformment la raison (de la loi sacre) . (B.) 136. Vedapraga signifie, suivant le commentaire, qui a tudi les Vdas et les Angas.
76
LES LOIS DE MANOU
ou un fils ignorant et dont le pre est ignorant, dont le pre a tudi le Vda jusqu'au bout : on doit considrer 137. De ces deux (personnages) comme le plus vnrable celui dont le pre est instruit (dans le d'tre honor cause du respect Vda) ; mais l'autre mrite d aux livres saints. funraire on ne doit point traiter un 138. A un sacrifice ami ; on peut gagner son affection par (d'autres) ; on prsents convier un Brahmane doit un sacrifice funraire qu'on ne ni comme ami. considre ni comme ennemi aux Dieux et aux Mnes ont 139. Celui dont les offrandes aprs la mort aucun fruit de pour objet les amis ne recueille ses offrandes aux Dieux et aux Mnes. contracte des amitis 140. L'homme qui dans sa dmence entre tous les au moyen d'un repas funraire, mprisable un ami par le Dvidjas, acquis perd le ciel, comme ayant funbre. moyen d'un sacrifice 141. Cette offrande dans) un festin en commun (consistant (avec des amis) est appele par les Brahmanes (l'oblation) aux dmons; en ce monde comme une vache elle reste dans une table. aveugle 142. De mme qu'en semant sur un sol strile le laboureur ne rcolte aucun produit, ainsi en offrant les aliments du des livres saints, sacrifice des gens ignorants le donateur ne retire aucun fruit. 143. Mais un prsent fait suivant la loi un homme instruit assure celui qui le donne et celui qui le reoit la jouissance et dans l'autre. d'une rcompense en ce monde 139. Ont pour objets les amis : c'est--dire celui qui invite une crmonie en l'honneur des Dieux ou des Mnes des gens pour s'en faire par l des amis. Cf. le vers suivant. 140. rddhamitra : L. vou au sacrifice par intrt seulement . Il me semble plus naturel de faire de ce mot un compos possessif. 141. B. fait dpendre dvijaih de dakshin et non d'abhihit : l'offrande (de nourriture) par des Dvidjas . Le texte porte dans une seule table , mais je ne pense pas qu'il faille attacher un sens eka.Reste en ce monde, c'est--dire ne produit pas de fruit dans l'autre.
LES LOIS DE MANOU
77
144. (A dfaut d'un Brahmane on peut son gr, instruit), dans un sacrifice funraire, un ami (vertueux) honorer plutt mme instruit qu'un ennemi ; car l'offrande mange par un ennemi reste sans fruit aprs la mort. soin de 145. A un sacrifice funraire on doit avoir grand convier un (Brahmane) le Vda ayant tudi compltement et connaissant bien le Rig-Vda, ou un (Brahmane) vers dans le Yadjour-Vda bout de (cette) (et) qui a t jusqu'au branche instruit dans le Sma(du Vda), ou un (Brahmane) Vda qui le possde en entier. 146. Si l'un de ces (trois) mange un sacrifice funraire les anctres honor, aprs avoir t (convenablement) (de celui qui offre le repas) jusqu'au ascendant septime reoivent une satisfaction durable. 147. Telle est la rgle fondamentale pour l'accomplissement des sacrifices aux Dieux et aux Mnes ; apprenez la observe par les gens rgle secondaire (que voici), toujours vertueux. 148. On peut convier dfaut d'un ( un repas funbre, Brahmane son aeul maternel, son oncle maternel, instruit), le fils de sa soeur, son beau-pre, son prcepteur, le fils de sa un parent, un prtre ou une fille, son gendre, officiant, personne pour qui on offre un sacrifice. 149. Celui qui connat la loi n'a pas besoin d'examiner un la crmonie en l'honneur Brahmane des (pour le convier) Dieux ; mais pour celle en l'honneur des Mnes, il doit l'examiner scrupuleusement. 150. Manou a dclar indignes des offrandes aux Dieux et 145. B. restreint Vedapraga au Rig-Vda un adhrent du Rig-Vda qui a tudi une entire (recension de ce) Vda . Vers dans le Yadjour-Vda : un adhvaryu. Il y a un quatrime Vda, l'Atharva-Vda, d'origine plus rcente que les trois autres, et que Manou ne connat pas. 148. Yjya une personne pour qui on offre le sacrifice signifierait, selon d'autres, celui qui accomplit le sacrifice . 149. Examiner un Brahmane : au sujet de la puret de sa famille (cf. v. 130), ou peut-tre au point de vue personnel.
78 aux Mnes
LES LOIS DE MANOU
de leur caste, les Brahmanes exclus voleurs, ou athes. eunuques un un sacrifice funraire 151. On ne doit point convier homme qui porte les cheveux natts, celui qui n'a point tudi le Vda, ni un infirme, un joueur, ni ceux qui sacrifient pour tout le monde. les montreurs les marchands 152. Les mdecins, d'idoles, de viande, et ceux qui vivent de trafic doivent tre exclus des aux Dieux et aux Mnes. sacrifices au service d'un village ou d'un roi, un 153. Un homme homme qui a mal aux ongles ou les dents noires, un (tudiant) son prcepteur, un (homme) qui qui fait de l'opposition nglige le feu (sacr), un usurier, un gardeur 154. Un phtisique, de troupeaux, un frrecadet mari avant son an, un (homme) les (cinq qui nglige un ennemi des Brahmanes, un frre an grands) sacrifices, avant son cadet, un membre d'une qui ne s'est pas mari corporation, celui qui a enfreint 155. Un acteur, ses voeux, le mari noces) d'une femme Soudra, le fils d'une femme (en premires un borgne, celui qui tolre dans sa maison un remarie, amant de sa femme, 156. Celui qui enseigne pour un salaire, et celui qui reoit l'instruction l'lve d'un Soudra et le salaire, moyennant 151. Qui porte les cheveux natts: c'est--dire un novice. (Kull.) Au lieu de durbala faible, infirme , Medh. a une autre leon suivie par L. et B. H., durbla sans prpuce . Qui sacrifient pour tout lemonde : le texte dit seulement pour beaucoup de gens tels que des dgrads ou autres. 152. B. H. met un point aprs les marchands de viande et rapporte le commencement du vers au vers prcdent. Les montreurs d'idoles ou les prtres d'un temple (B.), ou ceux qui adorent les idoles pour gagner leur vie . (B. H.) 154. Je ne sais sur quelle autorit L. traduit ganbhyantara par un homme qui vit aux dpens de ses parents. 155. Un acteur : ou un danseur, un chanteur. Celui qui a enfreint ses voeux veut dire un novice qui a manqu la chastet . 156. On peut aussi prendre draishya pour un compos possessif, comme
LES LOIS DE MANOU
79
Soudra un homme dans ses paroles, le prcepteur, grossier fils d'une femme adultre ou le fils naturel d'une veuve, 157. Celui qui dlaisse sans motif sa mre, son pre ou son prcepteur, celui qui est entr en rapport avec des dsoit par les liens du Vda, soit par ceux du mariage, grads 158. Un incendiaire, un empoisonneur, celui qui mange le un vendeur de soma, un (homme) pain d'un fils adultrin, un faux qui voyage par mer, un barde, un marchand d'huile, tmoin, 159. Un (fils) qui a procs avec son pre, un joueur, un un (homme) atteint d'une maladie ivrogne, grave, un (homme) un marchand dcri, un trompeur, d'essences, 160. Un fabricant d'arcs et de flches, l'poux d'une jeune soeur marie avant son ane, celui qui trahit un ami, celui son fils, qui vit du jeu, celui qui a pour prcepteur 161. Un pileptique, un strumeux, un (homme) atteint de la lpre blanche, un dlateur, un fou, un aveugle, un dtracteur des Vdas, tre exclus. (tous ces gens) doivent 162. Un cornac un dresseur de boeufs, de d'lphants, de chameaux, celui qui fait mtier de l'astrologie, chevaux, un leveur d'oiseaux, ainsi qu'un matre d'escrime, 163. Celui qui dtourne les cours d'eau, ou qui aime les un architecte, un messager, un planteur d'arbres obstruer, (salari), 164. Un dresseur de chiens, un fauconnier, un sducteur de filles, un homme un (Brahmane) malfaisant, qui mne la vie d'un Soudra, un sacrificateur aux dieux infrieurs, le fait B., celui qui enseigne des lves Soudras . Un homme grossier en paroles : ou suivant d'autres, un homme dcri (abhiasta) . (Kull.) 157. B. H. entend diffremment: celui qui est abandonn par sa mre . Les liens du Vda : c'est--dire en tudiant avec eux le Vda. 159. Un procs : ou simplement des contestations. Un joueur, ou bien celui qui tient une maison de jeu. Sur les deux sens possibles de pparogin, cf. v. 92 ; par maladie grave il faut entendre l'lphantiasis ou la phtisie. Abhiasta dcri , ou suivant B. celui qui est accus d'un pch mortel. 164. Soudra : le texte porte vrshala. Suivant Kull. le sens est celui qui
80
LES LOIS DE MANOU
un eunuque, 165. Celui qui viole les bonnes coutumes, un cultivateur, un pied celui qui mendie perptuellement, des gens de bien, bot, un (homme) mpris un conducteur 166. Un berger, de buffles, d'une l'poux un croque-mort, femme remarie, (tous ces gens) doivent tre exclus. soigneusement doit exclure des deux (cr167. Un Brahmane judicieux dont la conduite monies) ces (gens), les plus vils des Dvidjas, d'tre admis en reset qui sont indignes est rprhensible, pectable compagnie. sans instruction s'teint comme un feu 168. Un Brahmane consacre aux d'herbe ; on ne doit point lui donner l'offrande dans les cendres. Dieux ; ce serait sacrifier 169. Je vais dire sans rien omettre quel fruit revient (aprs aux Dieux consacre la mort) au donateur qui offre l'oblation en resd'tre admise ou aux Mnes une personne indigne pectable compagnie. 170. Ce qui a t mang par des Brahmanes ayant rompu leurs ans et leur voeu, par des jeunes frres maris avant d'tre admises, est en ralit autres telles personnes indignes dvor par les dmons. 171. Celui qui prend femme et allume le feu sacr, alors est appel Parivettar, que son an n'est pas encore mari, et l'an Parivitti. gagne sa subsistance des Soudras dropaklplavrttih .Les divinits infrieures sont les Ganas. 165. Un pied bot: ou bien un homme qui a l'lphantiasis aux jambes. Kliva eunuque est traduit par L. celui qui remplit ses devoirs avec ngligence . 167. Les deux crmonies : c'est--dire celle en l'honneur des Dieux et celle en l'honneur des Mnes. Toutes ces infirmits sont considres comme des punitions de fautes commises dans une vie antrieure. 168. Un feu d'herbes (sches) est vite consum et il ne reste plus que des cendres pour y verser l'offrande. 170. Par les dmons : et non par les Dieux et les Mnes auxquels l'oblation est destine, et par consquent ce sacrifice est strile . (Kull.) 171. Allume le feu sacr : c'est--dire accomplit la crmonie de l'Agnihotra. Est appel : littralement doit tre tenu pour.
LES LOIS DE MANOU
81
172. Tous deux, ainsi que la jeune fille avec laquelle l'hyet le men est contract, (le pre) qui la donne en mariage, vont tous les cinq en enfer. prtre du sacrifice (nuptial) 173. Celui qui satisfait sa passion pour la femme de son autorise frre mort, mme quand elle a t lgalement ( avoir un enfant de lui), doit tre considr comme l'poux d'une femme remarie. il nat deux (sortes) de fils, le 174. Des femmes adultres : le kounda kounda et le golaka si l'poux est encore vivant, le golaka aprs la mort de l'poux. 175. Ces deux tres ns de la femme adultre font perdre au donateur ici-bas et aprs la mort (le fruit) des offrandes aux Dieux et aux Mnes, (dont il leur a) donn (une part). 176. Pour tous les (htes) honorables qu'un (homme) inl'insens digne d'tre admis regarde manger, qui donne (le ne recueille aucun fruit dans l'autre monde. repas funraire) 177. Un aveugle, dtruit par sa prsence, pour le donateur (d'un repas) la rcompense la rception) (que lui vaudrait de quatre-vingt-dix un borgne (celle) de soixante, un htes, (homme) atteint de lpre blanche (celle) de cent, celui qui a une maladie grave (celle) de mille. 178. Le donateur (d'un repas funraire) perd le fruit de son oeuvre mritoire pour tous les Brahmanes (invits) qu'un peut toucher avec ses (homme) qui sacrifie pour les Soudras, membres. un Brahmane, 179. Si par cupidit instruit dans quoique 173. Cf. IX, 58sqq., le cas o de tels rapports peuvent tre autoriss. Je faisdpendre kmatah d'anurajyeta: on peut aussi en faire un adverbe part au gr de ses dsirs, par passion . Un e femme remarie, une didhish. 174. Las femmes adultres : littralement les femmes des autres. 177. Vkshya voyant c'est--dire assistant Le comm. dit : dfaut de quelqu'un qui voit, un aveugle plac un endroit o un autre pourrait voir . Atteint de maladie grave : cf. v. 92, et v. 159; cette maladie doit tre naturellement encore plus grave que la lpre, peut-tre la consomption. Kull. dit seulement rogarja, la reine des maladies. 178. Peut toucher avec ses membres : ou bien dont il a touch les membres . Il faut sous-entendre pendant la dure du repas . 6
S2
LES LOIS DE MANOU
il va rapid'un tel (personnage), un prsent le Vda, accepte sa perte, tel un pot de terre non cuite dans l'eau. dement de soma devient donne un vendeur 180. (La nourriture) du pus et du sang ; (donne) un de l'ordure ; un mdecin, elle reste strile. elle se perd ; un usurier, d'idoles montreur ni ne (fructifie) 181. Celle qui est donne un marchand et (celle qu'on ni dans l'autre, dans ce monde donne) un est comme l'offrande jete Dvidja n d'une femme remarie, dans la cendre. 182. Mais les Sages dclarent (offerte) que la nourriture d'tre admis et mchants, aux autres gens indignes que l'on vient d'numrer, (devient) graisse, sang, viande, moelle et os. maintenant 183. Apprenez compltement par quels Brahune compagnie manes tre purifie par (la peut pollue ces de gens indignes d'tre admis, (et connaissez) prsence) une compagnie. minents Brahmanes qui purifient 184. Ceux qui excellent dans la science du Vda et de tous de (prtres) et qui descendent les traits accessoires, instruits, d'une comles purificateurs tre considrs comme doivent pagnie. d'une des l'tude 185. Un Brahmane qui s'est consacr les cinq feux, celui qui entretient du Yadjour-Vda, parties Trisoula portion du Rig-Vda celui qui connat appele le fils d'une celui qui est vers dans les six Angas, parna, et celui qui chante le rite de Brahm femme marie suivant du Sma-Vda, la partie principale et celui qui le sens du Vda 186. Celui qui comprend 180. Strile : littralement apratishtham, qui ne se tient pas bien, qui n'est pas solide . B. traduit ne trouve pas de place (dans le monde des Dieux) . minents : ou simplement ces Brahmanes; 183. Ces Brahmanes dvijgrya signifie, comme dvijottama le premier parmi les Dvidjas . 184. Les traits accessoires sont les Angas. Un prtre instruit, un rotriya, un thologien. 185. Suivant le Dictionnaire de Saint-Ptersbourg trinciketa signifie dans ce passage qui a allum trois fois le feu appel nciketa . C'est aussi le nom d'une des parties du Yadjour-Vda.
LES LOIS DE MANOU
83
le novice qui a donn mille (vaches son prcepl'enseigne, teur), un centenaire, (tels sont) les Brahmanes qui doivent tre considrs comme purificateurs d'une compagnie. 187. La veille de la clbration d'un sacrifice funraire, ou le jour mme, on doit inviter dment trois au moins des Brahmanes qui ont t mentionns. invit une (crmonie) en l'honneur 188. Un Brahmane des Mnes, doit toujours tre matre de ses sens ; qu'il s'abstienne de rciter le Vda, et que celui qui offre le sacrifice funbre (l'imite). 189. Car les Mnes accompagnent ces Brahmanes invits, et s'asseyent les suivent comme le vent (quand ils marchent) prs d'eux quand ils sont assis. 190. Un Brahmane invit suivant les rgles un sacrifice aux Dieux ou aux Mnes, et qui d'une manire quelconque est coupable, et deviendra sa ( l'invitation) manque (aprs mort) un porc. sa 191. Mais celui qui invit un repas funraire, satisfait se charge de tous les pchs passion avec une femme Soudra, commis par le donateur (du repas). 192. Exempts de colre, observateurs de la puret, toujours au combat, dous de grandes chastes, vertus, ayant renonc (tels) sont les Mnes, divinits primordiales. 193. Apprenez de tous compltement quelle est l'origine 1S7. Prvedyur aparedyurv signifie littralement le jour prcdent oue jour qui suit . L'expression le jour qui suit est ambigu, au moins en franais ; elle semblerait dsigner le jour aprs le sacrifice . Mais le commentaire de Kull. est prcis : le jour prcdent, ou dfaut de celui-ci, le jour mme du rddha . 188. Qu'il s'abstienne de rciter le Vda : l'exception de la prire murmure qui est obligatoire . (Kull.) 190. A tikrman: littralement qui transgresse est comment par Bhojanam akurvnah . 192. Les Mnes ou Pitris ne sont pas seulement les anctres diviniss des hommes, auxquels on offre des sacrifices ; ils sont aussi les anctres des Dieux et des gnies, et les anctres primordiaux du genre humain. 193. Qui ils sont : peut-tre ne faut-il pas faire de ye une proposition spciale, mais le rapprocher de yaih : c'est la tournure grecque TIVET!<JIV.
84
LES LOIS DE MANOU
ces (Mnes), tre qui (ils sont), et par quels rites ils doivent honors. 194. Les classes de Mnes sont considres (diverses) comme les fils de tous ces Saints, Martchi et les autres, enfants de Manou issu de Brahm. 195. Les Somasads sont considrs fils de Virdj comme les anctres des Sdhyas et les Agnichvttas fils de Martchi sont fameux dans le monde tant les anctres) des (comme Dieux. 196. Les Barhichads fils d'Atri sont reconnus (comme les des Daityas, des Dnavas, des Ganddes Yakchas, anctres) des Sarpas, et des des Rkchasas, des Souparnas harvas, Kinnaras. 197. Les Somapas des Brahmanes, les (sont les anctres) ceux des ceux des Kchatriyas, les djyapas Havirbhoudjs et les Souklins ceux des Soudras. Vaisyas, fils 198. Les Somapas sont fils de Kavi, les Haviclimats de les djyapas de Poulastya, les Souklins d'Anguiras, Vasichtha. les Kvyas, 199. Les Agnidagdhas, les Anagnidagdhas, doivent les Barhichads, et les Saoumyas les Agnichvttas seulement. tre reconnus des Brahmanes (pour les anctres) 200. De ces classes principales de Mnes, qui viennent de d'tre numres, une infinit sachez qu'il existe ici-bas fils et de petits-fils. 201. Des Sages sont issus les Mnes, des Mnes les Dieux au et les Dnavas naissance) ; mais les Dieux (ont donn dans et inanims, monde anims entier, (avec j les tres) l'ordre. 194. Cf. I, 35. Hiranyagarbha, sein d'or, est un des noms de Brahm. 195. Virdj, cf. I, 33. 196. Sur ces divers noms, cf. I, 37 et notes. Les Daityas fils de Diti, ou Asuras. 197. Somapa signifie buveur de soma. Havirbhuj mangeur d'oblations. J3'apa buveur de la graisse du sacrifice. 198. Kavi ou Bhrgu. Havishmat = Havirbhuj. 201. Sages ou Saints, les Maharshis. Les Dnavas, sorte des dmons.
LES LOIS DE MANOU
85
offerte avec foi ces (Mnes), 202. Mme de l'eau (pure), dans des vases d'argent ou orns d'argent, est la source d'une flicit imprissable. 203. Pour les Dvidjas, la crmonie en l'honneur des Mnes est plus importante en l'honneur des que la crmonie car l'oblation aux Dieux qui prcde l'oblation aux Dieux; Mnes est dclare un moyen propitiatoire pour celle-ci. 204. On doit commencer aux Dieux par une offrande aux Mnes) ; comme (moyen de) protection pour (l'oblation car les Dmons le repas funraire emportent priv de cette protection. 205. Il faut commencer et finir (un Srddha) par une offrande aux Dieux, il ne faut ni commencer ni finir par l'offrande aux Mnes ; car celui qui commence et qui finit par l'offrande aux Mnes prit bientt avec toute sa race. 206. Il faut enduire de fumier de vache un lieu pur et isol, et avoir soin qu'il ait une pente vers le Sud. satisfaits des offrandes 207. Car les Mnes sont toujours et dans des faites en des lieux purs, sur les rives des fleuves endroits isols. ont fait convenablement 208. Aprs que les Brahmanes sur des il faut les faire asseoir sparment leurs ablutions, d'herbe kousa. siges prpars, garnis ces Brahmanes sur 209. Ayant fait asseoir irrprochables odorifrantes leurs siges, il faut les honorer avec des guirlandes et des parfums, (honor) les Dieux. aprs avoir pralablement 203. pyyana : littralement un moyen de faire prosprer . 204. Jeu de mots tymologique sur rakshas dmon et le verbe rakshati, protger. 206. Yama, seigneur des Mnes est rgent du Midi. 207. En des lieux purs : des lieux tels que les forts et autres qui sont naturellement purs . (Kull.) 208. Herbe sacre usite dans les crmonies, Poa cynosurodes. 209. Irrprochables : ajugupsita, littralement non excr , fait allusion sans doute ces catgories mentionnes plus haut de Brahmanes qui doivent tre exclus des crmonies. Peut-tre aussi faut-il entendre sans les insulter , c'est--dire avec respect , comme traduit L.
86
LES LOIS DE MANOU
kousa 210. Aprs leur avoir apport de l'eau, de l'herbe et des grains de ssame, autoris par (tous que le Brahmane dans le feu. les autres) Brahmanes ensemble fasse (l'oblation) 211. Ayant d'abord adress Agni, Soma et Yama, suivant les rgles, une oblation (comme) moyen propitiatoire ensuite les Mnes (par une (du Srddha) qu'il satisfasse offrande de riz). 212. Mais s'il n'y a point de feu (sacr), qu'il mette (les dans la main d'un Brahmane oblations) ; car le feu et un Brahmane c'est tout un, disent les Brahmanes qui connaissent les livres saints. 213. Ces Brahmanes exempts de colre, faciles contenter, vous la prosprit du monde, on les appelle les antiques, Dieux du sacrifice funraire. 214. Aprs avoir fait (l'oblation) au feu (et) tourn comautour (en marchant de gauche) on doit droite, pltement d'eau la terre avec la main droite. asperger 215. Ayant du reste de l'offrande, on fait trois boulettes et la face tourne vers le Sud, (les) doit, avec recueillement offrir de la mme manire d'eau. que (les libations) 216. Ces boulettes offertes suivant le rite, on doit, attentif, cette main (droite) avec (les racines) de ces brins essuyer l'intention des (anctres) les d'herbe kousa, qui mangent parcelles essuyes. 210. On peut rapporter saha kuryt : qu'il fasse avec eux. 212. S'il n'y a point de feu : parce qu'il n'est pas encore mari ou que sa femme est morte . (Kull.) 213. Facile contenter : suprasdn est comment par prasannamukhn, au visage serein . Antiques : d'une race primitive. 214. Construction embarrasse. Voici ce que dit Kull.: Ayant fait la srie des rites accompagnant l'oblation au feu, tels que l'aspersion du feu et autres (formalits), en allant vers la droite. 215. De la mme manire que l'eau : c'est--dire avec la main droite . (Kull.) 216. Ces anctres sont d'aprs Kull. le grand grand-pre et les autres anctres en remontant, c'est--dire le pre et l'aeul de ce dernier. Les trois boulettes sont pour les trois premiers ascendants.
LES LOIS DE MANOU
87
tourn vers le Nord, ayant 217. S'tant rinc la bouche, trois suspensions celui qui connat fait lentement d'haleine, et les les textes sacrs adorera les six (divinits des) saisons Mnes. l'eau qui reste prs 218. De nouveau il versera lentement et recueilli, dans l'ordre des boulettes, il flairera ces boulettes o elles ont t places. 219. Prenant successivement de ces de petites portions il les fera manger suivant la rgle, ces Brahmanes boulettes, assis, avant (le repas). 220. Celui dont le pre est encore en vie doit offrir le aux (Mnes des trois anctres) (repas funbre) qui l'ont prcd ; ou bien encore il peut faire manger son pre au repas funraire comme un Brahmane. 221. Mais celui dont le pre est mort, et dont l'aeul est encore en vie, doit, (paternel) aprs avoir prononc le nom de son pre, mentionner celui de son grand grandpre. 222. Ou bien le grand-pre peut prendre part au repas a dit Manou, ou bien (son petit-fils) autoris par lui lui-mme sa volont. accomplir (la crmonie) vers dans les mains de ces (htes) de l'eau Ayant avec un brin d'herbe de ssame, il (leur) kousa, le sommet de ces boulettes en disant : Svadh pour
funbre, peut de 223. mle donnera eux ! 224. Puis ayant pris lui-mme un (plat) rempli d'aliments avec ses deux mains, il le dposera doucement devant ces en pensant aux Mnes. Brahmanes,
220. C'est--dire au grand-pre, bisaeul, etc. Comme un Brahmane vipravat, c'est--dire comme un des htes Brahmanes. 222. Le grand-pre peut prendre part au repas funbre : la place du Brahmane qui le reprsenterait s'il tait mort . (Kull.) A sa volont : c'est--dire suivant Vishnu, auteur d'un code de lois, cit par Kull. son grand-pre vivant l'ayant autoris faire sa guise, il peut sa volont ou bien faire manger son grand-pre, ou bien faire deux rddhas l'intention de son pre et de son bisaeul . 223. Svadh dsigne la libation aux Mnes, et est une sorte d'interjection.
88 LES LOIS DE MANOU 225. Les aliments sans les tenir entre les qu'on apporte sont enlevs de force par les esprits malfaideux mains sants. 226. Les assaisonnements tels que bouillon, et lgumes lait frais ou lait suri, beurre fondu et miel, il doit les autres, et recueilli, dposer avec soin par terre, tant attentif durs et les divers mets, 227. (Ainsi que) les aliments et boissons fruits, viandes dlicates, racines, parfumes. tous 228. Ayant ces (plats) successivement, apport et attentif, recueilli qu'il les offre ( ses htes) en (leur) toutes les qualits de chacun. expliquant 229. Il ne doit en aucun cas verser une larme, s'irriter, avec le pied, ni les dire un mensonge, toucher les aliments secouer. la colre 230. Une larme envoie les mets aux Fantmes, le mensonge aux chiens, le contact (les envoie) aux ennemis, du pied aux Dmons, une secousse aux malfaiteurs. il doit le donner, 231. Tout ce qui plat aux Brahmanes, et faire des rcits concernant l'tre libralement, suprme, car cela est agrable aux Mnes. 232. Dans un (sacrifice) aux Mnes, on doit faire entendre du Vda, les livres de lois, les l( ses htes) la lecture et les (textes les popes, les (rcits des) Pournas gendes, Khilas. appels) apocryphes 225. Sans les tenir dans les deux mains ; c'est--dire avec une seule main. Les esprits dsigne ici les Asuras. 227. Bhakshya, aliment qui a besoin d'tre mastiqu. 230. Les fantmes, les Prtas : Une larme verse fait arriver les aliments du rddha aux Prtas, et il n'en revient aucune satisfaction aux Mnes . (Kull.) 231. Ou bien raconter des histoires vdiques ; Brahman =Veda. B. traduit : proposer des nigmes tires du Vda . 232. Les livres de lois tels que le Code de Manou et les autres; les popes telles que le Mahbhrata; les lgendes telles que le Sauparna, le Maitrvruna; les Khilas tels que lerskta, le ivasankalpa, etc. . (Kull.) Les Purnas sont des recueils en vers des anciennes lgendes, au nombre de dix-huit,attribus au sage Vysa (1000-1200 avant Jsus-Christ (?). Vysa est un nom qui signifie compilateur.
LES LOIS DE MANOU 233. Content
89
charme lui-mme, qu'il (ses htes) Brahsuccessivement manes, qu'il leur fasse manger (de chaque chose) et qu'il les engage plusieurs reprises (en leur prsenles qualits. tant) le riz et autres (mets dont il proclamera) 234. Qu'il ait soin, un repas funraire, de convier le fils de sa fille, ft-il en son noviciat, sur le sige qu'il mette une couverture du Npal) et qu'il rpande (en poil de chvre terre des grains de ssame. 235. Trois (choses) purifient dans-un le fils repas funbre, de la fille, la couverture et les grains de ssame ; trois (choses) la puret, l'absence de colre et de y sont recommandes, prcipitation. 236. Tous les aliments doivent tre trs chauds, et on doit en silence; les Brahmanes les'manger (mme) interrogs ( ce sujet) ne doivent par celui qui donne (le repas) point dclarer les qualits des mets. 237. Aussi longtemps restent chauds et que les aliments la qualit des mets, que l'on mange en silence, sans proclamer les Mnes prennent leur part (du repas). 238. Ce que l'on mange la tte couverte, ce que l'on mange la face tourne vers le Sud, ce que l'on mange avec des sandales (aux pieds), ce sont les Dmons qui le dvorent. 239. Il ne faut pas qu'un homme de caste mprise, un un coq, un chien, une femme un porc, qui a ses rgles, voient manger les Brahmanes. eunuque 240. Tout ce qui est vu par eux durant une oblation au feu, une (distribution un repas (donn des Brahde) prsents, un sacrifice aux Dieux ou aux Mnes, est sans profit. manes), 233. Guna signifie peut-tre ici non pas qualit, mais comme au vers 226, les assaisonnements . 234. B. entend qu'il faut mettre cette couverture sur le sige de chaque hte. B. H. qu'il donne ( son hte) une couverture pour sige. 239. Un homme de caste mprise veut dire ici un Cndla, issu d'un Soudra et d'une Brhman. Un porc : Kull. explique varha par un porc de village , c'est--dire domestique, oppos sanglier, sens ordinaire de varha. 240. Prsents : tels que vache, or, etc. . (Kull.)
90 241.
LES LOIS DE MANOU
Le porc dtruit (les effets de la crmonie) par son flair, le coq par le vent de ses ailes, le chien par son regard, un homme de caste mprise par son attouchement. mutil ou celui 242. Un boiteux, un borgne, un homme mme il serait le serviteur de trop, quand qui a un membre de l. de celui qui offre (le repas funraire), doit tre loign ou un moine mendiant vient quter 243. Si un Brahmane lui faire honneur, sa nourriture, (le matre du repas) pourra ses moyens, avec la permission de (ses htes) Brahsuivant manes. toutes sortes de mets (avec des assai244. Ayant mlang et les ayant aspergs d'eau, qu'il les dpose sonnements) (sur des brins d'herbe kousa), devant terre, en les parpillant (ses htes) qui ont fini de manger. et ce qui a t parpill sur 245. Le reste (des aliments), morts doit tre la part des (enfants) des brins d'herbe kousa, l'initiation et des (hommes) avant (sans qui ont abandonn motif) des femmes de leurs castes. un (repas en l'hon246. Les restes tombs terre pendant la part des serviteurs dvous neur) des Mnes sont dclars et honntes. du (rite dit) Sapindkarana, on 247. Avant la clbration d'un Brahmane doit (faire) en l'honneur qui vient de mourir aux Dieux sans (y joindre un repas funraire, l'offrande) et y) convier en offrant seulement (un seul Brahmane) (runis, une boulette. 241. Par son flair : en respirant le parfum des mets . (Kull.) 245. Morts avant l'initiation. D'aprs Kull. asamskrtapramtnm signifie pour lesquels la crmonie de la crmation n'a pas t faite Cf. V, 69, o il est dit que les enfants morts avant l'initiation ne doivent pas tre brls. Kulayoshitm des femmes de leur caste ou bien des femmes de leur famille (B. H.), ou bien de.nobles femmes . (B.) Ces interprtations et d'autres sont fournies par les commentateurs. 247. Le texte de Jolly porte asapinda au lieu d'sapinda. La leon avec a bref, autorise par Kull. et plusieurs autres, signifierait le sacrifice pour les personnes non-sapindas . Le sapindkarana a pour but de recevoir parmi les sapindas ou parents jusqu'au sixime degr inclus, un Brahmane
LES LOIS DE MANOU
91
248. Quand le (rite dit) Sapindkarana a t accompli son intention, la loi, l'oblation suivant des boulettes doit tre faite par les fils de la manire (indique prcdemment). 249. L'insens qui aprs avoir mang un repas funraire donne ses restes un Soudra, tombe la tte la premire dans l'enfer (appel) Klasotra. 250. Si celui qui a pris part un repas funraire entre le d'une femme les Mnes Soudra, jour mme dans la couche de ses (anctres) seront couchs (tout) ce mois dans pendant l'ordure de celle-ci. 251. Aprs avoir demand bien ( ses htes) : Avez-vous dn ? s'ils sont satisfaits, il les invitera se rincer la bouil les congdiera en disant : che, et cette faite, opration Reposez-vous (ici ou chez vous). 252. A quoi les Brahmanes doivent : aussitt rpondre Contentement soit ! Car toutes les crmonies en l'hon est la plus excellente neur des Mnes, le mot contentement des bndictions. il doit faire connatre 253. Ensuite ( ses htes) qui ont termin leur repas, ce qui reste des aliments, et avec l'autorisation des Brahmanes, en faire l'emploi qu'ils lui diront. 254. Dans un sacrifice aux Mnes il faut dire : Avez-vous un sacrifice une bien dn ? ; dans pour purificatoire de famille : Avez-vous bien entendu ? ; dans un sacrifice : Avez-vous russi ? ; dans un sacrifice des rjouissance ? Dieux : tes-vous contents de kousa, la purification de la 255. L'aprs-midi, les brins les grains de ssame, la distribution demeure, (des aliments), rcemment mort. Le rddha dont il est ici question s'appelle ekoddishta, adress un seul. 249. Klastra, nom- qui signifie fil de la mort. 252. Le mot svadh. 254. Le sacrifice purificatoire pour une famille goshthaou goshthrddha. Le vrddhi-rddha ou rddha pour l'accroissement de la prosprit est appel ici abhyudaya, c'est--dire crmonie clbre l'occasion de rjouissances. Les quatre formules en question sont Svaditam, Surutam> Sampannam et Rucitam.
92
LES LOIS DE MANOU
sont des avanet des Brahmanes leur prparation, distingus en l'honneur des Mnes. tages dans une crmonie 256. Les brins d'herbe les (prires) kousa, purificatrices, les offrandes de toutes sortes ainsi que les purificale matin, doivent tre reconnus tions prcdemment indiques, pour des avantages dans un sacrifice aux Dieux. des anachortes, 257. La nourriture le lait, le soma, la viande non assaisonne et le sel naturel sont dits les offrandes de nature. 258. Ayant les (htes) Brahmanes, recueilli, congdi silencieux et pur, la face tourne vers le Sud, on doit implorer : (en ces termes) ces Mnes minents les hommes gnreux 259. Puissent abonder parmi nous! aussi Puissent et (notre) (la science du) Vda postrit ! Puisse la foi ne jamais nous quitter ! Puissions(s'accrotre) donner ! nous avoir beaucoup 260. Aprs avoir ainsi fait l'offrande, on doit aussitt faire ces boulettes une manger par une vache, un Brahmane, chvre, (les faire consumer) par le feu (sacr) ou les jeter dans l'eau. 261. Quelques-uns font l'offrande des boulettes aprs (le les font manger aux oiseaux, ; d'autres repas des Brahmanes) ou bien les jettent dans le feu ou dans l'eau. au 262. Une pouse lgitime fidle son mari, et attentive culte des Mnes, devra manger la boulette du soigneusement milieu, (si elle) dsire avoir un fils. 263. (Ainsi) elle enfantera une longue un fils destin vie, plein de gloire et de sagesse, riche, ayant une nombreuse et juste. vertueux postrit, 264. Ayant lav ses mains et rinc sa bouche, (le matre du repas) devra des aliments ses parents prparer pour 257. La nourriture des anachortes : du riz sauvage. (Kull.) Le soma est le jus exprim de l'Asclepias acida. La viande non assaisonne : dpourvue d'odeurs fortes et autres (Kull.), ou bien, suivant l'interprtation de Medh., la viande non dfendue .
LES LOIS DE MANOU
93
avec respect, il et aprs les leur avoir prsents (paternels) fera dner leur tour ses parents maternels. ce que 265. Qu'il laisse les restes des Brahmanes, jusqu' il fera l'offrande de la ceux-ci aient t congdis ; ensuite maison: telle est la rgle. 266. Je vais maintenant sans rien omettre, quelle exposer, donne aux Mnes la rgle, sert suivant (sorte d')offrande pour un long temps ou pour l'ternit. 267. Des grains de ssame, du riz, de l'orge, des haricots, de l'eau, des racines le rite satisfont et fruits offerts suivant les anctres des hommes pour un mois. 268. On les satisfait pour deux mois avec du poisson, pour trois avec de la chair de gazelle, avec de la chair pour quatre de mouton, pour cinq avec de la chair d'oiseau, 269. Pour six avec de la chair de chevreau, pour sept avec de la chair de daim, pour huit avec de la chair d'antilope, pour neuf avec de la chair de cerf. 270. Ils sont satisfaits dix mois avec de la chair de sanglier et de buffle, onze mois avec de la chair de livre et de tortue, 271. Un an avec du lait de vache et du riz au lait; la satisfaction la chair d'un bouc blanc dure (que leur donne) douze annes. 272. L'herbe klaska et le (poisson) la chair mahsalka, de rhinocros et celle d'une chvre rouge, du miel et tous les aliments des ermites, leur procurent une satisfaction ternelle. 273. N'importe mle du miel, offerte quelle (substance) 265. L'offrande de la maison est l'offrande bali, l'oblation aux Bhtas ou tres. 268. De la chair d'oiseau qu'il est permis aux Dvidjas de manger . (Kull.) 269. Cerf: ruru, espce particulire de cerf ou d'antilope. 271. Un bouc blanc, vrdhrnasa, appel tripiva (qui boit par trois endroits), parce que quand il boit l'eau d'une source, trois choses touchent le liquide : sa langue et ses deux oreilles, et ainsi il boit par trois endroits' . (Kull.) 272. Klaka, Ocimum sanctum. Mahalka (?), poisson, crabe ou crevette. 273. Magh est le nom du dixime astrisme lunaire.
94
LES LOIS DE MANOU
le treizime en (la saison des) pluies et sous la (jour lunaire) constellation aussi (une joie) imprissable. Magh (procure) 274. a Puisse-t-il natre dans notre ligne quelqu'un qui nous donnera du riz au lait avec du miel et du beurre clarifi, le treizime et ( l'heure) o l'ombre de l'l(jour lunaire) phant tombe l'Est ! (tel est le voeu des Mnes). 275. Tout ce qu'un homme de foi donne ponctuellement, selon la rgle, devient monde (la pour les Mnes dans l'autre source d'un contentement) ternel et indestructible. 276. Dans la quinzaine noire, les jours partir du dixime, le quatorzime sont recommands except, pour un sacrifice mais il n'en est pas de mme des autres. funraire, 277. Celui qui accomplit aux jours (un sacrifice funbre) obtient pairs et sous les constellations paires, (la ralisation) de tous ses dsirs ; celui qui honore les Mnes aux (jours et sous les constellations) obtient une impairs impaires, brillante postrit. 278. Et de mme que la deuxime est prfrable quinzaine la premire, ainsi l'aprs-midi vaut mieux que la matine funraire. pour (la clbration d'un) sacrifice 279. On doit accomplir en l'honneur des (la crmonie) Mnes ponctuellement, sans se lasser, la fin, suivant jusqu' les prescriptions, le cordon sacr pass sur l'paule droite, en marchant de gauche droite, l'herbe kousa (et) en tenant dans la main. 280. On ne doit point faire de sacrifice funraire pendant la nuit, car la nuit est rpute aux Dmons, ni (appartenir) 274. Quand l'ombre de l'lphant tombe l'Est, c'est--dire l'aprs-midi; l'lphant est mis ici par synecdoque. Suivant Vishnu, cit par Kull., cette dernire condition est requise au dfaut de la premire ; il faudrait donc traduire : Si ce n'est pas le treizime jour lunaire, en tout autre l'heure o, etc. . 277. Au lieu de arcan honorant , il y a une autre leon sarvn ; il faut sous-entendre alors l'ide exprime par ce verbe : (celui qui offre le rddha) tous les Mnes . 279. En allant de gauche droite : apasavyam est expliqu par Kull. pitrtrthena la partie de la main consacre aux Mnes.
LES LOIS DE MANOU
95
ni au moment aux deux crpuscules, qui suit le lever du> soleil. cette rgle, offrir ici-bas le sacrifice 281. On doit, suivant trois fois par an, en hiver, en t, en automne funraire, ; tous les sacrifices, (mais) celui qui fait partie des cinq grands jours. le sacrifice en l'honneur 282. L'oblation qui accompagne et la des Mnes, ne doit pas se faire dans un feu ordinaire, crmonie funraire (ne doit tre accomplie) par un Brahlune. mane entretenant le feu (sacr) qu'au jour de la nouvelle les Mnes 283. Un Brahmane qui aprs le bain satisfait toute la d'eau obtient par l-mme avec (une simple libation) aux du sacrifice de l'accomplissement (quotidien) rcompense Mnes. 284. On appelle Vasous les (Mnes de nos) pres, Roudras (ceux de nos) arriredityas (ceux de nos) grands-pres, le texte rvl ternel. ; ainsi (s'exprime) grands-pres le Vighasa, consommer 285. On doit toujours toujours l'Amrita est le reste d'un repas ; le Vighasa (funmanger le reste d'un sacrifice. raire), l'Amrita les cinq sacrifices vous a t 286. Tout le rituel concernant la manire la rgle concernant de expos ; coutez maintenant vivre des Brahmanes. 281. Trois fois par an est un minimum. Kull. dit : Qu'il fasse tous les mois le rddha rglementaire, ou dfaut de cela, la rgle est qu'il en fasse un tous les quatre mois . 284. Le texte rvl, c'est--dire la ruti. 285. Le reste d'un repas : Le reste de ce qui a t mang par les Brahmanes et autres . (Kull.)
LIVRE
QUATRIME : Subsistance, tude ou dfendus. permis du
du Matre de maison Les Devoirs aliments moraux, Vda, devoirs
1. Aprs tre rest le premier de son existence quart le Brahmane auprs de son prcepteur, ayant pris femme passera le deuxime quart dans sa propre maison. 2. Le genre de vie qui ne cause aucun tort aux cratures, ou qui en cause le moins possible, est celui que doit adopter le Brahmane, sauf en cas de dtresse. 3. Il doit amasser des biens autant qu'il est ncessaire sa subsistance par les occupations irrprochables qui lui sont sans fatiguer son corps. propres, 4. Il peut vivre du Rita et de l'Amrita, ou du Mrita ou du ou mme du Satynrita, mais jamais de la SvaPramrita, vritti. de glaner des grains et des pis; 5. Rita dsigne l'action Amrita c'est (ce qu'on reoit) sans l'avoir Mrita demand; l'aumne Pramrita sollicite; (c'est) au contraire dsigne l'agriculture. 3. Qui lui sont propres, svaih qui sont prescrites pour sa caste . (Kull.) 4. Ces termes techniques sont expliqus dans les vers suivants ; leur sens littral n'a aucune trace de rapport avec les ides qu'ils dsignent dans ce passage : rta c'est la vrit ; amrta l'ambroisie ; rnrta la chose morte, ou le mort ; pramrta signifie la mme chose que mfta, ou suivant l'interprtation de B. ce qui cause bien des morts , suivant L. substance trs mortelle ; satynrta signifie vrit et fausset ; vavrtti vie de chien 5. Unchaila : je considre ce mot comme un compos copulatif : les deux termes signifient glaner.
98 6.
LES LOIS DE MANOU
dont on peut vivre dsigne le commerce, Satynrita aussi la domesticit est appele la rigueur; Svavritti; (un doit-il l'viter. Brahmane) de grains suffisante 7. On peut avoir une provision pour son grenier, ou pour remplir une jarre, ou n'en avoir remplir pour que pour trois jours, ou enfin n'avoir aucune provision le lendemain. 8. Or de ces quatre Brahmanes matres de maison, (c'est) dans l'ordre chaque fois le dernier (qui) doit tre tenu pour comme tant celui qui) par sa vertu suprieur (au prcdent, le monde. a le mieux subjugu 9. L'un d'eux subsiste l'autre par par six occupations, enfin vit (par une seule qui trois, l'un par deux, le quatrime de la Sainte-criture. est) l'enseignement 10. Que celui qui vit en glanant des pis et des grains, l'entretien attentif du feu sacr, accomplisse seutoujours les sacrifices lement de lune et qui ont lieu aux changements aux solstices. 11. En aucun cas il ne doit pour subsister une poursuivre vie d'un Brahmane, mondaine; occupation qu'il vive del sincre et pure. droite, 6. Le commerce et l'usure . (Kull.) 7. Pour remplir son grenier : cette expression signifie suivant Kull. une provision de trois ans . Pour remplir une jarre une provision d'un an . Medh. dit : 11 peut avoir du grain et autres biens en quantit suffisante pour entretenir de nombreux domestiques, une pouse et tout ce qui s'ensuit durant trois annes. 8. Subjugu le monde, en d'autres termes a gagn le plus de mrite spirituel . C'est une locution courante de dire qu'un saint subjugue le monde par ses vertus . 9. Les six occupations, suivant Kull., sont glaner, recevoir l'aumne, la demander, le labourage, le commerce et l'usure cf. v. 5 et 6 et note 6. Suivant Medh. la sixime occupation est l'enseignement . Les trois occupations, sont, suivant Kull., enseigner, sacrifier, recevoir l'aumne. Les deux occupations sont, suivant Kull., sacrifier et enseigner . L'occupation unique, le Brahmasattra dsigne la rcitation quotidienne du Vda ou l'enseignement. 10. L'entretien du feu sacr, l'Agnihotra.
LES LOIS DE MANOU
99
le parfait 12. Celui qui dsire le bonheur doit chercher a pour contentement et dompter ses sens ; car le bonheur et le malheur racine le contentement, l'inverse. sorti de noviciat et qui mne l'un quel13. Un Brahmane noncs), doit remconque des genres de vie (prcdemment dont l'observation) lui assure le plir les devoirs (suivants, ciel, une longue vie et la gloire. 14. Il doit toujours, sans se lasser, remplir les obligations qui lui sont prescrites par le Vda, car celui qui les remplit dans la mesure de ses moyens atteint la condition suprme. ou dans le malheur, il ne doit pas 15. Dans la prosprit la richesse avec trop d'avidit, ni par des actes dchercher fendus, ni (accepter) de n'importe qui. 16. Qu'il ne s'attache aux objets des point par sensualit l'attachement excessif sens; qu'il rprime par la raison ceux-ci. du l'tude 17. Il doit fuir tous les biens qui empchent tre occup ) l'enseigner comme il conVda, et (toujours la ralisation de ses vient; car c'est l (ce qui lui procurera) dsirs. ses vtements, ses pa18. Il doit vivre ici-bas en mettant avec son ge, ses occuparoles, ses penses en conformit sa science et sa race. tions, sa fortune, 19. Il doit toujours avoir sous les yeux ces traits qui d13. Un Sntaka est celui qui a pris le bain final et qui est entr dans la catgorie des matres de maison. 14. La condition suprme dsigne ici comme ailleurs la dlivrance finale. ' 15. Prasangena avec avidit signifierait, suivant Kull., par des arts qui sduisent les hommes, tels que la musique et le chant . Le sens que j'ai adopt est autoris par le commentaire de Nr. 16. Par la raison, manas. B. traduit (en rflchissant leur indignit) dans son coeur . 17. Yathtath est traduit par le Dictionnaire de Saint-Ptersbourg comme il convient . D'autre part le commentaire l'explique par kena api upyena, par n'importe quel moyen . 19. Les traits interprtatifs du Vda : le mot nigama dsigne ici les
100
LES LOIS DE MANOU
la science, qui conduisent la richesse, veloppent rapidement duVda. les traits interprtatifs quisontprofitables, ainsique 20. Car plus un homme tudie les traits, plus il acquiert de science, et plus son savoir brille. 21. Il doit autant que possible ne jamais les sangliger crifices aux Sages, aux Dieux, aux tres, aux hommes et aux Mnes. le rituel, 22. Certaines gens connaissant accomplissent dans leurs organes constamment les (cinq) grands sacrifices des sens, sans faire aucun effort (extrieurement). 23. Les uns sacrifient constamment leur respiration dans leur parole, et leur parole dans leur respiration, voyant la rdu sacrifice dans (leur) parole et (leur) compense imprissable respiration. 24. D'autres Brahmanes, voyant par l'oeil de la science de ces sacrifices a pour base la science, que l'accomplissement les font toujours par la science seule. doit toujours offrir le sacrifice au feu 25. (Un Brahmane) et la fin du jour et de la nuit, et accomau commencement les sacrifices de la nouvelle plir la fin de chaque quinzaine et de la pleine lune. est puis, 26. Quand le grain (prcdemment recueilli) de grain nouveau ; la doit faire une oblation le Brahmane le sacrifice fin de chaque saison, il doit accomplir qui a lieu tous les quatre mois, l'poque du solstice offrir un animal Agas; par stra trait Manou a en vue les ouvrages sur la religion, les lois, la mdecine, l'astrologie, etc. 22. Extrieurement, c'est--dire pour les offrir extrieurement. 23. Pendant qu'un homme rcite un Brhmana (trait religieux), il est dans l'impossibilit de respirer, et alors il sacrifie sa respiration dans sa parole ; pendant qu'un homme respire, il est dans l'impossibilit de rciter, et alors il sacrifie sa parole dans sa respiration . (Kull.) 25. Les sacrifices de la nouvelle et de la pleine lune sont le dara et le paurnamsa. 26. L'oblation avec du grain nouveau est l'grayana; chaque saison est de quatre mois; le sacrifice qui a lieu tous les quatre mois (cturmsya) est appel ici adhvara.
LES LOIS DE MANOU
101
la fin de l'anne de soma. faire les offrandes domestique, 27. Un Brahmane les feux (sacrs), s'il dsire qui entretient vivre longtemps, ne doit pas manger du grain nouveau ou de la viande, avant d'avoir offert les prmices du grain nouveau et (sacrifi) un animal domestique. 28. Car ses feux (sacrs), avides de grain nouveau et de du grain s'ils n'ont pas t honors viande, par les prmices et par l'offrande dvod'un animal domestique, cherchent rer ses souffles vitaux. 29. Qu'aucun hte ne sjourne dans sa maison sans tre d'un honor autant d'une d'aliments, que possible sige, d'eau ou de racines et fruits. couche, 30. Les hrtiques, les gens qui ont des occupations dceux qui vivent comme des chats, les gens perfides, fendues, il ne comme des hrons, les sceptiques et ceux qui vivent mme d'une parole. doit pas les honorer aux offrandes 31. Il doit honorer (en leur donnant part) matres de destines aux Dieux et aux Mnes les Brahmanes avoir maison, instruits, aprs qui ont quitt leur prcepteur leurs voeux ; mais qu'il vite ceux tudi le Vda et accompli qui sont tout le contraire. un matre de maison doit donner 32. Selon ses moyens ceux qui ne cuisent pas pour eux-mmes (tels (des aliments) et attribuer ou les religieux mendiants), que les tudiants sans (toutefois) une part (tous) les tres, qu'il en prouve aucun dtriment. sorti de noviciat, tant 33. Un (Brahmane) par la press 28. Les souffles tsitauoe, prns, c'est--dire son existence. 30. Les gens qui vivent comme des chats sont les hypocrites. Cf. plus bas au v. 196, la dfinition de ceux qui vivent comme des hrons. 31. Peut-tre faut-il avec B. sparer pour le sens vedavidyvratasntn de rotriyn grhamedhinal et en faire deux termes diffrents : ceux qui sont devenus Sntakas^aprs avoir tudi le Vda ou accompli leurs voeux, (et) les matres de maison qui sont rotriyas (instruits) . 33. D'un roi de la caste des Kchatriyas . (Kull.) Yjya .une personne pour laquelle il sacrifie est traduit par d'autres le sacrificateur .
102
LES LOIS DE MANOU
des secours d'un roi, ou d'une faim, peut implorer personne il sacrifie, ou de son lve, mais d'aucun autre ; pour laquelle telle est la rgle. 34. Un (Brahmane) sorti de noviciat qui est en tat (de se sa subsistance) ne doit jamais se laisser prir de faim, procurer ni porter des vtements vieux ou sales, quand il a du bien. 35. Qu'il ait les cheveux, les ongles, la barbe coups, qu'il soit le matre de ses sens, qu'il porte des vtements blancs, l'tude du Vda et qu'il soit pur, constamment appliqu ce qui peut lui tre salutaire. 36. Qu'il porte un bton de bambou, un pot plein d'eau, un cordon sacr, une poigne d'herbe kousa et deux boucles d'oreilles brillantes en or. 37. Il ne doit point regarder il se lve ou le soleil quand il est clips, quand il se couche, quand quand il se reflte dans l'eau, ou quand il est son znith. 38. Il ne doit point enjamber la corde est atta( laquelle son image ch) un veau, ni courir quand il pleut, ni regarder dans l'eau ; telle est la rgle. 39. (En passant d'une vache, d'une prs) d'un monticule, clarifi ou de idole, d'un Brahmane, (d'un pot) de beurre d'un carrefour, ou d'arbres bien connus, il doit les miel, avoir sa droite. 40. Quelque dsir fougueux il ne doit point qu'il prouve, sa femme l'poque des rgles, ni coucher avec approcher elle dans le mme lit. 41. Car lorsqu'un homme une femme approche qui a ses force, vue, vitalit, rgles, sagesse, nergie, (tout) dprit (en lui). 42. (Mais) s'il vite sa femme quand elle a ses rgles, saforce, vue, vitalit, gesse, nergie, (tout) crot (en lui). 34. Se procurer sa subsistance par sa science ou par d'autres moyens . (Kull.) 40. Pramatta, littralement en rut ; propos de cette prescription cf. III, 45 sqq. 41. Tejas nergie signifie aussi gloire.
LES LOIS DE MANOU 43.
103
Il ne doit pas manger avec sa femme, ni la regarder elle est assise ternue, bille, ou quand quand elle mange, nonchalamment. 44. Un Brahmane ne doit point qui tient son nergie, sa (femme) du kohol sur les regarder lorsqu'elle s'applique yeux, quand elle se parfume d'essences, quand elle est sans ou quand elle accouche. vtement, 45. Il ne doit point prendre d'aliments n'ayant qu'un seul ni se baigner tout nu ; il ne doit point uriner sur vtement, une route, sur des cendres, ni dans un parc vaches, 46. Ni dans une terre laboure, ni dans l'eau, ni sur une ni dans un temple en pile de bois, ni sur une montagne, ruines, ni sur une fourmilire, 47. Ni dans les trous habits ni en par des tres vivants, ni debout, ni sur le bord d'un fleuve, ni sur la marchant, cime d'un mont. 48. Qu'il n'vacue d'excrments ou d'urine la face jamais tourne vers le vent, le feu, un Brahmane, le soleil, l'eau ou des vaches. 49. Qu'il dpose (ses excrments) aprs avoir couvert (le des feuilles, de l'herbe, sol) avec du bois, des mottes, et autres choses semblables, en retenant ses paroles, tant pur, le corps envelopp et la tte couverte. 50. Le jour il vacuera ses urines et ses excrments le tourn vers le Nord, la nuit la face tourne vers visage le Sud, aux deux crpuscules de la mme manire que le jour. 43. Suivant Kull. avec sa femme signifie dans le mme plat, ekaptre . 44. Le kohol ou poudre d'antimoine dont les femmes en Orient se peignent les paupires. 46. Citi pile de bois ou pile de briques (B.), ou bcher funbre . (L.) J'ai supprim kadoana en aucun temps qui m'a paru un remplissage. 47. Naditram sdya sur le bord d'un fleuve . Le grondif sdya est souvent employ comme quivalent d'une prposition, sur ou dans. Cependant B. lui donne toute sa valeur verbale en atteignant la rive .
104 51.
LES LOIS DE MANOU
soit de jour, soit-de ou dans l'obscurit, Dans l'ombre tourn le visage nuit, un Brahmane peut faire (ses besoins) dans la direction qui lui plat, comme aussi dans le cas o il craindrait pour sa vie. en face du de celui qui urine 52. Elle prit l'intelligence feu, du soleil, del lune, dans l'eau, en face d'un Brahmane, d'une vache, du vent. re53. Il ne doit point souffler sur le feu avec sa bouche, ni garder une femme nue, jeter dans le feu des immondices, s'y chauffer les pieds. 54. Il ne doit point placer (le feu) sous (un lit ou autre au ni le mettre ni marcher meuble par-dessus, semblable), pied (de son lit quand il dort), ni faire de mal tre qui vive. en route, ni se couni se mettre 55. Il ne doit ni manger, du crpuscule cher au moment ; il ne doit ni tracer des lignes sur la terre, ni ter la guirlande (qu'il porte). ni ni excrments, ni urine, 56. Qu'il ne jette dans l'eau ni sang, ni ni autre chose souille d'immondices, crachat, poisons. 57. Il ne doit point dormir seul dans une maison dserte, ni veiller quelqu'un qui dort, ni causer avec une femme qui sans tre invit. a ses rgles, ni aller un sacrifice au feu, dans un parc consacr 58. Dans l'emplacement le Vda, en de Brahmanes, en rcitant en prsence vaches, qu'il ait le bras droit dcouvert. mangeant, une vache en 59. Un homme sage ne doit point dranger la chose qui que ce soit; s'il voit train de boire, ni raconter 51. Lorsqu'il y a impossibilit de distinguer les rgions clestes. (Kull.) Il craindrait pour sa oie de la part des voleurs, des tigres et autres (Kull.) 55. Du crpuscule, du matin ou du soir. Oter sa guirlande : il ne doit point l'ler lui-mme, mais se la faire ter par un autre . (Kull.) 57. Quelqu'un qui dort quelqu'un qui lui est suprieur en richesse, en science, etc. . (Kull.) Sans tre invit sans tre choisi en qualit de prtre officiant . (Kull.) 59. B. traduit une vache qui allaite (son veau) . Kull. dit : une
LES LOIS DE MANOU
105
personne. au firmament, un arc-en-ciel qu'il ne le montre dans un village o la loi est n60. Il ne doit point habiter dans celui o les maladies longtemps glige, ni (sjourner) tout en route se mettre sont nombreuses ; il ne doit point sur une montagne. seul, ni rester longtemps dans un royaume 61. Une doit point rsider (gouvern de gens ni dans (une contre) qui pleine par) un Soudra, n'observent par les pas la Loi, ni dans celle qui est envahie ni dans celle qui est possde par des gens des hrtiques, plus basses castes. dont on a ex62. Il ne doit point manger (une substance) ni (prendre ses reoutre mesure, ni se rassasier trait l'huile, ni (manger) ou trop tard (le soir), pas) trop tt (le matin) dans la soire quand il a (trop copieusement) djeun. 63. Il ne doit faire aucun effort sans but, ni boire de l'eau sur des mets (placs) ni manger dans le creux de sa main, son giron ; il ne doit jamais tre curieux. d'un instruni chanter, ni jouer 64. Il ne doit ni danser, ni grincer (des dents), ni dans ment, ni claquer (des mains), la colre faire du tapage. de les pieds dans un bassin 65. Qu'il ne se lave jamais ni dans (un cuivre ; qu'il ne mange pas dans un plat cass, vase) d'apparence impure. un des vtements, 66. Il ne doit point porter des souliers, un ornement, une guirlande, un pot eau, cordon sacr, qui aient dj servi d'autres. vache qui boit de l'eau ou du lait , et il ajoute si elle boit le lait d'autrui, il ne doit point le dire celui dont elle boit le lait . L'arc-en-ciel, littralement l'arc d'Indra. 63. Curieuas sans motif . (Kull.) 61. Il ne doit pas excuter des danses, chants, ou morceaux de musique, non commands par les castras . (Kull.) 65. Vase d'apparence impure bhvapratidshite signifie litt. souill par nature. Le commentaire dit qui fait natre un doute dans l'esprit , c'est-dire de la puret duquel on n'est pas sr. A noter l'interprtation toute diffrente suivie par B. H. : Qu'il ne mange pas dans un plat cass, ni lorsque (son) esprit est troubl.
106 67. Qu'il
LES LOIS DE MANOU
mal ne voyage point avec des btes de somme extnues les dresses, par la faim ou la maladie, ayant les yeux ou les sabots endommags, ou bien la queue cornes, mutile. 68. Qu'il voyage toujours avec des (btes) bien dresses, des marques d'une couleur et portant propices, rapides, d'une forme irrprochables, et sans les stimuler beaucoup avec l'aiguillon. la chaleur de se 69. Il doit viter (du soleil) qui vient et un sige lever, la fume d'un cadavre (mis sur le bcher) bris ; il ne doit pas se couper (lui-mme) les ongles ou les ni se ronger les ongles avec les dents. cheveux, 70. Il ne doit point craser des mottes de terre ou arracher de l'herbe avec ses ongles; il ne doit faire aucun acte ou qui puisse avoir dans l'avenir des consquences inutile, fcheuses. 71. L'homme qui crase une motte de terre, qui arrache de l'herbe ou qui ronge ses ongles, court rapidement sa de mme qu'un dlateur ou une personne perdition, impure. 72. Il ne doit point raconter de mdisances, ni porter de monter sur le dos d'une vache extrieurement; guirlande est en tout cas un acte rprhensible. 73. Il ne doit point entrer dans un village ou dans une maison enclose (de murailles) autrement que par la porte ; la nuit il doit se tenir distance des racines d'arbre. 74. Il ne doit point jouer aux ds, ter lui-mme ses couch sur un lit, ou tenant chaussures, manger (ses aliments) dans sa main, ou (en posant le plat) sur un sige. 69. Bltapa, signifie littralement jeune chaleur . Kull. citant l'opinion de Medh. explique ainsi : pratharnoditdityatpa : il ajoute que d'autres entendent le soleil dans le signe de la Vierge . 70. Ecraser des mottes de terre sans motif . (Kull.) 72. Raconter des mdisances ou se chamailler. (B.) Extrieurement sa touffe de cheveux (Kull.), ou peut-tre extrieurement ses habits . Suivant d'autres commentateurs, en dehors de la maison . 74. Oter ses souliers, les porter avec la main dans un autre lieu . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
107
75. Aprs le coucher du soleil, qu'il ne prenne aucun aliment contenant des grains de ssame ; qu'il ne se couche nulle part sans s'tre rinc jamais ici-bas tout nu, qu'il n'aille la bouche. 76. Qu'il mange les pieds humides, mais qu'il ne se couche les pieds humides; car celui les pieds jamais qui mange humides atteint un grand ge. 77. Il ne doit jamais s'engager dans un lieu inaccessible et la vue ; il ne doit pas regarder des excrimpntrable ni passer une rivire ments ou de l'urine, avec (en nageant) les bras. 78. Il ne doit point marcher sur des cheveux, des cendres, des graines de coton ou des peautrs, des os, des tessons, existence. pour peu qu'il tienne une longue des Tchn79. Qu'il ne frquente point des gens dgrads, des gens de des fous, des orgueilleux, dlas, des Poulkasas, basse caste, des Antyvasyins. ni des ni un conseil, 80. Il ne doit donner un Soudra il ne doit destine aux Dieux; restes (du repas), ni l'offrande observance la Loi, ni lui imposer aucune point lui expliquer religieuse. la Loi ou 81. Car celui qui explique tombe vance religieuse un Soudra, (appel) Asamvrita. 82. Qu'il ne se gratte point la tte jointes, qu'il ne la touche pas avant de qu'il ne se baigne pas sans la (plonger qui impose une obseravec lui dans l'enfer avec les deux mains s'tre rinc la bouche, dans l'eau).
76. Les pieds humides, parce qu'il vient de prendre un bain de pieds ; en d'autres termes le bain de pieds doit prcder le repas, mais non le coucher. 77. Inaccessible, parce qu'il est embarrass d'arbres, de lianes et de ronces, et qu'il recle des serpents, voleurs et autres . (Kull. ) 79. Un Cndla est le fils d'un Soudra et d'une femme Brhman, cf. X, 12. Pulkasa (Joly) ou Pukkasa n d'un Nishda et d'une femme Soudra, cf.X, 18. Antyvasyin n d'un Cndla et d'une femme Nishd, cf. X. 39. 80. A un Soudra qui n'est pas son esclave . (Kull.) 82. Avant de s'tre rinc, littralement ayant encore des restes d'aliments en bouche .
108
LES LOIS DE MANOU
les cheveux 83. Qu'il vite (dans la colre) d'empoigner sa il a baign ou de donner des coups sur la tte ; quand avec de l'huile tte, qu'il ne touche aucun de ses membres de ssame. 84. Qu'il n'accepte rien d'un roi non issu de (caste) kchade d'un dbitant d'un fabricant d'huile, triya, d'un boucher, d'un lupanar. ni de celui qui vit (du produit) liqueurs, 85. Une presse huile est aussi (mauvaise) que dix bou huile, un lupanar une taverne cheries, que que dix presses dix tavernes, un roi (non kchatriya) que dix lupanars. 86. Un (tel) roi est tenu pour l'gal d'un boucher qui tienun prsent de lui est (chose) drait dix mille boucheries; horrible. 87. Celui d'un des prsents qui reoit de la Loi ira successivement : suivants roi avaricieux et dans les vingt
transgresseur et un enfers 88. Tmisra,
Andhatmisra, Mahraourava, Raourava, Klasotra, Mahnaraka, 89. Sandjvana, Mahvtchi, Tapana, Sampratpana, Potimrittika, Sakkola, Koudmala, Samghta, 90. Lohasankou, la rivire Slmal, Panthna, Ridjcha, et Lohatchraka. Asipatravana et 91. Des Brahmanes le Vda clairs, qui ont tudi la flicit dsirent cela, n'acceptent aprs la mort, sachant rien d'un (tel) roi. de maison) doit s'veiller au moment 92. (Le matre sur Brahme, rflchir sur la vertu et les richesses, consacr 83. Empoigner les cheoeuas les siens ou ceux d'un autre . (Kull.) Quand il a baign sa tte dans l'huile de ssame . (Kull.) Il est probable qu'au vers prcdent il s'agit aussi d'un bain d'huile. 84. On a vu plus haut qu'il y avait parfois des rois Soudras. Un dbitant de liqueurs, littralement celui qui a pour enseigne un tendard. 85. Joly imprime vey au lieu de vea, un roi est l'gal des prostitues ; mais la gradation est plus rgulire avec vea. 92. Le moment consacr Brahma : un muhrta est gal l/30e du jour, soit 48 minutes. Le brhmya muhrta est, suivant Kull., la dernire veille de la nuit .
LES LOIS DE MANOU les peines physiques entranent et sur la qu'elles du Vda. interprtation besoins 93. S'tant satisfait aux lev, ayant s'tant reste recueilli, longtemps purifi, qu'il le crpuscule murmurer du (la prire), pendant (il rcite de mme la prire) qu' l'autre crpuscule temps 94. vritable
109
naturels, debout et matin, en son
propre. Par de longues dvotions aux crpuscules, les sages une longue existence, la science, la rputation, la acquirent dans la connaissance du Vda. gloire et la supriorit 95. Aprs avoir accompli suivant la rgle (la crmonie (le jour de la pleine lune du mois) Srvana, dite) Oupkarman ou du (mois) de Praouchthapada, un Brahmane doit pendant assidment le Vda. quatre mois et demi tudier 96. Un Brahmane doit accomplir la (crmonie dite) des Vdas en dehors (du village) dans le (mois) l'Outsardjana ou au premier blanche du Paoucha, jour de la quinzaine (mois) Mgha dans la matine. en dehors (du village) l'Outsarga 97. Aprs avoir accompli des Vdas suivant du) Livre (des lois), il doit (les prceptes la lecture pendant une nuit prcde et suivie d'un suspendre ce jour et la nuit (qui le suit). jour, ou bien pendant
93. La prire : la gyatr. 94. La rputation pendant leur vie, la gloire aprs leur mort . (Kull.) 95. L'Upkarman, ainsi que le remarque B., est l'ouverture solennelle de la priode scolaire brahmanique, et l'Utsarjana ou Utsarga en est la clture . Le mois rvana tombe en juillet et aot, le mois Praushthapada ou Bhdrapada en aot-septembre. 96. Le mois Pausha tombe en dcembre-janvier, le mois Mgha en janvier-fvrier. Le texte porte Pushya et non Pausha. Suivant B.,Pushya dsigne le jour Pushya, c'est--dire le sixime jour lunaire de chaque mois ; il ajoute dans sa traduction entre parenthse du mois Pausha . Suivant L., ce mot dsigne le huitime astrisme lunaire. 97. Une nuit prcde et suioie d'un jour, littr. une nuit aile ; le jour de l'Utsarga la nuit qui suit et le lendemain, ou seulement le jour de l'Utsarga et la nuit qui suit.
110 98.
LES LOIS DE MANOU
Mais aprs cela il doit rciter assidment les Vdas les (quinzaines) brillantes et tous les Vdngas pendant les quinzaines obscures. pendant 99. Il ne doit pas rciter ou en prsence en bredouillant, de Soudras la dernire a rcit le Vda pendant ; lorsqu'il veille de la nuit, fatigu qu'il ne se rendorme pas (quelque) (qu'il soit). 100. Un Brahmane zl doit toujours rciter les parties (du Vda) suivant la rgle nonce mtriques plus haut, et, s'il n'a pas d'empchement, les Brhmanas et les Mantras. 101. Celui qui tudie des (le Vda) et qui l'enseigne lves conformment la rgle, doit toujours viter (de le faire dans) les heures o l'tude du Vda est interdite. 102. Quand et quand le vent se fait entendre la nuit, le jour il y a des tourbillons ce sont de poussire, pendant l, dans la saison des pluies, les deux (cas) o l'on doit susla rcitation du Vda : (tel est) l'avis de ceux qui pendre connaissent (les rgles de) la rcitation. 103. Quand il y a des clairs, et de la pluie, du tonnerre et quand il y a abondance de grands la rcitation mtores, mme mosuivant (doit tre suspendue), Manou, jusqu'au ment (du jour qui suit). 104. Si Ton voit ces (phnomnes) se produire (au moment des crpuscules), aprs que les feux ont t allums (pour le sache alors qu'il ne doit pas y avoir de sacrifice), qu'on hors de et de mme quand on voit des nuages rcitation, saison. 105. Quand il se produit un trembleun bruit surnaturel, ment de terre ou une clipse des corps clestes, qu'on sache 98. Les quinzaines brillantes et les quinzaines obscures sont dtermines par les phases de la lune. 100. Les parties mtriques, sont, suivant Kull., la gyatr et le reste . Le deuxime hmistiche porte brahman synon. de Veda que Kull. explique par Brhmana. Les Brhmanas sont des traits religieux composs pour et par les Brahmanes. Les Mantras sont des hymnes ou prires. 104. Hors de saison, hors de la saison des pluies . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
111
momme (doit tre suspendue) jusqu'au que la rcitation a lieu) dans ment (du jour qui suit), mme (si le phnomne la saison (des pluies). 106. Mais si les clairs et le bruit du tonnerre (se produila suspension doit durer sent) quand les feux sacrs flambent, aussi longtemps que l'clat (du soleil ou des toiles) ; si le troisime mentionns (des phnomnes plus haut se produit, il doit y avoir suspension) la fois le jour et la nuit. la perfection 107. Ceux qui dsirent du mrite spirituel la rcitation dans les villages et doivent toujours suspendre o (rgne) une mauvaise dans les villes, et partout odeur. 108. Dans un village o se trouve un cadavre, ou en prsence d'un (homme sans loi, comme un) Soudra, une quand ou au milieu d'une la runion de gens, personne pleure, rcitation (doit tre) suspendue. 109. Dans l'eau, minuit, quand on vacue ses excrments ou son urine, quand on n'a pas encore rinc sa bouche, ou quand on a pris part un repas funraire, qu'on ne mdite mme pas dans son esprit (sur le Vda). 110. Un Brahmane clair qui a accept une invitation un funraire en l'honneur d'une rcemment repas personne ne doit point rciter le Vda de trois jours; il en est dcde, le roi vient de mme d'avoir un fils ou qu'il y a une quand clipse. 106. Si l'clair et le bruit du tonnerre ont lieu au crpuscule du matin, la suspension doit durer autant que la lumire du soleil, autant que le jour; si ces (phnomnes) ont lieu au crpuscule du soir, la suspension doit durer autant que la lumire des toiles, autant que la nuit . (Kull.) Le troisime (cesha) : Sur les trois (phnomnes) mentionns plus haut, savoir clair, tonnerre, pluie, si le restant, le troisime, c'est--dire la pluie, se produit, il y a suspension aussi bien la nuit que le jour, le jour et la nuit . (Kull.) 110. Il s'agit ici d'une crmonie ekoddishta ; cf. III, 247. Quand le roi est staka, c'est--dire lorsqu'il se trouve dans l'tat d'impuret par suite de la naissance d'un fils. Une clipse, littralement : Quand Rhu apparat. Rhu est un dragon mythologique qui de temps autre se jette sur le soleil ou la lune pour les dvorer : de l les clipses.
112
LES LOIS DE MANOU
111. Aussi sur le corps d'un longtemps que subsistent clair Brahmane l'odeur et les taches et des (des aliments d'un repas funraire en l'honneur d'une parfums) personne rcemment il doit s'abstenir de la rcitation dcde, vdique. 112. Il ne doit point rciter le Vda les pieds couch, levs (sur un sige), ou avec une toffe jete sur les reins, ni aprs avoir mang de la viande ou du riz et autres (aliments) une naissance (ou une mort), 113. Ni quand il y a du brouillard, ni quand (on entend) ni pendant le bruit des flches, les deux crpuscules, ni la nouvelle ni le jour de lune, ni le quatorzime jour (lunaire), la pleine lune, ni le huitime jour (lunaire). 114. Le jour de la nouvelle lune tue le matre le spirituel, le huitime et le jour del quatorzime (jour tue) le disciple; le souvenir les pleine lune (tuent du) Vda ; aussi faut-il viter. 115. Un Brahmane ne doit point rciter (le Vda) quand il y a une pluie de sable, quand les rgions clestes sont en feu, un ne, ou un chaquand un chacal hurle, quand un chien, meau font entendre leur cri, ni enfin au milieu d'une compagnie. 116. Qu'il ne rcite point (le Vda) prs d'un cimetire, ni prs d'un village, ni dans un parc vaches, ni portant un vtement ses rapports ni aprs qu'il avait pendant conjugaux, avoir reu un prsent dans un sacrifice funraire. 117. Quel que soit le prsent reu un sacrifice funraire, tre vivant ou objet inanim, il ne doit pas, aprs l'avoir le Vda, rciter car on dit du Brahmane accept, que sa main est sa bouche. 111. Parf'ims, safran et autres . (Kull.) 112. Ou une mort : les personnes deviennent impures par suite d'une naissance ou d'un dcs. 117. Sa main est sa bouche: c'est--dire, le pch est gal de rciter le Vda aprs avoir reu (en les prenant dans sa main) des prsents un rddha, ou aprs avoir mang {en les mettant dans sa bouche), des aliments un rddha.
LES LOIS DE MANOU
113
118. Quand le village est envahi par des brigands, quand il y a une alarme cause par un incendie, qu'il sache que la mme moment rcitation doit tre suspendue (du jusqu'au jour qui suit), ainsi que (dans tous les cas) de prodiges. ou d'un Outsarga, il est 119. A propos d'un Oupkarman mais la rcitation trois nuits; de suspendre pendant prescrit ainsi qu'aux nuits qui teraux huitimes (lunaires), jours doit tre) d'un saison minent jour (la suspension chaque et d'une nuit. ni sur un le Vda cheval, 120. On ne doit pas rciter ni en bateau, ni sur un chameau, ni sur un lphant, arbre, ni sur un ne, ni quand on est sur un terrain strile, ni quand on est en voiture, ni pendant une une dispute 121. Ni pendant (verbale), ni une bataille, ni durant d'une arme, rixe, ni au milieu ni ni pendant une indigestion, aussitt aprs avoir mang, aigres, aprs avoir vomi, ni quand on a des renvois un hte, ni la permission 122. Ni sans avoir demand quand le vent souffle avec force, ni quand le sang coule d'un ni quand on a t bless par une arme. membre, rciter le Rig-Vda ou le Yadjour123. On ne doit jamais ni quand le chant du Sma-Vda, Vda, quand on entend un Vda, ou lu un ranyaka. on a termin 119. Upkarman : cf. v. 95. Trois nuits et trois jours. Les Hindous comptent par nuits aussi bien que par jours. Les saisons sont au nombre de six : vasanta le printemps, grshma l't, varsha la saison pluvieuse, arad l'automne, hemanta l'hiver, iira le froid. Kull. dveloppe ainsi le deuxime hmistiche : aprs le jour de la pleine lune du mois d'Agrahyana (novembre-dcembre), aux huitimes jours lunaires des trois quinzaines noires (subsquentes), etc. . 123. Les prires du Sma Vda, comme le remarque L., sont en vers et destines tre chantes, celles du Rig Vda sont en vers, mais doivent tre rcites ; celles du Yadjour Vda sont gnralement en prose. Aprs quand on a termin un Vda ou lu un Aranyaka Kull. ajoute : on doit attendre un jour et une nuit avant de commencer la lecture d'un autre Vda . Un ranyaka est un trait religieux destin tre lu dans la solitude des forts (aranya).
114
LES LOIS DE MANOU
124. Le Rig-Vda est consacr aux Dieux, le YadjourVda aux hommes, le Sma-Vda aux Mnes ; c'est pourquoi le son de ce dernier est (pour ainsi dire) impur. 125. Instruits de ces (choses) les Sages rcitent quotidiennement d'abord l'essence des trois (Vdas) dans l'ordre voulu, le Vda lui-mme. puis ils rcitent 126. Sachez qu'il faut suspendre la rcitation un jour et une nuit, si un animal une grenouille, un chat, domestique, un chien, un serpent, un ichneumon ou un rat passent entre (le matre et le disciple). 127. Il y a deux (cas) o un Brahmane doit toujours soila rcitation, la place gneusement suspendre (c'est) lorsque et (lorsque) lui-mme o il rcite est impure, n'est pas purifi. sorti de noviciat doit toujours tre 128. Un Brahmane au jour de la nouvelle lune, au (chaste comme) un tudiant, au jour de la pleine lune et au quahuitime jour (lunaire), torzime mme clans la saison (fixe pour les jour (lunaire), rapports conjugaux). 129. Qu'il ne prenne point de bain aprs le repas, ni tant ni au milieu de la nuit, ni plusieurs avec malade, reprises ses vtements, ni dans un tang inconnu. 130. Qu'il ne marche pas exprs sur l'ombre des (statues vdes) Dieux, ni sur celle (de son pre ou autre) personne ni sur celle d'un roi, d'un homme sorti de noviciat, nrable, de son prcepteur, d'un roux, d'un initi. 131. A midi et minuit, de la viande aprs avoir mang un repas funraire, ainsi qu'aux deux crpuscules, qu'il ne sjourne point dans un carrefour. 124. Le texte dit impur . Le commentaire adoucit l'expression par iva. Tout ce qui touche la mort ncessite une purification. 125. L'essence la syllabe mystique OM, les (trois) paroles (bhh, bhuvah et svah) et la Svitr . (Kull.) 128. Sur la saison fixe pour les rapports conjugaux, cf. III, v. 45 sqq. 130. Guru dsigne les parents, le prcepteur et gnralement ceux auxquels on doit le respect. D'un roua; : babhru dsigne peut-tre un animal de poil roux, notamment une vache rousse. Un initi au sacrifice .
LES LOIS DE MANOU
115
sur sur des onguents, 132. Qu'il ne marche pas exprs du sang, de ou des excrments, l'eau d'un bain, sur de l'urine du crachat ou du vomissement. l'humeur, 133. Qu'il n'honore l'ami d'un ennemi, point un ennemi, un pervers, un voleur ; (qu'il ne courtise du pas) la femme prochain. 134. Car en ce monde il n'est rien de si contraire une des relations avec la femme longue existence que d'avoir d'autrui. ne doit certainement 135. Celui qui dsire prosprer un serpent un Kchatriya, et un Brahmane jamais mpriser instruit, pour faibles (qu'ils soient). causer la mort de celui 136. Car ces trois (tres) peuvent un sage ne doit jamais m; c'est pourquoi qui les mprise priser ces trois (tres). 137. Qu'il ne se mprise pas lui-mme pour ses insuccs la mort la fortune, sans jusqu' passs, et qu'il poursuive de l'atteindre. dsesprer il doit dire des (choses) 138. Il doit dire la vrit; ni de ; il ne doit pas dire de vrits agrables dsagrables, ; telle est la loi ternelle. agrables mensonges bien ! ; 139. Qu'il dise bien ! bien ! ou simplement et qu'il ne qu'il n'ait pas d'inimitis pour des raisons futiles, se dispute avec personne. ni trop matin, 140. Qu'il ne voyage ni trop tard, ni en ni seul, ni avec un Soudra. plein midi, ni avec un inconnu, ni ceux qui ont un membre 141. Qu'il n'insulte de moins, de trop, ni ceux qui manquent ni ceux qui ont un membre ni les gens trs gs, ni ceux qui sont dpourd'instruction, ni ceux de basse extraction. vus de beaut ou de fortune, 132. Peut-tre simplement : qu'il ne se tienne pas en contact avec . 139. La premire partie de ce vers est obscure. L'interprtation de Nr. est celle-ci : Ce qui est bien, qu'il dise que c'est bien, ou qu'il appelle bien mme ce qui n'est pas bien : bhadram ity eva va 'bhadram api . Mais ce prcepte serait en contradiction avec celui du vers 138, il ne doit pas dire de mensonges agrables.
116
LES LOIS DE MANOU
en bouche des aliments 142. Un Brahmane qui a encore ou ne doit point toucher del main une vache, un Brahmane la foule des le feu ; il ne doit point, bien portant, regarder dans le ciel, (s'il n'est) pas purifi. corps lumineux il doit toujours 143. S'il a touch ces (tres) tant impur, d'eau ses organes des avec la paume de la main asperger et son nombril. sens, tous ses membres ne touche 144. A moins d'tre malade, qu'il pas sans la et "s'abstienne motif les trous de son (corps), (de porter secrtes. main) tous les poils (des parties) des usages qui portent bon145. Il doit tre observateur tre pur, matre de ses heur et des rgles de bonne conduite, et sacrifier au feu sans relche. murmurer (la prire) organes, les usages qui portent bonheur 146. Car lorsqu'on observe et les rgles de bonne conduite, qu'on est toujours pur, qu'on et qu'on fait les offrandes murmure (la prire), (au feu), on est l'abri du malheur. le Vda en 147. Qu'il rcite tous les jours, sans se lasser, dclarent temps voulu, car (les Sages) que c'est l le devoir ; tout autre est appel devoir accessoire. par excellence 148. Par l'tude constante du Vda, par la puret, par les de la vie des cratures, on a la austrits, par le respect de ses existences antrieures. rminiscence ses existences antrieures 149. (Celui qui) se rappelant tudier le Vda, continue obtient, par son application au Vda, une flicit ternelle. constante et de la pleine lune, il doit 150. Aux jours de la nouvelle Savitar et les rites propitial'offrande accomplir toujours 144. Les trous sont au nombre de neuf (d'o vient aussi que le mot trou dsigne figurinent le nombre neuf), savoir : les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, le mat urinaire, l'anus. 145. Mangalcrayukta : on peut faire, comme je l'ai fait, des deux premiers termes un compos copulatif, ou au contraire on peut y voir un compos de dpendance, et la traduction se rduit observateur des usages qui portent bonheur . 150. Le jour de la nouvelle lune et le jour de la pleine lune sont les jours
LES LOIS DE MANOU toires
117
honorer les Mnes au huitime ; il doit toujours (jour et au (jour) suivant. lunaire) 151. Loin de sa demeure il doit vacuer loin de sa l'urine, demeure loin aussi les restes (vider) l'eau du bain de pieds, d'aliments et la semence gnitale. 152. Au matin il doit dcharger son ventre, se peigner, se les dents, se mettre du kohol sur les yeux, et laver, se brosser adorer les Dieux. et de la pleine lune qu'il aille 153. Au jour de la nouvelle les (images des) Dieux, les Brahmanes le roi visiter vertueux, et les personnes leur proqu'il doit rvrer, pour (s'assurer) tection. 154. Qu'il salue avec respect les personnes ges, qu'il leur cde son propre sige, qu'il s'asseye auprs d'elles en joignant les mains et qu'il les suive quand elles s'en vont. observer les coutumes vertueuses 155. Il doit sans relche lies ses propres qui ont t compltement occupations, et par la tradition, dclares et qui sont la par la rvlation base de la loi (sacre). il obtient une longue 156. Par une conduite (vertueuse) la postrit vie, par elle (il obtient) dsire, par elle une les richesse dtruit ; la conduite imprissable (vertueuse) funestes. (effets des) marques appels Parvan. L'offrande Savitar (le Soleil), ou peut-tre l'offrande accompagne de la Svitr. Rites propitiatoires, nti, ou suivant d'autres expiatoires . 151. Kull. explique vasatha, demeure, par l'emplacement du feu sacr . Nisheka est expliqu par retas sperme : prcepte trange, car on ne peut supposer qu'il s'agisse d'une mission volontaire ; peut-tre faut-il entendre par l l'eau qui a enlev les traces d'une pollution involontaire. 152. Se peigner, ou peut-tre s'habiller, s'attifer . 153. Les personnes qu'il doit rcrer, ses gurus. 154. Enjoignant les mains, c'est--dire en faisant le salut appel anjali. 155. La rvlation et la tradition dsignent le Vda et le recueil des lois. 156. Les marques funestes, alakshanam, c'est--dire le malheur : la cause est mise ici pour l'effet.
118 157. monde
LES LOIS DE MANOU
mal est blm dans le Car un homme qui se conduit et ne jouit pas d'une malade, ; il est toujours infortun, existence. longue de toute marque 158. Mme s'il est dpourvu (annonant conduite l'homme d'une le bonheur) vertueuse, plein de foi et sans envie, vit cent annes. d'autrui 159. Qu'il vite avec soin tout acte qui dpend ; avec zle tout ce qui ne dpend au contraire qu'il s'applique que de lui-mme. d'autrui 160. Tout ce qui dpend (cause de) la peine, tout du plaisir de soi-mme ce qui dpend ; sachez que (donne) de la peine et du plaisir. c'est l en somme la dfinition celui qui le fait une satisfac161. Tout acte qui procure il doit l'accomplir avec zle; mais qu'il vite tion intime, (tout acte) contraire. 162. Qu'il ne fasse jamais de mal son matre spirituel, une le Vda, son pre, sa mre, celui qui lui explique aux Brahmanes, aux vaches, personne qu'il doit rvrer, un ascte. de l'athisme, des critiques sur le 163. Qu'il se garde de des Dieux, de la haine, de l'opinitret, Vda, du mpris de la colre, de la duret. l'orgueil, 164. Il ne doit point, dans la colre, lever le bton sur ni se livrer des voies de fait (sur personne), sauf sur autrui, il peut les frapper un fils ou un disciple ; ceux-l pour les corriger. menace seulement un Brahmane avec 165. Un Dvidjaqui Mais 162. Kull. mentionne ici l'opinion d'un autre commentateur: Govindarja, gnralisant la dfense de leur faire du mal, dit qu'il ne doit pas leur faire de mal, mme quand ceux-ci le menacent d'une arme , c'est-dire mme en cas de lgitime dfense. Toutefois cette opinion est contredite au v. 167, qui reconnat le droit de lgitime dfense. 163. L'athisme : le mot nstikya signifie littralement l'opinion qu'il n'y a pas un autre monde. (Kull.) Ce mot stambha, que j'ai traduit par opinitret, est interprt trs diversement par les autres traducteurs, hypocrisie (L.); fraude (B.H.); manque de modestie. (B.) 165. Seulement, mais qui ne le tue pas . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
119
l'intention de le blesser, Terrera cent annes dans l'enfer misra. 166. Si par colre il le frappe mme intentionnellement, avec un brin d'herbe, il renatra pendant vingt et une existences dans des seins (d'animaux de son) vils en punition Si dans sa folie il fait couler le sang du corps d'un sans avoir t attaqu Brahmane, aprs la par lui, il s'attire mort des souffrances terribles. 168. Autant le sang (vers) ramasse de pous(de grains) sire sur le sol, autant d'annes celui qui a vers ce sang est dans l'autre monde. dvor par d'autres (animaux carnassiers) 169. Donc un homme sens ne devra un jamais attaquer ni le frapper mme avec un brin d'herbe, ni faire Brahmane, couler le sang de son corps. 170. Le mchant, la fortune est illgitime, celui dont celui qui se complat faire sans cesse le mal, n'arrivent ici-bas. point au bonheur 171. Mme quand on est victime de son honntet, on ne doit jamais tourner son esprit vers l'iniquit, en voyant les soudains revers de fortune des gens injustes et pervers. 172. L'iniquit ici-bas ne produit pas toujours pratique des fruits immdiats, non plus que la terre, mais s'avanant elle coupe les racines de celui qui l'a commise. lentement, 173. Si (le chtiment ne l'atteint) pas lui-mme, (il atses petitssinon ses enfants teint) ses enfants, (du moins) commise ne reste jamais sans fruit pour enfants; l'injustice son auteur. 166. Ppayonishu, littralement dans des seins coupables , par exemple clans le sein d'une chienne ou d'autres animaux . (Kull.) 168. D'autres animaux; carnassiers, tels que chiens, chacals et autres . (Kull.) 170. Anrta, illgitime, signifie, suivant Medh. de la richesse acquise en faisant une dclaration mensongre dans un tmoignage pour le jugement d'un procs . 172. S'aeanant lentement : Claudo pede poena, dit une sentence bien connue. pch. 167.
120
LES LOIS DE MANOU
174. Il peut prosprer puis pour un temps par l'injustice, de ses ennemis ; mais ( la voir la prosprit, puis triompher la racine. fin) il prit jusqu' dans la dans la vrit, se complaire 175. On doit toujours on et dans la puret; dans une conduite vertueuse justice, et la Loi (sacre), conformment doit chtier ses disciples ses bras et son ventre. tenir en bride son langage, la Loi et les plaisirs 176. La richesse qui sont contraires doivent tre fuis, ainsi que tout (acte) mme qui lgitime et qui est rprouv entranerait par le plus tard des regrets, monde. de ses mains, de ne doit pas tre'actif 177. (Un Brahmane) ilnedoit tre ni dloyal ses pieds, de ses yeux (sans ncessit); ni en pense. ni bavard, et ne nuire autrui ni en action, dans le chemin des gens vertueux, 178. Qu'il marche il suivi son pre et ses anctres ; en le suivant qu'ont aucun mal. n'prouve de la maison, ou un prtre 179. Avec un prtre officiant un hte, un suborun oncle maternel, avec un prcepteur, avec un une personne donn, un enfant, ge ou infirme, et des parents avec des parents mdecin, paternels par ou des parents maternels, alliance, avec son 180. Avec son pre et sa mre, avec des parentes, il ne doit sa fille et ses esclaves, frre, son fils, sa femme, point avoir de contestations. toute contestation avec ces (personnes) 181. En vitant 175. Le texte dit ryavrtti, une conduite digne d'un rya, c'est--dire d'un Dvidja. Kull. explique ce mot par sadcra. 176. Comme exemple d'un acte mme lgitime Kull. cite le cas d'un homme charg de famille qui donnerait tout son avoir. Rprouv, ou peuttre qui ferait de la peine aux gens . 178. Suivant une autre interprtation na rishyate veut dire il ne fait aucun mal . 179. Rtvij prtre officiant, purohita prtre domestique. 180. Au lieu de avec son frre et son fils on peut entendre avec le fils de son frre . 181. Dcharg de tout pch, des pchs qu'il a commis son insu. (Kull. )
LES LOIS DE MANOU
121
un matre de maison est dcharg de tout pch ; en triomil conquiert tous les mondes suivants : phant de ces (querelles) 182. Le prcepteur du monde de Brahm, le est matre des cradans le monde du Seigneur pre est tout-puissant un prtre sacritures, un hte est matre du monde d'Indra, fiant du monde des Dieux ; 183. Les parentes du monde des Nymphes (disposent) les parents maternels de celui de tous les Dieux clestes, une mre de celui des eaux, runis, les parents par alliance et un oncle de celui de la terre; les pauvres et les infirmes, 184. Les enfants, les vieillards, un de l'air; doivent tre comme les seigneurs regards frre an est l'gal d'un pre, une femme et un fils sont les ; gaux du propre corps (de quelqu'un) sa est l'gal de son ombre, 185. L'esclave (de quelqu'un) fille est l'objet suprme de sa tendresse ; c'est pourquoi (mme) il doit supporter offens par (l'une de) ces (personnes), sans colre. (l'offense) il doit vi recevoir 186. Bien qu'autoris des prsents, des prter la propension ( en recevoir) ; car en acceptant la splendeur le Vda s'teint sents, que lui communique rapidement. 187. Un sage qui ne connat pas les rgles par prescrites la Loi pour l'acceptation des prsents, n'en doit point recevoir, ft-il press par la faim. un 188. Mais un ignorant de l'or, une terre, qui accepte un vtement, des grains cheval, une vache, de la nourriture, de ssame, du beurre est rduit comme en cendres clarifi, du bois (au feu). 189. L'or et les aliments dtruisent sa longvit, une 182. Le Seigneur des cratures Prajpati. 183. Les Nymphes ou Apsaras ; tous les Dieux runis, les Vivadevas. 185. L'esclave est compar l'ombre parce qu'il suit partout le matre Krpanani plus exactement objet de piti . 186. Autoris par sa science et sa saintet . (Kull.)
122
LES LOIS DE MANOU
ses yeux, terre et une vache son corps, un cheval les vteclarifi son nergie, les grains de ments sa peau, le beurre ssame sa postrit. 190. Un Brahmane ne qui ne pratique pas les austrits, des cadeaux, rcite pas le Vda, et est enclin recevoir s'enavec (le donateur), comme avec un bagloutit (dans l'enfer) teau en pierre dans l'eau. doit redouter 191. C'est pourquoi des l'ignorant d'accepter de n'importe un qui; car pour un tout petit prsent, prsents (dans l'enfer) comme une vache dans un ignorant s'engloutit bourbier. mme pas de l'eau 192. Celui qui connat la Loi n'offrira un Brahmane qui a les moeurs du chat, ni un Brahmane qui a les moeurs du hron, ni un Brahmane du Vda. ignorant 193. Car le bien mme lgitimement acquis que l'on donne dans l'autre ces trois (individus) monde et porte prjudice celui qui donne et celui qui reoit. 194. De mme que celui qui passe l'eau sur un bateau en ainsi l'ignorant et l'ignorant pierre s'y engloutit, qui donne tous les deux (dans l'enfer). qui reoit s'abment 195. Un homme qui dploie l'tendard de la vertu, tout en tant toujours avide, qui est hypocrite, qui dupe les gens, et qui calomnie tout le monde, doit tre qui est malfaisant considr comme ayant les moeurs du chat. 196. Un Brahmane aux yeux baisss, unimalhonnte, de ses intrts, et affectant une proccup perfide quement a les moeurs du hron. feinte douceur, 197. Les Brahmanes comme le hron, et ceux qui agissent du chat, tombent en punition de leur qui ont les manires dans (l'enfer conduite coupable appel) Andhatmisra. 198. Celui qui a commis un pch ne doit pas faire pnien se donnant en vue d'actence, l'apparence (d'agir 191. De n'importe qui, ou bien, suivant une autre interprtation, quel prsent . 192. Cf. v. 195 et 196. n'importe
LES LOIS DE MANOU
123
voilant ainsi son pch sous des qurir) du mrite spirituel, et en imposant aux femmes et aux Soupratiques pieuses, dras. 199. De tels Brahmanes sont blms aprs la mort et icibas par les exgtes du Vda, et le voeu accompli sous un va aux dmons. prtexte mensonger 200. Celui qui sans tre tudiant gagne sa vie en portant les insignes de (tous) d'tudiant, prend (sur lui) les pchs les tudiants ; il renat dans le ventre d'un animal. 201. On ne doit jamais se baigner dans l'tang d'un autre ; car en s'y baignant on se souille d'une partie des pchs de celui qui a creus l'tang. 202. Celui qui a fait usage d'un vhicule, d'un lit, d'un d'un jardin, d'une maison, sans que (le sige, d'un puits, les lui ait) donns, endosse le quart des pchs propritaire (de celui-ci). 203. On doit toujours ses bains clans des rivires, prendre dans des tangs creuss par les Dieux, dans des lacs, dans des fosss et dans des sources. les devoirs 204. Le sage doit constamment observer supmoindres les devoirs rieurs, mais non toujours ; car celui qui les premiers les seconds et accomplit seulement nglige dchoit. 200. Littralement celui qui sans (avoir le droit dporter des) insignes, vit en les portant ; le commentaire cite par exemple l'tudiant et les autres , et mentionne parmi les insignes usurps la ceinture, le bton, etc. 201. Une partie de ses pchs, le quart . (Kull.) 203. Les tangs creuss par les Dieux : expression un peu obscure ; peuttre naturels , ou encore, suivant l'interprtation de L., creuss en l'honneur des Dieux . 204. Les premiers s'appellent yama, les seconds niyama. Kull. citant l'opinion du lgislateur Yjilavalkya, range parmi les premiers la chastet, la compassion, la patience, la mditation, la sincrit, l'honntet, ne faire de mal personne, ne pas voler, la douceur, la temprance ; parmi les seconds le bain, le silence, le jene, le sacrifice, la lecture du Vda, la rpression des instincts sexuels, l'obissance au guru, la puret, l'absence de colre et l'attention . Je ne saisis pas bien la nuance entre la chastet, brahruacarya, et la rpression des instincts sexuels, upasthanigraha.
124 205.
LES LOIS DE MANOU
un sacrifice Un Brahmane ne doit jamais manger la science sacre, ni par une personne accompli trangre un sacrifice offert par un prtre de village, par une femme, ou par un eunuque. 206. Car l'offrande faite par ces personnes porte malheur aux gens de bien et dplat aux Dieux ; il faut donc s'en loigner. 207. Qu'il ne mange jamais (des aliments offerts par) des ou malades, renfermant des cheveux gens ivres, en colre et des insectes, ou qui ont t touchs volontairement avec le pied, 208. Ou qui ont t regards ou touchs par un avorteur, par une femme ayant ses rgles, ou becquets par les oiseaux, ou touchs par un chien, 209. Ou des aliments flairs par une vache, et particulirement ceux qui ont t offerts tout venant, ou les aliments ou par une courtisane, ou ceux (donns par) une communaut un homme instruit, que rprouve 210. Ou les aliments un musicien, (donns) par un voleur, un charpentier, un usurier, un initi (au sacrifice), un avare, un prisonnier dans les chanes, 211. Par un maudit, un eunuque, une femme impudique, un hypocrite, ou des (aliments) ou ceux aigris, de la veille, d'un Soudra, ou les restes (de quelqu'un), 205. Une personne trangre la science sacre, littralement non rotriya. Un prtre de village : B. traduit celui qui sacrifie pour une multitude de gens. 207. Iorcs, ou bien fous . Des cheaeux et des insectes ou bien des insectes de cheveux , c'est--dire des poux. 208. Bhrnaghna , avorteur, littralement tueur de foetus, serait suivant certains commentateurs l'quivalent de brahmaghna, meurtrier d'un Brahmane. 209. Offerts atout venant, ghushtnnani ; Kull. explique ainsi ce mot: Pour lesquels on a cri : qui veut en manger ? 211. Abhiasta, maudit : celui qui est en horreur tout le monde pour avoir commis un pch mortel . (Kull.)Eunuque ou hermaphrodite.On peut runir les deux derniers termes les restes d'un Soudra .
LES LOIS DE MANOU
125
un chasseur, 212. Ou les aliments (donns par) un mdecin, de restes, un homme un homme cruel, un mangeur violent, d'un homme ou les (aliments une femme en couches, qui ou avant les autres et) se rince la bouche, quitte le repas ne ceux (d'une personne) pour qui les dix jours (d'impuret) sont pas couls, de la 213. Ou les (aliments) offerts irrespectueusement, ou (les viande qui n'est pas traite suivant les prescriptions, aliments donns sans poux (ou sans fils), par) une femme par un ennemi, par (le seigneur d')une ville, par un homme de sa caste, ou ceux sur lesquels on a ternu, dgrad 214. Ou les aliments un (donns par) un calomniateur, un homme qui vend (la rcompense) des sacrifices, menteur, un danseur, un tailleur, un ingrat, un acteur, un orfvre, un Nichda, 215. Par un forgeron, un vannier, un armurier, 216. Par un leveur de chiens, un marchand de liqueurs, ou un teinturier, un homme un blanchisseur, malfaisant, un amant de celui dans la maison duquel (rside son insu) sa femme, un amant (de leur femme), 217. Par ceux qui tolrent qui les aliments sont constamment gouverns par leur femme, (donns pour) un mort avant que les dix jours (d'impuret) soient couls, ou des (mets) rpugnants. ceux 218. Les aliments (donns par) un roi tent l'nergie, ceux d'un d'un Soudra dans la science divine, la supriorit la renomme ceux d'un corroyeur orfvre la longvit, ; 212. Ltt. : des aliments pour lesquels le rincement de bouche a eu lieu . Une femme qui vient d'accoucher, stik, est impure pendant les dix jours qui suivent ; un dcs entrane galement dix jours d'impuret. 213. Vrthmmsa : j'ai traduit d'aprs le Dictionnaire de Saint-Ptersbourg. Kull. explique ce terme devatdim uddiya yannakrtam, qui n'a pas t prpare l'intention des divinits et autres . L. traduit de la viande qui n'a pas t offerte en sacrifice ; B. non mange pour un but sacr . 215. Nishda n d'un Brahmane et d'une femme Soudra. Cf. X, 8. 216. Malfaisant, nramsa ou un homme sans piti .
126
LES LOIS DE MANOU
219. Ceux (que donne) un artisan dtruisent la postrit, ceux d'un blanchisseur la force, ceux d'une et communaut d'une courtisane excluent des mondes ; (meilleurs) 220. Ceux (que donne) un mdecin sont (comme) du pus, ceux d'une femme impudique sont (comme) du sperme, ceux d'un usurier des excrments, ceux d'un armurier (comme) des immondices (comme) ; 221. Les aliments des autres (catgories) qu'on a successivement numres comme tant celles dont on ne doit pas sont, au dire des Sages, (l'quivalent) goter la nourriture, de la peau, des os et des poils. 222. Donc si l'on a mang sans intention des aliments d'une de ces (personnes, on doit s'imposer) un jene de quelconque trois jours ; si on en a mang en connaissance de cause, ainsi des excrments ou de l'urine, on doit faire la que du sperme, pnitence simple. 223. Un Brahmane instruit ne doit pas manger les mets cuits (apprts par) un Soudra qui n'accomplit pas de Srdil peut accepter dhas ; mais, dfaut (d'autre) de ressource, crus en quantit lui (des aliments) suffisante pour une nuit. et les dfauts) 224. Car les Dieux ayant pes (les qualits avare et d'un usurier ont dclar d'un thologien gnreux, la nourriture (donne) par l'un et par l'autre quivalente. venant eux a dit: Ne des cratures 225. Le Seigneur faites pas gal ce qui est ingal ; car la nourriture (donne est purifie gnreux par la foi ; (celle de) par) l'homme l'autre est souille par le manque de foi. 221. Au lieu de ete ' nye, B. H. lit ebhyo ' nye autres que celles qui ont t mentionnes . 222. La pnitence simple est appele krcchra; cf. XI, 212.Ainsi que du sperme: il vaudrait peut-tre mieux traduire, comme L., de mme que si l'on avait got de la liqueur sminale . 224. Un thologien, unrotriya. 225. On peut fermer les guillemets aprs ce qui est ingal.
LES LOIS DE MANOU
127
avec foi les 226. On doit toujours sans relche accomplir avec foi et au car accomplis sacrifices et les oeuvres pies; ces deux (actes) acquises, moyen de richesses lgitimement sont (la source de rcompenses) imprissables. tant le devoir de libralit, 227. Qu'on observe toujours dans les sacrifices que dans les oeuvres pies, avec des sentil'on de ses moyens, ments de joie, dans la mesure lorsque les dons). trouve un vase (digne de recevoir on vous demande, donnez 228. Quand quelque toujours ; car il se trouvera chose, si peu que ce soit, (et) sans rechigner de les dons) qui vous dchargera un vase (digne de recevoir tout pch. de la satisfaction 229. Celui qui donne de l'eau obtient ; un bonheur celui celui qui donne des aliments, imprissable; de ssame, dsire ; celui la postrit qui donne des grains yeux ; qui donne une lampe, d'excellents 230. Celui qui donne de la terre, obtient de la terre ; celui qui donne de l'or, une longue vie ; celui qui donne une maison, de magnifiques habitations de l'argent, ; celui qui donne une beaut ; suprieure 231. Celui qui donne un vtement une place dans (obtient) le monde de Tchandra ; celui qui donne un cheval, une place dans le monde des Asvins ; celui qui donne un taureau, une grande fortune ; celui qui donne une vache, (une place dans) le monde du Soleil ;
226. Les oeuvres pies : creuser un tang de lotus, une source, faire une fontaine, un jardin de plaisance . (Kull.) 228. Ptra un vase, c'est--dire une personne digne de recevoir les bienfaits. 229. La satisfaction par l'exemption de la faim et de la soif . (Kull.) 230. Calemboursur rpya, argent (conserv dans le mot roupie) et rpa beaut. 231. Candra est le Dieu Lunus ; autre jeu de mots sur ava cheval et Avin : les deux Avins, fils du soleil, sont les Dioscures des Grecs. La corrlation d'un certain nombre de ces termes est fonde sur des consonances ; le rapport qui unit les autres est peu intelligible pour nous.
128 232.
LES LOIS DE MANOU
Celui qui donne une voiture ou un lit (obtient) une la souverainet ; celui pouse ; celui qui donne la protection, ternel ; celui qui donne le qui donne du grain, un bonheur avec Brahme. Vda, l'galit 233. Le don du Vda surpasse tous les autres dons : eau, aliments, vache, terre, vtement, grains de ssame, or, beurre clarifi. 234. Quelle dans laquelle on fait un que soit l'intention suivant cette don quelconque, on en recevra (la rcompense) intention (dans une autre vie), avec les honneurs (qu'on mrite). et celui qui donne 235. Celui qui reoit respectueusement au ciel ; dans le cas vont l'un et l'autre respectueusement en enfer. contraire (ils tombent) dire un 236. On ne doit pas tirer vanit de ses austrits, les Brahmanes mme mensonge aprs avoir sacrifi, injurier ce qu'on a donn. offens par eux, ni publier 237. Par le mensonge le sacrifice est ananti, par l'orgueil des austrits est perdu, aux (le mrite) par les outrages Brahmanes la longvit, le (fruit du) don. et par l'ostentation 238. Sans faire de mal aucune on doit accucrature, muler de la vertu petit petit, comme les termites (font) leur afin un compagnon dans l'autre fourmilire, (d'obtenir) monde. 239. Car dans l'autre monde ni pre, ni mre, ni enfants, ni femme, ni parents ne sont l pour (vous servir de) compagnons ; la vertu seule vous reste. 240. Chacun nat seul, meurt seul, recueille seul (le fruit) de ses bonnes et seul (le chtiment) de ses mauactions, vaises. 232. Celui qui donne le Vda est le prcepteur. Jeu de mots sur Brahman qui signifie la fois Vda et Brahme. L'galit avec Brahme signifie l'union avec Brahme. 234. L'intention : soit par dsir d'obtenir le ciel, soit sans aucune vue intresse . (Kull.) 238. Dharma, vertu ou mrite spirituel.
LES LOIS DE MANOU 241.
129
Laissant le cadavre terre comme un morceau de bois, ou une motte de terre, les parents (du dfunt) s'en vont la face ; sa vertu (seule) suit (son me). en dtournant 242. Qu'il ne cesse donc d'accumuler petit petit la vertu (dans l'autre pour (avoir) un compagnon vie) ; car avec la vertu pour compagne, on traverse les tnbres impntrables (de l'enfer). 243. Elle conduit rapidement dans l'autre monde, rayonnant et revtu d'un corps thr, l'homme qui a eu pour objet le devoir, et qui a effac ses pchs par la pnitence. principal 244. Celui qui dsire lever sa ligne, doit toujours contracter des alliances avec les gens les plus minents, et viter tous les gens vils. 245. Un Brahmane s'allie avec les gens les qui toujours et vite les gens infrieurs, atteint le premier plus minents, la condition de rang ; dans le cas contraire (il descend) Soudra. 246. Un homme ferme dans ses entreprises, doux, patient, avec les gens de moeurs cruelles, et qui n'a point commerce ne fait aucun mal (aux cratures), grce une telle conduite, le ciel par sa continence et sa libralit. conquiert 247. Il peut accepter de tout le monde du bois, de l'eau, des racines et fruits, des aliments non sollicits, ainsi que du miel et l'offre d'une protection. des cratures a dclar que les aumnes 248. Le Seigneur et offertes, sans avoir t pralablement sollicites, apportes mme d'un pcheur. peuvent tre acceptes annes les Mnes ne mangent 249. Pendant quinze pas de (l'homme) ces (aumnes), et (les offrandes) qui ddaigne le feu ne porte pas (son) oblation (vers les Dieux). 250. Il ne doit point rejeter (les dons tels que) : un lit, une des parfums, de l'herbe de l'eau, des fleurs, kousa, maison, 249. Le feu est considr comme vhicule de l'oblation du sacrifice, parce qu'il s'lve vers le ciel. 250. Qui ont t donns sans qu'on les ait demands. (Kull.) 9
130
LES LOIS DE MANOU
du poisson, des pierres du lait suri, des grains, prcieuses, du lait, de la viande et des lgumes. 251. Dans le dsir d'assister les personnes qui ont droit ou bien son respect, ou celles qui sont dans sa dpendance, les Dieux ou des htes, il peut accepter (des pour honorer de n'importe prsents) qui ; mais il ne doit pas en profiter lui-mme. 252. Mais si ses parents sont morts, ou s'il vit spar d'eux dans (une autre) maison, il doit, lorsqu'il cherche sa subsisdes gens de bien. tance, l'accepter (seulement) 253. Un mtayer, un ami de la famille, un bouvier, un les Soudras esclave, un barbier, (ceux) dont il (sont) parmi les aliments, ainsi que celui qui s'offre (pour peut manger entrer son service). 254. (Ce dernier) doit en se prsentant faire connatre il est, ce qu'il dsire faire, et comquelle sorte de personne ment il entend le servir. 255. Celui qui se donne auprs des gens de bien pour un autre est rellement, est le plus grand des que ce qu'il sur terre : c'est un voleur, de perun usurpateur pcheurs sonnalit. 256. Toutes choses sont fixes par la parole, ont pour racine la parole, de la parole ; donc celui qui vole procdent la parole est un (homme) qui vole tout. 257. Aprs s'tre acquitt suivant la rgle de ses devoirs envers les grands les Mnes, et avoir les Dieux, Saints, 251. Les personnes qui ont droit son respect sont ses gurus : pre, mre, etc. . (Kull.)Celles qui sont dans sa dpendance sont sa femme et autres . (Kull.) 253. L. entend tout diffremment le mot bhojynna : Ceux qui peuvent manger la nourriture qui leur est donne par ceux auxquels ils sont attachs . 254. Quelle sorte de personne il est : quelle est sa famille, quel est son caractre, etc. . (Kull.) 257. Ses devoirs envers les Saints par la lecture du Vda, envers les Mnes par la procration d'un fils, envers les Dieux par les sacrifices . (Kull.) Le fils est destin accomplir aprs sa mort les rddhas. Ma-
LES LOIS DE MANOU
131
transmis tout (son avoir) son fils, on doit demeurer (dans la maison) dtach (des choses terrestres). 258. On doit constamment mditer seul et l'cart sur (ce l'me ; car celui qui mdite dans la solitude qui est) salutaire atteint la flicit suprme. 259. Voil la rgle constante de conduite d'un Brahmane matre de maison, et les prescriptions concernant celui qui est en sorti de noviciat ; (elles sont) une source d'accroissement saintet et (sont) louables. 260. Un Brahmane instruit dans les livres saints, qui se ces rgles, et qui continuellement conforme dtruit (en lui) le pch, sera glorifi dans le monde cle Brahme. dhyastham sthitah, littralement arriv rindiffrence.Kull. commente ainsi cette expression : dtach de son fils, de sa femme, de ses richesses, etc., et toutes ses penses tournes vers Brahme .
LIVRE
CINQUIME
Aliments et dfendus permis ; Causes d'impuret et Purifications des femmes. ; Devoirs
1. Ayant du Brahmane entendu cet expos des devoirs sorti de noviciat, les Sages dirent au magnanime Bhrigou qui du feu : procde 2. Seigneur ! Comment la mort a-t-elle prise sur les Brahmanes leurs devoirs comme il a t dit, qui accomplissent et qui connaissent les livres vdiques ? 3. Le vertueux fils de Manou, ces Bhrigou, rpondit Sages : coutez pour quelles fautes la mort cherche grands dtruire l'existence des Brahmanes. 4. (C'est) pour leur ngligence rciter le Vda, leurs infidlits la rgle de conduite, leur paresse leurs ( remplir leurs des aliments devoirs), pchs (contre l'abstinence) dtruire les Brahmanes. (dfendus, que) la mort cherche 5. L'ail, l'oignon, les champignons, ne doivent l'chalote, tre mangs non plus que (tous les point par les Dvidjas, dans l'impuret. vgtaux) poussant 6. La sve rouge des arbres, et (les sucs) provenant d'une le (fruit du) selou, le lait d'une vache qui vient de entaille, tre soigneusement vits. vler, doivent 1. Du Brahmane sorti de noviciat, c'est--dire du matre de maison. 2. Vedastra peut s'entendre aussi comme compos copulatif les Vdas et les Castras (traits) . Comment, etc., S'il n'y a pas eu ngligence des devoirs, ce qui est la cause de la brivet de la vie. (Kull.) 6. elu, Cordia myxa.
134
LES LOIS DE MANOU
7. Un plat de riz et de grains de ssame, du samyva, du riz au lait, un gteau de fleur de farine, qui n'ont pas t ainsi que des viandes offerts une divinit, non consacres, la nourriture aux Dieux, et les offrandes, (destine) 8. Le lait d'une vache qui a vl dans les dix jours qui d'une chamelle ou d'un solipde, d'une brebis, prcdent, d'une vache en chaleur ou qui a perdu son veau, 9. (Celui) de toutes les btes sauvages, sauf le buffle, le lait de femme et tous les liquides doivent tre vits. aigris 10. Parmi les (liquides) le lait aigris, on peut consommer avec lui, ainsi que les (subssr, et tout ce qui a t prpar des fleurs, racines et fruits purs. tances) extraites 11. On doit s'abstenir de tous les oiseaux de proie, des oiseaux dans les villes, des solipdes non permis qui vivent (par le Vda), ainsi que de l'oiseau tittibha, 12. Du moineau, de la foulque, du flamant, de l'oie, du de la grive, du coq de bruyre, du pivert, du coq domestique, de la corneille, perroquet, 13. Des oiseaux qui frappent avec le bec, des palmipdes, des vanneaux, des oiseaux avec leurs serres, qui dchirent des plongeons, des oiseaux ichtyophages ; (on doit s'abstenir ou de viande sche, aussi) de viande frache 14. Du hron, du marabout, du corbeau, du hochequeue, 7. Samyva gteau prpar avec du beurre clarifi, du lait, du sucre, et de la farine de froment . (Kull.) Qui n'ont pas t offerts une divinit, littralement prpars en vain . Viandes non consacres qui n'ont pas t asperges d'eau en rcitant des prires . (Kull.) La nourriture destine aux Dieux appele naivedya. 11. Cet oiseau est le Parra jacana. 12. Foulque : littralement nageur (lequel?). damant, harp.sa,Phoenicopterus roseus ou cygne. L'oie : Anas casarca ou le coucou (?). Le coq domestique : littralement coq de village . Grue : littralement oiseau de marais (lequel?). Bien entendu nous ne garantissons pas l'identification de tous ces noms d'oiseaux. 13. On peut runir plongeons au terme suivant : les oiseaux qui plongent pour manger le poisson . 14. Animaux mangeurs de poissons : sans doute les outres et autres du mme genre.
LES LOIS DE MANOU
135
des (animaux) de poissons, du porc domestique et mangeurs de toute sorte de poissons. 15. Celui qui mange la viande (d'un animal) quelconque est dit le mangeur de cet (animal), celui qui mange du poisson est un mangeur de toute (sorte donc de) viande ; on doit s'abstenir du poisson. 16. Mais on peut manger le silure et le cyprin, ils quand sont- employs aux Dieux ou aux Mnes ; pour une offrande du poisson et (on peut) aussi (manger) ray, du sinhatounda du sasalca en toute circonstance. 17. Qu'on ne mange pas de quadrupdes ou d'oiseaux solitaires ou inconnus, ni d'animaux cinq ongles, quand mme ils ont t dsigns parmi ceux qu'on peut manger. le hrisson, le rhinocros, la 18. Le porc-pic, l'iguane, sont parmi les animaux cinq ongles ceux tortue, le livre, tre mangs, ainsi que les animaux qu'on dclare propres de dents qu' une mchoire, le chameau n'ayant except. 16. Poisson ray : (lequel?); les deux autres espces sont tout fait inconnues. Ce vers peut s'entendre de deux manires : ou bien les deux premires espces sont permises seulement dans un repas en l'honneur des Dieux ou des Mnes, et les trois autres en toute occasion ; c'est le sens qne j'ai adopt ; ou bien on peut, comme le fait B. H., comprendre le pthna et le rohita employs dans les offrandes aux Dieux et aux Mnes, le rjva, le simhatunda et le saalka aussi peuvent tre mangs en en toute occasion . 17. A quoi bon les avoir permis pour les dfendre ensuite ? Cette restriction s'applique peut-tre seulement aux solitaires ; quant aux inconnus, comment dcider s'ils sont permis ou dfendus? La traductiou de L. serait trs satisfaisante, si elle ne modifiait pas un peu le texte, bien qu'ils ne soient pas au nombre de ceux qu'on ne doit pas manger ; c'est--dire que, en dehors des catgories prohibes prcdemment, il est encore dfendu de manger les animaux solitaires, inconnus, ou pourvus de cinq ongles (sauf, pour ces derniers, l'exception signale au vers suivant). 18. Iguane, ou suivant L. le crocodile du Gange . Le rhinocros n'a que trois ongles ; le chameau est dpourvu effectivement des incisives de la mchoire suprieure, ce qui expliquerait l'expression une range de dents ; mais quels sont les autres dsigns ici, en dehors du chameau ? Ce trait caractristique n'existe que chez les lamas, vigognes et alpagas, apparents au chameau ; or, ce sont des animaux du Nouveau Continent.
136 19.
LES LOIS DE MANOU
sciemment du champignon, Le Dvidja qui mange du de l'ail, du coq domestique, des oignons, porc domestique, des chalotes est dchu de sa caste. une de ces six (choses) 20. Celui qui son insu mange devra faire (une pnitence ou la pnitence dite) sntapana, lunaire des asctes ; pour d'autres il (aliments dfendus) devra jener un jour. une pni21. Une fois l'an un Brahmane accomplira se purifier des aliments tence pour (prohibs) (simple) ceux (qu'il aurait sans le savoir ; pour a qu'il mangs faire une pnitence) sciemment (il devra partimangs) culire. et les oiseaux 22. Les prescrits (comme quadrupdes tre tus par les Brahmanes peuvent propres tre mangs) de ceux comme aussi pour la subsistance en vue du sacrifice, d'eux ; car Agastya (le) fit jadis. qui dpendent 23. En effet il y avait des gteaux sacrs (faits avec la de manet oiseaux qu'il est permis chair) des quadrupdes anciens ainsi que dans les offrandes ger, dans les sacrifices et les Kchatriyas. (faites par) les Brahmanes mme datant de la veille, 24. Tout aliment non prohib, ml de la graisse, peut tre mang, ainsi que les restes de l'offrande. 25. Tous les (mets) faits d'orge et de bl, ainsi que ceux avec du lait, peuvent tre mangs prpars par les Dvidjas, mme quand ils datent d'un certain temps, et sans tre mlangs avec de la graisse. 26. Telle est la liste complte des aliments ou dpermis la rgle fendus aux Dvidjas ; je vais maintenant exposer des viandes. concernant l'usage ou l'abstention 20. Pour ces pnitences cf. XI, 212, 213, 219. Un jour et une nuit. 21. La pnitence simple est appele Krcchra. 22. Agastya, fameux Richi, auteur prtendu de plusieurs hymnes du Rig Vda et hros des popes du Mahbhrata et du Rmyana. 24. L'offrande de beurre clarifi appele havis.
LES LOIS DE MANOU 27.
137
On peut manger a t conde la viande aprs qu'elle et quand au dsir des Brahmanes, sacre, et (pour complaire) la vie est en on a reu l'autorisation ou quand rgulire, danger. 28. Le Seigneur a cr tout cet (univers) des cratures ; tout ce qui est inanim pour (tre) le soutien de l'existence et anim est le soutien de l'existence. aux (tres) 29. Les (tres) inanims servent de nourriture les (animaux) de crocs ceux qui en sont anims, dpourvus les (animaux) sans mains ceux qui en ont, les pourvus, celles qui ont du courage. timides (cratures) dont 30. Celui qui mme chaque jour mange les animaux la viande est permise ne commet de fautes ; car le point Crateur a fait aussi bien les cratures tre mandestines ges que ceux qui les mangent. 31. Manger de la viande (seulement) au sacrifice , cette celle des Dieux ; c'est pourquoi (de rgle est dclare l'usage la viande) en toute autre circonstance est appel la coutume des Dmons. 32. Celui qui mange de la viande les avoir honor aprs Dieux et les Mnes, ne commet aucun pch, soit qu'il l'ait ou qu'il ait tu lui-mme achete, (l'animal),ou qu'elle lui ait t donne par un autre. 33. Un Dvidja connaissant la Loi, moins de ncessit ne doit pas manger de viande contrairement la absolue, la rgle, il sera aprs contre sa rgle ; car s'il en mange 27. Consacre, c'est--dire asperge d'eau bnite avec rcitation des prires ou mantras.Autorisation : Dans des crmonies religieuses o l'usage de la viande est prescrit, telles que le rddha, le madhuparka. (Kull.) Sur le madhuparka cf. note du vers 41. 29. De crocs : les crocs sont le signe caractristique des carnassiers. 30. Dont la viande est permise : littralement : mangeables, dya . Peut-tre le sens est-il destins tre sa nourriture. 32. Honorer les Dieux, c'est leur offrir une part des aliments. Qu'il ait tu lui-mme : le terme utpdya est vague. D'autres entendent par l qu'il a obtenue lui-mme ou qu'il a leve lui-mme . 33. Sans merci : littralement : malgr lui .
13S
LES LOIS DE MANOU
mort dvor sans merci par les (animaux qu'il a mangs). 34. Le crime d'avoir tu des btes sauvages en vue d'un moins dans l'autre profit est (considr comme) vie, grave celui d'avoir de la viande sans que un motif mang religieux. 35. Au contraire l'homme conformment au rite, pri de la viande (dans une crmonie requi refuse de manger devient ligieuse) aprs sa mort un animal pendant vingt et une existences successives. 36. Un Brahmane ne doit jamais manger d'ani(la chair) maux non consacrs en se par les prires ; mais qu'il mange conformant la rgle ternelle consacre (la viande) par les prires. 37. S'il a envie (de viande), un animal avec qu'il fabrique de la graisse ou de la fleur de farine ; mais qu'il ne dsire sans un motif (religieux). jamais tuer un animal 38. Autant il y a de poils sur la bte, autant de fois celui une mort violente dans ses qui l'a tue sans motif endurera existences successives aprs la mort. 39. C'est l'tre existant par luirmme qui a cr les animaux en vue du sacrifice ; le sacrifice la (est institu) pour la prosprit de tout cet (univers) ; c'est pourquoi le meurtre n'est pas un meurtre. (commis) pour le sacrifice 40. Les plantes, le btail, les arbres, les animaux, les oiseaux gorgs en vue du sacrifice renaissent dans des existences suprieures. 41. Lorsque de miel, (l'on offre un hte) la mixture ou une offrande aux Mnes et aux (qu'on fait) un sacrifice on doit gorger des animaux, et non Dieux, alors seulement dans aucune autre occasion : ainsi l'a proclam Manou. 34. En vue d'un profit, fait allusion au chasseur de profession. 37. Sans un motif, c'est--dire sans destination aux divinits et autres . (Kull.) 40. Parmi les animaux Kull. mentionne les tortues et autres . 41. Le madhuparka est un plat que l'on offre un hte, et qui est fait d'un mlange de lait suri avec du miel et du beurre.
LES LOIS DE MANOU 42.
139
sens du Vda, Un Dvidja connaissant le vritable qui et luil'animal gorge un animal pour cette fin, fait entrer mme dans la flicit suprme. 43. Qu'il habite dans sa (propre) maison ou chez son matre ou dans la fort, d'un caractre un Dvidja spirituel, gnreux ne doit pas, mme en cas de dtresse, commettre aucune violence (sur un tre anim) par le qui ne soit autorise Vda. 44. Sachez que le mal (fait) aux tres anims et inanims, et prescrits n'est pas (dans les cas) autoriss par le Vda, du mal, car c'est du Vda la Loi proprement que dcoule morale. 45. Celui qui fait du mal des cratures inofensives pour son plaisir, ne prospre ni pendant sa vie, ni aprs sa mort. 46. Celui qui ne cherche pas faire souffrir aux cratures la captivit ou la mort, (et) dsire le bien de tous les (tres), obtient la flicit suprme. russit sans 47. Celui qui ne fait de mal aucun (tre), difficult dans toutes les choses qu'il projette, qu'il entreil attache son plaisir. prend, et auxquelles 48. On ne peut se procurer de viande autrement qu'en faides animaux, sant violence aux tres anims, et le meurtre s'abstenir de donc d'obtenir le ciel; on doit empche viande. la provenance de la chair, (qu'on ne peut 49. Considrant 44. Niyat peut tre rapport carcare, le mal commis sur les tres anims et inanims , et alors il faut supprimer un des deux termes autoris et prescrit . Car c'est du Vda que dcoule la loi morale, c'est-dire une chose n'est juste ou injuste qu'autant que le Vda la proclame telle ; donc le mal prescrit par le Vda n'est pas du mal. 46. On peut comprendre le compos bandhanavadhaklea de deux manires : la peine des liens et de la mort ou bien les liens, la mort et les peines . 47. Au lieu de rati, plaisir, certaines ditions ont dhrti : il attache sa pense.
140
LES LOIS DE MANOU
et le meurtre des anise procurer que par) l'enchanement de viande. absolument maux, on doit s'abstenir 50. Celui qui ne mange pas de la viande comme un vamet n'est pire, au mpris de la rgle, est aim dans ce monde pas afflig par les maladies. 51. Celui qui tolre (le meurtre d'un animal), celui qui le dpce, celui qui le tue, celui qui achte ou vend (sa chair), celui qui la sert et celui qui la mange, celui qui l'apprte, (sont tous considrs comme) ses meurtriers. 52. Il n'y a point de plus grand pcheur que celui qui d'autres cherche accrotre sa propre chair par la chair les Mnes et les Dieux. (tres, sans que ce soit pour) honorer 53. Celui qui pendant conscutives offre ancent annes et celui nuellement le sacrifice du cheval, qui s'abstient de viande, une rcompense (obtiennent) gale pour leur vertu. 54. En vivant de fruits et de racines purs, et en mangeant la nourriture des asctes, on ne gagne pas une aussi grande de viande. rcompense qu'en s'abstenant 55. Celui dont je mange ici-bas la CHAIR IL (minsa), ME (mm sa) dvorera dans l'autre monde : telle est l'tymologie du mot chair suivant les Sages. 56. Il n'y a point de pch manger de la viande, ( boire) ou user des plaisirs charnels des liqueurs (dans spiritueuses, car c'est un penchant naturel chez les tres ; les cas permis), de grandes rcommais l'abstention (de ces plaisirs) procure penses. dment 57. Je vais maintenant par ordre les puexposer les rifications concernant pour les quatre castes, (prescrites) les choses. morts et concernant 50. Un vampire, un Pica. 53. Offre : il vaudrait peut-tre mieux mettre le conditionnel offrirait , cause du chiffre de cent annes. 54. La nourriture des asctes consiste en riz sauvage et autres . (Kull.) 55. Calembour tymologique sur mrusa, viande, que Manou drive de sa = il et de mm = me.
LES LOIS DE MANOU
141
ou qui, sa 58. A la mort d'un enfant qui a fait ses dents, dentition tous les paet l'initiation, faite, a reu la tonsure rents (sont) impurs ; la naissance on dclare (d'un enfant) est la mme. (que l'impuret) 59. (La dure) de l'impuret (occasionne) par un cadavre est fixe dix jours pour un parent Sapinda, (ou bien elle ce qu'on ait recueilli les ossements, (ou) continue) jusqu' trois jours, (ou) un jour seulement. 60. La parent cesse avec la septime d'un Sapinda perd'un Samnosonne (ascendante ou descendante), la parent daka (cesse) lorsque et le nom. l'on ignore la naissance 61. De mme que (la dure) de l'impuret occasionne par un cadavre est fixe ( dix jours) pour les Sapindas, ainsi la naissance (cette rgle) doit tre (observe) (d'un enfant) une puret absolue. par ceux qui dsirent 62. L'impuret occasionne par un cadavre est (commune) tous (les Sapindas), celle qui rsulte d'une naissance (est la mre et au pre ; (ou plutt l'impuret) due une propre) naissance la mre seulement ; le pre se purifie (est propre) par une (simple) ablution. 63. Un homme se purifie qui a mis sa semence par des 58. B., suivant l'interprtation de Medh. et de Gov., traduit qui, avant de faire ses dents, a reu la tonsure ; Kull. dit : Jtadantnantare, immdiatement aprs la naissance des dents . Il est vrai que anantara, d'aprs le Dictionnaire de Saint-Ptersbourg, signifie quelquefois qui vient immdiatement avant . 59. Les parents jusqu'au sixime degr, en remontant ou en redescendant, sont dits les Sapindas (cf. le vers suivant. Recueilltes ossements: Les os doivent tre recueillis le quatrime jour suivant la prescription de Vishnu. (Kull.) Pour le Brahmane qui entretient le feu prescrit par la ruti et quia tudi une kh (recension du Vda) entire, avec les Mantras et les Brhmanas, l'impuret est d'un jour ; pour celui qui n'a qu'un de ces deux mrites, ( savoir) l'entretien du feu prescrit par la ruti ou l'tude du Vda, l'impuret est de trois jours ; celui qui n'a aucun de ces deux mrites, et qui se contente d'entretenir le feu prescrit par la Smrti est impur quatre jours, enfin celui qui est dpourvu de tous ces mrites est impur dix jours. (Kull.) 60. Sapinda signifie li par le gteau funbre appel pinda ; Samnodaka signifie li par la libation d'eau . Cette parent s'tend aussi loin qu'il existe des traces d'une communaut d'origine et de nom. 63. Rapports sexuels, terme vague prcis par Kull. : s'il a eu un enfant d'une femme antrieurement marie un autre .
142 ablutions
LES LOIS DE MANOU
son impuret ; aprs des rapports sexuels, il gardera trois jours. pendant 64. Aprs un jour et une nuit, plus trois priodes de trois ceux qui ont touch un cadavre sont purifis ; les nuits, Samnodakas (le sont) en trois jours. 65. Un lve la crmonie funbre en qui accomplit l'honneur de son prcepteur dcd est purifi en dix jours ; de mme ceux qui emportent le cadavre. 66. En cas de fausse une femme est purifie au couche, bout d'un de jours nombre gal celui des mois (couls ; une femme vertueuse depuis la conception) qui a ses rgles a cess. (est purifie) par un bain aprs que l'vacuation 67. En cas de dcs d'un enfant mle auquel on n'a pas encore pratiqu la tonsure, la purification est dclare faite au bout (d'un jour et) d'une nuit; pour (le dcs de) ceux une purification de trois nuits qui ont dj reu la tonsure, est requise. 68. Quand meurt avant deux ans, les parents (un enfant doivent l'inhumer hors (du village), orn (de guirlandes et de fleurs et le dposer) dans une terre pure, sans recueillir ses ossements (par la suite). 69. Pour lui ils ne doivent faire ni la crmonie par le feu, ni les libations d'eau ; aprs l'avoir laiss comme du bois la trois jours. fort, ils jeneront 70. Les parents ne doivent pas faire de libations d'eau pour ils peuvent le (un enfant) de moins de trois ans ; (pourtant) sa dentition, ou si l'on avait faire s'il avait dj termin du nom. de l'imposition accompli (pour lui) la crmonie 64. Priphrase pour dire dix jours et dix nuits . Touch un cadavre. Suivant Gov., il s'agit des Brahmanes non parents qui emportent le cadavre (au cimetire) moyennant rtribution . 65. La crmonie dite pitrmedha, sacrifice aux Mnes. 67. Qui ont dj reu la tonsure, mais qui n'avaient pas encore reu l'initiation . (Kull). La crmonie de la tonsure s'appelle Cdkarman. 69. C'est--dire on ne doit pas brler son corps, ni faire de rddha en son honneur. 70. Cette crmonie s'appelle le Nmakarman.
LES LOIS DE MANOU 71.
143
Si un compagnon de noviciat meurt, (la dure de) est fixe un jour ; la naissance d'un enfant, une l'impuret de trois (jours et trois) nuits est impose aux purification Samnodakas. 72. (Ala mort) d'une jeune fille (fiance, mais) non marie, sont purifis au bout de trois jours ; (le futur et ses) parents mais les parents sont purifis de la manire nonce paternels (dans le vers prcdent). 73. Ils doivent trois jours manger des aliments pendant non assaisonns de sel (artificiel), se baigner, s'abstenir de et dormir terre sparment. viande, 74. Telle est la rgle de l'impuret (contracte par la d'un cadavre, prsence) prescrite (pour les cas o les parents du dfunt sont) proximit ; apprenez maintenant, (au cas o ils sont) loigns, la rgle concernant les Sapindas et les Samnodakas. 75. Si l'on apprend la mort d'un (parent) en terre trangre dans les dix jours (qui suivent le dcs), on est impur pendant le reste des dix jours. 76. Mais si les dix jours (qui suivent le dcs) taient couls, on est impur pendant (trois jours et) trois nuits ; si une anne s'est coule la mort), on est (entire) (depuis purifi rien qu'en se baignant. 77. Un homme qui apprend aprs le dlai de dix jours la mort d'un parent (Sapinda) ou la naissance d'un fils, se purifie en se baignant dans l'eau avec ses vtements. 78. Lorsqu'un enfant (qui n'a pas fait sa dentition) ou qu'un meurt en pays tranger, Samnodaka on se purifie parent rien qu'en se baignant avec ses vtements. instantanment, 79. Si dans les dix jours il se produisait de nouveau une mort ou une naissance, un Brahmane reste impur (seulement) des dix jours. jusqu' l'expiration 72. De la manire nonce dans le vers prcdent, c'est--dire en trois jours . (Kull.) 76. Rien qu'en se baignant : littralement rien qu'en touchant l'eau.
144-
LES LOIS DE MANOU
80. A la mort d'un prcepteur l'impuret (de L'lve) est durer (trois jours et) trois nuits ; si c'est le fils ou la dclare femme (du prcepteur qui vient mourir, l'impuret dure) un jour et une nuit : telle est la rgle tablie. 81. Si un (Brahmane) instruit dans votre qui habite on est impur durant maison (par amiti vient mourir), trois oncle maternel, un disciple, un prtre (si c'est).un jours; un parent officiant, (loign , l'impuret dure) une nuit avec et le jour qui suit. le jour qui prcde vient mourir, 82. Si le roi du pays qu'on habite (l'imque l'clat (du soleil, si c'est le puret dure) aussi longtemps non jour, et des astres, si c'est la nuit) ; pour un (Brahmane) dans votre maison, instruit (qui meurt l'impuret dure) un et de mme pour un prcepteur le jour entier, qui connat Vda et les Angas. 83. Un Brahmane est pur au bout de dix jours, un Kchaau bout de quinze, un triya au bout de douze, un Vaisya Soudra au bout d'un mois. 84. Il ne faut pas prolonger (sans motif) les jours d'imni interrompre les rites relatifs au feu (sacr) ; car puret, ces rites, celui qui accomplit ft-il ne peut tre Sapinda, impur. 85. Celui qui a touch un Tchndla, une femme ayant un homme une femme en couches, un ses rgles, dgrad, cadavre ou celui qui l'a touch, se purifie par un simple bain. 86. Celui qui s'est purifi en se rinant la bouche, la vue 81. Upasampanne est comment par maitrdin tatsampavartini tadgrhavsini, qui rside dans le voisinage, qui habite dans la maison de celui-ci par amiti ou par une autre cause pareille . Mais il serait plus simple de le traduire par tant mort , d'autant plus qu'on est oblig ensuite de suppler ce terme. Littralement une nuit aile. 82. Un jour entier : Un jour seulement, mais non la nuit qui suit, et s'il meurt la nuit, une nuit seulement. (Kull.) Qui connat le Vda ; Kull. ajoute une restriction plus ou moins, peu ou beaucoup . 83. Un Brahmane est pur la mort d'un sapinda initi, ou la naissance d'un enfant venu terme . (Kull.) 86. Qui s'est purifi avant de commencer les crmonies en l'honneur
LES LOIS DE MANOU
145
doit toujours murmurer les de quelque (personne) impure purificatoires. prires au soleil et les (versets) 87. S'il touche un os humain encore gras, un Brahmane s'il (touche) un os dgraiss, se purifie en se baignant, (il se et en touchant une vache ou purifie) en se rinant la bouche le soleil. en regardant 88. Celui qui est li par un voeu ne doit_point offrir de libation d'eau ( des funrailles) l'achvement du jusqu' voeu ; (le voeu) termin, s'il offre une libation il ne d'eau, devient pur qu'au bout de trois nuits. 89. Les libations d'eau ne doivent point se faire pour ceux d'un mlange de castes, et qui qui sont ns irrgulirement (des sectes) de mendiants ou appartiennent .(hrtiques), qui ont attent leur existence, 90. Ni pour les femmes engages dans une secte hrtique, ou qui vivent dans la luxure, ou qui se font avorter, ou qui tuent leur mari, ou qui boivent des liqueurs fortes. 91. Celui qui est li par un voeu ne viole pas ce voeu en le cadavre de son prcepteur, de emportant (au cimetire) son rptiteur, de son pre, de .sa mre ou de son matre spirituel. des Mnes et des Dieux . Les prires au Soleil se trouvent Rig-Vda, I, 50,1, sqq. Les'Pvamnisou versets purificatoires, sont dans le Mandata IX. (Note de B.) 88. Li par un voeu dsigne suivant Kull. un tudiant, un brahmacrin . Cette rgle ne s'applique pas au cas o la personne dfunte est la mre, le pre ou le prcepteur. (Kull.) 89. Vrthsamkarajtnm littralement ns d'un mlange (de castes) en vain . Suivant Kull. il faut sparer vrth de samkara, et ns en vain signifierait qui habituellement ngligent leurs devoirs : j'ai remplac l'expression vague en vain par irrgulirement . Pravrajysu tishthatm peut s'entendre qui demeurent parmi les mendiants religieux . 91. Celui qui est li par un voeu, comme plus haut, dsigne l'tudiant ; le prcepteur crya, le rptiteur updhyya, le matre spirituel guru. Suivant le commentaire, le premier est celui qui lui a fait tudier une kh (branche du Vda) entire , le second celui qui a fait tudier seulement une portion du Vda ou un Anga, le troisime celui qui lui a expliqu le sens du Vda, ou seulement d'une portion des Vdas . 10
146
LES LOIS DE MANOU
le cadavre d'un Soudra 92. On doit emporter par la porte Sud de la ville, celui d'un Dvidja par les portes Ouest, Nord, Est, suivant la caste. 93. Les rois, les gens qui sont lis par un voeu, ou ceux qui un long sacrifice, ne (contractent) point d'imaccomplissent (les puret ; car (les rois) sont assis sur le trne d'Indra, aussi purs que Brahme. autres) sont toujours est la purification 94. Pour un roi sur son trne glorieux la protection dclare car le trne est destin instantane, du peuple ; telle en est la cause. 95. (Il en est de mme pour les parents de) ceux qui ont ou un combat, ou par le tonnerre, t tus dans une bagarre une vache ou ou par le roi, ou (qui sont morts en dfendant) ou ceux dont le roi dsire (la puret). un Brahmane, les huit protec96. Le prince a un corps (o s'incarnent) les le Soleil, le Vent, Indra, teurs du monde, Soma, Agni, des richesses et de l'eau (KouveraetVarouna), deux Seigneurs et Yama. de ces gardiens du 97. (C'est parce que) le roi est rempli en lui; car la n'est reconnue monde, qu'aucune impuret ou l'impuret des mortels est produite ou dtruite par puret du monde. ces gardiens 98. Pour celui qui a t tu en faisant son devoir de Kcha92. Suivant la caste : littralement suivant les convenances . D'un Dvidja : le Vaisya par la porte Ouest, le Kehatriya par la porte Nord, le Brahmane parla porte Est . (Kull.) 93. Un voeu : le noviciat ou un voeu de pnitence . (Kull.) Ne contractent point d'impuret pour la mort d'un Sapinda ou autre . (Kull.) Un long sacrifice sattra tel que le Gavmayana et autres. 95. Tus par le roi, c'est--dire excuts par son ordre pour un dlit . (Kull.) Dont le roi dsire la puret tels que son prtre domestique et autres, afin que ses affaires ne souffrent point de retard . 96. Soma:=Candra, le Dieu Lunus; Agni, le feu; Kuvera ou Kubera, Dieu des richesses; Varuna, Dieu des eaux; Yama, Dieu des enfers . 98. Par des armes brandies contre lui, ou peut-tre pendant qu'il brandissait ses armes, c'est--dire les armes la main . Le sacrifice est instantanment accompli veut dire qu'il obtient la mme saintet qu'en faisant un jyotishtoma ou autre sacrifice . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
147
contre lui en un combat, triya, par des armes qu'on brandissait le sacrifice est instantanment et la purification (a accompli, lieu sur-le-champ) ; telle est la rgle: le Brahmane 99. (A la fin d'une priode d'impuret) une crmonie se purifie en tou(funraire) qui a accompli chant de l'eau, un Kchatriya son char ou ses (en touchant) son aiguillon ou la bride (de armes, un Vaisya (en touchant) ses boeufs), un Soudra (en touchant) son bton. des Dvidjas, 100. 0 les meilleurs on vous a expliqu les en cas de mort) d'un Sapinda; (prescrites purifications aples purifications concernant les morts prenez (maintenant) un degr plus loign. le cadavre d'un Brah101. Un Brahmane qui a transport tait mane qui n'est pas son Sapinda, comme (si ce dernier son proche) parent, ou celui d'un parent maternel, est purifi au bout de trois jours. 102. Mais s'il a mang les aliments (offerts par les Sapinil est purifi au bout de dix jours seuledas) de ces (morts), s'il ne mange ment; au bout d'un jour (et une nuit), pas leurs aliments et ne sjourne pas dans leur maison. 103. Aprs avoir volontairement suivi (le convoi) d'un soit d'un tranger, il se pumort, soit d'un parent (paternel), rifie en se baignant tout habill, en touchant du feu, ou en du beurre clarifi. mangeant 104. On ne doit pas faire emporter le capar un Soudra davre d'un Brahmane lorsqu'il y a des gens de la mme caste prsents souille d'un ; car l'offrande par le contact Soudra ne conduit point (le dfunt) au ciel. 99. Son char ou sa monture, lphant ou cheval. 100. Les meilleurs des Dvidjas sont les Brahmanes. A un degr plus loign, littralement non sapindas. 102. S'il habite dans leur maison, et mange leurs aliments, celui qui a emport le cadavre n'est pur qu'aprs le laps de trois nuits, prcdemment indiqu. (Kull.) 104. Gens de mme caste, littralement : les siens ce qui pourrait signifier ses propres parents . Mais le commentaire explique sveshu par samnajtyeshu, ce qui s'oppose mieux l'ide de Soudra.
148 105.
LES LOIS DE MANOU
La connaissance les austrits, le feu (du Vda), les aliments, la terre, l'eau, les onctions (sacr), l'esprit, relile vent, les crmonies (avec de la bouse de vache), le soleil, le temps, (telles sont) les sources de purigieuses, fication pour les tres anims. la puret (dans 106. Parmi tous les modes de purification, le meilleur ; car celui des richesses est dclare l'acquisition) est (vraiment) de ses richesses, qui est pur (par la source) de l'eau et de la qu'avec pur, et non celui qui n'est purifi terre. se purifient 107. Les gens instruits par la patience (des ceux qui ont fait des actes dfendus, injures); par les dons; ceux qui ont des pchs cachs, en murmurant (des prires) ; le Vda, par les austrits. ceux qui connaissent parfaitement 108. Par la terre et l'eau ce qui doit tre purifi est purifi; une rivire est purifie une femme dont la par son courant, un Brahmane pense est souille (est purifie) par ses rgles, (au monde). par le renoncement 109. Les membres sont purifis par l'eau, l'esprit par la vrit, l'me individuelle par la science (sacre) et les austrits, l'intelligence par le savoir. la rgle (concernant) 110. Ainsi vous a t expose la purification du corps ; coutez maintenant la rgle (concernant) des divers objets. la purification 111. Les Sages ont dclar que pour les objets en mtal, les objets en pierre, les pierres la puret prcieuses, (s'obl'eau et la terre. tient) par les cendres, 112. Un vase d'or sans souillure devient pur rien que par 105. Les aliments du sacrifice . L'esprit manas : B. traduit (la rpression) de l'organe interne . Les tres anims, littralement pourvus d'un corps . 107. Le compos akryakrinab, ceux qui font ce qui ne doit pas tre fait , peut s'entendre aussi ceux qui ne font pas ce qui doit tre fait, en d'autres termes, ceux qui ngligent leurs devoirs . 109. Bhttman, littralement l'me des tres oppose l'me universelle. La science, vidy, c'est--dire la connaissance du Vda. 112. Sans souillure qui ne renferme pas les souillures des restes d'ali-
LES LOIS DE MANOU l'eau
149
ce qui est en ; de mme ce qui est produit par l'eau, non travaill. pierre et l'argent 113. L'or et l'argent de l'union de l'eau et du proviennent la purification la plus efficace pour ces feu; c'est pourquoi est celle qui drive) de leur propre origine. (mtaux 114. (Les objets en) cuivre, fer, laiton, tain, zinc, plomb, doivent tre purifis comme il convient au moyen ( chacun) d'acides et d'eau. d'alcali, 115. Pour tous les liquides la purification est prescrite kousa, pour les ob(celle qui se fait) avec deux brins d'herbe une couche ou autres, c'est) jets solides (tels qu'un sige, d'eau, pour les objets en bois le rabotage. l'aspersion la purification des 116. Dans la crmonie du sacrifice, vases sacrs, tels que les coupes et les tasses, (se fait) en les frottant la main et en les rinant l'eau. se puri117. Les pots, les cuillers, les poches liquides, de bois, le van, le fient l'eau chaude, ainsi que le couteau le pilon et le mortier. chariot, se 118. Des grains et des vtements en grande quantit d'eau ; pour une petite quantit purifient par une aspersion (des mmes objets), la purification (se fait) en les lavant. 119. Pour les peaux et la vannerie, la purification (se fait) et comme pour les vtements les racines ; pour les lgumes, les fruits, la purification est la mme que pour les prescrite grains. avec de 120. Les articles de soie et de laine (se purifient) ments,etc. (Kull.)Ce qui est produit par l'eau.v. les coquillages, etc.(Kull.) 113. Kull. mentionne un rcit vdique relatif aux amours d'Agni et de Varunn qui ont donn naissance l'or et l'argent. Par purification il faut entendre ici le nettoyage. 116. Les coupes soma (oamasas) sont en bois, les tasses (grahas), suivant L., servent mettre le beurre clarifi. 117. Sruc et sruva dsignent deux sortes de cuillers. Le spnya est un couteau de bois de la longueur du bras, servant divers usages dans le sacrifice. Je ne sais o L. a pris le sens de vase de fer . 120. L'arbre savon arishta, Sapindus detergens. Les toffes amupatta, terme dont le sens reste obscur.
150
LES LOIS DE MANOU
la terre saline, les couvertures de (du Npal) avec les fruits l'arbre savon, les toffes avec les fruits de YJEgle marmeblanche. de moutarde los, les tissus de lin avec des graines instruit les (ob121. Un homme (de la Loi) doit purifier les comme cornes, os, ivoire, jets faits avec des) coquilles, de vache, ou avec de l'eau. tissus de lin, ou avec de l'urine 122. L'herbe, le bois, la paille se purifient par des aspersions d'eau; une maison, en la balayant et l'enduisant (de fumier de vache) ; un (ustensile) en terre, en le soumettant une deuxime cuisson. avec des 123. (Un ustensile) en terre qui a t en contact du pus, de l'ordure, del salive, fortes, de l'urine, liqueurs du sang, n'est pas purifi par une seconde cuisson. 124. Le sol est purifi par cinq (procds qui sont) : ba(de fumier de vache), arroser (avec de l'urine layer, enduire de vache), ratisser, ou y faire sjourner des vaches (un jour et une nuit). 125. Des aliments qui ont t becquets par des oiseaux, on flairs par des vaches, remus (avec le pied), sur lesquels ou des ina ternu, qui ont t souills par des cheveux en y jetant de la terre. sectes, se purifient 126. Aussi soumis au contact longtemps qu'un (objet) d'une immondice en garde l'odeur et la tache, on doit emde tous les objets. ployer la terre et l'eau la purification 127. Les Dieux ont assign trois choses pures aux Brahmanes : celle (o l'on) ne voit pas (de souillure), celle qui a t" purifie avec de l'eau, et celle qui a t recommande par la parole (des Brahmanes). 128. Les eaux qui ont pass sur un sol (pur), suffisantes 121. B. traduit : avec une mixture d'urine de vache et d'eau ; je crois qu'il vaut mieux sparer les deux termes. 125. Comme plus haut, au lieu de cheveux et insectes , on peut mettre insectes de cheveux, c'est--dire poux . 127. Adrshtam, littralement non vue , c'est--dire o l'on ne voit pas de souillure, ou peut-tre, comme l'entend L. souille leur insu . Purifie avec de l'eau en cas de doute . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
151
une vache, non souilles par aucune immonpour dsaltrer la couleur et le got, sont pures. dice, agrables par l'odeur, 129. La main d'un artisan est toujours pure (pendant qu'il et de mme toute marchandise en vente ; travaille), expose l'aumne donne l'tudiant est toujours exempte d'impuret ; telle est la rgle. 130. Toujours pure est la bouche d'une femme, (pur) aussi est l'oiseau qui fait tomber un fruit (en le becquetant) ; pur est le veau qui fait couler (le lait en ttant), pur est le chien o il attrape un daim. au moment tu par les 131. Manou a dit que la viande (d'un animal) chiens est pure, ainsi que celle (d'une bte) tue par d'autres ou par des gens de caste mprise tels que Tchncarnassiers dlas et autres. 132. Tous les trous (du corps humain) qui sont au-dessus sont du nombril sont purs ; tous ceux qui sont au-dessous ainsi que les excrtions sorties du corps. impurs, les gouttes une ombre, une 133. Les mouches, (d'eau), la poussire, la terre, le vache, un cheval, les rayons solaires, comme purs au toucher. tre considrs vent, le feu, doivent 134. Pour purifier (les organes par o) sont expulss l'urine et les excrments, la terre et l'eau doivent tre emautant qu'il est ncessaire, ainsi que pour purifier ployes, les douze impurets du corps. la crasse 135. La matire le sperme, le sang, de sbace, les ongles, le la tte, l'urine, les excrments, le crumen, mucus nasal, les larmes, la chassie, la sueur, voil les douze de l'homme. impurets 136. Celui qui dsire la puret, devra faire une (application de) terre son pnis, trois son anus, dix une main seule, et sept aux deux mains. 131. Gens de caste mprise : dasyu signifie littralement barbare. 133. Par gouttes il faut entendre, suivant Kull., les petites gouttes de salive qui s'chappent de la bouche . 136. Une main seule : la gauche, car celui qui connat la puret ne doit pas employer la main droite purifier (les parties) infrieures . (Kull.)
152
LES LOIS DE MANOU
137. Telle est la purification d'un matre de maison ; elle sera double pour un tudiant, pour un ermite, quatriple druple pour un ascte. on doit 138. Aprs avoir vacu l'urine et les excrments, de mme se rincer la bouche, et se laver les trous du corps; de on va rciter le Vda, au moment et toujours quand manger. 139. Celui qui dsire la puret de son corps doit d'abord la bouche, ; par trois fois se rincer puis deux fois l'essuyer mais une femme et un Soudra ces actes) une (accomplissent seule fois. se raser 140. Les Soudras qui vivent selon la Loi doivent est le (la tte) une fois par mois ; leur mode de purification et pour nourriture mme que celui des Vaisyas, (ils ont) les restes des Dvidjas. 141. Les gouttes (de salive) de la bouche qui ne tombent ni (les poils) de la ne rendent pas impur, pas sur un membre barbe qui entrent dans la bouche, ni ce qui reste dans les dents. 142. Les gouttes qui touchent les pieds de (en tombant) celui qui prsente d'autres de l'eau pour se rin(personne) cer la bouche, doivent tre considres comme pareilles (l'eau qui coule) sur le sol : elles ne rendent pas impur. 143. Celui qui porte en main un objet, et qui vient tre touch comment ou une chose) n'importe (par une personne sa puret en se rinant la bouche, sans dimpure, reprend poser (pour cela) l'objet. 144. Celui qui a vomi ou qui a la diarrhe, doit se baigner et manger du beurre clarifi; im(ensuite) (mais s'il vomit il doit seulement se rincer mdiatement) aprs avoir mang, 141. Certains suppriment une des deux ngations et lisent patanti au lieu de na yanti : le sens est alors les gouttes qui tombent sur un membre ne rendent pas impur . 143. On peut aussi faire retomber l'adverbe n'importe comment sur celui qui porte . Il faut admettre qu'on tient l'objet dans une seule main, car sans cela comment pourrait-on se rincer la bouche, sans dposer l'objet?
LES LOIS DE MANOU
153
la bouche ; le bain est (la purification) pour celui prescrite sexuels. qui vient d'avoir des rapports la bouche 145. Bien que (dj) pur, on doit se rincer crach, dit un mensonge mang, aprs avoir dormi, ternu, ou bu de l'eau, et aussi quand on va rciter le Vda. la rgle de la purifi146. On vous a expos compltement cation pour toutes les castes, ainsi que (celle de) la purificales devoirs des femmes. maintenant tion des objets ; apprenez 147. Une petite fille, une jeune femme, une femme mre, mme ne doivent jamais rien faire de leur propre autorit, dans leur maison. de son la femme doit tre dpendante 148. Dans l'enfance de son poux, (et) si son mari est pre, dans la jeunesse, mort, de ses fils; elle ne doit jamais jouir de l'indpendance. d'tre de son 149. Elle ne doit jamais souhaiter spare et de ses enfants ; car en se sparant pre, de son poux deux familles. d'eux, elle dshonorerait 150. Qu'elle soit toujours dans les travaux gaie, entendue du mnage, de l'entretien du mobilier, modre soigneuse dans ses dpenses. 151. Celui auquel elle a t donne ou par par son pre, son frre avec l'autorisation du pre, elle doit lui obir de son vivant, et ne pas l'outrager aprs sa mort. 152. La formule de bndiction et le sacrifice au Seigneur des cratures sont usits dans les mariages sur pour appeler la prosprit les (maries) ; mais l'autorit (du mari) repose sur le don (de la femme par son pre). 145. Bien que dj pur, c'est--dire bien que s'tant dj rinc la bouche, on doit recommencer l'opration. Kull. fait dpendre la dernire proposition de ce qui prcde. Aprs avoir dormi, etc.. si on dsire rciter le Vda, il faut se rincer la bouche ; mais il semble qu'il faudrait alors supprimer le ca qui suit adhyeshyamnah 148. De ses fils : leur dfaut, ce sont les parents paternels qui ont autorit sur la femme . (Kull.) 151. Aprs sa mort par une mauvaise conduite ou en ngligeant les rddhas et autres oblations destines contenter ses Mnes . (Kull.) 152. La formule de bndiction s'appelle svastyayana.
154 153.
LES LOIS DE MANOU
dont l'hymen a t clbr avec les prires L'poux sa femme, en temps opportun ou toujours d'usage procure hors de saison, la flicit en ce monde et dans l'autre. 154. Mme indigne, de qualits, un dbauch, dpourvu doit toujours tre rvr un dieu par une comme poux femme vertueuse. 155. Pour les femmes il n'existe ni sacrifice, ni voeux, ni jene part ; une femme qui obit son mari sera par ce seul fait exalte au ciel. 156. Une femme vertueuse dans qui dsire (tre runie) un autre monde son mari, ne doit rien faire qui lui dplaise de son vivant ou aprs sa mo'rt. 157. Qu'elle macie, si elle veut, son corps (ensenourrissant) de fleurs, de racines et de fruits purs ; mais son mari mort, elle ne doit mme pas prononcer le nom d'un autre homme. 158. Jusqu' la mort elle doit tre patiente, adonne des observances attentive suivre les excelchaste, pieuses, lentes rgles de conduite des femmes qui n'ont qu'un poux. 159. Plusieurs milliers de Brahmanes, chastes depuis leur sont alls au ciel sans avoir perptu leur postrit. jeunesse, 160. Une femme vertueuse qui aprs la mort de son poux dans la chastet, va au ciel, mme sans avoir d'enpersvre chastes. fants, tout aussi bien que ces (hommes) 161. Mais la femme, d'avoir des enfants, qui par dsir ses devoirs envers son poux (mort), se dshonore manque ici-bas et perd (tout espoir d'tre un jour) runie son mari. 162. Les enfants ns ici-bas d'un autre ne (que du mari) 153. En temps opportun ou hors de saison est une priphrase pour dire en toute circonstance. 155. A part: sans leur poux . (Kull.) 156. Son mari, littralement celui qui a pris sa main . 157. On voit qu'il n'est pas question dans les lois de Manou de l'obligation pour la veuve de monter sur le bcher de son mari dfunt. 158. Niyat, adonne des observances pieuses , peut s'entendre aussi exerant du contrle sur elle-mme . 162. On peut avec Medh. entendre ainsi la premire partie du vers : les enfants ns d'un autre que du mari n'appartiennent pas la mre .
LES LOIS DE MANOU
155
a de la femme ni ceux (qu'un homme) sont pas (lgitimes), d'un autre (n'appartiennent au procrateur) ; en aucun cas il n'est permis aux femmes vertueuses de se remarier. 163. Celle qui dlaisse un poux de caste infrieure pour cohabiter avec un (homme) d'une caste suprieure, devient dans ce monde, et on la dsigne sous le nom de mprisable celle qui a eu d'abord un autre poux . 164. Par son infidlit encourt son poux, une femme dans le le blme dans ce monde; (aprs la mort) elle renat ventre d'un chacal, ou bien elle est tourmente par des maladies (en punition) de son crime. ses paroles et son 165. Celle qui, chaste dans ses penses, obtient runie) (d'tre corps, ne trahit jamais son poux, une lui dans l'autre monde, et les gens de bien l'appellent femme vertueuse. 166. Par une telle conduite une femme, chaste dans ses penici-bas une excellente ses, ses paroles et son corps acquiert et dans l'autre monde (est runie) son poux. renomme, 167. Un Dvidja instruit de la Loi, lorsque sa femme de mme caste, s'tant conduite de la sorte, meurt avant lui, doit la brler avec le feu consacr et les vases du sacrifice selon la rgle. 168. Aprs avoir ainsi employ les feux consacrs pour les funrailles de sa femme morte avant lui, il peut contracter un nouvel hymen, et de nouveau allumer (les feux). 169. Fidle ces rgles, qu'il ne nglige les cinq jamais et mari, qu'il habite dans sa maison pendant la sacrifices, seconde priode de son existence. 164. Il semble qu'il vaut mieux mettre ou bien , quoique le texte porte et ; car si elle renat comme chacal, on ne voit pas quelles sont les maladies dont elle peut tre afflige sous cette forme. Pparoga peut signifier aussi des maladies graves, telles que la lpre . (Kull.) 167. Le feu consacr : les feux prescrits par la ruti et la Smrti . (Kull.) Le (exte dit avec l'Agnihotra .
LIVRE
SIXIEME
L'Ermite;
l'Ascte.
1. ment
Le Dvidja sorti de noviciat, qui a ainsi vcu conformdes matres de maison, doit (en la rgle dans l'ordre la fort, ferme dans sa rsolution, et bien suite) aller habiter matre de ses sens. 2. Un matre de maison qui se voit des rides et des cheveux blancs, et (qui a) un enfant de son enfant, doit se retirer dans les bois. et 3. Renonant tout aliment produit par la culture tous ses biens, qu'il aille dans la fort, aprs avoir confi sa femme ses fils, ou accompagn de cette dernire. 4. Emportant avec lui le feu sacr et les ustensiles (du et quittant le village pour la fort, culte) du feu domestique il y vivra matre de ses sens. suivant la rgle les (cinq) grands sacri5. Il accomplira aux ermites fices avec toute sortes (d'aliments) purs propres ou avec des herbes, racines et (tels que le riz sauvage), fruits. 1. Niyata ferme dans sa rsolution , peut signifier aussi vou des pratiques pieuses. 2. Kull. restreint le sens de apatya au sexe masculin : le fils d'un fils . 3. Littralement aux aliments des villes (ou des villages). Ses biens peut-tre plus exactement ses meubles . 4. Le feu sacr : littralement l'Agnihotra.
158
LES LOIS DE MANOU
se baigne 6. Qu'il porte une peau ou un vtement d'corce, et (laisse soir et matin, ait toujours les cheveux longs, sa barbe, ses poils, ses ongles ; crotre) bali avec les aliments 7. Qu'il fasse l'offrande qu'il a, et donne l'aumne ceux qui se selon ses moyens ; qu'il honore son ermitage d'une aumne consistant en eau, prsentent racines et fruits. 8. Qu'il soit toujours la rcitation du Vda pour appliqu toudonnant son compte, bienveillant, recueilli, endurant, envers tous les sans jamais recevoir, jours compatissant tres. 9. Qu'il offre suivant la rgle (le sacrifice de) l'Agnihotra le sacrifice de la avec les trois feux consacrs, sans ngliger nouvelle lune, et celui de la pleine lune, en temps voulu. 10. Qu'il accomplisse le sacrifice aux corps cgalement du grain nouveau, les crmonies lestes, l'offrande qui ont et lieu tous les quatre mois, (les sacrifices appels) Touryana dans l'ordre voulu. Dakchasyyana, nourri11. Avec du riz pur de printemps et d'automne, il prparera ture des asctes, rcolt de ses propres mains, les gteaux et autres suivant les prescriptions, sparment, mets du sacrifice. trs pure, pro12. Ayant offert aux divinits cette oblation ' duit des forts, qu'il emploie pour lui le reste (avec) du sel prpar par lui-mme. 13. Qu'il mange les vgtaux dans l'eau ou sur poussant 6. Cheveux longs : la coiffure appele jat consistant en tresses ou nattes de cheveux. 7. L'offrande bali est l'offrande aux tres, aux bhtas. 8. Dnta endurant signifie littralement dompt : il vaudrait peuttre mieux le traduire par ayant ses sens dompts ; le commentaire de Kull. dit : Qui endure les choses allant par paire, telles que le froid et le chaud, etc. 10. Le rksheshti, l'grayana, les cturmsyas, le turyana et le dakshasyyana. Les deux derniers sont des modifications du sacrifice la nouvelle lune. Kull. lit uttaryana au lieu de turyana le sacrifice du solstice d'hiver .
LES LOIS DE MANOU
159
le produit des arbres racines et fruits, la terre, les fleurs, des fruits. purs et les huiles extraites 14. Il doit s'abstenir de miel, de champignons pousss bhostrina et sigrouka, terre, ainsi que des (herbes appeles) et des fruits du slechmtaka. 15. Au mois d'svina, il devra jeter les aliments d'ascte ses vtements uss, et les prcdemment, qu'il a rcolts racines et fruits (qu'il a en rserve). herbes, de la culture, 16. Qu'il ne mange aucun produit mme s'il ni des racines et des fruits a t jet par quelqu'un, qui ont (faim) qui le presse. pouss dans un village, quelque 17. Il peut manger ou bien des (aliments cuits sauvages) sur le feu, ou seulement (des fruits) mris par le temps ; il ou (n')avoir peut (les craser avec) un pilon de pierre, (que) ses dents pour mortier. 18. Il peut ramasser (des aliments) pour un jour seul, ou en ramasser pour un mois, ou pour six mois, ou pour un an. 19. S'tant de son mieux de la nourriture, il peut procur soit au quatrime soit la nuit, soit le jour, repas, manger soit au huitime. suivant les rgles de la pni20. Ou bien il peut vivre la tence lunaire la quinzaine brillante et pendant pendant au ou bien une fois seulement obscure, manger quinzaine des deux quinzaines de la bouillie de faterme de chacune rine de riz cuite. 14. Bhstrna, Andropogon schoenanlhus igruka,Moringapterygosperma leshmtaka ou leshmntaka, Cordia myxa. 15. Avina ou vayuja = septembre-octobre. 18. La traduction de B. pour la premire partie du vers est la suivante : Il peut aussitt (aprs son repas quotidien) laver son vase pour recueillir les aliments. En effet tel est le sens littral de sadyahprakshlaka. 19. Soit la nuit, soit le jour, c'est--dire le soir ou le matin. Comme il y a deux repas rguliers par jour, le quatrime repas signifie celui qui se fait la fin du deuxime jour, le huitime celui qui se fait la fin du quatrime. 20. La pnitence lunaire Cndryana (Cf. XI, 217) consistant diminuer chaque jour sa ration d'une bouche pendant la quinzaine brillante. Une fois seulement, c'est--dire le matin ou le soir . (Kull.)
160
LES LOIS DE MANOU
21. Ou bien il peut ne vivre absolument que de fleurs, racines et fruits, mris par le temps et tombs d'eux-mmes, en se conformant aux prceptes de Vikhanas. 22. Qu'il se roule terre ou se tienne debout tout un jour sur la pointe des pieds; ou bien qu'il passe son temps (tanet aux trois moments debout, tt) assis, (tantt) principaux de la journe qu'il aille l'eau (pour se baigner). 23. En t qu'il supporte les cinq feux, pendant la saison des pluies qu'il n'ait d'autre abri que les nuages, en hiver humides, augmentant par degr qu'il porte des vtements ses austrits. de la aux trois moments 24. En se baignant principaux aux Mnes et aux Dieux ; qu'il offre des libations journe, des austrits (de plus en) plus rudes, qu'il macie pratiquant son corps. en lui-mme, les (trois) feux sacrs, 25. Ayant dpos suivant la rgle, il doit vivre sans feu, sans abri, silencieux, et de fruits, dracines se nourrissant sur aux plaisirs matriels, 26. Indiffrent chaste, couchant tout abri, logeant au pied des arbres. la dure, ddaignant ncessaires sa subsistance 27. Qu'il accepte les aumnes asctes ou des autres des Brahmanes seulement Dvidjas de maison qui habitent dans la fort. matres 21. Vikhanas un Richi auteur suppos de Stras contenant des rgles relatives la vie des anachortes. 22. Les trois moments, savanas, sont le matin, midi et le soir. Savaneshu forme un jeu de mots en sparant sa-vaneshu (dans les forts). 23. Les cinq feux : Qu'il se fasse brler par des feux placs aux quatre points cardinaux, et par l'ardeur du soleil au-dessus de lui. (Kull.) Toutes ces austrits exagres sont encore pratiques par certains fakirs de l'Inde moderne. 24. Se baignant : je traduis ainsi d'aprs le commentaire : le texte porte upaspran qui signifie exactement se rinant la bouche . 25. Ayant dpos en lui-mme en avalant des cendres, etc. . (Kull.) 27. Ou des autres Dvidjas : le texte porte et et non ou ; mais le commentaire de Kull. indique qu'il doit s'adresser d'abord aux premiers, et leur dfaut, aux autres Dvidjas .
LES LOIS DE MANOU 28. Ou bien
161
habitant la fort peut rapporter (l'anachorte) du village (des aliments), dans un coraprs les avoir reus net fait d'une feuille, dans (le creux de) sa main, ou dans un huit bouches. tesson, et en manger 29. Ces pratiques et d'autres devront tre observes par le Brahmane retir dans la fort, et pour obtenir (l'union de) son me (avec l'tre il tudiera) les divers textes suprme, sacrs contenus dans les Oupanichads, 30. Qui ont t tudis et les Brahmanes par les Sages matres de maison, de leur science et pour l'accroissement de leurs austrits, et pour la purification de leur corps. 31. Ou bien qu'il se dirige vers la rgion du Nord-Est, droit devant lui, ferme dans sa rsolution, marchant vivant d'air et d'eau, ce que son corps tombe en dissojusqu' lution. 32. S'tant dfait de son corps par l'une de quelconque ces pratiques de (usites par) les grands Sages, exempt le Brahmane soucis et de crainte, est exalt dans le monde de Brahme. 33. Aprs avoir ainsi pass dans les bois la troisime priode de son existence, il devra durant la quatrime errer dtach de toute affection. (en ascte mendiant), 34. Celui qui a pass d'ordre en ordre, offert les sacrifices et vaincu ses sens, et qui fatigu de (faire) des aumnes et des offrandes, se fait moine errant, obtient la aprs sa mort flicit suprme. 29. Les Upanishads ou doctrine sotrique sont des traits qui se proposent de dcouvrir le sens cach du Vda. Les textes sacrs, littralement les rutis. 31. Ou bien s'il lui survient une maladie incurable, etc. . (Kull.) La rgion Nord-Est, littralement la rgion invincible . Yukta, ferme dans sa rsolution, signifie d'aprs Kull. appliqu aux pratiques du Yoga. Le Yoga est une des coles philosophiques de l'Inde, dont on attribue la fondation Patafljali. 32. Une de ces pratiques nonces plus haut (Kull.), ou suivant Medh. l'immersion, l'action de se prcipiter d'une montagne, la crmation volontaire, ou la mort par le jene. 11
162
LES LOIS DE MANOU
35. Ayant pay les trois dettes, il devra appliquer son esfinale ; mais celui qui cherche la dliprit la dlivrance vrance finale, sans avoir acquitt est prci(les trois dettes) pit (clans l'enfer). 36. Ayant tudi le Vda suivant la rgle, procr des enfants conformment la Loi, et offert des sacrifices suivant ses moyens, on peut appliquer la dlivrance son esprit finale. 37. Un Brahmane la dlivrance sans finale, qui cherche avoir tudi le Vda, des enfants et offert des saprocr crifices, est prcipit (en enfer). 38. Aprs avoir des le sacrifice au Seigneur accompli dans lequel (il abandonne) tous ses biens en guise cratures, et dpos en lui-mme le feu (sacr), un Brahd'honoraires, mane peut quitter sa maison (pour se faire ascte). 39. Des mondes radieux de celui deviennent (le partage) la scurit tous les du Vda et assurant qui, prdicateur tres anims, quitte sa maison (pour se faire ascte). crainte aux 40. Le Dvidja qui ne cause pas la moindre une fois tres anims n'aura rien redouter d'aucune part, dlivr de son corps. de purification, 41. Quittant sa maison, pourvu de moyens 35. Les trois dettes (Cf. IV, 257) aux grands Sages, aux Mnes et aux Dieux. Ou bien encore par les trois dettes on peut entendre les trois premiers degrs de la vie brahmanique, tudiant, matre de maison et anachorte . C'est seulement aprs avoir pass par tous ces ordres qu'on peut songer la dlivrance finale. 38. Sarvavedasadakshinm : je prends veda au sens de biens . Au surplus, il y a peut-tre une quivoque voulue, et ce mot peut s'entendre ainsi : O l'on donne tout comme honoraires (suivant l'injonction du Yajur-)Veda. Honoraires du sacrifice donns au prtre. La fin de ce vers signifie suivant Kull. qu'il peut entrer dans le quatrime ordre, sans avoir pass par celui des habitants de la fort (ou anachortes) . (Kull.) 39. On peut traduire plus littralement les mondes deviennent resplendissants lorsque, etc. . Assurant la scurit signifie ne faisant de mal aucune crature. 41. Les moyens de purification, pavitras, sont le bton, le pot--eau, etc. . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
163
aux jouissances insensible silencieux, qui (lui) sont offertes, il mnera la vie errante (des asctes). 42. Qu'il aille sans compagnon, en vue seul, toujours d'obtenir considrant (la flicit suprme), (que l'homme) solitaire atteint son but, (lui qui) ne dlaisse et n'est point point dlaiss. 43. Qu'il n'ait ni feu, ni abri, et qu'il aille au village (dedes aliments, indiffrent ferme dans sa mander) ( tout), concentrant sa pense sur l'tre rsolution, silencieux, suprme. 44. Un tesson, d'un arbre les racines des (pour gte), la solitude et l'indiffrence tout, sont les marques haillons, de celui qui est prs de la dlivrance finale. 45. Il ne doit pas dsirer la mort, il ne doit pas dsirer la comme son heure, un serviteur vie, il doit attendre (attend) ses gages. 46. Qu'il (ne) pose son pied (sur un lieu qu'aprs s'tre assur par) la vue (qu'il est) pur; qu'il boive de l'eau purifie (en la filtrant) avec un linge, qu'il dise des paroles purifies par la vrit, son coeur (toujours) qu'il conserve pur. 47. Qu'il supporte les injures, ne mprise n'ait personne, d'inimiti avec personne, au sujet de ce corps. colre pour colre ; une injure 48. Il ne doit pas rendre il doit rpondre parole ; il ne doit profrer par une bonne aucune parole fausse rpandue par les sept portes. 43. Bhvasarnhita signifie littralement concentr dans sa pense. Mais Kull. explique bhva par brahman. 45. -Ses gages nirvea ; il y a une autre leon, nirdea un ordre. 46. Littralement qu'il pose un pied purifi par la vue . Pour viter (de marcher) sur un cheveu, un os, etc. . (Kull.) Avec un linge pour viter (de dtruire) les petits insectes, etc. . (Kull.) 47. De ce corps : Kull. ajoute faible et sujet aux maladies . 48. Cette expression les sept portes est bizarre, et les commentaires ne sont pas d'accord sur son vritable sens. Suivant Kull. elle dsignerait l'esprit, l'intelligence et les cinq sens ; l'ide est qu'il ne faut profrer aucun mensonge ayant rapport des objets soumis aux perceptions des sens et de l'esprit.
164
LES LOIS DE MANOU
49. Mettant ses dlices dans l'me suprme, assis, indiffaux dsirs de la chair, rent ( tout), inaccessible n'ayant dans d'autre il doit vivre ici-bas que lui-mme, compagnon l'attente du bonheur (ternel). obtenir l'aumne 50. Qu'en aucun cas il ne cherche par ni par l'astrodes prodiges et des prsages, (l'interprtation) ni (en donnant) des avis ou en explilogie et la chiromancie, quant (le sens des traits). 51. Qu'il n'entre dans une maison jamais (pour mendier) ou de Brahmanes, de chiens, d'ermites, d'oiseaux, remplie mendiants. d'autres la barbe coups, muni d'une les ongles, 52. Les cheveux, sbile, d'un bton, d'un pot eau, qu'il erre continuellement, et ne faisant de mal aucune crature. recueilli, ni avoir ne doivent 53. Ses ustensiles pas tre en mtal, de les laver l'eau, comme il est recommand aucune flure; les coupes du sacrifice. une cuelle de bois, un (pot) de terre ou 54. Une gourde, tels sont les ustensiles en clats de bambou, un (panier) que a dclar ceux Manou fils de l'tre existant par lui-mme, d'un ascte. et ne une fois (par jour), l'aumne 55. Il doit recueillir ; car un ascte trop avide d'aumnes pas tenir la quantit aux objets des sens. s'attache cesse de s'lever, 56. Quand la fume (de la cuisine) quand sont teints, le pilon est en repos, quand les charbons quand est range, les gens ont mang et que la vaisselle (c'est alors l'aumne. aller demander doit toujours que) l'ascte soit pas attrist ; s'il 57. S'il ne reoit rien, qu'il n'en de ce qui qu'il se contente qu'il n'en soit pas rjoui; reoit, 49. N'ayant d'autre compagnon que lui-mme : tman peut signifier aussi le moi, ou l'me . Kull. entend ainsi ayant son corps pour seul compagnon . 53. Les coupes, camasas, dont il a t question antrieurement. 57. Ses ustensiles, son bton, son pot--eau, etc. . (Kull.) Attacher
LES LOIS DE MANOU
165
est ncessaire la vie, et vite d'attacher de l'importance ses ustensiles. 58. Il doit ddaigner absolument d'obtenir l'aumne force de salutations : (car) un ascte mme (sur le point) d'obtenir la dlivrance finale, est enchan par (les aumnes) obtenues force de salutations. 59. Qu'il rfrne ses organes attirs des par les objets et en se tenant debout et sens, en prenant peu d'aliments, assis dans la solitude. 60. En domptant ses sens, en dtruisant (en lui) l'amour et la haine, en s'abstenant de faire du mal aux cratures, il devient propre l'immortalit. 61. Qu'il rflchisse aux mtempsycoses des hommes, leur chute en enfer, de leurs pchs, leurs consquence tourments dans le monde de Yama, 62. A la sparation d'avec ceux qu'on aime, la runion avec ceux qu'on hait, la vieillesse qui triomphe (de vous), la maladie qui (vous) accable, 63. A ce corps que l'on quitte, la renaissance dans un de cette me individuelle (autre) sein, la transmigration dans dix mille millions de matrices, 64. Aux peines les tres corporels, consqui affligent la flicit ternelle dont ils jouissent quence de leurs pchs, en rcompense de leur vertu. 65. Qu'il considre concentre l'essence par une mditation subtile de l'Ame suprme, et sa prsence dans tous les corps (des tres) les plus levs comme les plus infimes. de l'importance en disant : Celui-ci est vilain, je n'en veux pas; celui-l est beau, je le prends . (Kull.) 58. Sur le point : le texte dit simplement dlivr ; on peut tre considr comme dlivr mme avant d'tre mort, lorsqu'on est dans les conditions requises pour la dlivrance finale. 61. Yama, le dieu des Enfers, le Pluton hindou. 65. La mditation concentre dont il est question ici s'appelle Yoga ; ce nom dsigne aussi un systme philosophique (Cf. supra note du vers 31). L'Ame suprme paramtman est oppose l'me individuelle.
166
LES LOIS DE MANOU
66. A quelque ordre qu'il appartienne, bien qu'il ait t calomni (et priv des insignes de son ordre),qu'il accomplisse ses devoirs, toutes les cratures : car ce ne sont gal envers la vertu. pas les insignes qui constituent 67. Bien que le fruit de la strychnine clarifie l'eau, l'eau son nom. ne devient pas claire par le seul fait de mentionner il doit jour et nuit, les tres anims, 68. Pour pargner de son corps, marcher en examme au dtriment toujours minant le sol. des tres qu'il a tus invo69. Pour expier (la destruction) le jour ou la nuit, l'ascte devra se baigner et lontairement faire six suspensions d'haleine. suivant d'haleine 70. Rien que trois suspensions accomplies et des trois paroles sacramentelles la rgle, et accompagnes de la syllabe OM, doivent tre considres comme (l'acte) le d'austrit pour un Brahmane. plus parfait 71. De mme que les scories du minerai sont consumes sont dtruites des organes par la fusion, ainsi les souillures de l'haleine. par la suspension 66. Jolly lit bhshita orn (de guirlandes, etc.) , au lieu de dshita (Kull.) calomni. Au lieu de vasan sjournant dans n'importe quel ordre , il y a une autre leon ratah satisfait. La fin de ce vers rappelle notre proverbe : L'habit ne fait pas le moine. 67. Le Kataka, Strychnos potatorum : lorsqu'on frotte avec les fruits de cette plante le fond d'un vase d'eau trouble, cela fait prcipiter les impurets du liquide. Cette image est le dveloppement de l'ide prcdemment exprime, que les insignes extrieurs ne constituent pas la vertu. 68. Dans certaines sectes de l'Inde, notamment chez les Janistes, le respect des tres anims va si loin qu'ils ne boivent que de l'eau filtre, ne respirent qu' travers un voile, et s'en vont balayant le sol devant eux, de peur d'avaler ou d'craser leur insu quelque animalcule invisible . Barfch., Les Religions de l'Inde, p. 87. 70. Cf. II, 76. Les Vyhrtis c'est--dire les mots Bhh, Bhuvah, Svah. Kull. ajoute aprs OM la Svitr et le Ciras : ciras littralement tte dsigne le dbut, la strophe initiale d'un hymne; mais je ne sais quel hymne il est fait allusion. La Svitr aussi appele Gyatri, est un hymne du Rig Vda que tout Brahmane doit rpter mentalement dans ses dvotions du matin et du soir.
LES LOIS DE MANOU 72.
167
Qu'il dtruise les souillures par la suspension d'haleine, le pch par la concentration les dsirs sensuels mentale, par la rpression et les qualits (des organes), qui ne sont pas l'tre propres suprme par la mditation. 73. Par le moyen de la mditation, qu'il observe le passage de l'me individuelle travers les (divers) les plus tres, levs et les plus infimes, (passage) inintelligible pour ceux dont l'me n'a pas t rgnre du Vda). (par l'tude 74. Celui qui possde la claire vue n'est pas li par les actes ; celui qui en est dpourvu est soumis une srie de transmigrations. 75. Par le respect de la vie (des cratures), par le dtachement des (plaisirs) sensuels, par les devoirs pieux prescrits dans le Vda, par les pratiques de l'asctisme, rigoureuses on atteint ici-bas cet tat. 76. On doit quitter ce (corps) sjour des (cinq) lments, les os, pour attaches les tendons, qui a pour piliers pour ciment la chair et le sang, pour la peau, couverture qui exhale une mauvaise et d'excrodeur, qui est plein d'urine ments, 77. Qui est assailli des maladies, infirme, et les chagrins, par la vieillesse caduc. plein de passion, sige
72. Qu'il dtruise: littralement qu'il brle . Anvarn gunn les qualits qui ne sont pas propres l'Etre suprme (vara) sont suivant Kull. la colre, la cupidit, l'envie, etc. . B. H. entend ce mot tout diffremment sur lesquelles on n'exerce pas de contrle . 73. On peut prendre dhynayoga comme compos copulatif par la mditation et la concentration . 74. Qui a la claire vue, c'est--dire, suivant Kull., brahmaskshtkravant, qui possde la claire vue de l'Etre suprme . N'est pas li parles actes, c'est--dire n'est pas condamn repasser par d'autres existences, comme consquence de ses actes en cette vie. 75. Cet tat, tatpadam, qui consiste dans l'union troite avec Brahme . (Kull.) 76-77. Sjour des lments, c'est--dire compos des lments tels que la terre, etc. . (Kull.) Plein de passion, uni la qualit de passion (rajas) . (Kull.) En philosophie on reconnat trois qualits : bont, passion, obscurit (sattva, rajas et tamas). Cf. XII, 24 sqq.
163
LES LOIS DE MANOU
ou arbre se dtache du bord de la rivire, 78. Comme'un un arbre, ainsi celui qui abandonne comme un oiseau (quitte) ce corps est dlivr d'un monstre dangereux. ses ses amis ses bonnes 79. Abandonnant actions, de la il s'lve par le moyen ennemis ses mauvaises actions, l'ternel. mditation jusqu' Brahme il devient 80. Quand par la condition (de son esprit) ici-bas tous les objets, alors il atteint la flicit indiffrent et aprs la mort. 81. S'tant ainsi dfait peu peu de tous les attachements, et dlivr de toutes les (affections qui vont) deux par deux, il seul. repose en Brahme de la mdita82. Tout ce qui vient d'tre dclar dpend n'obtient tion; car celui qui ne connat pas l'me suprme pas le fruit de ses oeuvres. rela83. Qu'il rcite constamment (les parties du) Vda aux divinits, tives au sacrifice, et (celles) qui se rapportent et tout ce qui est et (celles) qui traitent de l'me suprme, expos dans le Vdnta. 84. (Le Vda) est le refuge (mme) de ceux qui (en) ignoet de rent (le vritable sens) et de ceux qui le comprennent, ceux qui dsirent le ciel, et de ceux qui aspirent l'ternit. en se confor85. Le Brahmane qui mne la vie asctique 78. Le commentaire de Kull. tablit ici une distinction entre ces deux comparaisons : L'arbre quitte le bord par ncessit, emport par le courant ; l'oiseau quitte l'arbre volontairement ; de mme l'homme quitte le corps par ncessit ou de sa propre volont. 80. Les objets des sens. 81. Deux par deux, telles que faim et satit, plaisir et peine. 82. Ce qui vient d'tre dclar, ce qui a t dit dans le vers prcdent (Kull.) relativement au dtachement de toutes choses, etc. Ses oeuvres, c'est--dire l'accomplissement des rites prescrits. 83. Le Vednta (fin du Vda), ou les Upanishads et le systme thologicophilosophique qui repose sur eux. B. runit les deux derniers termes celles qui traitent de l'me et sont contenues dans le Vednta. 85. Ici comme dans les passages prcdents, brahman est au neutre, et dsigne la divinit impersonnelle, l'Absolu, tandis que Brahm, masculin,
LES LOIS DE MANOU niant
169
aux rgles (qui viennent dans l'ordre, d'tre nonces) secou ici-bas le pch, s'lve Brahme ayant jusqu'au suprme. 86. On vous a ainsi expos la loi relative aux asctes matres de conduite maintenant la rgle d'eux - mmes ; coutez des (asctes) qui renoncent (aux pratiques prescrites par) le Vda. 87. L'tudiant, le matre de maison, l'anachorte, l'ascte, de ces quatre ordres distincts (tous) du matre proviennent maison. 88. Et tous ces (ordres) successivement embrasss confor la condition mment au trait (des lois) conduisent suprme le Brahmane qui fait ce qui a t prescrit. 89. Et d'aprs du texte sacr du Vda, les prceptes le de maison matre est dclar suprieur (aux trois autres car il les supporte tous les trois. ordres), et tous les fleuves 90. De mme que toutes les rivires aboutissent leur lieu de repos dans l'Ocan, ainsi les hommes vont (se rfugier) sous la protection des divers ordres du matre de maison. ces quatre 91. Les Dvidjas ordres doivent appartenant observer la dcuple loi. toujours soigneusement 92. Contentement, patience, empire sur soi-mme, probit, est un Dieu personnel, le crateur du monde, la plus haute des divinits du Panthon indien. J'ai traduit anena kramayogena (littralement d'aprs cette rgle successive ) en me conformant l'interprtation de Kull. B. traduit : Aprs l'accomplissement successif des actes mentionns plus haut. 86. Les asctes, yatis. Kull. en reconnat quatre varits : les Kutcaras, les Bahdakas, les Hamsas et les Paramahamsas :les premiers parmi ces yatis. les Kutcaras ngligent les rites prescrits par le Vda, tels que l'Agnihotra, etc. , et se bornent la prire et la mditation. 88. La condition suprme n'est autre chose que la dlivrance finale . (Kull.) 89. Une variante porte le Vda et la Smrti au lieu de la ruti du Vda . L. entend diffremment : le matre de maison qui observe les prceptes de la ruti et de la Smrti. 92. La science dh, est suivant Kull. la connaissance des Castras et
170 puret, vrit, 93. et qui dition 94. cout
LES LOIS DE MANOU
des sens, science, connaissance (du Vda) rpression tels sont les dix prceptes de (cette) loi. douceur, Les Brahmanes de la loi, les dix prceptes qui tudient la conles suivent, aprs les avoir tudis, atteignent suprme. Un Dvidja qui, recueilli, la dcuple loi, qui a pratique du Vednta, et qui a suivant la rgle (l'interprtation) la vie asctique. pay ses (trois) dettes, peut embrasser s'tant 95. Ayant renonc toutes les pratiques religieuses, de ses de (tous) les pchs de ses actions, matre dcharg organes, ayant tudi le Vda, il peut vivre son aise sous la de ses fils. protection 96. Ayant ainsi renonc aux pratiques uniquereligieuses, de dsirs, de son objet, ment exempt ayant tu le occup il parvient la flicit suprme. pch par la renonciation, loi des Brah97. Ainsi vous a t expose la quadruple manes, aprs la mort des fruits imp(loi) sainte, produisant les devoirs des rois. coutez maintenant rissables; autres . La connaissance du Vda ou suivant Kull. connaissance de l'me suprme . 94. Les trois dettes, cf. la note du vers 35. 95. Ayant renonc : le nom de Sannysin signifie celui qui a renonc . Abhyasyan, leon adopte par Jolly au lieu de abhyasya, signifie tudiant , plus exactement que ayant tudi . 96. Son objet la contemplation de l'Etre suprme (Kull.), ou tout simplement la dlivrance finale. La renonciation au monde, le fait d'avoir embrass la vie asctique, pravrajya. 97. Quadruple, c'est--dire concernant le novice, le matre de maison, l'anachorte et l'asote.
LIVRE
SEPTIEME Le Roi
le souve1. Je vais exposer les devoirs d'un roi, comment rain doit se conduire, (il peut quelle est son origine, comment la perfection atteindre) suprme. 2. Un Kchatriya la rgle l'initiation qui a reu suivant la doit assurer comme il convient prescrite par le Vda, de tout le (royaume). protection 3. En effet lorsque ce monde priv de rois tait troubl de tous cts par la crainte, le Seigneur cra un roi pour la de tout cet (univers), protection 4. En prenant des lments ternels Indra, au Vent, la Lune et au Dieu au Soleil, au Feu, Varouna, Yama, des richesses. 5. Attendu qu'il a t cr avec des lments (pris ) ces sur toutes les crades Dieux, il excelle en splendeur princes tures. du Soleil les yeux et les coeurs, et 6. Il brle la manire en face. sur terre ne peut mme le regarder personne 7. Par sa puissance il est le Feu, le Vent, (extraordinaire) le Dieu des le Soleil, la Lune, le Seigneur de la justice, le grand Indra. richesses, Varouna, 1. La perfection suprme : le mot siddhi peut aussi se prendre au sens de succs, russite un succs complet . 4. Yama = Pluton; Varuna, l'Ouranos des Grecs, est la personnification du ciel qui embrasse tout. Kubera ou Kuvera est le Dieu des richesses. 7. Le Seigneur de la justice dsigne ici Yama, qui juge les morts.
172
LES LOIS DE MANOU
sous pr8. Mme enfant, un roi ne doit pas tre mpris texte qu'il est un (simple) mortel, car c'est une grande divinit qui rside sous la forme humaine. l'individu 9. Le feu brle seulement qui s'en approche avec le feu du roi brle une famille (entire) imprudemment; et tous ses biens. ses troupeaux sa (propre) puisconsidr 10. Ayant mrement l'affaire, il prend tour tour des formes le lieu et le temps, sance, varies pour (assurer) le triomphe de la justice. la Desse de la 11. Celui dans la faveur rside duquel dans la valeur duquel dans la fortune, (rside) la Victoire, en lui toute colre duquel (rside) la Mort, celui-l renferme splendeur. 12. Quiconque en sa folie hait le roi prira certainement, car le roi conoit sur-le-champ la rsolution de le perdre. 13. Que (personne) donc ne transgresse la loi que le roi dcrte au sujet de ceux qu'il aime, et les ordres rigoureux (dont il frappe) ceux qu'il n'aime pas. 14. En sa faveur le Seigneur cra jadis son propre fils le de tous les tres,(personnification Chtiment, de) protecteur la justice, form de la splendeur de Brahm. 15. Grce la crainte du chtiment tous les tres mobiles et immobiles sont mme de jouir (de ce qui leur est propre) et sont maintenus dans le devoir. 10. Il prend des formes varies : Impuissant il se rsigne, devenu puissant il extermine, et ainsi dans un seul et mme temps et lieu, suivant les circonstances, il est ennemi, ami ou neutre. (Kull.) 13. En d'autres termes, on doit se conformer aux caprices de la faveuret de la disgrce royales. Ce sens autoris par le commentaire de Medh. me parait bien d'accord avec ce qui prcde. Toutefois B. H. rapporte le verbe transgresser au roi : Que le roi ne modifie jamais la loi qu'il tablit pour ceux qu'il aime, etc. La traduction de L. est encore plus loigne de celle que nous avons adopte : Que le roi ne s'carte jamais des rgles par lesquelles il a dtermin ce qui est lgal et illgal, relativement aux choses permises et aux choses dfendues. 15. Autrement le fort enlverait au faible ses biens, sa femme, etc. (Kull.) Au contraire Medh. et d'autres prennent bhoga au sens passif : permettent qu'on jouisse d'eux .
LES LOIS DE MANOU
173
et le lieu et le temps, la puissance 16. Ayant bien considr la science (du coupable), que (le roi) inflige le (chtiment) avec justice aux hommes dont la conduite est rprhensible. 17. Le chtiment est le roi, il est le mle, il est le guide et de le matre, il est reconnu comme le garant (de l'excution) la loi des quatre castes. le chtiment 18. Le chtiment seul rgit tous les hommes, le chtiment seul les protge, veille sur eux endormis ; au dire des Sages, le chtiment (est) la justice (mme). il fait le bon19. Inflig justement, aprs mre rflexion, il les mais appliqu sans rflexion, heur de tous les sujets; ruine de fond en comble. ceux 20. Si le roi n'infligeait pas sans cesse le chtiment le plus faible le plus fort rtirait d'tre chtis, qui mritent comme un poisson la broche ; le chien 21. La corneille le gteau du sacrifice, mangerait la proprit n'existerait aussi lcherait l'offrande, plus ; tout serait sens dessus dessous. car entier est maintenu 22. Le monde par le chtiment, est difficile trouver; un homme vertueux (c'est) (par nature) entier est du chtiment (que) l'univers grce la crainte mme de jouir (de ce qui lui est propre). 23. Les Dieux, les Gants, les Musiciens les clestes, eux aussi, ne peuvent Dmons,les Oiseaux,les Serpents, jouir (de ce qui leur est propre) que contenus par le chtiment. 16. Le lieu et le temps o a t commis le dlit. L. traduit aktim ca vidym ca par les moyens de punir et les prceptes de la loi . 17. Le mle les autres sont comme des femmes . (Kull.) On pourrait aussi faire de purusha une apposition au mot roi, le chtiment est un roi plein d'nergie . 21. Tout serait sens dessus dessous : Parmi les (quatre) castes, Brahmanes et autres, ceux qui sont en bas comme le Soudra, etc., deviendraient les plus levs. (Kull.) 22. Cf. la note du vers 15. 23. Ne peuvent jouir de ce qui leur est propre: C'est par la crainte du chtiment que le feu chauffe, que le soleil brille, qu'Indra, le Vent, et cinquimement la Mort se meuvent. (Kull.) Il faut entendre ici jouir
174 24. rires
LES LOIS DE MANOU
Toutes les castes seraient toutes les barbouleverses, seraient ce serait un soulvement de tous les brises, du chtiment. hommes, par suite de la destruction 25. Partout o le chtiment noir, avec ses yeux rouges, dtruisant les mchants, il n'y a pas de dsordre s'avance, les hommes, voie parmi pourvu que celui qui l'applique bien. 26. On ditqu'un roi est un (juste) excuteur (du chtiment), est vridique, lorsqu'il qu'il agit avec discernement, qu'il est en vertu, plaisir et richesse. sage et qu'il se connat 27. Le roi qui applique le (chtiment) justement prospre en ces trois choses (vertu, et richesse) ; mais le (roi) plaisir mchant et fourbe, voluptueux, prira par le chtiment mme. 28. Car le chtiment a une grande il est difficisplendeur; lement appliqu n'est pas perfectionn; par ceux dont l'esprit il dtruit avec toute sa parent un roi qui s'carte du devoir; 29. Puis il (dtruit) ses forteresses, ses ses territoires, et affligerait mme peuples, avec les tres anims et inanims, les Sages monts au ciel et les Dieux. 30. Il ne peut tre appliqu justement par un (roi) priv de dont l'esprit n'a pas t perfecconseillers, insens, cupide, tionn, qui est esclave des sens. peu prs dans le sens de remplir leurs fonctions , moins qu'on n'adopte l'interprtation passive de bhoga. Les Gants ou Dnavas, issus de Danu, qui firent la guerre aux Dieux, les Gandharvaset les Rkchasas. 25. Dtruisant les mchants, ou bien les pchs. 27. Par le chtiment mme qu'il applique injustement. 28. A une grande splendeur : L. prend ce compos comme un compos dterminatif, est une grande nergie . Perfectionn par l'tude des lois . 29. c II affligerait les Sages monts au ciel et les Dieux, parce qu'on cesserait de leur prsenter des offrandes. (Kull.) En effet, les hommes tant dtruits, il n'y aurait plus personne pour offrir les sacrifices. J'ai fait de autarikshagatnune pithte de nature jointe munn au sens de coelicolse. B. entend par l qui montent au ciel parce qu'on ne leur fait plus d'offrandes .
LES LOIS DE MANOU
175
31. C'est par (un roi) pur, fidle sa parole, observateur des lois, aid par de bons conseillers, prudent, que le chtiment peut tre (justement) inflig. 32. Qu'il se conduise dans ses tats, qu'il chtie avecjustice svrement ses ennemis, qu'il soit droit avec ses amis, et envers les Brahmanes; patient 33. La renomme d'un prince lors ainsi, qui se conduit mme qu'if vivrait de glanures, s'tend dans le monde, comme une goutte d'huile dans l'eau. 34. Mais la renomme d'un prince qui fait tout le contraire et qui n'a pas vaincu ses passions, se resserre dans le comme une goutte de beurre fondu dans l'eau. monde, 35. Le roi a t cr (pour tre) le protecteur des castes et des ordres, les suivant leur rang, qui tous, accomplissent devoirs propres chacun. 36. Tout ce qui doit tre fait par le (roi) et ses ministres des sujets, je vais vous l'exposer dment pour la protection et en ordre. 37. Lev de bonne les Brahle prince honorera heure, manes verss dans la science des trois (Vdas) et instruits et il suivra leurs conseils. (des rgles de la politique), 38. Qu'il honore constamment insles Brahmanes gs, truits dans les Vdas et purs ; car celui qui honore les vieillards est toujours mme par les Dmons. respect lors mme 39. Qu'il apprenne d'eux la modestie, toujours ne prit modeste ; car un roi modeste qu'il serait lui-mme jamais. 31. Pur en ce qui concerne l'acquisition des richesses, etc. . (Kull.) 33. Vivrait de glanures, c'est--dire mme si ses trsors taient puiss . (Kull.) 35. Les castes Brahmanes, Kchatriyas, etc. , et les ordres, novice, matre de maison, etc. . (Kull.) 37. Litt. : verss dans la triple science sacre , c'est--dire possdant la connaissance du Rg Vda, du Yajur Vda et du Sma Vda . (Kull.) Manou ne reconnat pas le quatrime Vda, l'Atharva Vda. 38. Honorer les Brahmanes, c'est leur faire des prsents. 39. Vinaya modestie , ou peut-tre bonne conduite.
176 . 40. Le
LES LOIS DE MANOU
de modestie a perdu maint roi avec son manque ont gagn de simples anachortes ; par la modestie entourage des royaumes. et le roi Nahou41. Le manque de modestie perdit Vna et Nimi. fils de Pidjavana et Soumoukha cha, et Soudas ont Prithou et Manou 42. Au contraire par la modestie et des richesses, Koubera la souverainet gagn la royaut, le fils de Gdhi le rang de Brahmane. 43. De ceux qui sont verss dans les trois Vdas il apprende la ternels dra la triple science (du Vda) et les (principes) du de l'me (suprme); connaissance politique,la logique,la des (diverses) la pratique professions. (il apprendra) peuple ses sens : car (un 44. Qu'il s'applique jour et nuit vaincre ses sens peut (seul) tenir ses sujets dans roi) qui a vaincu l'obissance. 45. Qu'il vite avec soin les dix vices produits par l'amour ainsi du plaisir, par la colre, qui que les huit engendrs (tous aboutissent ) une triste fin. 40. Son entourage ses lphants, chevaux, trsors, etc.. (Kull.) 41,42. Vena fils d'Anga, descendant de Manu Svyambhuva, devenu roi voulut interdire les sacrifices : les Sages, aprs d'inutiles remontrances, le turent avec des brins d'herbe consacre. Nahusha, roi de Pratishthna voulu, se faire porter par des Brahmanes : Comme ils allaient trop lentement son gr, il s'oublia au point de frapper la tte sacre d'Agastya en lui disant: Sarpa, sarpa (avance, avance) ; le saint irrit rpta les mmes mots, mais dans un autre sens ; dans sa bouche ils signifiaient : marche, serpent. En effet Nahusha fut chang en serpent. (Note de L.) Suds est un roi qui parat frquemment dans le Rig-Vda et la cour duquel auraient vcu les Saints rivaux Vasishtha et Vivmitra. (Cf. Dowsou. Dict. of Hindu Mythology.) Sumukha.(?). Nimi, roi de Mithil, tait fils d'Ikshvku et fut victime d'une maldiction du Sage Vasisbtha,qui lui ta sa forme corporelle. Prthu, roi de la race solaire, et descendant d'Ikshvku ; ce nom est commun bien des rois et il est difficile de dire auquel il est fait allusion ici. Manu (?). Le fils de Gdhi Vivmitra, Sage clbre, tait n Kchatriya, mais par ses austrits intenses, il s'leva la caste des Brahmanes et devint un des Sept grands Richis. Plusieurs des lgendes auxquelles il est fait allusion ici se trouvent dans les popes indiennes. 43. La politique : dandaniti signifie littralement l'application des chtiments . La connaissance de l'me [suprme), ou peut-tre la connaissance de soi-mme, tman admet les deux interprtations.
LES LOIS DE MANOU 46.
177
Car un roi adonn du aux vices produits par l'amour et sa vertu ; (adonn aux vices) plaisir perd sa richesse engendrs par la colre, (il perd) mme l'existence. 47. Lchasse, de jour, la mdisance, les ds, le sommeil la danse, le chant, la musique les femmes, et les l'ivrognerie, telle est la catgorie des dix vices produits voyages inutiles, du plaisir. par l'amour la tromperie, la calom48. La malice, la violence, l'envie, de la proprit, les injures ou les voies de nie, l'usurpation des huit vices engendrs fait, voil la catgorie par la colre. 49. Qu'il s'applique vaincre la convoitise, reconnue par tous les sages comme la racine de ces deux (classes de vices); en effet ces deux classes (de vices) en drivent. les ds^ les femmes, la chasse, ces quatre 50. La boisson, l'ordre les plus pernicieux (vices), qu'il le sache, sont suivant du plaisir. de la catgorie produite par l'amour et l'usurpation de la 51. Les voies de fait, les injures, proprit, qu'il le sache, sont les trois (vices) les plus pernicieux parmi ceux qui proviennent de la colre. 52. Un roi qui est matre de lui-mme doit savoir que dans cette classe de sept vices qui s'attachent tout, le premier est toujours plus grave (que le suivant). (nomm) 53. Du vice et de la mort, c'est le vice qui est dclar le vicieux tombe au plus profond ; un (homme) plus pernicieux de vices (va) au ciel. (des enfers), celui qui meurt exempt 54. (Le prince) doit nommer dont sept ou huit ministres, ont t au service royal, les anctres instruits, courageux, et (qui ont t) exercs aux armes, issus de (nobles) familles, examins. 46. Il perd l'existence parla colre de ses sujets. (Kull.) 48. La malice, paiunyam, c'est suivant Kull. l'action de divulguer les fautes ignores . 52. Qui est matre de lui-mme, tmavant; pourtant Kull. explique cette pithte par praasttman, dou d'une me excellente . La fin du vers signifie que par exemple la boisson est pire que le jeu, le jeu pire que les femmes, etc. 12
178
LES LOIS DE MANOU
55. Mme une entreprise facile est difficile excuter pour un seul homme ; plus forte raison un royaume qui donne de gouverner (est malais pour un roi) surtout grands revenus (s'il est) sans auxiliaires. avec eux les (questions) 56. Qu'il examine continuellement les revede paix et de guerre, l'tat (du royaume), ordinaires et de ses sujets) et la connus, la protection (de sa personne solidation (du bien) acquis. de chacun d'eux isol57. Aprs avoir consult l'opinion ment, et celle d'eux tous runis, qu'il fasse ce qui est avantageux ses affaires. concernant 58. Quant aux questions les plus importantes il doit les traiter de la politique), les six articles (principaux de tous ces (conle plus minent avec un Brahmane instruit, seillers). le char59. Plein de confiance(en celui-ci), il doit toujours avec lui, il doit ger de toutes les affaires ; aprs avoir dlibr excuter les entreprises. d'autres ministres 60. Il doit aussi intgres, dsigner bons collecteurs fermes, d'impts, prouvs. experts, 61. Autant l'excution de ses affaires requiert depersonnes, habiles et autant il doit en dsigner qui soient infatigables, exprimentes. ceux qui sont braves, 62. Parmi ces (gens) il doit prposer 55. On peut faire rapporter surtout s'il est sans auxiliaire un seul homme. 56. Ordinaires, smnyam, ou peut-tre,comme le traduit L., qui doivent tre discutes en commun . On peut aussi faire de ce mot un adverbe en commun. L'tat du royaume : sthna signifie suivant Kull. l'arme, le trsor, la capitale et le royaume . La consolidation du bien acquis. B. a adopt une autre interprtation, la sanctification de ses gains (par des dons pieux) . 58. Les six articles principaux (cf. v. 160) sont alliance, guerre, marche, campement, division des forces, recherche d'une protection , ou bien ceux qui sont nurnrs au v. 56 paix, guerre, tat du royaume, revenus, protection de sa personne et de ses sujets, et consolidation du bien acquis . 62. Aux finances, littralement au gain, aux revenus. On peut aussi construire autrement la phrase il doit employer les braves, les habiles et
LES LOIS DE MANOU
179
bien ns et intgres aux finances et l'exploitation habiles, des mines ; (quant ) ceux qui sont timides, (il doit les emde son palais. ployer) dans l'intrieur 63. Qu'il dsigne aussi un ambassadeur vers dans toutes et les gestes, les sciences, les signes, le maintien comprenant habile et bien n. intgre, d'un roi (quand il est) 64. On fait cas de l'ambassadeur dou d'une bonne mmoire, condvou, habile, intgre, le temps et le lieu (opportuns), naissant beau, brave et loquent. 65. L'arme du gnral, le maintien de l'ordre dpend de l'arme, les trsors et le royaume (dpend) (dpendent) du roi, la paix et son contraire de l'ambas(la guerre) sadeur. 66. Car l'ambassadeur seul rapproche et (les adversaires) divise les allis ; l'ambassadeur ngocie les affaires d'o rsulte la dsunion ou l'union. 67. Dans les ngociations il doit deviner le maintien, les gestes et les actes (du souverain tranger) par les gestes et les actes de ses (missaires) et (pntrer) ses intensecrets, tions par les serviteurs (de celui-ci). des inten68. Inform exactement (par son ambassadeur) ses mesures tions du souverain (le roi) devra prendre tranger, pour qu'il ne puisse lui faire aucun mal. les bien ns aux revenus, les intgres aux mines, les timides dans l'intrieur de son palais , ce qui ferait trois catgories au lieu de deux. Cette dernire prescription est ainsi justifie par le commentaire de Kull. : parce que des gens courageux, voyant frquemment le roi seul ou entour de ses femmes, pourraient le tuer l'instigation de ses ennemis. 63. Toutes les sciences : littralement tous les castras ou traits spciaux . 64. Dvou : anurakta est ici pris avec la valeur active : pourtant Kull. l'entend autrement : aim du peuple . 65. Du gnral : littralement du ministre; mais Kull. donne senpati . L. traduit : Le bon ordre dpend de la juste application des peines ; en effet le sens ordinaire de danda est chtiment. Mais ce mot est expliqu par Kull. la puissauee consistant en lphants, chevaux, chars, fantas sins, etc. .
180 69.
LES LOIS DE MANOU
Il devra habiter un pays sec, fertile en productions, surtout de salubre, peupl (entour) d'ryas, agrable, voisins pacifiques, et o la vie soit plantureuse. 70. Qu'il s'tablisse dans une ville dont l'accs est dfendu soit par un dsert, soit par de la terre, soit par de l'eau, soit soit par des montagnes. par des bois, soit par des soldats, 71. Qu'il tche autant une (ville) que possible d'occuper ; en effet parmi toutes les (autres protge par des montagnes places) une (ville) protge par des montagnes l'emporte par de nombreux avantages. 72. Parmi ces (diverses sortes de places), les trois premires les rats, les animaux sont occupes par les btes (sauvages), les trois dernires dans l'ordre par les singes, les aquatiques, les Dieux. hommes, dans leurs repaires 73. De mme que ces (tres) rfugis d'un roi ne sont l'abri de leurs ennemis, ainsi les ennemis lui faire de mal quand il est abrit dans saforteresse. peuvent 74. Un seul archer plac sur un rempart tient tte cent tiennent ; cent (archers (assigeants) tte) dix mille ; c'est l'on recommande des forteresses. pourquoi (d'avoir) de 75. La (forteresse) doit tre pourvue d'armes, d'argent, d'ende Brahmanes, d'artisans, grains, de btes de somme, et d'eau. gins, de fourrage 76. Au milieu de cette (place, le roi) doit se btir pour luimme un palais trs spacieux, toutes les propre protg, d'eau et d'arbres. saisons, resplendissant, pourvu 77. Log dans ce (palais), qu'il pouse une femme de mme les marques issue caste, (sur son corps) ayant propices, d'une grande famille, unissant la beaut et les charmante, vertus. 70. Un dsert d'une tendue de cinq yojanas . Par de la terre un mur de pierres ou de briques . (Kull.) 72. C'est--dire les dserts servent d'abri aux btes sauvages, la terre aux rats, l'eau aux animaux aquatiques, les bois aux singes, etc. 76. Protg par des fosss, des murs, etc. . (Kull.) Resplendissant de chaux . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 78.
181
des un prtre de la maison et choisisse Qu'il dsigne officiants, chargs d'accomplir pour lui les crmonies prtres et celles qui se font avec les trois feux sacrs. domestiques d'abon79. Un roi doit offrir divers sacrifices accompagns il doit donner dants prsents et en vue d'acqurir des mrites, aux Brahmanes et richesses. jouissances le tribut 80. Il doit faire dans son royaume percevoir annuel de confiance ; il doit tre (dans par des (personnes) ses rapports) avec le monde toujours observateur de la loi, et se conduire comme un pre envers ses sujets. 81. Qu'il dsigne divers inspecteurs pour tel ou intelligents tel service, de surveiller tous les actes des hommes chargs qui font ses affaires. 82. Qu'il honore (par des prsents) les Brahmanes revenus aux de la maison de leur prcepteur ; car ce (qu'il donne) d'un roi. Brahmanes est dclar le trsor imprissable 83. Ni voleurs, ni ennemis ne le peuvent ravir, et il ne se doit tre perd point ; c'est pourquoi imprissable (ce) trsor dpos par le roi chez les Brahmanes. 84. L'offrande n'est ni mise en la bouche d'un Brahmane ni dessche, ni perdue ; elle est suprieure rpandue, au feu. l'oblation 85. Le don (fait) quelqu'un qui n'est pas Brahmane une rcompense) gale (au don; fait) un (homme) (procure double ; un (Brah(une rcompense) qui se dit Brahmane, cent mille fois plus grande ; mane) instruit (une rcompense) le Vda en entier celui qui a appris (une rcompense) infinie. 78. Le prtre de la maison s'appelle purohita, le prtre officiant rtvij. 79. En vue d'acqurir des mrites : dharmrtham peut s'entendre aussi pour remplir son devoir ou bien pour la vertu . Jouissances des femmes, des maisons, des couches, etc. . Des richesses de l'or, des vtements, etc.. (Kull.) 80. Dans ses rapports avec le mon.de,ou tout simplement dans le monde . 82. Revenus de la maison de leur prcepteur, c'est--dire ayant termin leur noviciat aprs avoir tudi le Vda . (Kull.) 85. gale au don, ou bien une rcompense ordinaire.
182 86.
LES LOIS DE MANOU
du rcipient et la foi (du donaCar selon les qualits petite aprs la mort une rcompense teur), le don (procure) ou grande. ou 87. Provoqu gal, suprieur par (un adversaire) ne un roi protecteur de ses sujets infrieur (en force), d'un des devoirs le combat, se souvenant doit pas refuser Kchatriya. ses sujets, 88. Ne pas lcher pied en une bataille, protger obir aux Brahmanes, c'est pour un roi le meilleur moyen de prosprer. dans une 89. Ds rois qui dsireux de se tuer l'un l'autre le combattent avec toute leur nergie, sans tourner bataille dos, vont au ciel. 90. (Un roi) dans un combat ne doit point tuer ses ennemis ou ni avec des flches empennes avec des armes caches, ni avec des traits enflamms. empoisonnes, pied (quand lui91. Qu'il ne frappe point un ennemi ni ni un suppliant, mme est sur un char), ni un eunuque, sont pars, ni un (homme) celui dont les cheveux assis, ni celui qui dit : Je suis ton (prisonnier), sa 92. Ni un (homme) ni celui qui a quitt endormi, cuirasse, qui est nu, qui est sans armes, qui n'a point pris ou qui est (dj) qui est (simple) spectateur, part au combat, aux prises avec un autre (adversaire), 86. Il y a ici un vers interpol, rejet par Kull., dont le sens est : Un objet donn avec foi, suivant la rgle de lieu et de temps, un rcipient (digne, est) ce qui mne le devoir la perfection. 90. Suivant Kull. des armes caches sont des armes qui extrieurement sont faites en bois ou autre matire analogue, et qui renferment des pes effiles caches l'intrieur . Cette description conviendrait nos cannes pes. 91. Un ennemi pied: j'ai suivi l'interprtation de Kull. Mais le sens littral de sthalrdha est plutt mont sur une minenee (pour s'y rfugier) . Suppliant, mot mot ayant les mains jointes . Dont les cheveux sont pars, c'est--dire un fugitif . Un, eunuque ou simplement un lche, un effmin . 92. On peut runir en un seul terme celui qui est spectateur sans prendre part au combat . -
LES LOIS DE MANOU
183
dont les armes 93. Ni un homme sont brises, qui est accabl (de chagrin), bless, qui a peur ou qui est grivement les devoirs qui fuit ; qu'il se rappelle (des gens de coeur). 94. Mais le lche qui est tu en fuyant dans une bataille actions de son chef, quelles prend sur lui toutes les mauvaises soient. qu'elles 95. Et tous les mrites qu'aurait quels qu'ils soient pu monde le (lche) tuen sont gagner pour l'autre fuyant acquis son chef. 96. Voitures et chevaux, lphants, parasols, argent, tous ces objets, ainsi que les mtaux grain, btail, femmes, vils sont celui qui s'en empare. 97. Un texte du Vda dit : On doit prlever une part ' spciale (du butin) pour le roi ; le (butin) qui n'a pas t individuellement doit tre partag conquis par le roi entre tous les soldats. et ternelle des guerriers; 98. Telle est la loi irrprochable un Kchatriya en tuant ses ennemis dans le combat ne doit point s'en carter. 99. Qu'il ce qu'il n'a de tche pas encore, d'acqurir et conserver ce qu'il a acquis, d'accrotre ce qu'il conserve, de distribuer des personnes ce qu'il a augment dignes. 100. Qu'il sache que c'est l la quadruple (rgle) qui fait ce qu'il dsire ; qu'il la mette en obtenir l'homme toujours exactement sans relche. pratique 101. Ce qu'il n'a pas encore (de le conquis, qu'il tche conqurir) par les armes ; ce qu'il a conquis qu'il le conserve ; ce qu'il a conserv (par par sa vigilance qu'il l'augmente 93. Accabl de chagrin au sujet de ses enfants, etc. . (Kull.) 96. Les mtaux vils, l'exception de l'or et de l'argent . (Kull.) 97. Le texte du Vda dont il est question se trouve Aitareya-brhmana, III, 21. (Note de B.) La part du roi consiste suivant Kull. en or, argent, territoire, etc. . 99. Des personnes dignes : littralement des rcipients . 101. Des moyens propres en assurer l'accroissement : le commerce de terre et de mer . (Kull.)
184
LES LOIS DE MANOU
en assurer) l'accroissement les moyens ; ce qu'il a propres des personnes accru, qu'il le distribue dignes. le sceptre lev, qu'il fasse toujours 102. Qu'il ait toujours sa bravoure, secret ce qui doit qu'il tienne toujours paratre les points faibles de l'ennemi. tre secret; qu'il pie toujours 103. Le monde entier tremble devant celui qui a toujours le sceptre lev ; qu'il soumette donc toutes les cratures par son sceptre. 104. Qu'il procde toujours et jamais par la par la droiture sur ses gardes, des perfidie ; toujours qu'il soit au courant ruses employes par l'ennemi. 105. Les autres ne doivent son point faible, pas connatre tandis que lui doit connatre le point faible des autres ; pareil la tortue,il doit cacher ses membres et protger ses parties vulnrables. 106. Comme le hron, il doit mditer le but, comme le livre battre en retraite, le loup ravir comme (sa proie), comme le lion s'lancer l'attaque. 107. Lorsqu'il est ainsi en train de faire des conqutes, son pouvoir tous ses adversaires qu'il soumette par la conciliation et autres moyens. les 108. Si les trois premiers sont insuffisants moyens en les attaquant rduire, qu'il les soumette progressivement par la force. 109. Parmi tels que la conciliation et les quatre moyens, 102. Qu'il ait toujours le sceptre lev, c'est--dire qu'il soit toujours prt frapper . On peut aussi prendre daiida au sens d'arme : qu'il tienne toujours son arme exerce . 105. De mme que la tortue cache sa tte, ses pattes et autres membres, ainsi il doit prendre sous sa garde tous les membres de l'tat, tels que les ministres et autres. (Kull.) 106. D'autres ditions intervertissent l'ordre de ces termes : comme le livre battre en retraite est mis la fin du deuxime hmistiche, et comme le lion s'lancer l'attaque la fin du premier. 107. Ces moyens sont au nombre de quatre : conciliation, corruption, division et force . (Kull.) 108. A les rduire : littralement les arrter .
LES LOIS DE MANOU les
185
les gens instruits recommandent autres, toujours (de ' du la conciliation et la force la pour prfrence) prosprit royaume. enlve les mauvaises herbes 110. De mme que lesarcleur son royaume et et conserve le grain, ainsi le roi doit protger ses ennemis. dtruire son inconsidrment 111. Si le roi dans sa folie opprime perdre le il ne tarde royaume, pas, avec ses parents, et la vie. royaume, d112. De mme que les mauvais traitements physiques la vie chez les cratures, ainsi la vie des rois est truisent de leur royaume. dtruite par l'oppression il doit toujours 113. Pour la protection de son royaume bien son observer la rgle suivante ; car un roi qui protge royaume prospre. un corps du royaume 114. Qu'il place (comme) protection au milieu de troupes command (par un officier de confiance) de deux,.trois, cinq ou cent villages. un chef 115. Qu'il nomme un chef pour (chaque) bourg, un chef pour vingt, un chef pour cent, un pour dix bourgs, chef pour mille. au fur et informer 116. Le chef du bourg doit de lui-mme dans son bourg le chef de dix mesure des crimes commis le chef de vingt et celui-ci ( son tour doit en avertir) bourgs, bourgs. doit notifier 117. Le chef de vingt bourgs son son tour de cent bourgs, et celui-ci en rfrer au chef de mille bourgs. tre fournies 118. Les choses qui doivent roi par les habitants, ( savoir) les aliments, combustibles et autres, le chef du bourg les sa subsistance). le tout au chef doit lui-mmev jour au chaque les les boissons, (pour percevra
111. Inconsidrment ou peut-tre par une conduite injuste. 115. Grma signifie village, mais la dnomination de bourg me parat plus approprie ici.
186
LES LOIS DE MANOU
119. Le chef de dix bourgs aura pour sa part un koula, le chef de vingt bourgs en aura cinq, l'administrateur de cent le revenu) d'un le (percevra bourgs (tout entier), bourg de mille bourgs seigneur (celui) d'une ville. 120. Les affaires communales de ces (bourgades), ainsi que les affaires doivent tre particulires (des administrateurs) contrles du roi, loyal et infatigable. par un autre ministre 121. Qu'il nomme dans chaque ville un administrateur d'une haute situation, d'un extrieur gnral, terrible, pareil une plante parmi des toiles. 122. Ce dernier doit lui-mme constamment visiter tous ces (fonctionnaires) et s'assurer exactement de leur conduite dans (leurs) provinces, de ses agents secrets. par le moyen 123. Car les intendants du roi prposs la protection (du deviennent des prvaricateurs peuple) gnralement qui le bien d'autrui ses sujets ; (le roi) doit protger s'approprient contre eux. 124. Les (fonctionnaires) de malhonntes, qui prennent des plaideurs, le roi doit confisquer tous leurs biens l'argent et les bannir. 125. Aux femmes employes son service et tous ses le roi doit allouer des gages quotidiens domestiques, proportionns leur rang et leur office. 126. Un salaire d'un pana doit tre allou au plus infime, et de six au plus lev, plus une livre tous les six mois et un drona de grains par mois. 119. Kula, littralement famille, c'est--dire ici un territoire suffisant nourrir une famille, est ainsi dfini par Kull. autant de terre qu'en peut labourer une paire de charrues atteles de six boeufs. Ville, pura, oppose grma, bourg ou village. 120. Le premier hmistiche est un peu obscur. L. traduit les affaires de ces communes, soit gnrales, soit particulires. Au contraire B. rapporte teshm aux fonctionnaires : les affaires de ces (fonctionnaires) qui sont relatives (leurs) villages, et leurs affaires spares. 11faut noter l'interprtation de prthak kryni par Nr. les querelles qu'ils ont les uns avec les autres. 122. Ses agents secrets : Kull. ajoute dlgus dans chaque province. 126. Un pana : cf. VIII, 136, pour la valeur de cette monnaie de cuivre,
LES LOIS DE MANOU
1S7
1es taxes en prenant 127. (Le roi) fera payer aux marchands en considration les (prix) d'achat et de vente, (la longueur ainsi que (les de nourriture, de) la route, les frais accessoires les marchandises. ncessaires) pour assurer dpenses fixer dans le roi doit toujours 128. Aprs (mr) examen, et les impts de telle manire son royaume que lui-mme celui qui fait le travail, y trouvent avantage. leur le veau et l'abeille 129. Comme la sangsue, prennent nourriture petit petit, ainsi (c'est) petit petit (que) le roi doit tirer de son royaume les impts annuels. la cinquantime 130. Le roi peut prlever partie des troule sixime ou le douzime des peaux et de l'or, le huitime, grains. 131. Il peut prendre aussi la sixime de partie des arbres, des la viande, du miel, du beurre des parfums, clarifi, des fleurs, racines et fruits, des essences, drogues, des lgumes, des herbes, des peaux, des 132. Des feuilles, en jonc, des vases de terre et de tout ce qui est en (ustensiles) pierre. un roi ne doit point lever 133. Mme mourant (de besoin) et un Brahmane de taxe sur un Brahmane instruit, instruit, dans ses tats, ne doit point y mourir habitant de faim. un Brahmane 134. Le roi dans les tats duquel instruit sous peu son royaume dsol meurt de faim (verra) par la famine. et de sa mora135. Aprs s'tre assur de son instruction cls moyens d'existence lit, le roi doit lui assigner lgaux, encore usite aujourd'hui dans l'Inde. Le droiia est le boisseau, mais l'quivalence exacte de cette mesura n'est pas tablie. La livre se compose d'une paire de vtements vastrayuga, c'est--dire un vtement de dessus et un vtement de dessous. Suivant Kull. l'augmentation doit porter aussi sur les livres et les grains : on doit donner au plus lev six paires de vtements tous les six mois et six dronas de grains tous les mois. 127. Les frais accessoires de nourriture, ou peut-tre la nourriture et les assaisonnements. 130. Des grains suivant l'excellence ou la mdiocrit du sol . (Kull.) 135. Lgaux dharmya conformes la Loi. (Kull.)
188
LES LOIS DE MANOU-
et le protger de toute manire, comme un pre (ferait) pour son propre fils. 136. Tous les actes pieux que (ce Brahmane) accomplit sous la protection du roi accroissent la lonjournellement et le royaume du souverain. gvit, la richesse 137. Le roi fera payer chaque anne une modique redevance titre d'impt aux gens de basse classe qui vivent de trafic dans son royaume. aux artisans, aux Soudras 138. Quant aux ouvriers, vivant de leur travail manuel, le roi les fera travailler (pour lui) une fois par mois. 139. Qu'il ne coupe point sa racine ni celle des autres par une excessive car en coupant sa racine (ou la leur) il avidit, rend malheureux lui ou les autres. 140. Ayant examin affaire, que le roi se montre (chaque) svre ou doux (suivant le cas) ; un roi qui est svre et doux ( propos) est estim. les affaires des gens, 141. Quand il est fatigu d'examiner sa place son premier ministre, (un homme) qu'il mette connaissant les lois, sage, matre de lui-mme, issu d'une (bonne) famille. 142. Rglant ainsi toutes les affaires qui lui incombent, avec dvouement et zle ses sujets. qu'il protge 143. (Le souverain) par qui (laisse) enlever de son royaume des brigands ses sujets plors, sous ses yeux et sous ceux de ses ministres, est un (roi) mort et non (un roi) vivant. 137. De trafic : il s'agit ici de ce que nous appelons le petit commerce : Ceux qui achtent et vendent des objets de peu de prix, tels que lgumes, plumes et autres. (Kull.) 139. Qu'il ne coupe point sa racine : Quand par affection pour ses sujets il ne prlve pas les impts, les taxes, etc., il coupe sa propre racine; quand par excs d'avidit il prlve des impts normes, il coupe la racine des autres. (Kull.) 140. Ayant examin (chaque) affaire : kryam vikshya signifie peut-tre simplement selon le cas , que j'ai du reste suppl. 141. Qu'il mette sa place : littralement qu'il mette sur ce sige. i>
LES LOIS DE MANOU 144.
189
c'est de protger Le devoir suprme d'un Kchatriya vient ses sujets: car le roi, jouissant des avantages qu'on est tenu ce devoir. d'numrer, s'tant veille (de la nuit), 145. S'tant lev la dernire les fait les oblations au feu, rvr recueilli, purifi, ayant salle des auil entrera dans la somptueuse Brahmanes, diences. et les congtous ses sujets 146. tant l, il contentera avec ses il dlibrera diera ensuite ; ses sujets congdis, ministres. ou bien se retirant 147. Montant au faite d'une colline, ou dans une fort dserte, l'cart sur la terrasse (du palais), avec eux, sans tre observ. qu'il dlibre sont ne dont les dlibrations 148. Le souverain pas connues du commun des mortels assembls, jouira de la terre soit dpourvu de trsors. entire, quoiqu'il 149. Au moment de la dlibration, qu'il loigne les idiots, les personnes les muets, les aveugles, les sourds, les animaux, les estropis. les barbares, les malades, ges, les femmes, 145. On peut runir les deux termes ayant fait avec recueillement les oblations au feu . On a vu plus haut ce qu'il fallait entendre par rvrer les Somptueuse bhm : Brahmanes : c'est leur donner des prsents. Kull. explique ainsi cette pithte pourvue des marques de bon augure qu'une maison doit avoir. 146. Ses sujets qui sont venus pour le voir, et il les rjouira en causant avec eux, et en les regardant (avec affabilit) . (Kull.) 147. Au faite: littralement sur le dos . 148. Assembls, terme un peu vague. B. supple dans le but de dcouvrir ses desseins . Jouira de la terre entire veut dire qu'il sera invincible. 149. Les animaux qu'on peut s'tonner de voir en pareille compagnie sont les perroquets, corneilles et autres oiseaux bavards . (Kull.) Sur le rle des oiseaux divulgateurs des secrets, suivant les croyances des Hindous, on peut consulter le curieux roman de Subandhu, intitul Vsavadatt. Il est probable cependant que ce n'est pas seulement la crainte des indiscrtions qui fait exclure toutes les catgories d'tres figurant sur cette liste, car on ne conoit gure quelle indiscrtion on pourrait avoir redouter d'un sourd. Sans doute que leur prsence tait considre comme portant malheur.
190
LES LOIS DE MANOU
les dlibratrahissent 150. Car (ces tres) mprisables les les animaux et particulirement et de mme tions, contre eux. femmes ; aussi doit-on se prcautionner 151. A midi ou minuit, le corps et l'esprit qu'il reposs, dlibre soit avec ses ministres, soit tout seul, sur la vertu, le plaisir et la richesse, ces 152. Sur (les moyens) (en mme temps) d'acqurir de ses filles et l'une l'autre, sur le mariage choses opposes sur la protection de (ses) fils, des sur l'achvement 153. Sur l'envoi des ambassadeurs, de sur la conduite (des femmes) entreprises (commences), son harem, sur les faits et gestes de ses missaires, 154. Et sur toutes les huit affaires (d'un roi), et sur les sur la bienveillance oula malveillance cinq classes (d'espions), des tats environnants. et sur la conduite (de ses voisins), 155. (Qu'il mdite) avec soin sur la conduite du (prince 150. Mprisables : c'est en punition de fautes commises dans une vie antrieure, qu'ils ont t affligs d'idiotie, etc . (Kull.) 152. La protection c'est--dire l'ducation . 153. Sur l'envoi des ambassadeurs : ou bien en faisant de ce compos un copulalif sur les ambassadeurs et les envoys . De son harem : Kull. rappelle judicieusement que le roi Vidratha fut tu par sa femme avec un poignard cach dans les tresses de ses cheveux, et le roi de Ki avec un npura (anneau pour les chevilles) empoisonn. 154. J'ai omis un adverbe de remplissage soigneusement . Les commentateurs diffrent sur l'explication des huit affaires d'un roi, et en proposent plusieurs. Voici celle de Kull : les revenus, les dpenses, les ordres aux ministres, la prvention des dlits, la dcision des cas douteux, l'examen des affaires judiciaires, le chtiment, les expiations. Medh. en propose deux autres : entreprendre ce qui n'est pas fait, complter ce qui a t fait, amliorer ce qui a t complt, recueillir les fruits des actes, plus la conciliation, la corruption, la division et la force (cf. v. 107) ; ou bien, commerce, agriculture, construction de digues, lever des forteresses, prendre des lphants, creuser des mines, faire camper les troupes, dfricher les forts vierges . L'explication de Kull. qui parat la plus acceptable est tire du Ntistra de Uanas. Les cinq classes d'espions sont: les espions ordinaires, les anachortes dgrads, les agriculteurs sans ressources, les marchands ruins, les faux pnitents. 155. Littralement du prince intermdiaire ; madhyamane signifie pas, comme le traduit L., celui qui a des forces mdiocres , mais celui qui,
LES LOIS DE MANOU dont
191
le territoire sur les faits et gestes du est) intermdiaire, du sur la conduite (prince) qui rve de faire des conqutes, neutre et (sur celle) de (son) ennemi. (prince) 156. Ces (quatre) lments en rsum la souche (forment) des tats circonvoisins ; en outre huit autres sont numrs ; tels sont les douze lments dclars les (principaux). 157. (Il y en a) encore cinq autres ( savoir) : les ministres, le royaume, les forteresses, les trsors, l'arme ; ces (cinq) compts pour chacun (des douze font) en rsum (un total de) soixante-douze. comme 158. (Le roi) doit considrer ennemi (tout prince de ainsi immdiat, qui est son voisin) que le partisan ami ( le voisin ) immdiat de son ( cet ) ennemi ; comme et comme neutre ennemi, (celui) qui est au del de ces deux-ci. tous par la conciliation et autres 159. Qu'il les gagne soit runis, soit spars, (ou bien) par la bravoure moyens, et la politique (seules). 160. Qu'il songe sans cesse aux six procds (qui sont : la guerre, faire) alliance, marcher, (entreprendre) camper, une protection. diviser (ses forces), chercher situ entre le territoire de l'ennemi et celui du prince ambitieux, et incapable de leur rsister s'ils sont unis, peut leur tenir tte quand ils sont aux prises . (Kull.) 156. Les quatre lments sont ceux qui figurent dans le vers prcdent. Les tats circonvoisins : mandata signifie littralement cercle, c'est--dire les tats environnants. Les huit autres sont, suivant Kmandaki (Nitisra, VIII) cit par Kull., en avant des territoires ennemis : 1) l'ami ; Z") l'ami de l'ennemi ; 3") l'ami de l'ami ; 4) l'ami de l'ami de l'ennemi, et en arrire : 5J celui qui attaque par derrire ; 6) celui qui est attaqu par ce dernier ; 7") l'alli de celui qui attaque par derrire ; 8) l'alli de celui qui est attaqu par ce dernier. 159. On a vu vers 107 que les quatre moyens sont : concili ation, corruption, division, force. 160. Diviser (ses forces), diviser ses propres forces dans son intrt . (Kull.) D'autres entendent par l diviser l'ennemi . Chercher une protection : lorsqu'on est press par l'ennemi, se mettre sous la protection d'un roi plus puissant . (Kull.)
192
LES LOIS DE MANOU
161. Ayant examin le parti prendre, il doit (suivant le cas) se dcider camper, marcher, (faire) alliance, attaquer, diviser (ses forces), ou chercher une protection. 162. Un roi doit savoir qu'il y a deux sortes d?alliances et de guerres, de marcher, de camper, de (deux manires) diviser (ses forces) et de chercher protection. 163. On doit reconnatre deux espces d'alliances procurant dans le prsent et dans l'avenir : celle o l'on (des avantages) agit de concert, et au contraire (celle o l'on agit sparment). 164. La guerre est dite de deux sortes, (soit) qu'on l'entrede son propre mouvement, dans un but personnel, en prenne ou inopportun, la fasse pour temps opportun (soit qu'on l'injure venger) (faite) un alli. 165. La marche est dite de deux sortes : quand on (se met tout en route) seul, en cas d'affaire urgente surgissant d'un alli.coup, ou quand on est accompagn 166. Le campement est dit de deux sortes : (on reste dans soit quand) on a t affaibli peu peu par le destin l'inaction, de fautes antrieures, soit en considration ou (en punition) d'un alli. les avantages des six procds 167. Ceux qui connaissent des forces est de deux sortes : lorsque disent que la division s'arrte l'arme (en un lieu) et le chef (en un autre) pour d'une entreprise. assurer la russite 161. Le parti prendre : littralement ce qui doit tre fait kryam signifie peut-tre tout simplement l'affaire . 162. On peut aussi entendre dvaidham division (des forces) comme un adjectif s'accordant avec samrayam une double manire de chercher protection , comme le traduit B. Cette interprtation rduit cinq le nombre des procds ici indiqus. Mais au vers 167 il est dit que la division des forces est de deux sortes , ce qui justifie notre traduction. 167. Une partie des troupes, lphants, chevaux, etc., sous la conduite d'un gnral, est envoye d'un ct pour faire face l'attaque du roi ennemi, d'autre part le roi avec quelques troupes reste dans sa forteresse. (Kull.) Au reste le sens du vers demeure obscur, car le roi d'un ct, l'arme de l'autre, cela ne constitue pas un double systme de division des forces : on attendrait encore un second exemple.
LES LOIS DE MANOU
193
168. La recherche d'une protection est aussi dite de deux sortes : lorsqu'on cherche . se roi) press par ses ennemis mettre l'abri de leurs attaques, ou bien (lorsqu'on cherche ) d'un prince passer parmi les gens vertueux (pour le protg puissant). 169. Quand (un roi) entrevoit est assure que sa supriorit dans l'avenir, et (que) pour le moment prsent (il n'a qu'un) il doit alors recourir aux ngolger dommage ( souffrir), ciations amicales. 170. Quand il estime que tous ses sujets sont parfaitement satisfaits et que lui-mme est au fate de la puissance, il doit alors faire la guerre. 171. Quand il estime que ses propres troupes sont dans des et en bon tat, et qu'il en est tout autredispositions allgres ment (de celles) de l'adversaire, alors l'ennemi. qu'il marche 172. Mais quand il est faible en quipages et en troupes, il doit alors soigneusement se tenir en place, en se rconciliant peu peu avec ses ennemis. 173. Quand le roi estime que ses ennemis sont tout fait en puissance, en deux ses forces, alors, divisant suprieurs ses fins. qu'il tche d'arriver il peut facilement 174. Mais quand tre attaqu par les forces de ses ennemis, alors bien vite sous la qu'il se mette d'un prince juste et puissant. protection 168. Cherche se mettre l'abri de leurs attaques : littr. dans le but d'atteindre un avantage ; mme lorsque dans le moment il n'est pas press par l'ennemi, par crainte d'une agression de ses ennemis futurs, il se met sous la protection d'un prince puissant . (Kull.) Je ne sais ce que l'auteur entend ici par les gens vertueux . 169. Ngociations amicales : littr. alliance . 170 Prakrti dsigne les sujets ou bien, comme l'entend B. H., les lments de l'tat sont florissants . Ces lments ont t indiqus au v. 157, ministres, trsor, royaume, forteresses, arme . 171. Il est remarquer que Manou semble subordonner la dclaration de guerre uniquement l'avantage qu'on espre en retirer, et nullement au principe du droit et de la justice. 172. quipages : lphants, chevaux, etc. (Kull.). 173. Divisant ses forces, cf. note du v. 167. A ses fins qui sont d'arrter l'ennemi . (Kull.) 13
194
LES LOIS DE MANOU
l'gal 175. Qu'il honore de tout son pouvoir, toujours d'un prcepteur la fois et ses celui qui contient spirituel, et les forces de ses ennemis. sujets (dsobissants) lui fait 176. Mme alors s'il remarque que cette protection la guerre. du tort, qu'il n'hsite pas recourir 177. Un prince vers dans la politique devra faire en sorte ni ennemis ne que ni allis, ni neutres, par tous les moyens lui soient suprieurs. 178. Qu'il considre exactement l'avenir et le prsent de les avantages toutes les entreprises, et les dsavantages de toutes (les actions) passes. 179. Celui qui sait les avantages et les dsavantages au conseil dans le prsent et qui venir, qui est prompt les consquences des actions n'est jamais conoit passes, domin par ses ennemis. 180. Qu'il dispose tout de manire que ni allis, ni neune le tiennent en leur dpendance tres, ni ennemis, ; telle est en somme la (vraie) politique. une expdition contre 181. Mais si le prince entreprend il doit marcher sur la un royaume ennemi, progressivement de l'adversaire de la manire capitale qui suit. 182. Le prince doit se mettre en marche dans le joli mois de Mrgasrcha ou vers les mois de Phlgouna et de suivant Tchaitra, (l'tat) de ses troupes. 183. Mme d'autres s'il entrevoit une victoire poques, ou si une calamit a frapp son ennemi, il peut certaine, marcher en prenant l'offensive. 176. Au lieu de sa yuddham, Kull. et d'autres lisent suyuddham, bravement . 182. Mrgarsha, novembre-dcembre : pour l'pithte de joli, il faut tenir compte de la diffrence des climats. Phlguna, fvrier-mars; Caitra, mars-avril. L'tat de ses troupes : le roi qui dsire conqurir un royaume tranger, et dont la marche est retarde par des lphants et des chars, doit entrer en campagne en hiver, au joli mois de mrgarsha; celui qui a des troupes de cavalerie, et dont la marche est rapide, doit se mettre en campagne au printemps, aux mois de phlguna et de caitra . (Kull.).
LES LOIS DE MANOU
195
184. Ayant pris ses dispositions dans (sa propre) capitale et dment ce qui est ncessaire l'expdition, (prpar) et plac propos des espions, ayant assur ses positions de routes et les six 185. Ayant les trois sortes prpar sur la ville corps de troupes, qu'il marche progressivement suivant les principes de la stratgie. ennemie, d'un alli qui favo186. Il doit se dfier particulirement rise secrtement et d'un (transfuge) l'ennemi, qui aprs avoir est revenu pass ( l'ennemi) ( lui) ; car (ce sont l) les ennemis les plus dangereux. 187. Il doit marcher sur son chemin, son arme ayant ou de sanglier, ou range en forme de bton, ou de chariot, de dauphin, ou d'aiguille, ou (d'oiseau) garouda. 188. De quelque ct qu'il apprhende le danger, il doit ses troupes de ce ct, et lui-mme se placer toujours tendre (au centre) d'un bataillon dispos comme un lotus. 189. Qu'il place le gnral et le commandant des troupes dans toutes les directions, et qu'il tourne le front de bataille du ct d'o il craint le danger. 184. Mla, capitale ; B. son (royaume) originel . Assur ses positions, spada est un terme un peu vague : B. sa base d'oprations ; L. ayant ramass des provisions ; Kull. explique autrement, ayant gagn les mcontents du parti adverse . 185. Les trois sortes de routes plaines, marais, forts . Les six corps de troupes lphants, chevaux, chars, infanterie, le gnral et les ouvriers . (Kull.) Les principes de la stratgie, cf. v. 192. 187. Suivant le commentaire, voici comment il faut entendre ces divers termes de comparaison : bton en tte le commandant des troupes, au milieu le roi, derrire un gnral, sur les deux flancs les lphants, prs d'eux les chevaux, puis les fantassins ; chariot l'avant en forme de pointe, l'arrire large ; sanglier l'avant et l'arrire troits et le centre large ; dauphin le contraire du sanglier (c'est--dire le eentre troit, l'avant et l'arrire larges ; l'aiguille une colonne allonge ; le garuda pareil au sanglier, sauf que le centre est plus large . Garuda, oiseau mythologique, fils de Kayapa et de Vinat, frre d'Aruna, cocher du soleil et l'ennemi des serpents. 189. Le commandant des troupes et le gnral n'tant que deux, il semble difficile de les placer dans toutes les directions.
196
LES LOIS DE MANOU
190. Qu'il place en tous sens des rgiments srs, ayant et attaquer, des signaux sachant rsister convenus, intrpides et fidles. un petit nombre 191. Qu'il fasse combattre (de soldats) en serrs ; qu'il tende son gr des (forces) nombreuses ; rangs (ses troupes) ranges en forme d'aiguille qu'il fasse combattre ou de foudre. avec les chars et la 192. En (pays) plat qu'il combatte avec des barques et sur un (terrain) cavalerie, marcageux couvert d'arbres et de sur un (terrain) des lphants, buissons avec des arcs, sur un plateau avec des pes, boucliers (et autres telles) armes. du les hommes 193. Qu'il fasse combattre l'avant-garde les hommes du les Matsyas, les Pantchlas, Kouroukchtra, Sorasena et (autres) qui sont grands et agiles. 194. Aprs avoir rang ses troupes, ; qu'il qu'il les exhorte leur conduite les passe soigneusement en revue et constate l'ennemi. quand elles chargent il doit camper et ravager 195. Quand il a bloqu l'ennemi, ses de (l'adversaire) et dtruire continuellement le territoire son eau et son combustible. ses vivres, fourrages, les 196. Il doit aussi dtruire les tangs, les remparts, et lui causer des alertes fosss, harceler pendant (l'ennemi) la nuit. ceux qui sont accessibles 197. Qu'il tche de corrompre de ce qui est fait la corruption et qu'il se tienne au courant ; quand le destin est favorable, qu'il combatte (par l'ennemi) sans peur, dsireux de la victoire. 198. Par la conciliation, la corruption, la division (em190. Des signaux convenus au moyen de timbales, tambours et conques . (Kull.) 191. En forme de foudre les troupes rparties en trois corps . (Kull.) 193. Cf. II, 19. Ces provinces sont situes au nord de l'Inde. 197. Accessibles la corruption : les parents de son ennemi qui aspirent au trne et les ministres mcontents . (Kull.) 198. Cf. v. 107 et note, sur les quatre moyens de venir bout d'un ennemi.
LES LOIS DE MANOU
197
ensemble ou sparment, ployes) qu'il tche de triompher de ses ennemis, mais jamais par le combat. 199. Car lorsque deux (adversaires) sont aux prises dans un combat, on ne voit pas (d'une faon) certaine (de quel ct ou la dfaite ; par consquent sera) la victoire qu'il vite la bataille. 200. Si toutefois les trois expdients inprcdemment alors, (bien) prpar, diqus n'ont pas russi, qu'il combatte ses ennemis. pour vaincre il doit adorer les Dieux et (honorer) 201. Aprs la victoire les Brahmanes vertueux des immunits et ; il doit accorder l'amnistie. proclamer 202. Aprs s'tre enquis en dtail des voeux de tous les du pays conquis), un (souverain) de. (habitants qu'il y installe la dynastie et lui impose des conditions. (vaincue) 203. Qu'il fasse respecter les lois (du pays) telles qu'elles sont tablies, et honore par des (prsents de) pierres prcieuses ce (nouveau roi) ainsi que les grands personnages. 204. La confiscation des biens convoits le mconproduit le don (de ces mmes biens) engendre l'affection : tentement, sont recommandables suivant la circons(ces deux actions) tance. 205. Toute ici-bas est soumise l'ordre du entreprise destin et ( l'action) de l'homme ; mais de ces deux, le destin est insondable, tandis que dans (les affaires) humaines l'action est connue. 201. Il doit adorer les dieux. Kull. explique ceci d'une manire qui me semble peu naturelle : ayant conquis un royaume tranger, il doit adorer les dieux qui y sont (adors) . Honorer les Brahmanes, c'est, comme on l'a vu plus haut, leur faire des prsents. L'amnistie : littr. l'absence de crainte. Les immunits sont suivant Medh. des exemptions de taxes pour un an ou deux . 205. Ici-bas : le texte porte seulement idam. Par le destin il faut entendre suivant Kull. la rsultante des bonnes et mauvaises actions dans une vie antrieure . Le destin est insondable, dans les (actions) humaines il y a mre rflexion : c'est pourquoi c'est par les efforts humains qu'il faut tcher d'atteindre le but . (Kull.)
198
LES LOIS DE MANOU
206. Ou bien (le vainqueur) peut encore conclure soigneusement une alliance avec (le vaincu) et s'en retourner (chez lui), considrant que les trois fruits (d'une expdition sont) un ami, de l'or et du territoire. 207. Examinant dans les tats environnants (le prince) et l'adversaire de ce dernier, qui le menace par derrire qu'il tire le fruit de son expdition (du vaincu devenu) son alli ou (rest) son ennemi. de l'or et du territoire un prince ne 208. En acqurant prospre pas autant qu'en se faisant un alli fidle, qui, bien deviendra) puissant par la suite. que faible (d'abord, 209. Un alli (mme) faible est estim (s'il est) vertueux, faisant le bonheur de ses sujets, dvou et reconnaissant, ferme dans ses entreprises. 210. Les sages considrent comme trs dangereux un ennemi de noble race, brave, adroit, libral, qui est clair, reconnaissant et ferme. des hommes, cl211. Noblesse, connaissance bravoure, extrme sont toujours les vertus mence, libralit (qui doivent) briller dans un prince neutre. 212. Que le princen'hsite pas abandonner,pour (sauver) mme un pays agrable, fertile et en crales sa personne, riche en troupeaux. de l'adversit,qu'il 213. En prvision mnage sesrichesses; ses richesses son pouse ; qu'il pour sauver qu'il sacrifie son pouse et ses richesses sa sacrifie toujours pour sauver propre personne. 206. Vrajet qu'il s'en retourne ou peut-tre qu'il traite . Les trois fruits : en faisant la paix avec le vaincu, il exige de lui qu'il soit son alli, lui paye un tribut et lui cde un territoire. 207. Ce vers un peu obscur veut dire qu'avant de partir en expdition le prince conqurant doit assurer ses derrires. 208. Ce vers rappelle le mot de Salluste (Jugurtha) : Non exercitus neque aurum praesidia regni Sunt, verum amici. 209. Faisant le bonheur de ses sujets : j'entends ainsi tushtaprakrti, moins qu'on ne prfre le prendre au sens de dont la nature est contente, c'est--dire content , comme le traduit B. H.
LES LOIS DE MANOU
199
214. Un (prince) fondre sage qui voit toutes les calamits la fois sur lui, doit employer, runis ou spars, tous les (quatre) expdients. ces trois choses, celui qui entreprend, 215. Considrant et tous les moyens s'efforce runis, qu'il l'entreprise d'atteindre le but. avoir ainsi avec ses ministres sur 216. Aprs dlibr toutes ces (questions), avoir de l'exercice et s'tre pris midi en son harem pour y dner. le roi entrera baign, 217. L il mangera des aliments par des servi(prpars) les moments teurs dvous, connaissant et incor(propices) auront et (bnis) par ; (ces aliments t) prouvs ruptibles les poisons. les formules qui neutralisent 218. Il doit purifier toutes ses affaires avec des drogues les poisons, et avoir toujours soin de porter qui neutralisent l'effet des poisons. des pierres prcieuses qui dtruisent de confiance dont les robes et les orne219. Des femmes ments ont t examins, devront l'venter et lui prsenter l'eau et les parfums. avec prvenance 220. Il doit galement des prcautions pour ses prendre ses aliments, sa ses lits, ses siges, son bain, voitures, toilette et tous ses ornements. 221. Aprs dner il peut se rcrer avec ses femmes dans le harem ; mais aprs la rcration, qu'il songe de nouveau aux affaires en temps voulu. 214. Cf. note du v. 107. 215. Celui qui entreprend, c'est--dire lui-mme . (Kull.) 216. De l'exercice en faisant des armes, etc. . (Kull.) Kull. rapporte midi s'tant baign . 217. Les moments propices, c'est--dire simplement l'heure des repas . (Kull.) prouvs ; parmi les moyens d'preuve, Kull. cite le suivant : en prsence d'un aliment empoisonn, les yeux de l'oiseau cakora deviennent rouges . Quant l'effet des mantras neutralisant les poisons, on en peut voir un curieux exemple la fin du drame de Priyadarsik. 218. Ses affaires aliments et objets (dont on se sert) . (Kull.) 219. Examins dans la crainte qu'elles ne portent une arme cache, ou que leurs ornements ne soient enduits de poison . (Kull.) Cf. note du v. 153.
200
LES LOIS DE MANOU
222. Ayant mis son costume, en qu'il passe de nouveau armes revue ses guerriers, tous ses chars, et quipements. 223. Les dvotions du crpuscule il (ira) bien accomplies, retir couter les rapports de ses arm dans un appartement missaires secrets et de ses espions. 224. Puis congdiant tous ces gens, et passant dans un il entrera de nouveau dans le autre retir, appartement escort des femmes harem, ( son service) pour y dner. avoir de nouveau aliments et 225. Aprs pris quelques de musique, s'tre rcr au son des instruments qu'il se et se lve repos de ses fatigues. couche en temps convenable 226. Telles sont les rgles que doit observer un prince bien il est indispos, il peut confier toutes ces portant ; quand (affaires) ses ministres. 222. Vhana, terme trs gnral, comprend les lphants, les chevaux, les chars . (Kull.) 223. Bien arm, de peur d'un attentat de la part de ses espions. 224. On ne voit pas bien pourquoi il doit passer dans un autre appartement secret avant d'entrer au harem.
LIVRE Lois civiles
HUITIEME et criminelles.
1. Un roi dsireux end'examiner les affaires judiciaires trera au Palais de justice avec un maintien modeste (accomet de conseillers expriments. pagn) de Brahmanes 2. L, assis ou debout, la main droite leve, modeste dans ses habits et ses ornements, il examinera les affaires des plaideurs. 3. Il (jugera) l'une aprs l'autre, quotidiennement d'aprs les principes tirs des usages locaux et des traits (de lois), les (causes) ranges sous les dix-huit : titres (suivants) 4. Le premier de ces (titres) des est le non-payement dettes; 3) la vente (d'une (les autres sont': ) 2) les dpts; ; 4J les associations ; chose) dont on n'est pas le propritaire des choses donnes; 5j la reprise 5. 6)Le des gages; d'un 7) la rupture non-payement contrat ; 8) la rdhibition des achats et des ventes ; 9J les contestations entre matre (du troupeau) et berger ; 6. 10j La loi (relative sur les limites; aux) disputes 11) les voies de fait, et 12J les injures; 13J le vol ; 14J la violence; 15^) l'adultre; 7. 16J Les devoirs du mari et de la femme; 17J le partage ; 18J le jeu et le pari ; tels sont les dix-huit (des successions) ici-bas les procs. points sur lesquels portent 8. S'appuyant sur la Loi ternelle, les procs qu'il tranche 4. Le non-payement des dettes : rndnam peut s'entendre de deux faons, soit adnam le non-payement, soit dnam le recouvrement.
202 des hommes qui sont
LES LOIS DE MANOU gnralement en contestation sur ces
sujets. 9. Si le prince ne fait pas lui-mme l'examen des affaires, clair de les examiner. qu'il charge alors un Brahmane 10. Ce dernier entrera dans l'auguste tribunal accompagn de trois assesseurs, et debout ou assis, il connatra des affaires la juridiction du roi). (soumises 11. (La cour) o sigent trois Brahmanes verss dans le Vda et un (juge) clair dsign par le roi, s'appelle la cour de Brahm ( quatre faces). 12. Mais quand la justice blesse se prpar l'injustice sente au tribunal sans qu'on lui retire le dard, les juges sont blesss. (eux-mmes) 13. Ou il ne faut pas entrer au tribunal, ou il faut (y) dire la vrit; un homme qui ne parle point ou qui parle fausest coupable. sement 14. Partout o la justice est dtruite la par l'injustice, vrit au vu des juges, ceux-ci par le mensonge, (galement) sont dtruits. 15. Dtruite, la justice elle protge; dtruit; protge, la justice, de peur de dtruire c'est pourquoi gardons-nous ne nous fasse prir. que la justice dtruite 16. Caria justice divine est un taureau ; celui qui lui fait du tort est considr par les Dieux comme un homme de caste il ne faut pas violer la justice. vile; voil pourquoi 11. A quatre faces est suppl par le commentaire. Brahm a quatre ttes ; il en avait originairement cinq, mais l'une d'elles fut brle par le feu de l'oeil de Siva, pour avoir parl de lui irrespectueusement : de l les pithtes de caturmukha quatre faces ou de ashtakarna huit oreilles . 12. Dharma dsigne la Justice personnifie. Sont blesss par ce dard de l'injustice . (Kull.) 15. Suivant Kull. ce vers est une admonestation adresse par les assesseurs au juge prt violer la justice. 16. La justice est reprsente sous la forme d'un taureau vrsha : celui qui lui fait du tort, alam, est donc un Vrshala, homme de caste vile. Inutile de faire remarquer que cette tymologie est tout fait fantaisiste, d'autant plus que alam n'a gure ce sens.
LES LOIS DE MANOU 17.
203
La justice est le seul ami qui (vous) suive mme dans en mme la mort; car toute autre chose va la destruction temps que le corps. 18. Un quart de l'injustice sur retombe (d'un jugement) l'auteur un quart sur le tmoin (du mfait), (qui a menti), un quart sur tous les juges, un quart sur le roi. le roi est sans reproche, 19. Au contraire les juges exempts sur son auteur, (tout entire) (de pch), et la faute retombe le chtiment est chti. quand celui qui mrite 20. Un (Brahmane) mrite que sanaissance, qui n'a d'autre ou un Brahmane au gr du roi interqui se dit tel, peuvent prter pour lui la Loi, mais jamais un Soudra. 21. Lorsqu'un roi laisse sous ses yeux un Soudra rendre la justice, son royaume s'abme comme une vache dans une fondrire. 22. Un royaume de Soudras, infest d'athes et rempli bientt de Brahmanes tout entier, prit dpourvu ravag par la famine et les pidmies. assis sur le sige et avoir 23. Aprs s'tre de justice ador les (Dieux) protecteurs du monde, (le roi) revtu (de doit et recueilli commencer l'examen des son costume) causes. 24. Considrant ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, et surtout ce qui est juste et injuste, les examine toutes qu'il affaires des plaideurs suivant l'ordre des castes. 25. Par des signes extrieurs (tels que) la voix, le teint, 18. Un quart : littr. : un pied pda du taureau qui symbolise la justice. 20. Littr. : un Brahmane qui subsiste seulement en vertu de sa naissance, de sa caste, et qui ne remplit pas les devoirs d'un Brahmane (Kull.), c'est-dire qui n'tudie pas le Vda et n'accomplit pas le sacrifice. Un Brahmane qui se dit tel dont l'origine est douteuse . (Kull.) Le commentaire ajoute dfaut d'un Brahmane instruit, il peut employer un Kchatriya, voire mme un Vaisya connaissant le code des lois . 22. Athe : littr. celui qui dit qu'il n'y a pas un autre monde . 24. Et surtout : l'expression kevala est un peu obscure : littr. la justice et l'injustice seules . Suivant l'ordre des castes veut dire qu'il doit s'occuper d'abord des Brahmanes, puis des Kchatriyas, etc.
204
LES LOIS DE MANOU
la mine, les yeux, le maintien, les gestes, le qu'il dcouvre caractre intime des gens. 26. Par la mine, les gestes, la dmarche, le maintien, le du regard et de la voix se trahit langage, par les modifications la pense intrieure. 27. C'est au roi de prserver le patrimoine d'un mineur, ce qu'il soit revenu (de noviciat) ou qu'il soit sorti jusqu' de l'enfance. 28. Qu'il protge aussi les femmes striles, celles qui n'ont celles qui sont fidles pas de fils, celles qui sont sans famille, leurs poux (absents), les veuves et les infirmes. 29. Un roi juste punira du chtiment des voleurs les parents qui usurpent leur vie. (le bien) de ces femmes pendant 30. Le roi fera garder en dpt pendant trois ans le bien dont le propritaire est inconnu de ces ; avant l'expiration trois ans le propritaire au del (de ce peut le reprendre, terme) le roi a le droit de se l'approprier. sui31. Celui qui dit : Ceci est moi doit tre examin la forme, le nombre et vant la rgle ; s'il (peut) spcifier il doit tre remis les autres (renseignements), en possession de l'objet. 32. Mais s'il ne (peut) exactement le lieu et le indiquer la couleur, la forme et les moment (o l'objet a t) perdu, il mrite une amende dimensions, gale (la valeur de) cet (objet). du devoir des hommes 33. Se souvenant de bien, le roi sur un bien perdu et retrouv la sixime la prendra partie, dixime ou la douzime. 34. Un objet perdu et retrouv doit demeurer sous la garde 27. Le patrimoine d'un mineur dpouill par un oncle indigne, etc. (Kull.); la minorit finit avec la seizime anne remarque Kull. 30. Le roi aprs l'avoir fait proclamer au son du tambour pour retrouver le possesseur . (Kull.) 33. A titre de droit de garde il prlvera un douzime la premire anne, un dixime la seconde, un sixime la troisime . (Medh.) 34. Retrouv par les gens du roi . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
205
le de (personnes) choisies exprs ; ceux qu'il surprendrait voler, le roi les fera craser par un lphant. C'est 35. Si un homme dit avec vrit d'une trouvaille: moi , le roi a le droit d'en prendre le sixime ou le douzime. 36. Mais celui qui fait une fausse dclaration doit payer une amende de son propre bien ou une (gale) au huitime assez petite portion du trsor, aprs qu'on l'aura valu. 37. Quand un Brahmane instruit trouve un trsor cach car il mme en entier, jadis (en terre), il peut se l'approprier est le seigneur de toutes les choses. 38. Si le roi trouve un trsor ancien cach en terre, qu'il en donne moiti aux Brahmanes, moiti et mette (l'autre) dans son trsor. des trsors anciens et des 39. Le roi a droit la moiti mtaux (qu'il (qui sont) en terre pour prix de la protection du sol. donne ses sujets) et en qualit de matre 40. Le bien ravi par des voleurs doit tre rendu par le roi quelque caste (qu'il appartienne) ; le roi ( son propritaire) ce bien se rendrait de vol. coupable qui s'approprierait les la justice, 41. (Un roi) qui connat aprs avoir tudi celles des celles des (diverses) lois des castes, provinces, des familles, doit (les) faire et celles rgner corporations (comme) sa propre loi. 35. Soit que la trouvaille ait t faite par lui ou par un autre (Kull.); le sixime ou le douzime suivant que cet homme est sans qualits, ou pourvu de qualits. (Kull.) Cette interprtation est dj propose par le mme au vers 33. 36. Ici, comme prcdemment, l'alternative est subordonne au manque de vertus ou la possession de vertus del personne. (Kull.) 37. Kull. contredit l'opinion de Medh. Govind. et Nr. qui entendent prvopanihitam jadis cach , au sens de cach par ses anctres . 39. La moiti au cas o il ne sont pas pris par un Brahmane clair . (Kull.) 40. Doit tre rendu lorsque le roi a pu le reprendre aux voleurs . (Kull.) 41. Littr. : qu'il tablisse sa propre loi , On peut aussi entendre avec B. tablir la loi particulire chacune d'elles (des castes, provinces) . Kull. fait une restriction, c'est que les coutumes particulires ne soient pas en contradiction avec les textes sacrs .
206
LES LOIS DE MANOU
42. Car les gens qui s'occupent de leurs affaires et se renferment dans leurs occupations deviennent chers propres bien qu'ils soient loigns. (tout) le monde, 43. Le roi et les hommes du roi ne doivent soujamais lever d'eux-mmes un procs, ni touffer un procs commenc par un autre. 44. De mme que le chasseur dirige ses pas par les traces de sang du daim (bless), ainsi le roi doit diriger la marche de la justice par induction. 45. Observant les rgles de la procdure, la qu'il examine le fait (en question), sa propre les tmoins, vrit, personne, le lieu, le temps et la forme (particulire du cas). 46. Toutes (les coutumes) verpratiques par les Dvidjas tueux et justes, qu'il les fasse observer (comme des lois), si elles ne sont pas en contradiction avec les (usages) des proet des castes. vinces, des familles 47. Quand un crancier lui pour un recouvres'adresse ment d'argent sur un dbiteur, il doit forcer le dbiteur rendre au crancier (que celui-ci) prouvera l'argent (avoir t prt par lui). 48. Pour contraindre son dbiteur le payer, un crancier tous les moyens de le faire (peut employer) susceptibles rentrer dans son bien. 49. Par des moyens moraux, par un procs, par la ruse, et en cinquime lieu par la force, (le par la coutume tablie, crancier) peut recouvrer l'argent prt. 45. Vyavahravidhau sthitah signifie peut-tre, comme le traduit B., lorsqu'il est engag dans une procdure au lieu de observant les rgles de la procdure . 49. Les moyens moraux : dharma est comment par la mdiation conciliatrice des amis et parents . Procs : vyavahra, suivant Medh., signifie que quand le dbiteur est insolvable, on le force travailler pour s'acquitter de sa dette . La ruse consiste lui emprunter quelque chose qu'on refuse de lui rendre jusqu' ce qu'il ait pay. La coutume tablie carita, en tuant la femme, les enfants, le btail du dbiteur, et l'emmenant sa maison avec des coups, etc. .
LES LOIS DE MANOU
207
50. Le crancier lui-mme son bien sur son qui recouvre dbiteur ne doit pas tre rprimand par le roi pour avoir repris ce qui lui appartenait. 51. Si un (dbiteur) nie une dette, et qu'elle soit prouve avec vidence, payer la somme au cran(le roi) l'obligera ses moyens. cier, plus une petite amende proportionne 52. Si le dbiteur somm devant le tribunal de rendre, nie doit indiquer le lieu (o s'est fait le (la dette), le demandeur autre preuve. prt) ou donner quelque 53. Celui qui dsigne un lieu faux, ou qui aprs l'avoir se rtracte, celui qui ne s'aperoit dsign pas que sa dclaration antrieure contredit sa dclaration subsquente, 54. Celui qui aprs avoir dclar ce qu'il fallait dclarer, revient sur un fait dment (sur son dire), celui qui, interrog reconnu (par lui), ne s'en tient pas ( ce qu'il a dit), 55. Celui qui s'entretient avec les tmoins dans un lieu qui ne convient celui qui ne veut pas (rpas cet entretien, une question celui qui est pondre) pose (expressment), contumace, 56. Celui qui somm de parler ne parle pas, celui qui ne celui qui ne sait pas (ce qu'il prouve pas ce qu'il a avanc, faut dire) en premier lieu et en dernier lieu ; tous ces gens-l leur procs. perdent 57. Celui qui dit : J'ai des tmoins lui , et lorsqu'on , ne peut le faire, pour les (mmes) rpond : Montre-les raisons doit tre dbout par le juge. 50. Rprimand. Suivant Kull. le sens est le roi ne doit pas l'empcher de reprendre son bien . 53. Un lieufaux, adea ou bien un lieu impossible . Une autre leon suivie par L. et B. porte adeyam un tmoin qui n'est pas sur les lieux au moment du prt . (Kull.) 54. Dment reconnu par lui : c'est l'interprtation de Kull. On peut aussi entendre bien tabli . 56. Ce qu'il faut dire, ou bien suivant Kull. le premier (point), c'est-dire la preuve, et le second (point), c'est--dire la chose prouver . 57. Pour les mmes raisons prcdemment nonces (Kull.), parce que son cas rentre dans ceux qu'on vient de mentionner.
208 58.
LES LOIS DE MANOU
la loi tre ne parle pas, il doit d'aprs Si le demandeur ne rpond pas si le (dfendeur) puni de prison ou d'amende; il perd en toute justice son dans un dlai de trois quinzaines, procs. une dette, et celui qui la 59. Celui qui nie faussement tous deux par le roi, rclame ( tort), devront tre condamns de la justice, une amende double (del violateurs (comme) somme en litige). (la requte) d'un 60. Celui en justice qui comparat et qui interrog crancier, (par le juge) nie la dette, doit tre du roi ou convaincu au moins par trois tmoins en prsence du Brahmane (dlgu par lui). 61. Je vais numrer sortes de gens peuvent tre quelles tmoins d'un procs et cits comme cranciers, par des la vrit doit tre atteste comment par ces (tmoins). de maison, les (pres) qui ont des en62. Les matres fants mles, les gens du pays, (qu'ils soient) Kchatriyas, cits par le demandeur, ont droit de ou Soudras, Vaisyas sauf en cas , mais non d'autres tmoigner quelconques, d'urgence. 63. Dans les procs on peut citer comme tmoins des gens de toute caste, srs, connaissant tous leurs devoirs, exempts de cupidit ; mais il faut viter ceux qui sont (d'un caractre) oppos. 64. On ne doit prendre ni ceux qui ont (comme tmoins) un intrt dans l'affaire, ni les amis, ni les compagnons, ni les ennemis, ni ceux qui ont t surpris mentir (dans une autre circonstance), ni ceux qui sont atteints ni de maladie, ceux qui sont souills (de pchs mortels), 61. Un procs pour recouvrement de dettes ou autre chose . (Kull.) On voit par l que les prceptes suivants s'appliquent toutes sortes de tmoins en gnral. 62. Les gens du pays : maula signifie aborigne, autochtone ; les cas d'urgence sont indiqus aux v. 69 et 72. 64. Compagnons : ou suivant Kull. domestiques . A mentir : littr. ceux qu'on a vus en faute.
LES LOIS DE MANOU 65.
209
ni le roi, ni un Ne peuvent tre pris comme tmoins ni un tuni un acteur, ni un (Brahmane) instruit, artisan, ni un (ascte) renonc aux attaches diant, (avec le ayant monde), de mauvaise 66. Ni un esclave, ni un (homme) rputation, ni un ni un barbare, ni celui qui exerce un mtier dfendu, ni ni un enfant, ni un (homme vieillard, seul), ni un infirme, un (homme) qui il manque un sens, 67. Ni un (homme) ivre, ni un fou, afflig, ni un (homme) ni un (homme) tourment par la faim et la soif, ni celui qui ni ni celui qui est en proie l'amour, est accabl de fatigue, celui qui est en colre, ni un voleur. les 68. Les femmes doivent tmoigner pour les femmes, Dvidjas du mme rang pour les Dvidjas, les Soudras honntes les hommes des castes infrieures pour les Soudras, pour ceux des castes infrieures. 69. (Au cas o le dlit a t commis) dans l'intrieur d'une ou dans une fort, et s'il y a eu mort d'homme, habitation, du fait peut porter a connaissance quiconque tmoignage entre les deux parties. 70. Faute (de mieux), une femme, un enfant, un vieillard, un esclave, un lve, un parent, un serviteur peuvent porter dans de telles circonstances). (tmoignage 71. Mais (comme) les enfants, les vieillards, les infirmes ainsi que (les personnes) dont l'esprit est drang mentent on doit considrer leurs dpositions (parfois) en tmoignant, comme peu sres. 65, Ni un tudiant : Kull. explique lingastha par tudiant , mais le sens est peut-tre plus gnral, un ascte . 66. Un barbare, un Dasyu un homme cruel, un brigand . (Kull.) Un homme seul : testis unus, testis nullus. 68. Les femmes dans les contestations entre femmes, pour recouvrement de dettes, etc. . (Kull.)Du mme rang de la mme caste . (Kull.) Des castes infrieures, les Cndlas et autres pour les Cndlas et autres . (Kull.) 70. Dans de telles circonstances : celles qui ont t mentionnes au vers prcdent. 14
210
LES LOIS DE MANOU
72. Dans tous les (cas de) violence, vol, adultre, outrages difficile sur les et voies de fait, il ne faut pas se montrer tmoins. doit le souverain des tmoignages, 73. En cas de division ; en cas d'galit de) la majorit accepter (la dposition ceux qui sont distingus il s'en rapportera) (numrique, mrites d'gal) ; s'il y a division (entre des tmoins parleurs aux Brahmanes. mrite (il s'en rapportera) ou oculaire 74. Le tmoignage fond sur une constatation est acceptable sur un ou-dire ; un tmoin qui en pareil cas dit la vrit ne perd ni sa vertu ni ses biens. 75. Un tmoin une assemble de gens qui dit, devant en autre chose que ce qu'il a vu, est prcipit honorables, enfer aprs sa mort, et perd le ciel. sans avoir t expressment cit (comme 76. Si quelqu'un a vu ou entendu chose, et qu'on l'interroge tmoin) quelque ce sujet, il doit dposer conformment ce qu'il a vu ou entendu. 77. Un homme de convoitise, (tout seul), qui est exempt peut (dans certains cas) tre (admis) comme tmoin, mais non cause de l'inconstance mme honntes, femmes, plusieurs de l'esprit non plus que d'autres hommes souills fminin, de pchs. 78. Ce que (les tmoins) dclarent de leur propre mouvement doit tre admis comme intressant le procs ; mais s'ils dclarent toute autre chose, cette (dclaration) est sans valeur pour la justice. 72. Violence : incendies de maisons, etc. . (Kull.) 73. Aux Brahmanes : c'est le sens ordinaire de dvijottama ce qu'il y a de mieux parmi les Dvidjas . Kull. entend par l les plus accomplis des Dvidjas qui remplissent leurs devoirs religieux . 74. Ses biens parce qu'il n'y a pas d'amende pour lui . (Kull.) 75. Assemble de gens honorables, littr. d'ryas. Suivant Govind. il faut entendre par l une assemble de Brahmanes . 77. Un homme tout seul : restriction la rgle du v. 66. 78. De leur propre mouvement sans tre influencspar la crainte, etc. . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 79.
211
en Les tmoins tant runis dans la salle du tribunal, le juge doit d'abord' du demandeur et du dfendeur, prsence : les interroger en leur parlant amicalement en ces termes 80. Tout ce que vous savez avoir t fait de part et d'autre en cette avec affaire, dites-le par les deux (parties) car vous tes ici pour tmoigner. vrit; en dposant, obtient 81. Un tmoin qui dit la vrit et ici-bas la plus fortunes, (dans l'autre vie) les rgions haute renomme est honor de Brahm ; un tel tmoignage (lui-mme). 82. (> Celui qui porte un faux tmoignage est enchan fortement de Varouna, contre sa volont, par les liens cent existences en dire la vrit ; il faut donc pendant tmoignant. 83. Par la vrit un tmoin est purifi ; par la vrit la la vrit doit tre dite par ; c'est pourquoi justice prospre les tmoins de toutes les castes. 84. Car l'me elle-mme est le tmoin de l'me, et l'me est le refuge de l'me ; ne mprise donc pas ton me, ce tmoin par excellence des hommes. 85. Les mchants en effet se disent : Personne ne nous voit ; mais les dieux les voient et leur conscience aussi. 86. Le ciel, la terre, les eaux, le coeur (humain), la lune, le soleil, le feu, Yama, le vent, la nuit, les deux crpuscules et la justice connaissent la conduite de tous les tres corporels. des (images des) dieux 87. Le matin, en prsence et des 82. Les liens de Varouna signifie des noeuds de serpent ou bien l'hydropisie. (Kull.) On sait que l'hydropisie est une maladie spcialement attribue Varuna. Varuna, l'Ouranos des Grecs, est une personnification du Ciel qui embrasse tout. 85. Leur conscience : littr. l'homme, le mle (purusha), l'esprit qui est en eux . Ce purusha est quelque chose comme le dmon socratique. 86. Le coeur humain : c'est--dire le purusha du vers prcdent. Je considre les v. 80-86 comme faisant partie de l'allocution du juge aux tmoins. Mais il est possible que le v. 80 seul soit dans la bouche du juge. Yama est le juge des morts, le Minos hindou.
212 Brahmanes,
LES LOIS DE MANOU
aux doit demander tant purifi (le juge) la vrit, le visage de tmoigner purifis Dvidjas (galement) vers le Nord ou l'Est. tourn en l'interrogeant; 88. Parle , doit-il dire un Brahmane un Dis la vrit , doit-il dire un Kchatriya; (quanta) au nom de) son btail, deses grains, (il doit le sommer Vaisya entous (les crimes) de son or, un Soudra (en rappelant) la dchance de caste (que voici) : tranant d'un l'assassin 89. Les lieux (de tourments) assigns d'une femme ou d'un enfant, celui au meurtrier Brahmane, seront ta (demeure qui fait du tort un ami, ou un ingrat, aprs la mort) si tu parles faussement. tes bonnes actions toutes 90. Honnte homme, depuis chose si tu dis autre ta naissance iront aux chiens, (que la vrit). 91. 0 homme de bien! Tandis que tu penses de toi : et les Je suis seul , cet (tre) sage qui voit les bonnes en ton coeur. mauvaises actions rside toujours 92. C'est le dieu Yama fils du Soleil qui rside en ton avec lui, tu n'as pas coeur ; si tu n'es pas en dsaccord besoin d'aller au Gange, ni (au pays des) Kourous. 93. Nu et ras, tourment par la faim et la soif, aveugle, il ira demander l'aumne la porte de son avec une sbile ennemi celui qui porte un faux tmoignage. 94. Le malhonnte dans un (homme) qui interrog une question, tombe dbat judiciaire faussement rpond et les ten enfer, la tte la premire, dans l'obscurit nbres. 88. Un Vaisya, en lui disant : Tu serais aussi coupable pour une dposition fausse que pour un vol de vache, de grains ou d'or. (Kull.) 89. Je traduis te comme gnitif du pronom personnel. En le prenant comme dmonstratif le sens est ces (lieux) seront (la demeure) de celui qui parle faussement . 92. C'est--dire tu n'as pas besoin d'aller faire des plerinages aux lieux saints.
LES LOIS DE MANOU
213
95. Celui qui devant un tribunal dit (une chose) conest ou dont il n'a pas t tmoin traire la ralit, oculaire, du poisson avec les artes . comme un aveugle mangeant d'homme 96. Les dieux ne connaissent pas en ce monde aucune dont l'me claire meilleur que celui n'prouve en tmoignant. apprhension dont un des parents 97. Ami, coute par ordre le nombre faux tmoin cause la perte, et dans quel cas. 98. Par un mensonge propos de petit btail il en perd il en perd dix, propos de vaches cinq, par un mensonge propos de chevaux il en perd cent, par un par un mensonge il en perd mille. propos de personnes mensonge propos d'or, il perd ceux qui 99. Par un mensonge propos de terre sont ns et natre, par un mensonge il perd toutes les choses ; ne dis donc pas de mensonge propos de terre. propos de l'eau (d'un 100. On dit qu'un (mensonge) charnels avec les femmes, tang ou d'un puits), des plaisirs des pierres soit produites prcieuses par l'eau, soit de nature (celui qui concerne) est quivalent la terre. minrale, tous ces pchs en 101. Considrant (qu'on commet) dclare toute chose faussement, tmoignant promptement comme tu l'as entendue ou vue . font le les troupeaux, 102. Les Brahmanes qui gardent un mtier, ou sont acteurs, exercent commerce, domestiques comme des Soudras. usuriers, (le juge) doit les traiter 95. Avec les artes il se promettait du plaisir et n'en retire qu'une grande peine . (Kull.) 96. Aucune apprhension : ne se demande pas si elle dira la vrit ou un mensonge . (Kull.) 98. Il en perd cinq est expliqu de deux 'manires : il les envoie en enfer ou bien il se rend aussi coupable que pour le meurtre de cinq parents . (Kull.)A propos de personnes : c'est--dire d'esclaves . (Kull.) 100. Les pierres prcieuses, les perles ou les diamants. 102. Doit les traiter comme des Soudras : en demandant leur tmoignage il doit les interroger comme les Soudras (Kull.); cf. v. 88. pour la formule qu'on adresse aux Soudras.
214 103. sachant Dans
LES LOIS DE MANOU
cas celui qui dit une chose, tout en (certains) dans l'intrt de la justice, ne qu'il en est autrement, des dieux. perd pas le ciel : on appelle cela le langage d'un Vaisya, d'un Kchatriya, 104. Si la mort d'un Soudra, de la vrit, doit rsulter de la dclaration d'un Brahmane, est : car un tel (mensonge) il faut dire alors un mensonge la vrit. prfrable faire du pch 105. La meilleure expiation qu'on puisse c'est d'offrir Sarasvat les gteaux de ce faux tmoignage, la desse de l'loquence. consacrs une oblation 106. Ou bien on peut suivant le rite rpandre des (vers) clarifi dans le feu en l'accompagnant de beurre Varouna Kochmnda ou de l'hymne qui commence par adresses aux eaux. Oud, ou des trois invocations 107. Un homme (refuse de) porter qui sans tre malade au bout de de prt ou autre, dans une (affaire) tmoignage la dette et (de plus paye) trois quinzaines endosse entire, au roi). de la somme (comme amende un dixime dans les sept jours survient 108. Le tmoin qui auquel ou la mort une maladie, un incendie suivent sa dposition, la dette et une payer doit tre contraint d'un parent, amende. font dfaut, 109. Dans les procs o les tmoins (le juge) la vrit les deux connatre srement entre ne pouvant au moyen devra (tcher adverses, de) la dcouvrir parties du serment. 103. Dharmatas dans l'intrt de la justice ou par un motif pieux . Kull. donne comme exemple par piti, etc. , cf. le vers suivant. Ce prcepte est d'une application dlicate. 104. Le commentaire restreint ce prcepte au cas d'un dlit commis dans un moment d'garement . 105. Sarasvat, nom d'une rivire, dsigne aussi la desse de l'loquence et l'pouse de Brahm. 106. Les textes Kshmnda se trouvent Taitt. ran., X, 3-5, l'hymne Varuna Rig Veda, I, 24,15. Les trois vers adresss aux eaux Rig Veda, X, 9, 1-3. (Note deB.). 108. Parce que ces vnements sont considrs comme une punition cleste pour avoir faussement dpos.
LES LOIS DE MANOU
215
ont t faits et par les grands 110. Des serments sages et cas (douteux), et certains) pour (claircir par les dieux Vasichtha mme pronona un serment devant le roi (Soudas) fils de Pidjavana. 111. Un homme sage ne doit jamais prter un faux serdans une affaire insignifiante; car celui qui prte ment,mme se perd en ce monde et dans l'autre. un faux serment de ma112. (Toutefois d'amour, quand il s'agit) d'affaires d'une vache, de combustible (pour le riage, de la nourriture il n'y a point de pch ou pour aider un Brahmane, sacrifice), mortel (prter un faux) serment. 113. Que le (juge) fasse jurer un Brahmane par (sa) vraun Vaisya par cit, un Kchatriya par son char et ses armes, ses vaches, ses grains et son or, un Soudra (en le menaant de tous les pchs graves. du chtiment) du feu (dans sa main) 114. Ou bien il l'obligera prendre la sous l'eau, ou mme toucher ou plonger sparment tte de chacun de ses enfants et de sa femme. 115. Celui que le feu allum ne brle pas, que l'eau ne bref fait pas surnager, auquel il n'arrive point de malheur dlai, doit tre tenu pour justifi par son serment. 116. Car jadis quand Vatsa fut accus par son frre cadet, 110. Suds, cf. VII, 41 : Vivmitra ayant accus par-devant le roi Suds Vasishtha d'avoir dvor ses cent fils, celui-ci se justifia en prtant serment . (Kull.) 112. Celui qui a plusieurs femmes et qui dit : Je n'en aime aucune autre, c'est toi qui est ma prfre , dans le but d'obtenir les plaisirs de l'amour ; voil en ce qui concerne les matresses ; en ce qui concerne un [mariage, quand on dit : C'est toi seule que j'pouserai. (Kull.) Pour les autres cas la saintet du but excuse le mensonge, la fin justifie les moyens. 113. Cf. v. 88. Les pchs graves ceux qui entranent la dchance . 114. C'est le jugement de Dieu. Toucher sparment en sorte que l'imprcation retombera non seulement sur lui-mme, mais sur la tte de ses enfants et de sa femme. 115. L'preuve de l'eau consiste rester longtemps sous l'eau sans reparatre la surface. 116. Jadis le Richi Vatsa fut accus par son jeune frre consanguin
216 le
LES LOIS DE MANOU
du monde, un ne (lui) brla feu, cet espion pas mme en considration de sa vracit. cheveu, a t donn 117. Toutes les fois qu'un faux tmoignage et ce qui dans un procs, sur l'affaire, (le juge) devra revenir a t fait sera dfait. 118. Un tmoignage crainte, erreur, (donn) par cupidit, et enfantillage est dclar amiti, amour, colre, ignorance nul. de 119. Je vais numrer sortes par ordre les diverses chtiments ( infliger) celui qui rend un faux tmoignage pour n'importe quel de ces motifs. 120. (Celui qui tmoigne devra faussement) par avarice si c'est par erreur, l'amende du payer mille panas; (il payera) il payera deux amendes premier degr ; si c'est par crainte, intermdiaires il payera fois ; si c'est par amiti, quatre l'amende du premier degr ; 121. Si c'est par amour, dix fois l'amende du (il payera) interpremier degr ; si c'est par colre, trois fois l'amende deux cents en mdiaire ; si c'est (panas) par ignorance, seulement cent. entier ; si c'est par enfantillage, 122. Telles sont les amendes dit-on, que les sages fixrent, de la justice et pour le faux tmoignage, pour la sauvegarde la rpression de l'injustice. et bannir ensuite 123. Un roi juste doit mettre l'amende (les hommes des) trois castes (infrieures) quand ils ont rendu un faux tmoignage ; quant un Brahmane, (il se contentera de) le bannir. Maitreya de n'tre pas un Brahmane et d'tre le fils d'une femme Soudra ; C'est faux,dit-il, et pour justifier son serment il passa par le feu. (Kull.) 118. Enfantillage : peut-tre cela signifie-t-il parcequ'on est enfant. le tmoignage d'un enfant est nul. 120. Cf. v. 138. L'amende du premier degr = 250 panas, l'amende intermdiaire =500 panas, l'amende du degr suprieur = 1,000. 121. L'amende intermdiaire : littr. l'autre . 123. Cf. v. 380o il est dit qu'on ne doit jamais toucher aux biens o la personne d'un Brahmane.
LES LOIS DE MANOU
217
124. Manou fils de l'tre existant a dsign par lui-mme dix endroits le chtiment aux (gens des) pour (y appliquer) trois (dernires) il doit partir castes ; (quant au) Brahmane, sain et sauf. 125. (Ce sont) les organes la langue, le ventre, gnitaux, les deux mains, et cinquimement les deux pieds, l'oeil, le les biens et le corps (entier). nez, les deux oreilles, 126. Aprs avoir scrupuleusement le mobile, le examin lieu et le temps (du crime), et considr les facults (du coule chdu) dlit, que le roi fasse tomber pable) et (la nature timent sur ceux qui le mritent. dtruit la bonne renomme 127. Un chtiment injuste et ternit sa gloire (aprs sa mort), (d'un roi) en ce monde, d'aller au ciel ; il doit mme dans l'autre monde l'empche donc s'en garder. 128. Un roi qui punit ceux qui ne mritent pas de punide se couvre tion, et qui ne punit pas ceux qui en mritent, et tombe en enfer (aprs sa mort). dshonneur 129. Qu'il punisse d'abord par de (simples) paroles, ensuite en troisime lieu par une (plus svres), par des reproches enfin par une peine corporelle. amende, est insuffisante rprimer 130. Si la peine corporelle les contre eux mme tous les quatre (coupables), qu'il emploie modes de punition ensemble. 131. Les dnominations usites sur terre, en vue des transactions entre les hommes, certaines pour (dsigner quantits et or, je vais les numrer sans de) cuivre, argent exception. 132. La particule tnue de que l'on voit dans un rayon travers le grillage soleil pntrant (d'une fentre) est la plus un atome flottant. petite unit de poids et s'appelle 133. Sachez que huit atomes flottants en poids (quivalent) 125. Le corps entier la mort pour les grands crimes . (Kull. ) 126. Les facults la richesse, la force physique, etc. . (Kull.) 132. Atome flottant ou plus exactement atome tremblant, trasarenu.
218
LES LOIS DE MANOU
un grain de moutarde une lente, trois de celles-ci noire, blanche. trois de ceux-ci un grain de moutarde blanche font un grain d'orge 134. Six grains de moutarde font un krichnala, trois grains cinq moyens d'orge moyen, font un souvarna. seize mchas font un mcha, krichnalas font un pala, dix palas font un dha135. Quatre souvarnas doivent tre consirana ; deux krichnalas pess ensemble drs comme un mchaka d'argent. ou un pourna 136. Seize de ceux-ci (font) un dharana karcha de cuivre est un pana ; mais sachez qu'un d'argent ou un krchpana. considrs 137. Dix dharanas doivent tre (d'argent) souvarnas comme un satamna ; le poids de quatre d'argent un nichka. s'appelle du 138. Deux cent cinquante panas sont dclars l'amende comme (l'amende) premier (degr), cinq (cents) sont considrs du plus haut (degr). mille comme (l'amende) intermdiaire, il doit 139. Quand la dette a t reconnue (par le dbiteur) ; s'il nie (la dette il payera) payer cinq pour cent (d'amende) de Manou. le double : tel est le prcepte en accroisse140. Un prteur pourra prlever d'argent l'intrt fix par Vasichtha ment de son capital, (c'est-partie du cent par mois. dire) la quatre-vingtime des gens vertueux, des devoirs 141.' Ou bien se souvenant il prendra deux du cent (par mois) ; car celui qui prenddeux d'usure. du cent n'est pas coupable 134. Krshnala baie noire de VAbrus precatorius. Le kyshnala ou raktik (par corruption ratti) est encore usit par les joaillers et les orfvres et correspond 0,122 grammes ou 1,875 grains. (Note de B.) Msha := fve. 136. Un karsha est le quart d'un pala. (Kull.) 139. Cette amende lui est inflige pour avoir oblig son crancier le faire comparatre en justice. S'il nie la dette et que le demandeur la prouve. 140. B. fait remarquer que cette rgle se retrouve dans le code de Vasishtha, II, 51. 1, 25 % par mois = 15 % par an. 141. Cette rgle, suivant Kull., concerne le cas o le prteur n'a pas de gage. Nest pas coupable d'usure, littr. il n'est pas un pcheur pour gain illicite .
LES-LOIS
DE MANOU
219
l'ordre 142. Deux, trois, cinq pour cent, suivant quatre, d'intrt des castes, voil ce qu'il peut prendre lgitimement mensuel. 143. Mais (s'il a reu) un gage dont il retire un profit, il ne aucun intrt doit recevoir pour son prt; un tel gage (mme) aprs un long laps de temps ne peut tre engag ni vendu. ne peut user d'un gage par force ; s'il 144. (Un crancier) les intrts il doit abandonner en fait usage, (de l'argent le du gage) en (en payant) le (propritaire prt) et indemniser il serait un voleur de gages. prix ; autrement tre perdus ne doivent 145. Ni un gage, ni un dpt par tre repris suite (d'un long laps de) temps ; ils peuvent (par tre rests le propritaire, (aux longtemps aprs mme) mains du dpositaire). un cheval de trait et 146. Une vache lait, un chameau, sont employs avec le con dresser, un (animal) lorsqu'ils ne sont jamais sentement perdus pour ce (du propritaire), dernier. voit 147. Mais quel que soit (le bien) dont le propritaire dix ans, (personnes), pendant jouir sous ses yeux d'autres il n'a plus le droit de le reprendre. sans protester, ni mineur et (qu'il laisse 148. S'il n'est ni simple d'esprit, d'autres jouir sous ses yeux (de son bien, ce bien) personnes) : l'usufruitier a droit de le est perdu (pour lui) lgalement (garder). un dpt un bien de mineurs, 149. Un gage, une limite, des femmes, le bien du roi, le et un dpt (scell), (ouvert) ne sont pas perdus bien d'un Brahmane instruit, par le fait (qu'un autre) en a joui. 142. Cette rgle complte la prcdente : le Brahmane paye 2 % P&r mois, le Kchatriya 3 /0, le Vaisya 4 /, le Soudra 5 '/. 143. Un gage un terrain, une vache, un esclave, etc. . (Kull.) 144. Par force, c'est--dire contre le gr du propritaire; un gage un gage garder, tel que vtements, ornements, etc. . (Kull.) On conoit en effet que l'usure d'un tel gage lui ferait perdre de sa valeur. 146. A dresser p. ex. un taureau . (Kull.)
220 150. L'insens
LES LOIS DE MANOU
d'un gage sans la permission qui dispose du propritaire devra faire remise de la moiti des intrts, en ddommagement de l'usage (qu'il a fait du gage). 151. L'intrt de l'argent pay en une seule fois ne doit le double (de la dette ; et l'intrt jamais dpasser pay) en en fruits, en laine et en btes de somme ne doit pas grains, dpasser cinq fois (le capital). 152. (Un intrt) excessif dpassant le taux lgal n'est pas admis ; c'est ce qu'on a le de l'usure ; (le prteur) appelle droit de demander cinq pour cent (par mois au plus). 153. Il ne doit pas percevoir au del de l'anne, l'intrt ni (un taux) non reconnu, ni un intrt compos, ni un intrt temps ni (un taux) le double du capital), (dpassant ni un intrt extorqu (en temps de dtresse), (sous forme de prestation) corporelle. 154. Celui qui est dans l'impossibilit de payer sa dette et dsire renouveler le contrat, peut aprs avoir sold l'intrt chu signer un nouvel engagement. 155. S'il ne peut payer l'intrt (chu), il doit l'inscrire dans le nouveau et s'engager payer tout l'intrt contrat, qui est d. 156. Celui qui a sign un engagement pour un transport 150. Il y a ici contradiction avec le vers 144, moins qu'on n'admette cette distinction subtile que, dans le cas du vers 144, le crancier a us du gage au su du propritaire et malgr sa dfense, tandis que dans ce dernier cas il en use en cachette et sans lui avoir demand au pralable son autorisation. 151. En une seule fois : c'est--dire quand on paye d'un seul coup, et non par mois ou par jour l'intrt avec le principal, les deux runis ne doivent pas dpasser le double du capital primitif; de mme, dans l'espce suivante, l'intrt ajout au principal ne doit pas dpasser cinq fois le capital primitif. 15.2. Vyatirikta excessif, peut s'entendre aussi avec L. qui s'carte de la rgle prcdente , ou avec B. tant contre (la loi) . 153. Au del de l'anne : le crancier ne peut percevoir au del d'une anne l'intrt qui a t convenu pour un, deux, ou trois mois. L'intrt corporel est celui qu'on paye en travaillant pour le crancier. 155. L'intrt chu est port au capital, et le dbiteur le reconnat comme faisant partie de la dette. 156. Suivant certains commentateurs cakravrddhi, tarif de transport par voiture, signifierait l'intrt compos .
LES LOIS DE MANOU
221
et fix un lieu et une date, s'il ne remplit pas (ces par voiture, n'a pas droit au prix (conde lieu et de temps, conditions) venu) . marien voyages 157. Le tarif fix par les gens experts les lieux, les temps et les objets, times et connaissant (a force le de loi) dans ces (sortes de contrats) en ce qui concerne se porte ici-bas caution de la comparution et qu'on ne puisse le produire (d'un dbiteur), ( l'poque la dette de celui-ci sur son propre avoir. fixe), on payera d pour s'tre port garant, les promesses 159. L'argent ce les dettes de jeu, les dettes de cabaret, faites la lgre, d'une amende ou d'un impt, le fils (du qui reste ( payer) n'est pas tenu les payer. dbiteur) au cas de caution pour 160. La rgle prcdente s'applique d'un paye; mais si celui qui s'est port garant comparution au payeles hritiers ment meurt, (le juge) peut contraindre ment. la mort 161. Sur quel motif le crancier aprs peut-il, et dont d'un garant, qui n'tait pas caution pour le payement, des rclamer ensuite les affaires sont bien connues, (auprs ? hritiers) et qu'il 162. Si le garant a reu de l'argent (du dbiteur) ait assez de fonds (pour payer la dette), alors (le fils de celui doit acquitter (la dette) sur son propre qui) a reu l'argent bien : telle est la rgle. 163. Un contrat n'est pas valable s'il est fait par un homme 157. Voyages maritimes dsigne suivant Kull. les voyages par terre et par mer . 159. A la lgre, c'est--dire quand pour plaisanter on a promis des bouffons et autres . (Kull.) 161. Qui n'tait pas caution pour le payement, mais seulement pour la comparution du dbiteur, suivant la distinction tablie au vers prcdent. Dont les affaires sont connues, c'est--dire, suivant Kull. le motif pour lequel il s'est port garant tant connu . 163. Malade : rta signifie littralement accabl par la maladie . (Kull.) payement. 158. Si l'on
222
LES LOIS DE MANOU
dpenivre, par un fou, par un malade, par une personne ou une personne non autoun vieillard dante, un enfant, rise. ft-elle 164. Une convention confirme (par des preuves la si elle est faite contrairement crites) n'est pas valable loi tablie en vigueur dans le procs. 165. Si (le juge) dcouvre ou qu'une chose ait t engage vendue donne ou reue frauduleusement, frauduleusement, o il dcouvre une fraude, il doit annuler partout (le contrat). 166. Si l'emprunteur est mort et que l'argent (emprunt) ait t dpens les parents de) la famille, pour (l'entretien rembourser sont tenus sur leur propre mme s'ils avoir, sont spars (de biens). 167. Le march mme dpendante fait qu'une personne ou soit prsent pour (l'entretien de) la famille, que le matre celui-ci n'a pas le droit de le casser. absent, 168- Ce qui a t donn par force, et par force, possd fait par mme ce qui a t sign par force, (bref) tout contrat force, Manou l'a dclar nul. 169. Trois (sortes de personnes) ptissent pour autrui : les le garant, la famille; tmoins, quatre profitent (aux dpens : le Brahmane, le riche (qui prte), le marchand, le d'autrui) prince. 170. Un prince mme dans le besoin ne doit pas prendre ce qui ne doit pas tre pris, et mme riche, ne doit pas ddaigner ce qui doit tre pris, quelque insignifiant que soit le profit. 171. En prenant ce qui ne doit pas tre pris, et en refusant ce qui doit tre pris, un roi se fait taxer de faiblesse, et prit en ce (monde) et dans l'autre. 164. Peut-tre faut-il entendre vyvahrikt comme un terme part, la coutume oppose la loi. 166. A plus forte raison s'ils vivent sous le rgime de la communaut. 167. Dpendante un esclave .' (Kull.) Le march : par exemple un emprunt . (Kull.) 169. Kula famille, signifierait, suivant Kull., les juges .
LES LOIS DE MANOU 172.
223
en empchant le mEn prenant ce qui lui revient, les faibles, le roi (voit) son lange des castes, en protgeant en ce (monde) et dans l'autre. et il prospre crotre, pouvoir l'exemple de Yama, le souverain, 173. C'est pourquoi, sans gard pour ce qui lui plat ou ce qui lui dplat, doit la conduite de ce juge des morts, en domptant sa imiter ses sens. colre, et en rfrnant 174. Mais le mauvais assez insens prince pour juger les causes contre la justice, tombe bientt au pouvoir de ses ennemis. 175. Au contraire si (le roi), faisant taire ses affections et ses haines, dcide les causes avec justice, ses sujets se tournent vers lui comme les fleuves vers l'Ocan. 176. Le (dbiteur) le roi de ce qui se plaint par-devant poursuit (sur lui) un recouvrement que le prteur (par son choix, devra tre condamn n'importe quel moyen) et au par le roi payer le quart (de la dette comme amende) la somme (due). (crancier) 177. Le dbiteur son crancier mme par peut indemniser s'il est de mme son travail, caste, ou de caste infrieure ; mais (s'il est) de caste suprieure, il le payera petit petit. 178. Telle est la rgle suivant le roi doit rgler laquelle les affaires des gens qui sont en procs les uns quitablement contre les autres, en les claircissant et par des tmoignages des preuves. 179. Le sage (ne) fera de dpt (que) chez une personne de bonne de conduite connaissant la loi, famille, honnte, bien apparente, riche et honorable. vridique, 180. Comme le dpt de n'importe quel objet s'est fait 174. Juger les causes, litt. faire les affaires. 176. Le dbiteur qui sous prtexte qu'il est le favori du roi. (Kull.) Chandena son choix ou peut-tre indpendamment (de la cour) . Les moyens de recouvrement sont indiqus au v. 49. 177. Contradiction avec le v. 153. De caste suprieure un Brahmane . 178. Preuves telles que le serment ou le jugement de Dieu. 179. Honorable rya ; ce mot est pris parfois au sens de Dvidja.
224
LES LOIS DE MANOU
entre les mains de n'importe qui, ainsi doit-il tre repris : tel le dpt, tel le retrait. du le dpt la requte 181. Celui qui refuse de restituer du doit tre interrog dposant, par le juge en l'absence dposant. 182. A dfaut de tmoins, (le juge) doit sous des prtextes faire dposer effectivement de l'or (ou autres (spcieux) chez le (dfendeur), secrets par des agents objets prcieux) (convenables). d'ge et d'extrieur le dpt tel quel et dans 183. Si le (dpositaire) restitue il n'y a rien l (qui corles conditions (o il a t effectu), de l'autre. L'accusation robore) comme il le devrait cet 184. Mais s'il refuse de restituer or ces (agents secrets), qu'on le contraigne par force restituer les deux (dpts) ; telle est la rgle de la loi. 185. Ni un dpt ouvert, ni un dpt scell, ne doivent (du dposant, quand jamais tre remis au plus proche parent celui-ci vit encore) ; car l'un et l'autre sont perdus en cas de ils ne sont mort de celui qui les a reus; dans le cas contraire pas perdus. remet de 186. Mais celui qui (aprs la mort du dposant) du dfunt ne doit lui-mme (le dpt) au plus proche parent tre inquit ni par le roi, ni par les parents du dposant. cas d'incertitude), il faut rclamer 187..(En l'objet sans dtour et par les moyens amicaux, ou bien obtenir le recousur la vrement par la persuasion, aprs avoir fait enqute conduite (du dpositaire). de tous les 188. Telle est la rgle pour le recouvrement 182. Dposer : pour redemander ensuite le dpt. 184. Les deux dpts : c'est--dire le dpt dont il a ni l'existence et celui que le roi a fait faire chez lui pour prouver son honntet. 185. Son plus proche parent son fils, etc. . (Kull.) Si le fils, etc. (auquel on les a confis), vient mourir avant de les avoir remis au pre, ces deux dpts sont perdus... C'est pourquoi, dans la crainte d'un malheur, on ne doit pas les remettre un autre qu'au vrai dposant. (Kull.) La dernire proposition du vers parat un pur remplissage.
LES LOIS DE MANOU
225
dpts ouverts ; mais pour un (dpt) scell (le dpositaire) n'encourt aucun (blme) s'il n'a rien soustrait (en changeant le sceau). 189. (Quand un dpt a t) ravi par des voleurs, emport n'est pas tenu par l'eau, brl par le feu, (le dpositaire) s'il n'en a (lui-mme) restitution, pris aucune partie. 190. Celui qui s'approprie un dpt, ou celui qui (rclame une chose) sans l'avoir que (le roi) l'examine dpose, par tous les moyens, et par les serments dans le Vda. prescrits 191. Celui qui (refuse de) rendre un dpt, et celui qui rclame ce qu'il n'a pas dpos, doivent tre punis tous les payer une amende gale deux comme voleurs, ou contraints (au dpt rclam). un dpt 192. Que le roi fasse payer celui qui s'approprie et ouvert une amende de) ce (dpt), gale (la valeur celui qui s'approprie sans un dpt scell, pareillement distinction. 193. Celui qui par des moyens frauduleux du s'empare subir bien d'autrui doit publiquement avec ses complices' divers supplices. 194. Si un dpt d'une certaine valeur a t fait par quel(qu'il est) intact ; qu'un en prsence de tmoins, il faut s'assurer celui qui fait une dclaration mrite une amende. mensongre 190. Les moyens les quatre expdients, la douceur et le reste . (Kull.) Les serments, c'est--dire les preuves, le jugement de Dieu, par ex. porter du feu, etc. . (Kull.) 191. Comme eoleurs, c'est--dire mutils, s'il s'agit d'un objet de valeur ou de pierreries, etc., et s'il s'agit d'un objet de peu de valeur, cuivre, etc., condamns payer l'quivalent . (Kull.) 192. Suivant Kull. ce vers s'applique au cas d'un premier dlit . Sans distinction signifierait, suivant Nr. sans distinction de caste . Dans le vers prcdent les commentateurs remarquent que les peines corporelles doivent tre infliges aux autres qu'aux Brahmanes ; en.d'autres termes, la personne du Brahmane est inviolable. 193. Divers supplices consistant lui couper la main, le pied, la tte, etc. . (Kull.). 194. Tmoin : peut-tre simplement de la famille . Suivant Kull. kula signifie tmoin ; au v. 169 il donnait ce mot le sens de juge . 15
226 195.
LES LOIS DE MANOU
en ont t effectus Mais si le dpt et la rception la restitution doit tre faite aussi en secret : tel le secret, telle la restitution. dpt, le dpositaire, 196. C'est ainsi que le roi, sans malmener doit dcider en matire de dpt ou de prt amical. 197. Celui qui vend le bien d'autrui sans en tre le prone doit et sans y tre autoris pritaire, par le propritaire, : c'est un voleur qui se figure point tre admis en tmoignage n'tre pas un voleur. 198. S'il est parent le punisse (du propritaire), qu'on d'une amende de six cents panas ; s'il n'est point (son) parent il se rend coupable de vol. et s'il n'a point d'excuse, 199. Une donation ou une vente faite par quelqu'un qui doit tre considre comme nulle, n'est pas le propritaire, dans les procdures. d'aprs la rgle (admise) 200. Quand la possession est apparente, mais non l'acquisien c'est l'acquisition tion, (de proprit) qui fait preuve telle est la rgle. pareil cas, et non la possession: 201. Celui qui acquiert n'importe quel bien par voie d'ad'une en prsence de tmoins, en prend chat, possession faon absolument lgale par le fait de son achat. ne peut tre produit, et que (l'acheQue si le vendeur sera soit justifi teur) par un achat public, (ce dernier) mais le (premier par le roi sans amende, acquitt propritaire) de l'objet perdu peut le reprendre. 203. Une marchandise mle une autre ne doit point tre 198. Point d'excuse, telle que l'avoir reu en prsent, ou achet du fils, ou d'un autre proche parent du propritaire . (Kull.) 201. Tmoin, cf. note du v. 194. Par voie d'achat : suivant Kull. vikraya = vikrayadea le lieu du march. Ce prcepte s'applique au cas o le vendeur n'est pas propritaire de l'objet. 202. Si le oendeur v non propritaire ne peut tre produit parce qu'il est mort, ou parce qu'il est parti . (Kull.) Le reprendre des mains de l'acheteur, condition de payer celui-ci la moiti de la valeur de l'objet . (Kull.) 203. Incomplte en poids, etc . (Kull.) Cache couverte de peinture . (Kull.) 202.
LES LOIS DE MANOU vendue
227
avarie (comme (comme pure), ni une (marchandise) bonne), ni une (marchandise) qui est loin, ou qui incomplte, est cache. 204. Si aprs avoir montr une jeune fille un prtendant, on lui en donne une autre, il peut toutes deux les pouser Manou. pour le mme prix; ainsi l'a dclar et que 205. Si (la future) est folle, lpreuse ou dflore, celui qui la donne (en mariage) dclare ses pralablement aucune peine. tares, il n'encourt 206. Si le prtre officiant choisi pour un sacrifice abandonne son oeuvre, ses acolytes doivent lui donner une part (seulement du salaire), la tche (qu'il a proportionnellement faite). 207. Mais celui qui abandonne son oeuvre une fois que les du sacrifice ont t rpartis, honoraires toute sa peut prendre part, en faisant achever (sa tche) par un autre. 208. Mais au cas o des rtributions ont t particulires fixes pour chaque partie d'une crmonie, est-ce seulement celui (qui accomplit telle ou telle partie) qui doit recevoir les ou bien tous doivent-ils rtributions (qui y sont attaches), se les partager ? le chariot, 209. Que l'Adhvaryou prenne que le Brahman l'allumage du feu sacr, que le Hotar le cheval prenne aussi un cheval, le chariot que l'Oudgtar (prenne) prenne l'achat (du soma). (employ) 210. Les (quatre) principaux parmi tous (les seize prtres) 204. Montr une jeune fille : il s'agit du cas o le prtendant achte sa future. 207. Abandonne son couvre pour cause de maladie, etc. . (Kull.) 209. Les fonctions du sacrifice sont rparties entre plusieurs officiants parmi lesquels l'Adhvaryu et le Hotar jouent le principal rle; l'Adhvaryu a la direction matrielle des dtails de la crmonie et rcite les vers du YajurVeda, le Brahman ou prtre principal prside, le Hotar rcite les vers du FtgVeda, l'Udgtar chante le Sma-Veda. L'allumage du feu sacr s'appelle Agnydhna. Le char pour l'achat ou plutt pour le transport du soma. 210. Kull. explique ainsi ce partage proportionnel : soit cent vaches partager : ceux de la premire srie en auront quarante-huit, ceux de la
228
LES LOIS DE MANOU
ont droit la moiti (des honoraires), les quatre (suivants), la moiti de cela, la troisime au tiers, et la quacatgorie trime au quart. 211. C'est en appliquant cette rgle que doit tre faite la des parts entre les hommes icirpartition qui se runissent bas pour cooprer une oeuvre. 212. Si de l'argent quelqu'un a t donn (ou promis) cette qui le demandait pour une oeuvre pie, et qu'ensuite la donation ne doit point (oeuvre) n'ait pas t accomplie, avoir lieu. 213. Si (le solliciteur) par orgueil ou par cupidit exige de la promesse), (l'accomplissement que le roi le condamne un souvarna d'amende en expiation de ce vol. 214. Je viens d'expliquer comme il convient le moyen un don (promis) ; je vais exposer ensuite (les lgal de retirer cas o) l'on peut refuser de payer les gages. 215. Si un salari sans tre malade nglige par orgueil de il est passible suivant les conventions, faire son ouvrage de huit krichnalas, et son salaire lui sera supd'une amende il fasse et qu'une fois rtabli (s'il est) malade, il doit receil a t convenu comme d'abord, (son ouvrage) voir son salaire, mme aprs un long laps de temps. il n'excute 217. Mais si malade ou bien portant pas l'ouil ne recevra suivant les conventions, aucun salaire, vrage n'est incomplet mme si l'ouvrage que de peu. 218. Telle est, expose en dtail, la loi en ce qui concerne la retenue des salaires ; je vais maintenant dclarer la loi les engagements. ceux qui rompent relative avec une convention 219. L'homme qui a fait sous serment Mais seconde vingt-quatre, ceux de la troisime seize, ceux de la quatrime douze. 212. OEuvre pie sacrifice, mariage, etc. . (Kull.) 213. Dans le cas o l'argent a t donn, s'il refuse de le rendre, et dans le cas o l'argent a t promis, s'il le prend par force . (Kull.) 219. Une corporation de marchands et autres . (Kull.) On peut aussi prim. 216.
LES LOIS DE MANOU
229
un bourg ou un district, une corporation habitant et qui la de son royaume. que (le roi) le bannisse rompt par cupidit, 220. Qu'il fasse arrter ce briseur de contrats et lui fasse d'une valeur de) quatre souvarnas, (chacun payer six nichkas et un satamna d'argent. 221. Tel est le systme de punitions un que doit appliquer de bourgades prince juste ceux qui dans les communauts ou de castes rompent un engagement. 222. Celui qui ayant achet ou vendu un bien ici-bas, en du regret, dans les dix prouve peut le rendre ou le reprendre de dix jours, on ne peut ni rendre ni ou le rend (par reprendre (un bien) ; celui qui le reprend de six cents (panas). force) sera puni par le roi d'une amende 224. Si quelqu'un donne (en mariage) une jeune fille qui a une tare, sans en avertir (le prtendant), que le roi lui-mme lui inflige une amende de quatre-vingt-seize panas. 225. Mais celui qui par mchancet dira d'une jeune fille : Elle n'est pas vierge , mrite une amende de cent (panas), moins qu'il ne prouve cette tache. 226. Les prires ne peuvent tre dites que pour nuptiales des vierges, et jamais en ce monde pour (des femmes) qui ne sont plus vierges, car celles-ci sont exclues des crmonies lgales. 227. Les prires sont toujours le signe caracnuptiales de la femme tristique ; mais les (lgitimement pouse) hommes instruits savoir que la (crmonie doivent n'est) consomme (qu')avec le septime autour pas (fait par la marie du feu sacr). faire la construction autrement : l'homme appartenant une corporation, etc. 220. On peut aussi entendre six nichkas, ou quatre souvarnas, ou un satamna ce qui, comme le remarque Kull., constitue trois amendes pouvant tre infliges suivant que le cas est plus ou moins grave . 223. Un bien non susceptible de dtrioration, une terre, une plaque de cuivre, etc.. (Kull.) jours. 223. Mais au del
230 228. Quand
LES LOIS DE MANOU
se repent ici-bas d'avoir conclu un quelqu'un le ramener dans cette rgle contrat, (le juge) devra suivant la voie de la justice. selon les principes de la 229. Je vais exposer exactement au il faut trancher) les diffrends relatifs loi (comment ou du berger. btail, (causs) par la faute du propritaire de la conservation 230. Le jour la responsabilit (du btail) au berger, la nuit au propritaire, incombe (si le btail est) le berger est respondans sa maison ; (s'il en est) autrement, la nuit). sable (aussi pendant 231. Un vacher avec l'assenqu'on paye en lait pourra, timent du propritaire, traire la meilleure vache sur dix ; ce s'il ne reoit point d'autres sera son salaire, gages. 232. Si (une bte) s'est gare, a t dtruite par la verdans mine, dchire par les chiens, ou s'est tue (en tombant) une fosse, (et que l'accident soit d) la ngligence du c'est celui-ci seul qui doit payer (le prix de l'animal). berger, 233. Mais lorsqu'une bte est ravie par des voleurs et que il n'est pas tenu la payer, le berger donne l'veil, pourvu qu'il ait averti son matre en temps et lieu (utiles). il doit prsenter au propri234. Quand une bte meurt, la peau, la queue, la vessie, les tentaire les deux oreilles, comme le-calcul biliaire dons, (de l'animal) pices conviction. 235. Quand les chvres et les brebis sont cernes par des tout loups, et que le berger n'accourtpas (pour les dfendre), saisi et tu par le loup reste la charge du berger. animal 236. Mais lorsqu'elles sont parques, (et) qu'elles paissent ensemble dans une fort, si le loup fond sur l'une d'elles et la tue, le berger en ce cas n'est nullement responsable. 232. Vermine : je pense qu'il faut entendre par breux aux Indes. Les chiens et autres animaux 234. Comme pices conviction : une autre membres. 236. Parques, peut-tre simplement surveilles, l les serpents si nomde ce genre. leon porte angni les en bon ordre.
LES LOIS DE MANOU
'
231
il faut laisser un pturage 237. Tout autour d'un village communal d'une tendue de cent, arcs ou de trois portes de doit tre) autour d'une trois fois ville (cet espace bton; (plus grand). le btail endommage des crales 238. Si dans cet endroit non encloses (de haies), que le roi n'inflige aucune amende au berger. 239. En cet endroit du champ) devra faire (le propritaire une haie par-dessus un chameau ne puisse regarder, laquelle et fermer tous les trous par o un chien ou un sanglier pourrait passer la tte. 240. (Si le btail fait des dgts) dans un champ clos (situ) sur une grande route ou prs d'un village, le berger mrite de cent (panas); une amende les btes sans (quand) (sont) le (gardien du champ) doit les loigner. gardien, 241. Dans les autres champs doit (le matre de) l'animal payer un pana et quart (pour le dgt) ; mais en tout cas (tout doit tre rembours ce qui a t endommag dans) la rcolte du champ : telle est la rgle. au propritaire amende 242. Mais Manou a dclar qu'il n'y avait aucune dans les dix payer (si le dgt a t caus par) une vache a vl, par des taureaux, et par du btail jours aprs qu'elle soient consacr aux dieux, (que ces animaux) accompagns ou non d'un gardien. 243. Si (la moisson est endommage) par la faute du produ champ, une amende (il payera) gale dix fois pritaire 237. L'arc comme mesure de longueur reprsente quatre coudes, environ six pieds. 240. Le berger lorsque les troupeaux sont accompagns du berger . (Kull.) 241. En tout cas que le btail soit accompagn ou non d'un gardien et l'indemnit doit tre paye par le berger ou le propritaire, selon que la faute est l'un ou l'autre . (Kull.) 243. Par la faute du propritaire s'il laisse manger ses rcoltes par ses propres bestiaux, ou s'il ne sme pas l'poque convenable . (Kull.) Le roi a droit pour sa part 1/6 des rcoltes : l'amende serait donc presque du double de la rcolte.
232
LES LOIS DE MANOU
la part (du roi) ; mais l'amende de moiti (sera seulement) n'en et que le propritaire (si la faute en est ) ses serviteurs ait rien su. 244. Telle est la rgle qu'un roi juste devra observer pour les dlits (commis le btail ou le berger. par) le propritaire, propos 245. S'il surgit un diffrend entre deux villages le mois de Djyaichtha d'une limite, (qu')il (c'est) pendant sont les plus alors que les bornes devra fixer cette limite, aises discerner. des arbres (telsque) le Ficus 246. Il mettra comme bornes leButea le Ficus le Bombax indica, frondosa, religiosa, le palmier et l'arbre le Valica robusta, heptaphyllum, des bambous de diverses des Des ronces, sortes, des tertres, des roseaux, des des plantes acacias, grimpantes, de Trapa de cette manire la borne ne buissons bispinosa; point. disparat 248. Des pices d'eau, des puits, des tangs, des ruisseaux doivent ainsi que des temples tre mis aux points de jonction des bornes. d'autres 249. On doit aussi tablir secrtes marques pour les limites, en considration des perptuelles mprises (que les hommes en ce monde, des commettent) par ignorance bornes : 250. Pierres, de vaches, os, queues cendres, peautres, fumier sec, tuiles, charbon, tessons, cailloux, sable, 251. Enfin toutes sortes de (substances) que la terre ne ronge pas avec le temps, on doit les faire placer, caches (sous au point de jonction des limites. terre), 245. Jyaishtha mai, juin. Aises discerner, parce que l'herbe a t dessche parla chaleur du soleil. (Kull.) 246. Les noms hindous de ces arbres sont: nyagrodha, avattha, kimuka, lmali, la. 247. Trapa bispinosa en sanskrit kubjaka. 251. Les faire placer dans des jarres, au tmoignage de Brhaspati . (Kull.). On attribue ce Richi un ancien code de lois. lait, 247.
LES LOIS DE MANOU 252. Par
233
ces marques, immmoriale de par l'anciennet et par le cours des ruisseaux, le roi dterminera l'occupation, les limites de deux (villages) en diffrend. 253. S'il y a doute mme la vue de ces marques, on doit faire appel aux tmoins une contestation de pour rgler limites. 254. Les tmoins pour (une question de) limites, (appels) devront tre interrogs sur les marques des bornes en prsence des familles du village et des deux parties. la dcision unanime 255. Suivant prononce par eux dans ainsi l'enqute, (le roi) fera consigner (par crit) les limites, que les noms de tous ces (tmoins). de la terre sur leurs ttes, portant des cou256. Mettant ronnes et des vtements par rouges, aprs avoir jur chacun dterminent actions, de) leurs (les (la rcompense qu'ils bornes) selon la justice. 257. S'ils dterminent (les bornes) en la manire qui vient d'tre prescrite, ils sont sans reproche (et ce sont des) tmoins contrairement ; mais s'ils (les) dterminent ( la vridiques leur fasse payer une amende de deux cents justice), qu'on (panas). 258. A dfaut de tmoins aux deux (appartenant villages en diffrend), des villages environnants que quatre habitants fassent en prsence du roi la dli( cette fonction) prpars mitation des frontires. 259. Mais s'il n'y a ni voisins, (ni) aborignes (qui puis252. On peut aussi rapporter satatam aux cours d'eau : par des cours d'eau coulant perptuellement . 254. Les deux parties les deux reprsentants des deux villages. (Kull.) 256. Des couronnes de fleurs rouges. Jur en disant : Puissent toutes nos bonnes actions demeurer sans rcompense (si nous n'observons pas la justice) . (Kull.) 258. Habitants des villages voisins : plus exactement peut-tre habitant sur les confins du village . Prpars cette /onction prayata. B. entend ce mot comme quivalent de niyata pur. 259. Ni voisins ni aborignes : ou bien en un seul terme s'il n'y a point de voisins habitants originaires du pays .
234 sent servir
LES LOIS DE MANOU de) tmoins interroger dans une question les habitants mme de frontires, des forts, (le tels
roi) pourra que : 260. Chasseurs, d terreurs oiseleurs, pcheurs, bergers, de racines, de serpents, et autres htes preneurs glaneurs, des bois. 261. Les marques dclareront au que ces (gens) interrogs le roi les fera tablir avec sujet de la jonction des frontires, justice entre les deux villages. 262. La dlimitation des bornes propos d'un champ, d'une d'un tang, d'un d'une maison, doit source, jardin, tre fixe par le tmoignage des voisins. 263. Pour un faux tmoignage propos d'une limite que des hommes le roi condamnera les voisins contestent, intermdiaire. payer chacun l'amende en intimidant 264. Celui qui usurpe une (le possesseur) un tang, un jardin, un champ, doit tre puni d'une maison, de cinq cents (panas) ; (s'il a agi) par ignorance, amende l'amende (sera de) deux cents (panas). 265. Quand la limite ne peut tre dtermine (par des ou ds tmoignages), un roi quitable, dans l'intrt marques des (deux parties) fixera lui-mme (la portion de) terre (qui chacune) ; telle est la rgle. revient 266. Ainsi a t dclare en entier la loi relative la dlimitation des bornes; je vais maintenant exposer les dcisions relatives aux outrages. 267. Pour un Kchatriya un Brahmane outrage payera cent (panas) d'amende cent cinquante ou deux ; un Vaisya cents ; un Soudra sera passible d'une peine corporelle. un Kchatriya un Brahmane 268. Pour outrage payera un Vaisya il payera la cinquante (panas) ; pour outrage 263. L'amende intermdiaire est de 500 panas. 264. En intimidant le possesseur en le menaant de la mort ou des fers . (Kull.) On conoit qu'on puisse par ignorance usurper une pice de terre, un tang, mais pour une maison l'erreur semble peu admissible.
LES LOIS DE MANOU moiti
235
un Soudra (il de cinquante (panas) ; pour outrage payera) douze (panas). d'un Dvidja envers de 269. En cas d'offense quelqu'un mme caste (l'amende sera) aussi de douze (panas) ; pour des elle sera double. propos malsants 270. Un homme de la dernire caste qui adresse des in des Dvidjas mrite lui coupe la sultes grossires qu'on est vile. langue ; car son extraction leur nom et leur caste d'une 271. S'il mentionne faon on lui enfoncera dans la bouche une tige de fer outrageante, rouge longue de dix doigts. aux Brahen remontrer il (veut) 272. Si par insolence de lui fasse verser manes sur leurs devoirs, que le prince dans la bouche et dans l'oreille. l'huile bouillante faussement 273. Celui qui par insolence conteste ( un sa caste, son pays natal, homme de mme caste) sa science, devra payer son corps a t purifi, ou les rites par lesquels une amende de deux cents (panas). de boiteux ou de 274. Celui qui traite un autre de borgne, la chose ft-elle telle autre (qualification) vraie, analogue, d'amende. payera au moins un krchpana sa mre, son pre, sa femme, son 275. Celui qui calomnie devra payer cent (panas), frre, son fils, ou son prcepteur, 269. Propos malsants, littr. des paroles qui ne devraient pas tre prononces, des insultes l'adresse de la femme, de la mre, de la soeur d'un autre . (Kull. ) 270. Littr. : Un homme qui n'a qu'une naissance qui n'a pas t rgnr par l'initiation, en opposition aux Dvidjas, ceux qui ont une seconde naissance. Son extraction est vile, car il est issu des pieds de Brahm . (Kull.) Cf. I, 51. 271. Comme exemple d'insulte Kull. cite H ! toi Yajnadatta, rebut des Brahmanes ! . 273. A un homme de mme caste doit tre suppl, car comme le remarque Kull., vu la lgret de la peine, cette rgle ne s'applique pas au Soudra insultant des Dvidjas . Son pays natal : cf. II, 19, 20, o certains districts sont indiqus avec une mention honorable. 275. Calomnie : Kull. entend par l une maldiction plus ou moins grave ; suivant d'autres, le sens est les accuse de pchs mortels .
236 ainsi
LES LOIS DE MANOU
que celui qui ne se drange point pour cder le pas son prcepteur. 276. (En cas d'outrages d'un Brahmane et rciproques) d'un Kchatriya,un au Brahmane l'amende (roi) sage imposera et au Kchatriya l'amende intermdiaire. infrieure, 277. La mme punition doit tre exactement applique un Vaisya et un Soudra leur caste, sans mutilation suivant : telle est la rgle. (de la langue pour ce dernier) 278. Ainsi vous a t expose en dtail la rgle des chtiments en paroles; pour les outrages je vais dire maintenant la dcision concernant les voies de fait. 279. Quel que soit le membre de basse dont un (homme) caste (se sert pour) blesser un suprieur, doit ce (membre) tre coup : tel est l'ordre de Manou. 280. S'il lve la main ou un bton, il mrite d'avoir la main il mrite avec le pied, coupe ; si dans la colre il frappe d'avoir le pied coup. 281. Un (homme) de caste infrieure de s'asqui s'avise seoir ct d'un de caste leve, doit tre marqu (homme) sur la hanche et banni, ou bien (le roi) lui fera couper la fesse. 282. Si par insolence il crache le roi (sur un Brahmane), lui fera couperles deux lvres, s'il pisse (sur lui) le pnis, s'il l'anus. pte (en sa prsence) 283. S'il l'empoigne par les cheveux, que (le roi) n'hsite pas lui faire couper les mains, (et de mme, s'il le saisit) le cou, ou les testicules. par les pieds, la barbe, 276. L'amende infrieure est de 250 panas, l'intermdiaire de 500. 277. Suivant leur caste, c'est--dire que le Vaisya paye l'amende infrieure, le Soudra l'amende intermdiaire, mais n'est pas passible de la mutilation de la langue suivant la prescription du v. 270, parce que la rciprocit des outrages diminue sa culpabilit. 279. Un suprieur, c'est--dire un homme des trois premires castes. 281. Couper la fesse de manire ce qu'il n'en meure pas . (Kull.) 282. Vanus : on ne comprend gure comment cela peut se faire. Le chtiment est applicable au cas o l'incongruit est faite par insolence et non par mgarde . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 284. S'il gratigne il payera une
237
caste), la chair (il payera) exil. 285. Pour caus toutes (sortes d')arbres, dommage leur utilit : l'amende doit tre proportionne respective telle est la rgle. faire) du mal aux 286. Pour un coup donn (de manire la ou aux btes, (le roi) proportionnera l'amende hommes du mal caus. grandeur ou 287. Pour un membre pour une blessure endommag, du sang (vers, l'agresseur)-payera les frais de la gurison, ou bien (si le bless s'y refuse) il payera le tout titre d'amende ou par mgarde le qui sciemment endommage devra lui donner satisfaction et payer au roi du dommage. l'quivalent en cuir, en bois ou en 289. S'il s'agit de cuir, d'ustensiles ; et (est) de cinq fois la valeur argile, l'amende intrinsque de mme pour les fleurs, racines et fruits. une voiture, le cocher et le pro290. En ce qui concerne de la voiture, on admet dix (cas o l'amende pritaire pour caus sera) remise ; pour tous les autres une dommage amende est prescrite. 291. Quand la bride est coupe, le joug bris, quand (la o reculons, l'essieu du va de travers voiture) quand vhicule est rompu ou la roue casse ; sont casss, 292. Quand les traits, le licou, ou les rnes 284. Six nichkas. Cf. v. 137. 287. S'il s'y refuse : il faut entendre d'aprs Kull. si l'auteur de la blessure ne veut pas payer les frais . Mais il me semble plus naturel d'expliquer : si la victime refuse d'accepter l'indemnit . Le tout, c'est--dire les frais de gurison et l'amende . 291. La bride, littr. la corde passe dans le nez de la bte. De travers ou reculons par suite des ingalits du sol . (Kull.) 292. Gare, littr. tez-vous de l . (au roi). 288. Celui bien d'autrui
ou fait saigner de mme (quelqu'un amende de cent (panas) ; s'il entame six nichkas, s'il casse un os il sera
238
LES LOIS DE MANOU
et quand (lecocher) a cri Gare! , Manou a dclar qu'il une amende. n'y avait pas (lieu d'infliger) 293. Mais si la voiture du cocher, verse par la maladresse le propritaire une devra alors, en cas de dommage payer amende de deux cents (panas). 294. Si le cocher est habile (mais ngligent), c'est le cocher mais si le cocher est maladroit, tous qui supporte l'amende; les voyageurs une amende de cent (panas) par tte. payeront 295. S'il se trouve arrt dans son chemin par du btail ou par une (autre) et qu'il cause la mort d'un tre voiture, une amende sans aucun doute. vivant, (doit tre inflige) 296. S'il y a mort d'homme, sa culpabilit est du coup la mme que (celle d'un) voleur ; pour de gros animaux, (tels que) chevaux et autres vaches, chameaux, lphants, (l'amende est) moiti moindre. 297. Pour du menu btail cras, l'amende (est) de deux cents (panas) ; pour de jolis quadrupdes ou oiseaux sauvages, sera de cinquante l'amende (panas). 298. Pour des nes, chvres et brebis, l'amende sera de pour la mort d'un chien ou d'un porc, l'amende cinq mchas; sera d'un mcha. 299. Une femme, un fils, un esclave, un lve, un (jeune) frre utrin, tre chtis peuvent pour une faute commise, avec une corde ou une canne de bambou, 300. Mais (seulement) sur la partie postrieure du corps, 293. Verse ou peut-tre s'carte de la route . 294. Les voyageurs sont rendus responsables parce qu'ils ont choisi un cocher maladroit. 295. Sans aucun doute avicritah. Je me suis cart ici du texte de Jolly qui porte la leon vicritah : il faudrait entendre alors ce mot dans un autre sens : (l'amende) est prescrite . La nature de cette amende est dtermine dans les vers suivants 296-298. 296. Sa culpabilit : c'est--dire il paye la mme amende que pour un vol, soit mille panas. On ne s'explique pas comment un accident de voiture peut causer la mort d'un lphant. 297. Quadrupdes ou oiseaux sauvages daims et gazelles, flamants et perroquets . (Kull.) 300. C'est--dire est condamn mille panas d'amende. Cf. v. 296.
LES LOIS DE MANOU
239
la autrement encourt jamais sur la tte; quiconque frappe mme peine qu'un voleur. 301. Ainsi vous a t expose compltement la loi concernant les voies de fait; je vais maintenant dclarer la rgle pour fixer la peine du vol. 302. Que le roi fasse tous ses efforts pour rprimer les car par la rpression du vol s'accroissent sa gloire et voleurs; sa puissance. 303. Car le roi qui assure la scurit (de ses sujets) doit tre honor; en effet c'est (comme s'il accomplissait) toujours un sacrifice dont la scurit perptuel (publique reprsenterait) les honoraires. 304. Un roi qui protge le sixime des (ses sujets) acquiert mrites de chacun d'eux ; au contraire celui qui ne spirituels les protge le sixime de leurs point, acquiert galement dmrites. 305. Quelque (mrite que ses sujets acquirent) par l'tude du Vda, par les sacrifices, par les aumnes, par le culte rendu (aux dieux), le sixime juste le roi en reoit titre pour (prix) de la protection (qu'il donne ses peuples). 306. Quand un roi protge avec les justice (toutes) des chtiments coret chtie ceux qui mritent cratures, porels, (c'est comme s'il) offrait chaque jour un sacrifice avec cent mille honoraires. 307. Un roi qui n'assure aucune et qui prend protection, nanmoins le tribut des fruits de la terre), les (du sixime les taxes (sur les marchandises), les cadeaux impts, quoet les amendes, ira tout droit en enfer. tidiens, 308. On dit qu'un roi qui sans protger (ses sujets) reoit le sixime (des fruits de la terre) comme tribut, prend sur lui tous les pchs de tout son peuple. 303. Sacrifice : un sattra ou sance, grande fte du Soma, durant plusieurs jours, avec de nombreux officiants. Perptuel, littr. le sattra de celui-ci croit sans cesse . Les honoraires, prsents donns celui qui accomplit le sacrifice. 307. Les cadeaux quotidiens fruits, fleurs, lgumes, etc. . (Kull.)
240 309. Sachez qu'un qui s'enrichit
LES LOIS DE MANOU
prince qui n'observe pas la loi, qui est d'une manire athe, illgale, qui ne protge va en enfer. pas (ses sujets), qui mange (son peuple), 310. Que (le roi) rprime les criminels par soigneusement trois moyens : l'emprisonnement, les fers et les divers chtiments corporels. 311. Car en rprimant les mchants et en encourageant les bons, les princes sont toujours les comme purifis, Brahmanes (le sont) par les sacrifices. 312. Un souverain dsireux de son propre bien doit touenvers les plaideurs, les enfants, les jours se montrer patient et les malades l'invectivent. vieillards, lorsqu'ils 313. Celui qui pardonne des gens dans le malheur leurs est pour ce (fait) exalt au ciel; mais celui qui, (fier) injures, de sa puissance, ne leur pardonne pas, va pour ce (fait) en enfer. 314. Un voleur doit se prsenter au roi en toute hte, les cheveux le vol (en ces termes) : J'ai fait pars et confesser cela, punis-moi! 315. Il doit porter sur ses paules un pilon, ou une massue de bois dekhadira, ou un pieu aux deux bouts, ou pointu une verge de fer. 316. Puni ou relch, le voleur est purg de (du pch) sur lui la vol; mais le roi, en ne le punissant pas, prend du vol. responsabilit 309. Qui mange son peuple : cette expression rappelle le demoboros basileus d'Homre. 310. Chtiments corporels, vadha la schlague ou la mutilation de la main, du pied, etc. . (Kull.) 314. Un voleur dsigne ici, suivant Kull., celui qui a vol l'or d'un Brahmane . 315. Khadira = Mimosa catechu. Ces quatre instruments correspondent dans l'ordre aux quatre castes : le voleur repentant apporte lui-mme l'instrument de son supplice. 316. Soit qu'il rende l'me sur l'instant, frapp d'un coup de la massue ou des autres instruments, soit que, laiss pour mort, il survive . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
241
317. Le meurtrier d'un Brahmane instruit sa communique faute celui qui mange ses aliments, une femme infidle son poux, un lve ou celui pour qui le sacrifice-est offert son directeur un voleur (la communique) au roi. spirituel, 318. Les hommes des crimes, qui ont commis (mais) qui ont t punis par le roi, sont purifis et vont au ciel, comme des gens vertueux qui ont fait de bonnes actions. 319. Celui qui vole la corde ou le seau d'un puits, ou qui dtriore un rservoir, sera puni d'une amende d'un mcha, et remettra ces (objets) en la mme (place). 320. A celui qui vole plus de dix mesures de grain, un chtiment corporel (doit tre inflig); pour une quantit il payera onze fois (la valeur du grain vol) et (renmoindre, son bien. dra) au (possesseur) 321. De mme un chtiment (devra tre inflig) corporel au poids, (tels que) or, pour (un vol d'objets) qui se vendent et autres, ou de vtements argent prcieux, dpassant (une valeur de) cent (palas). 322. Pour de cinquante (un vol) de plus (palas), il est de couper la main au voleur ; pour un moindre prescrit (vol), on lui infligera une amende de onze fois la valeur intrinsque (de l'objet). 323. (Pour avoir enlev) des gens de qualit, et surtout des femmes, et pour avoir drob des bijoux prcieux, (le mrite la mort. coupable) 324. Pour avoir vol de gros animaux, des armes, un rele temps mde, le roi fixera l'amende aprs avoir considr et le motif. 317. Le meurtrier d'un Brahmane : le texte dit le meurtrier d'un foetus . Y aurait-il un jeu de mots tymologique sur bhrna et brahman? Le mari qui tolre un rival (Kull.), c'est--dire le mari complaisant. L'lve qui nglige les sacrifices , et le guru qui le tolre . (Kull.) 319. Un mcha d'or (Kull.) Sur cette valeur, cf. v. 134. 320. Pour une quantit moindre, littr. pour les autres (cas) . La mesure de grains appele kumbha = 20 dronas de 200 palas chaque, environ 3 boisseaux ou un hectolitre. 321. Sur la valeur du pala, cf. v. 135. 16
242 325.
LES LOIS DE MANOU
un Brahmane, Pour (vol) de vaches appartenant ainsi que pour vache, (les narines d')une pour avoir perc le coupable) aura la avoir drob du btail ( des Brahmanes, moiti du pied coup. du fu326. Pour (avoir vol) du fil, du coton, du ferment, du lait suri, du lait, du lait mier de vache, de la mlasse, de l'eau ou de l'herbe, baratt, et en jonc, du sel de toute en bambou 327. Des ustensiles de la terre, des cendres, sorte, (des vases) d'argile, clades oiseaux, de l'huile, du beurre 328. Des poissons, des animaux, du miel, et autres produits rifi, de la viande, de mme espce (telles substances 329. Et aussi d'autres bouillie de riz, mets de toute sorte, l'amende que) liqueurs, (de l'objet vol). (doit tre) le double de la valeur intrinsque 330. Pour (vol) de fleurs, graines vertes, buissons, plantes et autres non cosss, arbrisseaux, (grains) grimpantes, l'amende (sera) de cinq krichnalas. 331. Pour les (grains) fruits, cosss, racines, lgumes, s'il n'y a aucun lien de pal'amende (sera) de cent (panas), rent (entre le voleur et le vol); s'il y a un lien de parent, (elle sera) de cinquante (panas). en excut avec violence 332. Un acte (de cette nature) de l'objet) constitue un brigandage ; (du possesseur prsence c'est un vol (simple) ; et de en son absence, (s'il est excut) mme ce qu'on nie aprs l'avoir pris. vole les objets susdits, 333. Si quelqu'un sont) (lorsqu'ils ou s'il drobe le feu (sacr) d'une (pour s'en servir), prpars du premier maison, degr. que le roi lui fasse payer l'amende 325. Perc les narines d'une vache, c'est--dire lui avoir pass une courroie dans les narines pour la faire travailler comme bte de somme . (Kull.) 328. Produits des animaux, cuir, corne, etc. . (Kull.) 330. Et autres grains, je lis anyeshu au lieu de la leon de Jolly alpeshu en petite quantit. 331. Lien de parent, ou plus gnralement un lien quelconque. 333. L'amende du premier degr, 250 panas. Il s'agit ici non pas comme le veut Govind., du feu ordinaire laukika, mais du feu sacr, car vu l'insignifiance du dlit, l'amende serait exagre . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 334.
243
acavec lequel un voleur Quel que soit le membre le roi doit le lui ter complit (son crime) envers la socit, pour l'exemple. une un ami, une mre, 335. Un pre, un prcepteur, un fils, un prtre ne doivent pas tre pouse, domestique de leur devoir. laisss impunis par le roi, quand ils s'cartent une 336. L o un simple particulier serait condamn amende d'un krchpana, le roi en devra payer mille : telle est la rgle. 337. Pour un vol, la culpabilit d'un Soudra est huit fois celle d'un Vaisya seize fois, celle d'un Kchaplus grande, fois, triya trente-deux 338. Celle d'un Brahmane fois, ou mme soixante-quatre ou deux fois soixante-quatre cent fois compltes, fois, lorsla nature de la faute. que (chacun d'eux) connat 339. (Prendre) des racines et fruits aux arbres, du combustible pour le feu, de l'herbe des vaches, pour la nourriture Manou a dclar que ce n'tait pas un vol. 340: Si un Brahmane, ou de ses pour prix d'un sacrifice cherche obtenir un bien de la main d'un homme leons, qui a pris ce qu'on ne lui avait pas donn, il devient l'gal d'un voleur. 341. Un Dvidja en voyage dont les provisions sont pui334. Pour l'exemple, signifie suivant Kull. pour empcher la rptition du crime . 336. Cette amende il la jettera dans l'eau, ou la donnera aux Brahmanes. (Kull.) 337. Culpabilit, c'est--dire l'amende. Huit fois plus grande que la peine ordinaire . (Kull.) 338. La nature de sa faute, littr. la qualit de sa faute , moins qu'on ne veuille dans doshaguna voir avec L. un compos copulatif le mal et le bien de l'action . 339. Aux arbres non enclos . (Kull.) Pour le feu du sacrifice : la saintet du but excuse le mal de l'action ; il en est de mme dans le cas suivant. 340. Un sacrifice qu'il a accompli pour lui . Cherche obtenir : Kull. ajoute en connaissance de cause . 341. Cette permission n'existe pas pour le Soudra.
244
LES LOIS DE MANOU
pour avoir pris dans ses, ne doit point tre mis l'amende deux cannes sucre ou deux racines. le champ d'autrui du btail en libert ou met en li342. Celui qui attache autrui), et celui qui du btail attach bert (appartenant les une voiture, encourent un esclave, un cheval, prend mmes peines que le voleur. ces rgles acles voleurs suivant 343. Un roi qui rprime aprs quiert de la gloire en ce monde et la plus haute flicit la mort. d'Indra et au sjour 344. Un roi dsireux de parvenir ne doit une gloire et indestructible, (d'avoir) imprissable un homme un acte souffrir qui commet pas un seul instant de violence. doit tre un acte de violence 345. L'homme qui commet comme le pire des mchants, considr (pire mme) que le le voleur, ou celui qui frappe avec un bton. diffamateur, d'un acte de viol'auteur 346. Mais le prince qui pargne sa perte et se rend odieux lence court rapidement ( ses ni en vue d'un profit consiNi par un motif d'amiti, le roi ne doit (jamais) laisser ceux qui drable, chapper des actes de violence et rpandent la terreur commettent parmi toutes les cratures. les armes lorsque leurs 348. Les Dvidjas peuvent prendre devoirs sont entravs et quand une calamit rsultant (du des temps (menace) les castes rgnres. malheur) 349. Pour sa dfense personnelle, dans une lutte pour les dons du sacrifice, les femmes et les Brahpour protger celui qui tue pour le bon droit n'est pas criminel. manes, 342. Suivant le degr plus ou moins fort du dlit, ils devront tre punis de la mort, de la mutilation, ou de la confiscation des biens. (Kull.) 344. Un acte de violence incendie de maison, brigandage . (Kull.) 348. Leurs devoirs, ou bien quand la justice est entrave , car dharma a les deux sens. Le malheur des temps en temps d'invasion d'une arme trangre . (Kull.) Les castes rgnres, c'est--dire les Dvidjas. 349. La premire partie du vers, jusqu' celui qui tue, pourrait tre rapporsujets). 347.
LES LOIS DE MANOU
245
350. On peut tuer sans hsitation vous attaque quiconque la main, un enfant, un les armes un prcepteur, (ft-ce) vieillard ou un Brahmane trs instruit (dans le Vda). 351. Celui qui tue soit en public, soit en secret, un agresun crime seur main arme, ne commet aucunement ; c'est la violence oppose la violence. 352. Ceux qui entretiennent criminelles avec des relations la femme du prochain, les bannisse aprs les que le prince avoir marqus de chtiments la terreur. qui inspirent 353. Car de (l'adultre) des castes le mlange provient et de ce (mlange) rsulte la violation des parmi le monde, devoirs mmes (de la socit) et dtruit qui coupe les racines toute chose. 354. Un homme qui a des entretiens secrets avec la femme du prochain, accus de fautes (de (s'il) a t prcdemment ce genre),payera l'amende du premier degr. 355. Mais un homme qui n'a pas encore t accus, et qui cause (avec une femme) ne compour un motif (avouable), met aucun crime ; car il n'y a point de sa part violation (de la loi). 356. Celui qui s'entretient avec la femme du prochain te ce qui prcde : Les Dvidjas peuvent prendre les armes pour leur dfense personnelle, etc. Dans une lutte pour les dons du sacrifice dans une lutte cause par une tentative d'enlvement des vaches et autres dons du sacrifice . (Kull.) 350. On peut tuer lorsqu'on est dans l'impossibilit de se sauver par la fuite . (Kull.) 352. Chtiments qui inspirent la terreur couper le nez et les lvres . (Kull.) 353. Adharma, signifie le pch ou le non-accomplissement des devoirs . Les sacrifices n'tant pas accomplis rgulirement par suite du manque de sacrificateurs qualifis pour les offrir, il n'y aurait pas de pluie, et par suite le monde entier prirait. (Kull.) 355. Suivant Kull. il s'agit d'une conversation faite en prsence de tmoins . 356. Il payera l'amende de l'adultre, mille panas. (Kull.) Parce qu'on suppose qu'il avait de mauvais desseins en choisissant un lieu solitaire et cart pour s'entretenir avec la femme du prochain.
246
LES LOIS DE MANOU
un bain sacr, dans une fort ou dans un bois, ou au confluent de deux rivires, est passible (de la peine) de l'adultre. 357. tre aux petits soins (pour une femme), jouer (avec et ses vtements, s'asseoir avec ses parures elle), toucher comme (entaelle sur un lit, tous (ces actes) sont considrs chs) d'adultre. un en358. Si quelqu'un touche une femme (marie) ou se laisse toucher droit inconvenant par elle (de la mme rciproque faon), tous (ces actes faits) d'un consentement d'adultre. sont considrs comme (entachs) mrite la peine de mort 359. Un non-Brhmane pour des quatre castes doivent car les femmes l'adultre, toujours tre gardes avec soin. les personnes 360. Les mendiants, les bardes, qui ont acd'un sacrifice et les artisans peucompli les rites initiatoires vent sans empchement causer avec des femmes (maries). ne lie conversation avec la femme du 361. Que personne la dfense si on le lui a dfendu ; celui qui malgr prochain, d'un souvarna. causerait (avec elle), mrite une amende ne concerne des com362. Cette rgle pas les femmes de ni des (maris) qui vivent diens ambulants, (des intrigues) leurs pouses, leurs femmes ; car ceux-ci ou, se prostituent leur commerce tenant cachs, favorisent galant. celui qui a des entretiens secrets avec ces 363. Toutefois, d'un ou avec des servantes matre, (femmes), dpendant ou avec des religieuses, doit payer une lgre amende. 357. Aux petits soins, lui envoyer des bouquets, des parfums et des onguents . (Kull.) 359. Un non-Brhmane dsigne un homme des trois dernires castes. Pourtant Kull. spcifie le cas d'un Soudra qui viole une Brhman . 360. Sans empchement : un autre sens, adopt par B. H. est ( moins) cuisiniers, qu'ils n'en aient reu la dfense (du mari) . Des artisans etc. . (Kull.) Causer de leurs affaires . (Kull.) 361. Si on le lui a dfendu : on dsigne ici le matre de la femme, svmin, celui dont elle dpend. 363. Des religieuses bouddhistes . (Kull.) Il s'agit vraisemblablement de sectes mprises.
LES LOIS DE MANOU
247
364. Celui qui dflore une jeune fille malgr elle doit recevoir aussitt un chtiment qui la corporel ; mais l'homme dflore avec son consentement ne mrite point de chtiment corporel, (pourvu qu'il soit) de mme (caste). de un (homme 365. Si une jeune fille fait des avances aucune caste) suprieure, (le roi) ne devra lui faire payer un (homme de caste) inf; mais si elle s'adresse (amende) il l'obligera rester confine chez elle. rieure, 366. (Un homme de caste) infrieure qui fait la cour une un chtiment (jeune fille de la caste) la plus leve mrite celui qui fait la cour une (jeune fille de) mme corporel; si le pre y consent. (caste) devra donner le prix nuptial, souille une 367. L'homme dans son drglement, qui, et doit avoir aussitt les deux doigts coups jeune fille, de six cents (panas). payer une amende une jeune 368. Un (homme) de mme (caste) qui dshonore fille consentante, ne doit point subir l'amputation des doigts, une amende de deux cents (panas) pour mais on lui infligera le (retour d'un pareil) fait. prvenir doit 369. La jeune fille qui en contamine une autre payer tre condamne deux cents d'amende, (panas) 364. Chtiment corporel la mutilation des parties gnitales, etc., si ce n'est pas un Brahmane . (Kull.) 365. Confine ehes elle enchane jusqu' ce qu'elle se soit dfaite de sa passion . (Kull.) 366. Uttama de la caste la plus leve , mais Kull. l'explique seulement par de caste suprieure . Le prix nuptial, c'est--dire l'pouser. S'il courtise une jeune fille de mme caste de l'aveu de celle-ci, si le pre y consent, il donnera au pre le prix nuptial ; dans le cas contraire il payera une amende (au roi) et la jeune fille devra l'pouser . (Kull.) Le prix nuptial est le prix d'achat de la fiance. 367. Souille une jeune fille : il ne s'agit pas ici d'un viol proprement dit, mais seulement d'un attouchement avec les doigts . (Kull.) Voil pourquoi il est condamn avoir les doigts coups, en vertu du principe qui punit le membre coupable. 368. Dshonore doit s'entendre comme au vers prcdent d'un acte d'onanisme. De mme dans les vers suivants, 369-370. 369. Payer deux fois le prix nuptial au pre de la jeune fille . (Kull.)
248
LES LOIS DE MANOU
deux fois le. prix nuptial, et recevoir dix (coups de) verge. 370. Mais la femme une jeune fille (marie) qui souille mrite d'avoir la tte rase, deux doigts coups, aussitt et d'tre promene les rues) sur un ne. ( travers 371. (Si) une femme fire de sa parent ou de ses (propres) son poux un autre), avantages, outrage (en se donnant en un lieu trs frque le roi la fasse dvorer par des chiens quent. 372. Qu'il fasse brler le complice de sa faute sur un lit de fer rouge, et qu'on mette au-dessous du bois, (jusqu' ce soit brl. que) le coupable 373. Pour un coupable accus de (rcidive (d'adultre) dans la mme) l'amende sera double; il en sera de anne, mme pour avoir cohabit avec une Vrty (avec rcidive) ou une femme de caste mprise. 374. Un Soudra avec une femme d'une qui a des relations des trois premires ou non garde, castes, garde perd le membre et tous ses (biens) si elle n'tait (coupable) pas garsi elle l'tait. de, et (il perd) tout (la vie et la fortune) 375. (Pour adultre avec une Brhman un Vaigarde), (perdre) tous ses (biens) sya sera condamn aprs (avoir d'un an, un Kchatriya une subi) un emprisonnement payera amende de mille (panas) et aura la tte rase avec de l'urine (d'ne). 376. Si un Vaisya ou un Kchatriya a des relations avec une Brhman non garde, que (le roi) fasse payer cinq cents et mille au Kchatriya. (panas) au Vaisya 377. Mais l'un et l'autre, avec une (s'ils) ont des relations 373. Une vrty (cf. X, 20) est la femme d'un Dvidja qui n'a pas t initi, et qui est exclu de la Svitr (Kull.). Une femme de caste mprise, une Cndl. La rcidive a lieu dans la mme anne. 374. Garde par son poux et par d'autres . (Kull.) La diffrence entre les deux cas s'explique, je pense, par ce fait que la ngligence de l'poux ou autre gardien naturel de la femme diminue d'autant la culpabilit de l'adultre. 377. Une Brhman doue de vertus , ajoute Kull.
LES LOIS DE MANOU
249
Brhman tre punis comme un Soudra ou garde, devront brls sur un feu d'herbes sches. 378. Un Brahmane garqui use par force d'une Brhman de payera une amende de mille (panas) ; il en payera cinq cents (si la femme) avec laquelle il a eu des relations tait consentante. 379. Pour un Brahmane, la tonsure la peine caremplace de la peine pitale, (tandis que) les autres castes sont passibles de mort. 380. Que (le roi) ne fasse jamais prir un Brahmane, etil commis tous les crimes ; qu'il le bannisse de son royaume en lui laissant ses biens, et sans lui faire aucun mal. 381. On ne connat pas dans ce monde de plus grand crime d'un Brahmane; que le meurtre que le roi donc ne conoive le meurtre d'un Brahmane. pas, mme en pense, 382. Un Vaisya qui a des relations avec une femme Kchaou un Kchatriya avec une femme Vaisya triya garde (gartous deux le mme chtiment de), mritent que (s'il s'agisnon garde. sait) d'une Brhman 383. Un Brahmane une amende de mille (panas) payera avec des femme gardes ces pour adultre (appartenant) deux (castes) ; pour un Kchatriya ou un Vaisya (qui ont des l'amende sera de avec une femme Soudra relations) (garde), mille (panas). non gar384. (Pour adultre) avec une femme Kchatriya de cinq cents (panas); de, le Vaisya quant (sera ) l'amende 379. Pour un Brahmane : il s'agit non seulement d'un cas d'adultre, mais en gnral de tous les crimes pouvant entraner la peine capitale. C'est un principe absolu, confirm par les deux vers suivants, que la personne du Brahmane est inviolable. Par la tonsure, il faut entendre ici non pas la crmonie appele Cdkarman dont il a t question au livre II, v. 35, mais une tonsure ignominieuse, sans doute celle qui est indique au v. 375, tre ras avec de l'urine d'ne. 382. Ce chtiment est (cf. v. 376) une amende de 500 panas pour le Vaisya et de mille pour le Kchatriya. 384. Quant au Kchatriya, pour le mme dlit, c'est--dire adultre avec une Kchatriya non garde . (Kull.)
250
LES LOIS DE MANOU
d'avoir la tte rase avec de choisir il peut au Kchatriya, l'urine (de cinq cents panas). (d'ne) ou de payer l'amende avec des femmes 385. Un Brahmane qui a des relations avec ou Vaisya, ou (mme) de caste Kchatriya non gardes mais (il en une Soudra, payera cinq cents (panas) d'amende; mille (si c'est avec) une femme de la plus basse classe. payera) ni adul386. Le roi dans la ville duquel il n'y a ni voleur, des violences ni personne qui commette tre, ni diffamateur, d'Indra. sera admis au royaume ou des brutalits, de dlits) dans son de ces cinq (sortes 387. La rpression assure un roi la souverainet parmi (les rois) ses royaume pairs, et la gloire en ce monde. aban388. Si la personne pour qui est offert le sacrifice abandonne officiant ou si le prtre donne le prtre officiant, la personne (alors que l'un et pour qui est offert le sacrifice, le sacrifice et ne sont souills sont en tat (d'accomplir) l'autre) de ils devront tre mis l'amende faute grave), (d'aucune mille (panas) chacun. ni un fils ne 389. Ni un pre, ni une mre, ni une femme, moins doivent tre abandonns ; celui qui les abandonne, (de leur caste), doit tre puni par le qu'ils ne soient dgrads de six cents (panas). roi d'une amende au sujet des deux Dvidjas sont en discussion 390. Lorsque de son propre devoirs des (diffrents) ordres, un roi soucieux 385. De la plus basse classe : au-dessous des quatre castes, il y a les castes mixtes dont il est question au livre X. Kull. donne pour exemple ici une femme Cndl . 386. Dans la ville doit s'entendre plus gnralement du royaume. Brutalit littr. personne qui frappe avec un bton . Indra est dsign ici par un de ses surnoms akra. 388. A l'amende de mille panas chacun, cela veut dire que celui des deux qui sans un motif valable, tel que l'indignit de l'autre partie, abandonne le sacrifice, est passible de l'amende. 390. Les diffrents ordres : on se rappelle qu'il y en a quatre, tudiant, matre de maison, anachorte et mendiant. Suivant Kull., il s'agit seulement des matres de maison , et non des quatre ordres. D'autres l'entendent des ermites .
LES LOIS DE MANOU
251
de dcider bien se gardera ( la lgre le sens de) la loi. le roi, assist comme il convient, 391. Les ayant honors les apaiser par de bonnes devra d'abord de Brahmanes, paleur enseigner leur devoir. roles et (ensuite) donnant un festin vingt Brahmanes, 392. Un Brahmane et celui voisin d'inviter son plus proche qui (nglige) ct de ce dernier, immdiatement (alors que qui demeure d'une amende est passible tous deux) mritent (cet honneur), d'un mcha. un d'inviter instruit 393. Un Brahmane qui (nglige) ses ftes de famille, et vertueux instruit (autre) Brahmane devra lui payer le double (de la valeur) du repas, et un mcha au roi). d'or (comme amende un septuagun estropi, un idiot, 394. Un aveugle, aux Brahmanes naire, et un (homme) qui rend des services tre contraints l'impt ne devront instruits par aucun (roi). un Brahdes gards 395. Que le roi tmoigne toujours dans le malheur, un malade, (quelqu'un) mane instruit, de une personne un vieillard, un indigent, un enfant, un homme honorable. qualit, sur 396. Un blanchisseur doit laver (le linge) doucement bien polie; il ne doit point une planche de (bois de) slmali ni les faire porter des effets pour d'autres, (par qui changer que ce soit). 397. Un tisserand (qui a reu) dix palas (de fil pour faire 392. Sur le sens de prtiveya et d'anuveya les commentateurs ne sont pas d'accord. Suivant Medh. prtiveya est le voisin qui habite en face de lui, et anuveya celui qui habite derrire lui. J'ai suivi l'interprtation de Kull. Un mcha d'argent . (Kull.) 393. A ses ftes de famille telles que mariage, etc. (Kull.) Un Brahmane instruit, un rotriya son voisin . (Kull.) . 394. Un estropi,littr. celui qui marche avec un banc c'est--dire sans doute ce que nous appelons un cul-de-jatte. 395. Un homme honorable, un rya. 396. lmali = Bombax heptaphyllum. S'il fait cela, il payera une amende. (Kull.) 397. Un pala en plus : il doit rapporter une toffe pesant onze palas, par
252
LES LOIS DE MANOU
de l'toffe) un pala en plus ; s'il agit autredoit rapporter d'une amende de douze (panas). ment, il est passible 398. Le roi prlvera la vingtime partie du tarif que fixeront pour les (diverses) marchandises des (gens) experts dans l'imposition des taxes, et connaissant de (la valeur) toutes les denres. 399. Le prince tout l'avoir de celui qui par confisquera des marchandises dont (le roi) a le monocupidit exporte pole ou (dont la vente) est interdite. 400. Celui qui fraude les pages, qui achte et vend une heure indue, qui fait une fausse dclaration dans l'numration (de ses marchandises), une amende payera gale huit fois (le droit qu'il a fraud). 401. Considrant la provenance, la destination, le sjour le gain et le dchet de toutes les denres, le roi (en magasin), fixera (les tarifs) d'achat et de vente. 402. Tous les cinq jours, ou la fin de la quinzaine, le roi tablira en prsence de ces (experts) le tarif (des marchandises). 403. Les poids et mesures doivent toujours tre poinonns et vrifis nouveau tous les six mois. 404. A un bac le page pour une voiture (vide) est d'un d'un quart pana, d'un demi-pana pour un homme (charg), d'un huitime de (de pana) pour une vache et une femme, sans fardeau. pana pour un homme 405. Des voitures de colis doivent le charges acquitter suite de la portion de gruau et autres substances qui entre dedans . (Kull.) Il est vident que l'auteur vise ici l'augmentation du poids du fil brut par l'apprt. 400. A une heure indue la nuit . (Kull.) 401. La provenance et la destination gama et nirgama de quelle distance elles viennent pour les marchandises d'importation, quelle distance elles vont pour les marchandises d'exportation. (Kull.) 402. Tous les cinq jours pour les denres d'un prix variable, et la fin de la quinzaine pour les marchandises d'un prix invariable. (Kull.) 405. Des hommes sans bagages ou sans escorte. Kull. entend par l des mendiants . Des caisses vides : on peut faire du compos rikta-
LES LOIS DE MANOU
253
la valeur (des marchandises) ; des caisses vides page suivant et des hommes sans bagages une somme insigni(payeront) fiante. 406. Pour un long parcours (par eau), le tarif sera proportionn au lieu et au temps ; sachez que ce (tarif n'est applicable qu'aux parcours les rives d'un fleuve ; en qui suivent) mer il n'y a point de (fret) fix. 407. Une femme de deux et plus, un mois grosse un anachorte et les Brahmanes les insiascte, portant ont droit la gratuit du passage sur gnes de leur ordre un bac. 408. Tout ce qui est endommag sur un bateau par la faute des bateliers, doit tre remplac collectivement aux frais des bateliers, par cotisation. 409. Telle est la dcision tablie en cas de contestation des si les bateliers sont en faute pendant la traverse ; passagers, l'accident est l'effet) de la fatalit, (quand (ils ne doivent) aucune indemnit. 410. Que (le roi) oblige les Vaisyas ( faire) le commerce, le prt d'argent, la culture, l'lve du btail, et les Soudras servir les Dvidjas. 411. Un Brahmane devra aider un Kchatriya par charit et un Vaisya dans l'indigence, en leur faisant excuter les travaux propres ( leur caste respective). 412. Si un Brahmane (abuse par avarice de) sa puissance pour contraindre malgr eux des Dvidjas ayant reu l'initiation faire oeuvre servile, d'une amende que le roi le punisse de six cents (panas). bhndni un compos possessif en le rapportant ynni sous-entendu : le sens serait alors des voitures charges de caisses vides . 406. Au lieu et au temps suivant que l'eau est fortement agite ou calme, ou bien qu'on est en t ou en hiver . (Kull,) 407. Grosse de deux mois , c'est--dire partir du moment o la grossesse se voit extrieurement. Les insignes de leur ordre : suivant Kull., cette expression dsigne des tudiants qui ont les insignes du noviciat .
254
LES LOIS DE MANOU
faire 413. Quant au Soudra, achet ou non, qu'il l'oblige existant de luioeuvre servile, car il a t cr par l'tre mme pour le service des Brahmanes. n'est pas 414. Un Soudra mme affranchi par son matre tant inn en lui, ; car ce (caractre) dgag de la servitude ? l'effacer qui donc pourrait : celui qui a t fait pri415. H y a sept espces d'esclaves sonnier sous les drapeaux, celui qui entre au service pour la celui qui est celui qui est n dans la maison, nourriture, achet et celui qui est donn, celui qui est transmis de pre en fils (par hritage), et celui qui est devenu esclave par suite d'une amende (non paye). 416. Une femme , un enfant, un esclave , ces trois sont dclares ne rien possder ; (le bien) (personnes) celui dont elles dqu'elles acquirent appartient pendent. 417. Un Brahmane les peut en toute scurit s'approprier biens d'un Soudra'(son rien en esclave) ; car celui-ci n'ayant son matre peut lui prendre son bien. propre, 418. ait soin d'obliger les Vaisyas et Que le (roi) les Soudras remplir leurs fonctions ; car si ces deux leurs le monde serait boudevoirs, (castes) manquaient levers. 419. Qu'il s'occupe de sesenchaque jour de l'achvement 413. Achet ou non c'est--dire entretenu ou non . (Kull.) Il serait plus naturel, ce semble, d'entendre achet comme esclave ou seulement entr en condition en change de sa nourriture ; cf. v. 415 les sept catgories de serviteurs. 415. Celui qui a t fait prisonnier sous les drapeaux dans une bataille . (Kull.) Ce passage semblerait tablir qu'un Kchatriya peut-tre rduit en esclavage, cependant Medh. conteste cette interprtation, et veut qu'il s'agisse ici seulement d'un Soudra pris la guerre . 417. Kull. ajoute en cas de dtresse, le Brahmane peut mme avoir recours la force pour enlever un esclave ce qu'il possde, sans s'exposer une amende de la part du roi . En toute scurit peut signifier ou bien sans craindre de commettre un pch ou tout simplement sans s'exposer une amende .
LES LOIS DE MANOU
255
et (inspecte) ses btes de somme, ses revenus et ses treprises, fixes, ses mines et son trsor. dpenses 420. Le roi qui rgle ainsi toutes les affaires et litigieuses vite tout pch, parvient la condition suprme. 420. On peut construire autrement : Le roi qui rgle ainsi toutes les affaires litigieuses, vite le pch et parvient la condition suprme, c'est-dire la batitude, la dlivrance finale, moksha.
LIVRE Devoirs Suite des
NEUVIME des Lois poux. civiles
L'Hritage.
et criminelles.
1. Je vais maintenant les lois ternelles exposer pour le chemin du devoir, soit sl'poux et l'pouse, qui suivent pars, soit runis. 2. Nuit et jour les femmes doivent tre tenues dans la det autres) mles (de la famille) ; pendance par leurs (maris aux objets des sens, on doit les si elles sont (trop) attaches tenir sous son autorit. 3. (C'est) leur pre (qui) les protge dans leur enfance, leur poux (qui les protge dans leur jeunesse, leurs fils (qui) les protgent dans leur vieillesse ; la femme ne doit jamais tre indpendante. 4. Un pre qui ne donne pas (sa fille en mariage) temps est blmable est un poux ; blmable qui ne voit pas (sa femme aux poques est un fils qui ne ; blmable voulues) est devenue veuve. protge pas sa mre lorsqu'elle 1. L'poux et l'pouse dans une carrire exempte d'infidlit rciproque . Kull. Spars, c'est--dire quand l'poux est absent ou mort. 2. Objets des sens mme permis . Kull. tmano vae : je rapporte le pronom rflchi celui dans la dpendance duquel se trouve la femme, Kull. au contraire le rapporte cette dernire : Elles doivent tre mises sous leur propre contrle, c'est--dire elles doivent rprimer elles-mmes leur penchant excessif aux objets des sens. 4. A temps veut dire, suivant Gautama cit par Kull., avant qu'elle ait commenc avoir ses menstruations . Veuve : les lois de Manou ne connaissent pas la coutume barbare de s acrifier la femme sur le bcher du mari dfunt. 17
258
LES LOIS DE MANOU
5. Les femmes doivent tre particulirement prserves contre les mauvaises sans consfussent-elles inclinations, elles feront le chagrin de deux quence ; car non surveilles, familles. de (toutes) 6. Considranl que c'est l le devoir principal les castes, de garder mme faibles s'efforcent que les maris leurs femmes. 7. Car en gardant sa femme, on prserve soigneusement et sa postrit, les coutumes sa famille, soi-mme vertueuses, ses propres devoirs. un foetus 8. L'poux en entrant dans sa femme, (y) devient et renat ici-bas ; la dnomination donne l'pouse, de jy vient de ce que l'homme fois en nat une seconde (Jyate) elle. tel 9. Tel (l'homme) femme connat charnellement, qu'une doit l'enfant (l'poux) qu'elle met au monde ; c'est pourquoi de sa sa femme en vue de la puret soigneusement garder postrit. 10. Personne ne peut les femmes garder par la force; : mais on peut les garder suivants par les moyens amasser ou d11. Que (le mari) occupe sa (femme) et son propre tenir (les objets penser l'argent, propres cuire les aliments et (accomplir) ses devoirs, corps), les ustensiles de mnage. surveiller la maison (mme sous la sur12. Les femmes enfermes de confiance ne sont pas gardes ; cellesd'hommes veillance) elles-mmes. l (seules) sont bien gardes qui se gardent 6. Mme faibles aveugles, perclus . (Kull.) 7. Sa postrit, c'est--dire on assure la puret de sa ligne, Sa famille les enfants lgitimes seuls ont qualit pour offrir les sacrifices funraires aux Mnes des anctres . (Kull.) Soi-mme: pour la mme raison.Ses devoirs : le mari d'une femme infidle n'a pas le droit d'allumer le feu sacr . (Kull.) 8. Encore un calembour tymologique. B. fait remarquer que cette ide est emprunte au Vda : voyez Aitareya Brhmana, VII, 13 . 11. Ses devoirs : obissance envers le mari. 12. Homme de confiance dsigne sans doute un eunuque.
LES LOIS DE MANOU 13.
259
La boisson, l'absence les mauvaises frquentations, le vagabondage, de l'poux, le sommeil ( des heures indues) et le sjour dans une maison telles sont les six trangre, (sources de) dshonneur pour une femme. 14. Les femmes ne regardent et ne tienpas la beaut, nent aucun compte de l'ge ; beau ou laid (elles se disent) : C'est un homme lui. , et se donnent 15. Par passion pour l'homme, par par mobilit d'esprit, leurs naturel elles trahissent ici-bas d'affection, manque soigneusement qu'on les garde. poux, quelque 16. Donc connaissant cette disposition naturelle qu'a mise au moment l'homme doit en elles le Crateur de la cration, les garder. un soin extrme apporter 17. (L'amour de) leur lit, (de) leur sige, (de) la toilette, la malice et la la luxure, la colre, les penchants vicieux, aux (voil les attributs dpravation, assigna que) Manou femmes. 18. Pour les femmes, il n'y a point de crmonies relide prires : telle est la loi tablie. Les gieuses accompagnes et exclus des prires, femmes, (tres) incomplets (sont) le (mme) : telle est la rgle. mensonge 19. En effet il y a plusieurs passages dans les Vdas mmes 14. Cette conception du caractre de la femme est tout fait orientale. La Bruyre a dit avec plus de justesse et de courtoisie : Il y a des femmes pour qui un jardinier est un jardinier, et d'autres pour qui c'est un homme. Peut-tre faut-il limiter le jugement svre de Manou aux femmes qui sont dans les six cas numrs au v. 13. 17. L'amour de leur lit et de leur sige, c'est--dire la paresse. Les penchants cicieux, littr. anryat le manque de noblesse. Manou est ici non pas l'auteur des lois, mais le crateur Manou fils de l'Etre existant par lui-mme. 15. Crmonies accompagnes de prires (mantras), telles que la crmonie de la naissance, etc.. (Kull.) Exclues des prires (mantras), signifie qu'il n'y a pour elles aucune crmonie accompagne de mantras. Kull. ajoute qu'elles sont ignorantes de la loi, tant prives (de la connaissance) de la Smrti et de la ruti qui en sont le fondement . Cf. livre II, 66. 19. Littr. Il y a plusieurs textes rvls (ruti) chants dans les saintes critures (nigama).
260 destins
LES LOIS DE MANOU
coutez le naturel caractriser (de la femme). de leurs les textes sacrs concernant) l'expiation (maintenant (pchs). et infidle son poux a pch, 20. Si ma mre dvoye ! Telle est de moi cette semence puisse mon pre loigner de cette formule la teneur d'expiation. en son esprit quoi que ce soit 21. Si (une femme) mdite est dclare cette de fcheux (formule) pour son poux, de cette infidlit. (l'expiation) parfaite qui une d'un homme 22. Quelles que soient les qualits elle les acquiert s'unit femme elle-mme, lgitimement, dans l'Ocan. comme une rivire (qui se confond) 23. Akchaml, (bien que) ne dans la plus basse caste, par et Srangu son union avec Vasichtha, (par son union) avec devinrent Mandapla dignes d'honneur. de basse femmes 24. Elles et d'autres ici-bas, qui taient un rang lev, grce aux belles quaont atteint extraction, lits de leurs poux. ordinaire 25. Telle est la rgle toujours pure de conduite les lois relamaintenant du mari et de la femme ; apprenez et aprs la de prosprit ici-bas source tives aux enfants, mort. 20. Dvoye, peut-tre au sens propre allant dans la maison d'un autre _ (Kull.) Cette semence de l'homme adultre . Cette formule est mise dans la bouche d'un fils instruit de la faute de sa mre . (Kull.) B. fait remarquer qu'elle se retrouve dans le nkhyana Gi'hya Stra, III, 13 . 21. Cette prire est une expiation pour le fils et non pour la mre. (Kull.) 22. Quand une rivires'unit l'Ocan, son eau devient aussi sale. (Kull.) 23. Vasishtha, clbre sage vdique auquel on attribue plusieurs hymnes, pousa une Cndl. Akshaml ou Arundhat : cette dernire personnifie l'toile du matin. Le sage Mandapla, suivant le Mahbhrata, malgr sa dvotion, tant tomb en enfer, parce qu'il n'avait pas d'enfant pour l'en tirer, prit la forme de l'oiseau dit Sranga et eut d'une femelle de cette espce quatre enfants. Devinrent dignes d'honneur, veut dire qu'elles obtinrent le ciel en rcompense de leur dvouement leurs poux. 25. Aprs la mort, parce que les enfants font les sacrifices funraires aux Mnes.
LES LOIS DE MANOU 26. Entre des
261
diheureuses femmes par leur fcondit, un flambeau et qui sont (comme) (clairant gnes d'honneur, il n'existe et la desse de la fortune, pas, toute) la maison, diffrence. la moindre dans les familles, ils des enfants, les soigner au monde 27. Mettre quand dans tous leurs les soins domestiques sont ns, et (surveiller) de la femme. les fonctions dtails, (telles sont) videmment des devoirs 28. La postrit, religieux, l'accomplissement de la volupt les petits soins, (tout cela) dpend suprme, et pour ainsi que (l'entre du) ciel pour les anctres l'pouse, soi-mme. et son ses penses, ses paroles 29. Celle qui rfrnant monde arrive dans le mme corps, ne trahit pas son poux, par les gens de bien une que lui (aprs la mort) et est appele femme vertueuse. son mari, une femme encourt 30. Mais par son infidlit et (aprs la mort) elle renat dans le le blme en ce monde, affreuses. sein d'un chacal et est afflige de maladies au fils , cette relativement 31. Apprenez maintenant, toute l'humanit, sainte dcision prononce par applicable et par les grands sages, ns ds le principe. les gens vertueux au sei32. Ils sont d'avis que le fils (lgitime) appartient celui qui a engneur (de la femme) ; mais en ce qui concerne 26. Calembour sur str femme et r la desse de la Fortune : cela revient dire qu'une femme vertueuse et fconde fait la prosprit d'une maison. 27. Les soins domestiques rgaler les htes et amis, etc. . (Kull.) Dans tous leurs dtails pratyartham : une autre leon porte pratyaham journellement. 28. Devoirs religeux l'agnihotra et autres . (Kull.)Par volupt suprme il faut entendre ici le plaisir sexuel. L'entre du ciel, parce que celui qui n'a pas de fils lgitime tombe en enfer. Cf. la note du v. 23 sur la lgende de Mandapla. Le mot putra fils est expliqu ailleurs par le calembour tymologique de put-tr qui tire de l'enfer appel put. 30. Maladies affreuses, ou comme dans plusieurs autres passages, maladies qui sont la punition d'une faute antrieure, telles que la phtisie et la lpre . (Kull. ) 32. Propritaire du sol dsigne le mari de la femme: mme s'il ne l'a pas engendr lui-mme . (Kull.) La comparaison de la femme un champ
262
LES LOIS DE MANOU
il y a divergence dans les textes gendre (un fils illgitime), rvls ; les uns dclarent celui (que l'enfant appartient) les autres disent (qu'il est) au propritaire qui l'a engendr, du sol. 33. La tradition considre la femme comme le champ et l'homme comme la semence ; la production de tous les tres du sol avec la semence. corporels (est due) l'union 34. Parfois c'est la semence c'est qui prdomine, parfois la matrice de la femme ; mais quand toutes les deux sont est (le plus) estim. gales, (c'est alors) que le produit 35. De la semence et de la matrice, c'est la semence qui est dclare : car le produit de toutes les plus importante est caractris cratures de la sedistinctifs par les signes mence. 36. Quelque semence qu'on jette dans un sol prpar (par le labourage) en temps une (plante (opportun), de) mme en cet endroit, les proprits dis(espce) pousse portant de sa (semence). tinctives 37. En effet cette terre est appele l'ternelle des matrice la semence tres crs, et (pourtant) ne dveloppe dans ses de la matrice. aucune des qualits productions 38. Ici-bas des semences de diffrentes semes en sortes, dans un mme terrain temps voulu par les laboureurs pousleur propre nature. sent (chacune) suivant 39. Les deux espces de riz, le ssame, les deux espces de fves,l'orge, croissent leur semence, suivant ainsi que l'ail et la canne sucre. fcond est usuelle. Au lieu de kartari il y a une autre leon bhartari suivie par B. qui traduit ainsi relativement au sens du mot seigneur, les textes rvls diffrent . . 33. La tradition : smrt signifie peut-tre tout simplement la femme est dite le champ, etc. . 36. La comparaison manque un peu de justesse, car le terroir influe seulement sur les qualits accessoires de la plante, sans altrer l'espce, tandis que la femelle modifie l'espce : tmoin les animaux hybrides. 39. Le riz vrhi et le riz li (j'ignore en quoi diffrent les deux espces). La fve mudga Phaseolus mungo et la fve msha Phaseolus radiatus.
LES LOIS DE MANOU
263
40. Qu'une~(sorte de) plante soit seme et qu'il en pousse une autre, c'est ce qui n'arrive semence qu'on point ; quelque sme, il crot (une plante de mme espce). 41. Aussi un homme bien lev, vers dans les instruit, Vdas et les Angas, ne doitet dsireux de vivre longtemps, il jamais semer dans la femme d'autrui. ce 42. Ceux qui connaissent (les choses du) pass citent sujet les stances chantes par le dieu du Vent, qui (recomdans la l'homme de ne point semer de semence mandent) femme d'autrui. 43. De mme que la flche enfonce dans (par un chasseur) une blessure dj faite (par un autre) est (une flche perdue), ainsi se perd aussitt la semence (jete) dans la femme d'autrui. 44. Ceux qui connaissent (les choses du) pass considrent cette terre (Prithiv) comme l'pouse du roi Prithou ; ils diun sent qu'un terrain celui qui l'a dfrich, appartient l'a perc d'une flche. daim celui qui (le premier) lui-mme et 45. L'homme est autant que sa femme, dclarent ses enfants , est-il dit; et les Brahmanes gale ment ceci : L'homme est dit ne faire qu'un avec la femme. une femme n'est dga46. Ni par vente, ni par abandon, nous savons ) son poux; que ge (des lois qui l'unissent des telle est la loi tablie de toute antiquit par le Seigneur cratures. 41. Les Vdas et les Angas est le commentaire de jnna et vijnna, deux mots qui signifient connaissance et science. 42. Le dieu du vent Vyu : il y a l une allusion qui m'chappe. 43. Se perd pour celui qui la rpand parce que c'est le propritaire du champ (le mari) qui recueille le fruit de la postrit . (Kull.) 44. Prthu, cf. VII, 42 et note. Prthu fora la terre qui s'y refusait donner ses fruits pour la nourriture des tres anims ; c'est de lui que celle-ci prit son nom. On voit ici pourquoi il est dit dans le vers prcdent que la flche enfonce dans une blessure dj faite est perdue : c'est parce que le gibier appartient au premier tireur. 45. L'homme est autant, c'est--dire l'homme complet se compose de ces trois personnes . Est-il dit dans les Vdas . Les Brahmanes instruits dans les Vdas . (Kull.)
264
LES LOIS DE MANOU
47. Une seule fois se fait le partage une (de l'hritage), seule fois une jeune fille est donne en mariage, une seule fois on dit : J'accorde. . Ces trois actes n'ont lieu qu'une fois. 48. De mme chamelles, que pour les vaches, juments, buffles chvres et brebis, ce n'est pas servantes, femelles, le procrateur qui possde les petits, ainsi (en est-il) pour les femmes du prochain. 49. Ceux qui ne possdent mais qui ont de pas de champ, la semence et qui la rpandent dans le champ ne d'autrui, rcoltent aucunement le fruit de la moisson produite. 50. Quand mme un taureau cent veaux dans engendrerait les vaches d'un autre ces veaux seraient au (propritaire), des vaches ; la semence du taureau aurait t propritaire en pure perte. rpandue 51. Ainsi ceux qui ne possdent pas de champ et rpandent leur semence dans le champ d'autrui, font le bnfice du propritaire du champ, et celui qui a donn la semence ne retire aucun fruit. 52. Si aucune convention n'existe entre le propritaire du la semence la champ et celui qui a donn (relativement) le grain appartient videmment au propritaire du moisson, car la matrice est plus importante champ, que la semence. 53. Mais si par contrat (un champ) est confi ( une autre en vue de l'ensemencement, alors celui qui a personne) fourni la semence et le propritaire du champ sont tous deux 47. Le partage condition qu'il ait t fait suivant la justice . (Kull.) J'accorde, c'est--dire la jeune fille: c'est le pre qui dit cela. On pourrait aussi entendre cette phrase dans un sens plus gnral, propos de n'importe quel don. 51. Ceux qui ne possdent pas de champ, c'est--dire ceux qui ne sont pas maris . (Kull.) 52. La matrice est plus importante que la semence, semble en contradiction avec ce qui est dit au v. 35, o la semence est dclare suprieure la matrice ; mais c'est que le point de vue est tout diffrent. 53. Je ne pense pas qu'il faille ici prendre le mot champ dans un sens mtaphorique comme au v. 51.
LES LOIS DE MANOU considrs (sol). 54. ici-bas comme ayant droit (au produit)
265 de ce
Si, emporte par le fleuve ou par le vent, la semence le produit de) cette sepousse dans le champ d'un (tranger, de la sedu champ ; le propritaire mence est au possesseur mence ne recueille pas la moisson. la progni55. Sachez que telle est la rgle applicable chvres ture des vaches, chamelles, servantes, juments, et brebis, oiseaux femelles et buffles femelles. de la sela valeur relative 56. Ainsi vous a t dclare la loi mence et de la matrice; je vais maintenant exposer les femmes en cas de dtresse. (concernant) d'un frre an est pour le cadet (comme) 57. La femme du cadet est considre et la femme d'un gourou, l'pouse de l'an. (comme) la belle-fille avec la femme de son 58. Un frre an qui a des relations de son an, sauf en cas cadet, ou un cadet (avec la femme) sont tous deux dchus de leur caste, mme (s'ils de dtresse, le faire. ont t) autoriss dsirs fait dfaut, les rejetons 59. Au cas o la postrit autoritre obtenus par une femme rgulirement pourront ou avec le beau-frre d'une se (au moyen cohabitation) la sixime gnration. (autre) parent jusqu' quelque des relations) avec 60. Celui qui il a t enjoint (d'avoir 56. La valeur relative littr. la valeur et la non-valeur. En cas de dtresse signifie quand elles n'ont pas d'enfants . (Kull.) 57. Guru est pris ici dans son sens le plus large, non pas spcialement le prcepteur spirituel, mais toute personne laquelle on doit une sorte de respect filial. Peut-tre dsigne-t-il spcialement ici le beau-pre, et alors l'pouse d'un guru pourrait tre traduit par belle-mre , en opposition belle-fille qui vient dans le second membre de phrase. 58. Autoriss par le mari ou par des parents . (Kull.)Sauf en cas de dtresse moins qu'il n'y ait pas d'enfants . (Kull.) Ces relations peuvent tre autorises en cas de strilit du mariage, comme on le voit au vers suivant. 59. Parent jusqu' la sixime gnration, Sapinda. 60. Une veuve ou une femme dont le mari est encore vivant, lorsqu'il n'y a pas d'enfant . (Kull.)
266
LES LOIS DE MANOU
une veuve, devra (le faire) oint de beurre en silence, clarifi, la nuit, (et) engendrer en elle un fils, jamais deux. pendant 61. Quelques considen ces matires, (sages) entendus rant que le but de cette dlgation n'est pas rempli (s'il n'y a qu'un fils), pensent qu'un second (fils) peut tre lgitimement dans les femmes engendr (ainsi autorises). 62. Mais quand le but de cette dlgation d'une auprs veuve a t rempli conformment la loi, les deux personnes se conduire doivent vis--vis comme un beaul'une de l'autre pre et une belle-fille. 63. Si les deux dlgus violent la rgle et se guident par leurs dsirs charnels, l'un et l'autre seront dchus de leur caste (comme) ayant souill (l'un) la couche d'une belle-fille, celle d'une belle-mre. (l'autre) 64. Les Dvidjas ne devront une veuve jamais autoriser avec un autre (que son mari) ; (avoir un commerce charnel) car ceux qui l'autorisent avec un autre ( avoir des relations) violent la loi ternelle. 65. Dans les passages duVda relatifs au mariage, il n'est d'une autorisation point fait mention (de ce genre),le mariage des veuves en secondes noces n'est pas non plus indiqu dans les lois nuptiales. 66. Cet (usage), blm par les Dvidjas instruits (comme) une loi (bonne pour) des animaux, mme fut, dit-on, (tabli) pour les hommes quand Vena tait roi. 61. S'il n'y a qu'un fils, qui n'a qu'un fils, n'a pas de fils . (Kull.) 62. Les deux personnes, c'est--dire celui qui avait t dlgu pour engendrer un ls, et la femme auprs de laquelle il avait t dlgu. Leurs rapports charnels doivent cesser ds que l'enfant est engendr. Un beau-pre : littr. un guru. 63. Les deux dlgus. Le frre an et le frre cadet. (Kull.) Bellemre : littr. guru. 64. Ce vers et les suivants 64-68 contiennent une thorie diamtralement oppose celle qui vient d'tre nonce ; il y a l sans doute une interpolation d'poque plus rcente. Cf. l'Introduction. 66. Il a t question ailleurs de l'orgueil de Vena qui voulut que les sacrifices lui fussent adresss et non aux dieux, et qui fut tu par les Brh-
LES LOIS DE MANOU
267
tous les rois sages, 67. Cet excellent parmi qui auparavant possdait la terre entire, causa la confusion des castes, son intelligence ayant t obscurcie par la concupiscence. 68. Depuis lors, les sages blment celui qui par garement autorise une femme dont l'poux est mort avoir des enfants (d'un autre homme). 69. Si le fianc d'un jeune fille meurt aprs que les fianfrre (du dfunt) doit l'pouailles ont t faites, le propre ser d'aprs la rgle suivante . suivant le rite, pous cette (jeune fille qui 70. Ayant, doit tre) vtue de blanc et de conduite pure, il aura des relations avec elle une fois chaque (favorable) jusqu' poque de la progniture. (ce qu'il obtienne) sa fille quel71. Un (homme) sens, aprs avoir accord un autre ; car de nouveau qu'un , ne doit point la donner celui qui, aprs l'avoir accorde fois), la donne (une premire en ce une seconde, encourt (le pch de) faux tmoignage un homme. qui concerne une jeune fille, 72. Mme aprs avoir pous lgitimement de blme, malade, on peut la rpudier (si elle est) entache dflore, (ou si on vous l'a) fait pouser par ruse. un ddonne en mariage une fille ayant 73. Si quelqu'un le (contrat) avec faut sans le dclarer, (le mari) peut annuler le malhonnte (homme) qui (lui) a donn la jeune fille. mnes avec des brins d'herbe kua. Il semblerait d'aprs ce passage qu'il ait t l'introducteur de la pratique du niyoga ou dlgation. 67. Kull. remarque qu'il tait excellent entre tous les rjarshis parce qu'il possdait la terre entire, et non cause de sa vertu . 68. Cette interdiction du niyoga prononce par lui-mme (Manou) appartient l'ge Kali dit Brhaspati. (Kull.) 69. Si le fianc, littr. l'poux. 70. L'enfant ainsi procr appartient au dfunt. (Kull.) 71. Ce pch est mentionn au liv. VIII, 98, o il est dit que par le faux tmoignage en ce qui concerne un homme, ou tue mille parents . 72. Entache de blme suivant Kull. signifie qui a des marques funestes . Dflore, c'est l'interprtation de Kull.; vipra dushta signifie exactement corrompu. 73. Cf. VIII, 205 et 224.
268 74. Un
LES LOIS DE MANOU
homme au loin) peut que ses affaires (appellent son pouse; partir aprs avoir assur des moyens d'existence car une femme mme honnte peut se pervertir (quand elle est) presse par le besoin. 75. Si (l'poux) avant de partir des moyens (lui) a assur elle devra vivre en observant la chastet; s'il est d'existence, parti sans rien lui assurer, qu'elle subsiste par un mtier honorable. 76. Si l'poux est parti pour accomplir un devoir pieux, elle devra l'attendre huit ans; (s'il est parti) pour (acqurir) la science ou la gloire six ans, et trois (s'il est parti) pour son plaisir. 77. Un mari devra patienter un an avec une pouse qui le hait; mais au bout d'une anne, il devra la priver de son douaire et cesser de cohabiter avec elle. 78. Si elle manque envers son poux, parce ( ses devoirs est adonn ou frapp d'une que celui-ci) (au jeu), buveur, elle doit tre abandonne trois mois, et maladie, pendant et de ses meubles. prive de ses parures 79. Mais si son aversion de ce que son mari est) (provient ou frapp de fou, dgrad (de sa caste), chtr, impuissant, maladies elle ne peut tre ni abandonne, ni prive affreuses, de son douaire. 80. Une (femme) de mauvaises insoubuveuse, moeurs, 75. En observant la chastet, sans jamais aller dans la maison d'un autre homme . (Kull.) Un mtier honorable tel que filer, etc. . (Kull.) 76. Devoir pieux pour excuter un ordre de son guru, ou en plerinage . ou peut-tre pour une affaire d'amour, (Kull.) Pour son plaisir, pour jouir d'une autre femme . (Kull.) Ensuite elle ira le retrouver. (Kull.) 77. Patienter : littr. l'attendre : l'aversion est comme un loignement Au bout d'un an si elle continue le har . Il deora la priver de son douaire ce qu'il lui a donn, tel que ornements, etc., en lui octroyant seulement la nourriture et le vtement . (Kull.) 79. Maladies affreuses telles que la lpre, etc. . (Kull.) 80. Malade de la lpre, etc. . Mchante qui bat ses domestiques et autres . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU mise,
269
tre remmchante, malade, peut toujours prodigue, place par une autre. la huitime 81. Une (femme) strile peut tre remplace sont morts la dont tous les enfants une (femme) anne, une (femme) qui n'enfante dixime, que des filles la onzime; mais celle qui est acaritre immdiate(peut tre remplace) ment. malade 82. Mais une (femme) qui est bonne et vertueuse son consenne peut tre remplace clans sa conduite qu'avec sans respect. et ne doit jamais tre traite tement, la maison 83. Une femme (conjuqui quitte remplace ou rpudie enferme gale) en colre doit tre immdiatement de (sa) famille. en prsence boit des liqueurs 84. Mais celle qui, malgr la dfense, et les ruou frquente les spectacles mme une fte, de six krichnalas. nions, sera punie d'une amende des femmes de leur (caste) ou 85. Si les Dvidjas pousent les honneurs et le logement d'une autre (caste), la prsance, doivent tre (dtermins) l'ordre de de ces (femmes) d'aprs leur caste. de mme 86. Parmi tous (les Dvidjas, c'est) la (femme) (caste) et non jamais celle d'une autre caste qui doit remplir le service du corps, et (l'assister) dans les auprs de l'poux devoirs religieux de tous les jours. 87. Mais l'insens ces (fonctions) qui fait remplir par une autre (femme), alors qu'il a prs de lui une (femme) de mme considr comme (aussi mpricaste, a t de toute antiquit sable qu')un Tchndla (engendr par un Soudra et une) Brhman. 88. (S'il se prsente de beau, un) prtendant distingu, lui donner sa fille en mariage, mme (caste, un pre) pourra 83. Sa famille son pre, etc. . (Kull.) La femme remplace n'est pas pour cela chasse du domicile conjugal. 84. Malgr la dfense de son mari . (Kull.) 83. L'ge huit ans . (Kull.)
270
LES LOIS DE MANOU
suivant la rgle, lors mme n'a pas atteint qu'elle (l'ge). 89. Mais une jeune fille, mme nubile, devra rester dans la maison (paternelle) la mort plutt que d'tre jamais jusqu' donne un (prtendant) de qualits. dpourvu 90. Une jeune fille nubile devra attendre trois annes (un elle pourra prendre mari) ; pass ce temps, ( son choix) un poux de mme caste. 91. Si on nglige de la marier et qu'elle se cherche ellemme un poux, elle ne commet aucun pch, ni celui qu'elle prend. 92. Une fille qui se choisit elle-mme (un mari), ne doit avec elle aucune de son pre, de emporter (venant) parure sa mre ou de ses frres ; si elle en emportait, ce serait un vol. 93. Celui qui prend une jeune fille dj nubile ne doit pas au pre le prix nuptial, car ce dernier perd tous ses droits (sur sa fille) en empchant (les effets de) sa nubilit. 94. Un (homme) de trente ans peut pouser une jeune fille de douze ans qu'il aime, ou un (homme) de vingt-quatre ans une (jeune fille) de huit ans ; si (l'accomplissement de) ses devoirs devait souffrir d'un retard,(qu'il se marie) au plus tt. 95. L'poux donne qui prend une femme par les Dieux, sans avoir pour elle d'amour, doit (pourtant) l'entretoujours 90. Attendre un mari de la main de son pre ou des autres personnes dont elle dpend . (Kull.) La jeune fille que ses parents ne marient pas a le droit au bout de trois ans de se marier par elle-mme. 91. Si on nglige : on dsigne ici son pre et ses autres parents . (Kull.) 93. En empchant les effets de sa nubilit, c'est--dire en l'empchant de devenir mre . (Kull.) Ce vers est en contradiction avec certains autres relatifs au prix nuptial. Medh. le considre comme n'tant pas de Manou. 94. Ses devoirs si ses tudes sont termines, pour ne pas retarder son entre dans l'ordre des matres de maison . (Kull.) D'aprs ce vers il semble que le mari doit avoir en moyenne deux fois ou deux fois et demie l'ge de sa femme. 95. Donne par les dieux v. par Bhaga, Aryaman, Savitar, etc. . (Kull.) ; ce sont les dieux dont on invoque les noms la crmonie du mariage. L'expression de donne par les Dieux veut dire tout simplement lgitime-
LES LOIS DE MANOU tenir, 96.
271
aux Dieux. afin d'tre agrable (si elle est) vertueuse, Les femmes ont t cres pour (mettre au monde) des les hommes c'est pourquoi enfants, pour (perptuer) l'espce; en commun de devoirs religieux l'accomplissement (par l'est prescrit dans le Vcla. poux) avec l'pouse 97. Si celui qui donne le prix (nuptial) une pour (obtenir) l'avoir celle-ci le donn, jeune fille meurt aprs pousera frre (de son futur), si elle y consent. 98. Mme un Soudra ne doit pas accepter le prix nuptial en donnant sa fille (en mariage); car celui qui accepte ce prix fait une vente dguise de sa fille. 99. Ni les gens vertueux ni ceux (des (des temps) anciens, n'ont certes jamais fait ceci de donner (une temps) modernes, un autre. fille) quelqu'un aprs l'avoir promise 100. Certes, nous n'avons jamais ou dire mme dans les crations antrieures homme de bien) ait fait une (qu'un vente dguise de sa fille pour une somme appele prix nuptial. 101. Que la fidlit dure jusqu' la mort , rciproque voil en somme ce qui doit tre considr comme la loi suprme pour le mari et la femme. unis parla crmonie 102. Et ainsi un mari et une femme, doivent constamment s'efforcer de ne pas tre (du mariage) dsunis (et) de ne pas violer la fidlit mutuelle. la loi concernant 103. Ainsi vous a t dclare mari et sur l'affection, et (les moyens) d'obtenir femme, (loi) fonde en cas de dtresse; maintenant la postrit (les rapprenez du patrimoine. gles) de partage ment pouse, parce que les Dieux garantissent en quelque sorte le contrat. B. entend ceci un peu diffremment : Le mari reoit sa femme des Dieux, il ne l'pouse pas selon sa propre volont. 96. La rgle pour allumer le feu (sacr) est commune l'poux et l'pouse. (Kull.) 97. Meurt avant que le mariage ait t consomm . (Kull. ) 9S. Ce vers condamne formellement la vente des filles, tandis que le prcdent l'autorise : il y a l une contradiction manifeste.
272
LES LOIS DE MANOU
104. Aprs la mort d'un pre et d'une mre, que les frres runis se partagent car ils n'y ont aucun l'hritage paternel, droit du vivant (de leurs parents). 105. (Ou bien) l'an la succession seul doit recueillir paternelle en entier (et) les autres doivent vivre dans sa dpendans celle du pre. dance, 'comme (ils vivaient auparavant) la naissance d'un un 106. Aussitt aprs premier-n, homme devient pre d'un fils, et (il est) libr de sa dette envers les Mnes ; cet an mrite donc la totalit du patrimoine. 107. Ce fils seul,par lequel il paye sa dette et obtientl'immortalit est l'enfant du devoir ; les autres sont les enfants de l'amour. frres 108. Un fils an doit protger ses plus jeunes et ceux-ci, suivant la loi, doivent comme un pre ses enfants, se comporter vis--vis de l'an comme des fils (envers un L'an fait prosprer la famille ou au contraire la l'an est le plus respectable l'an ne doit ruine; ici-bas; pas tre trait sans gard par les gens de bien. 110. Si l'an se conduit comme un frre an (doit le faire), l'gal d'un pre et d'une mre ; s'il n'a qu'il soit (honor) d'un frre an, il doit (nanmoins) tre respas la conduite pect comme un parent. 104. Se partagent l'hritage paternel si le frre an renonce son droit d'anesse . (Kull.)Du vivant de leurs parents le pre, s'il le veut, peut faire le partage entre ses fils . (Kull.) 106. Aussitt aprs la naissance mme avant la crmonie de l'initiation . (Kull.) Sa dette envers les Mnes: on a dj vu que le ciel est ferm aux anctres pour qui l'on n'accomplit pas le rddha : la naissance d'un fils assure donc la perptuit du sacrifice funraire. 107. L'enfant du devoir, c'est--dire celui qui a t engendr en vue de l'accomplissement des devoirs pieux. 108. S'il n'y a pas eu de partage des biens, l'an doit fournir aux plus jeunes la nourriture et les vtements comme le ferait un pre. (Kull.) 109. Lorsqu'il n'y a pas eu de partage fait, l'an, suivant qu'il est vertueux ou non, fait prosprer la famille ou la ruine. (Kull. ) 110. Comme un parent comme un oncle maternel, etc. . (Kull.) pre). 109.
LES LOIS DE MANOU
273
111. Qu'ils vivent ainsi ensemble ou sparment, s'ils dsirent (remplir les devoirs religieux ; car les desparment) voirs religieux se multiplient ; par conspar la sparation la loi. sont conformes quent les crmonies spares 112. L'an (a droit ) un prciput (du gal au vingtime avec ce qu'il y a de meilleur dans tous les biens, patrimoine) le pun moiti de cela, le cadet au quart. 113. Que l'an et le plus jeune prennent (leur part) selon qu'il a t dit; les autres (frres) entre l'an et le plus jeune auront (chacun) une part intermdiaire. le meil114. Parmi les biens de toute sorte, l'an prendra et sur leur, ainsi que tout ce qui a une valeur particulire, dix (ttes de btail), il obtiendra la plus belle. 115. (Parmi des frres) dans qui excellent (galement) leurs occupations, il ne sera point (prlev) sur de prciput dix (ttes de btail en faveur de l'an) ; on lui donnera seulement une bagatelle comme marque d'honneur. 116. Si l'on prlve ainsi un prciput on (pour l'an), doit faire des parts gales (avec le reste) ; mais au cas o l'on ne fait aucun prlvement, voici quelle doit tre la rpartition entre les (frres) : 117. L'an une part en plus (de la sienne), le prendra 111. Se multiplient par la sparation, parce que chacun accomplit pour son compte les cinq grands sacrifices et autres rites . (Kull.) Dharma signifie la fois devoir religieux et les mrites spirituels que l'on acquiert par l'accomplissement des devoirs religieux . 112. La part supplmentaire du pun est de un quarantime, celle du cadet de un ' quatre-vingtime ; le reste de l'hritage est partag galement. Cf. v. 116. 113. Une part intermdiaire chacun recevra un quarantime . (Kull.) Tous les frres entre l'an et le cadet sont traits sur le mme pied. 114. Tout ce qui a une valeur particulire dsigne un objet isol, qu'on ne peut rpartir entre les cohritiers, un vtement ou une parure, ditMedh. La plus belle : Kull. fait une restriction, si l'an a de bonnes qualits, que les autres n'ont pas . 115. Dans leurs occupations, la rcitation du Vda . (Kull.) 117. Soit 55 partager entre quatre frres ; l'an aura 20, le pun 1S, les deux plus jeunes chacun 10. 18
274
LES LOIS DE MANOU
les plus jeunes chacun une part; pun une part et demie, telle est la rgle tablie. 118. Quant aux filles, leurs frres doivent individuelleun sur leur lot, chacun ment leur donner (quelque chose) seraient dchus quart de leur part; ceux qui s'y refuseraient (de leur caste). 119. On ne doit jamais une seule chvre, une partager seule brebis, ou un animal solipde unique; (s'il reste) une ou une brebis en surplus elle est chvre (aprs le partage), dvolue l'an. 120. Si un plus jeune frre engendre un fils dans la femme de son an, le partage doit tre fait galement entre eux; telle est la rgle tablie. 121. Le reprsentant (qui est le fils engendr par le plus suivant la loi, la place de l'hjeune frre) ne peut prendre, ritier principal (qui est le frre an, au point de vue du prest (devenu) ciput) ; l'hritier principal pre par la procration (d'un fils par le plus jeune frre) ; c'est pourquoi, confor loi (prcite), mment on doit donner ( ce fils) une part (gale celle de son oncle, et rien de plus). 122. S'il y a un doute sur la manire de faire le partage, quand le cadet est n de la femme premire pouse, et l'an de la seconde (femme), 118. Suivant le commentaire de Kull. les frres doivent donner une dot leurs soeurs non maries, et de la mme caste qu'eux, c'est--dire nes de la mme mre, au cas o le pre a eu plusieurs femmes de castes diffrentes. 119. On ne doit ni compenser la diffrence en donnant un autre objet de mme valeur, ni vendre l'animal pour en partager ensuite le prix. (Kull.) 120. Un plus jeune frre ayant reu l'autorisation (niyoga) . (Kull.) Entre eux entre le fils ainsi n (kshetraja) et l'oncle qui est son pre naturel, et cet (enfant) n'a pas droit au prciput qu'aurait eu le pre (c'est-dire le frre aine) . (Kull.) 121. C'est--dire que cet enfant n'a aucun droit au prciput qu'aurait eu son pre lgal (le frre an), parce qu'il n'est le fils de ce dernier que par autorisation (niyoga). J'ai suivi pour ce vers obscur le commentaire de Kull. 122. La primogniture est-elle dtermine par l'antriorit de la naissance de l'enfant, ou par le fait d'tre n de la premire femme ?
LES LOIS DE MANOU 123.
275
Le (fils) n de la premire (femme) prendra pour un taureau de ; puis les autres taureaux prciput (excellent) moindre valeur (seront) pour ses (frres) infrieurs par (l'ordre dans lequel ont t pouses) leurs mres. 124. Mais le (fils) an, n de la femme premire pouse, et un taureau, les autres recevront quinze (vaches) prendra leur part selon (le rang) de leur mre : telle est la rgle. 125. Entre fils ns de mres gales (parla caste) et sans il n'y a point de prcellence due (aucune autre) distinction, la mre ; la primogniture est subordonne (la date de) la naissance. 126. (Les Sages) dclarent que l'invocation ( Indra condans (les prires tenue) (est le prividites) Soubrahmany et entre deux jumeaux en (engendrs lge) du premier-n, la primogniture mme temps) dans des matrices, est reconnue de l'ordre) de leur naissance. (dpendre 127. Celui qui est sans fils peut par le rite suivant charger : Que l'enfant sa fille de lui en donner un, (en disant) d'elle fasse mon intention les offrandes aux qui natra Mnes'. 128. Conformment cette rgle Dakcha le lui-mme, 123. Prvaja ici n'est pas l'an, mais comme le dfinit Kull., celui qui est n de la premire femme . 124. Le fils an s'il est savant et vertueux . (Kull.) Recevront leur part se partageront les vaches qui restent, suivant l'ordre dans lequel leurs mres ont t pouses . (Kull.) 125. Prcellence due la mre : c'est--dire que si les mres sont de mme caste, l'ordre dans lequel elles ont t pouses est indiffrent. En gnral les dernires pouses sont de caste infrieure. Ce vers est en contradiction avec les prcdents. 126. Dans des matrices : faut-il entendre des matrices diffrentes ? Et alors jumeaux signifierait deux enfants dont la conception a t faite la mme poque, mais appartenant deux femmes diffrentes. 127. Peut faire sa fille putrik, en disant, au moment de la donner en mariage, et avec le consentement de son gendre : Que l'enfant qui natra d'elle, etc. . (Kull.) 128. Daksha un des Prajpatis avait 24, 50 ou 60 filles : son histoire est raconte dans le Mahbhrata et les Purnas.
276
LES LOIS DE MANOU
des cratures, chargea jadis (ses filles) de lui donner Seigneur sa race. des fils pour accrotre treize Kasyapa, 129. Il en donna dix Dharma, vingt-sept dans la joie de son me. avec honneur auroi Soma, les traitant une fille commis130. Un fils est un (autre) soi-mme, existe une telle (fille qui sionne est l'gale d'un fils ; lorsqu'il autre est un autre) soi-mme, prtendre pourrait quel ? l'hritage de la mre, il doit tre la 131. Quel que soit le douaire et le fils de la fille (commispart de la fille (non marie); hrite de tous les biens de (son aeul maternel mort) sionn) sans enfants. donc fille (commissionne) 132. Que le fils d'une prenne et du (grand-)pre mort sans enfant, tout l'avoir (maternel) funraires, (l'un) son propre que lui seul offre deux gteaux son aeul maternel. pre, (l'autre) 133. Entre le fils d'un fils et le fils d'une fille (commisla loi ; car il n'y a point de diffrence ici-bas suivant sionne) sont sortis du corps du le pre (de l'un) et la mre (de l'autre) mme (homme). de donner 134. Mais si aprs qu'une (fille) a t charge en ce cas un fils, le partage un fils, il nat (au pre de celle-ci) doit tre gal, car une femme n'a pas de droit d'anesse. 129. Dharma la justice personnifie. Kayapa, sage vdique, fils de Marici: de cet hymen naquirent les dieux, les dmons, les oiseaux, les serpents et tous les tres vivants. Soma, le dieu Lunus : les vingt-sept pouses de Soma prsident aux vingt-sept astrismes lunaires. 130. Commissionne, une putrik, cf. v. 127. 131. Non marie : d'aprs Gautama cit par Kull., c'est le sens '.de kumr 132. B. comprend diffremment la premire partie de ce vers : Le fils de la fille putrik doit (aussi) prendre l'avoir de son (propre) pre, qui ne laisse pas (d'autre) enfant. Ainsi le fils de la putrik hrite en partie double de son aeul maternel et de son propre pre (s'il est fils unique) : voil pourquoi il offre les deux gteaux funraires. 133. Kull. interprte diffremment : Il n'y a point de diffrence au point de vue des affaires mondaines (loke), ni des devoirs religieux (dharmatah). 134. Le partage doit tre gal, il n'y a pas de prciput donner au fils de la putrik . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
277
meurt 135. Mais si une fille commissionne n'importe comment sans (laisser de) fils, le mari de la fille commissionne peut sans hsiter prendi'e son bien. enfante 136. (Si) une (fille) ayant reu ou non commission, devient l'aeul maternel un fils d'un (poux) de mme (caste), ce d'un petit-fils; de) cet (enfant) possesseur par (la naissance de la fortune. funbre et hriter doit offrir le gteau dernier les mondes, 137. Par un fils on conquiert par un petit-fils on l'immortalit on obtient ; mais par le fils de ce petit-fils du soleil. obtient le monde de l'enfer fils dlivre son pre 138. Parce (tr) qu'un de l'enfer) (sauveur par appel Pout, il a t nomm Pouttra Brahm lui-mme. le fils d'un fils et le fils d'une fille commis139. Entre ici-bas ; car mme le fils il n'y a pas de diffrence sionne, monde dans l'autre d'une fille sauve (son aeul maternel) comme (le ferait) le fils d'un fils. offre le premier 140. Que le fils d'une fille commissionne le sa mre, le second au pre de celle-ci, funraire gteau au pre du pre (de sa mre). troisime hritera de 141. Un fils adoptif dou de toutes les qualits bien qu'il soit issu tous les biens de celui (qui l'a adopt), d'une autre famille. 135. Le pre ne peut hriter de sa fille putrik. Son bien dsigne ici ce qu'on lui a donn de son vivant. 136. Suivant Kull. krt et akrt signifient, le premier que la jeune fille a t faite putrik au moment du mariage, avec le consentement du futur (cf. v. 127), et le second que la destination de la fille a t faite mentalement et non en termes exprs. 137. Les mondes, c'est--dire le ciel. 138. Ce calembour tymologique sur le mot putra fils n'a bien entendu aucune valeur. Brahm Svayambh, l'tre existant par lui-mme. .141. Un fils adoptif, littr. un fils donn dattrima. Les commentateurs ne sont pas d'accord sur. cette rgle. Voici, je crois, l'opinion la plus admissible : s'il y a un fils lgitime et un fils adoptif en prsence, le dernier, s'il est dou de toutes les vertus, recevra la sixime partie de l'hritage ; il n'hritera du tout qu' dfaut d'un fils lgitime ou d'un kshetraja (c'est-dire d'un fils eng endr par autorisation).
278 142.
LES LOIS DE MANOU
Un (fils) donn ne fait plus partie de la famille, et n'a plus droit au bien de son pre par le sang : le gteau funraire suit la famille et le patrimoine, les offrandes aux Mnes cessent (envers) celui qui a donn (son fils un autre). 143. Ni le fils d'une femme qui n'a point t autorise ( d'un autre homme), ni celui (qu'une enfanter femme) ayant n'ont droit aucune part, (dj) un fils a eu de son beau-frre, le produit de l'amour (l'autre) (l'un) tant le fils d'un amant, sensuel. mle engendr 144. Un enfant sans observer la rgle dans une femme (indique plus haut), mme qui y a t n'a pas droit l'hritage car il est autorise, paternel, engendr par un homme dchu (de sa caste). 145. Un fils n d'une (femme) autorise peut hriter comme un fils charnel; car cette semence et la postrit (qui en sort) au propritaire du champ. lgitimement appartiennent 146. Celui qui prend sous sa garde le bien et la femme un fils pour son d'un frre mort, devra aprs avoir engendr frre (en vertu d'une autorisation), remettre cet (enfant) l'hritage. 147. Si une femme autorise a un fils de son beau-frre ou cet (enfant) est dclar inapte d'un autre (proche parent), et engendr en vain, (s'il a t) procr hriter, (seulement) par concupiscence. doit reconnatre 148. Telle est la rgle qu'on pour le (entre enfants ns) de femmes d'une mme (caste) ; partage entre (fils) engenmaintenant (la rgle de partage) apprenez drs par un seul homme dans plusieurs femmes de diverses (castes). 144. Plus haut. V. 60. Dchu : il est dit au v. 63 que celui qui n'observe pas le prcepte indiqu au v. 60 est par le fait dchu de sa caste. 145. Un fils n d'une femme autorise s'il est engendr suivant les rgles prescrites et dou de bonnes qualits . (Kull.) Le propritaire du champ dsigne ici mtaphoriquement le mari. 147. Suivant une autre leon il faudrait entendre : une femme non autorise .
LES LOIS DE MANOU
279
149. Si un Brahmane a quatre femmes aux (appartenant diverses entre les castes) par ordre, voici la rgle de partage fils enfants par elles : 150. Le laboureur, le taureau le (fcondateur des) vaches, les parures et l'habitation devront tre donns comme chariot, au fils de la Brhman, avec une part (de choix) en prciput vertu de sa prminence. trois parts du patri151. Le fils de la Brhman recevra deux parts, le fils de la Vaisya moine, le fils de la Kchatriya une part et demie, le fils de la Soudra n'aura qu'une part. 152. Ou bien encore un homme vers dans la loi divisera la totalit de l'hritage en dix parts et procdera un partage ainsi qu'il suit : quitable 153. (L'enfant de la) Brhman prendra parts, le quatre fils de la Kchatriya trois parts, le fils de la Vaisya deux parts, une part. le fils de la Soudra laisse ou ne laisse pas de fils (n 154. Que le (Brahmane) on ne doit pas d'aprs la loi d'une femme des castes Dvidjas), au fils de la Soudra. donner plus du dixime 155. Le fils d'une Soudra (qu'il ait t engendr par) un un Kchatriya, ou un Vaisya, n'est pas apte Brahmane, il (n')a pour sa part (que) ce que son pre lui donne hriter; (directement). de la mme 156. Tous les fils de Dvidjas ns de (femmes) caste (que leur poux) devront donner l'an un prciput, et se partager le reste entre eux. galement 157. Pour un Soudra c'est une rgle que sa femme doit tre 151. Soit 75 partager entre eux : le premier aura 30, le second 20, le troisime 15 et le quatrime 10. 153. Sans prlever de prciput. (Kull.) 154. S'il n'y a pas de fils de caste brahmanique, tout l'hritage (s auf ce dixime) reviendra aux fils de la Kcha riy et de la Vaisya. (Kull.) 155. Ce vers semble une contradiction avec les prcdents, comme le remarque Kull. Ce dernier suppose que cela dpend des qualits ou de l'absence de qualits de la Soudra, ou bien l'interdiction de recevoir le dixime de l'hritage concerne le fils de la Soudra non pouse . 157. Aucun n'a droit un prciput. (Kull.)
2S0
'
LES LOIS DE MANOU
de mme caste et non d'une autre; les fils qui naissent d'elle auront une part gale, fussent-ils cent. 158. Parmi les douze fils des hommes que Manou issu de l'Etre existant a mentionns, six sont parents par lui-mme et hritiers, et six parents sans tre hritiers. le (fils) engendr dans la femme 159. Le fils lgitime, le (fils) donn, le (fils) adopt, le (fils) n clandes(autorise), tinement et le (fils) rejet et (sont tous) les six hritiers parents. 160. Le (fils) n d'une le (fils) jeune fille (non marie), en mariage le (fils) achet, le (fils) n apport (par la femme), d'une femme remarie, le (fils) qui s'est donn lui-mme, et le (fils) d'une Soudra, sans tre (sont tous) les six parents hritiers. 161. Le rsultat obtenu en (voulant) passer l'eau avec un est le mme en mauvais bateau que celui qu'on obtient de passer les tnbres avec (l'aide de) (infernales) (essayant) fils mprisables. et un fils engendr dans la femme 162. Si un fils lgitime l'un des deux seuls autorise sont tous deux cohritiers, l'exclusion de l'autre. (appartient) l'hritage paternel, seul le matre de la fortune 163. Le fils lgitime (est) 158. Les six derniers n'ont pas droit l'hritage de la famille, mais sont des parents, et comme tels, accomplissent les libations d'eau et autres cr* monies qui incombent aux parents. (Kull.) 159. Autorise, cf. ce qui a t dit prcdemment du niyoga. Le fils rejet par ses parents naturels . (Kull.) 160. Le fils apport en mariage est celui dont la femme tait dj enceinte lorsqu'elle s'est marie. 161. En d'autres termes, on ne peut pas plus passer l'enfer avec l'aide de fils mprisables, que passer l'eau dans une mauvaise barque. On a vu v. 138 que les fils servent vous tirer de l'enfer. Kull. indique qu'il faut entendre par/sis mprisables le kshetraja (fils engendr dans la femme autorise, cf. v. 59) et les autres . D'o il suit qu'il n'y a que le premier des douze qui soit apte vous tirer de l'enfer. 162. Le cas envisag ici est celui o une femme a eu un fils d sou beaufrre par autorisation du mari, et o un fils lgitime est n dans la suite. 163. De quoi subsister, la nourriture et le vtement . (Kull.) Les
LES LOIS DE. MANOU
281
; mais pour ne point faire tort aux autres, qu'il paternelle (leur) donne de quoi subsister. le fils lgitime fait le partage de l'hri164. Mais lorsque ou un cinquime du qu'il donne un sixime tage paternel, au fils engendr dans la femme (autorise). patrimoine 165. (C'est ainsi que) le fils lgitime et le fils engendr dans la femme (autorise) se partagent le patrimoine ; quant aux dix autres, suivant leur rang, ils ont une part dans la famille et dans l'hritage. 166. Le fils (qu'un homme) a de sa propre femme rgulidoit tre reconnu comme le fils lgitime rement pouse en rang. (et) le premier dans le lit conjugal d'un homme 167. Le fils engendr la femme a t autoou malade, mort, impuissant (lorsque) rise suivant la loi spciale, le fils de l'pouse. s'appelle de leur plein 168.. Le fils que son pre et sa mre donnent sans enfant, d'eau, aune personne gr,en faisant une libation doit tre (et qui est) de mme (caste que le pre adoptif) reconnu comme l'enfant donn. de mme (caste) dont on fait son fils, sachant 169. L'enfant doit le bien et le mal et dou de vertus filiales, (distinguer) comme le fils adoptif. tre considr autres sauf le kshetraja ou fils engendr dans la femme par autorisation . (Kull.) 164. Au kshetraja, suivant qu'il est ou non dou de qualits. (Kull.) 165. Suivant leur rang, veut dire que dans l'ordre nonc plus haut chacun a part dfaut du prcdent . (Kull.) Ainsi par exemple, s'il n'y a pas de fils donn, c'est le fils adopt quia part. Cf. v. 159. 166. De sa propre femme, littr. dans son propre champ . Lefils lgitime, aurasa, le fils de sa chair. 167. La loi spciale, le niyoga. Le fils de l'pouse, le kshetraja. 168. De leur plein gr prltisamyuktam et non sous l'empire de la crainte, etc. . (Kull.) On peut aussi rapporter ce compos l'enfant plein d'affection pour la famille qui l'adopte . Une personne sans enfants, littr. dans la dtresse, padi. 169. Littr. le fils fait, krtrima. Distinguer le bien et le mal, c'est-dire sachant que l'accomplissement ou le non-accomplissement des rddhas et autres crmonies relatives la vie future produisent le mrite spirituel ou le pch . (Kull.)
232
LES LOIS DE MANOU
170. Si (un enfant) nat dans la demeure de quelqu'un, sans qu'on sache de qui il est, (c'est un fils) n clandestinement dans la maison, et il appartient l'poux de la femme qui l'a enfant. 171. L'enfant abandonn ou par par son pre et sa mre, l'un des deux, dans sa maison, est appel que l'on accueille l'enfant rejet. 172. L'enfant met au monde secrtement qu'une demoiselle dans la maison paternelle doit tre appel le fils del demoiet (appartenant) selle, n d'une fille non marie l'pouseur (futur de celle-ci). 173. (Si) une (fille) enceinte se marie, soit connue qu'elle ou non (pour telle, l'enfant qu'elle porte dans) son sein appartient l'pouseur, et est appel l'enfant reu avec l'pouse. 174. Si quelqu'un achte une) postrit pour (s'assurer ses pre et mre un enfant, lui soit) semblable (que celui-ci ou non (en qualits), cet (enfant) est dit le (fils) achet. 175. Si une (femme) de son poux ou veuve, abandonne se remarie de son plein gr, (le fils) qu'elle enfante est appel fils d'une femme remarie. 176. Si elle est (encore) vierge (quand elle se remarie), ou si elle revient a quitt ( son poux) qu'elle (jeune pour en suivre un autre), elle devra accomplir nouveau la crmonie avec son second mari (ou avec le premier (nuptiale) qu'elle reprend). 177. L'orphelin de pre et de sans motif (par ses parents), qui qu'un, (un fils) donn s'appelle 178. Le fils qu'un Brahmane mre ou (l'enfant) abandonn se donne de plein gr quelde lui-mme. engendre par luxure dans une
171. Ou par l'un des deux lorsque l'autre est mort . (Kull.) 174. S'assurer une postrit qui accomplisse en son honneur les sacrifices funraires . (Kull.) Semblable en bonnes qualits et non en caste, cette dernire condition tant exige galement pour tous ces fils . (Kull.) 177. Sans motif par aversion . (Kull.) 178. tymologie par calembour de praava que Manou drive de prayan
LES LOIS DE MANOU
283
est un cadavre, d'o son nom de Soudra, (bien que) vivant, cadavre vivant. a un fils d'une esclave, 179. Si un Soudra ou de la femme une part (de esclave de son esclave, (ce fils) peut prendre avec l'autorisation (de son pre) : telle est la rgle l'hritage), tablie. en commenant 180. Ces onze fils qu'on vient d'numrer les Sages les reconnaissent pour les par le fils de l'pouse, destins empcher) substituts du fils (lgitime, qu'il y ait dans les crmonies interruption (funbres). 181. Ces fils mentionns comme substituts (du fils lgitime) celui de tant sortis de la semence d'autrui, appartiennent la semence duquel ils sont ns, et aucun autre. 182. Si parmi des frres issus d'un mme (pre et d'une il s'en trouve un qui ait un fils, Manou a dclar mmemre), un fils par le moyen de ce (seul) fils. que tous possdent d'un mme l'une 183. Si parmi toutes les femmes (mari), a un fils, Manou a dclar un fils par le que toutes possdent de ce (seul) fils. moyen des plus levs de 184. A dfaut de chacun (dans l'ordre ces douze fils, c'est) celui qui vient immdiatement aprs qui vivant et ava cadavre. B. H., traduit est un cadavre pour sauver son pre de l'enfer . Dans une Soudra pouse par lui . (Kull.) 180. Ces onze fils numrs aux v. 159-160. Substituts : c'est--dire chacun dans l'ordre destin remplacer le prcdent, si celui-ci fait dfaut, dans la clbration des rddhas. 181. Prasangt, expression obscure. B. traduit mentionns par rapport au (filslgitime) . B. H. en certaines occasions. Ce vers contredit ce qui a t affirm ailleurs que l'enfant appartient au champ et non au semeur. Kull. remarque qu'ils ne doivent pas tre adopts, s'il y a un fils lgitime (aurasa) ou une fille charge de donner un fils au pre sans enfant (putrik) . 182. Et alors on ne doit pas faire de subslitution de fils : c'est celui-l qui offrira les gteaux funraires et recueillera l'hritage. (Kull.) 183. Mme restriction que dans le cas prcdent : quand une des copouses a un fils, une autre femme ne doit point adopter de fils donn ou autre . (Kull.) 184. gaux en condition, veut dire ns de la mme mre et par cons-
284
LES LOIS.DE MANOU
est apte hriter ; s'il y en a plusieurs gaux (en condition), ceux-ci ont tous droit une part du patrimoine. 185. (Ce ne sont) ni les frres ni les pres, (ce sont) les fils le pre du pre ; (mais) peut (qui) recueillent l'hritage (d'un fils dcd) sans enfant mle, ou bien prendre l'hritage les frres. trois d'eau doivent tre faites 186. Les libations pour trois le gteau funraire doit tre offert (ascendants), est celui qui offre ; le quatrime (ascendants) (descendant) et le gteau funraire) ; le cinquime (les libations n'y participe point. 187. Le bien doit toujours revenir au plus proche parent du (dfunt) une (personne) de sapinda, puis ( son dfaut), de la mme famille, ou mme spirituel (puis) un prcepteur un lve. 188. Mais dfaut de tous (ces hritiers naturels), que des de Brahmanes verss dans les trois Vdas, purs et matres leurs sens, se partagent ; ainsi la loi sera sauvel'hritage garde. ne doit jamais tre pris par le 189. Le bien d'un Brahmane roi : telle est la rgle. Mais pour les autres castes, dfaut de tout (hritier le roi peut recueillir la succession. naturel), quent occupant le mme rang dans la srie, par exemple plusieurs fils de la femme remarie. 185. Les fils le fils lgitime, et son dfaut le fils de l'pouse, et les autres substituts . (Kull.) Sans enfant mle a et qui ne laisse ni veuve ni fille . (Kull.) Les frres dfaut du pre ou de la mre . (Kull.) 186. Trois ascendants le pre, le grand-pre paternel et le bisaeul . (Kull.) N'y participe point, et par suite n'a point droit l'hritage l'exclusion des frres et autres collatraux ; le droit de succession ne s'tend donc pas au del du petit-fils. 187. D'aprs le vers prcdent on voit qu'il faut ici restreindre la qualit de sapinda au troisime descendant, tandis qu'en gnral, au point de vue religieux, elle s'tend jusqu'au sixime. Sakulya, de la mme famille, dsigne les parents loigns, les samnodakas. 188. Se partagent l'hritage et offrent les gteaux funraires ; de la sorte il n'y aura pas de violation de la loi relative aux sacrifices funbres envers le dfunt auquel appartenait le bien . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
285
a un 190. Si (la veuve) de celui qui est mort sans enfant fils d'un homme de la mme famille, (c'est) ce (fils) qu'elle du bien. remettra la totalit 191. Que si deux (fils) enfants par une mre de deux se disputent la fortune, chacun d'eux doit (pres diffrents) l'exclusion de l'autre ce qui vient de son pre. prendre 192. Mais quand la mre est morte, tous les frres utrins et toutes les soeurs utrines doivent se partager galement le bien maternel. 193. Si ces (soeurs) ont des filles, qu'on leur donne aussi en signe d'affection chose de l'avoir de leur grand'quelque suivant leur dignit. mre maternelle, 194. (Les prsents le feu (nuptial), la profaits) devant cession nuptiale, ce qui a t donn en signe d'affection, ce de la mre et du pre, voil ce qu'on qui vient du frre, de la femme. appelle la sextuple proprit 195. (Les prsents) et ceux qu'elle a reus aprs le mariage doivent revenir ses que lui fait son poux par affection enfants, (mme) si elle meurt du vivant de son mari. 196. Si une (femme marie suivant les rites) de Brahm, des Dieux, des Sages, des Musiciens clestes, ou du Seigneur de la cration meurt sans postrit, son bien est dclar (ap son poux seul. partenir) 197. Mais les biens qui ontt donns une (femme) marie 190. Il s'agit d'un fils enfant par autorisation avec le frre du dfunt ou un autre proche parent. 191. Les deux pres tant morts ; Kull. pense qu'il s'agit spcialement du cas o le fils d'une femme remarie est en comptition avec le fils lgitime du premier poux. En ce cas, le bien du premier mari revient au fils du premier lit, celui du second au fils du deuxime lit. 192. Les soeurs utrines non maries : quant celles qui sont maries, elles reoivent un cadeau proportionn la fortune . (Kull. citant l'opinion de Bfhaspati). Sur l'avoir de la mre, cf. v. 194. 193. Des filles non maries . (Kull.) 195. Reus aprs le mariage de la famille de son poux ou de sa propre famille . (Kull.) 196. Cf. sur ces rites, III, 21 sqq. 197. Les autres rites celui des Dmons et celui des Vampires . (Kull.)
286
LES LOIS DE MANOU
suivant le rite des Asouras et autres (rites mprisables) sont dclars sa mre et son pre, si elle meurt (appartenir) sans postrit. 198. Quel que soit le bien qui ait t donn n'importe quand une femme par son pre, (c'est) la fille de la Brhman (qui) doit en hriter ou bien l'enfant de cette dernire. 199. Les femmes ne doivent point se faire un pcule sur les biens del famille qui sont communs ni mme plusieurs, sur leur propre avoir, sans l'autorisation de leur poux. 200. Les parures qu'une femme a portes du vivant de son poux, les hritiers (de celui-ci) ne doivent point se les partager ; s'ils le font, ils sont dchus (de leur caste). 201. N'ont aucune part ( l'hritage) les impuissants, les et les (gens) dgrads (de leur caste), ainsi que les aveugles sourds de naissance, les fous, les idiots, les muets, et ceux qui sont privs de quelque organe. 202. Mais c'est une rgle qu'un (homme) sage donne tous la nourriture selon ses moyens, et le vtement ceux-ci, jusrien ; car (s'il) ne leur donnait qu' la fin (de leur existence) il serait dgrad (de sa caste). 203. Mais si jamais et les autres dsiraient l'impuissant 198. Un Brahmane ayant des femmes de diffrentes castes, si la Kchatriya ou une autre meurt sans postrit, ce que son pre lui a donn revient la fille de la co-pouse de caste brahmanique, ou aux enfants d'icelle, dans le cas o la dfunte est morte sans postrit. (Kull.) 199. Leur propre avoir : suivant Kull., cela signifie l'avoir propre de l'poux , en opposition aux biens de famille indivis ; quant l'avoir propre de la femme, celle-ci en a la libre disposition. 200. Du vivant de l'poux peut se rapporter ce qui suit, et alors le sens est : Les hritiers ne doivent point se partager du vivant de l'poux les parures qu'une femme a portes. 201. Privs de quelque organe. Signifie suivant Kull. les boiteux et autres . Cette exclusion des estropis s'explique par la croyance que les infirmits de naissance sont la punition de fautes commises dans une vie antrieure. 202. Atyantam jusqu' la fin, signifie d'aprs B., sans restriction . 03. L'impuissant peut avoir un enfant kshetraja, c'estr-dire engendr par un autre que le mari avec autorisation de celui-ci.
LES LOIS DE MANOU
287
aient une si tant est qu'ils leurs enfants, femme, (prendre) sont aptes hriter. postrit, 204. Quelque bien qu'un an, aprs la mort de son pre, une portion il doit en revenir) acquire (par son propre labeur, dans la aient profit aux plus jeunes (frres); pourvu qu'ils science (sacre). 205. Mais si tous, tant ignorants, ont acquis du bien par en ce cas le partage ce doit tre gal, (puisque leur travail, bien) ne vient pas du pre : telle est la dcision. 206. Le bien (acquis par) la science celui-l appartient un (cadeau) seul quil'agagn; de mme un (prsent) d'amiti, de noces, ou un (don fait un hte et accompagn) d'un de miel (et de lait sur). mlange 207. Mais si l'un des frres, se suffisant par son propre travail, n'a pas envie de sa part (de l'hritage), qu'il soit exclu du partage, chose pour son petite aprs avoir reu quelque entretien. 208. Ce qu'un (des frres) gagne par son labeur sans dtritant acquis par ses propres ment du bien patrimonial, efforts, contre son gr (avec les il n'est pas oblig de le partager autres). un bien de famille 209. Si un pre recouvre que n'avait (son propre pre), il n'est pas tenu d'en faire pu recouvrer c'est un bien) gagn son gr ses fils, (puisque part, contre par lui-mme. vivant en 210. Si des frres spars, (puis) (d'abord) en ce cas les parts doifont un nouveau commun, partage, vent tre gales ; il n'y a point le droit d'anesse. 204. Il s'agit du cas o des frres vivant en communaut de biens, viendraient aprs coup faire un partage. 205. Ont acquis du bien par l'agriculture, le commerce . (Kull.) Le partage est gal veut dire qu'il n'y a point de prciput pour l'an. (Kull.) 206. Le mlange de miel et de lait sur, madhuparka, est le plat qu'on offre un hte. 207. Reu quelque petite chose afin que ses enfants par la suite ne puissent rclamer . (Kull.)
288
LES LOIS DE MANOU
du partage), si l'an ou le plus jeune (Au moment est priv de sa part, ou si l'un des deux meurt, sa part n'est . pas perdue. 212. Que ses (frres) ses demi-frres) utrins,-et (parmi ceux qui s'taient mis en commun (avec lui), et ses soeurs utrines se runissent ensemble et se la partagent galement. 213. Un an qui par avarice ses plus jeunes dpouille frres de) frre an, n'a plus droit une perd (sa qualit et mrite d'tre puni par le roi. part (exceptionnelle) 214. Tous les frres adonns des actes rprhensibles ne mritent pas (d'avoir part ) l'hritage ; l'an ne doit point se faire un avoir propre au dtriment de ses plus jeunes frres. 215. Si des frres vivant en commun (avec leur pre) associent leurs efforts de la richesse), le ( pour acqurir un de ses pre ne doit jamais (lors du partage) avantager enfants. 216. Mais un (fils) n aprs le partage seul la part prendra du pre; ou bien si quelques-uns (des autres fils) se sont associs de nouveau avec (le pre), il partagera avec eux. 217. Une mre dont le fils (meurt) sans enfant, doit hriter de lui ; si la mre elle-mme est morte, c'est la mre du le bien. pre qui prendra 218. Quand tout le passif et l'actif ont t partags suivant la rgle, tout ce qu'on dcouvre par la suite doit tre galement (rparti). 211. Priv de sa part parce qu'il se fait ascte . 212. Se la partagent au cas o il ne laisse ni fils, ni pouse, ni fille, ni pre, ni mre . (Kull.) 213. Le texte porte est priv de s a part . Mais Kull. explique bhga par uddhrabhga, la part exceptionnelle, le prciput. 214. Actes rprhensibles le jeu, l'ivrognerie, etc. . (Kull.) Au dtriment de ses plus jeunesfrres, littr. en ne leur donnant pas (ce qui leur revient) . 217. Suivant Kull. l'ordre de succession en pareil cas est : 1 le pre et la mre, 2 les frres; 3 les neveux ; 4 la mre du pre. Il est entendu que le fils dont la succession est ouverte ne laisse ni fils, ni fille, ni veuve.
211.
LES LOIS DE MANOU 219.
289
Un vtement, une voiture, une parure, des aliments un conseiller ou un cuits, de l'eau, des femmes (esclaves), un pturage sont dclars indivisibles. prtre de la famille, 220. Ainsi vous a t expliqu le partage (des successions) et la rgle de l'attribution fils, (des parts aux divers) commencer l'ordre; par le fils de l'pouse et les autres suivant coutez maintenant la loi concernant le jeu. 221. Un roi doit exclure de son royaume le jeu et le pari ; ces deux vices ruinent les royaumes des princes. vol mani222. Le jeu et le pari ne sont rien moins qu'un s'efforcer de les rprimer feste ; aussi un roi doit-il toujours tous les deux. 223. Parmi les hommes on appelle jeu ce qui se fait avec des objets inanims, pari ce qui se fait avec des tres anims. 224. Tous ceux qui s'adonnent au jeu ou au pari, ou qui en la pratique, que le roi leur inflige une peine encouragent aux Soudras les insignes comme corporelle, qui usurpent des Dvidjas. 225. Joueurs, danseurs et chanteurs, hommes cruels, fauteurs d'hrsies, gens adonns des occupations prohibes, doivent tre aussitt chasss de la marchands d'eau-de-vie, ville. 219. Une voiture, une parure, dont un des cohritiers avait us personnellement avant l'poque du partage, ne doivent point tre partages ; si toutefois ces objets avaient une grande valeur, ils devraient tre partags . (Kull.) L'eau d'un tang doit tre la jouissance de tous . (Kull.) Un conseiller spirituel ou un prtre de la maison, est le commentaire de Kull., pour yogakshema, qui signifie seulement bien, avoir , B. traduit d'aprs Medh. : biens destins des usages pieux et des sacrifices , ce qui donne un sens prfrable. 220. Les divers fils : les onze sortes de fils, autres que le fils lgitime, et qui ont t numres plus haut. 223. Le jeu se fait avec des ds, des btonnets ; le pari est engag sur des bliers, des coqs que l'on fait battre. (Kull.) 224. Qui en encouragent la pratique ; les teneurs de tripots . (Kull). Une peine corporelle : suivant la gravit du cas, le roi lui fera couper la main, etc. . (Kull.) Les insignes des Dvidjas, le cordon sacr, etc. . 225. Hommes cruels, ceux qui hassent les gens instruits dans les Vdas . (Kull.) 19
290
LES LOIS DE MANOU
dans les tats d'un roi, habitant 226. Ces voleurs dguiss du mal aux sujets vertueux font continuellement par l'exermtiers. cice de leurs coupables de on a vu le jeu (causer) 227. Dans un ge antrieur inimitis ; aussi un sage ne doit-il grandes pas s'y adonner mme par amusement. 228. A tout homme en cachette ou bien qui s'y adonne le roi doit infliger le chtiment ouvertement, qui lui plaira. ou Soudra, 229. Un (homme de) caste Kchatriya, Vaisya s'il est hors d'tat de payer l'amende, de sa dette s'acquittera un Brahmane la payera petit petit. par le travail; 230. Aux femmes, aux enfants, aux fous, aux vieillards, aux pauvres et aux infirmes, le roi (fera) infliger le chtiment un jonc, une corde et autres avec une verge, tels (instruments). 231. Ceux (l'administration des) qui tant prposs affaires ruinent les affaires des plaideurs, se (parce qu'ils) au feu de l'argent, chauffent leurs que le roi confisque (biens). 232. Ceux qui font de faux dits, ceux qui corrompent les ceux qui tuent les femmes, les enfants, les Brahministres, ainsi que ceux qui ont des intelligences avec l'ennemi, manes, qu'il les mette mort. 233. Quand une (affaire) a t conclue ou une (punition) le roi aprs s'tre assur qu'on a procd lgalement, inflige, ne doit jamais revenir (sur ce qui a t dcid). 234. (Quand) un ministre ou un juge rglent une affaire d'une faon illgale, le roi en personne doit revenir sur cette mille (panas (affaire) et (leur) imposer d'amende). 227. Un ge antrieur, un kalpa. Suivant les commentateurs, c'est une allusion l'histoire de Nala et de Yudhishthira. 231. Se chauffent au feu de l'argent veut dire mtaphoriquement qu'ils se laissent corrompre prix d'argent. 11 semble difficile d'admettre l'interprtation de L. enflamms de l'orgueil de la richesse . 232. Corrompent ou bien font natre des dissensions parmi les ministres
LES LOIS DE MANOU
291
un buveur d'eau-ded'un Brahmane, 235. Le meurtrier tous vie, un voleur, celui qui souille la couche d'un gourou, chacun comme de grands ces gens-l doivent tre considrs pcheurs. 236. Si ces quatre n'accomplissent pas (grands pcheurs) une pnitence, corporel (que le roi) leur inflige un chtiment d'une amende selon la loi. accompagn 237. (Pour avoir souill) la couche d'un gourou, (le couau front avec un fer rouge d'un signe pable sera marqu les parties sexuelles de la femme ; pour avoir bu figurant) de taverne des liqueurs, d'une enseigne ; (il sera marqu) d'un Brahmane, pour vol, d'un pied de chien; pour meurtre d'un homme sans tte. 238. Privs de toute participation aux repas, aux sacrifices, l'tude et au mariage, qu'ils errent sur la terre, misrables et exclus de tous les devoirs religieux. 239. Ces (gens) marqus devront tre repousss par leurs ni piti ni et maternels, et ne mritent paternels parents de Manou. respect : telle est la prescription 240. Mais (les coupables) de toute caste qui accomplissent au front la pnitence ne devront prescrite, pas tre marqus par (ordre du) roi ; il leur fera seulement payer la plus forte amende. 241. Pour les crimes (qu'on vient de dire) une amende sera inflige un Brahmane intermdiaire ; ou bien il sera en gardant son argent et ses meubles. exil du royaume 242. Mais ceux des autres ces (castes) qui commettent crimes involontairement mritent tout qu'on leur confisque leur (avoir) ; et (s'ils les commettent) volontairement (ils l'exil. mritent) 235. Un voleur, celui qui a vol l'or d'un Brahmane . Un buveur un Dvidja buveur de sur . (Kull.) Guru ici a le sens le plus tendu. 237. Pour col de l'or d'un Brahmane . (Kull.) 241. Un Brahmane dou de qualits, et qui a pch involontairement; mais s'il est dpourvu de qualits et qu'il ait pch volontairement, il doit tre exil . (Kull.) Cf. le vers suivant. 242. L'exil : suivant Kull. pravsanam serait la peine de mort.
292
LES LOIS DE MANOU
ne doit point 243. Un bon prince l'argent s'approprier il est d'un grand pcheur ; s'il se l'approprie par cupidit, lui-mme infect de la faute (commise par le pcheur). Varouna, 244. Qu'il jette l'eau cette amende en l'offrant et instruit un Brahmane ou bien qu'il en fasse cadeau vertueux. du chtiment, car il exerce 245. Varouna est le seigneur son autorit mme sur les rois ; un Brahmane qui a tudi du monde entier. tout le Vda est le seigneur le o le roi vite de s'approprier 246. Dans tout (pays) naissent en temps (convebien des malfaiteurs, les hommes ; nable) et vivent longtemps chacune des cultivateurs 247. Et les moissons poussent et les enfants ne meurent comme elles ont t semes, pas et il ne nat pas de monstre. de basse caste fait du mal un Brah248. (Si) un homme sortes mane avec intention, que le roi le frappe de diverses de chtiments la terreur. corporels inspirant comme 249. La faute d'un prince est considre gale, soit qu'il punisse un innocent ou dlivre un coupable ; mais il rprime (est grand) (juste(son) mrite spirituel quand ment). 250. Ainsi a t expose tout au long la (rgle pour) dcider dans les procs entre deux plaideurs, (dont le cas rentre une des) dix-huit catgories. ainsi exactement ses 251. Un souverain qui accomplit acqurir les la loi, peut chercher devoirs conformment ceux qu'il pas (encore) et doit protger pays qu'il ne possde dj. possde 246. En temps convenable, c'est--dire terme . (Kull.) 247. Ne meurent pas en bas ge . (Kull.) 248. Un homme de basse caste un Soudra . (Kull.) 249. Son mrite spirituel, dharma, ou peut-tre simplement son devoir est de rprimer justement . 250. Sur les dix-huit catgories ou chefs d'accusation, cf. VIII, v. 3 sqq. 251. A acqurir en inspirant de l'affection aux peuples t>. (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 252. Aprs des forteresses constamment
293
et bti avoir mis l'ordre exact dans ses tats suivant des livres, (les prceptes) qu'il fasse tous ses efforts (de son pour ter les pines
royaume). honorable ceux qui ont une conduite 253. En protgeant et en tant les pines, les souverains uniquement proccups au ciel. de la dfense de leurs sujets parviennent les tributs sans punir les 254. Mais (si) le prince peroit et (lui-mme) son royaume est branl voleurs, perd le ciel. est en sret, protg 255. Au contraire (quand) le royaume constamment comme par le bras puissant (du roi), il prospre un arbre bien arros. dcouvre 256. Que le prince, voyant (tout) par ses espions, les deux sortes de voleurs le bien d'autrui qui ravissent ; cachs. (les autres) (les uns) manifestes, les voleurs manifestes 257. De ces (deux sortes), (sont sur les diverses marchandises, ceux) qui vivent (en trichant) cachs sont les larrons, les (brigands) des forts et les voleurs autres. les tricheurs, 258. Les prvaricateurs, les escrocs, les des prires ceux qui vivent en enseignant joueurs, propitiaet les diseurs de bonne aventure, toires, les hypocrites 252. Vishtadea signifie peut-tre s'tant tabli dans un pays ; il semble pourtant que le roi n'a pas le choix du pays qu'il doit gouverner. Livres : allusion aux prceptes donns 1. VII, v. 70 sqq. Les pines, c'est--dire les voleurs, les malfaiteurs . (Kull.) 253. Honorables, littr. qui vivent comme des ryas . Le texte porte au triple ciel . 255. A ct de sicyamnah arros, il y a une autre leon sevyamnah entour de soins. 256. Cracakshu peut signifier aussi qui a ses yeux pour espions . 257. Les larrons ceux qui s'introduisent par une brche faite dans un mur . (Kull.) ' 258. Les tricheurs, ou suivant Kull. ceux qui extorquent de l'argent par des menaces . Les escrocs ou peut-tre les falsificateurs de mtaux prcieux, tels que l'or, etc. . (Kull.) Des prires propitiatoires pour obtenir des richesses, des fils, etc. . (Kull.) Les hypocrites ceux qui affectent une bonne conduite et en secret sont des mchants . (Kull.)
294 259.
LES LOIS DE MANOU
Les ministres et les mdecins qui ne font pas leur ceux qui exercent un art et les adroites devoir, courtisanes, 260. Ceux-l et leurs pareils, se montrant ouvertement, ainsi que d'autres en secret, sans et, gens qui agissent les insignes des gens honorables, honneur, portent (le roi) doit les considrer comme des pines (de la socit). 261. Les ayant dcouverts de confiance par des (agents) et exerant le mme et par des espions dguiss mtier, (cachs sous) divers dguisements, qu'il les (fasse) inciter ( commettre des dlits), et les amne (ainsi) en son pouvoir. 262. Aprs avoir fait publier selon la vrit les crimes (commis) par eux dans leurs diverses actions, que le roi leur une peine leur fortune et leur inflige proportionne dlit. 263. Car sans le chtiment il est impossible la de rprimer des voleurs l'me en perversit mchante, qui rdent cachette sur cette terre. 264. Les maisons de runion, les rservoirs, les ptisseries, les lupanars, les tavernes et restaurants, les carrefours, les arbres consacrs, les assembles, les spectacles, 265. Les vieux jardins, les forts, les boutiques d'artisans, les maisons les bois et les parcs, abandonnes, 266. Ces lieux et autres pareils, les fasse que le souverain surveiller ainsi que par des par des postes et des patrouilles, afin d'carter les voleurs. espions, 267. Par le moyen de ci-devant voleurs, adroits, (se faisant 259. Ministres : mahmtra signifie aussi cornac d'lphant . Qui ne font pas leur devoir 1, c'est--dire qui ne gurissent pas, les charlatans. Ceux qui exercent un art, par exemple les peintres de profession . (Kull.) 260. On peut construire le mot mot diffremment ces pines manifestes..., le roi doit apprendre les connatre . 261. Divers dguisements, cf. VII, v. 154 et note sur les cinq classes d'espions. Protshya les excitant ; il s'agit vraisemblablement ici de ce que nous appelons les agents provocateurs. Une autre leon porte protsdya les anantissant . 267. Les inciter : il s'agit ici, comme au v. 261, de la provocation au dlit
LES LOIS DE MANOU
295
eux et de ces (malfaiteurs), s'associant les) compagnons il devra les dcouvrir et connaissant leurs diverses pratiques, les inciter des dlits). ( commettre aliments de (leur offrir) divers 268. Sous prtexte (dliou (une reprchez des Brahmanes, cats), de les conduire en les amneront sentation de) tours de force, (ces espions) prsence (des gens du roi). et ceux 269. Ceux qui ne viennent pas (au lieu dsign) ces ci-devant par le roi), employs qui ont vent (voleurs de vive force et les tue, avec leurs amis, qu'il les attaque et proches. parents mort un voleur 270. Un roi juste ne doit point mettre vol ; mais celui qui est (sur lequel on n'a) pas (saisi l'objet) vol et des instruments (de sa profession), (de l'objet) porteur le faire mourir. il ne doit pas hsiter des aliments 271. Tous ceux qui dans un village fournissent une cachette ou leur donnent aux voleurs, pour leurs instrude mort. ments, qu'il les punisse et ses provinces, 272. (Si) ceux qu'il a chargs de protger cet office, demeuil a enjoint les voisins auxquels (de remplir en cas d'attaque qu'il les (par des brigands), rent) neutres chtie aussitt comme des voleurs. des 273. L'homme qui subsistant (de l'accomplissement) qui doit amener la rpression. D'autres entendent par l qu'il les fasse sortir de leur retraite . 268. Dlicats, des gteaux et du riz au lait . (Kull.) Ches des Brahmanes, en leur disant : Il y a un Brahmane qui connat un moyen de faire russir tous vos dsirs; allons le voir . Tours de force, en leur disant : Il y a un homme qui lui seul combat contre plusieurs ; allons le voir . (Kull.) Les amneront en prsence du roi pour les faire arrter. 269. J'ai traduit le terme obscur de mlapranihith d'aprs le commentaire de Kull. Il serait peut-tre plus simple d'entendre qui ont reconnu la racine , c'est--dire la raison de ces agissements, en d'autres termes, qui ont vent le pige. 271. Le compos bhndvakadh, peut signifier aussi qui fournissent aux voleurs des instruments et un asile . 272. Par voisins il faut entendre ici sans doute les vassaux. 273. Celui qui accomplit les crmonies pour les autres et subsiste des
296
LES LOIS DE MANOU
de la rgle de (son) devoir, devoirs pieux s'carte (que le roi) de son devoir. le consume par le chtiment (comme) violateur une digue 274. Quand un village est attaqu, ou dtruite, se commet sur une route, quiconque qu'un acte de brigandage ses moyens, ne se hte pas (de porter secours) suivant doit ses biens. tre banni en emportant les trsors du roi et ceux qui 275. Ceux qui drobent (faire) des choses contraires qu'il ( ses ordres), persistent ainsi qu' ceux qui leur inflige divers chtiments corporels, excitent (contre lui) ses ennemis. 276. Le roi fera couper les mains aux voleurs de nuit avec sur un pieu pointu. et les fera empaler effraction 277. Il fera couper deux doigts un coupeur de bourse son premier vol, son second une main et un pied, son troisime il lui infligera la peine de mort. 278. Ceux qui donnent du feu, des aliments, (aux voleurs) des armes ou un abri, ainsi que les receleurs du vol, le prince doit les punir l'gal des voleurs. 279. Celui qui dtruit le (roi) le (la digue) d'un rservoir, fera prir (en le noyant) dans l'eau ou par la mort ordinaire ; ou bien (il le condamnera) rparer mais en (le dommage), lui infligeant la plus forte. l'amende 280. Que le roi fasse prir sans balancer ceux qui forcent un grenier, un arsenal, un temple, ceux qui volent des ldes chevaux et des chars. phants, 281. Celui qui dtourne l'eau d'un tang anciennement ou qui coupe une conduite devra creus, d'eau, payer l'amende du degr infrieur. dons du sacrifice, mme tant Brahmane, etc. (Kull.) Il s'agit ici des prtres sacrifiants, de ceux qui vivent en accomplissant les crmonies pour d'autres. 275. Divers chtiments corporels, tels que couper la main, le pied, la langue . (Kull.) 277. Deux doigts, le pouce et l'index . (Kull.) 279. La mort ordinaire, c'est--dire la tte tranche. L'amende la plus leve = 1,000 panas. 280. Un grenier royal . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
297
282. Mais celui qui sans un besoin des pressant dpose sur une route royale, ordures devra payer deux krchpanas l'ordure. et nettoyer aussitt un vieillard, une 283. Mais un homme en, pressant besoin, un enfant, femme enceinte, devront (en tre quittes pour) une rprimande et pour nettoyer : telle est la (l'ordure) rgle. de travers 284. Tout mdecin (ou vtrinaire) qui traite (une maladie devra payer) une amende : s'il s'agit d'animaux s'il s'agit d'humains du degr infrieur, (l'amende) (l'amende) moyenne. un poteau, un pont, un tendard, 285. Celui qui dtruit tout (le dgt) et payer des images, devra rparer cinq cents (panas). de bonne qualit, 286. Pour avoir frelat des marchandises ainsi que pour avoir bris des perles ou les avoir mal perces, du premier on doit payer l'amende degr. avec d'honntes 287. L'homme qui agit malhonntement ou qui fait des prix diffrents, doit tre puni de (acheteurs), du premier l'amende degr ou du degr intermdiaire. 288. (Quele roi) place toutes lesprisonssur une route royale d'o l'on puisse voir les criminels tourments et dfigurs. la muraille 289. Celui qui dtruit ou comble le foss en284. J'ai ajout vtrinaire cause de ce qui suit, bien que le texte n'tablisse pas cette distinction. 285. Un tendard a la porte du roi, etc. . (Kull.) Des images de petites images en terre glaise, etc. . (Kull.) Il est probable qu'il ne s'agit pas 'idoles, car le chtiment serait plus grave. 286. Littr. gt des objets qui n'taient pas gts. Kull. explique ainsi: pour avoir fourr des objets de mauvaise qualit parmi les objets de bonne qualit. Pour.avoir mal perc des perles : il faut sous-entendre que l'auteur de la maladresse n'est pas le propritaire des perles, ou bien qu'il a cherch les vendre en trompant l'acheteur. 287. Samaih est expliqu par Kull. samamlyadtrbhih qui payent un prix gal et auxquels on donne des marchandises de qualit diffrente, les unes suprieures, les autres infrieures ; mais sama a le sens de honnte. On peut aussi sous-entendre avec cette pithte le mot choses, celui qui agit ingalement avec des choses qui sont gales .
298
LES LOIS DE MANOU
tourant une forteresse, ou qui enfonce la porte (d'une ville) devra tre banni sur-le-champ. 290. Pour tout malfice, que (le roi) inflige une amende de deux cents (panas) ainsi que pour une crmonie (magique avec des racines le but) n'a pas t accomplie) (lorsque et pour toute sorte de sorcellerie. atteint, 291. Celui qui vend de mauvaise celui qui met de graine, celui qui dtruit la (bonne) graine par-dessus (la mauvaise), un chtiment la mutilation. une borne, mritent corporel, 292. Mais un orfvre qui agit frauduleusement est la pire de toutes les pines ; le souverain doit le faire couper en morceaux avec des rasoirs. 293. Pour vol d'instruments de remaratoires, d'armes, selon l'poque et le mobile (du des, le roi fixera le chtiment vol). 294. Le souverain et les ministres, la capitale, les tats, le l'arme et les allis, tels sont les sept lments trsor, (qui a sept membres. font) dire qu'un royaume 295. Sachez d'un royaume que parmi ces sept lments dans l'ordre, chacun est plus important (numrs) (que le et sa) destruction suivant, (est une calamit) plus grande. 296. Ici-bas, dans un royaume sept membres, qui se tient droit comme le triple bton (d'un ascte), aucun (des lde ses qualits ments) n'a de prminence par la supriorit sur (celles des) autres. 290. Malfice par des sacrifices qui doivent causer la mort de quelqu'un . (Kull.) Avec des racines, c'est--dire avec des plantes qui sont censes mettre les personnes notre discrtion, tels les philtres- Au cas o il rsulte la mort de quelqu'un la punition est celle du meurtre. (Kull.) 291. De mauvaise graine pour de la bonne . (Kull.) Par-dessus la mauvaise et qui vend le tout comme de bonne qualit . (Kull.) Une autre leon de Nand. adopte par Jolly bjotkrasht au lieu de bjotkrshtam, signifie qui ramasse de la graine dj seme . J'ai gard la leon de Kull. 296. Les trois btons d'un ascte qui sont lis ensemble, et se supportent mutuellement . (Kull.) Ce vers semble en contradiction avec le prcdent, qui dit que le premier est plus important que le second, et ainsi de suite. B. traduit un peu diffremment : cause de l'importance des qualits de chacun pour les autres .
LES LOIS DE MANOU
299
297. Chaque membre pris part est spcialement appel telle ou telle fonction ; chacun est dclar le meilleur relativement la fonction propre accomplie par lui. 298. Par des espions, de sa puissance par le dploiement et par l'excution le roi doit consd'entreprises (diverses), tamment connatre sa force et celle de ses ennemis. considr toutes les calamits les 299. Ayant et tous vices (qui affligent ses tats et ceux des autres), et leur plus ou moins de gravit, il commence une qu'alors (seulement) entreprise. 300. Bien que fatigu, il doit recommencer fois plusieurs ses entreprises, car la fortune l'homme rcompense persvrant dans ses desseins. 301. Les (divers) ges (du monde) Krita, DvTret, tous (rappellent les diverses) conduites d'un,, paraetKali le roi est dit (reprsenter) roi ; c'est pourquoi un ge. il est l'ge Kali, veill l'ge Dvpara, 302. Endormi prt agir l'ge Tret, agissant l'ge Krita. la conduite 303. Le roi doit imiter du d'Indra, glorieuse de Varouna, de Tchandra, du feu, soleil, du vent, de Yama, de la terre. 304. De mme les quatre mois qu'Indra pendant pleut ainsi le roi exerant l'office d'Indra doit (faire) pluvieux, ses bienfaits sur son royaume. pleuvoir huit mois le soleil pompe l'eau 305. De mme que pendant ainsi (le roi) doit constamment tirer lui les avec ses rayons, : car c'est taxes de son royaume (en cela que son) office celui) du soleil. (ressemble 299. Les calamits pidmies, etc. . Les vices les malheurs rsultant de l'amour, de la colre, etc. . (Kull.) 301. Sur les quatre ges" du monde, cf. I, v. 69, sqq. Le roi, suivant qu'il se conduit bien ou mal, fait rgner l'ge d'or ou l'ge de fer. 302. L'ge Kali est le plus mauvais et. le plus rcent des quatre ges. Voil pourquoi il est identifi avec le roi endormi, parce que le roi endormi ne fait pas rgner la justice. 303. Ces diverses comparaisons sont lucides dans les vers suivants.
300 306.
LES LOIS DE MANOU
De mme que le vent se meut, pntrant dans toutes les cratures, ainsi le roi doit pntrer au moyen de (partout) ses espions ; car c'est (en cela que son) office (ressemble celui) du vent. 307. De mme que Yama au temps venu rprime amis et ainsi (le roi) doit rprimer tous les sujets ; car c'est ennemis, celui) de Yama. (en cela que son) office (ressemble 308. De mme qu'on voit (des gens) enlacs dans les liens de Varouna, ainsi (le roi) doit enchaner les mchants ; car c'est (en cela que son) office (ressemble celui) de Varouna. 309. De mme que les mortels se rjouissent en voyant la pleine lune, ainsi (la vue) du prince (doit rjouir ses) sujets ; (c'est en cela qu'il) remplit l'office de Tchandra. 310. Que (le roi) soit toujours plein d'ardeur et d'nergie et qu'il dtruise les ministres ennemis ( punir) les mfaits l'office ; c'est en cela qu'il est dit (remplir) (de sa personne) du feu. 311. De mme que la terre supporte toutes les galement ainsi (le roi doit) supporter tous ses sujets ; (c'est cratures, en cela qu'il remplit) l'office de la terre. 312. Usant de ces moyens et d'autres (pareils), que le roi sans se fatiguer constamment les voleurs dans ses rprime tats et dans (ceux) d'autrui. 313. Mme tomb dans la plus grande dtresse, qu'il n'irrite car ceux-ci dans leur courroux pourjamais les Brahmanes, avec son arme raient en un instant l'anantir et ses chars. 307. Yama le juge des morts. Rprime jeu de mots sur le nom de Yama et la racine yam qui veut dire rprimer ; l'tymologie du reste n'est pas sre. 308. Les liens de Varuna sont une expression mtaphorique pour dsigner l'hydropisie. 309. Candra est le dieu Lunus. 311. La terre supporte : encore un jeu de mots tymologique dhar dhrayate. 312. Dans ceux d'autrui, c'est--dire ceux qui habitent dans d'autres royaumes, et qui viennent piller le sien . (Kull.) 313. Qu'il n'irrite jamais les Brahmanes, c'eslr-dire qu'il ne leur te
LES LOIS DE MANOU 314.
301
de prir en irritant ceux dont Qui donc ne (risquerait) est cause que le feu dvore tout, que (l'eau de) (la maldiction) l'Ocan est imbuvable, et que la lune disparat et renat tour tour ? 315. Comment en faisant du mal pourrait-on prosprer ceux qui courroucs creraient d'autres mondes, (d'autres) du monde, de leur et dpouilleraient les dieux gardiens nature divine ? 316. Quel (homme) dsireux causer du de vivre voudrait tort ceux sur lesquels les (trois) ternellement reposent mondes et les dieux, et dont la richesse est le Vda? 317. Instruit ou ignorant, est une grande un Brahmane de mme que le feu, employ ou non (au sacrifice) divinit, est un puissant dieu. 318. Mme dans les cimetires, le (feu), ce brillant purifidans cateur, n'est pas souill ; et quand on y a jet l'oblation, les sacrifices, il croit encore (en puissance). toutes (sortes) d'occupations 319. Aussi, bien qu'adonns les Brahmanes doivent tre honors ; toujours peu estimes, car (un Brahmane) est la plus haute divinit. pas leurs biens . (Medh.) Anantir par des maldictions et des incantations . (Kull.) 314. Allusion des lgendes piques. Bhrgu maudit Agni et le condamna tout dvorer. C'est une maldiction de Vadavmukha que l'Ocan doit ses eaux sales, et Daksha pour punir Candra son gendre de sa dsobissance le condamna la consomption ; mais les filles de Daksha implorrent sa compassion et il adoucit la sentence en rendant la consomption priodique : c'est ainsi que s'expliquent les phases lunaires. 315. Littr. ferait les Dieux non Dieux , allusions des lgendes piques. Vivmitra pour forcer les Dieux recevoir au ciel Trianku, cra par le pouvoir de ses austrits sept nouveaux Richis et d'autres constellations, et menaa de crer un autre Indra et d'autres Dieux. Mndavya par sa maldiction fit natre Yama dans le corps d'un Soudra. 316. Sur lesquels reposent les trois mondes et les Dieux, par le moyen du sacrifice : sans le sacrifice les Dieux ne pourraient subsister, et sans les Dieux les mondes leur tour ne pourraient subsister. Les trois mondes, le ciel, l'air et la terre, ou bien le ciel, la terre et l'enfer. 318. L'oblation, le beurre clarifi qu'on jette dans la flamme.
302
LES LOIS DE MANOU
insolents envers devenaient 320. Si jamais les Kchatriyas seuls aies faire rentrer les Brahmanes, (c'est) aux Brahmanes dans la soumission sont issus des Brah; car les Kchatriyas manes. du Brahmane, 321. Le feu provient de l'eau, le Kchatriya est le fer de la pierre ; leur pouvoir partout qui pntre contre (l'lment o) ils ont pris naissance. impuissant 322. Ni la caste des Kchatriyas ne prospre sans la caste ni la caste des Brahmanes des Brahmanes, sans la caste des Kchatriyas et les Kchatriyas en ; mais les Brahmanes s'unissant dans ce monde et dans l'autre. prosprent aux Brahmanes tout 323. Aprs avoir donn l'argent son fils, des amendes et transmis son royaume provenant (que le roi) cherche le trpas dans une bataille. ainsi et toujours 324. Se conduisant appliqu ses devoirs de tous ses serviteurs au bonheur de roi, qu'il fasse travailler son peuple. a t expose en entier la rgle ternelle 325. Ainsi d'un roi ; apprenez les devoirs maintenant (concernant) la rgle des devoirs et le Soudra , dans pour le Vaisya l'ordre. 326. Aprs avoir t initi et s'tre mari, que le Vaisya 320. A les faire rentrer dans la soumission par des maldictions et incantations . (Kull.) 321. Leur pouvoir, c'est--dire le feu ne peut rien contre l'eau, le Kchatriya contre le Brahmane, le fer contre la pierre. Lefeu provient de l'eau : cela veut dire, suivant Medh., que l'eau passe dans les vgtaux, dont le bois sert faire le feu. Le fer provient de la pierre, parce qu'il vient d'un minerai. Quant l'origine des Kchatriyas dont il est ici question, elle est en dsaccord' avec ce qui a t dit au chapitre de la Cration. 323. L'argent des amendes, sauf celles qui ont t payes par les grands criminels . (Kull.) Le roi, lorsqu'il est vieux, bien entendu, doit chercher la mort dans une bataille, ou dfaut d'une bataille, il doit se laisser mourir de faim . (Kull.) D'autres commentateurs indiquent le suicide par la submersion ou par la crmation. 326. Sa profession vrtt, c'est--dire les occupations par lesquelles un Vaisya doit subsister : le commerce, l'agriculture et l'entretien des troupeaux.
LES LOIS DE MANOU
303
de et de l'entretien de sa profession constamment s'occupe ses troupeaux. les troupeaux, des cratures 327. Car le Seigneur ayantcr et au roi il en garde au Vaisya ; au Brahmane les donna humaines. confia toutes les cratures ce voeu : Je formuler ne doit jamais 328. Un Vaisya ; et quand le Vaisya les troupeaux voudrais ne pas garder ne doit les autre est dispos aucun soin), ( en prendre garder. 329. Il doit connatre le cours des pierres prcieuses, et essences. tissus, coraux, mtaux, parfums perles, de semer les de (la manire) 330. Il doit tre au courant et des terres, de la bonne ou mauvaise qualit graines, fond le systme des poids et mesures, connatre ct des objets, les 331. Et aussi le bon et le mauvais les profits et des contres, et les dsavantages avantages et l'lve du btail. pertes (sur) les marchandises, et 332. Il doit savoir (quels sont) les gages des serviteurs, de conserver et la manire les divers dialectes des hommes, et de la vente. les objets, et (les conditions de) l'achat ses biens par 333. Qu'il mette tous ses efforts accrotre des moyens et qu'il ait soin de donner la nourrilgitimes, ture toutes les cratures. envers les Brahmanes instruits 334. Mais l'obissance matres de maison, et renomms dans les Vdas, (pour leur devoir d'un Soudra, vertu, (et ce) qui le voil) le suprme la batitude. conduit doux en 335. S'il est pur, obissant envers ses suprieurs, 327. Cratures humaines prajh : je pense qu'il faut donner ce mot ce sens restreint en opposition pan, les troupeaux, de l'hmistiche prcdent. 328. Aucun autre, c'est--dire aucun homme d'une autre caste. 329. Cours, littr. la valeur suprieure moyenne et infrieure. 334. La vertu qu'on recommande particulirement au Vaisya c'est la libralit, au Soudra c'est l'obissance. 335. Ses suprieurs, c'est--dire ceux des castes plus leves. Soumis
304
LES LOIS DE MANOU
sans prsomption, soumis aux Brahmanes, toujours paroles, il obtient (de renatre dans) une caste plus leve. des 336. Ainsi se trouve expose la rgle pure de conduite ne sont) pas dans la dtresse ; castes, (quatre) (lorsqu'elles maintenant en cas de apprenez (devoirs) par ordre leurs dtresse. aux Brahmanes, littr. cherchant un refuge auprs des Brahmanes, et leur dfaut, auprs des Kchatriyas et des Vaisyas . (Kull.)
LIVRE Castes mles ; Occupations
DIXIEME des castes
v ; Temps de dtresse.
fidles leurs occupa1. Que les trois castes des Dvidjas, mais que les Brahmanes tudient tions propres (le Vda), et nul autre : telle est la dcision. seuls l'enseignent, d'existence 2. Le Brahmane doit savoir les moyens (pres(les castes) ; il doit en instruire crits) par la loi pour toutes et lui-mme les autres, s'y conformer. de son de sa supriorit, 3. En vertu de sa prminence, des voeux, et de son initiation de l'observance sporigine, les castes. de (toutes) est le seigneur ciale, le Brahmane sont les et Vaisya 4. Les castes Brahmane, Kchatriya la quatrime, celle des trois castes qui ont deux naissances; Il n'existe n'en a qu'une. Soudras, point de cinquime (caste). 5. Dans toutes les castes, doivent tre considrs comme les (enfants) la caste seulement qui sont ns appartenant dans l'ordre direct de femmes et vierges (caste) ( d'gale de leur mariage). l'poque 6. Les enfants engendrs avec des femmes par des Dvidjas 3. Sa prminence : la supriorit de sa race (Kull.), ou de ses qualits . (Medh.) Son origine de la tte de Brahm . (Kull.) L'observance des voeux, tels que ceux d'un Sntaka . Kull. entend autrement : sa connaissance parfaite du Vda . 4. Il n'y a point de cinquime caste primitivement ; mais il y a des castes infrieures et mprises, rsultant du mlange des castes principales, et dont l'numration vient ci-aprs. 5. Dans l'ordre direct, Brahmane avec Brhman, Kchatriya avec Kchatriya (Kull.) 6. Semblables leur pre mais infrieurs en caste . (Kull.) Ces enfants 20
306
LES LOIS DE MANOU
de la caste immdiatement infrieure sont dclars semblables ( leurs pres, mais) entachs de blme par la faute de leur mre. 7. Telle est l'ternelle loi pour (les enfants) ns de femmes de leurs infrieure (de la caste) immdiatement ( celle maintenant la rgle lgale pour ceux qui ; apprenez mres) naissent infrieures de deux ou trois degrs. (de femmes) 8. D'un Brahmane nat un (fils) appel (uni) une Vaisya Ambachtha, (d'un Brahmane uni) une Soudra (nat) un Nichda nomm aussi un Prasava. 9. D'un Kchatriya nat un tre appel (uni) une Soudra tenant du Kchatriya et du Soudra, Ougra, qui se complat dans les moeurs cruelles. d'un Brahmane 10. Les enfants et d'une (femme des) trois des d'un Kchatriya castes et d'une (infrieures), (femme) deux (dernires) d'un Vaisya et d'une de castes, (femme) la sienne), ces six (sortes d'encaste (infrieure l'unique fants) sont appels repousss. 11. D'un Kchatriya nat (uni) la fille d'un Brahmane d'un Vaisya sa caste un Sota, (un fils appel) d'aprs (uni) un une femme de (caste) ou sacerdotale naissent royale et un Vaidha. Mgadha une Kchatriya, 12. D'un Soudra (uni) une Vaisya, sont le Mrdhvasikta (fils d'un Brahmane et d'une Kchatriya), le Mhishya (fils d'un Kchatriya et d'une Vaisya), et le Karana (fils d'un Vaisya et d'une Soudra). Le Mrdhvasikta a pour fonction d'enseigner conduire un lphant, un cheval, un char et le maniement des armes; le Mhishya a pour mtier l'enseignement de la danse, de la musique et de l'astronomie, ainsi que la garde des moissons; la profession du Karana est de servir les Dvidjas, etc. (Kull.) 7. De deux ou trois degrs : littr. spares par une ou deux castes , c'est--dire par exemple de Brahmane Vaisya ou Soudra. 8. Ce nom de praava est expliqu au livre IX, v. 178, un cadavre vivant . 9. Ugra est un adjectif qui signifie cruel. 10. Repouss apasada. 12. Le plus vil est le Cndla, parce que la distance entre ses deux parents est la plus considrable.
LES LOIS DE MANOU
307
une Brhman, naissent des (des fils issus) d'une confusion castes (et qu'on appelle) et Tchndla Kchattar : yogava, (ce sont) les plus vils des hommes. 13. De mme qu'un Ambachtha et un Ougra, engendrs dans l'ordre avec (des femmes) de deux castes audirect, sont considrs tre touchs sans dessous, (comme pouvant ainsi (en est-il) du Kchattar et du Vaidha impuret), quoique ns dans l'ordre inverse. 14. Ces fils de Dvidjas dans des femmes d'une engendrs caste immdiatement vient d'numrer infrieure, qu'on sous le nom d'immdiats, cause par ordre, on les dsigne de la tache (provenant de l'infriorit) de leur mre. 15. Un Brahmane de la fille d'un Ougra un engendre de la fille d'un Ambachtha un vrita, (enfant) appel d'une (femme de caste) yogava un Dhigvana. bhra, 16. D'un Soudra naissent dans l'ordre inverse trois (sortes : l'yogava, le Kchattar et le Tchndla d'enfants) repousses le plus vil des hommes. 17. D'un Vaisya naissent dans l'ordre inverse un Mgadha et un Vaidha, d'un Kchatriya un Sota : (nat) seulement ces trois (fils) sont aussi repousss. 18. Le fils d'un Nichda et d'une Soudra est par sa naissance un Poulkasa; mais le fils d'un Soudra et d'une femme Nichd est dnomm un Koukkoutaka. 13. L'ordre direct descend du Brahmane au Soudra, l'ordre inverse remonte du Soudra au Brahmane : ainsi l'Ambashtha nat d'un Brahmane et d'une Vaisya (deux degrs plus bas, ordre direct), l'Ugra d'un Kchatriya et d'une Soudra. Au contraire le Kshattar nat d'un Soudra et d'une Kchatriya (deux degrs plus haut, ordre inverse), le Vaidha d'un Vaisya et d'une Brhman. 14. Immdiats anantara : les ekntaras sont ceux dont le pre et la mre sont spars par une caste (par exemple Brahmane avec Vaisya), et les dvyantaras ceux dont le pre et la mre sont spars par deux castes. 16. Repousses : Incapables de remplir les devoirs de fils c'est--dire d'offrir les sacrifices funraires aux Mnes des anctres. (Kull.) 17. Seulement, parce qu'au-dessus du Kchatriya il ne reste qu'une caste. 18. Pulkasa, ou Pukkasa, suivant une autre leon.
308 19. De mme
LES LOIS DE MANOU
le fils d'un Kchattar et d'une est Ougr mais celui qui est engendr appel Svapka; par un Vaidha et une femme Ambachtha se nomme un Vena. 20. Les (enfants) ns de Dvidjas des (femmes) (maris) de mme caste, mais qui n'accomplissent pas les crmonies, tant exclus de la Svitr, doivent tre dsigns sous le nom de Vrtyas. 21. D'un Vrty un Bhridjnaissent (de caste) Brahmane un Vtadhna, un Pouchpajakantaka abject, un Avantya, skhara et un Saikha. 22. D'un Vrty un Djhalla, (de caste) royale (naissent) un Malla, un Litchchivi, un Nata, un Karana, un Khasa, un Dravida. 23. D'un Vrty nat un Soudhanvan, (de caste) Vaisya un Tchrya, un Kroucha, un Maitra, un un Vidjanman, Stvata. 24. De l'adultre de diverses) castes, de (entre personnes de avec des femmes d'pouser, mariages qu'il est interdit rsulte l'abandon des occupations (prescrites) pour chacun, la confusion des castes. 25. Je vais numrer ces (enfants) d'origine compltement et qui direct ou dans l'ordre inverse, mixte, ns dans l'ordre sont connexes les uns aux autres. 26. Le Sota, le Vaidhaka, le plus vil des le Tchndla de naissance, et le Mgadha, celui qui est Kchattar hommes, ainsi que l'yogava, 20. Les crmonies, telles que l'initiation, etc. . (Kull.) Vrty = excommuni. 21. Pushpaekhara ou Pushpadha. Ces diverses dnominations proviennent de la diffrence des contres. (Kull.) 22. Licchivi ou Nicchivi, suivant les ditions. 25. L'ordre direct, cf. note du v. 13. Anyonyavyatishakth connexes les uns aux autres , terme obscur. B. H. traduit : et ceux (dont la naissance) est mutuellement confondue . L. d'aprs Kull. le rapporte aux castes : produits par les races mles , lorsqu'elles s'unissent entre elles .
LES LOIS DE MANOU 27.
309
Tous les six engendrent avec des femmes de mme ; ils (en) procrent (classe) des races semblables (aussi) avec des (femmes) la caste de leur mre, et avec appartenant des femmes (de condition) suprieure. 28. De mme que d'un (Brahmane et de femmes) des trois castes Soudra castes ou) des deux (Kchatriya, Vaisya, et Vaisya) nat (dans l'ordre un fils de direct (Kchatriya un Dvidja) et (aussi) d'une femme de mme race qui devient mme caste, lorsqu'il de n'y a aucun degr intermdiaire, mme entre ces (races) rejetes l'ordre (est pareil). 29. Ces six (mentionns plus haut) leur tour engendrent, les uns des avec les femmes (en s'unissant) rciproquement (sortes autres, plusieurs d'enfants) mprisables, repousss des castes, et encore plus mprisables qu'eux-mmes. 30. De mme qu'un Soudra engendre avec une femme de un enfant qui est repouss caste Brahmane (des castes), ainsi celui qui est exclu (des castes) engendre (avec des femmes) des quatre castes (des enfants) encore plus repousss (des castes que lui-mme). 31. Mais ces hommes repousss (des castes) engendrent des (enfants leur tour, dans l'ordre inverse, encore) plus (des castes qu'eux-mmes, et), abjects, repousss (ils engenau nombre de quinze. drent) des castes (encore plus) abjectes 32. Un Dasyou avec une femme un engendre yogava 27. Des races semblables, la similitude est relative non la famille du pre, mais celle de la mre . (Kull.) 28. Le sens de ce vers reste obscur pour moi. J'ai suivi le commentaire de Kull. B. H. traduit : Comme le moi d'un homme est n de femmes de deux des trois castes, et, quand il n'y a pas de caste intermdiaire, de femmes de sa propre caste, etc. B. met Comme un (Brahmane) engendre en (des femmes de) deux des trois (castes dvidjas) un fils semblable lui-mme, mais infrieur cause du degr plus bas de la mre, et un gal lui-mme, avec une femme de sa propre race, etc . En somme l'ide de Manou n'est pas claire. L'ordre est pareil signifie suivant Kull. qu'il n'y a pas de diffrence de rang entre les enfants de classe mixte engendrs dans l'ordre inverse. 29. Mentionns plus haut au v. 26. 32. A parer et servir son matre, ou bien en faisant avec Kull. un
310
LES LOIS DE MANOU
vivant parer et servir (son matre), adroit Sairandhra et subsisne soit) pas esclave, comme un esclave, (quoiqu'il tant (aussi) de ses filets. un 33. Un Vaidha (avec une femme yogava) engendre aux douces paroles, qui loue continuellement Maitreyaka les gens, sonnant une cloche au lever du soleil. un 34. Un Nichda (avec une femme yogava) engendre ou Dsa, qui vit du mtier de batelier, et que les Mrgava Kaivarta. habitants de l'ryvarta appellent de vile naissent chacun 35. Ces trois (tres) de caste les vtements des morts, sont femmes yogavs, qui portent des aliments et mangent prohibs. mprises 36. D'un Nichda nat un femme (et d'une Vaidh) ouvrier en cuir, d'un Vaidha de Krvara, (et de femmes caste Krvara et Nichda) naissent un Andhra et un Mda en dehors du village. qui habitent 37. D'un Tchndla et d'une femme nat un Vaidh, le bambou; d'un Nichda Pndousopka, qui travaille (et d'une femme Vaidh) nat un hindika. 38. Mais d'un Tchndla et d'une femme Poulkas nat un Sopka, (tre) mchant, qui vit du mme mtier que son pre, objet de mpris pour les gens de bien. enfante d'un Tchndla un fils 39. Une femme Nichd dans les cimetires, et (appel) Antyvasyin employ mme de ceux qui sont repousss (des castes). mpris 40. Ces races, issues d'une confusion dsi(des castes), gnes d'aprs leurs pres et leurs mres, peuvent se reconnatre leurs occupations, soit qu'elles se cachent, soit qu'elles se montrent. compos de dpendance, servir son matre dans sa toilette . Filets pour tuer les daims et autres btes sauvages . (Kull.) 35. Ces trois, c'est--dire le Sairandhra, le Maitreyaka et le Mrgava. 37. Ahindika exerant le mtier de gelier . (Kull.) 38. Qui oit du mme mtier que son pre mlavyasanavrttimn est expliqu par Kull. qui a pour mtier d'excuter par ordre du roi les criminels , comme le Cndla.
LES LOIS DE MANOU
311
et de femmes) de la mme 41. Six fils ns (de Dvidjas immdiatement ont les ou d'une caste caste infrieure, devoirs des Dvidjas ; mais tous ceux qui sont ns dans l'ordre comme ayant les mmes inverse (des castes) sont considrs devoirs que les Soudras. et de la semence 42. Par la vertu de leurs austrits (dont ici-bas ils sortent) ceux-ci parviennent d'ge en ge des les releves ou plus existences dgrades parmi plus hommes. les rites sacrs et nglig 43. Mais pour avoir abandonn voici les races de Kchatriyas les Brahmanes, qui sont tom: bes peu peu en ce monde au rang de Vrichalas Kmles Dravidas,les les Tchodas, 44. Les Paoundrakas, les Pahlavas, les Sakas, les Paradas, les Yavanas, bodjas, les Kirtas, les Daradas. les Tchnas, de 45. Toutes les races en ce monde qui sont en dehors des de la bouche, des bras, des cuisses, celles qui naquirent des Barbares ou la langue qu'elles parlent pieds (de Brahm), celle des ryas, sont appeles Dasyous. 46. Ceux qui ont t mentionns comme (fils) repousses de l'ordre des Dvidjas, ou comme ns par un renversement des mtiers des castes, doivent vivre (en exerant) ddaigns par les Dvidjas. 41. Six fils : un Brahmane avec une Brhman ou une Kchatriya, un Kchatriya avec une Kchatriya ou une Vaisya, un Vaisya avec une Vaisya ou une Soudra, engendrent six sortes de fils dans l'ordre direct, qui ont les devoirs des Dvidjas. Mais ceux qui sont engendrs dans l'ordre inverse, par exemple le Sta n d'un Kchatriya et d'une Brhman ont les devoirs des Soudras. 43. Vrshala = Soudra. 44. Quelques-unes de ces dnominations sont aisment reconnaissables dans des noms modernes telles que celles des Dravidiens, des Cambodgiens. Les Yavanas dsignent chez les crivains Hindous les Grecs (ines). 45. En dehors qui ont t exclues des castes pour leur ngligence des crmonies sacres . (Kull.) 46. es repousses (apasada) sont ceux qui sont ns du mlange des castes Dvidjas dans l'ordre direct . (Kull.) Cf. v. 10.
312 47. Aux
LES LOIS DE MANOU
et la conduite des Sotas le soin des chevaux aux Vaidhas la aux Ambachthas la mdecine, voitures, aux Mgadhas le commerce. garde des femmes, du poisson, auxyogavas 48. Aux Nichdas la destruction de charpentier, aux Mdas, aux Andhras, aux le mtier des animaux Tchountchous et aux Madgous la destruction de forts. aux Poulkasas le soin de 49. Aux Kchattars, aux Ougras, tuer ou de prendre (les btes) qui vivent dans des trous, aux la musique instrule-travail du cuir, aux Venas Dhigvanas mentale. 50. Ces (races) doivent habiter prs des arbres consacrs,, dans les cimetires, sur les montagnes et dans les bois, tre et vivre de leurs occureconnaissables ( certains insignes) pations propres. 51. La demeure des Tchndlas et des Svapatchas (doit de tre) en dehors du village ; ils ne doivent point possder vaisselle, (et n'ont pour toute) proprit (que) des chiens et des nes. 52. Pour vtements aient les habits des morts, qu'ils leur nourriture dans des plats casss ; (que) (qu'ils prennent) leurs parures sans cesse une (soient) en fer et (qu'ils mnent) vie errante. 53. Un homme observateur de la loi ne doit point recher47. La garde des femmes, littr. le service des femmes , c'est--dire la garde du harem . (Kull.) 48. La destruction du poisson et la destruction des animaux des forts, c'est--dire la pche et la chasse. Les Cuncus et les Madgus n'ont pas t mentionns prcdemment. Suivant Kull., ils sont ns d'un Brahmane avec une femme Vaidh, et d'un Brahmane avec une femme Ugr . 49. Le travail du cuir ou suivant Kull. la vente du cuir, la diffrence des Krvaras qui s'occupent de la prparation du cuir, comme on l'a vu au v. 36. 51. Possder de vaisselle : la vaisselle de fer et autre matire dans laquelle ils ont mang ne doit plus tre employe . (Kull.) Cf. le vers 54 o il est dit qu'ils doivent manger dans des plats casss. 53. Observateur de la loi, ou bien, comme l'entend B. un homme qui remplit un devoir religieux .
LES LOIS DE MANOU cher leur eux et ne 54. La tre servie de circuler 55. Le naissables
313
commerce ; (ils ne doivent avoir) affaire qu'entre se marier qu'avec (des femmes) de la mme,(caste). les autres doit leur nourriture que leur donnent dans des plats casss ; la nuit il leur est dfendu dans les villages et les villes. reconvaquer leurs occupations, jour ils doivent des insignes (dtermins) par le roi ; ils doivent : les cadavres sans parents (de ceux qui meurent) emporter telle est la rgle. les con56. Sur l'ordre du roi, qu'ils excutent toujours la loi, et .qu'ils prennent damns conformment (pour eux) les vtements, la literie et les parures des supplicis. un homme 57. C'est ses actes qu'on peut reconnatre exclu de sa caste, inconnu, qui, quoique d'origine impure, a l'air d'un homme d'honneur. mprisable, la grossiret, la cruaut, la ngligence 58. La bassesse, en ce bas monde un homme des devoirs religieux trahissent d'origine impure. de tient son caractre 59. Un homme de basse extraction son pre ou de sa mre, ou de tous les deux ; en aucun cas, il ne peut dissimuler son naturel. 60. Un homme mme n dans une grande famille, (mais de castes, possde qui est issu) d'un mlange plus ou moins un caractre avec) cette (origine). (en rapport irrde ces naissances 61. Le royaume o se produisent destructives des castes, prit rapidegulires, (de la puret) ment avec ses habitants. 62. Le sacrifice dsintress de la vie en faveur d'un Brahdes femmes et des mane ou d'une vache, ou pour la dfense assure ces (tres) dgrads la flicit suprme. enfants, 54. Dans des plats casss et par l'intermdiaire des domestiques . (Kull.) Ce vers signifie peut-tre qu'ils ne doivent point eux-mmes se prparer leur nourriture, mais la recevoir d'autrui . L'interdiction de circuler la nuit rappelle celle dont le moyen ge frappait les Juifs. 57. Littr., quoique non rya a l'air d'un rya . rya est parfois synonyme de Dvidja.
314 63.
LES LOIS DE MANOU
Le respect de la vie (des cratures), la vracit, le de la proprit, la puret et la rpression des sens, respect telle est en rsum la loi des quatre castes formule par Manou. 64. (Si une femme de la classe) issue d'un Brahmane et avec un (poux de caste) suprieure, la d'une Soudra enfante remonte au premier (classe) infrieure rang au bout de sept gnrations. 65. C'est ainsi qu'un Soudra s'lve au rang de Brahmane, au rang de Soudra ; sachez qu'il et qu'un Brahmane descend d'un Kchatriya en est de mme pour la postrit et d'un Vaisya. 66. (Supposez) un (enfant) issu n'importe comment d'un Brahmane et d'une (femme) de basse origine, et (un enfant et d'un (homme) de basse origine, s'il issu) d'une Brhman sur celui auquel appartient la supriorit : y a (contestation) 67. Celui honorable et d'une qui est n d'un homme femme de basse devenir un origine peut par ses vertus homme honorable ; celui qui est n d'une (mre) honorable 64. C'est--dire suivant Kull. si une femme de la classe Praava (issue d'un Brahmane et d'une Soudra) pouse un Brahmane, et qu'elle ait une fille qui pouse un Brahmane, et ainsi de suite, jusqu' la septime gnration, l'enfant qui nat alors acquiert la qualit de Brahmane. 65. C'est ainsi qu'un Soudra, c'est--dire la postrit d'un Soudra par une succession de mariages. Suivant Kull., pour la descendance d'un Brahmane et d'une Kchatriya, il faut trois gnrations pour revenir la condition de Brahmane, ou descendre celle de Kchatriya pur; pour la postrit d'un Brahmane et d'une Vaisya il faut cinq gnrations. La postrit d'un Vaisya et d'une Soudra met trois gnrations pour reprendre la qualit de Vaisya, ou descendre celle de Soudra pur; pour celle d'un Kchatriya et d'une Soudra il faut cinq gnrations, et trois pour la postrit d'un Kchatriya et d'une Vaisya. En d'autres termes suivant que la femme est de un, deux ou trois degrs infrieure l'poux, il faut trois, cinq ou sept gnrations pour revenir la puret primitive de la caste du mari, ou descendre tout fait la caste de la femme. 66. De basse origine. Littr. non ry, une Soudra. Nimporte comment, c'est--dire mme en dehors du mariage . (Kull.) 67. Honorable, littr. rya et non rya; c'est la qualit du pre qui prdomine.
LES LOIS DE MANOU et d'un
315
de basse (reste un homme) (pre) de basse origine origine ; telle est (notre) dcision. ne doit tre initi, telle est la loi 68. Ni l'un ni l'autre le cause de la tache de sa naissance, tablie ; le premier inverse des dans l'ordre second (parce qu'il a t procr) castes. dans un bon 69. De mme qu'une bonne semence poussant ainsi le fils d'un pre et d'une mre honorables sol russit, l'initiation est digne de (recevoir) complte. la attribuent 70. Certains d'importance plus sages une gale) d'autres au sol ; d'autres semence, (en attribuent et au sol ; mais voici ce sujet la rgle et la semence : tablie de sol y prit; 71. La semence jete dans un mauvais n'est qu'une terre strile. mme un sol o l'on n'a rien plant 72. Puisque (des enfants mme) par la vertu de la semence et glorifis, devinrent des sages honors ns d'animaux (c'est) la semence (au sol). suprieure (qui) est proclame un homme 73. Ayant considr (de caste) vile qui fait les et un homme honorable actes d'un homme (de caste) (de d'une homme (de caste) caste) honorable qui fait les actes ne sont a dclar ceci: Ces deux (hommes) vile, le Crateur ni gaux, ni ingaux. 74. Les Brahmanes d'atteindre) (aux moyens appliqus doivent vivre et assidus leurs devoirs, l'union avec Brahm dans leur ordre les six actes exactement (en accomplissant) : (suivants) 70. Comparez ce passage avec ce qui est dit aux vers 33-41 du livre IX. 72. Kull. cite l'exemple de Rshyarnga, fils de Vibhndaka, qui suivant le Mahbhrata et le Rmyana tait n d'une daine et avait une petite corne (rnga) au front. 73. Ils diffrent par la caste, et se ressemblent parce que tous deux font des actes dfendus. C'est pourquoi personne ne doit faire les actes qui lui sont interdits . (Kull.) 74. Brahmayonisthh, littr. se tenant dans Brahm comme dans leur source.
316 75.
LES LOIS DE MANOU
et tudier, sacrifier Enseigner pour soi et sacrifier pour les autres, donner et recevoir, (tels sont) les six actes (presde la premire caste. crits) pour un (homme) 76. De ces six actes (qui) lui (sont propres), trois' lui prosa subsistance : sacrifier curent et autrui, pour enseigner recevoir de gens) purs. (des prsents 77. (En descendant) du Brahmane au Kchatriya, trois de ces actes cessent (d'treprescrits, savoir) : enseigner, sacrifier pour autrui et en troisime (lieu) accepter (des prsents). 78. Ces mmes (actes) cessent aussi (d'tre prescrits) pour le Vaisya : telle est la rgle; car le Seigneur des cratures, a dit que ces actes ne convenaient Manou, pas ces deux (castes). 79. Les moyens de subsistance du Kchatriya sont de du Vaisya porter l'pe et le javelot, (de faire) le commerce, les troupeaux et de labourer devoirs (de garder) ; leurs sont de donner (des prsents), d'tudier religieux (le Vda) et les sacrifices. d'accomplir) 80. Parmi leurs occupations les plus recomrespectives, mandables sont pour un Brahmane du Vda, l'enseignement un Kchatriya la protection pour (des peuples), pour un le commerce. Vaisya 81. Mais un Brahmane qui ne peut subsister par l'occususdite qui lui est propre, la loi du pation peut vivre suivant car ce dernier est le plus rapproch de lui (dans Kchatriya, l'ordre des castes). 82; Au cas o il ne pourrait subsister par aucune de ces deux (occupations) faire ? Si (cette question) que devra-t-il se pose, (voici la rponse) : Qu'il vive de la vie d'un Vaisya, en s'adonnant l'agriculture et au soin des troupeaux. 83. Mais un Brahmane ou mme un Kchatriya vivant des d'existence d'un Vaisya doivent autant moyens que possible 75. Enseigner et tudier le Vda et les Angas . (Kull.) 77. En d'autres termes ces trois actes sont interdits au Kchatriya. 83. D'autres cratures telles que les boeufs et autres (employs labou-
LES LOIS DE MANOU
317
de mal, et dpend viter l'agriculture, qui cause beaucoup d'autres (cratures). est chose 84. (Quelques-uns) pensent que l'agriculture excellente est blme ; mais cette occupation par les (gens) de bois pointe de fer envertueux ; car (l'instrument) la terre et les (tres) qui vivent dans la terre. dommage 85. Mais celui que l'insuffisance de ses moyens d'existence l'accomplissement des devoirs oblige renoncer religieux des marchandises s'enrichir, (que vend trafiquer pourra,'pour en exceptant ce qui (doit tre) except. un) Vaisya, 86. Qu'il vite (de vendre) toute espce de condiments, du sel, des aliments cuits ainsi que du ssame, des pierres, du btail et des (tres) humains, 87. Toute espce d'toffes teintes, (des tissus de) chanvre, lin, laine, mme non teints, fruits, racines, (mdiciplantes nales), 88. Eau, armes, de toutes soma, parfums poison, viande, lait (frais), huile de sortes, miel, lait suri, beurre clarifi, ssame, cire, sucre, herbe kousa, 89. Toutes les btes des forts, (animaux) pourvus de crocs, oiseaux, liqueurs spiritueuses, indigo, laque, ainsi que tous les solipdes. 90. Mais celui qui vit d'agriculture, peut son gr vendre des grains de ssame purs (de tout mlange) en vue de des devoirs (l'accomplissement) (religieux, pourvu qu'il) les ait fait pousser lui-mme et qu'ils n'aient par sa culture, pas sjourn longtemps. 91. S'il fait des grains de ssame autre chose qu'un alirer) . (Kull.) Le vers suivant explique en quoi l'agriculture cause beaucoup de mal. 85. Celui le Brahmane ou le Kchatriya . (Kull.) 86. Ou bien du riz cuit (ml) avec des grains de ssame . Le sel est mentionn part pour marquer la gravit du pch . (Kull.) 87. Teintes (rakta), plus spcialement peut-tre rouges, le rouge tant la couleur par excellence. En espagnol Colorado signifie rouge. 88. Cire, littr., miel, niadhu. f^~Jtf. v'*;. f- i
318
LES LOIS DE MANOU
ou un don, il renatra sous forme de ver, et ment, un onguent, dans des excrments de chien. sera plong avec ses anctres du sel, de la laque, 92. (Pour avoir vendu) de la viande, un Brahmane est dchu immdiatement (de sa caste) ; pour Soudra au bout de trois jours. avoir vendu du lait, il devient volontairement ici-bas les 93. Mais pour avoir vendu au autres marchandises un Brahmane (prohibes) acquiert bout de sept jours la condition de Vaisya. 94. Des essences peuvent tre changes contre des essendes aliments cuits ces, mais non du sel contre des essences, contre des aliments cuits, et des grains de ssame contre un gal poids d'autres grains. 95. Un homme de caste royale dans la dtresse, tomb ; mais il ne doit jamais peut vivre par tous ces (moyens) les occupations s'arroger (de la caste) suprieure. 96. Un homme de basse caste, se livrant aux par cupidit doit tre dpouill (des castes) occupations suprieures, par le roi de ses biens et exil sur-le-champ. 97. Mieux vaut (accomplir) ses propres incompltement fonctions celles d'autrui, car celui qui vit que bien remplir selon la loi d'une autre caste dchoit immdiatement de la sienne. 98. Un Vaisya qui ne peut vivre de ses propres fonctions en subsister des occupations d'un Soudra, peut au besoin vitant les actes prohibs, et il doit renoncer ( celles-ci) ds qu'il le peut. 99. Mais un Soudra de trouver du service auprs incapable des Dvidjas et menac (de voir) ses enfants et sa femme mourir manuels. (de faim), peut vivre des travaux 100. (Qu'il pratique) les mtiers manuels et les divers arts dont l'accomplissement rend (le'plus de) services auxDvidjas. 101. Un Brahmane les occuqui ne (veut pas) adopter 94. Des essences, rasa, ou liquides ou condiments . 95. De la caste suprieure, c'est--dire des Brahmanes. 100. Mtiers charpentiers, etc. ; arts peintre, etc. . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
319
et persvre dans (d'un Kchatriya ou) d'un Vaisya pations sa voie, bien que press par l'indigence et tourment (par la la rgle de conduite suivante : faim), peut pratiquer 102. Un Brahmane tomb dans la dtresse peut accepter de n'importe la loi, il n'est pas possible qui ; car d'aprs que ce qui est pur soit souill. 103. Enseigner des (gens) mprisables, offrir (le Vda) ou accepter n'est (pour eux) le sacrifice (d'eux des prsents) ; car ils sont (purs) comme pas une faute pour les Brahmanes l'eau et le feu. de mourir 104. Celui qui en danger des (de faim) accepte aliments de n'importe de pch qui, n'est pas plus souill que l'air par la fange. 105. Adjgarta press par la faim s'approcha pour tuer son fils et ne fut pas souill de pch, (car) il n'agissait (ainsi que) pour calmer sa faim. 106. Vmadva le juste et l'injuste, qui connaissait lorsque il voulut tourment de la viande de (par la faim) manger chien pour sauver sa vie, ne se souilla (d'aucun pch). 107. Bharadvdja, le rigide ascte, accepta du charpentier Bribou tait tourment vaches, plusieurs lorsqu'il par la faim avec ses fils dans une fort dserte. le juste et l'injuste, 108. Visvmitra qui connaissait tourment une cuisse de par la faim, s'approcha pour manger chien qu'il reut des mains d'un Tchndla. 102. Ce qui est pur. par exemple le Gange, etc. . (Kull.) 103. Les Brahmanes en dtresse . (Kull.) 105. Le sage Ajgarta vendit son fils unahepha pour un sacrifice. (Kull.) Cf. Aitareya Brhmana, VII, 13-16. 106. Vmadva, sage vdique auquel on attribue plusieurs hymnes ; dans l'un d'eux il dit : Press par un extrme besoin j'ai cuit les entrailles d'un chien . C'est ce passage que fait allusion Manou. 107. Bharadvja, sage auquel on attribue plusieurs hymnes vdiques, fils de Brhaspati et frre de Drona le prcepteur des Pndavas ; il est question de lui dans le Mahbhrata et leRmyana. 108. Vivmitra, sage clbre que ses austrits levrent de la condition de Kchatriya celle de Brahmane.
320 109. (Entre offrir ces
LES LOIS DE MANOU divers
(d'tres mpriactes), accepter (le (pour sables), eux) le sacrifice et (leur) enseigner est (ce qu'il y a de) plus Vda), l'acceptation (des prsents) bas de la part d'un Brahmane (et ce dont il est le plus) puni dans l'autre monde. 110. (Car) l'offrande du sacrifice et l'enseignement (du sont toujours faits pour (des gens) dont l'me a t Vda) tandis qu'un prsent s'accepte (parles sacrements), rgnre de la plus basse caste. mme d'un Soudra, (homme) 111. Par la prire et les oblations s'efface la faute commise ou en leur en offrant le sacrifice (pour des gens mprisables), encouru en acceptant (le Vda) ; mais (le pch) enseignant du prsent et les s'efface) par l'abandon (d'eux des prsents austrits. 112. Un Brahmane sans ressources peut glaner des pis et ramasser des grains de n'importe qui; pars (sur le champ) et ramasser car glaner vaut mieux qu'accepter des prsents, des grains pars est rput glaner. (plus louable).que sortis de noviciat doivent s'adresser 113. Des Brahmanes au souverain, sont dans la misre et qu'ils ont lorsqu'ils vil , ou (d'autres) articles besoin ; en) mtal (d'objets mais il ne faut pas s'adresser celui qui n'est pas dispos donner. 114. (Accepter un champ) inculte blmable (est moins un champ cultiv ; (parmi les objets suivants) qu'accepter) c'est aliments vache, chvre, brebis, or, grains, prpars, est moins le premier nomm (dont l'acceptation) toujours blmable au suivant). (par rapport 109. Puni, littr. blm . 110. Dont l'me a t rgnre, c'est--dire des Dvidjas . (Kull.) 112. Des prsents de gens non vertueux. (Kull.) 113. Sortis de noviciat, des Sntakas. Il ne faut pas s'adresser, littr. il doit tre quitt . Medh. et Govind. entendent par l il faut quitter le pays de ce prince, il ne faut pas y rester . Kull. ajoute : si le prince est connu pour tre un peu avare .
LES LOIS DE MANOU 115. Il y a sept moyens lgaux donation, achat, conqute, d'un travail et acceptation
321
hritage, excution vertueux. gages, domesarts manuels, travail 116. Enseignement, contentecommerce, ticit, garde des troupeaux, agriculture, ment (de peu), mendicit, (tels sont) les dix prt intrt, de subsistance. moyens ni un Kchatriya ne doivent 117. Ni un Brahmane, prter mais ils peuvent s'ils le veulent, dans un but pieux, intrt; un faible (taux). (moyennant) prter un grand pcheur 118. Un roi qui en temps de dtresse, prend mme le quart d'aucune n'est coupable faute, qu'il) (des rcoltes) (pourvu ses sujets dans la mesure de ses moyens. protge dans le combat, c'est de vaincre; 119. Sa fonction propre les Vaisyas qu'il ne tourne point le dos. Aprs avoir protg de son pe, il peut prlever l'impt lgal : 120. (A savoir) des Vaisyas le huitime comme taxe sur une les grains, le vingtime (sur l'or et le reste, jusqu' d'un krchpana. aux (Quant aux) Soudras, somme) minima artisans et aux manouvriers, (envers lui) qu'ils s'acquittent par leur travail. 115. Donation, lbha, trouvaille, etc., ou donation amicale . (Kull.) Les trois premiers moyens sont permis toutes les castes, le quatrime est permis au Kchatriya, le cinquime et le sixime au Vaisya, le septime au Brahmane. (Kull.) Excution d'un travail, karmayoga; c'est, suivant Kull., le labourage et le commerce. 116. Enseignement, vidy : ordinairement le mot dsigne l'enseignement du Vda; mais ici, suivant Kull., il s'agit d'autres sciences que del science sacre: la logique, l'exorcisme contre les poisons, etc. . Arts manuels l'criture, etc. . (Kull.). Moyens de subsistance en temps de dtresse . (Kull.) 117. Ni un Brahmane mme en dtresse . (Kull.) 118. Cf. VII, v. 130, o il est dit que le roi a droit au huitime, au sixime, ou au douzime des rcoltes, et au cinquantime des bnfices en troupeaux et en argent. 119. Les Vaisyas, pour dire le peuple en gnral. 120. Ce prcepte s'applique au cas de dtresse : en toute autre circons21
la richesse: d'acqurir intrt, placement des gens (de prsents)
322
LES LOIS DE MANOU
121. Mais un Soudra en qute de moyens d'existence peut servir un Kchatriya et mme gagner sa vie au service d'un riche Vaisya. 122. Mais il peut servir les Brahmanes soit en vue du ciel, soit en vue de l'une et l'autre (vie) ; car celui dont on dit d'un Brahmane atteint le but. qu'il est le serviteur 123. Le service des Brahmanes seul est rput l'occud'un Soudra ; car tout ce qu'il fait en par excellence pation dehors de cela est pour lui sans fruit. 124. Ceux-ci doivent lui assigner sur leur train de maison des moyens d'existence en rapport avec ses mrites, aprs de avoir examin ses capacits, son adresse et ses charges famille. 125. Ils doivent (lui) donner les restes de (leurs) aliments, des grains et les vieux vieux le rebut vtements, (leurs) meubles. 126. Pour un Soudra il n'y a point (de pch entranant) la dchance, l'initiation et il n'est point apte recevoir ; il n'est des devoirs point qualifi pour (l'accomplissement) cerreligieux, (mais) il ne lui est pas dfendu (d'accomplir et autres). (tels que lepkayadjna tains) devoirs 127. (Les Soudras) dsireux des mrites (d'acqurir) spirila conduite tuels, et connaissant (leurs) devoirs, (qui) imitent tance le roi doit s'en tenir la rgle donne au livre VII, v. 130. Le huitime des grains ou mme le quart , comme il est dit au v. 118. 121. Un Soudra qui ne trouve pas d'emploi auprs d'un Brahmane . Kull.) Au service d'un Vaisya dfaut d'un Kchatriya . IKull.) 122. L'une et l'autre vie en vue du ciel et en vue de gagner sa subsistance . (Kull.) B. H. entend littr. celui par qui le mot Brahman est sans cesse prononc (produit, jta) . Le but, c'est--dire la flicit suprme, la dlivrance finale. 126. Pour un Soudra qui mange de l'ail et autres choses (prohibes) . (Kull.) Pch entranant la dchance, ptaka. Les devoirs religieux tels que l'agnihotra et autres . (Kull.) Le pkayajna littr. sacrifice cuit dsigne certains rites domestiques trs simples. 127. Dsireux d'acqurir des mrites spirituels ou simplement d'accomplir leur devoir . La conduite des gens vertueux des trois castes. (Kull.) Suivant Yjnavalkya ils n'encourent pas de pch en accomplis-
LES LOIS DE MANOU des
323
tout en vitant les textes gens vertueux, (de rciter) des loges. sacrs, ne pchent pas et obtiennent 128. Plus un (Soudra) la conduite imite, sans murmurer, des gens vertueux, il gagne en ce plus (de bndictions) monde et dans l'autre, sans s'exposer au blme. 129. Un Soudra, mme s'il le peut, ne doit pas amasser de car un Soudra fait tort aux Brahrichesses, qui s'enrichit manes. 130. Ainsi ont t exposs les devoirs des quatre castes, en temps de dtresse ; ceux qui les observent exactement, arrivent au chemin (de la flicit) suprme. 131. Voil, en entier, la rgle du devoir des expose Je vais maintenant castes. dclarer la rgle quatre pure les expiations. concernant
sant les cinq sacrifices et autres, condition de s'abstenir (de la rcitation) des mantras, sauf le mantra de l'adoration. (Kull.) 128. La conduite des gens vertueux des Dvidjas dans les actes qui ne sont pas dfendus . (Kull.) 129. Fait tort aux Brahmanes parce qu'il s'enorgueillit de ses richesses et refuse de les servir . (Kull.)
LIVRE Pnitences
ONZIME et Expiations.
celui qui veut accomplir qui dsire une postrit, un sacrifice, celui qui voyage, celui qui a donn tous ses celui qui mendie biens, celui qui mendie pour son prcepteur, celui qui mendie pour son pre et sa mre, pour faire ses tudes, celui qui est malade, 2. Ces neuf Brahmanes doivent tre considrs comme ces mendiant la loi sacre; Sntakas, pour (accomplir) on doit faire des prsents en proportion de leur indigents savoir. 3. A ces meilleurs d'entre les Dvidjas on doit donner des aliments avec des prsents du sacri(en dedans de l'enceinte il est recommand de donner des aliments fice) ; aux autres, en dehors de l'enceinte du sacrifice. 4. Mais un roi doit distribuer il convient comme toutes titre d'honoet des prsents (sortes) de pierres prcieuses dans les Vdas. raires du sacrifice aux Brahmanes instruits 5. Quand (unhomme) dj mari prend une seconde femme, et qu'il a demand le seul fruit (de l'argent pour se marier), 1. Celui qui dsire une postrit, c'est--dire celui qui veut se marier. Donn tous ses biens qui a donn son avoir comme honoraires (dakshin) du sacrifice un sacrifice dit vivajit (qui conquiert tout) . (Kull.) 2. On peut construire aussi : Ces neuf Brahmanes Sntakas doivent tre considrs comme mendiant par des raisons vertueuses. Des dons tels que des vaches, de l'or, etc. . (Kull.) 3. De l'argent pour se marier, pour couvrir les frais du mariage, pour payer le prix nuptial ; on a vu ailleurs que le mariage est un achat dguis de la future.
1. Celui
326
LES LOIS DE MANOU
est le plaisir sexuel ; les enfants (qu'il retire de ce mariage) celui qui a donn l'argent. (appartiennent) distribue des prsents 6. Que chacun selon ses moyens instruits dans le Vda et dtachs aux Brahmanes (des choses de la terre ; par l) on gagne le ciel aprs la mort. 7. Celui des aliments en suffisance pour qui possde trois ans et mme nourrir qui plus les personnes pendant sont sa charge, est digne de boire le soma. ce (chiffre) et 8. Mais le Dvidja dont l'avoir est infrieur qui boit le soma, n'en retire aucun fruit, quand mme il aurait dj bu le soma prcdemment. tandis que 9. Un homme riche qui donne des trangers de vertu ; famille est dans la gne, est un hypocrite sa propre se tournera en poison pour le miel qu'il aura savour d'abord lui. fait pour assurer son bonheur futur 10. Ce qu'un homme dans sa dpendance, tourne au dtriment des personnes mal pour lui en cette vie et aprs la mort. offert (par un Dvidja et) surtout 11. Lorsqu'un sacrifice est interrompu (faute) d'un objet, (dans un par un Brahmane lieu o) rgne un roi juste, la russite du sacrifice, 12. Pour assurer (le sacrificateur) cet objet dans la maison d'un Vaisya peut prendre qui (bien 6. Dtachs des choses de la terre, ou qui vivent seuls, qui ont quitt enfants, femme, etc. . (Kull.) 7. Boire le soma, il a le droit d'accomplir le sacrifice du soma, dans le but d'assurer l'accomplissement de ses dsirs . (Kull.) 8. Prcdemment, au sacrifice annuel (nitya oppos kmya), qui est indiqu au livre IV, 26. 9. Qui donne par ostentation . Le miel de la rputation se tourne pour lui en poison en enfer . 10..Aurdhvadehikam : B. H. traduit : Si quelqu'un accomplit des rites funraires. 11. Faute d'un objet, littr. faute d'un membre . Un roi juste, car celui-ci ne punira pas une personne qui se conforme aux prescriptions des livres . (Kull.) 12. Prendre par force ou par ruse . (Kull.) Les sacrifices le Pkayajna et autres . (Kull.) Ne boit par le soma. Cf., v. 7, 8, note.
LES LOIS DE MANOU
327
ne fait pas de sacrifices et ne boit que) riche en troupeaux, pas le soma. 13. Ou bien, s'il le veut, qu'il prenne deux ou trois (objets ncessaires au sacrifice) dans la maison d'un Soudra ; car un Soudra n'a rien faire avec le sacrifice. 14. (Si un homme) possdant cent vaches n'allume pas le feu (sacr, si un homme) mille vaches n'offre possdant pas le sacrifice n'hsite (du soma), que le (sacrificateur) pas dans leur maison (les objets ncessaires). prendre 15. Il peut (aussi) les prendre ( un Brahmane) qui toujours reoit et jamais ne donne, si ce dernier ne veut pas (les) accorder (de bon gr) ; par l, sa gloire s'tend et ses mrites croissent. spirituels 16. De mme (le Brahmane) dont la rgle est de n'avoir pas de provisions pour le lendemain, quand il n'a pas mang six repas, peut au septime pendant prendre (des aliments) un (homme) qui nglige ses devoirs. 17. Qu'il les prenne soit dans la grange, soit dans le champ, soit dans la maison, o ; mais qu'il confesse la n'importe chose au (propritaire) si celui-ci l'interroge. 18. Un Kchatriya ne doit en aucun cas prendre ce qui 13. Ou bien s'il ne peut les prendre chez un Vaisya . (Kull.) Un Soudra n'a rien faire avec le sacrifice : ou bien comme traduit B. H. quand on accomplit les sacrifices, un Soudra n'a aucun droit de possession . Kull. ajoute : Comme il est interdit un Brahmane de demander un Soudra un objet pour le sacrifice, il doit le lui prendre de force. Cette interdiction est formule plus loin au vers 24. 15. Les prendre par force ou par ruse . (Kull.) A un Brahmane : quelques commentateurs l'entendent de toutes les castes. 16. Six repas trois jours . Au septime le matin du quatrime jour . Qui nglige ses devoirs : tels que la libralit et autres . (Kull.) Hnakarman signifie littr. quinglige les crmonies, les oeuvres. On peut encore entendre ce vers diffremment : au lieu de dont la rgle est de n'avoir pas de provisions pour le lendemain , on peut traduire il peut prendre des aliments...., mais sans toutefois faire une provision pour le lendemain . 18. De mme un Vaisya ou un Soudra ne doivent pas prendre ce qui est un Kchatriya, qui est leur suprieur par la caste. (Kull.)
328
LES LOIS DE MANOU
il a un Brahmane ; mais s'il est dans le besoin, appartient ce qui appartient un Dasyou, ou quelle droit d'enlever . qu'un qui nglige les sacrifices. 19. Celui qui prend les biens des mchants pour les donfait de lui-mme un bateau et transner aux gens vertueux, porte les uns et les autres. est 20. Le bien de ceux qui sont zls pour les sacrifices des dieux ; mais la riappel par les sages le patrimoine chesse de ceux qui ne sacrifient point est dite le patrimoine des dmons. 21. Un prince juste ne doit point infliger de chtiment ce dont il a besoin celui (qui-, par force ou par ruse, prend prcdemment noncs) ; car c'est par la pour les besoins folie du Kchatriya souffre la faim. que le Brahmane 22. Aprs s'tre enquis des charges de famille de celui-ci et avoir examin sa science et sa conduite, que le souverain d'existence la loi (prlui assigne des moyens conformes train de maison. levs) sur son propre 23. Lui ayant des moyens d'existence, assign qu'il le envers et contre tous; car il obtient la sixime partie protge des mrites de celui qu'il protge ainsi. 24. Un Brahmane ne doit jamais demander un Soudra un objet en vue du sacrifice; car le sacrificateur qui fait une telle demande renat ( un Soudra) aprs la mort comme Tchndla. 25. Un Brahmane un objet en vue du saqui a demand decrifice, et qui ne l'emploie pas tout ( ce pieux usage), vient pour cent ans (aprs sa mort) un oiseau de proie ou une corneille. 19. Les uns et les autres celui auquel il te en le dlivrant du pch (d'avarice), et celui auquel il donne en le tirant du dnuement . (Kull.) 21. Du Kchatriya, c'est--dire du roi : le roi ne devrait pas laisser les Brahmanes dans le besoin. 22. Conformes la loi ou simplement convenables, rguliers . 25. Un oiseau de proie, un bhsa, peut-tre un vautour.
LES LOIS DE MANOU
329
attente la proprit des 26. Le pervers qui par cupidit dieux et des Brahmanes vivra dans l'autre monde des restes des vautours. 27. Au bout de l'an on doit toujours offrir le sacrifice titre d'expiation des (sacriVaisvnar, pour l'omission du soma. d'animaux et des crmonies fices) prescrits 28. Mais un Dvidja qui sans (tre en) dtresse accomplit les devoirs religieux suivant les rgles. (prescrites pour les n'en tire aucun profit dans l'autre monde : temps) de dtresse, telle est la dcision. 29. Les Visve-Devas, les Sdhyas et les grands Sages (de la caste) brahmanique, craignant pour leur vie dans des la place crrent une rgle substitue (temps) de dtresse, de la rgle (primitive). 30. Aucune dans l'autre n'est rsermonde rcompense ve au pervers qui pouvant la rgle primi(se conformer) tive, agit d'aprs la rgle secondaire. 31. Un Brahmane instruit de la loi ne doit porter devant le roi aucune (plainte) ; son propre lui suffit pour pouvoir chtier ceux qui lui font du mal. 32. Son propre pouvoir est suprieur au pouvoir du roi ; donc le Brahmane doit (se servir) de son seul pouvoir pour punir ses ennemis. 33. Qu'il n'hsite pas employer les textes de l'AtharvaVda et ceux d'Anguiras du Brah; car la parole est l'arme ses ennemis. mane, avec laquelle il peut anantir 26. Dans l'autre monde, c'est--dire dans une autre naissance . (Kull.) Je ne vois pas bien quel est l'animal dsign ici comme vivant des restes des vautours. 27. Il s'agit ici d'omission involontaire. 32. Son pouvoir ne dpend que de lui, le pouvoir du roi dpend des autres. (Kull.) 33. Les textes, c'est--dire les prires magiques, les charmes, les incantations. Je traduis Atharva-Vda cause du commentaire ; mais comme le quatrime Vda n'est nomm nulle part dans Manou, il faut peut-tre prendre Atharvan comme le nom du sage : Atharvan est le fils an de
330
LES LOIS DE MANOU
34. Un Kchatriya doit triompher du malheur par la force de son bras, un Vaisya et un Soudra au moyen de leurs riet des oblations au feu. chesses, un Brahmane par des prires 35. Le Brahmane est appel le crateur, le punisseur, le le bienfaiteur ; on ne doit rien lui dire qui soit prcepteur, de mauvais ni employer de termes augure, ( son gard) grossiers. 36. Ni une jeune fille, ni une jeune femme, ni un (homme) de peu de science, ni un insens ne peuvent offrir le (sacrinon plus qu'un malade ou une (personne) fice) Agnihotra, non initie. 37. Car lorsque de telles offrent l'oblation, (personnes) elles tombent en enfer, ainsi que celui pour qui (elle est du sacrifice le prtre doit tre (un offerte) ; c'est pourquoi la disposition vers dans les (rites) relatifs des homme) du Vda. trois feux sacrs, et ayant une connaissance parfaite riche qui n'offre pas comme honoraires 38. Un Brahmane (la crmonie un cheval consacr Pradde) l'Agnydhya jpati, devient (l'gal) de celui qui n'a pas allum le feu sacr. 39. Un homme qui a la foi, et dont les sens sont dompts, d'autres doit accomplir (actes) pieux; mais il ne doit en auo les honoraires du prtre sont cun cas offrir des sacrifices insuffisants. du prtre sont insuffi40. Un sacrifice o les honoraires Brahm et l'auteur prsum du recueil qui porte son nom. Angiras est un autre sage auquel on attribue plusieurs hymnes vdiques. 34. Un Brahmane, littr. le meilleur des Dvidjas. 35. Kull. construit autrement : celui qui..., etc., est appel bon droit un Brahmane . Par vidhtar, crateur, il entend celui qui accomplit les rites sacrs . Le punisseur celui qui punit propos son fils ou son lve . Bienfaiteur de toutes les cratures . (Kull.) 36. Une jeune femme marie ou non marie . Offrir le sacrifice : littr. tre le hotar. 37. Les rites Vaitna. 38. L'Agnydhya, littr. l'action d'allumer le -feu sacr. 40. La renomme et la rputation : suivant Kull, yaas est la rputation pendant la vie, et krti la rputation aprs la mort.
LES LOIS DE MANOU
331
et le (bonheur sants dtruit les organes des sens, la renomme, la rputation, la postrit, le btail au) ciel, la longvit, ne (de celui qui l'offre) ; aussi un homme de peu de fortune doit-il point offrir de sacrifice. 41. Un Brahmane entretenant l'Agnihotra, qui nglige luvolontairement le feu sacr, doit accomplir la pnitence un mois, car cette (faute) est gale au meurtre naire durant d'un fils. d'un Soudra c42. Ceux qui aprs avoir reu de l'argent les prtres un Agnihotra, sont (considrs lbrent comme) dans les Vdas. des Soudras, et blms des gens instruits 43. Mettant le pied sur la tte de ces insenss, qui hod'un Soudra, le donorent le feu sacr (allum avec l'argent) les infortunes nateur monde). (dans l'autre (seul) traversera ou qui ac44. Un homme qui nglige un acte prescrit, ou qui est attach aux objets des complit un (acte) blm, sens, doit faire une pnitence. 45. Les sages prescrivent la pnitence pour les fautes commises involontairement sur la foi ; (mais) quelques-uns, des textes rvls, dclarent mme (la pnitence applicable) aux (fautes) intentionnelles. 46. Une faute commise involontairement est expie par la lecture du Vda, mais (une faute) par dqu'un (homme) commet mence volontairement (est expie) par diverses sortes de pnitences. 47. Un Dvidja qui soit par fatalit, soit pour (une action) commise est oblig de faire une p(dans une vie) antrieure, ne doit avoir aucun contact avec les gens vertueux nitence, avant que sa pnitence ne soit accomplie. 41. La pnitence lunaire, cf. XI, 217. Nglige matin et soir . (Kull.) 43. Satatam, littr. perptuellement, est comment par paraloke dans l'autre monde. Le donateur le Soudra . (Kull.) 46. Par dmence : dans l'garement de la passion ou de la haine . (Kull.) 47. Fatalit daivt, c'est--dire par inadvertance . (Kull.). Les actions commises dans une oie antrieure : certaines maladies, notamment la
332
LES LOIS DE MANOU
48. Il y a des mchants une dformaqui subissent ici - bas, tion corporelle de crimes commis (en punition) commis d'autres de crimes (en punition) (dans une vie) antrieure. 49. Celui qui vole l'or (d'un Brahmane) bual'onychie,le veur d'eau-de-vie a les dents noires, le meurtrier d'un Brahmane la phtisie, celui qui viole la couche d'un matre spirituel une maladie de peau. 50. Un calomniateur un dnonciateur a l'ozne, une en mauvaise un voleur de grains a un membre haleine, un moins, un falsificateur (de grains et autres marchandises) membre en trop. 51. Un voleur d'aliments un voleur de la (a) la dyspepsie, un voleur de vte(sainte) parole (est frapp de) mutisme, ments (a) la lpre blanche, un voleur de chevaux est boiteux. celui qui 52. Le voleur d'une devient lampe aveugle, l'teint devient borgne ; le mal (fait aux cra(mchamment) tures est puni de) maladie (tandis gnrale, qu'en) ne leur faisant aucun mal on est exempt de maladies. 53. Ainsi, suivant la diffrence de leurs actions, naissent des (tres) mpriss (tels que) crpar les (gens) vertueux tins, muets, aveugles, sourds, estropis. 54. C'est pourquoi il convient les pd'accomplir toujours en vue de la purification nitences ; car ceux dont les fautes n'ont pas t expies, renaissent avec des marques dshonorantes. phtisie et la lpre, sont considres comme la punition d'actes commis antrieurement. 49. Une maladie de peau : suivant Kull. le gland dpourvu de prpuce . 51. Un voleur de la sainte parole, celui qui tudie le Vda sans en avoir reu l'autorisation . (Kull.) 52. Ce vers est rejet par certains commentateurs. La fin du vers est lue diffremment par Kull. sphto'nyastryabhimarshakah, l'adultre a de l'oedme . 53. De leurs actions dans une existence antrieure . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 55.
333
des liqueurs Le meurtre d'un Brahmane, l'usage ainsi avec la femme d'un le vol, l'adultre fortes, gourou, ces actes) sont de ceux (qui commettent que la frquentation dclars des pchs mortels. une cafaussement un haut rang, porter 56. S'attribuer un matre lomnie devant le roi, accuser faussement spirituel, au meurtre d'un Brahmane. (est un pch) quivalent au Vda, le faux tmoidu Vda, 57. L'oubli l'outrage d'un ami, l'usage des aliments dfendus gnage, le meurtre ou (de mets) impropres tre mangs, ces six (actes) sont l'usage des liqueurs fortes. quivalents d'ar58. Le vol d'un dpt, d'une personne, d'un cheval, de diamants et de perles est dclar quigent, de terrain, valent un vol d'or. avec des 59. La fornication avec des soeurs utrines, avec de la plus basse (caste), jeunes filles ou des femmes comme d'un ami ou celle d'un fils est considre l'pouse la souillure du lit d'un gourou. quivalente 60. Tuer une vache, sacrifier inpour (des personnes) se du sacrifice, entretenir des relations adultres, dignes vendre soi-mme abandonner son prcep(comme esclave), l'tude teur, son pre, sa mre, son fils, dlaisser (du Vda) et (l'entretien du) feu sacr, 61. Laisser son plus jeune frre se marier le premier, se marier avant un frre an, donner sa fille ( une personne qui est dans) l'un de ces deux (cas), ou sacrifier pour cette (personne), 62. Dshonorer une vierge, (faire) l'usure, enfreindre un 55. Rptition du v. 235, IX. Le vol de l'or d'un Brahmane . (Kull.). Ce dernier restreint l'expression surpnam en disant les liqueurs dfendues . Guru ici est pris dans le sens le plus large. 57. Impropres tre mangs de l'ordure, etc. . (Kull.) 61. Dans l'un de ces deux cas, c'est--dire soit au frre an qui laisse son plus jeune frre se marier avant lui, soit au frre cadet qui se marie avant son an. 62. Un voeu, le voeu de chastet du novice . (Kull.)
334
LES LOIS DE MANOU
sa femme ou voeu, vendre un tang, un jardin de plaisance, son enfant, 63. tre un excommuni, abandonner un parent, enseid'un pour un salaire, gner (le Vda) apprendre (le Vda) vendre des articles dont la vente est salari, prcepteur prohibe, 64. Surveiller toutes (sortes de) mines, excuter les grands de construction, travaux dtruire les plantes (mdicinales), vivre (de la prostitution) de sa femme, la sorcel(pratiquer) lerie et les incantations au moyen de racines, 65. Abattre des arbres encore verts pour (en faire) du con> des crmonies bustible, accomplir pour soi seul, manger des aliments prohibs, 66. Ne pas entretenir le feu (sacr, commettre) un vol, ne pas payer ses dettes, lire de mauvais livres, exercer le mtier de danseur et de chanteur, 67. Voler des grains, des mtaux avoir vils, du btail, avec une femme adonne aux liqueurs commerce fortes, tuer une femme, un Soudra, un Vaisya, un Kchatriya, tre athe: (ce sont l) les pchs secondaires. 68. Faire du mal un Brahmane, ce qui ne doit respirer ou des liqueurs fortes, tricher, pas tre respir (commettre un acte de) pdrastie : (tous ces actes) sont considrs comme la perte de la caste. entranant 63. Excommuni, un Vrty exclu del Svitr, cf. X, 20. 65. Des crmonies pour soi seul, cuire pour soi seul . (Kull.) Aliments prohibs manger de l'ail, etc., une fois et sans intention . (Kull.) 66. Un vol : le vol d'un objet prcieux autre que l'or . (Kull.) Ses dettes : les trois dettes aux Dieux, aux Mnes, aux hommes . (Kull.) Par mauvais livres il faut entendre des livres en contradiction avec la ruti et la Smrti . (Kull.) 67. Tuer une femme sans prmditation . (Kull.) Athe: nstika signifie littr. celui qui dit : Il n'y a pas (de vie future). 68. Faire du mal un Brahmane avec un bton ou avec la main . (Kull.) Ce qui ne doit pas tre respir par suite de sa mauvaise odeur, tel que l'ail, l'ordure, etc. . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU 69. Tuer
335
un un chameau, un daim, un ne, un cheval, ainsi qu'un un une brebis, une chvre, poisson, lphant, comme un buffle : (ces actes) doivent tre considrs serpent, au mme niveau le coupable faisant (descendre que) le m^ lange des castes. des cadeaux de gens trs mprisables, 70. Accepter (faire) : (ces un Soudra et dire un mensonge le commerce, servir de recomme rendant actes) doivent tre considrs indigne cevoir des prsents. des oiseaux, ce 71. Tuer des vers, des insectes, manger avec des liqueurs fortes, voler des fruits, qui a t en contact du bois, des fleurs, de courage : (ce sont des pchs manquer une souillure. qui) causent 72. Apprenez maintenant exactement les diffrentes pni^ tences par lesquelles on efface chacun des divers pchs qui d'tre numrs. viennent 73. Pour se purifier, le meurtrier d'un Brahmane doit bdans la fort et y habiter douze ans, vivant tir une hutte d'aumnes et prenant une tte de mort pour tendard; 74. Ou bien il peut comme de son plein gr (s'exposer) cible (aux traits) de guerriers instruits ou (de son dessein), se jeter trois fois la tte la premire dans un feu allum ; 75. Ou bien il peut offrir le sacrifice du cheval (ou d'autres 70. Accepter des cadeaux de gens mprisables, c'est--dire de ceux qui sont numrs au livre IV, v. 84. Indigne de recevoir des prsents, o peut-tre, dans un sens plus gnral, indigne . 73. Suivant Kull. cette prescription concerne un Brahmane qui a tu un autre Brahmane sans le vouloir. Pour un Kchatriya le terme est doubl, pour un Vaisya tripl, pour un Soudra quadrupl . (Kull.) 74. Ou bien : si c'est un Kchatriya dpourvu de vertu qui a tu volontairement un Brahmane instruit dans les quatre Vdas, et vertueux. (Kull.) Instruits de son dessein, c'est--dire qui savent qu'il veut se faire tuer exprs. On pourrait aussi comprendre des archers habiles . Trois fois, c'est--dire jusqu' ce que mort s'ensuive . (Kull.) Dans le cas o le meurtrier involontaire tait dou de qualits, et sa victime dpourvue d qualits, il pourra choisir la peine plus lgre fixe au vers suivant. 75. Cette prescription concerne les Dvidjas en cas de meurtre non prmdit . (Kull.) Ces divers noms de sacrifices signifient: Svarjit = le vain-
336
LES LOIS DE MANOU
tels que) le Svardjit, le Gosava, le Visvadjit, le l'Abhidjit, Trivrit ou l'Agnichtout; 76. Ou bien pour expier le meurtre d'un Brahmane, il devra marcher cent yodjanas, rcitant un des Vdas, mangeant ses sens ; peu et domptant 77. Ou bien il peut offrir tout son avoir un Brahmane instruit dans les Vdas, ou assez de bien pour subsister, ou une maison avec son mobilier ; 78. Ou bien se nourrissant de graines (seulement) qu'on offre dans les sacrifices, Sarasvat en qu'il suive la rivire allant contre le courant sa nourriture, ; ou bien rduisant du Vda. qu'il rcite trois fois la Sanhit 79. Ayant ras (ses cheveux) sur la lisire du qu'il habite ou ou dans un ermitage, village ou dans un parc vaches, au pied d'un arbre, mettant son plaisir faire du bien aux Brahmanes et aux vaches. ou 80. Qu'il sacrifie sans hsiter sa vie pour un Brahmane une vache, (car) le sauveur d'une vache ou d'un Brahmane est absous du meurtre d'un Brahmane. 81. Il est (aussi) absous, lorsqu'il combat au moins trois fois (pour dfendre ou qu'il reles biens) d'un Brahmane, ou qu'il perd la vie couvre tous les biens d'un Brahmane, pour ce motif. queur du ciel,Gosava =sacrifice de la vache, Abhijit = le victorieux, Vivajit := l'omni-vainqueur, Trivrt = le triple, Agnishtut = la louange du feu. 76. Ou bien en cas de meurtre non prmdit commis par un Dvidja sur un Brahmane qui n'est Brahmane que par la naissance (c'est--dire qui ne remplit pas ses devoirs) . (Kull.) 100 yojanas environ 400 kilom. 77. Ou bien au cas o le meurtrier involontaire est un riche Brahmane, et o le Brahmane tu n'tait Brahmane que par la caste . (Kull.) 78. Samhit signifie proprement un texte arrang d'aprs les rgles grammaticales de la combinaison des lettres (sandhi). 79. Suivant Kull., ce vers permet celui qui a encouru la pnitence de douze annes, au lieu de se retirer dans la fort, d'habiter sur la lisire du village. 80. B. construit diffremment : celui qui sans hsitation sacrifie sa vie pour un Brahmane ou une vache est absous du meurtre d'un Brahmane, et aussi celui qui sauve la vie d'une vache ou d'un Brahmane .
LES LOIS DE MANOU
337
82. (Celui qui est) ainsi fidle son voeu (d'austrit), chaste et recueilli, au bout de douze ans a expi le meurtre d'un Brahmane. 83. Ou bien il est (encore) absous aprs avoir confess son crime dans une assemble des dieux de la terre et des dieux des hommes un sacrifice du cheval, et avoir pris (runis) le bain de purification. (avec les Brahmanes) 84. Le Brahmane (est dit) la racine de la loi, le Kchatriya celui qui confesse sa (en) est dit le sommet ; voil pourquoi faute devant une assemble de telles (gens) est purifi-. 85. En vertu de son origine mme le Brahmane est une divinit mme et il est une autorit pour les dieux, pour est le fonde(les hommes en) ce monde ; car le Vda mme ment de cette (autorit). 86. Que trois seulement de ces (Brahmanes) instruits dans les Vdas proclament l'expiation pour les fautes, cela (suffit) purifier les (pcheurs) des hommes instruits ; car la parole (sert de) purification. 87. Un Brahmane dans le recueillement l'une qui pratique de ces rgles (de purification) est absous du crime quelconque en tuant un Brahmane, qu'il a commis par l'empire (qu'il sur lui-mme. prend) 88. Pour avoir dtruit le foetus (d'un Brahmane dont le sexe tait) inconnu, ou un Kchatriya, ou un Vaisya en train de sacrifier, ou une femme ayant ses rgles, qu'il accomplisse la mme pnitence. 89. De mme pour avoir donn un faux tmoignage, pour avoir injuri son prcepteur, vol un dpt, caus la mort d'une femme ou d'un ami. 83. Les dieux de la terre les Brahmanes comme prtres sacrifiants . Les dieux des hommes les Kchatriyas comme organisateurs du sacrifice . (Kull.) Le sacrifice du cheval, l'Avamedha. Cette prescription s'applique au cas d'un Brahmane vertueux qui tue sans prmditation un autre Brahmane dpourvu de mrite . (Kull. citant l'autorit du Bhavishyapurna.) 89. Un faux tmoignage dans un procs propos d'or ou de terrain . (Kull.) La femme d'un Brahmane qui entretient le feu sacr . (Kull.)
338
LES LOIS DE MANOU
involon90. Telle est l'expiation impose pour le meurtre d'un Brahtaire d'un Brahmane volontaire ; pour le meurtre mane, il n'y a point de pnitence prescrite. 91. Un Dvidja de boire de la (liqueur) qui a eu la dmence boire (cette bouillante; sour, devra mme) liqueur quand il est absous de son son corps est chaud par ce (breuvage) pch ; ou de vache bouillante, 92. Ou bien qu'il boive de l'urine ou du purin ( la de l'eau, ou du lait, ou du beurre clarifi, ce que mort (s'ensuive) mme temprature) ; jusqu' d'avoir bu de (la li93. Ou bien pour expier (le pch) une fois une anne, sour, qu'il mange pendant queur) d'huile, qu'il (de riz), ou un gteau chaque nuit, des grains natts et un emblme une haire, (de (les cheveux) porte de liqueurs). marchand et le du grain, est une corruption 94. Car l'eau-de-vie une corruption est appel ; voil pourquoi (aussi) pch boire ne doivent point Brahmanes, Vaisyas Kchatriyas, d'eau-de-vie. 95. Sachez qu'il y a trois sortes d'eaux-de-vie, (l'eau-de-vie) tire de farine de riz, et celle qu'on de sucre, (l'eau-de-vie) et en particulier madhoka ; chacune (des fleurs de l'arbre) aux Brahmanes. sont interdites toutes en gnral 90. Il n'y a point de pnitence prescrite, c'est--dire le crime est trop grand pour pouvoir tre expi par une pnitence. Pourtant Kull. interprte ainsi ce prcepte : Cette purification (celle de douze annes indique au v. 73) doit tre double. 91. De boire volontairement . (Kull.) La contradiction entre moht par garement du texte, et l'explication du commentaire volontairement , n'est qu'apparente ; par garement ne veut pas dire ici inconsciemment ,mais par passion : la passion gare sans cesser d'tre volontaire. 93. Cette pnitence relativement plus douce est suivant l'opinion de Kull. pour le cas o l'on a bu involontairement de la liqueur. 94. Mala signifie souillure, immondice, au propre et au figur : par mala l'auteur entend, je pense, la fermentation du grain. 95. La premire gaud est le rhum, la deuxime paisht est l'arak, la troisime mdhvi est tire des fleurs de la Bassia latifolia. Aux Brahmanes :
LES LOIS DE MANOU 96.
339
les viandes (prohibes, (Toutes les autres) eaux-de-vie, la nourriture des Yakchas, forment la liqueur) soursava, le Brahdes Dmons et des Vampires ; il doit s'en abstenir, consacres aux dieux. mane qui mange les oblations dans hbt 97. Un Brahmane par l'ivresse peut tomber ou rciter (de travers) un (passage du) Vda, une immondice, acte inconvenant. ou commettre quelque 98. Si le Brahme dans son corps est une fois qui rside et sa qualit de Brahmane l'abandonne, noy dans l'alcool, il descend au rang de Soudra. 99. Ainsi vous ont t expliques les diverses expiations bu de l'eau-de-vie; (du crime) d'avoir je vais maintenant dire (quelles sont) les pnitences (infliges) pour avoir vol de l'or. 100. Un Brahmane qui a commis un vol d'or, doit se prsenter au roi et confesser son mfait en disant : Sire, pu nissez-moi! 101. Que le roi prenant une massue l'en frappe lui-mme une fois ; le voleur est purifi par ce coup ; ou bien un Brahmane rien que par des austrits. peut se purifier 102. Or le Dvidja la qui dsire effacer par des austrit l'arak est dfendu aux trois classes de Dvidjas, comme la plus pernicieuse de toutes ; les deux autres sont dfendues seulement aux Brahmanes . (Kull.) 96. Toutes les autres eaux-de-vie : en dehors du rhum, de l'arak et de la liqueur mdhv, il y en a neuf sortes . (Kull. citant Pulastya.) Avec le sursava cela fait donc treize sortes de liqueurs enivrantes. Les Yakshas sont des demi-dieux de la suite de Kuvera, le gardien des richesses. 98. Le Brahme : Brahman signifie la fois l'tre suprme et le Vda. 99. Vol de l'or un Brahmane . (Kull.) Cette restriction a t faite dj plusieurs fois. 100. Vers peu prs identique au v. 314, livre VIII. Seulement ici le voleur dsign est un Brahmane ; peut-tre comme le remarque Kull. Manou a-t-il mis un Brahmane exempli gratia, pour dsigner un homme en gnral, un Kchatriya ou un autre. 101. Prenant une massue, que le coupable porte sur son paule , comme au v. 315 du livre VIII. Est purifi par le coup, qu'il meure, ou qu'il en rchappe . (Kull.) 102. Sur la pnitence prescrite pour le meurtre d'un Brahmane, cf. XI, 73 sqq.
340
LES LOIS DE MANOU
la pnisouillure contracte en volant de l'or, doit accomplir d'un Brahmane, vtu de tence (prescrite) pour le meurtre dans les forts. vtements d'corce et (habitant) un Brahmane 103. Telles sont les pnitences par lesquelles (de l'or) ; voici peut effacer le pch qu'il a commis en volant il peut expier le crime maintenant pnitences par quelles d'adultre avec la femme d'un gourou. d'un gourou confessera 104. Celui qui a souill la couche son crime, et se couchera sur un (lit) de fer rougi, ou emun tuyau brassera (de mtal) incandescent; par sa mort il sera purifi. 105. Ou bien il se coupera la verge et les testilui-mme dans le creux de ses mains, il se dirigera cules, et les portant vers la rgion du Sud-Ouest, en marchant tout droit devant lui jusqu' ce qu'il tombe (mort). 106. Oubien tenant une massue en forme de pied de lit, vtu d'(habits la barbe dans en) corce, (habitant) longue, une fort dserte, un an, dans le qu'il accomplisse pendant la pnitence recueillement, (dite) de Pradjpati. 107. Ou bien, domptant trois ses sens, qu'il accomplisse de (riz mois durant la pnitence lunaire, (se nourrissant) aux oblations, et de bouillie pour sauvage) propre d'orge, effacer (le pch qu'il a commis la couche d'un en souillant) gourou. 103. Guru, ici au sens le plus large, le pre naturel ou le pre spirituel. 104. Qui a souill en connaissance de cause ajoute le commentaire de Kull. ; il semble d'ailleurs difficile qu'un crime de cette nature puisse tre L'pouse de mme caste . Un commis non intentionnellement. tuyau : suivant Kull. v l'image en fer d'une femme . 105. La rgion du Sud-Ouest : la rgion du Nirrti (gnie de la destruction) . 106. Suivant Kull. ce prcepte s'applique au cas o l'inceste est le rsultat d'une mprise . La pnitence de dite Prajpati est indique plus loin v. 212. 107. Ou bien dans le cas o l'pouse du guru n'tait ni vertueuse, ni de mme caste . (Kull.) De l une pnitence plus douce. Pnitence lunaire, cf. plus loin v. 217.
LES LOIS DE MANOU 108. commis
341
Telles sont les pnitences ceux qui ont par lesquelles des pchs mortels effacer leur souillure; peuvent des pchs secondaires, quant ceux qui ont commis (ils se suivantes : purifieront) par les diverses pnitences 109. Celui qui a commis un pch secondaire en tuant une vache, boira pendant un mois (de la bouillie) d'orge ; il habitera s'tant ras et couvert de la peau de sa (victime), dans un parc vaches. ses 110. Dans les deux mois (suivants), il devra, domptant sans sens, (ne) manger (qu'au) quatrime repas (des aliments) dans l'urine de vache. sel et en petite et se baigner quantit, 111. Le jour il suivra les vaches, et debout il aspirera la soulvent et les ado; la nuit il les servira qu'elles poussire dans (la posture et demeurera de rera, dite) la manire s'asseoir en homme . 112. Matre de lui, exempt de colre, qu'il s'arrte lorsmarche derrire elles quand elles mars'arrtent, qu'elles chent, s'asseye quand elles se reposent. 113. (Si une vache est) malade ou menace par un voleur, ou tombe ou embourpar un tigre, ou par d'autres dangers, be, qu'il la dlivre par tous les moyens. 114. Qu'il fasse chaud, qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou il ne doit point s'abriter luique le vent souffle violemment, mme sans avoir (d'abord) abrit de son mieux la vache. 115. S'il (voit une vache) manger chose) dans sa (quelque ou un son champ, sa grange, ou dans ceux d'autrui, maison, veau boire (du lait), qu'il ne dise (rien). 116. Le meurtrier d'une vache qui suit les vaches (pour les servir), selon cette rgle, efface au bout de trois mois le pch qu'il avait commis. 109. En tuant une cache sans le vouloir , sans cela le pch serait mortel. 110. Au quatrime repas, c'est--dire une fois tous les deux jours . Se baigner : suivant Medh. il s'agit seulement d'un bain de pieds. 111. Il les adorera ou les saluera. La posture vrsana consiste tre assis sans s'appuyer contre un mur, etc. . (Kull.)
342
LES LOIS DE MANOU
117. Sa pnitence il donnera un compltement accomplie, et dix vaches, taureau ou s'il ne (les) possde pas, il offrira des (Brahmanes) tout ce qu'il possde instruits dans les Vdas. 118. Les Dvidjas commis des pchs secondaires, ayant sauf (l'tudiant) qui a rompu son voeu de chastet, peuvent se purifier la mme ou bien pour accomplir pnitence, encore la pnitence lunaire. 119. Quant (l'tudiant) son voeu de chasqui a rompu un ne borgne tet, qu'il sacrifie la nuit, dans un carrefour, Nirriti, suivant le rite des sacrifices domestiques. 120. Aprs avoir suivant la rgle rpandu les oblations dans le feu, il fera la fin (du sacrifice) des offrandes de beurre clarifi au Vent, Indra, au prcepteur (des Dieux et Agni, en rcitant le verset du Rig : Puissent Brihaspati) les Marouts verser ensemble !... 121. Ceux qui sont instruits des Vdas, et qui connaissent la Loi, disent volontaire de sperme de la qu'une mission part d'un Dvidja soumis au voeu (du noviciat est) une violation du voeu (de chastet). 122. Tout l'clat le) Vda (est perdu) (que communique pour le novice qui rompt son voeu, (et) passe dans ces quatre les Marouts, et Agni. Indra, (divinits), Brihaspati 123. S'il a commis ce pch, de la peau qu'il aille revtu d'un ne mendier la porte de sept maisons, en confessant son action. 119. Un ne borgne : ou noir suivant une autre leon krshnena au lieu de knena. Les sacrifices domestiques pkayajna. 120. Au prcepteur des dieux, le texte dit seulement le guru. Agni est dsign ici sous son appellation de vahni le vhicule des offrandes. Le verset en question, comme le remarque B., se retrouve Taittirya-ranyaka, II, 18,4. Le texte ne donne que les deux premires syllabes compltes par Kull. samsincantu mruta iti. 122. Indra est ici nomm Puruhta. Brhaspati est dsign sous le nom de guru comme plus haut, et Agni sous celui de Pvaka le purificateur. 123. D'un ne qu'il a sacrifi comme il est dit au vers 119.
LES LOIS DE MANOU 124.
343
Des aumnes recueillies en celles-ci faisant un seul la bouche aux trois moments (repas) par jour, et se rinant de la journe, il est purifi au bout d'un an. (principaux) un des actes qui 125. Pour avoir commis volontairement entranent la dchance de caste, que (le coupable) accoma t) involonet (si l'acte plisse la pnitence Sntapana, taire, celle (dite) de Pradjpati. une caste mle, 126. Pour les actes qui vous ravalent ou vous rendent de recevoir des prsents, (on devra indigne la pnitence lunaire pendant un mois ; pour ceux accomplir) une souillure, on devra pendant trois jours qui entranent s'chauder avec de la bouillie d'orge (brlante). 127. Le quart (de la pnitence d'un fixe) pour le meurtre d'un Brahmane est prescrit du meurtre (comme expiation) le huitime si c'est un Vaisya (qui a t tu), le Kchatriya, seizime si c'est un vertueux Soudra. un Kcha128. Un Brahmane qui a tu involontairement donner mille vaches et un tautriya devra pour se purifier reau ; 129. Ou bien qu'il accomplisse trois ans la pnipendant tence impose au meurtrier d'un Brahmane, matrisant ses demeurant loin du village et habisens, les cheveux natts, tant au pied d'un arbre. 130. Un Brahmane devra qui a tu un vertueux Vaisya la mme durant un an et donner cent accomplir pnitence vaches. 131. Le meurtrier d'un Soudra devra accomplir intgra124. Se rinant la bouche ou se baignant . Les trois moments, savanas, sont le matin, midi et le soir. 125. Smtapana, pnitence dcrite plus loin au v. 213. 126. Cf. v. 68, 69, 70. Indigne de recevoir des prsents ou peut-tre simplement comme plus haut indigne . 127. Il s'agit ici du meurtre volontaire d'un Kchatriya. L'pithte de vertueux retombe aussi sur le Kchatriya et le Vaisya. 128. Donner mille vaches des Brahmanes . (Kull.) 130. Qui a tu: il s'agit d'un meurtre involontaire. 131. Le meurtrier involontaire comme au vers prcdent.
344 lement pourra mane. 132.
'
LES LOIS DE MANOU
cette pnitence six mois, ou bien encore il pendant donner un taureau et dix vaches blanches un Brah-
Pour le meurtre d'un chat, d'un ichneumon, d'un geai d'une d'un d'un d'une lzard, bleu, chien, grenouille, la (mme) pnid'une corneille, chouette, qu'il accomplisse d'un Soudra; tence que pour le meurtre 133. Ou bien qu'il boive trois jours du lait, ou qu'il fasse dans un un chemin d'un yodjana, ou bien qu'il se baigne la divinit adress des fleuve, ou bien qu'il rcite l'hymne eaux. un Brahmane donnera 134. Pour avoir tu un serpent, une charge de une bche en fer, pour (avoir tu) un eunuque de plomb ; paille et un mchaka clarifi 135. Un pot de beurre pour (avoir tu) un sanun glier ; une mesure de grains de ssame pour une perdrix; veau de deux ans pour un perroquet de trois ans ; un (veau) pour un courlis. 136. Pour avoir tu un flamant, une grue, un hron, un un vautour, un pervier, une qu'il donne paon, un singe, vache un Brahmane. il donnera 137. Pour avoir tu un cheval, un vtement; noirs ; pour une chvre ou pour un lphant, cinq taureaux un blier, un boeuf de trait; pour un ne, un (veau) d'un an. 132. Ici au contraire il s'agit du meurtre volontaire d'un de ces animaux. Cette pnitence est la pnitence lunaire. 133. Ou bien si le meurtre n'a pas t prmdit . (Kull.) Trois jours : le texte dit trois nuits . Yojana = environ 4 kilomtres. Suivant Kull. cette alternative est pour le cas o le pnitent est empch par la faiblesse de son estomac de boire du lait; de mme s'il ne peut accomplir la pnitence du yojana, il aura le choix de la suivante. Qu'il se baigne trois nuits conscutives . (Kull.) Cette prire, remarque B., se trouve Rig-Vda, X, 9. 134. Donnera un autre Brahmane . (Kull.) 135. Une mesure un drona. 137. Tous ces dons doivent tre entendus comme expiation du meurtre commis et non comme indemnit au propritaire des animaux; voil pourquoi le rcipient est toujours un Brahmane.
LES LOIS DE MANOU
345
138. Pour avoir tu des animaux il carnassiers, sauvages donnera une vache lait; pour des animaux non sauvages carnassiers une gnisse; un krichnala. pour un chameau 139. Pour avoir tu une femme adultre (appartenant l'une) des quatre il donnera suivant l'ordre des castes, classes, un sac de cuir, un arc, un bouc ou une brebis, pour sa purification. 140. Un Brahmane qui n'a pas le moyen d'expier par des dons le meurtre d'un serpent ou des autres (animaux mend'eux accomplir une pnitence tionns), pour chacun pourra sa faute. afin d'effacer un millier 141. Pour avoir dtruit de (petits) animaux ou un plein chariot il fera la (mme) vertbrs, d'invertbrs, d'un Soudra. pnitence que pour le meurtre 142. Mais pour le meurtre animaux ver(isol) de (petits) donne chose un Brahmane; tbrs, qu'il quelque petite des invertbrs, il sera purifi pour avoir dtruit (isolment) de respiration. fois par une simple) (chaque suspension ainsi que des 143. Pour avoir coup des arbres fruitiers, des plantes des lianes ou des plantes buissons, grimpantes, en fleurs, qu'il rcite cent (fois un texte du) Rig Vda. 144. (Pour avoir toutes sortes de cratures dtruit) qui 138. Un krshnala d'or . (Kull.) 139. Suivant l'ordre, c'est--dire un sac de cuir pour la Brhman, un arc pour la femme 'Kchatriya, etc. Il est vraisemblable qu'il s'agit ici de meurtre involontaire. 140. Une pnitence : suivant Kull. la pnitence dite de Prajpati . 141. De petits animaux vertbrs. Comme spcimens Kull. mentionne le lzard et autres , et parmi les invertbrs il cite les punaises . 142. Quelque petite chose un pana . (Kull. citant l'autorit de Sumantu. ) Isol. Kull. indique qu'il s'agit d'animaux tus un par un . - Une suspension de respiration en rcitant trois fois la Svitr avec les vers initiaux (ciras), le monosyllabe OM et les trois mots sacramentels (vyhrtis) Bhh, Bhuvah, Svah . (Kull.) 143. Pour avoir coup une fois et sans prmditation . (Kull.) 144. Toutes sortes : l'adverbe sarvaas peut signifier aussi en toute circonstance . Liquides ou peut-tre condiments ; rasa signifie littr. suc.
346 naissent
LES LOIS DE MANOU
dans les aliments ou dans les liquides, dans les dans les fleurs, du fruits, l'expiation (consiste ) manger beurre clarifi. sans motif des plantes 145. Pour avoir arrach cultives, dans la fort, il servira une vache ou nes spontanment durant un jour (en s'imposant) la pnitence (de ne boire que) du lait. on peut 146. Telles sont les pnitences (par lesquelles) en volontaire ou involontaire commis effacer tout pch est dtruisant ; coutez (maintenant (des cratures) quelle dfendus. l'expiation) pour avoir mang des aliments 147. (Celui qui) a bu par mgarde de (l'eau-de-vie appele) est purifi Vroun initiation; (mme s'il par une nouvelle la mort une (pnitence) entranant en a bu) avec intention), telle est la rgle. ne doit pas (lui) tre impose; dans un vase 148. (Celui qui) a bu de l'eau renferme sour ou toute autre liqueur de la (liqueur) contenu ayant devra pendant (cinq jours et) cinq nuits boire du spiritueuse, avec la plante lait bouilli Sankhapouchp. ou reu avec la formule 149. (Celui qui) a touch, donn, de l'eau-de-vie, ou qui "a bu l'eau laisse par un d'usage trois jours boire de l'eau bouillie avec doit pendant Soudra, de l'herbe kousa. avoir bu le soma res150. Mais un Brahmane qui aprs en de sour se purifie (exhale par) un buveur pire l'odeur 147. Par vrun il faut entendre suivant les commentateurs toute autre liqueur que l'alcool de riz (sur) pour lequel la pnitence est indique au v. 93. Une nouvelle initiation prcde d'une pnitence taptakrcchra (indique au v. 215) . (Kull.) B. dans une note propose d'entendre la deuxime partie du vers tout autrementque les commentateurs, mais la faute de celui qui en boit intentionnellement ne peut tre expie, elle reste aussi longtemps qu'il vit; telle est la rgle tablie . En d'autres termes pour le crime de boire avec intention de l'eau-de-vie la mort est la seule expiation. 148. Sankhapushpi = Andropogon aciculatum. 149. Reu avec la formule d'usage aprs avoir dit : C'est bien (merci) , (Kull.) Le texte porte suivant la rgle . 150. Bu le soma dans le sacrifice du soma . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
347
dans l'eau et en mangeant retenant trois fois sa respiration du beurre clarifi. 151. Les (gens) des trois castes Dvidjas qui auraient ou (une des excrments ou de l'urine, mang par mgarde la (liqueur) sour devront chose quelconque) touch ayant tre initis nouveau. le cordon sacr, le bton, la sollicitation 152. La tonsure, de (cette) et les voeux ne font pas partie des aumnes d'initiation des Dvidjas. deuxime crmonie de gens) des aliments 153. Celui qui a mang (provenant ou bien les restes dont on ne doit pas accepter de nourriture, ou bien de la viande dfendue, d'une femme ou d'un Soudra, devra boire de la bouillie d'orge pendant (sept jours et) sept nuits. 154. Un Brahmane qui a bu des (liquides) aigris et des lors mme que ces substances sont dcoctions astringentes, ce qu'elles aient t pures, devient impur jusqu' (rputes) Brahmane ou l'ordure d'un qui a aval l'urine d'un chacal, d'un d'un ne, d'un chameau, porc domestique, une pnitence lunaire. singe, d'une corneille, accomplira des viandes des champi156. Celui qui a mang sches, et (des aliments de provenance) incongnons pousss terre, dans un abattoir la mme nue, (ou) ayant sjourn accomplira pnitence. 152. Les voeux d'abstinence de miel, viande, femmes et autres choses . (Kull.) 153. Au livre IV, v. 222, la pnitence impose pour avoir mang des aliments offerts par des personnes dont on ne doit pas accepter de nourriture est un jene de trois jours, ou une pnitence krcchra suivant que le pch a t involontaire ou volontaire. 154. Ds liquides des sucs doux par leur nature, mais devenus aigres. (Kull.) Pures, c'est--dire non prohibes . (Kull.) 155. Ce vers vise le cas d'un acte commis sans intention. 156. De provenance inconnue, ou bien sans le savoir . Je ne pense pas qu'il faille attacher une grande importance l'pithte de bhaumni pousss terre . Suivant Medh. les champignons pousss terre sont opposs expulses. 155. Un
348 157.
LES LOIS DE MANOU
Pour avoir mang (de la viande) d'un animal carnasd'un d'un tre d'un sier, d'un chameau, sanglier, coq, d'une d'un ne, l'expiation est la pnihumain, corneille, tence (dite) brlante. 158. Le Dvidja dont le noviciat n'est pas achev, qui des aliments un (sacrifice) trois mensuel, jenera mange un jour dans l'eau. jours et restera 159. Mais l'tudiant occasion qui en n'importe quelle doit accomplir une pnitence mange du miel ou de la viande ordinaire et (ensuite) achever ce qui lui reste ( accomplir) de son noviciat. 160. Celui qui mange les restes d'un chat, d'une corneille, d'un ichneumon, ou (un aliment) d'un mulot, d'un chien, doit boire dans lequel il est tomb un cheveu ou un insecte, d'herbe Brahmasouvartchal. une infusion 161. Celui qui est soucieux de sa puret ne doit pas manou s'il en mange sans le vouloir, dfendus, ger d'aliments ou se purifie immdiatement (par les diverqu'il les vomisse, ses sortes de) purifications (prescrites). 162. Ainsi vous ont t exposes les diverses pnitences dfendus ; coutez prescrites pour avoir mang des aliments la rgle des pnitences effacer le (maintenant) (destines) pch de vol. ceux qui croissent dans le creux des arbres, lesquels ne sont pas prohibs. Cf. aussi le prcepte du livre V, v. 19. 157. Pnitence dite brlante, taptakrcchra indique plus loin au v. 215. Il s'agit ici d'un acte commis avec intention. 158. Littr. : le Dvidja qui n'est pas encore revenu (de la maison de son prcepteur) . Un sacrifice mensuel un rddha dit ekoddishta . (Kull.) 159. Mang du miel ou de la viande sans le vouloir, ou dans un moment de dtresse. (Kull.) De son noviciat, littr. de son voeu . La pnitence dsigne ici est celle de Prajpati. 160. Un cheveu ou un insecte, ou bien un insecte de cheveu, c'est--dire un pou . La plante dsigne ici est inconnue : peut-tre l'hlianthus ou suivant B. H. la rue sacre. 161. Suivant quelques commentateurs le mot odhana signifie non pas un m oyen de purification, mais un purgatif.
LES LOIS DE MANOU
349
163. Un Brahmane drob du grain, ayant volontairement des aliments ou un objet dans la maison (d'une personne) de sa caste, se purifie en faisant la pnitence (dite de Pradjpati) durant une anne. 164. La pnitence lunaire est la purification pour prescrite avoir enlev des hommes, des femmes, ou (usurp) un champ, une maison, ou les eaux d'un bassin ou d'un tang. 165. Celui qui a vol des objets dans la de peu de valeur maison d'autrui devra les restituer et accomplir la pnitence (dite) Sntapana pour sa purification. 166. Pour avoir vol des friandises (telles que des gteaux), ou des aliments un lit, un (tels que du lait), une voiture, des fleurs, racines et fruits, sige, l'expiation (consiste les cinq produits de la vache. avaler) 167. (Pour un vol) d'herbe, d'aliments de bois, d'arbres, de cuir, de viande, schs, de cassonnade, d'habits, (on doit un jene de (trois jours et) trois nuits. observer) 168. (Pour un vol de) pierres corail, perles, prcieuses, est de ne) cuivre, fer, laiton ou pierre, argent, (la pnitence douze jours. manger (que) des grains (crus) pendant 169. (Pour avoir vol) du coton, de la soie, de la laine, un animal ou solipde, un oiseau, un parfum, des fissipde ou une corde., (on ne doit vivre que de) plantes mdicinales lait durant trois jours. 170. Telles sont les pnitences un Dvidja par lesquelles en volant; mais (voici) les efface le pch qu'il a commis d'avoir eu des rela(prescrites) pour se purifier pnitences vous tait interdite. tions avec (une femme) dont l'approche avec des soeurs utrines, 171. Celui qui a eu des relations 164. Enlev des hommes ou des femmes, c'est--dire des esclaves . 165. Objets de peu de valeur en tain, en plomb, etc. (Kull.) 166. Kull. explique bhaksbya par gteau, etc. (modaka) , et bhojya par lait, etc. Les cinq produits de la vache, lait doux, lait sur, beurre, urine, bouse . (Kull.) 171. Rptition du v. 59. Suivant Kull. le sacrifice de la vie ne doit tre fait que pour dlits commis en connaissance de cause et avec rcidive.
350
LES LOIS DE MANOU
d'un ami, d'un fils, ou avec des filles non avec la femme devra les plus basses, des castes maries ou des femmes d'un la pnitence (fixe) pour le viol de la couche accomplir avec la fille de sa tante qui a eu des relations (qui est pour lui comme) une soeur, ou avec la fille paternelle de sa tante maternelle, ou avec la fille de son oncle maternel, une pnitence lunaire. accomplira 173. Un sage ne prendra pour pouse (aucune de) ces trois femmes; qu'on ne doit (c'est) cause (du lien) de parent car celui qui se marie avec (l'une d')elles, point les pouser; tombe en enfer. 174. Un homme qui accomplit le cot avec des animaux, ou avec une femme ses rgles, ou (qui l'approche ayant autrement ou dans l'eau, devra que par) ses parties sexuelles, une pnitence accomplir Sntapana. 175. Le Dvidja qui a un commerce charnel avec un (autre) ou avec une femme dans une voiture homme, (trane par) des vaches, ou dans l'eau, ou pendant le jour, devra se baigner tout habill. 176. Un Brahmane avec une femme qui a des relations Tchndl ou (toute autre) de basse classe, qui mange (leurs ou reoit (leurs prsents) dchoit (de sa caste si son aliments) acte a t) inconscient; il tombe (s'il a agi) volontairement, au mme rang qu'elles. 177. (Quand) une femme est dbauche, que (son) poux Celui 174. Avec des animaux sauf avec une vache, car dans ce cas il doit accomplir durant une anne la pnitence de Prajpati . (Kull.) 175. Avec un homme dans n'importe quel lieu . (Kull.) Tandis qu'avec une femme le pch est restreint au cas o l'acte a t commis dans une voiture. 176. Dchoit, il devra accomplir la pnitence prescrite pour un dgrad, et la gravit de la peine indique qu'il s'agit spcialement du cas o il y a eu rcidive dans l'acceptation des prsents et des aliments . (Kull.) Inconscient : cette restriction porte non pas sur l'acte lui-mme, qui ne peut avoir t involontaire, mais sur la condition de la femme qui a pu tre ignore ou connue de celui qui a eu des rapports avec elle. gourou. 172.
LES LOIS DE MANOU l'enferme dans
351
un appartement la isol et lui fasse accomplir adultre. pnitence (prescrite) pour l'homme 178. Mais si elle pche une seconde fois, sduite par un de mme (caste), une pnitence ordinaire (homme) (accomlunaire est prescrite pagne d')une pnitence pour l'expiation de sa (faute). 179. Le (pch) Brahmane commet en passant une qu'un nuit avec une Vrichal, il l'efface en trois annes, en vivant constamment d'aumnes et en rcitant (des prires). 180. Telle est l'expiation (prescrite) pour ces quatre (sortes) _ les expiations de pcheurs ; coutez maintenant (imposes ) ceux qui ont des rapports avec des (hommes) (de dgrads leur caste). 181. Celui qui hante un (homme) est dgrad dgrad au bout d'un an, non pas en sacrifiant (pour lui), (lui-mme) l'instruction ou en (contractant avec lui) une en (lui) donnant sa voiture, union de famille, mais (rien qu'en partageant) son sige et ses aliments. de ces (gens) d182., L'homme qui frquente quelqu'un devra accomplir la pnitence grads prescrite pour celui-ci, afin de se purifier de cette frquentation. et les parents 183. Les parents sixime jusqu'au degr 178. Ordinaire : la pnitence dite de Prajpati . (Kull.) 179. Des prires : la Svitr et autres . (Kull.) 180. Ces quatre sortes de pcheurs ceux qui tuent, ceux qui mangent des aliments dfendus, ceux qui volent, et ceux qui ont des relations avec des femmes qu'ils ne devraient pas approcher . (Kuii.) Des rapports : ici il s'agit des relations ordinaires, et non comme prcdemment des relations sexuelles. 181. Non pas en sacrifiant ce qui entrane la dgradation non pas en un an, mais immdiatement . (Kull.) On peut comprendre ce vers d'une faon tout oppose : il est dgrad lui-mme au bout d'un an en sacrifiant pour lui, en lui donnant l'instruction ou en contractant avec lui une union de famille, et non pas (simplement) pour avoir partag sa voiture, son sige et ses aliments . Ce dernier pch tant bien plus lger n'entrane la dgradation qu'aprs une priode de temps plus longue. 183. Les parents : les Sapindas et les Samnodakas. Des libations comme pour un mort, quoiqu'il soit encore en vie . (Kull.) Il s'agit d'un
352
LES LOIS DE MANOU
d'un (homme) doivent faire (pour lui des loigns dgrad d'eau en dehors (du village), en un jour nfaste, le libations) des parents, du prtre officiant et du matre soir, en prsence spirituel. 184. Une esclave doit renverser du pied un pot plein d'eau sixime (pour lui) comme pour un mort; ses parents jusqu'au demeureront degr et ses parents loigns impurs un jour et une nuit. 185. On doit s'abstenir de lui causer ou de s'asseoir ct de lui, de lui donner et (d'entretenir (sa part) d'hritage avec lui) les rapports entre les hommes. qui existent 186. (Son droit) d'anesse doit tre supprim ainsi que son d'an ; la part de l'an doit revenir un frre plus prciput en vertu. jeune, (mais) suprieur 187. Mais quand il a accompli la pnitence (prescrite), que renversent un nouveau (ses parents) pot plein d'eau et se avec lui dans un tang sacr. baignent en sa 188. Aprs avoir jet ce pot dans l'eau, qu'il rentre comme et accomplisse maison par le pass tous les devoirs de famille. 189. On doit suivre la mme rgle pour les femmes dgrades (de leur caste) ; mais on doit leur fournir les vtements, et la boisson, et les loger (dans une hutte) prs la nourriture de la maison. non 190. On ne doit pas avoir affaire avec des pcheurs faire de reproches ceux purifis ; mais on ne doit jamais qui ont fait leur expiation. les meurtriers les 191. Il ne faut pas frquenter d'enfants, ni ceux qui ont tu des suppliants ou des femmes, ingrats, lors mme qu'ils se seraient suivant la Loi. purifis grand pcheur, mahptakin. Les parents : suivant Medh. il s'agit des parents de ceux qui accomplissent la crmonie, et non de celui qui est dgrad. Kull. ne prcise pas. 186. Son droit d'anesse s'il est l'an . 187. Ses parents Sapindas et Samnodakas . (Kull.) 191. Ce vers est une restriction au prcdent. Les ingrats, ceux qui rendent le mal pour le bien, littr. ceux qui dtruisent le bien qu'on leur
LES LOIS DE MANOU
353
192. Les Dvidjas la Svitr n'a pas t enseigne auxquels suivant la rgle, il faudra leur faire accomplir trois pnitences (ordinaires), et (ensuite) les initier conformment la Loi. 193. La mme expiation est prescrite pour les Dvidjas qui ou qui ont nglig ont commis des actes illicites, (l'tude du) faire pnitence. Vda, et qui dsirent du bien par un acte 194. Des Brahmanes qui ont acquis ce (bien), sont purifis rprhensible par la renonciation par la prire et par les austrits. trois mille (fois) la 195. En rcitant avec recueillement en vivant de lait pendant un mois dans un parc Svitr, vaches, on est absous (du pch) d'avoir reu (des prsents) d'un mchant. 196. Lorsque (le pnitent) amaigri par le jene revient du il doit s'incliner devant (les Brahmanes parc vaches, qui) lui demanderont : Ami, dsires-tu tre (notre) gal ? Assurment 197. Aprs avoir rpondu aux Brahmanes ! , de l'herbe qu'il parpille pour les vaches, et quand les vaches ont sanctifi cet emplacement, l'admetque (les Brahmanes) tent (de nouveau parmi eux). 198. Celui qui a fait un sacrifice pour des excommunis, devoirs des trangers, une (rendu) les derniers (accompli) crmonie ou un sacrifice est absous impur, par magique trois pnitences (simples). a fait par de mauvais procds . (Kull.) Des suppliants, littr. ceux qui cherchaient une protection pour leur vie . (Kull.) 192. La Svitr n'a pas i enseigne, c'est--dire qui n'ont pas reu le sacrement de l'initiation dont l'enseignement de la Svitr fait partie. La pnitence ordinaire, cf. note du v. 178. 194. Un.acte rprhensible en recevant des prsents des mchants, etc. . (Kull.) 196. Notre gal, et ne recommenceras-tu pas recevoir des prsents des mchants? . (Kull.) 197. Ont sanctifi cet emplacement en mangeant l'herbe. (Kull.) 198. Des excommunis vrtyas. Une crmonie magique, c'est--dire une incantation destine ter la vie quelqu'un, telle que le rite 23
354
LES LOIS DE MANOU
199. Un Dvidja le un suppliant, qui a repouss divulgu Vda (mal propos), expie sa faute en vivant d'orge durant un an. 200. Celui qui a t mordu par un chien, un chacal, un un homme, un cheval, un ne, un carnassier domestique, un sanglier, se purifie par une suspension de respichameau, ration. un 201. Manger tous les six repas pendant (seulement) la Sanhit mois, rciter (du Vda) et (faire) continuellement les oblations (tels sont les moyens de) puri(dites) Skalas, fication pour ceux qui sont exclus des gens honorables. dans 202. Un Brahmane volontairement qui est mont une voiture ou par un ne, ou qui (trane par) un chameau de s'est baign tout nu, est purifi par une simple suspension respiration. 203. Celui qui press (par le besoin) dcharge son ventre, sans (avoir proximit) de l'eau, ou qui (fait cette opration) dans l'eau, est purifi en se baignant tout habill en dehors une vache. (du village et) en touchant usuelles 204. Pour avoir nglig les crmonies prescrites de maison, le d'un matre par le Vda et omis les devoirs jene est la pnitence (impose). ou tutoy 205. Pour avoir dit Houm ! un Brahmane un suprieur, on doit se baigner, jener le reste de la journe et apaiser (l'offens) par un salut respectueux. 206. Celui qui a frapp (un Brahmane) mme avec un brin yena et autres . (Kull.) Je ne sais en quoi consiste ce rite : le mot yena signifie aigle. Le sacrifice impur dit ahna qui dure de deux douze jours. 199. Mal propos des gens auxquels il ne doit pas tre enseign . (Kull.) 200. Un carnassier domestique un chat, un ichneumon, etc. . (Kull.) 201. A tous les six repas, c'est--dire faire un repas tous les trois jours. Les kalas sont des oblations au nombre de huit, accompagnes chacune d'une prire particulire. 204. Le jene pendant un jour entier . (Kull.) Un matre de maison littr. un Sntaka . 205. Hum! veut dire : Tenez-vous tranquille! (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
355
ou qui l'a attach ou d'herbe, par le cou avec un vtement, dans une contestation, devra l'apaiser en se qui l'a vaincu prosternant (devant lui). 207. Mais celui qui menace un Brahmane avec l'intention de le tuer, tombe en enfer pour cent ans; celui qui l'a frapp (effectivement), pour mille ans. 208. Autant le sang d'un Brahmane de coagule (de grains) autant de mil liers d'annes celui qui a fait (couler poussire, ce sang) demeure en enfer. 209. Pour avoir menac un Brahmane, fera (l'offenseur) une pnitence jet terre une pnitence pour l'avoir simple, son sang, qu'il fasse ( la extraordinaire; pour avoir rpandu et une pnitence extraordinaire. fois) une pnitence simple 210. Pour des pchs il n'a pas t auxquels l'expiation de purification on doit fixer, une pniprescrit (particulire), les moyens tence, aprs avoir pris en considration (du coupable) et (le caractre de) la faute. 211. Je vais maintenant vous exposer les moyens pratiet les Mnes, un qus par les Dieux, les Sages par lesquels homme peut effacer (ses) fautes. 212. Un Dvidja qui accomplit (la pnitence dite) de Pradtrois jours (manger le matin, jpati doit pendant seulement) trois jours (seulement) trois jours le soir, pendant pendant ce qui lui a t donn) sans qu'il l'ait manger (seulement et pendant trois autres ne rien manger du demand, jours tout. 213. (Absorber de vache, de un jour) de l'urine pendant la bouse de vache, du lait (doux), du lait suri, du beurre d'herbe clarifi, de l'infusion Kousa, (puis) jener (un jour et) une nuit, (constitue brlante. ce qu'on) appelle une pnitence 214. Un Dvidja extraordiune pnitence accomplissant 209. Les pnitences krcchra et atikrcchra sont indiques plus loin, v. 212 et 214. 213. Pnitence brlante, smtapana. 214. Pnitence extraordinaire, atikrcchra.
356
LES LOIS DE MANOU
de la trois (fois) trois jours manger devra naire, pendant manire simple, mais) une (seule) indique (pour lapnitence les trois derniers bouche chaque repas, et jener pendant jours. ardente la pnitence 215. Un Brahmane accomplissant bouillants et de la vapeur, boira de l'eau, du lait, du beurre une fois trois jours, et se baignera substance chaque pendant dans le recueillement. 216. Un jene de douze jours (accompli) par un (homme) loila pnitence matre de ses sens et attentif, (constitue) gne, qui efface tous les pchs. d'une bouche 217. Diminuer chaque (jour (sa nourriture) de la quinzaine) noire, et l'augmenter (dans la mme proporen se baignant au (mola (quinzaine) blanche, tion) pendant est ce qu'on appelle une ment de chacune des) trois libations, lunaire. pnitence cette dans (la 218. On doit suivre rgle intgralement dite) en forme de grain d'orge, (mais alors) on doit pnitence lunaire au dbut de la quinzaine la pnitence commencer des sens). blanche, (ses organes domptant 215. Pnitence ardente, taptakrcchra. 216. Pnitence loigne, parkakrcchra. 217. Suivant le commentaire de Kull. le pnitent doit manger quinze bouches le jour de la pleine lune et retrancher une bouche chaque jour de la quinzaine noire, de manire que le quatorzime jour il ne prenne plus qu'une bouche, et qu'il jene le jour de la nouvelle lune, puis il recommence prendre une bouche le premier jour de la quinzaine blanche, et ajoute progressivement une bouche chaque jour qui suit. Les trois libations le matin, midi, le soir . Upaspran signifie peut-tre se rinant la bouche et non se baignant . La pnitence cndryaa est appele taille de fourmi parce qu'elle est mince au milieu, et s'largit vers les deux extrmits. 218. La pnitence yavamadhyama est une varit de la pnitence lunaire; elle est dite en forme de grain d'orge, c'est--dire large au milieu et mince aux extrmits, parce que l'on commence par une bouche en augmentant progressivement pendant la quinzaine blanche jusqu' quinze bouches, puis on diminue dans la mme proportion pendant la quinzaine noire. On remarquera que cette diminution et cette augmentation d'aliments sont parallles la dcroissance et la croissance de la lune.
LES LOIS DE MANOU 219.
357
Celui qui accomplit la pnitence lunaire des asctes se matrisant avaler un mois lui-mme, devra, (pendant du sacrifice. de graines chaque jour) midi, huit bouches un Brahmane 220. Quand dans le recueillement mange le matin et quatre du soleil quatre bouches aprs le coucher un mois ,l accomplit ce qu'on) appelle la pnitence (durant lunaire des enfants. 221. Celui qui recueilli un mois, n'importe mange pendant de quelle trois (fois) quatre-vingts bouches de manire, du sacrifice, sa mort) au sjour du graines parviendra (aprs dieu de la Lune. 222. Les Roudras, les Adityas, les Vasous, les Marouts et les grands cette pnitence carter Sages pratiqurent pour tout mal. 223. Que (le pnitent) lui-mme fasse chaque une jour oblation au feu (en prononant) les trois grandes paroles, et qu'il vite) le menqu'il ne fasse aucun mal (aux cratures, songe, la colre et la malhonntet. 224. Qu'il se baigne tout habill trois fois par jour et trois fois par nuit, et n'adresse en aucun cas la parole des femmes, des Soudras ou des gens dgrads (de leur caste). 225. Qu'il passe debout (son temps) (le jour) et assis (la 219. Ascte, yati. Graines du sacrifice, graines sauvages. Cette troisime varit de pnitence lunaire peut commencer avec la quinzaine blanche, ou avec la quinzaine noire . (Kull.) 221. N'importe de quelle manire, c'est--dire pourvu qu'il ne dpasse pas durant le mois la somme de deux cent quarante bouches, il peut les rpartir comme il veut. 222. Le dieu Rudra suivant une lgende naquit du front de Brahm, et sur l'ordre de ce dieu spara sa nature en mle et femelle, puis multiplia chacun de ces deux en divinits, dont les unes taient blanches et bienfaisantes, les autres noires et malfaisantes. Les dityas prsident chaque mois de l'anne et sont des personnifications du soleil. Les Vasus, divinits au nombre de huit, serviteurs d'Indra, et personnifications des phnomnes naturels. Les Maruts sont les vents personnifis. 223. Les trois grandes paroles, les vyhrtis, bhh, bhuvah et svah. Cf. II, 76. 225. Fidle ses voeux en ce qui concerne la ceinture d'herbe Munja, le bton, etc. (Kull.)
358
LES LOIS DE MANOU
nuit), ou s'il ne le peut, couch sur la terre (nue) ; qu'il soit son prcepteur fidle ses voeux, qu'il honore chaste, spirituel, les dieux et les Brahmanes. autant 226. Qu'il rcite constamment qu'il le peut la Svila tr et (autres (et) qu'il (apporte) prires) purificatoires, mme attention dans tous les voeux qui ont pour but d'effacer les pchs. se 227. Telles sont les expiations doivent (par lesquelles) les Dvidjas dont les fautes ont t rvles ; quant purifier ceux dont les fautes n'ont pas t rvles, ils se purifient par les prires et par les oblations. 228. Par la confession, par l'asctisme, par le repentir, est absous de sa faute, par la rcitation (du Vda), un pcheur et aussi au besoin par les aumnes. 229. A mesure d'un le homme qu'un pch coupable un serpent confesse il en est absous, comme spontanment, de sa peau. (se dbarrasse) 230. Autant son esprit regrette la mauvaise action, autant son corps est dcharg de cette faute. 231. Car celui qui a commis un pch et s'en repent est absous de ce pch; l'homme en ces qui renonce (au pch : Je ne le ferai plus, est purifi. termes) 232. Ayant ainsi mdit dans son esprit sur les consdes actions verquences aprs la mort, qu'il soit toujours tueux de penses, de paroles et de corps. 233. Celui qui a commis un acte rprhensible sciemment ou inconsciemment, et dsire en tre absous, ne doit pas le commettre une seconde (fois). 234. Si pour un acte quelconque fait par lui, son esprit 228. Au besoin, littr. en cas de dtresse, padi , c'est--dire s'il est incapable d'accomplir des austrits . (Kull.) 230. Son corps : par arira le commentaire entend l'me vivante, l'me individuelle, le jvtman . 231. Au lieu de narah (dition Jolly). Kull. lit tu sah, texte suivi par B., mais il est purifi seulement par la rsolution de cesser de pcher, etc. 233. La pnitence serait double Kull. citant l'autorit de Dvala.
LES LOIS DE MANOU
359
ce de cet (acte), jusqu' qu'il fasse pnitence (sent) un poids, un soulagement (complet). qu'il prouve a sa racine dans divine ou humaine 235. Toute flicit sa fin dans l'austrit, son centre dans l'austrit, l'austrit, le sens du Vda. au dire des Sages qui connaissent d'un Brahmane 236. L'austrit (consiste dans) la connaisd'un Kchatriya dans la protecl'austrit sance (du Vda), d'un Vaisya dans (la pratique) tion (des sujets), l'austrit de d'un Soudra dans le service l'austrit sa profession, (des autres). 237. Les sages matres et vivant de fruits, d'eux-mmes, de racines et d'air, contemplent par (la vertu de) leur seule austrit les trois mondes avec (toutes les cratures) animes et inanimes. la sant, la science et les 238. Les plantes (mdicinales), divers divins s'obtiennent par la seule austrit; sjours l'austrit est (le moyen) d'y arriver. acqu239. Tout ce qui est difficile surmonter, difficile faire, peut tre accompli atteindre, difficile rir, difficile ; car tout cde (la puissance de) l'austrit. par l'austrit criminels et les autres pcheurs 240. Et mme les grands sont absous de leurs fautes rien que par les austrits rigoureusement pratiques. 241. Insectes, btail, oiseaux et vgserpents, papillons, au ciel par la vertu de l'austrit. taux (mme) arrivent 235. C'est--dire la flicit n'est produite et ne subsiste que par la pratique de l'austrit. 238. On pourrait rapprocher daiv de vidy, le science divine, et entendre sthitih la position (dans la vie). Mais le commentaire rapproche daiv de sthitih les diverses situations dans le ciel . 239. Littr. l'austrit est difficile surmonter . Il me semble difficile d'admettre l'interprtation de L. : L'austrit est ce qui prsente le plus d'obstacle. . 240. Les grands criminels, ceux qui ont commis des pchs mortels, entranant la dgradation, mahptaka. Pcheurs, littr. ceux qui ont fait des choses qui ne doivent pas tre faites . 241. Vgtaux, littr. les tres privs du mouvement. Ce vers signifie que
360 242.
LES LOIS DE MANOU
commettent en Quelques pchs que les hommes en paroles ou en actions, tout est promptement penses, ont l'austrit consum par le feu de l'austrit, lorsqu'ils pour seule richesse. 243. Les dieux les offrandes et font russir les agrent dsirs seulement du Brahmane purifi par l'austrit. 244. Le.toufr-puissant des cratures ce Seigneur produisit livre rien que par son austrit; de mme les sages ont obtenu du Vda par leur austrit. (la connaissance) 245. Les dieux sainte de tout cet voyant (que) l'origine de l'austrit, ont proclam la grande (univers procde) puissance de l'austrit. 246. La rcitation du Vda, l'accomplissement quotidienne des (cinq) grands sacrifices dans la mesure de ses moyens et la rsignation effacent les souillures, mme promptement celles causes par le pch mortel. 247. De mme en un moment que le feu consume par sa flamme le combustible qu'on y met, ainsi celui qui entend le Vda consume tout pch par le feu de sa science. 248. On vous a ainsi dclar, suivant la loi, les pnitences les pnitences maintenant ; apprenez pour les fautes (rvles) secrtes. pour les (fautes tenues) 249. Seize suspensions de respiration accompagnes (de la des trois paroles sacramentelles et de la syllabe rcitation) tous les jours pendant un mois purifient mme OM, rptes le meurtrier d'un Brahmane instruit. les mes qui rsident dans ces tres infrieurs, peuvent aprs des transmigrations arriver au ciel par le pouvoir de l'austrit. 242. L'austrit pour seule richesse, ou plus simplement lorsqu'ils sont riches en austrits . 243. Cela quivaut dire que si le Brahmane n'est pas purifi par l'austrit, les dieux n'agrent pas ses offrandes et ne font pas russir ses dsirs. 244. Le Seigneur des cratures, c'est--dire Brahm . (Kull.) 246. On pourrait aussi entendre au sens actif mahptakajni mme si elles ont produit les grands crimes , comme traduit B. H. 249. Le commentaire ajoute aprs la syllabe OM et la Svitr. Le meurtrier d'un Brahmane ou bien le me.urtrier d'un foetus .
LES LOIS DE MANOU 250.
36J
en rcitant Mme un buveur de sour est purifi de Koutsa ainsi : Loin d'ici... , (commenant) (l'hymne) de Vasichtha ainsi : Vers..., (commenant) (l'hymne) Mhitra et les (vers appels) Souddhavats. (l'hymne) 251. En rcitant mie fois (par jour durant un mois l'hymne) par ces mots : De lui vous... et le Sivaqui commence mme un voleur d'or devient l'instant sans tache.sankalpa, 252. En rptant (l'hymne par) : Buvez qui commence l'oblation ne , (et celui qui commence par) : L'inquitude le... , (et celui qui commence , et en par) : Ainsi, ainsi... rcitant Pouroucha, le profanateur de la couche l'hymne d'un gourou est absous. 253. Celui qui dsire effacer ses fautes grandes ou petites, devra rpter (une fois par jour), durant un an, l'hymne (qui (ou celui qui commence commence par) : Loin... par) : Quel que soit... ou (celui qui commence par) : Ainsi, ainsi... 254. Celui qui a accept des (prsents) interdits ou mang des aliments dfendus se purifie en trois jours en rcitant (l'hymne qui commence par : Vite le rjouissant... 255. Celui qui a commis beaucoup de pchs se purifie en 250. Kutsa et Vasishtha, sages vdiques auxquels on attribue plusieurs hymnes. Comme le remarque B. le premier de ces hymnes se trouve Rig-Vda, I, 97, le second Rig-Vda, VII, 80, le troisime Iiig-Vda, X, 185; les uddhavats (textes contenant le mot uddha purifi) se trouvent RigVda, VIII, 84, 7-9. 251. L'hyme commenant par asya vm se trouve Rig-Vda, I, 164; le ivasamkalpa, Vj. Samh., XXXIV, 1. Il s'agit toujours de l'or d'un Brahmane, 252. Jolly imprime havishyantya, mais le Dictionnaire de Saint- Ptersbourg considre cette leon comme fautive au lieu de havishpntiya. Ces quatre hymnes, comme le remarque B., se trouvent Rig-Vda, X, 88, X, 126, X, 119, X, 90. 253. Rig-Vda, I, 24, 14, et VII, 89, 5. Le troisime dj mentionn antrieurement se trouve X, 119. Ses fautes secrtes . (Kull.) 254. Rig-Vda, IX, 58, 1-4. En rcitant une fois par jour , cette restriction s'applique aussi aux prceptes suivants. 255. Rig-Vda, VI, 74, 1-4, et IV, 2, 4-6. Aryaman Varuna et Mitra, ajoute Kull.
362
LES LOIS DE MANOU
Soma et Roudra rcitant durant un mois (l'hymne) et les : Aryaman... trois vers (commenant , et en se par) dans une rivire. baignant 256. Un (homme) de fautes doit rpter charg (graves) une demi-anne les sept vers (commenant pendant par) : Indra... un acte rprhensible dans ; celui qui a commis d'aumnes un mois. l'eau, devra subsister pendant 257. Un Dvidja efface un pch mme trs grave en offrant durant un an du beurre clarifi, avec les prires des sacrifices ou en rcitant l'hymne (dits) Skalas (qui commence par) : Salut... 258. Celui qui est entach d'un pch mortel devra suivre en rptant un an les vaches dans le recueillement; pendant il est les (hymnes) Pvamns et en ne vivant que d'aumnes purifi. du s'il rpte trois fois la Sanhit 259. Ou bien encore Vda dans une fort, pur et sanctifi par trois (pnitences il est absous de toutes ses fautes. dites) parka, ses sens jene trois jours, 260. Mais celui qui matrisant se plonge trois fois par jour dans l'eau et rcite trois fois est absous de toutes ses (l'hymne appel) effaceur de pchs, fautes. du cheval, le roi des sacri261. De mme que le sacrifice de mme l'hymne toutes les fautes, fices, supprime (dit) enlve tous les pchs. effaceur dpchs 256. Rig-Vda, I, 106, 1-7.Un acte rprhensible dans l'eau, rpandre de l'urine ou des excrments . (Kull.) 257. kalas, cf. v. 201, note. On peut couper nama (salut) en deux mots. 258. Pvamns : le neuvime mandala du Rig-Vda relatif la purification du soma quand il a t press. 259. La Samhit : la rcension complte du Vda avec les Mantras et les Brhmanas . (Kull.) Sur la pnitence parka, cf. v. 216. 260. Aghamarshana (effaceur de pchs) est aussi le nom d'un saint auquel on attribue la composition de certains hymnes. C'est dans ce sens que l'entend B., l'hymne vu par Aghamarshana . Cet hymne se trouve Rig-Vda, X, 190.Trois fois par jour, aux trois moments : le matin, midi, le soir . (Kull.) Je prends yukta au sens de niyata.
LES LOIS DE MANOU
363
262. Un Brahmane ne qui sait par coeur le Rig-Vda serait souill d'aucun les trois mondes crime, et-il ananti ou accept les aliments de n'importe qui. 263. Celui qui rpte trois fois avec recueillement la Sanou hit du Rig(-Vda) ou bien (celle du) Yadjour(-Vda), est absous de avec les Oupanichads (celle du) Sma(-Vda) toutes ses fautes. 264. De mme qu'une motte de terre jete dans un grand lac se dissout en y tombant, ainsi toute mauvaise action est dans le triple Vda. (comme) submerge 265. Les (prires) du Rig(-Vda) et les principales (prires) du Yadjour(-Vda), ainsi que les diffrents du (hymnes) le doivent tre reconnus comme (formant) Sma(-Vda), dans le Vda. (est dit) instruit triple Vda; qui les connat, 266. Cette primitive essence du Vda, compose de trois sur laquelle est un autre lettres, repose la triade (vdique), celui qui en est Vda, secret; triple qui doit tre gard instruit (est dit) vers dans le Vda. 263. Les Upanishads, littr. les parties mystrieuses, la doctrine sotrique , partie philosophique du Vda qui fait suite aux Brhmanas, et forme une partie de la ruti ou parole rvle. 265. Les principaux au lieu de dyni, il y a une leon diffrente anyni les autres ou qui diffrent des premires , comme l'entend B. 266. Essence du Vda, littr. Brahman, souvent employ pour dsigner le Vda. Les trois lettres A, U, M, forment le monosyllabe mystique OM. La triade vdique : on a dj fait remarquer que Manou ne connat que trois Vdas.
LIVRE Transmigration des
DOUZIME Ames; Batitude finale.
Tu nous as dclar les quatre toute la loi concernant castes, toi qui es sans pch ! Explique-nous (maintenant) selon la vrit la rtribution finale des actions. aux 2. Et le vertueux fils de Manou, rpondit Bhrigou, la la dcision grands Sages : coutez (en ce qui concerne de tout cet ensemble d'actes. rtribution) 3. Les actes procdant de l'esprit, de la parole ou du corps des fruits bons ou mauvais; des actes rsultent produisent les (diverses) la suprieure, la conditions des hommes, et l'infrieure. moyenne 4. Sachez que l'esprit de cet (acte) est ici-bas l'instigateur li avec le corps, qui est de trois degrs, qui a trois siges et se rpartit en dix catgories. 5. Convoiter le bien d'autrui, des mditer en son esprit choses embrasser dfendues, l'erreur, (telles sont) les trois actions mentales. (mauvaises) 6. L'outrage, le mensonge, la calomnie et le bavardage tre (regards inconsidr doivent les quatre comme) (mauvaises actions) verbales. 1. 1. Ce sont les grands Sages qui s'adressent Bhrgu le narrateur suppos du livre de Manou. 4. Trois degrs, suprieur, moyen, infrieur . (Kull.) Trois siges, l'esprit, la parole, le corps . (Kull.) Dix catgories numres ci-aprs. 5. Mditer des choses dfendues, le meurtre d'un Brahmane, etc. (Kull.) L'erreur, la ngation d'un autre monde, le matrialisme . (Kull.)
366
LES LOIS DE MANOU
7. S'approprier ce qui n'a pas t donn, faire du mal en dehors des cas prescrits (aux cratures) par la loi, entretenir des relations adultres, (voil ce) qu'on appelle les trois actions corporelles. (mauvaises) 8. Pour un (acte) mental bon ou mauvais, reoit (l'homme) sa rcompense dans son esprit, (il la reoit) dans sa voix pour un (acte) verbal, dans son corps pour un (acte) corporel. 9. Pour des actes coupables du corps, un homme procdant des tres inanims, (aprs sa mort) entre dans la condition de la voix dans la condition des pour (ceux qui procdent) oiseaux ou des btes sauvages, de pour (ceux qui procdent) l'esprit, (il renat dans) une basse caste. 10. Celui dans l'intelligence duquel rside une triple autosur la parole, la pense rit (exerce) et le corps, est appel ( juste titre un homme) trois btons. 11. L'homme (sur sa parole, qui exerce cette triple autorit et son corps dans ses rapports) avec toutes les sa pense ainsi et qui dompte ses dsirs et sa colre parvient cratures, la flicit suprme. 12. (Le principe) qui fait agir ce corps est appel le connaisseur du champ; et ce (corps) qui accomplit les actes est appel par les sages le compos d'lments. 13. Il est un autre esprit interne dont le nom est le principe vital, qui nat en mme temps que tous les (tres) cor7. Faire du mal, c'est--dire tuer des animaux autrement que pour les sacrifices autoriss. 10. Jeu de mots : tridandin signifie qui a trois btons ; les trois btons sont l'insigne de la vie asctique. D'autre part danda signifie aussi autorit. L'auteur veut dire que le vritable ascte n'est pas celui qui porte comme insigne les trois btons, mais celui qui exerce un triple empire sur sa parole, sa pense et son corps. 12. Ce corps : Kull. explique le mot tman par corps, le moi corporel . Kshetrajna, le connaisseur du champ ; on a dj vu propos de la paternit l'emploi mtaphorique du mot kshetra, champ; ici le kshetrajfia est donc l'me qui connat le corps. Le bhttman, compos d'lments, est le corps qui tire son origine des lments tels que la terre et autres . (Kull.) 13. L'esprit interne antartman. Le principe vital, jiva au moyen
LES LOIS DE MANOU
367
et sont perus tous les plaisirs porels, par le moyen duquel toutes les peines dans les existences (successives). du le grand et le connaisseur 14. Ces deux (principes), Celui qui rside unis avec les lments, champ, pntrent dans (tous) les tres les plus levs comme les plus bas. manid'innombrables 15. Du corps de ce dernier jaillissent les mettent en mouvement festations qui perptuellement tres de toute sorte. est form 16. Avec des particules des cinq (lments) un autre corps duaprs la mort, pour les hommes pervers, aux souffrances rable, destin (de l'enfer). au des mchants) ont endur 17. Aprs que (les mes dans de ce corps les souffrances (infliges par) Yama moyen se rsorbent l'autre monde, (les particules qui les composent) lmensuivant leur catgorie, dans les mmes principes taires sorties). (dont elles taient 18. Quand elle a expi les pchs, sources d'infortunes, aux objets des sens, cette (me) purifie ns de l'attachement de ses souillures retourne vers ces deux (principes) puissants. duquel, transform en conscience et en sens, le kshetrajna dans les existences successives peroit le plaisir et la peine . (Kull.) 14. Le grand, mahn (ici du masculin) c'est l'intelligence, c'est le jva du vers prcdent oppos au kshetrajna. Les lments ^es cinq lments tels que la terre, etc. (Kull.) Celui dsigne suivant Kull. le paramtman, l'me suprme. 15. De ce dernier, c'est--dire du paramtman. Manifestations, littr. des formes mrtayah que Kull. explique par des principes vitaux (jvh) . 16. Particules: mtr est peut-tre ici synonyme de bhta; on pourrait donc traduire simplement avec les cinq lments . Durable pour rsister aux tourments . (Kull.) 17. Dans l'autre monde, iha n'a pas ordinairement ce sens-l; il s'oppose au contraire paraloke. Kull. explique ainsi : Aprs avoir subi au moyen de ce corps les tourments infligs par Yama, ces mes perverses tant subtiles, la dissolution de ce corps grossier, se rsorbent dans ces parties constitutives des lments. 18. Cette me : c'est--dire l'me individuelle, le jva ; les deux puissants sont le mahn et le kshetrajna du v. 14. Pourtant Kull. entend par l le mahn et le paramtman.
368
LES LOIS DE MANOU
19. Ces deux (principes) examinent ensemble sans relche le mrite ou la culpabilit de cette unie (me, et celle-ci) ses (mrites ou ses dmrites) obtient ou le la flicit malheur dans ce monde et dans l'autre. 20. Si (l'me) a pratiqu surtout le bien et trs peu le mal, de ces mmes lments, revtue elle (d'un corps compos) gote la flicit au ciel. 21. Mais si elle s'est principalement adonne au mal et trs peu au bien, dpouille de ces lments, elle subit les tortures infliges par Yama. 22. Cet esprit avoir endur les tourments vital, aprs revt de nouveau (infligs) par Yama, purifi de ses souillures, ces cinq mmes lments partie par partie. 23. (Que l'homme), considrant par le moyen de sa pense ces (diverses) conditions de l'esprit vital (rsultant de la du bien ou du mal, dirige toujours son esprit vers pratique) le bien. 24. Sachez que la Bont, la Passion et l'Obscurit sont les trois qualits de l'me le grand par le moyen desquelles et rside dans toutes les choses existantes sans pntre exception. de ces qualits 25. Lorsqu'une absolument dans prdomine un corps, elle rend (l'me) qui est revtue de ce corps minemment distingue par cette qualit. 26. (Le signe distinctif) de la Bont est la connaissance, (celui de) l'Obscurit (est) l'ignorance, (celui de) la Passion 20. Ces mmes lments la terre et les autres transforms en un corps grossier . (Kull.) 21. Dpouille aprs la mort, de ces lments qui constituaient le corps humain, et revtue d'un corps durable propre sentir les tourments, form des particules subtiles des lments . (Kull.) 22. Cet esprit vital le jva. Revt, c'est- -dire reprend un corps humain ou autre . (Kull.) Partie par partie, c'est--dire chacun dans la proportion voulue. 24. Les trois qualits sattva, rajas et tamas sont suivant la philosophie snkhya le subslratum de tout ce qui existe. L'me, c'est--dire suivant Kull. le mauat. Le grand, l'intelligence, cf. v. 14, note.
LES LOIS DE MANOU est l'amour
369
telle est la nature de ces (trois quaet l'aversion; et rside dans toutes les choses existantes. lits) qui pntre de joie, 27. Quand on dcouvre dans son me un sentiment la une sorte de calme, un clat pur, on doit y reconnatre qualit de Bont. de peine et cause du 28. Dans tout ce qui est accompagn de Passion, l'me, on doit reconnatre (la qualit) dplaisir les irrsistible et entrane perptuellement (laquelle est) d'un corps (vers les objets des sens). (mes) revtues de confusion, tout ce 29. Dans tout ce qui est accompagn tout ce qu'on ne d'une matire indistincte, qui a le caractre la on doit reconnatre ni connatre, ni conjecturer, peut d')Obscurit. (qualit 30. Je vais maintenant dclarer quels sont compltement excelles rsultats (rsultats) par ces trois qualits, produits ou mauvais. lents, intermdiaires la puret, la science, 31. La lecture du Vda, l'austrit, et la des devoirs sur les sens, l'accomplissement l'empire de la quasur l'me, (voil) les signes distinctifs mditation lit de Bont. entreprendre, le manque de 32. Le plaisir (qu'on prend) contila pratique des actes criminels et la poursuite fermet, distinctifs de la nuelle des objets des sens, (voil) les signes de Passion. qualit la cruaut, la somnolence, 33. La cupidit, l'irrsolution, l'habile dlaissement des bonnes coutumes, le scepticisme, tude de mendier et la ngligence, (voil) les signes distinctifs de la qualit d'Obscurit. 29. Confusion incapacit de discerner le bien du mal . (Kull.) On peut crire en deux motsavyaktam vishaytmakam, leon suivie par B. H. ce qui est indistinct, ce qui a pour essence le sensuel . Connatre ni par le sens intime (ou conscience), ni par les sens extrieurs . 30. Excellents, intermdiaires ou mauvais, littr. le premier, celui du milieu, le dernier. 32. A entreprendre en vue d'un profit . (Kull.) 33. Bhinnavrtti est expliqu par craparilopa le dlaissement des bonnes coutumes. (Kull.) 24
370
LES LOIS DE MANOU
et par ordre les signes dis34. En outre, voici en rsum dans se trouvent tinctifs de ces trois qualits (telles qu'elles) les trois (temps, le prsent, le pass et l'avenir). fait ou qu'on va faire, 35. Si un acte qu'on a fait, qu'on doit le consiinstruit vous cause de la honte, 1'(homme) de la qualit distinctif drer comme du signe marqu d'Obscurit. on dsire (acqurir) 36. Sachez que tout acte par lequel la et dont (toutefois) une renomme brillante en ce monde, du signe distincne vous afflige pas, (est marqu non-russite tif de la qualit) de Passion. de tout (son coeur), ce dsire connatre 37. Mais ce qu'on de la et ce dont l'me prouve sans honte qu'on accomplit du signe distinctif de la cet (acte) est marqu satisfaction, Bont. 38. de l'ObscuLe dsir (sensuel) est dit le signe distinctif la (recherche de la) richesse de la Passion, rit, (celui) de la Bont ; de (l'amour de) la vertu (est) le signe distinctif nomme ces (trois choses), c'est toujours la dernire qui est meilleure (que la prcdente). 39. Je vais brivement les transmiexposer par ordre travers tout cet (univers) (l'me) auxquelles grations est soumise, suivant chacune de ces trois (qu'elle possde) qualits. la 40. Ceux qui ont la qualit de Bont parviennent la condition ceux qui ont la qualit de Passion divine, condition ceux qui ont la qualit d'Obscurit humaine, (des la condition telles sont les trois animale; cendent) toujours de transmigrations. (sortes) 34. Le texte dit simplement : dans les trois (choses) trishu, mais les commentateurs sont d'accord pour l'entendre des trois moments du temps. A noter la leon de Nand. nrshu, dans les hommes. 37. Sarvena, Kull. commente par sarvtman. B. H. traduit diffremment en prenant jtum avec la valeur passive un acte qu'on dsire tre connu de chacun . Ce qu'on dsire connatre le sens du Vda, etc. . (Kull.) 38. L'amour de la vertu, ou bien la recherche du mrite spirituel (dharma).
LES LOIS DE MANOU
371
de transmigrations 41. Mais sachez que ces trois sortes a leur tour) en trois dues aux (trois) qualits (se subdivisent suivant les diffet suprieur, infrieur, (degrs), moyen rences des actes et du savoir (de chacun). 42. (tres) inanims, vers et insectes, poissons, serpents, ainsi que tortues, btail et animaux la sauvages (composent) condition infrieure l'Obscurit. que produit 43. lphants, Soudras et Barbares chevaux, mpriss, la condition lions, tigres, sangliers (composent) moyenne l'Obscurit. que produit 44. Baladins, et vampires dmons oiseaux, hypocrites, la condition (composent) suprieure parmi celles que produit l'Obscurit. 45. Btonnistes, lutteurs, comdiens, gens qui subsistent d'un mtier vil, joueurs et buveurs la condition (composent) infrieure produite par la Passion. 46. Rois, des rois, et les guerriers, prtres domestiques hommes dans la controverse la qui excellent (composent) condition moyenne produite par la Passion. 47. Musiciens Yakchas clestes, Gouhyakas, (et) Gnies au service des dieux, ainsi que les Nymphes clestes (composent) la condition suprieure produite par la Passion. 48. Ermites, des divinits les troupes asctes, Brahmanes, aux chars et les Daityas les astrismes lunaires ariens, 42. tres inanims, arbres, etc. . (Kull.) 43. Barbares, mleccha, l'pithte mpriss ne restreint pas la comprhension du terme. 44. Sur les oiseaux ou suparnas cf. livre I, 37. Les Dmons et les Vampires, les Rkshasas et Picas. Cf. I, 43. 45. Au lieu de kuvrttayah Kull. lit astravrttayah ceux qui vivent du mtier des armes, les matres d'armes. 47. Les Gandharvas ou musiciens clestes ; les Guhyakas et les Yakshas sont des demi-dieux gardiens des trsors, au service de Kuvera. Les Apsaras sont les Nymphes clestes. 48. Les troupes des Vaimnikas ou divinits qui se meuvent dans des chars ariens appels vimnas. Les Daityas ou descendants de Diti sont des gants ennemis des dieux.
372
LES LOIS DE MANOU
la condition infrieure produite par la Bont. (composent) 49. Sacrificateurs, Dieux, Vdas, constellations, Sages, Mnes et Sdhyas la condition annes, moyenne (composent) produite par la Bont. la Loi, le Grand 50. Brahm, les Crateurs de l'Univers, au dire des Sages, la condition et l'Invisible (composent), produite suprme par la Bont. en entier tout ce (systme 51. Ainsi (vous) a t expliqu sortes d'actes, de) transmigrations (produit) par les trois a) trois subdivide) trois classes, (dont chacune (compos toutes les cratures. sions et qui embrasse aux (objets 52. (En punition) de l'attachement des) sens, les ignorants, les plus vils des de la ngligence des devoirs, les plus basses. ont en partage les naissances hommes, 53. Apprenez maintenant en dtail et par ordre pour quelles dans telle ou actions ici-bas vital entre (commises) l'esprit telle matrice en ce monde. de longues sries d'annes 54. Aprs avoir subi pendant sont les grands criminels d'affreux (tourments en) enfer, sui l'expiration de ce temps aux transmigrations soumis : vantes d'un Brahmane entre dans le corps d'un 55. Le meurtrier d'une vache, d'une chien, d'un porc, d'un ne, d'un chameau, d'une d'un daim, d'un oiseau, d'un Tchnchvre, brebis, dla, d'un Poulkasa. 49. Les Sdhyas sont une classe de divinits infrieures, personnifiant les rites et prires du Vda, habitant avec les dieux ou dans la rgion intermdiaire entre ciel et terre. 50. Les crateurs Marci et les autres . (Kull.) Le Grand et l'Invisible, le Mahn et l'Avyakta sont les deux principes du systme Snkhya personnifis. 53. L'esprit vital le jva. Matrice, c'est--dire existence . (Kull.) 54. Sont soumis pour ce qui reste de leurs fautes (c'est--dire pour achever leur expiation) . (Kull.) 55. Dans le corps littr. dans la matrice. Il entre dans l'une quelconque de ces matrices suivant la gravit ou la lgret de ce qui lui reste a expier de sa faute . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
373
56. Un Brahmane buveur de sour entrera (dans le corps) d'un ver, d'un insecte, d'un papillon de nuit, d'un oiseau qui se nourrit d'excrments ou d'un animal destructeur. 57. Un Brahmane mille fois (dans des qui a vol (passera) de serpents, d'animaux de lzards, corps) d'araignes, aquadestructeurs. tiques ou de vampires 58. Celui qui a profan la couche d'un gourou (renatra) cent fois ( l'tat) de brin d'herbe, de ronce, de liane, (d'oiseau) de crocs et (de bte) dont la carnassier, (d'animal) pourvu nature est sanguinaire. 59. Ceux qui aiment faire le mal deviennent des carnasdes aliments des vers; les siers; ceux qui mangent dfendus, ceux qui ont comdes (tres) qui s'entre-dvorent; voleurs, merce avec des femmes de la plus basse caste, des revenants. 60. Celui qui a frquent des gens dgrads (de leur caste), et celui qui avec la femme d'autrui, qui (a eu des relations) devient un a vol un bien appartenant un Brahmane, dmon ennemi des Brahmanes. a drob des diamants, des 61. L'homme qui par cupidit renat (autres) parmi perles ou du corail, ou divers joyaux les orfvres. 62. Pour avoir vol du grain il devient rat, (pour avoir flamant, vol) du cuivre (il devient) (pour avoir vol) de l'eau (il devient) d'eau, poule (pour avoir vol) du miel (il 56. Animal destructeur, tigre, etc. . (Kull.) 57. Qui a vol l'or d'un Brahmane . (Kull.) Vampires ou Picas. 5S. D'un gourou, c'est--dire de son pre naturel ou spirituel. D'oiseau carnassier, vautour et autres . (Kull.) D'animal pourvu de crocs, lion, etc. . (Kull.) Bte dont la nature est sanguinaire, littr. commettant des actes cruels, expression commente par vailhala. 59. Des tres qui s'entre-dvorent des poissons et autres . (Kull.) Des revenants prtas. 60. Un bien appartenant un Brahmane, mais non de l'or. (Kull.) Un dmon appel Brahmarkshasa. 61. Orfvres quelques-uns entendent par l l'oiseau appel hemakra . (Kull.) C'est en effet un sens trs acceptable. 62. Des essences, de la sve de canne sucre, etc. (Kull.)
374
LES LOIS DE MANOU
taon, (pour avoir vol) du lait (il devient) corneille, devient) chien, (pour avoir (il devient) (pour avoir vol) des essences un ichneumon. vol) du beurre clarifi (il devient) du lard, 63. (S'il a vol) de la viande (il devient) vautour; de (l'huile un (oiseau) du cormoran; de) ssame, tailapaka; du lait suri, un oiseau balk. sel, un grillon; 64. S'il a drob de la soie (il devient) perdrix ; de la toile, une toffe de coton, courlis; une vache, iguane; grenouille; chauve-souris. de la mlasse, un rat 65. (S'il a vol) des parfums prcieux, (il devient) des lgumes feuilles, un paon; des aliments musqu; prdes aliments non prsortes, un porc-pic; pars de diverses pars, un hrisson. 66. S'il a drob du feu, il devient hron ; des ustensiles, de couleur, il renat (sous la forme gupe ; pour vol d'toffes d'un) francolin. 67. (S'il a vol) un daim ou un lphant, (il devient) loup; un cheval, et fruits, des racines (il devient) singe; tigre; une femme, des voitures, ours; de l'eau, coucou; chameau; du btail, bouc. 68. L'homme quel objet qui a drob par force n'importe autrui, ainsi que celui qui a mang les gteaux appartenant du sacrifice avant qu'ils aient t offerts ( une divinit), renatra invitablement l'tat de bte. 63. Cormoran (?) madgu, espce d'oiseau d'eau. Tailapaka, oiseau inconnu, ce nom signifie buveur d'huile. Balk, cigogne (?). 65. Aliments, anna signifie aussi plus particulirement du riz. On pourrait traduire du riz cuit et du riz cru . 66. Francolin (?) o perdrix rouge (?). Quelques-unes de ces attributions reposent sur une similitude d'attributs : ainsi le voleur de parfums devient un rat musqu ; le voleur d'toffes de couleur devient une perdrix rouge; d'autres reposent sur une simple allitration, vgguda chauve-souris, et guda mlasse; d'autres enfin paraissent tout fait arbitraires. 67. De l'eau pour boire . (Kull.) Coucou stokaka qui demande une goutte d'eau appel aussi ctaka, Cuculus melanoleucus, oiseau qui passe chez les Hindous pour ne boire que de l'eau de pluie. 68. Offerts, c'est--dire avant qu'on en ait jet une partie dans le feu .
LES LOIS DE MANOU 69.
375
Les femmes aussi qui ont commis un vol d'une manire du (mme) se chargent elles renaissent pch; analogue de femelles de ces mmes tres (qu'on vient d'nul'tat mrer). 70. (Les hommes des quatre) castes qui sans ncessit ont abandonn leurs devoirs respectifs, aprs avoir transmigr dans des existences renaissent dans la condition misrables, d'esclaves parmi leurs ennemis. 71. Un Brahmane ses devoirs devient un qui a manqu revenant de vomisse(appel) Oulkmoukha qui se nourrit un Kchatriya un revenant ment; (devient appel) Katapotana qui se nourrit d'immondices et de cadavres. ses devoirs 72. Un Vaisya devient un qui a manqu revenant (appel) Maitrkchadjyotikaqui mange du pus; un Soudra devient (un revenant appel) Tchailsaka. 73. Plus les gens dont l'me (est porte la) sensualit s'adonnent aux (plaisirs des) sens, plus leur propension augmente. 74. Par la rptition de ces actes coupables, ces insenss s'attirent ici-bas des souffrances dans ces diverses transmigrations (que voici) : 75. Le sjour dans le Tmisra et autres enfers pouvantables, la fort (dont les arbres ont) des pes en guise de feuilles et autres (lieux horribles), la captivit et les mutilations ; 70. Leurs devoirs respectifs, les crmonies telles que les cinq sacrifices et autres . (Kull.) Ennemis, littr. les Dasyus; une autre leon du reste porte atrushu au lieu de dasyushu. 71. Ulkmukha veut dire : dont la bouche est un brandon enflamm ; le sens du mot kataptana est obscur. 72. Maitrkshajyotika est suivant Kull. un dmon qui son anus sert d'oeil, ou qui a une lumire dans l'anus ; c'est du reste l'explication de ce compos. Quant au Cailsaka c'est un Prta ou revenant qui se nourrit de poux . 74. Insenss, littr. de peu d'intelligence. Ces diverses transmigrations dans des matrices de plus en plus mprisables d'animaux et autres . (Kull.)
376
LES LOIS DE MANOU
76. Diverses tortures dvor (telles que) d'tre par des corneilles et des chouettes, de (manger) une bouillie de et d'tre sable brlant cuit dans des pots, (supplice) intolrable ; 77. Renaissances dans des matrices perptuelles (d'tres) infrieurs exposs des maux sans fin, tourments par le froid de toutes sortes ; et le chaud et terreurs 78. Sjour dans naissances matrices, rpt (diverses) sous les autres ; pnibles, captivits rigoureuses, esclavage d'avec leurs parents et amis, et cohabita79. Sparation tion avec les mchants, des richesses perte gagnes, acquisition d'amis (qui deviennent des) ennemis; 80. Vieillesse sans ressources, tourments des maladies, afflictions de-toute espce et (enfin) la mort invincible, (telles sont les preuves qui les attendent). 81. Dans quelque disposition d'esprit qu'on accomplisse tel ou tel acte, on en recueille le fruit avec un corps dou de cette mme qualit. 82. Ainsi ont t expliqus entirement les origines et les des actes; apprenez rsultats les actes qui pro(maintenant) curent un Brahmane la dlivrance, finale. 83. L'tude du Vda, les austrits, la connaissance, ses sens, ne point faire de mal (aux cratures), servir dompter son prcepteur spirituel, (tels sont) les meilleurs moyens la dlivrance finale. (d'arriver) 78. Sjour rpt, le seul fait de renatre plusieurs fois constitue par luimme une peine. 79. Perte des richesses gagnes, littr. acquisition et perte de biens, c'est--dire biens acquis pour les reperdre ensuite. 80. Vieillesse sans ressources ou peut-tre l'ge (mal) incurable . 81. Disposition- d'esprit produite par la qualit de Bont, la qualit de Passion, ou la qualit d'Obscurit . (Kull.) Le corps futur sera dou d'une de ces trois qualits, suivant l'esprit dans lequel on a accompli l'acte tel que bain, aumne, etc. . (Kull.) Cf. v. 41 sqq. les divers corps produits par chacune des trois qualits avec leurs trois degrs. 83. La connaissance ayant pour objet Brahme . (Kull.)
LES LOIS DE MANOU
377
en en ce monde, ces actions vertueuses 84. Parmi toutes est-il une (qui soit) dclare (que les autres) plus propre finale? l'homme la dlivrance conduire de l'me est dclare la 85. Entre toutes, la connaissance de toutes les sciences, elle est la premire plus excellente; l'immortalit. car par elle on obtient tous les six actes 86. Parmi (prcdemment numrs), tre consiles actes prescrits par le Vda doivent toujours drs comme les plus efficaces pour assurer la flicit suprme ici-bas et dans l'autre monde. 87. Car dans l'accomplissement des actes prescrits par le sont contenus sans exception Vda, tous les autres (actes) par ordre dans les diverses rgles des crmonies. 88. Les actes prescrits par le Vda sont de deux sortes, les uns procurant le bonheur les autres assurant (matriel), les autres la dlivrance finale; les uns ayant un but intress, un but dsintress. 89. Un acte qui assure la russite d'un dsir ici-bas ou 84. Ce vers est une question adresse par les grands Sages Bhrgu qui leur rpond au vers suivant. 85. La connaissance de l'Ame de l'me suprme, paramtman, enseigne par les Upanishads . (Kull.) 86. Karma vaidikam, Kull. l'entend dans le sens de paramtmajna la connaissance de l'me suprme; les autres commentateurs au contraire prennent cette expression dans son sens littral, acte prescrit par le Vda , c'est--dire les rites, les sacrifices. Le v. 85 n'a en vue que le moksha ou dlivrance finale, tandis que le v. 86 considre la flicit en ce monde et dans l'autre. 87. Ici Kull. explique karma vaidikam par l'adoration de l'me suprme . 88. Dans ce vers au contraire Kull. donne karma vaidikam son sens ordinaire le jyotishtoma et autres sacrifices . Les actes dits pravrtta sont les crmonies faites dans le but d'une rcompense ici-bas ou dans l'autre monde, les actes dits nivrtta sont les crmonies faites sans aucune vue intresse, et partant plus mritoires que les autres. B. traduit : Qui causent une continuation de l'existence mondaine, pravrtta , et qui causent une cessation de l'existence mondaine, nivrtta . Au fond l'ide est la mme. 89. D'un dsir un sacrifice pour obtenir de la pluie . (Kull.) Dans
378 dans
LES LOIS DE MANOU
mais celui qui est l'autre monde est appel intress; et (qu'on accomplit tout dsir (de rcompense) tranger (de l'tre divin) aprs avoir) d'abord (acquis) la connaissance est dclar dsintress. 90. Celui qui accomplit des actes intresss atteint l'galit mais celui-ci de rang avec les dieux; des qui accomplit actes dsintresss des cinq s'lve assurment au-dessus lments. 91. Celui qui voit galement soi-mme dans tous les tres et tous les tres dans soi-mme, s'offrant soi-mme en sacriavec l'tre qui brille de son propre clat. fice, s'identifie 92. Un Brahmane, mme aprs avoir renonc aux rites la connaissance doit s'appliquer prescrits (par les Sstras), de l'me suprme, l'extinction (de ses passions) et l'tude du Vda. 93. Car c'est en cela que consiste surtout pour un Brahmane l'objet principal de l'existence cela ; c'est en atteignant et non autrement ses fins. qu'un Dvidja parvient 94. Le'Vda est l'oeil ternel des Mnes, des Dieux, des hommes ; le livre du Vda ne peut pas avoir t fait (par les il est incommensurable ; hommes), (pour la raison humaine) telle est la dcision. l'autre monde &un sacrifice tel que le jyotishtoma et autres en vue d'obtenir le paradis . (Kull.) Jfinaprva peut signifier aussi ayant la connaissance pour guide, dirig par la connaissance . 90. Qui accomplit : il faut entendre cela d'actes pieux rpts frquemment. Au-dessus des cinq lments, c'est--dire se dpouille des lments qui composent le corps, atteint la dlivrance finale . (Kull.) 91. Soi-mme, c'est--dire qui se dit : Moi je suis contenu dans tous les tres anims et inanims, et tous les tres sont contenus en moi. (Kull.) tmayjin, qui se sacrifie lui-mme ou qui sacrifie soi-mme, signifie suivant Kull. qui accomplit le jyotishtoma et autres sacrifices suivant la manire du Brahmrpana . S'identifie avec l'tre qui brille de son propre clat (avecBrahm), c'est--dire obtient la dlivrance finale. On peut traduire aussi il obtient l'indpendance, la domination , car la racine rj a les deux sens de briller et de rgner. 93. Parvient ses fins krtakrtya signifie littr. qui a fait ce qu'il devait faire, c'est--dire qui voit tous ses dsirs accomplis.
LES LOIS DE MANOU
379
95. Tous les textes rvls qui ne reposent pas sur le Vda et tous les faux systmes de philosophie ne produisent aucun carils sont dclars fonds sur l'Obscurit. fruitaprslamort; 96. Et tous les (systmes) autres que le (Vda) qui naissent et meurent sont striles et mensongers, (rapidement) parce qu'ils sont de date plus rcente. 97. Les quatre castes, les trois mondes, ordres les quatre le prsent, le pass et le futur, tout cela est explidistincts, qu au moyen du Vda. 98. Le son, la tangibilit, la forme, le got et l'odeur, ce sont expliqus au moyen du Vda seul, cinquime (attribut), les qualits et les actes. selon l'origine, 99. L'ternel trait du Vda soutient tous les tres ; c'est comme la (chose) celle qui je considre pourquoi suprme cette crature assure la flicit (l'homme). 100. Commandement des armes, pouvoir royal, fonctions sur le monde entier, de juge, souverainet celui qui connat le trait du Vda est digne de tout. 101. De mme qu'un feu violent consume mme les arbres ainsi celui qui connat efface toutes les le Vda humides, de son me, nes de ses (mauvaises) actions. souillures 102. En quelque ordre que se trouve (un homme) connaissant le vritable sens du trait du Vda, mme tandis qu'il l'union est (encore) en ce bas monde, il devient propre avec Brahme. 95. Les textes rvls Jolly imprime rutayah. D'autres textes portent smrtayah les traditions. 96. Qui naissent, Kull. prcise en disant qu'ils sont sortis de la main des hommes. 97. Prasidhyati signifierait plus littr. dpend du Vda pour sa russite. 98. Le compos gunakarmatah est obscur. Kull. entend karman au sens de karma vaidikam, et guna au sens des trois qualits primordiales. Bont, Passion, Obscurit: le sens seraitalors par le moyen des rites vdiques drivant des trois qualits de Bont, Passion et Obscurit, sources du son, de la tangibilit, etc. 99. Cette crature, Kull. entend par l l'homme qui est propre accomplir les rites vdiques .
380
LES LOIS DE MANOU
103. Ceux qui ont lu sont suprieurs aux ignorants; ceux qui retiennent (ce qu'ils ont lu) sont plus estimables que ceux qui ont lu (mais oubli) ; ceux qui comprennent (le sens de ce qu'ils ont appris) sont suprieurs ceux qui retiennent ceux qui mettent en pratique (sans comprendre); (ce qu'ils ont appris valent mieux) que ceux qui comprennent (mais qui ne pratiquent point). 104. L'austrit et la science (sacre) sont le plus excellent la dlivrance finale ; moyen pour un Brahmane (d'atteindre) il tue le pch, par la science il obtient l'impar l'austrit mortalit. 105. La perception, l'induction et les traits comprenant les divers trois traditionnels, enseignements (voil) de quiconque dsire (choses qui) doivent tre bien comprises la claire intelligence del Loi. seul et nul autre, 106. Celui-l connat la loi qui, s'apsur un systme en harmonie avec le philosophique puyant du Vda, mdite trait des anciens (l'oeuvre) sages et les de la Loi. prceptes 107. Ainsi ont t compltement et exactement expliqus la dlivrance les actes qui assurent finale ; (maintenant) on la partie secrte va rvler de ce trait de Manou. : Dans les (cas de la) loi qui n'ont 108. Si l'on demande ? pas t mentionns, quelle doit tre (la rgle de conduite) : Ce que des Brahmanes instruits dci(voici la rponse) deront (aura force de) Loi sans contestation. comme instruits les Brahmanes 109. Doivent tre reconnus et qui ont tudi selon la Loi le Vda avec ses appendices, sensibles du livre rvl. qui peuvent donner des preuves 104. La science la connaissance de l'me universelle . (Kull.) 105. Les traits Kull. explique stra parla Smrti. Les enseignements traditionnels, les gamas, les livres d'enseignement des diverses coles. 106. L'oeuvre des anciens sages, le. Vda dont les hymnes sont attribus aux Richis. 109. Selon la loi en observant les prescriptions relatives aux tudiants et autres . (Kull.) Ses appendices les Angas, qui sont la Mmms, le
LES LOIS DE MANOU
381
110. Ce qu'une assemble d'au moins dix, ou d'au moins trois (personnes) vertueuses aura dcid (tre) la loi, que ne le conteste. personne 111. Trois (personnes) verses dans un) des trois (chacune un logicien, un interprtateur MVdas, (de la doctrine un tymologiste, un jurisconsulte et un membre de mns), chacun des trois premiers constituent l'assemble ordres, d'au moins dix membres. un Yadjour-Vdiste et un Sma112.. Un Rig-Vdiste, Vdiste doivent tre considrs l'assem(comme constituant) ble d'au moins trois membres des points pour la dcision douteux de la loi. 113. Ce que mme un seul Brahmane dans le Vda instruit dclare comme (ayant force (tre) la loi doit tre considr de milliers de) loi suprme, plutt que la dcision d'ignorants. 114. (Mme) des milliers (de Brahmanes) qui n'ont pas qui ne sont pas verss dans rempli leurs voeux (de noviciat), le Vda et qui vivent de leur uniquement (du privilge) une assemble ne constituent caste, pas en se runissant (lgale). 115. Le pch de celui qui a t instruit par des sots, personnifications de l'Obscurit, et ignorants de la loi, retombe sur ceux qui (lui) ont expos la (loi). au centuple multipli Code des lois et les Purnas . (Kull.) La Mmms dsigne un systme philosophique ayant pour objet l'interprtation du Vda. Ceux qui peuvent donner des preuves sensibles, les Brahmanes qui en rcitant le texte rvl, sont cause qu'il devient perceptible par les sens, qui en enseignent le vritable sens . (Kull.) 111. Un logicien haituka, suivant Kull. celui qui connat le systme du Nyya qui n'est pas en contradiction avec la ruti et la Smrti . Un interprtateur de la doctrine Mimms'.le texte dit simplement tarkin comment par le compos mmmstmakatarkavid. Les trois premiers ordres, c'est--dire tudiant, matre de maison, ermite . 114. Leurs voeux, qui n'ont pas rempli les voeux d'un tudiant, tels que (ceux relatifs ) la Svitr et autres . (Kull.) 115. Tamobhta signifie littr. dont la nature est la qualit d'obscurit.
382
LES LOIS DE MANOU
la 116. Tous les (moyens) les plus excellents pour assurer dlivrance finale vous ont t exposs ; un Brahmane qui ne s'en carte pas obtient la condition la plus leve. dans son dsir 117. C'est ainsi que cette auguste divinit, des mondes me rvla tout ce mystre (de faire) le bonheur de la loi (sacre). suprme son attention, voie 118. Que (le Brahmane) recueillant dans son me individuelle le rel et le non rel; l'univers, il n'abancar en voyant dans son me individuelle l'univers, donne pas son esprit l'iniquit. l'univers 119. L'me seule (est) toutes les divinits; repose des sur l'me ; car (c'est) l'me (qui) produit l'enchanement actes des (tres) corporels. voie l'identit 120. Que (le Brahmane par la mditation) de l'ther avec les cavits du corps, du vent avec (les organes) avec du mouvement et du toucher, de la lumire suprme de la digestion et de la vue, de l'eau avec les (les organes) charnues avec les parties (de parties grasses et de la terre son corps); clestes avec 121. De la lune avec l'esprit, des rgions de la locode l'oue, de Vichnou avec (les organes) (l'organe) de la d'Indra avec la force, du feu avec (l'organe) motion, et du Seigneur parole, de Mitra avec les (organes) excrtoires des cratures avec (les organes) de la gnration. 117. C'est Bhrgu qui parle, et l'auguste divinit qui lui a rvl la loi est Manou. Le mystre qui doit tre tenu cach aux disciples indignes . (Kull.) 118. tman dsigne ici suivant Kull. l'me suprme , et suivant Govind. l'me individuelle . 119. Ici tman suivant Govind. est l'me suprme. 120. Voie l'identit, littr. fasse entrer samniveayet. L'tlier, jeu de mots sur khaether, et kha trou du corps (il y en a neuf). Lumire tejas du feu et du soleil . (Kull.) Sneha, littr. graisse. Kull. l'entend des fluides du corps. D'autres comme Medh. y voient la cervelle et autres substances analogues . Les parties charnues mrti est expliqu par arraprthivabhga les portions terrestres du corps . 121. L'esprit le manas, le sens interne. Les rgions clestes diah au
LES LOIS DE MANOU
383
122. Qu'il reconnaisse le Mle suprme comme le souverain de toutes mme, (choses), plus subtil que le subtil brillant comme l'intelligencB accessible l'or, (seulement quand elle est comme) endormie (dans la contemplation). 123. Les uns l'appellent les autres Manou seigneur Agni, d'autres le souffle vital, d'autres des cratures, Indra, d'autres Brahme. l'ternel 124. Pntrant toutes les cratures par le moyen des cinq il leur fait accomplir un cycle perplments (constitutifs), et l'accroissement tuel de transmigrations par la naissance, la destruction. de son) me (indivi125. Ainsi celui qui par (le moyen dans tous les tres, l'me reconnat (universelle) duelle) envers tous et s'absorbe devient anim des mmes sentiments en Brahme, (ce qui est) la condition suprme. rvl par 126. Un Dvidja de Manou qui rcite ce Trait aura toujours une conduite vertueuse et atteindra Bhrigou, la condition qu'il souhaite. nombre de huit reprsentant les points cardinaux et prsides par huit divinits. Indra est appel ici Hara. Le feu, Agni. Je souponne un calembour sur Mitra et mtra urine. Prajpati est rapproch en sa qualit de crateur des organes de la gnration. 122. Endormie, l'oeil et les autres sens extrieurs suspendant leurs fonctions , la contemplation est une sorte de sommeil. Sur le Mle, le Purusha qui n'est autre que Brahme, cf. liv. I, v. 11. 124. Des cinq lments les enveloppant avec des corps forms des cinq grands lments tels que la terre, etc. (Kull.) Un cycle littr. comme une roue de voiture. 126. Le vers commence par le mot iti qui marque la fin du discours de Bhrgu. (Kull.) Le dernier vers n'est donc pas dans la bouche du narrateur des lois de Manou. La condition qu'il souhaite, c'est le paradis, la dlivrance finale . (Kull.) FIN
ERRATA
Page >> .
2 ligne 29 au lieu de 1116 30 11 13 15 28 21 39 32 34 34 87 33 94 29 101 -31 107 33 108 20 176 24 260 30 279 32 340 33
Sankhya lisez Snkhya. Aouttami. Auttami karman. karma Brahmane Brahmane. Brahmane Brahmane. vyhrtis. vihrtis brhmana brhmana. Vishnu. Vishnu Vishnu. Vishnu prnh. prns Jolly. Joly Sanghta. Samghta Voulut. Voulu, Vasishtha Vasishtha. Kchatriy. Kchariy dite de de dite
25
INDEX
A Abhidjit (sacrifice), XI,' 75. Abhra (caste), X, 15. . Acquisition (moyens lgaux d'), X,115. Adhvaryou (prtre), VIII, 209. dityas III, (divinits), 284; XI, 222. Adjgarta (sage), X, 105. djyapas (mnes), III, 197,198. Adoptif (fils), IX, 141,159. Adultre, IV, 134; VIlI,352sqq., 371 sqq., 382 sqq.; XI, 103 sqq., 170 sqq. Agastya (sage), V, 22. Age (d'une pouse), IX, 94. (les quatre du monde), I, 68 sqq., 81 sqq. ; IX, 301, 302. (des dieux), I, 71. III, 85, Agni (le feu, divinit), 211 ;V, 96; IX, 303, 310; XI, 120,122; XII, 121, 123. Agnichtoma (sacrifice), II, 143. XI, 75. Agnichtout (sacrifice), Agnictivttas (mnes), III, 195, 199. Agnidagdhas (mnes), III, 199.
II, 15; Agnihotra (sacrifice), IV, 10; XI, 36, 41, 42. Agnydheya (sacrifice), II, 143; VIII, 209; XI, 38. havanya (feu), II, 231. AMna (sacrifice), XI, 198. hindika (caste), X, 37. Ahouta (sacrifice), III, 73, 74. Anesse, IX, 105 sqq.; XI, 186. Akchaml (personnage mythologique), IX, 23. Alimentation de la (crmonie II, 34. premire), Aliments (permis ou dfendus), IV, 205 sqq., 247 sqq., 253; V, 5 sqq.; X, 104 sqq.; XI, 153 sqq. Ambachtha (caste), X, 8, 13,15, 19, 47. Ambassadeur, VII, 63 sqq., 153. Ame, I, 15, 54; VI, 29, 49,63, 65, 73, 82; VIII, 84; XI 1,85, 91, 92, 118,119,125. VIII, 138, 159; IX, Amendes, 229, 231. Amour de soi, II, 2. Amrita, 111,285; IV, 4, 5. (mnes), 111,199. Anagnidagdhas
388
INDEX Austrit, I, 33, 34,41, 86,110; II, 83, 97,164,166,167,228, 229; III, 134; IV, 148, 236; V, 107; VI, 22, 23, 30, 70; XI, 101, 235 sqq. ; XII, 31, 83, 104. Autorise III, 173; (femme), IX, 59 sqq. vantya (caste), X, 21. Avortement, XI, 88. vrita (caste), X, 15. yogava (caste), X, 12,15,16, 26, 32, 35, 48. B Bain I, 111; II, 245; (final), 111,4. (rgle du), 11,176; IV, 45, 129, 201, 203; VI, 69. Bali (offrande), III, 70, 74, 81, 87, 89, 90, 91, 94, 108, 121, 265; VI, 7. Barhichads III, 196, (mnes), 199. Bton, II, 45 sqq., 64, 174; IV, 36. Bhadrakl III, 89. (divinit), X, 107. Bharadvdja (ascte), Bhridjjakantaka (caste), X, 21. Bhrigou (sage), I, 35, 59, 60; III, 16; V," 1,3; XII, 2,126. et Svah (paBhoh, Bhouvah roles sacramentelles), II, 76, 78, 81; VI, 70; XI, 223, 249. Bont (qualit), XII, 24 sqq. masc. le Crateur, Brahm, Brahme ou Brahman, neut.,
Andhatmisra (enfer), IV, 88, 197. Andhra (caste), X, 36, 48. Angas (du Vda), II, 105, 141, 242; III, 184, 185; IV, 98; V, 82; IX, 41. Anguiras (sage), I, 35; II, 151; III, 198; XI, 33. Anoumati (divinit), III, 86. IV, 79; Antyvasyin (caste), X, 39. Anvhrya (sacrifice), III, 123. Aouttami (Manou), I, 62. clestes. Apsaras. Cf. Nymphes (trait), IV, 123. ranyaka rcha (mode de mariage), III, 21, 53. rya, 11,39; VII, 69; VIII,75, 179, 395; IX, 253; X, 45, 57, 67. II, 22; X, ryvarta (contre), 34. Asamvrita (enfer), IV, 81. Asipatravana (enfer), IV, 90. Ascte, I, 114; V, 137; VI, 33 sqq.; VIII, 407; XII, 48. soura (mode de mariage), III, 21, 24, 25. Asouras ou mauvais esprits, I, 37; III, 225. svina (mois), VI, 15. Asvins (divinits), IV, 231. " Atharva-Vda (texte), XI, 33. Atome flottant, VIII, 132, 133. Atri (sage), I, 35; III, 16,196. II, 48 sqq., 182 sqq. ; Aumnes, III, 94 sqq.; IV, 33; VI, 43, 50 sqq.; X, 116; XI, 1 sqq.
INDEX l'Absolu,rtre suprme, 1,11, 17, 50,68,72,73; 11,58, 59, 82, 84, 233,244,248; 111,70, 89, 194; IV, 92, 182, 232, 260;V, 93; VI, 32, 79,81,85; VII, 14; VIII, 11,81 ;X, 74; XI,98;XII,50,102,123,125. Brhmanas (traits), IV, 100. II, Brahmndjali (crmonie), 70, 71. Brahmane (caste). (amende paye par les), IX, 229. (attentat contre), IV, 165 sqq.; VIII, 267, 380, 381 ; IX, 235, 237; XI, 55; XII, 55. (crimes des et leur VIII, chtiment), 123,124, 268, 276, 338, 340,378, 379, 383, 385, 392. l'au(demandant mne), II, 49 sqq. (devoirs et fonctions) 1, 88, 102 sqq. ; IV, 2 sqq. ; X, 1, 2, 74sqq., 81 sqq. ; 101 sqq. 117. le (droit prendre bien d'autrui), VIII, 339; XI, 11 sqq. (pouses),III,13sqq. (fonctions judic), VIII, 1,9 sqq., 87, 391; XII, 108 sqq. Brahmane
389
V, 92. (funrailles), (impuret),V,83sqq. sqq. (initiation),II,36 (mnes),III,197,199. (nom), II, 31, 32. I, 31, 93; (origine), XII, 48. (prsents aux), VII, 82 sqq., 37,38,79, 145; XI, 4. I, 93 (puissance), sqq.; IX, 245,313 X, 3; XI, sqq.: 31 sqq. II, 58 (purification), sqq. d'une (purificateurs III, compagnie), 183 sqq. et aliments (repas offerts aux), III, 96 sqq., 125 sqq.; IV, 192. (respect envers les), IV, 39,52,58,135, 142, 162; X, 43. (rites de mariage), III, 23, 24, 35. (salut), II, 122 sqq. (serment), VIII, 113. marque (supriorit parla science), II, 155. VIII, (tmoignage), 88. II, 65. (tonsure), Brhman, VIII, 375 sqq.; IX, 87, 151 sqq., 198.
390 Brahmarchis Brahmvarta 19.
INDEX (pays des), II, 19. (contre), II, 17, Dakcha (divinit), IX, 128,129. Dakchin (le feu du sacrifice), II, 231. Dnavas III, 196, (divinits), 201. Daradas (race), X, 44. Dsa (caste), X, 34. Dasyou (race), V, 131 ; VIII, 66; X, 32,45; XI, 18; XII, 70. Dmons, VII, 23, 38; XI, 96; XII, 60. Cf. aussi Asouras et Rkchasas. Dettes, VIII, 4,47sqq.,139 sqq., 151 sqq., 176, 177. (envers les Mnes), IX, 106. (les trois), IV, 257; VI, 35; XI, 66. Dhanvantari (divinit), III, 85. Dharana (poids), VIII, 135. Dharma (lajusticepersonnifie), VIII, 14 sqq.; IX, I, 81,82; 129. Dhigvana (caste), X, 15, 49. Dieux, 1,22, 67,94; 11,59; III, 201; IV, 130, 152, 224, 251, 257; V.127; VI, 24; VII, 23, 72, 201; VIII, 85, 87,96,103, 110; XI, 20, 26, 211, 243, 245; XII, 49, 94. Djhalla (caste), X, 22. Djyaichtha (mois), VIII, 245. Doctrine sotrique, II, 140. Dravida (caste), X, 22, 44. Drichadvat (rivire), II, 17. Drona (mesure), VII, 126. Dvpara (ge), I, 85, 86; IX, 301, 302.
Brhmyahouta(rite),III,73,74. Bribou (personnage mythologique), X, 107. XI, 120, Brihaspati (divinit), 122. C Cadeaux de mariage (dfendus), 111,53; (permis), III, 54. Castes (changement de), VII, 42 ;X, 42sqq.,64sqq. (devoirs des), II, 26sqq.; X, 63. (exclusion et rintgration), XI, 181 sqq. (mlange des), X, 6 sqq. (origine des quatre), I, 31, 87 sqq.; X, 4,45. Ceinture, 11,42,43, 64,169,174. de la), (crmonie Conception II, 16, 26, 142. Conduite (bonne), II, 6, 12, 18 ; IV, 145. Connaisseur du champ (principe), XII, 12, 13, 14. Contentement de soi-mme, II, 6,12. Cordon sacr, II, 27, 44, 64, 174; IV, 36. Crateur, IX, 16; X,73 ; XII, 50. Cration, I, 1 sqq. D Daityas (divinits), XII, 48. III, 196;
INDEX E Eau (dans la Cration), I, 8, 13, 78. (dans la vie sociale), III, 163; IX, 219,274, 281; XI, 164. (hymne la divinit des), XI, 133. (invocation aux),VIII, 106. lments (les cinq), I, 27. (les grands), I, 6, 18. (subtils), I, 56. d'un (les sept IX, 294 royaume), sqq. Enfants (immdiats), X, 14. (repousss), X, 10. III, 4 pouse (choix d'une), r sqq. poques (o l'on peut approcher une femme), III, 45 sqq. Ermite, VI, 1 sqq. Esprit (manas ou sens interne, cf. ce mot), XII, 4. (crateur), I, 74, 75. (les vitaux), II, 120. (mauvais cf. Asouras). tre (suprme), VI, 43, 72. (existant par lui-mme ou I, 3, 6, Svayambho), 92,94;V, 39; VIII, 124, 413. ther, I, 75, 76. Excommunis (vrtyas), II, 39, 40; VIII, 373; X, 20 sqq.; XI, 63, 198. F
391
Feu, cf. Agni. 364 sqq.; Fornication, VIII, XI, 59, 171. Fortune (desse), IX, 26. Cf. Sri. G Gdhi (personnage mythologique), VII, 42. Gandharvas ou Mu(divinits), siciens clestes, 1,37 ; 111,196 ; VII, 23; XII, 47. (ritedemariagedes), III, 21 sqq., 32; IX,196. Gange (fleuve), VIII, 92. Garouda (oiseau mythologique), VII, 187. Grhapatya (feu du sacrifice), 11,231. Glanure, IV, 5 ; X, 112. Golaka (fils adultrin), III, 174. Gotama (lgislateur), III, 16. Gosava (sacrifice), XI, 75. Gouhyakas (divinits), XII, 47. Grains (considrs comme mesures de poids), (d'orge), VIII, 134; (de moutarde blanche), VIII, 133, 134; (de moutarde noire), VIII, 133. Grand (principe, le Mahat), I, 15; XII, 14, 24, 50. H Havichmats III, 198. (Mnes), Havirbhoudjs (Mnes), III, 197.
392
INDEX J Jeu et pari, 1,115; II, 179; III, 151, 159, 160; IV, 74; VII, 47, 50; VIII, 159; IX, 220 sqq. de Dieu, VIII, 114, Jugement 115, 116. Justice (personnifie). Comparez Dharma. Jour (de Brahm), I, 68, 72, 73. (des dieux), I, 67. (des mnes), I, 66. K Ka (divinit), II, 58, 59. Kchth du temps), (division 1,64. Kaivarta (caste), X, 34. Kal (division du temps), I, 64. Klasotra III, (enfer), 249; IV, 88. I, 85, 86; IX, 301, Kali(ge), 302. Kmbodja (race), X, 44. Karana (caste), X, 22. Krvara (caste), X, 36. Krchpana (valeur montaire), VIII, 136. Kroucha (caste), X, 23. Kasyapa (sage), IX, 129. Katapotana (fantme), XII, 71. Kavi, II, 151 154; III, 198. Kvyas (mnes), III, 199.
IV, 30, 61 ; V, 89, Hrtiques, 90; IX, 225. Hritage (loi de partage), I, 115; IX, 47, 103 sqq. III, 70, 80, 94, 99 Hospitalit, sqq.; IV, 29,179, 182. Hotar (prtre), VIII, 209. Houta (sacrifice), III, 73, 74. I Idoles, III, 152,180; IV, 39, 130, 153. Imposition du nom (crmonie), II, 30; V, 70. Indra III, 87; IV, (divinit), 182; V, 96; VII, 4, 7; VIII. 344, 386; IX, 303, 304 ; XI, XII, 121, 123. 120,122; II, 36 sqq., 148 sqq., Initiation, . 169, 170. ( nouveau), XI, 147, 151,152. Initi (devoirs d'un), II, 69 sqq. Instruments (les cinq de destruction des tres anims), III, 68. de la rcitation du Interruption Vda, II, 105, 106; IV, 101 sqq. Investiture la ceinture (de d'herbe moundja), 11,169,171. (du cordon sacr), 27. Cf. ces II, mots. Invisible (1'), XII, 50.
INDEX (caste). Cf. aussi Roi. g [(choix d'un nom), II, 31,32. I ^ (funrailles), V, 92. .2((mariage), III, 23, 24,26,44. | II, 127. |/(salutation), II, 65. \itonsure), (crimes divers, VIII, 267, 276, 337, 375 sqq., 382 sqq. X, 43, (dgradation), 44. (devoirs et fonctions), 1,89; VII, 87,144; X, 77, 79, 83, 95, 117. (pouses), 111,13,14. II, 36 (initiation), sqq. (mnes), III, 197. I, 31, 87; (origine), XII, 46. II, 62; (purification), V, 83, 99. (tmoignage), VIII, 88,113. Kchattar (caste), X, 12, 13, 16, 19, 26, 49. Khasa (caste), X, 22. Khilas (textes), III, 232. Kinnaras I, 39; (demi-dieux), III, 196. Kirtas (race), X, 44. Kochmndas (textes), VIII, 106. Koudmala (enfer), IV, 89. Kouho (divinit), III, 86. Kchatriya
393
Koukkoutaka (caste), X, 18. Kounda(fils adultrin), III, 174. Kourous (pays des), II, 19; VII, 193; VIII, 92. Koutsa (hymne de), XI, 250. Kouvera ou Koubera (divinit), V, 96; VII, 4, 7,42. Kratou (divinit), I, 35. Krichnala 134, (poids), VIII, 135. I, 69,81, 83, 85, 86; Krita(ge), IX, 301, 302. L Lente (poids), VIII, 133. Libations (aux morts), V, 69, 70, 88, 89. et aux (aux mnes dieux), II, 176; III, 70,82, 283; VI, 24. Litchchivi (race), X, 22. Lohasankou (enfer), IV, 90. Lohatchraka (enfer), IV, 90. titres de la), Loi (les dix-huit VIII, 3 sqq. (des castes, familles, corporations), VIII, 41 sqq. (points douteux), XII, 108 sqq. (source de la), II, 6 sqq. M Mcha, mchaka (valeur montaire), VIII, 134, 135. Madgou (caste), X, 48. (rgion), II, 21. Madhyadsa
394
INDEX ou dfendu), (permis III, 5 sqq. (des veuves), V, 161, 162; IX, 64, 65, 69, 70, 176. Martchi I, 35, 58 ; (divinit), III, 194,195. Marouts III, 88; (divinits), XI, 120, 122, 222. Matsyas (race),II, 19; VII, 193. Mauvais Cf. Asouras. esprits. Mda (caste), X, 36. 54 sqq.; 141, Ministres, VII, IX, 234, 294. 146,216,226; Mitra (divinit), XII, 121. Mixture de miel ou MadhuIII, 3, 119, 120; V, parka, 41 ; IX. 206. Mletchchas (race), II, 23. Mouhorta (division du temps), 1,64. Mrita (aumne), IV, 4, 5. Mariage N I, 37. Cf. Ngas (demi-dieux), Sarpas. Nahoucha (roi), VII, 4L Naissance (crmonie), 11,27,29. II, 148, (seconde), 169. II, 169. (troisime), Nara (divinit), I, 10. Nrada (divinit), I, 35. Nryana (divinit), I, 10. Nata (caste), X, 22. Nichda (caste), X, 8, 18, 34, 36, 37, 39, 48.
Mgadha (caste), X, 11, 17, 26, 47. Mgha (mois), IV, 96. Magie, IX, 290; XI, 31 sqq., 64. Mahnaraka (enfer), IV, 88. Mahraourava (enfer), IV, 88. Mahat (principe). Cf. Grand. Mahvthi (enfer), IV, 89. Mhitra (hymne), XI, 250. Main (parties consacres de la), II, 58, 59. Maitra (caste), X, 23. Maitrkchadjyotika (fantme), XII, 72. Maitreyaka (caste), X, 33. Mle ou Pouroucha (principe), 1,11,19; VII, 17; XII, 122; (hymne ), XI, 252. Malla (caste), X, 22. Mandapla (sage), IX, 23. Mnes, I, 37, 66, 94; II, 58, 59; II 1,91,192 sqq., 284; IV,249, 257; XI, 211; XII, 49, 94. Manou, I, 1 sqq., 36, 61, 63, 102, 119; 11,7; III, 150,194, 222; IV, 103; V, 41, 131; VI, 54; VII, 42; VIII, 124, 139, 168, 204,242, 292, 339; IX, 17, 158, 182, 183, 239; X, 63, 78; XII, 123. Mantras (prires), IV, 100. Manvantara (priode), I, 79, 80. Mrgasrcha (mois), VII, 182. Mrgava (caste), X, 34. Mariage, II, 67. (ge du), IX, 88 sqq. (modes divers de), III, 20 sqq.
INDEX Nichka(valeurmontaire),VIII, 137. du temps), Nimcha (division 1,64. Nimi (roi), VII, 41. Nirriti (divinit), XI, 105, 119. II, 63. Niyitin (crmonie), Nom (choix du des enfants), II, 31 sqq. Noviciat, II, 41 sqq., 175 sqq. Nuit (de Brahm), 1, 68, 72,73. (des dieux), I, 67. (des mnes), I, 66. clestes ou Apsaras, Nymphes I, 37; XII, 47. O Oblations au feu, II, 28; III, 210, 214 ; VIII, 106. Obscurit (qualit), I, 49, 55 ; XII, 24 sqq., 95, 115. OEuf de Brahm, I, 9,12, 13. Offrandes aux dieux et aux mnes, II, 28; III, 82 sqq.; IV, 31; V, 16,45, 52; IX, 142. Offrandes aux Sages, II, 28. OM (syllabe mystique), II, 74 sqq., 81 sqq.; VI, 70; XI, 249, 266. Ordres (les quatre), III, 77, 78; VI, 89 sqq. Organes (les onze), II, 89 sqq. Oudgtar (prtre), VIII, 209. Ougra (caste), X, 9, 13, 15, 19,49. Oulkmoukha XII, (fantme), 71.
395
Oupkarman IV, (crmonie), 95, 119. VI, 29; Oupanichads (traits), XI, 263. Oupavtin II, 63. (crmonie), IV, 96, Outsarga (crmonie), 97, 119. Outathya (personnage mythologique), III, 16. P Pahlava (peuple), X, 44. Pala (poids), VIII, 135. Pana (valeur montaire), VIII, 136,!;138. (caste), X, 37. Pndousopka Pantchla (race), II, 19; VII, 193. Panthna (enfer), IV, 90. Paoucha (mois), IV, 96. Parada (peuple), X, 44. Prasava (caste), IX, 178; X, 8. mari Parivettar (frre cadet avant son an), Parivitta, III, 154,170,171 ; XI, 61. subtiles (Cration), I, Particules 16 sqq. Parvan (jour), III, 45; IV, 150, 153. Passion (qualit), XII, 24 sqq. Pvamn (texte), V, 86 ; XI, 258. Pch originel, II, 27. Pnitence (ardente), XI, 215. XI, 157, (brlante), 213. XI, 216, (loigne), 259.
396 Pnitence
INDEX Pindnvhryaka ( sacrifice ), III, 122. Pistchas ou Vampires, I, 37, 43 ;V, 50 ; XI, 96 ; XII, 44,57. Pitrimedh V, 65. (crmonie), Points cardinaux, I, 13. Politique des rois, VII, 159 sqq.; IX, 294 sqq. (caste), X, 21. Pouchpasekhara Poundraka ou Paoundraka (peuple), X, 44. Poulaha (divinit), I, 35. Poulastya (divinit), I, 35; III, 198. Poulkasa ou Poukkasa (caste), IV, 79; X, 18, 38, 49; XII, 55. Pourna (valeur montaire), VIII, 136. Pournas (textes), III, 232. Pouroucha. Cf. Mle. Pout (enfer), IX, 138. Potimrittika (enfer), IV, 89. Prahouta (sacrifice), 111,73,74. Pramrita (agriculture), IV, 4, 5. Praouchthapada (mois), IV, 95. Prsita III, 73, 74. (sacrifice), Pratchetas (divinit), I, 35. Prtchnvtin II, (crmonie), 63. Prayga (contre), II, 21. Prtre IV, 179; domestique, Vil, 78; XII, 46. Prtas 230; III, (fantmes), XII, 59. Prires, II, 85 sqq. Prise de la main (crmonie), III, 43.
(en forme de grain d'orge), XI, 218. (lunaire), V, 20 ; VI, 20; XI, 41, 107, 126,155, 156, 164, 172, 178, 219, 220. XI. 159, (ordinaire), 178, ] 98, 209. XI, (de Pradjpati), 125, 163, 212. V, 20; (Sntapana), XI, 125, 165,174. avoir bu des (pour liqueurs spiritueuses), XI, 91 sqq., 147 sqq. ou (pour fornication XI, 104 adultre), sqq., 170 sqq. aux (pour infraction voeux du noviciat), II, 181, 187, 220, 221; XI, 119 sqq., 158,159. XI, (pour meurtre), 73 sqq., 127 sqq. avec (pour relations des dgrads), XI, 180 sqq. (pour violences envers les Brahmanes),XI, 205 sqq. (pour vol), XL 89; 100 sqq., 162 sqq. Phlgouna (mois), VII, 182. Pidjavana (personnage mythoVII, logique), 41; VIII, 110.
INDEX Prix nuptial, VIII, 204; IX, 93, 97 sqq. Prithou (roi), VII, 42; IX, 44. Prithiv (la terre, pouse de IX, 44. Prithou), Procdure 1 VIII, judiciaire, sqq. ; IX, 229 sqq. Purification (des objets), V, 110 sqq. (des personnes), II, 53; V, 85 sqq., 134 sqq. d'un ( l'occasion dcs), V, 58 sqq. d'une ( l'occasion naissance ), V, 58 sqq. (pour avoir suivi un enterrement), V, 103. (pour avoir touch un cadavre), V, 64, 65. Q Qualits (les trois), 24 sqq. R Raivata (Manou), I, 62. Rkchasas (dmons), I, 37, 43; III, 21 sqq , 33, 170, 196, 204, 230, 280; IV, 199; VII, 23,38; XI, 96; XII, 44. Raourava (enfer), IV, 88. Rationalisme, II, 11. I, 15; XII,
397
des organes, II 88, Rpression 92 sqq. Repas, II, 51 sqq. . (funraires), III, 83, 122 sqq., 140,141,148 sqq., 220, 222 sqq., 234, 235, 246, 250. Retour la maison (crmonie), II, 108; 111,4. Rvlation, I, 108; II, 8 sqq., 13, 35, 169; IV, 155; XII, 109. Ridjcha (enfer), IV, 90. I, 23; II, 158; III, Rig-Vda, 145; IV, 123, 124; XI, 262, XII, 112. 263,265; Rincement de la bouche, II, 53, 58 sqq.: V, 139. Rita (glanure), IV, 5. Roi (devoirs et fonctions), VII et VIII, passim. (administration), 54 VII, sqq., 80 sqq., 114 sqq., 223. (bravoure), VII, 87 sqq.; IX, 323. (conqutes), VII, 99 sqq., 201 sqq. ; IX, 251; X, 115. ( tude et connaissances ), VII, 43. (impts), VII, 127sqq., 137 sqq.; X, 118, 119, 120. (jugement desprocs), VIII, 1 sqq. ; IX, 233, 234. (libralit envers les Brahmanes), VII, 37, 38, 79, 82 sqq., 134 sqq., 145; XI, 4, 22, 23.
398
INDEX (de la nouvelle lune), IV, 25; VI, 9. (de la pleine lune), IV, 25; VI, 9. II, 86, (pkayadjnas), 143; XI, 119. (aux sages), IV, 21. (au seigneur des craIII, 86; V, tures), 152; VI, 38. IV, 26; (du Soma), XI, 7 sqq. ou Visvadvas (aux dieux runis), III, 83 sqq. (visvadjit), XI, 75. Cf. aussi les termes spciaux tels que Agnichtoma, Agnihotra, etc. Sdhyas (divinits), I, 22; III, 195; XI, 29; XII, 49. Sages ou saints, I, 1,34, 36,41 ; II, 176; III, 194, 201; IV, 257; V, 1, 3; VII, 18, 29, 210; VIII, 110; IX, 31, 68; XI, 20, 29, 45, 211, 222, 235, 244; XII, 2, 49, 50, 106. Saikha (caste), X, 21. Sairandhra (caste), X, 32. Sakkola (enfer), IV, 89. Saka (peuple), X, 44. Skala (sacrifice), XI, 201, 257. Slmal (rivire infernale), IV, 90. Salutation, II, 117, 120 sqq. ; IV, 154. Samnodaka (parent), V, 60 ; XI, 183. Sacrifice
Roi (protection des sujets), VII, 2, 3, 35, 88,- 111, 112, 142, 144; VIII, 172, 303 sqq. ; IX, 253 ;X, 80,118. (punition des crimes), VII, 13 sqq.; VIII, 302, 310 sqq.; IX, 252 sqq., 312. (vices), VII, 45 sqq. Cf. aussi Kchatriya. S Sacrifice (du cheval), XI, 75, 83, 261. II, (les cinq grands), 28; III, 67, 69 sqq., 154; IV, 22; V, 169; VI, 5; XI, 246. VI, (dakchasyyana), 10. (aux dieux), III, 240, 254, 256; IV, 21. (aux tres ou esprits), 111,70, 74, 81, 90; IV, 21. ou Srd(funraires dhas: cf. aussi Repas funraires et'Sacrifices aux mnes), III, 138, 140, 144, 148, 151, 176, 178, 187, 204, 205, 276, 277, 278, 280, 281. (au feu : cf. Agnihotra). (aux mnes), III, 122, 127, 129, 135, 149, 188, 190, 232, 240, 250, 254, 279.
INDEX Sma-Vda, I, 23, III, 145; IV, 123, 124; XI, 263; XII, 112. IV, 89. Sampratpana (enfer), Sandjvana (enfer), IV, 89. Sanghta (enfer), IV, 89. Saoumyas (Mnes), III, 199. Saounaka (sage), III, 16. Sapinda (parent), II, 247; III. 5; V, 59 sqq., 84, 100, 103; IX, 59, 186, 187; XI, 183. III, Sapindkarana (crmonie), 247, 248. Srangu (personnage mythologique), IX, 23. Sarasvat (rivire et divinit), II, 17; VIII, 105; XI, 78. Sarpas ou Serpents (cf. Ngas). I, 37; III, 196; VII, 23. Satamna (valeur montaire), VIII, 137. Stvata (caste), X, 23. Satynrita (commerce), IV, 4,6. Savitar (divinit), IV, 150. Svitr (hymne), II, 39, 77, 81, 101, 102. 104,118, 148,170, 226. 220; XI, 192,195, Seigneur des cratures ou PradII, 77, 84, jpati), III, 86; IV, 226; 182, 225, 248; V, 28, 152; VI, 38; IX, 46, 327 ; XI, 38, 244; XII, 121,123. (les Seigneurs des craI, 34, 35; tures), XII, 50. (rite de mariage du), III, 21 sqq., 30, 38 sqq.
399
Sens interne, manas, II, 92. Sivasankalpa (texte), XI, 251. Sntaka(quia pris lebainfinal), I, 113; II, 138, 139; X, 113; XI, 2, 204. Soma (divinit), III, 87, 211 ; V, 96; IX, 129; XI, 255. (sacrifice du), IV, 26; XI, 7 sqq. (vente du), III. 158, 180. Somapas (mnes), III, 197,198. Somasads (mnes), III, 195. Sommeil de Brahm, I, 51 sqq. Sopka (caste), X, 38. de la preSortie (crmonie mire de la maison), 11,34. Soubrahmany (texte), IX, 126. Soudas (roi), VII, 41 ; VIII, 110. Soudhanvan (caste), X, 23. Soudra (caste) : VIII, 374. (adultre), (devoirs et fonctions), I, 91; VIII, 410, 413, 414, 418; IX, 334, 335; X, 99, 100, 121 sqq. (funrailles), V, 92. IX, 157,179. (hritage), (mnes), III, 197. III, 13, 23, (mariage), IX, 157. 24,44; (meurtre d'un), XI, 67. (nom), II, 31,32. (origine), I, 31.87; XII, 43. VIII, 267, (outrages), 270 sqq.
400 Soudra
INDEX Subsistance (d'un Kchatriya), X, 95. (d'un X, Soudra), 99, 100. X, 79, (d'unVaisya), 80, 98. (fille), III, 11; IX,
(prsents et aliments offerts par un), IV, 211, 218, 223, 253 ; XI, 24. II, 62; V. (purification), 83, 99, 139, 140. (rsidence), II, 24. II, 127. (salutation), (tmoignage), VIII, 88, 113. (tonsure), V, 140. et voies de (violences fait), VIII, 279 sqq.; IX, 248. (vol), VIII, 337. Soudr ou adultre (mariage avec une femme), III, 13 sqq., 44,155,191, 250; XIII, 383, 385 ; XI, 179. Souklins (mnes), III, 197. Souparnas ( tres mythologi VII, ques), I, 37; 111,196; 23; XII, 44. Sour XI, 94, 95, (liqueur), 148, 151, 250. Sorasena (pays), II, 19 ; VII, 193. Sota (caste), X, 11, 17, 26,47. Soumoukha (roi), VII, 41. Souvarna (valeur montaire), VIII, 134,135,137. Srddha. Cf. Sacrifice funraire. Srvana (mois), IV, 95. Sri (divinit), III, 89. Subsistance (moyens de) , X , 116. en (d'un Brahmane dtresse), X, 102 sqq.
Substitue 127 sqq. Svadh (rite), III, 223. Svapka (caste), III, 92; X, 19. Svrotchicha 1,62. (Manou), Svardjit (sacrifice), XI, 75. Cf. tre existant Svayambho. par lui-mme. T Tmasa (Manou), I, 62. Tmisra (enfer), IV, 88, 165; XII, 75. Tapana (enfer), IV, 89. Tchkchoucha I, 62. (Manou), Tchailsaka (fantme), XII, 72. Tchaitra (mois), VII, 182. Tchndla (caste), III, 239; IV, 79; V, 85, 131; IX, 87; X, 12, 16, 26, 37, 51; XI, 24; XII, 55. Tchndl (femme), VIII, 373 ; XI, 176. Tchandra IX, 303, (divinit), 309. Tchrya (caste), X, 23. Tchna (caste), X, 44. Tchoda (caste), X, 44. Terre (origine), I, 78. Tonsure (rite), II, 27, 35, 65; V, 58, 67.
INDEX Touryana (sacrifice), VI, 10. Tradition, I, 108; 11,6,9,10, 12 ; IV, 155. I, 28, 29, 55, Transmigration, 56; V, 164; VI, 61 sqq. ; IX, 15 sqq., 30; XI, 25; XII, 41 sqq. I, 83, 85, 86; IX, Tret(ge), 301, 302. Trisouparna (texte), III, 185. Trivrit (sacrifice), XI, 75. U III, 153, 180; Usure, usurier, IV, 210, 220,224; VIII, 140 116; XI, 62. sqq.;X, V Vachat (rite), II, 106. Vaideha (caste), X, 11, 13, 17, 19, 26, 31, 33, 36, 37, 47. Vaisvnar XI, 27. (sacrifice), Vaisya (caste). VIII, 375, (adultre), 376, 382, 383, 384. (au service d'un Brahmane), VIII, 411. (devoirs et fonctions), I, 410, 418; 90; VIII, IX, 326 sqq.; X, 79,98. V, 92. (funrailles), (mnes), III, 197. III, 13, 23, (mariage), 24, 35, 44. (meurtre d'un), XI,- 67, 88, 127, 130. Vaisya
401
(nom), II, 31, 32. II, 41 sqq., (noviciat), 190. (origine), I, 31, 87. VIII, 267, (outrages), .277. 11,62; V, (purification), 83,99. II, 127. (salutation), VIII, 88, (tmoignage), 113. (tonsure), II, 65. (vol), VII, 337. Vaisya (adultre avec une femme), VIII, 382 sqq. Vaivasvata (Manou), I, 62. Vmadeva, X, 106. Vampires. Cf. Pistchas. Varouna (divinit), III, 87; V, 96; VII, 3,7; VIII, 82,106; IX, 244, 245, 303, 308. Vroun (liqueur), XI, 147. Vasichtha ( sage ), I, 35; III, 110; 198; VIII, IX, 23. (lgislateur ), VIII, 140. (hymne de), XI, 250, Vasous (mnes), III, 284; XI, 222. Vtadhna (caste), X, 21. Vatsa (sage), VIII, 116. Vda (origine), I, 23; XII, 49. (autorit), II, 6 sqq. Vdnta (trait), II, 160; VI, 83, 94. Vena (roi), VII, 41; IX, 66, 67. Vena (caste), X, 19, 49. 26
402
INDEX Voeux, II, 28, 165, 173, 174. cf. ce Vrtya (excommuni, mot). Vrichala (caste), X, 43. Vrichal, XI, 179. Vyhritis. Cf. Bhoh. Y I, 23; IV, 124; Yadjour-Vda, XI, 263,265; XII, 112. Yakchas (divinits), I, 37; III, 196; XI, 96; XII, 47. Yama (divinit), III, 87, 211; V, 96; VI, 61; VII, 4, 7; VIII, 86, 92; IX, 303, 307; XII, 17, 21, 22. Yavana (peuple), X, 44. Yodjana (mesure), XI, 133.
Vent (divinit), V, 96; VII, 4, XI, 120. 7; IX, 42, 303,306; Cf. PvaVers purificatoires. mn. Vente des filles, III, 51. Vichnou (divinit), XII, 121. (caste), X, 23. . Vidjanman Vighasa (rite), III, 285. Vikhanas (lgislateur), VI, 21. Vinasana (pays), II, 21. II, 21. Vindhya (montagne), I, 32, 33; III, Virdj (divinit), 195. (sacrifice), XI, 75. Visvadjit Visvmitra (sage), VII, 42 ; X, 108. Visvadvas XI, 29. (divinits), (sacrifice aux), III. 83 sqq., 121.
FIN DE L'INDEX
IMP. FRANAISE ET ORIENTALE CHALON-SUR-SAONE, DE L. MARCEAU
Vous aimerez peut-être aussi
- L'astrologie populaire étudiée spécialement dans les doctrines et les traditions relatives à l'influence de la lune.: La lune, les astes et l'astrologie lunaire au cours des sièclesD'EverandL'astrologie populaire étudiée spécialement dans les doctrines et les traditions relatives à l'influence de la lune.: La lune, les astes et l'astrologie lunaire au cours des sièclesPas encore d'évaluation
- L'Histoire de l'Atlantide: Esquisse géographique, historique et ethnologiqueD'EverandL'Histoire de l'Atlantide: Esquisse géographique, historique et ethnologiquePas encore d'évaluation
- Le Château de Versailles: Les Dossiers d'UniversalisD'EverandLe Château de Versailles: Les Dossiers d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Histoire des Cieux et de la Terre 1: Voyage dans les passés et les futursD'EverandHistoire des Cieux et de la Terre 1: Voyage dans les passés et les futursPas encore d'évaluation
- Les 22 mystères du Tarot : Comment ils peuvent changer votre vie - Les secrets que chaque carte révèle sur vous - Livre Tarot de MarseilleD'EverandLes 22 mystères du Tarot : Comment ils peuvent changer votre vie - Les secrets que chaque carte révèle sur vous - Livre Tarot de MarseillePas encore d'évaluation
- Essais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsD'EverandEssais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsPas encore d'évaluation
- Ce que dit la Bible sur le Chant: Comprendre la parole bibliqueD'EverandCe que dit la Bible sur le Chant: Comprendre la parole bibliquePas encore d'évaluation
- Astro 02Document7 pagesAstro 02Ludovic OuedraogoPas encore d'évaluation
- Les trois monothéismes: Origine divine ou supercherie ?D'EverandLes trois monothéismes: Origine divine ou supercherie ?Pas encore d'évaluation
- La Culture Antique Très Vivante Au Moyen ÂgeDocument15 pagesLa Culture Antique Très Vivante Au Moyen ÂgeTribonien Bracton100% (1)
- Le Chant Des VoyellesDocument5 pagesLe Chant Des VoyellesFranck ServignatPas encore d'évaluation
- Traité Des SuperstitionsDocument24 pagesTraité Des SuperstitionsHenry HV100% (1)
- Symbolisme Animaux - Les Gallinacés PDFDocument8 pagesSymbolisme Animaux - Les Gallinacés PDFJelzz100% (1)
- Introduction Au Centiloquium Par Giuseppe Bezza1Document18 pagesIntroduction Au Centiloquium Par Giuseppe Bezza1lukasesanePas encore d'évaluation
- Histoire Des Saints D AlsaceDocument666 pagesHistoire Des Saints D AlsaceIHS_MAPas encore d'évaluation
- Les SaintsDocument266 pagesLes Saintsblurps455100% (3)
- De Lombre A La Lumiere - Livre Complet PDFDocument170 pagesDe Lombre A La Lumiere - Livre Complet PDFgheorghe.mihaela1369Pas encore d'évaluation
- Jacques Halbronn Une Anthropologie Du TempsDocument304 pagesJacques Halbronn Une Anthropologie Du TempsJacques Halbronn100% (1)
- Analyse de La Thèse D'élizabeth TeissierDocument31 pagesAnalyse de La Thèse D'élizabeth TeissierAlmuric59Pas encore d'évaluation
- L'Élevage Bovin en Egypte Antique A. RomanDocument11 pagesL'Élevage Bovin en Egypte Antique A. RomanRebek MattaPas encore d'évaluation
- Asmodee Zodiaque Magique Ou L Oracle CompletDocument294 pagesAsmodee Zodiaque Magique Ou L Oracle CompletAlfredo Dagostino100% (1)
- Sommaire RsDocument17 pagesSommaire RsAnouhianouhi AnouhiPas encore d'évaluation
- Symbolisme Animaux - Les Animaux MonstrueuxDocument7 pagesSymbolisme Animaux - Les Animaux MonstrueuxJelzz100% (1)
- Les Propheties de Nostradamus L Antechrist Venu D AsieDocument6 pagesLes Propheties de Nostradamus L Antechrist Venu D AsieElis Javier Mendez PerezPas encore d'évaluation
- Sorcellerie Croyance Et Superstition Dans La France Du 19eme Siecle DcBY7tyuyfY43YnbeyWURfx1D.chkp692gh9jiuopcvmd8jp2iw3wumljclc10wkoDocument11 pagesSorcellerie Croyance Et Superstition Dans La France Du 19eme Siecle DcBY7tyuyfY43YnbeyWURfx1D.chkp692gh9jiuopcvmd8jp2iw3wumljclc10wkofrancis3ndourPas encore d'évaluation
- L'Introduction Au Jugement Des Astres (... ) Dariot Claude Bpt6k79124vDocument97 pagesL'Introduction Au Jugement Des Astres (... ) Dariot Claude Bpt6k79124vAndré Cruz100% (1)
- Les Oracles SibyllinsDocument28 pagesLes Oracles SibyllinsDavid Zamora LópezPas encore d'évaluation
- Fiction Historique Et Conte FantastiqueDocument46 pagesFiction Historique Et Conte Fantastiquehanzeljosz87Pas encore d'évaluation
- MarcionDocument4 pagesMarcionlazarePas encore d'évaluation
- La Domitude Danièle Jay PDFDocument9 pagesLa Domitude Danièle Jay PDFcharleyPas encore d'évaluation
- L'astrologie Grecque - A. Bouché-LeclercqDocument698 pagesL'astrologie Grecque - A. Bouché-LeclercqUzumaki100% (2)
- Astro MythologieDocument7 pagesAstro MythologieBartPas encore d'évaluation
- Ching Selao, Le Double Palimpseste de Maryse Condé, Moi Tituba Sorcière Noire de SalemDocument20 pagesChing Selao, Le Double Palimpseste de Maryse Condé, Moi Tituba Sorcière Noire de SalemLorine100% (1)
- Consideration Masha'Allah (French)Document8 pagesConsideration Masha'Allah (French)chalimacPas encore d'évaluation
- Fêtes Et Coutumes Populaires: "La Petite Bibliothèque" Série BDocument107 pagesFêtes Et Coutumes Populaires: "La Petite Bibliothèque" Série BGutenberg.orgPas encore d'évaluation
- Jacques HALBRONN Les Légendes Dorées, de Nostradamus À André BarbaultDocument194 pagesJacques HALBRONN Les Légendes Dorées, de Nostradamus À André BarbaultJacques Halbronn100% (1)
- Rois MagesDocument10 pagesRois MagesYvess DEFLIPas encore d'évaluation
- Bibliographie AstroDocument4 pagesBibliographie AstroSobab100% (1)
- Péladan - La Clé de RabelaisDocument14 pagesPéladan - La Clé de RabelaisAntoine100% (1)
- 9782402626323Document33 pages9782402626323Kamta nelson100% (1)
- La Théorie Des Âges de Lastrologie Conditionaliste Par Hubert Boyelle1Document11 pagesLa Théorie Des Âges de Lastrologie Conditionaliste Par Hubert Boyelle1Renald VeilleuxPas encore d'évaluation
- Demain 10ème Année No. 7, 21 11 1935 01 1936Document44 pagesDemain 10ème Année No. 7, 21 11 1935 01 1936JanitairePas encore d'évaluation
- L'art de Tirer Les Cartes (... ) Magus Antonio bpt6k9804442qDocument344 pagesL'art de Tirer Les Cartes (... ) Magus Antonio bpt6k9804442qpascal becheri100% (1)
- La Famillie de Jeanne D'arc PDFDocument301 pagesLa Famillie de Jeanne D'arc PDFJhon Fredy Acuña MoralesPas encore d'évaluation
- R - de Typocosmie - TI - L'Influence Des Astres - 165 - 199Document19 pagesR - de Typocosmie - TI - L'Influence Des Astres - 165 - 199Tahiry Ny Aina Andriamiarana100% (1)
- Lastrologie Au Service Du Manager (Olivier Lowes)Document288 pagesLastrologie Au Service Du Manager (Olivier Lowes)selima.mezniPas encore d'évaluation
- Les Grandes Etapes de La Liturgie ByzanDocument20 pagesLes Grandes Etapes de La Liturgie ByzanDiana BitarPas encore d'évaluation
- Demain 14ème Année No. 2, 06 1939 08 1939Document64 pagesDemain 14ème Année No. 2, 06 1939 08 1939JanitairePas encore d'évaluation
- Directions Primaires DelboyDocument5 pagesDirections Primaires DelboymerlinoutPas encore d'évaluation
- Chapitre Iv L'antiquité RomaineDocument26 pagesChapitre Iv L'antiquité Romainebula19762437Pas encore d'évaluation
- Astrologie GuerisonDocument11 pagesAstrologie GuerisontonganjaraPas encore d'évaluation
- Aspects de L'eschatologie Manicheenne PDFDocument20 pagesAspects de L'eschatologie Manicheenne PDFneferisaPas encore d'évaluation
- DELEHAYE, Les Recueils Antiques de Miracles Des SaintsDocument42 pagesDELEHAYE, Les Recueils Antiques de Miracles Des SaintsDejan MitreaPas encore d'évaluation
- Congrès Internationaux D'astrologie 1 - Metz 1982Document128 pagesCongrès Internationaux D'astrologie 1 - Metz 1982Janitaire100% (1)
- HyperborDocument24 pagesHyperborJulien DufieuxPas encore d'évaluation
- Evangile Jean SteinerDocument144 pagesEvangile Jean Steinerhanel56100% (3)
- Le Code D'hammourabiDocument128 pagesLe Code D'hammourabijohncafféPas encore d'évaluation
- De La Gnose Aux CatharesDocument27 pagesDe La Gnose Aux CatharesjohncafféPas encore d'évaluation
- LE GRAND Œuvre de G de Givry 1Document36 pagesLE GRAND Œuvre de G de Givry 1johncafféPas encore d'évaluation
- De La Gnose Aux CatharesDocument27 pagesDe La Gnose Aux CatharesjohncafféPas encore d'évaluation