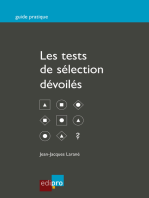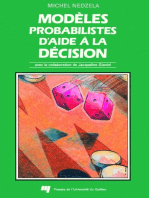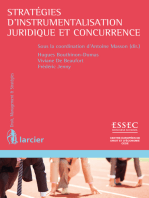Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Tage Mage
Tage Mage
Transféré par
Abdelhay ElyadiniTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Tage Mage
Tage Mage
Transféré par
Abdelhay ElyadiniDroits d'auteur :
Formats disponibles
FNEGE
Fondation Nationale Pour lEnseignement de la Gestion des Entreprises
TAGE MAGE
Test dAptitude aux Etudes Suprieures de Gestion
PRSENTATION LIVRET DU ANDIDAT
L!usa"e de #a $a#$u#atri$e est interdit%
Le test TAGE MAGE est un outil de slection aux tudes de gestion et de management. Il vise valuer les aptitudes verbales, calculatoires et logiques des candidats aux tudes de gestion dans trois grands domaines compr!ension et expression " rsolution de probl#mes d$arit!mtique " raisonnement et argumentation. %r en &''(, il rsulte de la )usion de deux tests d$aptitude * le TAGE, gr par la +,EGE et rguli#rement utilis par une quin-aine d$institutions universitaires et consulaires dans le cadre de la slection de candidats des )ili#res de .#me et /#me c0cles. * le MAGE, dvelopp par E.M. L0on et utilis dans les Grandes Ecoles de Gestion membres du %entre International d$Admission aux Etudes de Management 1%IAM2. Le test TAGE MAGE est un 3uestionnaire %!oix Multiples 13%M2. Il est constitu de '4 questions, rparties en ( preuves d$une dure de .4 minutes c!acune. %!aque preuve contient &5 questions. 6our c!acune des questions, il est propos 5 rponses, dont une seule est correcte.
Partie 1 : Rsolution de problmes - Calcul - Conditions minimales
Partie 2 : Aptitudes verbales - Comprhension - Expression
Partie 3 : Raisonnement logique - Logique - Raisonnement
Les candidats doivent se munir d$un cra0on papier et d$une gomme. L$utilisation d$une calculatrice n$est pas autorise.
Attention : Il n'est possible de passer le test TAGE MAGE qu'une seule fois par an. Ce document permet aux candidats davoir un aper u des !preuves constitutives du test TAGE MAGE. "es annales sont disponibles sur ###.ta$ema$e.com
Sous-test 1
CO PR!"#$S%O$ &'($ )#*)# !CR%)
Cette sous-preuve permet dvaluer les aptitudes des candidats identifier et/ou retrouver les informations contenues dans un texte. l sagit galement de savoir reprer les articulations logiques du texte et davoir cern les intentions de lauteur! manifestes de fa"on implicite ou explicite. Cette sous-preuve com#ine donc la comprhension et lexplication de texte. 1+ CO #$) SO$) C"O%S%S ,#S )#*)#S -
%es sources - $ans la presse %quotidienne et he#domadaire& et dans les revues lusage du grand pu#lic. - $ans les ouvrages et manuels de vulgarisation scientifique et technique. - $ans des revues scientifiques! particuli'rement dans le domaine des sciences humaines. 2+ CO .%#$ &# /(#S)%O$S0 /(#,,#S SOR)#S &# /(#S)%O$S Les () questions peuvent porter * - soit sur un simple reprage dinformation. - soit sur des propositions dinterprtation. +rois propositions sont en gnral faites. Les trois peuvent ,tre fausses- une seule peut ,tre exacte! etc. +ous les cas de figure sont thoriquement possi#les. - soit sur une proposition de titre pour un texte donn. - soit sur lopinion de lauteur! exprime de fa"on explicite ou implicite. $ans le cadre de cette sous-preuve! le pro#l'me de la lecture est encore compliqu par le fait que les candidats doivent prendre en compte linterprtation dun premier lecteur * le concepteur de lpreuve. ls doivent sefforcer de prendre en compte ce niveau supplmentaire de la lecture. Consignes Cette preuve comporte deux textes numrots ( et .. Chacun de ces textes est suivi d/une srie de questions. Chaque question vous prsente cinq propositions qui peuvent porter sur diffrents niveaux de lecture * - nformations 0isoles0 contenues dans le texte - des principales! traites dans un ou plusieurs paragraphes - 1osition de l/auteur telle qu/elle se refl'te dans le texte! etc. 1armi les cinq propositions prsentes dans le cadre de chaque question! certaines sont en contradiction flagrante avec le texte - d/autres a#ordent des aspects qui n/2 sont pas traits d/autres encore se rapprochent plus ou moins de ce qui est exprim - directement ou indirectement - dans ce m,me texte. La seule proposition considre comme exacte est celle qui se rapproche le plus de ce qui est dit dans le texte. Les quatre autres propositions sont considres comme fausses.
)e1te % : ,# CA # .#R) #) ,2A)O # 3atales fortes doses pour tout ,tre vivant! les radiations ionisantes peuvent! doses fai#les! gurir ou soulager des maladies du cancer! et elles ont permis la mise au point de mthodes d/investigation mdicale au4ourd/hui irrempla"a#les comme la radiographie aux ra2ons 5. $epuis le d#ut des annes 67! on les emploie dans l/industrie pour les usages les plus divers! de la strilisation des instruments chirurgicaux au traitement des mati'res plastiques. 8ur les aliments! les irradiations produisent des phnom'nes un peu analogues certains effets de la cuisson. Le choc des photons casse les grosses molcules comme (/9$:! porteur du code gntique! emp,chant toute multiplication des cellules et des micro-organismes. Les nergies utilises sont #eaucoup trop fai#les pour induire une radioactivit artificielle par modification des no2aux atomiques! comme cela se passe dans les racteurs nuclaires. 1ar ailleurs! la source des ra2onnements ionisants n/est 4amais en contact avec les denres alimentaires! qui ne peuvent donc pas ,tre contamines. Cependant! tous les doutes ne sem#lent pas avoir t encore totalement levs et cette technique conserve un certain nom#re d/adversaires. La 3rance est peut-,tre #ien place pour donner ses lettres de no#lesse l/ionisation* l/tude sur le camem#ert mene sur la demande d/une ;nion cooprative normande en est un #on exemple. l faut savoir que toutes les oprations visant liminer du lait cru les microorganismes ventuellement pathog'nes - par exemple par strilisation - suppriment aussi la plupart des germes utiles la fa#rication du fromage. En traitant le camem#ert par ionisation! au #out de quin<e 4ours d/affinage! on arrive diviser par mille le nom#re de germes indsira#les. La flore utile! quant elle! rsiste mieux aux ra2onnements! et! de toute fa"on! elle a eu le temps de li#rer les en<2mes ncessaires l/affinage. =oici une approche pragmatique que sem#lent avoir dsormais adopte la plupart des dfenseurs de l/ionisation. 1lus personne au4ourd/hui ne parle de traitement miracle! mais plut>t d/une technique supplmentaire de conservation des aliments! moins agressive que les traitements chimiques ou thermiques. Elle ne les remplacera pas! mais viendra complter certains traitements comme la pasteurisation! qui! souligne un responsa#le de (/?@8! fut d/ailleurs violemment com#attue lors de son apparition! avec des arguments similaires ceux des opposants actuels l/ionisation.
7ous trouvere- ci*dessous quelques exemples de questions concernant le sous*test & %ompr!ension d8un texte crit. /uestion 1+ Auelle est! selon le texte! la gamme d/utilisation des radiations ionisantes* (& +raitement de certaines maladies. .& @thodes d/investigation mdicales. B& 9pplications industrielles multiples. 9 - seulement (. C - (D.DB. C - (D. $ - (DB E - seulement .. /uestion 2+ 9 quoi peut-on comparer les effets des irradiations sur les aliments E 9 - une cuisson. C - une strilisation. C - une ionisation.
4
$ - une l2ophilisation. E - une conglation. /uestion 3+ Auelle est la position concurrentielle de la 3rance dans le domaine de l /ionisation E 9 - elle est sur le point d/affirmer sa supriorit. C - elle ne pourra russir qu/en cooprant avec d/autres. C - elle est le leader mondial. $ - elle va s/affirmer grFce l/ionisation du camem#ert. E - elle a un certain nom#re d/atouts. /uestion 3+ Comment se comporte! en cas d/ionisation! la flore permettant la fa#rication d/un camem#ert de qualit E 9 - elle est totalement insensi#le aux ra2onnements. C - elle est transforme en en<2mes grFces aux ra2onnements. C - elle voit son effet retard sous l/effet des ra2ons. $ - elle est strilise par les ra2ons. E - elle souffre des ra2onnements! mais ne disparaGt pas compl'tement. /uestion 4+ Au/est-ce qui provoque la segmentation de l/9$:! dans le cadre d/une irradiation E 9 - les neutrons lents C - les lectrons C - les photons $ - les ions E - les neutrons rapides.
R#PO$S#S : Auestion ( * C Auestion . * 9 Auestion B * E Auestion H * E Auestion ) * C
Sous-test 2
CA,C(,
Le sous-test de Cal5ul value la maGtrise de connaissances simples dans les domaines de larithmtique! de la gomtrie! de lalg'#re et du calcul. Le niveau de connaissance requis correspond celui de classe de troisi'me et pour certaines questions celui des classes de seconde et de premi're. 1lus prcisment! les 56amps de 5onnaissan5e requis sont les suivants * - entiers relatifs! dcimaux! nom#res rels - puissance! racine carre - pourcentage et proportion - progressions arithmtique et gomtrique - quations du premier et du second degr - s2st'me dquations %B inconnues maximum& - quation du second degr - anal2se com#inatoire simple - proprits des droites parall'les %thor'me de +hal's& et des droites perpendiculaires %thor'me de 12thagore& - proprits lmentaires du triangle! du cercle! du rectangle et du carr. Consignes Cette preuve est constitue de () questions pour lesquelles vous dispose< de .7 minutes. Les questions ne sont pas classes par ordre de difficult. L/utilisation de la calculatrice n/est pas autorise. 7ous trouvere- ci*dessous quelques exemples de questions concernant le sous*test . %alcul. /uestion 1+ La somme de B entiers naturels conscutifs est (6). Auelle est la valeur du plus grand de ces B entiersE 9& )B C& )H C& )6 $& )I E& 6( /uestion 2+ ;ne piscine est de forme strictement rectangulaire. 8i l/on augmente de J m'tres sa longueur et que l/on diminue de ) m'tres sa largeur! sa surface reste inchange. @ais si l/on augmente sa longueur de .7 m'tres et si l/on diminue sa largeur de (B m'tres! sa surface augmente de .7mK. Auelle est la largeur de cette piscineE 9& (7) m'tres C& (.7 m'tres C& (B) m'tres $& (H7 m'tres E& ()) m'tres /uestion 3+ ;n thFtre propose deux tarifs. 1our le premier! le spectateur pa2e la place I73 pour chaque spectacle. 1our le deuxi'me! il acquitte un a#onnement de (773 et pa2e alors sa place H73 pour chaque spectacle. 9 partir de com#ien de spectacle%s& le tarif avec a#onnement devient-il intressant pour le spectateurE 9&( C& . C& B $& H E& ) /uestion 3+ ;n concours d/entre dans une grande cole de commerce comporte la passation d/un test et un entretien oral. Le test valu sur .7! compte pour un coefficient B et l/entretien! valu sur .7 aussi! pour un coefficient .. La note mo2enne que doit atteindre un candidat pour ,tre admis est de (. sur .7. ;ne candidate a o#tenu la note de (7!) au test. Auelle est la note minimale quelle doit o#tenir son entretien pour ,tre admiseE 9& (.!J) C& (H!.) C& (.!) $& (B!) E& (H!J)
/uestion 4+ x et 2 poss'dent les proprits suivantes * Auelle est la valeur de x D 2 E 9& (I C& .M C& (B $& BJ E& .H
xK D 2K L .7I
x . 2 L )I
R#PO$S#S : Auestion ( * C Auestion . * 9 Auestion B * C Auestion H * C Auestion ) * 9
Sous-test 3
RA%SO$$# #$) 7 AR8( #$)A)%O$
L/preuve 0Raisonnement0 est constitue de () questions pour chacune desquelles le candidat doit anal2ser une situation-pro#l'me qui lui est prsente dans un petit paragraphe! avant de rpondre une question. l s/agit d/une preuve de raisonnement logique qui ne ncessite pas de connaissance approfondie des principes fondamentaux de la logique formelle. Les deux formes de raisonnement! inductif et dductif! sont values. Les situations-pro#l'mes prsentent des contextes pro#lmatiques parfois relativement flous et pour lesquels deux t2pes de #onnes rponses sont proposs. 1our le premier t2pe! la #onne rponse est explicitement unique. 1our le deuxi'me t2pe - ce qui constitue une situation de prise de dcision frquente dans la vie quotidienne - ! plusieurs rponses sont possi#les et le candidat doit alors choisir celle qui convient le mieux. Certaines questions visent la capacit valuer la meilleure ou la moins #onne des conclusions possi#les ou des illustrations possi#les! valuer le meilleur ou le moins #on paralllisme avec une situation ou raisonnement compara#le! expliciter les sous-entendus qui fondent les affirmations du discours propos. $ans ce t2pe de questions! les consignes orientent la rflexion et peuvent ,tre formules avec une grande varit * - =ers quelle conclusion tend ce dveloppement E - Auel argument soutient le mieux la conclusion E - Aui %parmi les catgories de personnes rpertories& peut s/exprimer ainsi E - Auelle est la meilleure illustration de cette rflexion E - Auel prover#e est le mieux illustr par cette situation E etc.
7ous trouvere- ci*dessous quelques exemples de questions concernant le sous*test / 9aisonnement : Argumentation.
/uestion 1+ Ro#ert a un vhicule plus puissant que celui de @arthe. :icolas a un vhicule plus puissant que celui de Clment. Clment a un vhicule moins puissant que celui de 1aul. @arthe et 1aul ont deux vhicules de puissance strictement identique. Laquelle de ces cinq propositions est-elle exacte E 9& C& C& $& E& @arthe a un vhicule moins puissant que celui de :icolas Ro#ert a un vhicule plus puissant que celui de Clment :icolas a un vhicule plus puissant que celui de 1aul @arthe a un vhicule moins puissant que celui de Clment :icolas a un vhicule plus puissant que celui de Ro#ert
/uestion 2+ Les services pu#lics sont souvent critiqus par les utilisateurs. Les arguments avancs sont de deux ordres * leur personnel est peu motiv et ils coNtent chers aux contri#ua#les. 8i lon prend lexemple du +O= sans linvestissement pu#lic le pro4et naurait 4amais a#outi car aucun oprateur priv naurait accept une telle charge financi're. La question quil faut alors se poser est la suivante * quels sont les domaines de la vie pu#lique que le priv ne peut investir par manque de renta#ilit mais dont le dveloppement est ncessaire pour le #ien ,tre gnral et le dveloppement conomique E Laquelle de ces propositions est la plus proche du sens gnral du texte E 9& C& C& $& les services pu#lics sont un gouffre financier le dveloppement de certains secteurs pu#lics sont indispensa#les les emplo2s des services pu#lics sont nom#reux et peu motivs le secteur priv est le seul qui peut assurer au plus pr's et au moindre coNt les #esoins des gens E& le dveloppement des services pu#lics est compl'tement li lhistoire des pa2s. /uestion 3+ La monte de la violence inqui'te. $ans certaines petites villes les autorits ont dcid de tolrer les comits anti-violence. Certains ont pratiqu un recrutement sur la #ase unique du volontariat. l sen est suivi des vnements graves. Le niveau dducation de #eaucoup de mem#res est souvent tr's #as et un nom#re non ngligea#le dentre-eux ont un casier 4udiciaire. Ces expriences mritent une rflexion approfondie. Auelle consquence peuton tirer E 9& C& C& $& E& lauteur est oppos au comit anti-violence la meilleure solution pour com#attre la violence est la cration de comits anti-violence les comits anti-violence nattirent que des gens dangereux les comits anti-violence doivent slectionner leurs mem#res il n2 a pas asse< de policiers dans les petites villes.
/uestion 3+ La russite dune entreprise est une question de march et de personne. l 2 a quelques annes une compagnie arienne perdait plus de .7 milliards de francs par an. Le remplacement du $irecteur a t salutaire. 1ar information du personnel! rfrendum et dcisions financi'res douloureuses il a ancr dans lentreprise une nouvelle culture. Lanne derni're pour la premi're fois depuis dou<e ans la compagnie a fait un #nfice dont le montant sl've (. milliards. 1armi ces cinq propositions quelle est celle qui est la plus proche du texte E 9& C& C& $& E& dans le contexte actuel les entreprises doivent se recentrer sur leur ligne de force le redressement de cette compagnie ne peut ,tre que temporaire le chef dentreprise est le seul lment important pour le d2namisme dune entreprise le coup des transformations dune entreprise est douloureux au niveau humain la personnalit du chef dentreprise 4oue un r>le central dans le comportement dune entreprise
/uestion 4+ Lexercice intensif du sport peut ,tre dangereux. 9 lentre dune salle de g2mnastique on peut lire la chose suivante * un sportif occasionnel ne doit pas faire deffort continu plus de .7 minutes daffiles quand il nest pas entraGn - par consquent! faites plus de .7 minutes dexercices continus quapr's un entraGnement. 1armi ces cinq raisonnements quel est celui qui correspond la phrase inscrite lentre de cette salle de g2mnastique E 9& 8il fait #eau demain! le parc sera rempli de visiteurs. La mto a annonc de la pluie pour demain. :ous ne pourrons pas aller au parc. C& 8i 4o#tiens une note suprieure () 4e pourrais choisir mon cole lanne prochaine. Lanne derni're 4ai o#tenu (6 et 4e nai pas pu aller dans lcole de mon choix.
C& ;ne prime de fin danne me permettrait de changer dordinateur. @on entreprise est en difficult et aucune augmentation nest possi#le. Pe ne peux pas programmer un nouvel achat. $& 1ierre est meilleur nageur que Pean qui est meilleur sprinter que 1ierre. 1ierre est donc meilleur sportif que Pean. E& Certains pa2s asiatiques sont rentrs dans une grave crise financi're qui peut entraGner lEurope. La Chine ne sem#le pas concerne mais ceci ne peut rassurer les marchs europens.
R#PO$S#S : Auestion ( * C Auestion . * C Auestion B * $ Auestion H * E Auestion ) * C
10
Sous-test 3
CO$&%)%O$S
%$% A,#S
Cette preuve vise contr>ler la capacit d/anal2se de la pertinence d/informations en vue de la rsolution d/un pro#l'me. Ce sous-test repose sur le m,me champs de comptence que l/preuve de Calcul. Chacun des noncs de cette preuve comprend gnralement des informations initiales %qui elles seules ne permettent pas de rpondre la question&! et deux informations notes %(& et %.& correspondant chacune delles une information complmentaire. Le candidat doit dcider si lune des propositions %(& ou %.&! ou les deux com#ines fournissent des informations suffisantes pour rpondre la question. 1lus prcisment! le candidat doit choisir lune des ) rponses %9&! %C&! %C&! %$& ou %E& dfinies comme suit * %9& 8i linformation %(& permet elle seule de rpondre la question! et si linformation %.& elle seule ne permet pas de rpondre la question. %C& 8i linformation %.& permet elle seule de rpondre la question! et si linformation %(& elle seule ne permet pas de rpondre la question. %C& 8i les deux informations %(& et %.& ensem#le permettent de rpondre la question! et aucune sparment ne le peut. %$& 8i chaque information permet sparment de rpondre la question. %E& 8i les deux informations ensem#le ne permettent pas de rpondre la question. Remarque : 8il sagit dun nonc de gomtrie comportant une figure! alors cette derni're ne tiendra compte que des informations contenues dans lnonc proprement dit! compte non tenu des informations %(& et %.&. #1emple 1+ Lentier p est-il divisi#le par ) E %(& p/() est un entier %.& p/(. est un entier ;olution L8in)ormation 1&2 nous assure que p est divisible par &5, donc par 5. L8in)ormation 1.2 nous assure que p est divisible par &., ce qui ne garantit pas la divisibilit par 5. La rponse est donc 1A2. #1emple 2+ Auel est en Quros le montant du compte en #anque de @onsieur $upont E %(& 8i on oprait un prl'vement de )R sur son compte! il resterait .(BJ)Q. %.& 8i on oprait un versement de )77Q! le montant du compte deviendrait gal .B777Q. ;olution si < dsigne le montant du compte, l8in)ormation 1&2 permet de rpondre 1<*4,45< = .&/>5, soit < = ..5442" l8in)ormation 1.2 permet galement de rpondre 1< ? 544 = ./4442. La rponse est donc 1@2. #1emple 3+ 9ndr est-il all au cinma E %(& =ictor ne va 4amais au cinma sans qu9ndr ou 1ierre ne laccompagne. %.& 1ierre et =ictor sont alls au cinma. ;olution Aucune des deux in)ormations 1&2 ou 1.2 sparment ne permet de rpondre, et les deux in)ormations ensemble ne permettent pas de rpondre. La rponse est donc 1E2. 8auf prcision contraire! tous les nom#res utiliss sont des nom#res rels.
11
7ous trouvere- ci*dessous quelques exemples de questions concernant le sous*test A %onditions minimales.
/uestion 1+
8ur une demi-droite d/origine ?! on consid're B points 9! C! C tels que ?9 S ?C S ?C. ?n consid're les milieux respectifs @( et @. de 9C et CC. Auelle est en cm! la valeur de 9C E %(& ?@( L (Jcm %.& ?@. L .H cm /uestion 2+ ;n tu#e de J m'tres est coup en trois morceaux. Auelle est la longueur du morceau le plus long E %( & ;n morceau mesure B!J7 m. %.& La diffrence des longueurs entre deux morceaux est I7 cm! et le troisi'me morceau mesure H7 cm. /uestion 3+ 9 et C sont deux nom#res strictement positifs. Le produits 9.C est-il strictement plus grand que (7 E %(& 9 T ) %.& C . /uestion 3+ @. $upont poss'de un terrain rectangulaire- suite un hritage! la longueur du terrain a t augmente de (7 m! et la largeur a t galement augmente de (7 m. Auelle est la nouvelle aire du terrain E %(& L/aire initiale du terrain tait de H777 m.. %.& Le prim'tre initial du terrain tait de .67 m. /uestion 4+
;n champ rectangulaire est entour de deux cl>tures rguli'rement espaces conformment la figure ci-dessus. Auelle est la diffrence de longueur entre les deux cl>tures E %(& L/espace sparant les deux cl>tures a une largeur de (m. %.& Le prim'tre de la cl>ture intrieure est de .77 m.
R#PO$S#S : Auestion ( * C Auestion . * $ Auestion B * E Auestion H * C Auestion ) * 9
12
Sous-test 4
#*PR#SS%O$
0Expression0 est une preuve destine tester l/aptitude comprendre une information formule dans un court message ver#al puis en trouver rapidement soit une reformulation conservant le sens initial! soit une reformulation meilleure par la correction et la prcision! soit la suite pro#a#le dans le dveloppement d/un message cohrent. Consignes Cette preuve comporte diffrents t2pes d/exercices * (. Evaluer le degr de s2non2mie dans les reformulations. .. Choisir la formulation qui reprend le mieux %correction et clart& l/nonc initial. B. Choisir les mots qui assurent la cohrence du texte.
Attention 9 - 8o2e< rapide. - 8o2e< attentif aux consignes de chaque exercice.
7ous trouvere- ci*dessous quelques exemples de questions concernant le sous*test 5 Expression.
Re56er56e de s:non:mie %onsigne de & 5 %!oisisse- la re)ormulation dont le sens se rapproc!e le plus du passage soulign /uestion 1+ 8elon une tude de l/?.@.8.! pr's de deux milliards de personnes travers le monde sont menaces par le paludisme! une maladie qui connaGt une recrudescence depuis plusieurs annes. 9 - 1our laquelle on a multipli les soins et les traitements!ces derni'res annes C - 8ur laquelle la recherche a fait porter des efforts renouvels! ces derniers temps C - $ont les risques de contamination augmentent rguli'rement d/anne en anne $ - Aui avait nettement recul! mais qui recommence svir E - Aui connaGt une rmission depuis plusieurs annes
/uestion 2+ La paranoUa est une sorte de folie de la perscution. 9 - L/interprtation mor#ide des comportements et des propos d/autrui renforce la maladie du paranoUaque
13
C - Le paranoUaque est un su4et mfiant et suscepti#le qui entretient la conviction qu/autrui veut lui nuire C - Le parano passe sa vie d4ouer les complots dirigs contre lui $ - Le #oucher du parano fait expr's de lui donner de mauvais steacVs E - Les paranoUaques rel'vent constamment les moindres in4ustices dont ils sont victimes Corre5tion linguistique %onsigne de ( &4 Indique- la )ormulation la plus correcte et la plus claire pour exprimer le sens du passage soulign. /uestion 3+ P/avais consult un excellent spcialiste pour une cure d/amaigrissement! et tu m/cris pour t/indiquer le mdecin dont tu sais que 4/ai suivi la cure. 9CC$E+u m/cris pour t/indiquer le mdecin dont tu sais que 4/ai suivi la cure +u m/cris pour que 4e t/indique le mdecin dont tu sais que 4/ai suivi la cure +u m/cris pour que 4e t/indique le mdecin dont tu sais que 4/ai suivi sa cure +u m/cris pour que 4e t/indique le mdecin dont tu sais que 4/en ai suivi la cure +u m/cris pour t/indiquer le mdecin duquel 4/ai suivi la cure! comme tu le sais
/uestion 3+ Wier! 4/ai pris au hasard un roman. P/ignore son auteur. Ce que 4e sais! c/est qu/il m/a passionn. 1lus 4/avan"ais et il devenait de mieux en mieux. 9CC$E1lus 4/avan"ais et il devenait de mieux en mieux. 1lus 4/avan"ais et il devenait de plus en plus #on 1lus 4/avan"ais et il tait d/autant plus #on 1lus 4/avan"ais et plus il devenait mieux 1lus 4/avan"ais et meilleur il devenait
Co6ren5e %onsigne de && &5 %omplte- avec la suite la plus co!rente. /uestion 4+ Les mdias qui assurent la notorit des sports et de leurs champions doivent pa2er des sommes souvent considra#les pour avoir le droit de les diffuser. ............... X 9CC$EAuelle discrtion Auelle drision Auelle contrarit Auel paradoxe Auel contraste
/uestion ;+ 0@onte< des pro4ets de 4oint ventures avec nous! proposent au4ourd/hui les responsa#les israliens aux industriels europens. =ous 2 gagnere< un acc's au march amricain avec des produits performants et #on march.0 1our l/instant! ............... est peu entendue! en particulier par les 3ran"ais. 9CC$ECette invocation Cette convocation Cette invitation Cette interpellation Cette rclamation
14
R#PO$S#S : Auestion ( * $ Auestion . * C Auestion B * C Auestion H * E Auestion ) * $ Auestion 6 * C
15
Sous-test ;
,O8%/(#
Le sous-test de logique value les capacits de raisonnement infrentiel sur des sries dinformations. Concr'tement! chaque question est constitue dune liste de donnes possdant entre elles un lien logique. Le raisonnement consiste infrer la r'gle de ce lien logique. 9 partir de l! il sagit pour le candidat! de dterminer parmi les cinq rponses qui lui sont proposes! celle qui respecte le lien logique quil a pu infrer. Les donnes sont de nature spatiale ou constitues de lettres et de chiffres. Les trois exemples suivants illustreront les diffrents t2pes de questions. #1emple sur une double srie de 56i<<res : Auestion * Auel est le nom#re quil faut mettre la place du point dinterrogation E M (I () E .H
9& C& C& $& E&
.I
H.
(H
B)
(. .( J (M .B
Bne premi#re srie de c!i))res est prsente verticalement et une deuxi#me !ori-ontalement. Il s8agit en un premier temps, d8in)rer la r#gle logique qui rassemble les lments de la premi#re srie puis, celle de la deuxi#me srie et en)in, de dterminer parmi les cinq rponses proposes, celle qui respecte la )ois la r#gle de la premi#re srie et la r#gle de la deuxi#me srie. @ans cet exemple, la srie verticale est constitue d8une srie de nombres qui sont tous des multiples de / et la srie !ori-ontale est constitue de nombres qui sont tous des multiples de >. Le nombre rec!erc! doit donc respecter les deux r#gles C Dtre multiple de / E et C Dtre multiple de > E. La bonne rponse est donc la rponse C F E. #1emple sur deu1 sries de lettres : Auestion * Auel est le groupe de lettres quil faut mettre la place du point dinterrogation E ?; RY E 9+Y +++ =+C ++? AZ L1
9& C& C& $& E&
Y+P +$ =9 ?CW 9CC
@ans cet exemple, la dmarc!e suivre pour trouver la solution, est identique celle de l8exemple prcdent mais les sries sont constitues de groupes de lettres. 6our la srie !ori-ontale, la r#gle d8appartenance la srie est la prsence d8un C I E dans le groupe de lettres et, pour la srie verticale, la r#gle d8appartenance est la prsence d8au moins un C T E. Le groupe de lettres rec!erc! doit donc possder un C I E 1premi#re r#gle2 et au moins un C T E 1deuxi#me r#gle2. La bonne rponse est donc la rponse C F E.
16
#1emple d'une srie de donnes spatiales : Auestion * Auelle est la case quil faut mettre la place du point dinterrogation E A B C D E
?
@ans cet exemple, il s8agit d8in)rer la r#gle qui permet de comprendre la succession logique des trois premi#res cases a)in de dterminer le contenu de la case contenant un point d8interrogation. %inq rponses sont proposes. Gn constate qu8il s8agit d8une succession de diagonales orientes di))remment d8une case l8autre. A c!aque tape une diagonale oriente dans l8autre sens, est aHoute. La bonne rponse est donc la rponse C % E. La r#gle in)rer est C aHouter l8tape suivante une diagonale oriente dans l8autre sens E. Le sous-test est constitu de ) questions de dou#le sries de chiffres! de ) questions de dou#le sries de lettres et de (7 questions de sries donnes spatiales.
7ous trouvere- ci*dessous quelques exemples de questions concernant le sous*test ( Logique.
/uestion 1+ B6 M )H .J E C& 6)
/uestion 2+ ?Y+ YR E ;LL @;@ +;; ;R? [Y9 9RY
I7 9& H)
)) C& (I
J7 $& II
.) E& HI(
9& ;;; C& ?+3 C& Y;+ $& RY1 E&1[9
/uestion 3+ .) 6( E (6 J7 C& MB
JI
.B
IM
)6
9& .I
C& ).
$& H)
E& BH
/uestion 3
/uestion 4
17
/uestion ;
R#PO$S#S : Auestion ( * 9 Auestion . * C Auestion B * E Auestion H * C Auestion ) * C Auestion 6 * 9
$O)A)%O$ &( )#S)
9fin dliminer les stratgies de rponses au hasard! chaque #onne rponse est gratifie de H points! tandis que les mauvaises rponses sont pnalises par le retrait dun point. Lesprance mathmatique de performance pour un candidat choisissant de rpondre au hasard est donc gale <ro. Les preuves sont notes comme suit *
Epreuves Partie I Rsolution de problmes Calcul Conditions minimales Partie II %ptitudes verbales Com!"%&ension E'!"ession Partie III Raisonnement &ogique +o,i-ue .aisonnement Nombre de questions !" 15 15 !" 15 15 !" 15 15 Dure Score par preuve #" 20 20 #" 20 20 #" 20 20 Score par partie $" 60 60 $" 60 60 $" 60 60 Mo enne des !a"ties #$ ## et ### ' 10 ( )co"e *inal su" 600 Score final
.AR=
# &2!>A,(A)%O$
:
D H points - ( point 7 point
Rponse exacte * Rponse inexacte * 9#sence de rponse ou rponse multiple *
La note finale dune preuve sera comprise entre - () et D 67.
18
Vous aimerez peut-être aussi
- Lofficiel Du Tage Mage - Manuel Officiel de Préparation Au TestDocument616 pagesLofficiel Du Tage Mage - Manuel Officiel de Préparation Au TestLyonel TiehiPas encore d'évaluation
- Battre Le Tage MageDocument49 pagesBattre Le Tage MageAmedamine33% (3)
- Le Grand Manuel Du TAGE 2Document788 pagesLe Grand Manuel Du TAGE 2Joseph Fazio100% (2)
- Bible Du Tage Mage - Tests Blancs 13-14-15!16!2022Document232 pagesBible Du Tage Mage - Tests Blancs 13-14-15!16!2022Loïc kevin DieukepPas encore d'évaluation
- Le Manuel de DU: Tage MageDocument64 pagesLe Manuel de DU: Tage Magegnimmadabo123100% (1)
- Le Grand Livre Des Tests Psychotechniques de Logique, de Personnalité Et de CréativitéDocument369 pagesLe Grand Livre Des Tests Psychotechniques de Logique, de Personnalité Et de CréativitéGrégori Gaudefroy100% (5)
- Test IFSI Séries GraphiquesDocument10 pagesTest IFSI Séries Graphiquesangry touraPas encore d'évaluation
- Annales Tage2 2013-2014Document127 pagesAnnales Tage2 2013-2014Ulysse CapsisPas encore d'évaluation
- Les Series VisuellesDocument40 pagesLes Series VisuellesKouame parfait Brou100% (1)
- 7TM BlancDocument248 pages7TM BlancArmine NasriPas encore d'évaluation
- Tage MageDocument1 pageTage MagesamiraraPas encore d'évaluation
- Sesame Annales 2009-2010Document161 pagesSesame Annales 2009-2010pikachu91Pas encore d'évaluation
- TAGE-MAGE Calcul 2012 PDFDocument6 pagesTAGE-MAGE Calcul 2012 PDFYann JustsuPas encore d'évaluation
- Feuille TageDocument16 pagesFeuille Tagerassouak100% (2)
- Tests PsychotechniquesDocument57 pagesTests PsychotechniquesAkram Ferchichi100% (2)
- Succes Facile: Comment réussir ses études en comptabilitéD'EverandSucces Facile: Comment réussir ses études en comptabilitéPas encore d'évaluation
- Livret Candidat TageMage PDFDocument65 pagesLivret Candidat TageMage PDFcrackmania100% (1)
- Livret Candidat Tage Mage Fnege WebDocument33 pagesLivret Candidat Tage Mage Fnege Webecoles2commercePas encore d'évaluation
- Tagemage AnnalesDocument32 pagesTagemage AnnalespfservantPas encore d'évaluation
- Les erreurs fréquentes en Mathématiques du cycle secondaire: Enquête statistique - TOME ID'EverandLes erreurs fréquentes en Mathématiques du cycle secondaire: Enquête statistique - TOME IPas encore d'évaluation
- Les tests de sélection dévoilés: Réussir les épreuves psychologiques à l'entretien d'embaucheD'EverandLes tests de sélection dévoilés: Réussir les épreuves psychologiques à l'entretien d'embauchePas encore d'évaluation
- La pratique des tests psychotechniques: Pour réussir les tests de sélection de l'entretien d'embaucheD'EverandLa pratique des tests psychotechniques: Pour réussir les tests de sélection de l'entretien d'embauchePas encore d'évaluation
- Reussir Le Test Tage Mage Annales Nouvelle Edition Fev 2008Document62 pagesReussir Le Test Tage Mage Annales Nouvelle Edition Fev 2008feryelPas encore d'évaluation
- Test de LogiqueDocument12 pagesTest de Logiquephm100% (2)
- Admission Tests TAGE MAGE GMAT 2Document1 pageAdmission Tests TAGE MAGE GMAT 2Oueslati FakherPas encore d'évaluation
- E-Book - Parties Verbales - TAGE MAGEDocument190 pagesE-Book - Parties Verbales - TAGE MAGEDavid GNAGOPas encore d'évaluation
- Exercice TAGE MAGE GRATUIT 10Document2 pagesExercice TAGE MAGE GRATUIT 10TageMajorPas encore d'évaluation
- LE Manuel Du: Tage MageDocument49 pagesLE Manuel Du: Tage Magegnimmadabo123100% (1)
- Corrige Tage MageDocument37 pagesCorrige Tage MageRabie Snouci100% (1)
- TAGEMAGE Calcul 2015Document5 pagesTAGEMAGE Calcul 2015Djalal DaouiPas encore d'évaluation
- BTM Test Blanc 13Document75 pagesBTM Test Blanc 13Mr PenZoPas encore d'évaluation
- Exercice TAGE MAGE Gratuit 5Document3 pagesExercice TAGE MAGE Gratuit 5TageMajorPas encore d'évaluation
- Cours TAGE MAGE - PGCD Et PPCMDocument3 pagesCours TAGE MAGE - PGCD Et PPCMTageMajor100% (1)
- Corrige TAGEMAGE Raisonnement-Argumentation 2015Document4 pagesCorrige TAGEMAGE Raisonnement-Argumentation 2015scribd20014Pas encore d'évaluation
- BTM Test Blanc 14Document60 pagesBTM Test Blanc 14Mr PenZoPas encore d'évaluation
- Test PsychotechniquesDocument38 pagesTest PsychotechniquesAouchouPas encore d'évaluation
- TAGE MAGE TEST BLANC 3 Admissions Parall PDFDocument35 pagesTAGE MAGE TEST BLANC 3 Admissions Parall PDFklfkPas encore d'évaluation
- Rapport Scores TAGE MAGE 2021 S2Document26 pagesRapport Scores TAGE MAGE 2021 S2Aziz AidaraPas encore d'évaluation
- Tage-Mage Calcul 2011Document7 pagesTage-Mage Calcul 2011Emna MechriPas encore d'évaluation
- Score Iae Broch 2019Document8 pagesScore Iae Broch 2019Yahya AçafPas encore d'évaluation
- LE Manuel Du: GrandDocument122 pagesLE Manuel Du: Grandkawtar.raoui23Pas encore d'évaluation
- Here With This NowDocument26 pagesHere With This NowOrockjoPas encore d'évaluation
- UntitledDocument534 pagesUntitledAmine IchbarPas encore d'évaluation
- Ifsi-As-Ap: Culture Générale Et Actualités Sanitaires Et SocialesDocument224 pagesIfsi-As-Ap: Culture Générale Et Actualités Sanitaires Et SocialesFethi ChourouPas encore d'évaluation
- L3 EcoDocument60 pagesL3 EcoEdward ElricPas encore d'évaluation
- Profil D'investissementDocument15 pagesProfil D'investissementSosthene LasmPas encore d'évaluation
- Brochure CPGEDocument24 pagesBrochure CPGEpaul1234686100% (1)
- Score IAEDocument20 pagesScore IAERéthices FagbohounPas encore d'évaluation
- Go SujetDocument1 pageGo SujetSteeve NzambaPas encore d'évaluation
- Pourquoi Faire Un Master Spécialisé Finance À HECDocument2 pagesPourquoi Faire Un Master Spécialisé Finance À HECJM Koffi100% (2)
- ContractionDocument5 pagesContractionEditions du 46100% (1)
- Le Tout-En-Un: Score Iae-MessageDocument58 pagesLe Tout-En-Un: Score Iae-MessagerhoydePas encore d'évaluation
- Accroître le transfert des apprentissages: Vers de nouvelles connaissances, pratiques et expériencesD'EverandAccroître le transfert des apprentissages: Vers de nouvelles connaissances, pratiques et expériencesPas encore d'évaluation
- Livret 2 - Dossier validation VAE - Responsable de travaux Réseaux télécoms Très Haut Débit: 2023, #62D'EverandLivret 2 - Dossier validation VAE - Responsable de travaux Réseaux télécoms Très Haut Débit: 2023, #62Pas encore d'évaluation
- Transformation numérique de l'établissement d'enseignement : partage de pratiques professionnellesD'EverandTransformation numérique de l'établissement d'enseignement : partage de pratiques professionnellesPas encore d'évaluation
- Stratégies d'instrumentalisation juridique et concurrenceD'EverandStratégies d'instrumentalisation juridique et concurrencePas encore d'évaluation
- Parcours pédagogiques d’enseignantes et d’enseignants à l’universitéD'EverandParcours pédagogiques d’enseignantes et d’enseignants à l’universitéPas encore d'évaluation