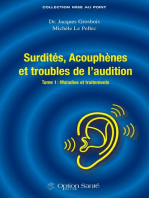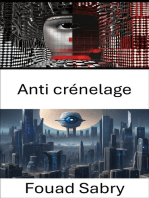Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
I4 Dsync
I4 Dsync
Transféré par
ramosthe05Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
I4 Dsync
I4 Dsync
Transféré par
ramosthe05Droits d'auteur :
Formats disponibles
ECOLE SUPERIEURE DINGENIEURS
EN ELECTRONIQUE
ET ELECTROTECHNIQUE
Cit DESCARTES BP 99
93162 NOISY-LE-GRAND CEDEX
TEL. : 01 45 92 65 00 FAX : 01 45 92 66 99
INTERNET : http://www.esiee.fr
DETECTION SYNCHRONE
Unit EM4-CIAN
2003-2004
O. Franais
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
SOMMAIRE
I RAPPELS SUR LE BRUIT............................................................................................................................... 3
I.1 DEFINITION.................................................................................................................................................... 3
I.2 VARIABLE ALEATOIRE ................................................................................................................................... 3
I.2.1 Densit de probabilit ........................................................................................................................... 4
I.2.2 Loi de probabilit quiprobable............................................................................................................ 4
I.2.2 Loi de probabilit gaussienne ............................................................................................................... 5
I.3 OUTILS MATHEMATIQUES ASSOCIES A LETUDE DES BRUITS EN ELECTRONIQUE............................................ 5
I.3.1 Reprsentation temporelle..................................................................................................................... 5
I.3.2 Reprsentation frquentielle.................................................................................................................. 6
II PRINCIPALES SOURCES DE BRUIT.......................................................................................................... 7
II.1 BRUIT THERMIQUE (JOHNSON NOISE) ........................................................................................................... 7
II.2 BRUIT DE GRENAILLE (SHOT NOISE) ............................................................................................................. 7
II.3 BRUIT DE FLICKER (ROSE OU DE SCINTILLEMENT) ........................................................................................ 8
II.4 BRUIT DUN AMPLIFICATEUR........................................................................................................................ 8
II.5 BRUIT TOTAL................................................................................................................................................ 9
III PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LES SYSTEMES ..................................................................... 10
III.1 CALCUL DU BRUIT SORTIE DUN SYSTEME LINEAIRE ................................................................................. 10
III.2 BANDE EQUIVALENTE DE BRUIT................................................................................................................ 11
III.3 FACTEUR DE BRUIT ................................................................................................................................... 12
IV DETECTION SYNCHRONE : THEORIE ET APPLICATIONS............................................................ 13
IV.1 CADRE DE LA DETECTION SYNCHRONE ..................................................................................................... 13
IV.2 CHAINE DE MESURE CLASSIQUE................................................................................................................ 14
IV.3 CHAINE DE MESURE MODULEE.................................................................................................................. 14
IV.4 DTECTION SYNCHRONE........................................................................................................................... 15
IV.5 CONCLUSION SUR LA DETECTION SYNCHRONE.......................................................................................... 17
IV.6 INFLUENCE DE LA PHASE : CAS DE RECUPERATION DE PORTEUSE............................................................. 18
IV.7 DOUBLE DETECTION SYNCHRONE ............................................................................................................ 19
IV.8 CAS DUN SIGNAL NON CONSTANT............................................................................................................ 19
V REALISATION DU MULTIPLIEUR........................................................................................................... 19
V.1 CAS DE LA BASSE FREQUENCE.................................................................................................................... 19
V.2 CAS DE LA HAUTE FREQUENCE................................................................................................................... 20
V.2.1Multiplieur paires diffrentielles...................................................................................................... 20
V.2.2 Multiplieur par Dcoupage................................................................................................................ 20
VI APPLICATION EXTENSION DU PRINCIPE....................................................................................... 21
VI.1 DETECTION SYNCHRONE APPLIQUEE A LA TRANSMISSION DE SIGNAUX .................................................... 21
VI.1.1 Transmission AM avec Porteuse....................................................................................................... 21
VI.1.2 Transmission AM sans porteuse ....................................................................................................... 21
VI.1.3 Transmission AM Bande Latrale Unique (BLU).......................................................................... 22
VI.1.4 Dmodulation I/Q............................................................................................................................. 23
VI.2 RECHERCHE DE NON-LINEARITE ............................................................................................................... 23
VI.3 DTECTION SYNCHRONE UTILISE EN LOCK IN ...................................................................................... 24
Cas N1 : Modulation du point de mesure .................................................................................................. 25
Cas N2 : Modulation autour du point de mesure....................................................................................... 26
Olivier Franais 2
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
DETECTION SYNCHRONE
La dtection synchrone est un procd utilis lorsque lon souhaite extraire un signal
utile noy dans du bruit. Ce principe sapplique gnralement des signaux de trs faibles
amplitudes (V). On retrouve lutilisation de cette technique pour :
- Mesure de tension de faible niveau noy dans du bruit qui peut peut tre alatoire
ou priodique (type rayonnement 50Hz).
o Capteur
o Chane de mesure et de transmission
- Signaux trs basses frquences, en bande troite, qui peuvent tre considrs
comme quasi-constants.
La dtection synchrone est un moyen de minimiser linfluence du bruit sur le signal
utile en effectuant une mesure optimisant le rapport signal sur bruit :
B
S
) t ( b
) t ( V
log 10 SNR
_______
2
_______
2
dB
= =
I Rappels sur le bruit
I.1 Dfinition
Dans toute mesure ou transmission de signal, on observe des signaux dorigines
multiples (rayonnement, effet dantenne, bruit des composants) qui se superposent
linformation recherche. Ce bruit se traduit par lapparition de signaux erratiques qui
gnrent des tensions ou courants parasites et se rajoutent au signal utile.
Systme
danalyse
e(t)
s(t)
be(t)
bi(t)
Le bruit est donc un signal indsirable qui vient perturber linformation utile. Il peut
tre de deux origines :
- Externe au systme : cest le cas des perturbations lectromagntiques (50Hz
Phnomne dantenne, de diaphonie). Il est toujours possible de minimiser leur
effet par des blindages appropris ou des filtrages appropris.
- Interne au systme : Ce bruit est gnr par les composants eux-mmes. Il ne peut
tre limin.
I.2 Variable alatoire
Avant daborder les bruits rencontrs en lectronique, nous allons dabord faire
quelques rappels sur les variable alatoires.
Olivier Franais 3
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
I.2.1 Densit de probabilit
Une variable alatoire x est classiquement associe une densit de probabilit
p(x) qui caractrise la loi de probabilit dapparition dun vnement (son occurrence) vis
vis de la variable alatoire. Ainsi, la probabilit quun vnement se produisent sur un
intervalle est telle que : | dx x , x + |
| | { }
+
= +
dx x
x
dx ) x ( p dx x , x X Pr
Ainsi, lvnement certain implique quune densit de probabilit soit telle que :
+
=1 dx ) x ( p
A partir de la densit de probabilit, on peut calculer lesprance mathmatique E lie
la variable x :
x dx ) x ( p . x ) x ( E = =
E(x) nest autre que la valeur moyenne de x.
Lesprance mathmatique de x vaut : x dx ) x ( p . x ) x ( E = =
Ce qui nous permet de dfinir la variance qui nest autre que lesprance
mathmatique de ( , elle est note : ) ) x ( E x
( ) ( ) x ) x ( E ) x ( E x E
2
x
= =
I.2.2 Loi de probabilit quiprobable
Dans ce cas, la densit de probabilit est constante sur la gamme de valeur de la
variable alatoire. Cest le cas par exemple du bruit de quantification. Dans le cas dune
quantification centre, le bruit varie entre +q/2 et q/2 avec q le pas de quantification. Dans le
cas dun signal variant de plusieurs pas de quantification, on suppose une qui-rpartition des
valeurs du bruit de quantification entre q/2, soit une densit de probabilit de 1/q :
0 +q/2 -q/2
p(b)
b
1/q
Ainsi : pour q / 1 ) b ( p = | | 2 / q : 2 / q b +
0 ) b ( p = pour | | 2 / q : 2 / q b +
On trouve alors une valeur moyenne du bruit : E(x)=0.
Une variance : =q/12.
Olivier Franais 4
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
I.2.2 Loi de probabilit gaussienne
De nombreuses variables alatoires sont du type gaussien. La densit de probabilit
dune gaussienne centre en a scrit :
e
2
2
2
) a x (
2
1
) x ( p
=
Sa reprsentation est la suivante :
a
x
p(x)
0
Ce qui donne comme esprance mathmatique de x et de x :
E(x)=a et E(x)=
On appelle a la valeur moyenne de la gaussienne et lcart type.
I.3 Outils mathmatiques associs ltude des bruits en lectronique
A la diffrence dune variable alatoire, un bruit en lectronique possde une valeur
alatoire qui fluctue dans le temps. Par contre, ce bruit possde des proprits statistiques qui
sont invariantes dans le temps et le rendent indpendants du temps. On dit quil est
stationnaire et ergodique (moyenne temporelle = moyenne statistique).
I.3.1 Reprsentation temporelle
Un bruit est un signal alatoire qui est en gnral associ une fonction de distribution
(ou de rpartition) et dont la valeur instantane est imprvisible. La valeur temporelle b(t) qui
lui est associ est en gnrale telle que sa valeur moyenne est nulle :
0 ) t ( b =
Par contre, sa valeur quadratique moyenne est non nulle est peut servir sa
caractrisation. On la note B et elle vaut :
_
2
>
=
T
0
T
_
2
dt ) t ( b
T
1
lim B
Rem : B correspond lesprance mathmatique de b.
_
2
Olivier Franais 5
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
La valeur quadratique moyenne nest autre que le carr de la valeur efficace du signal
associ au bruit. Le bruit est associ soit une source de tension v
b
soit une source de
courant i
b
reprsent par :
Vb(t) Ib(t)
On caractrise ces sources par leur tension ou courant efficace en utilisant la puissance
moyenne rduite de bruit, puissance calcule sur une rsistance de 1 :
_
2
b
_
2
b
b V
V
R
P = = ou
_
2
b
_
2
b
b I I
R P = =
En tout point du circuit, ce bruit est toujours ramen aux proprits du signal par le
calcul du rapport de la puissance du signal sur la puissance de bruit (SNR) :
b
s
dB
P
P
log 10 ) SNR ( =
O les puissances calcules correspondent la puissance rduite des signaux et sont
donc les valeurs quadratiques moyennes du signal et du bruit.
Linfluence du bruit sur le signal sera dautant plus faible que le (SNR)
dB
sera grand.
Le calcul de la puissance rduite de bruit peut se faire partir du comportement en
frquence du bruit au travers du systme.
I.3.2 Reprsentation frquentielle
On caractrise les bruits par leur Densit Spectrale de Puissance (DSP). La DSP nest
autre que la transforme de Fourier de la fonction dauto-corrlation du bruit.
Elle correspond la rpartition en frquence de la puissance de bruit.
+
=
0
b b
df ) f ( DSP P (cas monolatrale)
Ainsi, la puissance du bruit est obtenue en intgrant sa DSP sur la gamme de
frquence utile.
Rq1 : Une DSP peut tre associe un comportement en tension ou en courant :
) f ( V
2
b
-> V/Hz
) f ( I
2
b
-> A/Hz
) f ( I
2
b
Rq2 : Dans le cas dune DSP constante dans la bande de frquence utile on parle alors
de bruit blanc.
Rq3 : On dfinit aussi la DSP comme tant le carr du module de la transforme de fourrier:
2
b
) f ( X D =
Olivier Franais 6
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
II Principales sources de bruit
Dans ce qui suit, on se place dans un plan de frquence monolatrale [0 ; +].
II.1 Bruit thermique (Johnson noise)
Dans un conducteur, sous une agitation thermique, les lectrons ont des mouvements
alatoires qui gnrent des variations de potentiels qui se modlisent pour une source de bruit.
Ainsi, une rsistance gnre un bruit dorigine thermique ayant comme densit spectrale de
puissance :
1 e
TR k 4 ) f ( X
kT
hf
kT
hf
= (V
2
/Hz)
Avec T la temprature en degrs Kelvin, R la rsistance en ohms, h la constante de Planck
(6,6.10
-34
Js) et k la constante de Boltzmann : 1,38.10
-23
J.K
-1
A temprature ambiante (300K ) :
pour f=1Ghz 1
1 e
kT
hf
kT
hf
pour f=1Thz 9 , 0
1 e
kT
hf
kT
hf
On notera que pour les applications dlectronique, on peut ngliger le terme
1 e
kT
hf
kT
hf
.
Ainsi, le bruit thermique dune rsistance est considr comme un bruit blanc et
possde donc une DSP constante gale 4kTR (Pour R=1M, X(f)=10
-14
V/Hz).
TR k 4 ) f ( X
On modlise ainsi la rsistance bruyante par un gnrateur de tension plac en srie
avec une rsistance parfaite :
R
R
4kTR
R
4kT/R
ou
Modle de bruit dune rsistance
Ainsi, la tension efficace de bruit (moyenne quadratique) ou le courant efficace de
bruit introduit par une rsistance dans un systme ayant une bande utile f vaut :
f TR k 2 V
T
=
R
f kT
2 Is
=
II.2 Bruit de grenaille (Shot noise)
Ce bruit est du une gnration alatoire des porteurs dans les semi-conducteurs au
travers dune jonction et est proportionnel au courant qui traverse le composant. Ces
Olivier Franais 7
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
fluctuations microscopique du courant dans les semi-conducteurs se modlisent par une
source de bruit en courant ayant comme DSP :
moy
I q 2 ) f ( X = (A
2
/Hz)
Avec q=1,6.10
-19
C
Par exemple, une diode gnre un bruit de grenaille du type bruit blanc quand elle est
traverse par un courant et on le modlise par une source de courant en parallle sur la diode :
Modle de bruit dune diode
Dans un systme ayant une bande passante f , le courant quadratique moyen gnr
par le shot noise vaut :
f qI 2 I
m
2
s = (A)
II.3 Bruit de flicker (rose ou de scintillement)
Cest un bruit basse frquence. Il est li la prsence de dfauts ou dimpurets au
sein dun semi-conducteur (absorptions et relchements alatoires de porteurs). Il est dfini
par un coefficient empirique (K) qui est li la technologie et aux caractristiques des
composants. Sa dpendance spectrale en basses frquences volue en 1/F :
f
K
) f ( X = (V
2
/Hz)
II.4 Bruit dun amplificateur
Un amplificateur contient dans sa structure interne des diodes, transistor, rsistances
qui viennent dgrader le signal par le bruit quils gnrent. Il est pratique de reprsenter les
caractristiques en bruit de lamplificateur par un modle quivalent en bruit ramene en
entre constitu par :
- un gnrateur de tension de bruit plac en srie (type bruit thermique).
- un gnrateur de courant de bruit plac en parallle (type bruit de
grenaille).
Olivier Franais 8
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Le modle dun amplificateur avec son bruit ramen en entre est le suivant :
+
-
A.Op
non
bruyant
V(f)
I(f)
Modle de bruit ramen en entre dun Ampli. Op.
Le modle avec bruit ramen en entre est obtenu par identification en calculant le
bruit total en sortie de lamplificateur pour les deux reprsentations de lamplificateur
(Amplificateur bruyant et amplificateur non bruyant avec bruit ramen en entre).
Lidentification est effectue en deux temps afin de dterminer la source quivalent de
bruit en tension puis la source quivalent de bruit en courant (ou inversement !) :
V(f) : Entre mise en court-circuit, calcul du bruit en sortie puis
identification avec le calcul fait avec le bruit ramen en entre seul (V(f)
en V/Hz).
I(f) : Entre en circuit ouvert, calcul du bruit en sortie puis identification
avec I(f) (en A/Hz).
A noter, que cette reprsentation peut sappliquer pour tout systme. Une fois tablie,
elle simplifie grandement les calculs, car le systme (Ampli, Quadripole) est alors
considr comme parfait (non bruyant), il juste prendre en compte les sources quivalentes de
bruit places en entre (Ib et Vb).
Les data sheet des C.I. fournissent des renseignements concernant les valeurs V
b
et I
b
.
Les valeurs typiques sont une tension efficace de bruit de 10nV/ Hz et un courant efficace de
bruit de 0.01pA/ Hz .
II.5 Bruit total
Les bruits ntant pas corrls entre eux ( priori), le bruit total en sortie dun
systme est la somme des bruit prsents au sein du systme :
=
i
bi btot
P P
=
i
__
2
__
2
bi btot
V V
Ce qui sapplique aussi pour la DSP :
=
i
bi btot
) f ( DSP ) f ( DSP
=
i
2 2
) f ( V ) f ( V
bi btot
Ci dessous, lexemple dun relev de la densit spectrale de puissance de bruit dun
amplificateur inverseur Ampli. OP, le relev a t effectu pour diffrents gains :
Olivier Franais 9
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Bruit en sortie dun Amplificateur inverseur (Source Gilles Amendola)
On remarquera, dans ce cas, que le bruit est important en basse frquence (bruit de
flicker), quil prsente un minima pour 200kHz (zone de Bruit thermique du type bruit blanc),
quil diminue fortement au-del de 100Mhz (coupure en frquence de lampli). Le bruit total
est la superposition des diffrents bruits prsents dans le systme (A.OP et rsistance).
III Prise en compte du bruit dans les systmes
III.1 Calcul du bruit sortie dun systme linaire
Le calcul de la puissance de bruit en sortie dun systme seffectue partir de la
rponse en frquence qui lie la tension de bruit en sortie Sb lorigine de la source de bruit
Vb. Soit H(f) cette fonction de transfert :
Systme
H(f)
Vb(t)
Sb(t)
Connaissant H(f), on peut crire que :
) f ( V ). f ( H ) f ( S
b b
=
Ce qui implique en terme de densit spectrale de puissance que :
) f ( V . ) f ( H ) f ( S
2
b
2
2
b
=
La densit spectrale de puissance en sortie du filtre S est le produit entre la densit
spectrale de puissance en entre multipli par le module lev au carr de la fonction de
transfert du systme
) f (
2
b
) f ( V
2
b
2
) f ( H .
La puissance en sortie se calcule en intgrant la DSP : ) f ( S
2
b
+
=
0
2
b b , s
df ) f ( S P
Olivier Franais 10
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Exemple : Calcul de la tension efficace de bruit aux bornes dun circuit RC :
R
C
v(t) R
C
b
On prend en compte le bruit de la rsistance en lui associant sa tension de bruit b
(Bruit thermique de DSP Db(f) = 4kTR, du type bruit blanc). Le calcul seffectue en trois
tapes :
a: Calcul de la fonction de transfert qui lie la tension v la source de bruit b est :
RC 2 j 1
1
) f ( B
) f ( V
) f ( H
+
= =
b : Calcul de la DSP de bruit au niveau de la tension v :
) RC 2 ( 1
kTR 4
) f ( D ) f ( H ) f ( D
b
2
v
+
= =
La reprsentation dans le plan de frquence de la DPS en sortie est donc le produit
entre le bruit blanc de la rsistance R et le module au carr dun filtre passe bas de frquence
de coupure 1/RC :
0 f
4kTR
Dv(f)
Db(f)
1/RC
c : Calcul du carr de la tension efficace de bruit en sortie, qui correspond la
puissance rduite de bruit, obtenu en intgrant la DSP :
C
kT
) RC 2 tan( ac
C
kT
df
) RC 2 ( 1
kTR 4
df ) f ( D V
0 0 0
v
__
2
b
=
(
=
+
= =
+ +
+
On obtient donc une tension efficace de bruit V
b
=
C
kT
III.2 Bande quivalente de bruit
Soit un filtre de gain G(f), la bande quivalente de bruit est une bande de frquence
(f
b
ou Beq) donnant la mme puissance de bruit en sortie du filtre en considrant une
Olivier Franais 11
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
caractristique du filtre idalise par un gain constant Go sur cette bande de frquence (Beq
ou f
b
). Le gain constant Go a pour valeur le gain nominal de la fonction de transfert :
0
f
0
f
bruit
blanc
B
Gmax
Reprsentation par bande quivalente de bruit
Lutilisation de la Bande Equivalent de Bruit (Beq) se fait dans le cas de bruit
possdant un comportement du type bruit blanc (de valeur De). Ainsi dans ce cas, le calcul en
sortie du filtre de la puissance de bruit est :
+
=
0
2
2
b
df ) f ( G De S
En considrant le filtre idalis (Gain Go sur une bande de frquence Beq), on obtient
comme puissance de bruit en sortie :
Beq . Go . De S
2
b
=
Par identification on en dduit la valeur de la bande quivalente de bruit Beq :
= df ) f ( G
G
1
B
2
2
o
eq
Exemple : Calcul de la Bande quivalente de bruit pour un filtre passe bas du premier ordre
fo
f
j 1
1
) w ( H
+
=
( )
| |
2
fo ) fo / f arctan( fo df
fo / f 1
1
B
0
0
2
= =
+
=
La connaissance de la bande quivalente de bruit Beq dun filtre de gain nominal Go
permet, dans le cas de bruit densit spectrale constante De, de calculer la tension efficace de
bruit en sortie de lamplificateur de manire directe en appliquant la formule :
Beq . Go . De V
s , b
=
Cela permet de simplifier les calculs partir de la connaissance des Beq des filtres
utilises.
III.3 Facteur de bruit
Le facteur de bruit (not F) permet de connatre la dtrioration dun signal vis vis
du bruit au travers dun systme et ceci en terme de rapport signal sur bruit. Il est le rapport
entre le SNR en entre et le SNR en sortie du systme. Il correspond aussi au rapport entre le
bruit total en sortie et le bruit en sortie en considrant le systme parfait :
Olivier Franais 12
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
| |
| | entre d' gnrateur de rsistance la du sortie en Bruit
sortie en l Bruit tota
) / (
) / (
= =
sortie
entre
B S
B S
F
En effet, considrons un quadriple (systme) ayant un gain en puissance G et
gnrant en sortie un bruit Ni. On branche en entre un signal de puissance Se et ayant une
puissance de bruit Ni. En sortie du quadriple, on retrouve le signal avec une puissance
Ss=G.Se et un bruit de puissance Ns=Ne.G+Ni. Le calcul du facteur de bruit est donc :
| |
| | Ne . G
Ns
Ne . G
Ni
1
Ni
Ni Ne . G
.
G
1
Ns / Ss
Ne / Se
B / S
B / S
F
out
in
= + =
+
= = =
On trouve bien une dgradation du SNR, puisque F est suprieur 1.
Rq : La puissance de bruit en entre est en gnral associe une rsistance qui est prise
comme la rsistance quivalente du gnrateur dentre.
Cas de lassociation de plusieurs quadriple (Gain en puissance Gi, Facteur de bruit Fi) :
On montre que le facteur de bruit de lensemble est obtenu par la formule de Friss :
.....
G G G
1 F
G G
1 F
G
1 F
F F
3 2 1
4
2 1
3
1
2
1 tot
+
+ =
On voit quil est important de soigner le facteur de bruit du premier tage (tage
dentre, le pr-amplificateur), car une fois le signal amplifi par le gain G1, celui ci vient
rendre ngligeable les facteurs de bruits suivants (division par G1). On peut considrer que le
signal amplifi par le premier tage (G1) devient insensible aux bruits des quadriples
suivants.
IV Dtection synchrone : Thorie et applications
IV.1 Cadre de la dtection synchrone
On utilise le principe de la dtection synchrone dans principalement deux cas ddis
la mesure de tension de faible niveau (V) noy dans du bruit (alatoire thermique) ou
priodique (induit 50H) :
Mesure : Signal issu dun capteur
Transmission : Rception dun signal modul
Nous allons montrer lintrt de la dtection synchrone appliqu la chane de mesure
dun signal issu dun capteur.
Olivier Franais 13
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
IV.2 Chane de mesure classique
Une chane de mesure conventionnelle associe un capteur, un amplificateur puis un
filtre :
Capteur Ampli
Gain Gd
Filtre
Vmesure
Vout
Passe bas
Bande utile
Alim E (DC)
Chane de mesure classique
La tension en sortie du filtre est du type (cas montage type pont de wheatstone) :
) t ( b A . G . E Vout
d
+ =
Avec E : tension dalim du capteur, G
d
: Gain diffrentiel de lamplificateur, A : Info mesurer issue du capteur,
b(t) :bruit introduit par le capteur et lampli (prpondrant en basse frquence).
Ainsi, le filtre va permettre de rcuprer le signal utile et de minimiser la prsence du
bruit b(t). La mesure est effectue ici en basse frquence (Alimentation en DC), or cest en
basse frquence que le bruit de flicker est prpondrant (Voir Caractristique dun
amplificateur I.4)
f
Filtre
1
dB
Mesure avec moyenneur en sortie
On peut se contenter de ce type de mesure si le calcul du SNR rpond au cahier des
charges. Si ce nest pas le cas, la premire ide pour amliorer le SNR est deffectuer une
mesure dans une gamme de frquence o le bruit est minimum et non pas en basse frquence,
zone o le bruit de Flicker est prpondrant.
IV.3 Chane de mesure module
De manire assurer une mesure dans une zone de bruit minimal, on vient moduler la
source de mesure pour effectuer la mesure sur une frquence donne. Ainsi le capteur est
aliment non plus en continu mais via une frquence de modulation :
Capteur Ampli
Gain Gd
Filtre
Slectif
Vmesure
Vout
Alim AC (Fm)
[Beq]
Modulation
Chane de mesure modul
Olivier Franais 14
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Avec la modulation de la source du capteur, la tension en sortie de lamplificateur est :
) t ( b t cos A EG Vout
m d
+ =
Le choix de la frquence de modulation est li la zone de frquence o la DSP du
bruit est minimum. Le rle du filtre slectif va consister ne conserver en sortie de chane que
la frquence de modulation Fm.
f
Filtre
Slectif
1
dB
Fm
Ampli
Mesure avec filtrage slectif en sortie
On considrera que le bruit est caractris par une puissance et quil se rpartit sur
une bande quivalente de bruit B
2
b
eq
. Lamlioration du SNR va tre li la bande passante (f)
du filtre slectif :
Avant filtrage :
( )
2
b
2
d
2 / A EG
= SNR
Aprs filtrage :
( )
Beq
f
.
2 / A EG
2
b
2
d
= SNR
On voit que si lon veut amliorer le SNR, il faut alors raliser un filtre slectif avec
un trs bon facteur de qualit Q (Bande passante troite) :
f
f
Q
m
=
Or dun point de vue pratique, le facteur de qualit dun filtre classique ne peut
dpasser la valeur de 100. On va donc pouvoir amliorer le SNR, mais on va se butter une
limite technologique.
Mais si cette technique en terme de SNR nest pas suffisante, il faut alors faire appel
une technique complmentaire qui va permettre de raliser un filtre Bande Passante trs
troite. Cest le principe de la Dtection Synchrone.
IV.4 Dtection synchrone
La dtection synchrone sappuie sur la modulation de la source du capteur pour tre
dans une zone de bruit minimum. Le signal est ensuite amplifi et ventuellement filtr de
Olivier Franais 15
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
manire slective. Il est alors dirig vers un multiplieur pour effectuer la dmodulation
synchrone et puis filtr laide dun intgrateur :
Capteur Ampli
Vmesure Vout
(Fm)
Modulation
Gnrateur
Pilote
(+ Slectif)
Multiplieur
Intgrateur
Passe Bas
Dmodulation
Principe de la dtection synchrone
Le signal en sortie de lamplificateur (slectif) est : Vout ) t ( b t cos A EG
f m d
+ =
Ce signal est multipli par la porteuse Ecosw
m
t.
On a alors en sortie du multiplieur :
t cos E * )) t ( b t cos A EG ( V
m f m d mult
+ =
m m
m f m
2 2
mult
en centr Bruit 2 Pulsation Continu
t cos E ) t ( b t 2 cos 2 / GdA E 2 / GdA E V
+ + =
Le signal en sortie du multiplieur est ensuite filtr par un passe bas (Frquence de
coupure Fc) pour ne rcuprer que la composante continue du comportement du capteur :
2 / A G E V
d
2
mult
=
Le rapport signal sur bruit en sortie de chane est alors :
( )
Beq
fc
A EG
SNR
b
d
.
4 /
2
2
=
(on suppose un filtre passe bas du 1
er
Ordre Beq=/2.Fc)
f
Ampli
Slectif
0
Fm
Bruit
Multiplication
f
0 Fm 2Fm
Intgrateur
(Passe Bas Fc)
Dmodulation synchrone : translation de frquence
En comparant le SNR de la dtection synchrone (II.3) au SNR obtenu par modulation
et filtrage slectif (II.2), on voit que le moyenneur (filtre passe bas) se comporte comme un
Olivier Franais 16
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
filtre slectif, il est alors dans le cadre de la dtection synchrone quivalent un filtre passe-
bande de slectivit fm fc 2 .
On peut donc obtenir de trs grande slectivit quivalente et donc des facteurs de
qualit levs (>100). De plus, cest un filtre passe bande quivalent qui sadapte
automatiquement la frquence centrale (ici de modulation/dmodulation) :
f
0
Fm
f
Fm
Passe Bas
(Frquence de coupure Fc)
2Fc
Comportement
identique
Passe bande
(Slectivit 2Fc/Fm)
0
Equivalence du passe bas en passe bande slectif
IV.5 Conclusion sur la dtection synchrone
La dtection synchrone est constitu des tapes suivantes :
Modulation une frquence fm, zone de frquence o le bruit est minimum
(limination du bruit en 1/f, du bruit denvironnement type 50Hz ou
multiple et dautres interfrences).
Amplification (Slective : rduction la bande de frquence utile occupe
par la modulation). Forte attnuation du bruit hors bande.
Dmodulation par multiplication synchrone : Transposition autour de zro
des frquences synchrones de fm.
Moyenneur (Frquence de coupure fc) : Rcupration des signaux avec une
bande passante dautant plus troite que la constante de temps du
moyenneur est grande. (SNR important).
On dtecte ainsi les signaux initialement situs (avant dmodulation) dans la bande de
frquence [fm-fc ;fm+fc].
Afin de parfaire la rduction de bande, on utilise aprs la modulation un amplificateur
slectif de manire liminer les harmoniques de fm (3fm, 5fm). De cette manire on
saffranchit des non-linarits ventuelles du multiplieur et du THD du gnrateur pilote.
Le rapport signal sur bruit sera dautant plus grand que la constante de temps du
moyenneur sera grande (fc petit).
Olivier Franais 17
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
IV.6 Influence de la phase : Cas de rcupration de porteuse
Nous avons vu lintrt de la dtection synchrone applique lamlioration du
rapport signal sur bruit (SNR) dans un dispositif de mesure. Dans ce cas, la frquence de
modulation (porteuse) est identique la frquence de dmodulation.
Dans le cas de la transmission de donne par modulation damplitude, le mme
principe peut tre appliqu pour raliser la dmodulation et rcuprer le signal transmis. Par
contre dans ce cas, la porteuse nest plus physiquement prsente du faite de la transmission
qui spare lmetteur du rcepteur. Il faut donc tre capable de restituer la porteuse. On utilise
pour cela des PLL (Boucle Verrouillage de Phase).
Dtection
synchrone
Rcupration
de porteuse
(PLL - Boucle de costas)
Signal
reu
Vm
Une PLL est capable de restituer la frquence de la porteuse avec une amplitude
constante, par contre il est possible quil subsiste une diffrence de phase entre la frquence
de la porteuse et la frquence restitue :
Signal dentre (issu de la rception) : t cos A
m
(A :amplitude dtecter)
Porteuse restituer en sortie de PLL : ( ) + t cos E
m
'
(E :amplitude fixe)
La multiplication de ces deux signaux pour la dmodulation puis moyennage donne
comme signal de mesure :
= cos
2
A E
Vm
'
avec dphasage entre porteuse mise et porteuse restitue
La prsence dans le signal de mesure de vient perturber la dmodulation :
Il faut sassurer que le dphasage entre la porteuse mise et restituer est constant :
Importance de la PLL qui assure cette fonction par asservissement de phase.
Il faut que ce dphasage soit diffrent (loign) de /2 sinon le signal de mesure
est nul (Vm=0)
Cest ce que lon appelle la dmodulation synchrone o il faut faire un contrle de la
phase prcis. Utiliser un oscillateur local non asservi nassurerait pas une dmodulation
correcte.
Olivier Franais 18
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
IV.7 Double Dtection Synchrone
Si lon souhaite effectuer une dmodulation qui ne dpende pas de la phase existante
entre la frquence de modulation et de dmodulation, il est possible dutiliser ce montage :
Double dtection synchrone
IV.8 Cas dun signal non constant
Si on souhaite dtecter une amplitude A(t) qui varie lentement en fonction du
temps, le principe de la dtection est toujours applicable. Dans ce cas, il faudra choisir un
moyenneur en sortie de multiplieur ayant une constante de temps infrieure ou gale la
vitesse de variation du signal mesurer. Cela se traduit par une frquence de coupure
suprieure ou gale la frquence maximum du signal A(t).
V Ralisation du multiplieur
V.1 Cas de la basse frquence
Dans le cas dune porteuse en basse frquence, la dtection synchrone peut se faire de
manire complte en numrique en utilisant un DSP associ des filtres numriques :
Capteur Ampli
E/B
CAN
DSP
multiplieur
DSP
filtrage
CNA
filtre
EPROM
sinus programme
CNA
filtre
Clock
Vm
Modulation
Dmodulation
Olivier Franais 19
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
V.2 Cas de la haute frquence
V.2.1Multiplieur paires diffrentielles
On utilise une paire diffrentielle base de transistor bipolaire de manire effectuer
la multiplication. La structure cellule de Gilbert permet dobtenir une multiplication dans les
quatres quadrants.
V.2.2 Multiplieur par Dcoupage
On vient multiplier le signal dentre par un signal de dcoupage (1).
-
+
Vc
R1
R1
E
S
R2
+1
-1
S
Vc
E
Dtection synchrone par dcoupage
La commande du dcoupage est tel que :
- Vc>0 S=+E
- Vc<0 S=-E
Cela revient multiplier E par un signal crneau C
r
de valeur 1 :
S(t)=E(t)C
r
(t) avec
C
r
(t)= t ) 1 n 2 sin(
1 n 2
1 4
cr
0 n
+
+
=
(DSF du crneau)
On effectue donc une multiplication par un fondamental (n=0) et des harmoniques
(n>0). En prenant un crneau synchrone avec le signal S(t) (
m cr
= ), on se replace dans le
cas dune dtection synchrone :
| | | | ... 4 2
4
2
A
) t ( S
t ) 1 n 2 sin(
1 n 2
1 4
* ) t sin( A ) t ( S
m m
cr
0 n
m
+ + +
=
+
+
=
=
Le filtre passe bas plac en aval limine non seulement la pulsation double (2w
m
) mais
aussi toutes les harmoniques (4w
m
, 6w
m
.). En sortie du passe bas on rcupre uniquement le
terme constant :
=
A 2
) t ( S .
Olivier Franais 20
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Remarque :
Pour le passe bas, plus la frquence de coupure est basse plus le SNR sera grand mais
plus le rgime transitoire sera long. Il y a donc un compromis faire entre la rapidit et la
qualit de la dmodulation.
VI Application Extension du principe
Les applications de la dtection synchrone se retrouvent sous deux familles qui sont
les dispositifs de mesure (le signal qui sert effectuer la modulation et celui qui fait la
dmodulation, lensemble du systme est local) et les systmes de transmission o la
rception on est amen reconstituer le signal de modulation laide dune PLL.
VI.1 Dtection synchrone applique la transmission de signaux
Elle sapplique dans le cas de la transmission par modulation damplitude. On parle
alors de dmodulation synchrone. Il existe diffrents cas lis aux caractristiques de la
modulation damplitude.
VI.1.1 Transmission AM avec Porteuse
Le signal modul est du type : t cos ) t cos m 1 ( A ) t ( s
m
+ = . Avec m le taux de
modulation, la frquence du signal transmettre et w
m
la frquence de modulation. La
dmodulation se fait en multipliant s(t) par la porteuse restitue via une PLL (II.6) :
Principe de la dmodulation synchrone avec PLL
Le filtre de sortie a pour rle de ne conserver que le signal utile, ici la frquence .
VI.1.2 Transmission AM sans porteuse
Dans ce cas, le signal dmoduler est du type :
t cos t cos A ) t ( s
m
=
Olivier Franais 21
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Il ne contient aucune nergie la pulsation w
m
de la porteuse. Une simple PLL ne
suffit plus pour effectuer la dmodulation. On utilise alors une boucle de Costas constitue de
deux PLL :
La boucle de Costas pour la dmodulation synchrone
Note sur la boucle de Costas :
Soit Bcos( 0 t+a) le signal en sortie de l'oscillateur local, aprs multiplication et
filtrage on obtient : KABcos(a)e(t)/2 o K est la constante du multiplieur, on a donc bien
ralis une dmodulation. Il reste cependant un problme majeur rsoudre, en effet si la
phase de l'oscillateur local est de pi/2 le signal rcupr est nul car cos(pi/2)= 0; il est donc
indispensable de verrouiller la phase de l'oscillateur local. Une simple boucle verrouillage
de phase ne permet pas de verrouiller la phase de l'oscillateur local car le signal modul reu
ne contient aucune nergie la frquence f 0 . Pour verrouiller la phase de l'oscillateur local, il
faut gnrer un signal d'erreur indpendant de e(t); c'est ce que ralise la boucle de Costas du
nom de son inventeur.
VI.1.3 Transmission AM Bande Latrale Unique (BLU)
Afin de rduire lencombrement spectral, on ne transmet quune seule bande (droite ou
gauche autour de la porteuse). Le signal transmis est du type :
t ) cos( A ) t ( s
m
+ =
Olivier Franais 22
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
La dmodulation synchrone se fait en recomposant une porteuse en phase avec la
porteuse mise. Cela nest possible que si une porteuse dite rduite est transmise de manire
permettre la PLL de sasservir en phase sur la porteuse :
Dmodulation synchrone pour BLU
VI.1.4 Dmodulation I/Q
Lorsque que lon souhaite transmettre plusieurs informations sur un mme canal, de
manire rduire lencombrement spectral, on est amen utiliser une seule porteuse. Dans le
cas de deux signaux, on utilisera la porteuse brute dite en phase (In phase) pour un signal et
la porteuse dphase de /2 dite en quadrature (Q) pour lautre. A la rception, un
dmodulateur I/Q assurera la restitution des deux signaux :
Dmodulation I/Q
Il faut tre capable de restituer la porteuse en verrouillant sa phase vis vis dun
oscillateur local. Ceci se fait en gnral avec une boucle de Costas. Cette technique est
applique pour le codage de la chrominance pour le codage du rouge et Bleu (NTSC et PAL).
On peut tendre ce principe au cas de n signaux en crant des constellations de
dphasage et damplitude partir dune porteuse principale. Cest le cas de nombreuses
transmissions numriques de donnes par tlphonie.
VI.2 Recherche de non-linarit
Olivier Franais 23
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
La dtection synchrone peut sappliquer lorsque lon souhaite caractriser les non-
linarits dun systme du type :
... bX aX Y + + =
La connaissance du n
ime
coefficient (a, b, ) peut tre obtenue en excitant (modulant)
le systme par une frquence w et en le dmodulant par une frquence nw .
Exemple : cas Y bX aX+ =
t cos E X = t 2 cos
2
bE
t cos aE
2
bE
t cos bE t cos aE Y + + = + =
Obtention de a : Dmodulation (multiplication) de Y par puis moyenneur t cos E
2
E
a S =
Obtention de b : Dmodulation (multiplication) de Y par puis
moyenneur
t 2 cos E
4
E
b S
3
=
La limite de cette technique est lie la capacit du systme de gnrer des
harmoniques en phase avec le fondamental (pour n coefficients il faut n harmoniques). En
numrique, ce problme est rsolu en utilisant une mmoire contenant une sinusode et que
lon vient lire frquence variable.
VI.3 Dtection synchrone utilise en LOCK IN
Un systme de mesure dit Lock In consiste raliser une mesure en 4 tapes :
modulation, amplification slective, dmodulation synchrone et moyennage (filtrage passe
bas). Les trois dernires phases sont ralises par un amplificateur lock in.
Lorsque que lon cherche tracer la dpendance dun phnomne physique Y en
fonction dun paramtre X (Y=f(X)), on peut utiliser une modulation du paramtre X pour
amliorer le SNR qui est dtrior par la prsence dun bruit basse frquence souvent li
lappareillage.
Pour se faire, on effectue un balayage (lent) du paramtre X avec une priode To
auquel on vient rajouter une frquence de modulation (rapide) pour effectuer la mesure dans
une zone de faible bruit.
Olivier Franais 24
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Capteur
Paramtre
Ampli (Slectif)
Dtection
Synchrone
Filtre Passe Bas
T=RC
Source de
polarisation
Source de
Balayage
Gnrateur
Pilote modulation
Dmodulation
Visualisation
Y
X
To (Priode de balayage)
Principe du Lock-In
Cette modulation peut se faire de deux manires
Cas N1 : Modulation du point de mesure
On est dans un cas comparable de la modulation damplitude. On multiplie le signal
X par la frquence de modulation :
Sans modulation Avec modulation
X | |
To
at X = | | ) t f 2 cos( * at X
m To
=
Y | | ) at ( f ) X ( f Y
To
= = | | ) t f 2 cos( * ) at ( f Y
m To
=
C
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
T
e
m
p
o
r
e
l
t
Y
To 0
t
Y
To
0
Modulation Fm
C
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
F
r
q
u
e
n
t
i
e
l
0
Y(f)
f
fo
2fo
0
Y(f)
f
fm+f o
fm+2f o
fm
Ampli Slectif
On notera que lamplificateur slectif ainsi que le filtre Passe Bas de sortie ne doivent
pas perturber le spectre contenant la mesure. Il faut donc sassurer que leur bande de
frquence respective est bien suprieure la bande de frquence du signal Y qui contient des
harmoniques de fo.
Si on veut rduire la bande de frquence de Y il faut augmenter la dure T de balayage
(diminuer la frquence de balayage).
Olivier Franais 25
Dtection Synchrone Groupe ESIEE
Cas N2 : Modulation autour du point de mesure
Dans ce cas, on ajoute la frquence de modulation au signal de manire se placer
dans une situation du type petits signaux :
Sans modulation Avec modulation
X | |
To
at X = | |
fm A m To
X X ) t f 2 cos( b at X + = + =
Y | | ) at ( f Y
To
=
A
X
A A
dX
dY
X ) X ( f ) X X ( f Y |
.
|
\
|
+ = + =
(D.L. Taylor Ordre 1)
C
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
T
e
m
p
o
r
e
l
t
Y
To 0
t
Y
To
0
A
C
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
F
r
q
u
e
n
t
i
e
l
0
Y(f)
f
fo
2fo
0
Y(f)
f
fo
2fo
fm
Aprs dmodulation et filtrage, on obtient un signal dont lamplitude est limage de la
pente de la courbe dvolution de Y en fonction de X :
a
X X
2
dX
dY
2
b
Vs
=
|
.
|
\
|
Cela suppose que lon effectue une faible modulation autour du point.
Pour obtenir la courbe Y=f(X), il suffit dintgrer le rsultat.
Olivier Franais 26
Vous aimerez peut-être aussi
- Mecanique Generale - Cours Et Exercices Corriges PDFDocument277 pagesMecanique Generale - Cours Et Exercices Corriges PDFAlanbertro Omar100% (4)
- Les Capteurs de VibrationDocument15 pagesLes Capteurs de VibrationJames Xgun100% (2)
- Realiser Un Telemetre A UltrasonsDocument13 pagesRealiser Un Telemetre A Ultrasons0221diopePas encore d'évaluation
- Manuel Technique Regulateur-2eme Génération PDFDocument33 pagesManuel Technique Regulateur-2eme Génération PDFmaintenancePas encore d'évaluation
- Chap3 Systèmes Discrets PDFDocument23 pagesChap3 Systèmes Discrets PDFHichem HamdiPas encore d'évaluation
- Chauvin Arnoux C.A 832 Sound Level Meter User ManualDocument43 pagesChauvin Arnoux C.A 832 Sound Level Meter User ManualTeam QuestInPas encore d'évaluation
- Acquerire SMB Idrissi 2019Document8 pagesAcquerire SMB Idrissi 2019mahmoudPas encore d'évaluation
- Cours ArduinoDocument7 pagesCours Arduinostef raadPas encore d'évaluation
- Modelisation 1as 2022 OfficielDocument4 pagesModelisation 1as 2022 OfficielRAOUA JOUINI100% (1)
- Total 2Document214 pagesTotal 2Anonymous 1XnVQmPas encore d'évaluation
- Testo 816 1 Mode D'emploiDocument32 pagesTesto 816 1 Mode D'emploikessery koivoguiPas encore d'évaluation
- Intro Trait Signal CoursDocument20 pagesIntro Trait Signal Coursmoha.elayadyPas encore d'évaluation
- 01 IS 03 Acquerir CoursDocument13 pages01 IS 03 Acquerir CoursZEMOURI ABDELHAKIMPas encore d'évaluation
- Capteurs PDFDocument21 pagesCapteurs PDFLango Richard BambaPas encore d'évaluation
- Operating Instructions m4000 Advanced m4000 Advanced A P and m4000 Area 60 80 FR Im0017740Document156 pagesOperating Instructions m4000 Advanced m4000 Advanced A P and m4000 Area 60 80 FR Im0017740Achraf KitPas encore d'évaluation
- Les CapteursDocument6 pagesLes CapteursSouad LouniciPas encore d'évaluation
- CHAPON ArthurDocument77 pagesCHAPON ArthurSEIFEDDINE KADRIPas encore d'évaluation
- Cours Optoélectronique 2005-2006 PDFDocument33 pagesCours Optoélectronique 2005-2006 PDFOussama El B'charriPas encore d'évaluation
- 3CI2-A4 Ressources CapteurDocument2 pages3CI2-A4 Ressources CapteurLucien Dikla Ngueleo - 2022 intakePas encore d'évaluation
- Signaux AléatoiresDocument9 pagesSignaux AléatoiresmorchedtounsiPas encore d'évaluation
- Capt EursDocument26 pagesCapt EurswoulkanPas encore d'évaluation
- Cours TS UE STI 2018 2019 Distribue PDFDocument204 pagesCours TS UE STI 2018 2019 Distribue PDFmohamed chebbiPas encore d'évaluation
- 22-23 TS1 CRS2 - Transmit-InfoV1-articleDocument4 pages22-23 TS1 CRS2 - Transmit-InfoV1-articlelroy.persoPas encore d'évaluation
- PHYS708 Traitement SignalDocument44 pagesPHYS708 Traitement SignalbouzidiPas encore d'évaluation
- Capteurs Industriels de VibrationDocument8 pagesCapteurs Industriels de VibrationAbozou-Esso PissiyouPas encore d'évaluation
- Traitement Numerique Du Signal en TempsDocument14 pagesTraitement Numerique Du Signal en TempsGaya Sylvesteur MalkoudaïPas encore d'évaluation
- Expose LPJDocument27 pagesExpose LPJFrère Paul Angelo MahanPas encore d'évaluation
- Electronique Appliquee Aux Hautes FrequencesDocument555 pagesElectronique Appliquee Aux Hautes FrequencesRejeb Ghomrassi100% (5)
- Section 6Document33 pagesSection 6Hanse NgoyPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 1et2correct1-1Document31 pagesCHAPITRE 1et2correct1-1souhila.kmn2Pas encore d'évaluation
- CHAPITRE 1.2.3Document43 pagesCHAPITRE 1.2.3souhila.kmn2Pas encore d'évaluation
- Numerisation Des SignauxDocument18 pagesNumerisation Des SignauxFadila FEPas encore d'évaluation
- Chapitre 8 Mesurer Des Grandeurs Exercices 4eme 2017Document8 pagesChapitre 8 Mesurer Des Grandeurs Exercices 4eme 2017kenzajaoudi15Pas encore d'évaluation
- Etude Des CapteursDocument17 pagesEtude Des CapteursKhalil BelghiyatiPas encore d'évaluation
- TE 5 420 Interfaces Audionumériques AES - EBUDocument16 pagesTE 5 420 Interfaces Audionumériques AES - EBUmanessePas encore d'évaluation
- Capteurs Optiques WeloDocument12 pagesCapteurs Optiques Weloboris kengnePas encore d'évaluation
- Frg Fir 0524 Fr 0621Document136 pagesFrg Fir 0524 Fr 0621MADOUGOU OUROPas encore d'évaluation
- Code 4b5bDocument27 pagesCode 4b5bsevemassePas encore d'évaluation
- CHAPITRE I half correctDocument20 pagesCHAPITRE I half correctsouhila.kmn2Pas encore d'évaluation
- Cours Télécommunications ERM FRDocument268 pagesCours Télécommunications ERM FRDominiquePas encore d'évaluation
- Notice Alarme Atlantic's STIIIDocument43 pagesNotice Alarme Atlantic's STIIISébastien DE MARTINPas encore d'évaluation
- DSP - Tout Les ChapitresDocument24 pagesDSP - Tout Les ChapitresMohamed DjezzarPas encore d'évaluation
- Cours Tds Fip1a PDFDocument83 pagesCours Tds Fip1a PDFMarie MimiiPas encore d'évaluation
- ST PO Philosophie Des Protections V1Document50 pagesST PO Philosophie Des Protections V1ferriahocine2011Pas encore d'évaluation
- Chapitre1 - Généralité Sur Les SignauxDocument25 pagesChapitre1 - Généralité Sur Les SignauxAdama TraoréPas encore d'évaluation
- Revista Electronique Et Loisirs - 028Document96 pagesRevista Electronique Et Loisirs - 028Jhon Garay100% (2)
- Les CapteursDocument6 pagesLes Capteursleroy makita loubakiPas encore d'évaluation
- ELE6506 Mesures D Antennes PauDocument24 pagesELE6506 Mesures D Antennes PautugasutomoPas encore d'évaluation
- Électronique de Conditionnement Du CapteurDocument31 pagesÉlectronique de Conditionnement Du Capteurelectroblida100% (6)
- Traité d'économétrie financière: Modélisation financièreD'EverandTraité d'économétrie financière: Modélisation financièrePas encore d'évaluation
- Banque de filtres: Aperçu des techniques de banque de filtres de Computer VisionD'EverandBanque de filtres: Aperçu des techniques de banque de filtres de Computer VisionPas encore d'évaluation
- Maison Intelligente: Conception et réalisation d'une maison intelligenteD'EverandMaison Intelligente: Conception et réalisation d'une maison intelligenteÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)
- Simulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysD'EverandSimulation des vibrations mécaniques, 2e édition: par Matlab, Simulink et AnsysPas encore d'évaluation
- Reporting pilier 3 de solvabilité II: Guide pour la production des QRTD'EverandReporting pilier 3 de solvabilité II: Guide pour la production des QRTPas encore d'évaluation
- Tremblement: Dither : bruit visuel dans la vision par ordinateurD'EverandTremblement: Dither : bruit visuel dans la vision par ordinateurPas encore d'évaluation
- Surdité, acouphènes et troubles de l'audition - Maladies et traitementsD'EverandSurdité, acouphènes et troubles de l'audition - Maladies et traitementsPas encore d'évaluation
- Filtre adaptatif: Améliorer la vision par ordinateur grâce au filtrage adaptatifD'EverandFiltre adaptatif: Améliorer la vision par ordinateur grâce au filtrage adaptatifPas encore d'évaluation
- Robot d'inspection automatisé à rayons X: Améliorer le contrôle qualité grâce à la vision par ordinateurD'EverandRobot d'inspection automatisé à rayons X: Améliorer le contrôle qualité grâce à la vision par ordinateurPas encore d'évaluation
- Anti crénelage: Améliorer la clarté visuelle dans la vision par ordinateurD'EverandAnti crénelage: Améliorer la clarté visuelle dans la vision par ordinateurPas encore d'évaluation
- Cours Electronique Analogique CH 2 AODocument31 pagesCours Electronique Analogique CH 2 AOchouanaPas encore d'évaluation
- Visual Basic 2005 - Codes Prets À L'emploiDocument449 pagesVisual Basic 2005 - Codes Prets À L'emploisirGeekoPas encore d'évaluation
- Cours Hyperfréquences (Paramètres S - Antennes)Document230 pagesCours Hyperfréquences (Paramètres S - Antennes)chouana78% (9)
- Les Antennes PDFDocument52 pagesLes Antennes PDFhocine100% (1)
- A) Modulation PAM: Les Signaux Du Scope 1Document16 pagesA) Modulation PAM: Les Signaux Du Scope 1Maria MEKLIPas encore d'évaluation
- Chapitre-II Convertisseurs A N Et N A Slides ModifiéDocument45 pagesChapitre-II Convertisseurs A N Et N A Slides ModifiéGOUMMAR ABDERRAHIMPas encore d'évaluation
- TP Impulsion 01Document15 pagesTP Impulsion 01CarlPas encore d'évaluation
- IndexDocument4 pagesIndexKadri MongiPas encore d'évaluation
- QCM EchantillonnageDocument9 pagesQCM EchantillonnageMounir OussamaPas encore d'évaluation
- 06 SegmentationDocument62 pages06 SegmentationMohamed BakoukPas encore d'évaluation
- Détection D'un Signal Noyé Dans Le BruitDocument6 pagesDétection D'un Signal Noyé Dans Le BruitEL MESSAOUDI MariemPas encore d'évaluation
- La Reaction Negative Ou Contre-Reaction (CHRETIEN-RP135 1959 4p)Document4 pagesLa Reaction Negative Ou Contre-Reaction (CHRETIEN-RP135 1959 4p)Christian FassierPas encore d'évaluation
- TP MatlabDocument13 pagesTP Matlablamine fayPas encore d'évaluation
- TPTelecom EOAADocument22 pagesTPTelecom EOAAAli KHALFAPas encore d'évaluation
- Algotd2 1corDocument3 pagesAlgotd2 1cordiattaaida48Pas encore d'évaluation
- Microinter - 2018 - Licence TelecommunicationsDocument3 pagesMicrointer - 2018 - Licence Telecommunicationssahnoune aliPas encore d'évaluation
- Programme ComNumDocument4 pagesProgramme ComNumHamid BOUASSAMPas encore d'évaluation
- Résumé Elec BacDocument29 pagesRésumé Elec BacFethi BenmassoudePas encore d'évaluation
- Mel QuestDocument5 pagesMel QuestMerouane SendidPas encore d'évaluation
- Peavey Bandit 112Document16 pagesPeavey Bandit 112WilliamAgoNPas encore d'évaluation
- Chap 2 Principe de FonctionnementDocument10 pagesChap 2 Principe de FonctionnementtiinaPas encore d'évaluation
- Filtres Actifs: École Nationales D'ingénieurs de Monastir Département Génie ÉlectriqueDocument13 pagesFiltres Actifs: École Nationales D'ingénieurs de Monastir Département Génie ÉlectriqueHa Zem100% (1)
- Cours - ElectreoniqueDocument5 pagesCours - ElectreoniqueJules Anicet Windngoudi OUEDRAOGOPas encore d'évaluation
- Série D'exercices - Physique - Filtre Passe Bas Passif - Bac Informatique (2018-2019) MR Daghsni SahbiDocument4 pagesSérie D'exercices - Physique - Filtre Passe Bas Passif - Bac Informatique (2018-2019) MR Daghsni Sahbiamina sayah67% (3)
- 7-Mic4220 Rii ProfDocument50 pages7-Mic4220 Rii Proffsd vxxsPas encore d'évaluation
- Codage TP1Document9 pagesCodage TP1MED ElPas encore d'évaluation
- 2140 2 Sujet Bts Se U42 2012 PDFDocument15 pages2140 2 Sujet Bts Se U42 2012 PDFBervely WillPas encore d'évaluation
- Echantillonnage Et Quantification - Chap - 3Document41 pagesEchantillonnage Et Quantification - Chap - 3Oumayma Moussa ou mrahPas encore d'évaluation
- Rapport FinalDocument14 pagesRapport FinalalinPas encore d'évaluation
- Traitementdimage 18 19 Rattr+Sol Tf.Document2 pagesTraitementdimage 18 19 Rattr+Sol Tf.Sawat SiwarPas encore d'évaluation
- Son - Console de Mixage NumeriquesDocument5 pagesSon - Console de Mixage NumeriquesLes ATES0% (1)
- Chapitre I 2018-2019Document15 pagesChapitre I 2018-2019Oussama LamhiliPas encore d'évaluation
- AutomatismeDocument32 pagesAutomatismeYass561Pas encore d'évaluation
- Cours LogiqueDocument11 pagesCours LogiqueMohamed Anouar ChakerPas encore d'évaluation