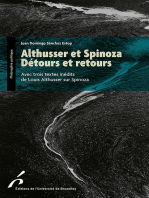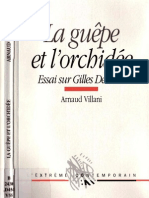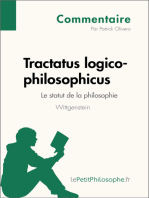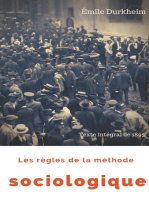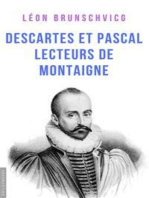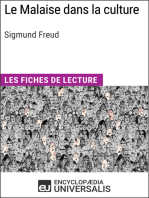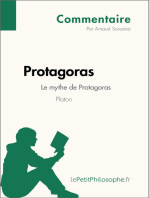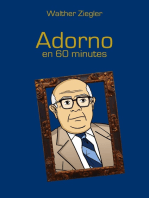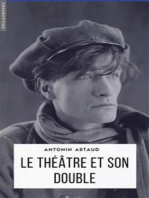Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
38456-Le Vocabulaire de Foucault
38456-Le Vocabulaire de Foucault
Transféré par
outronom0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues71 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues71 pages38456-Le Vocabulaire de Foucault
38456-Le Vocabulaire de Foucault
Transféré par
outronomDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 71
Vocabulaire de ...
Collection dirige par Jean-Pierre Zarader
Le vocabulaire de
Foucault
Judith Revel
Ancienne lve de l'ENS
Agrge de philosophie
Charge de cours l'universit de Rome-I
Dans la mme collection
Le vocabulaire de ...
Aristote, par P. Pellegrin
Bachelard, par J.-Cl. Pariente
Bouddhisme, par S. Arguillre
Bentham, par J.-P. Clro et Ch. Laval
Berkeley, par Ph. Hamou
Comte, par J. Grange
Derrida, par Ch. Ramond
Descartes, par F. de Buzon
et D. Kambouchner
Diderot, par A. Ibrahim
L'cole de Francfort, par Y. Cusset
et S. Haber
picure, par J.-F. Balaud
Foucault, par J. Revel
Frege, par A. Benmakhlouf
Freud, par P.-L. Assoun
Goodman, par P.-A. Huglo
Hegel, par B. Bourgeois
Heidegger, par J.-M. Vayss
Hume, par Ph. SaHel
Husserl, par J. English
Kant, par J.-M. Vaysse
Kierkegaard, par H. Politis
Lacan, par J.-P Clro
Leibniz, par M. de Gaudemar
Lvinas, par R. Calin et P.-D. Sebbah
Lvi-Strauss, par P Maniglier
Locke, par M. Parmentier
Machiavel, par Th. Mnissier
Maine de Biran, par P Montebello
ISBN 2-7298-1088-9
Matre Eckhart, par G. Jarczyk
et P.-J. Labarrire
Malebranche, par Ph. Desoche
Malraux, par J.-P Zarader
Marx, par E. Renault
Merleau-Ponty, par P Dupond
Montesquieu, par C. Spector
Nietzsche, par P. Wotling
Pascal, par P. Magnard
Platon, par L. Brisson et J.-F. Pradeau
Prsocratiques, par J.-F. Balaud
Quine, par J. G. Rossi
Rousseau, par A. Charrak
Russell, par A. Benmakhlouf
Saint Augustin, par Ch. Nadeau
Saint Thomas d'Aquin, par M. Nod-
Langlois
Sartre, par Ph. Cabestan et A. Tomes
Sceptiques, par E. Naya
Schelling, par P. David
Schopenhauer, par A. Roger
Spinoza, par Ch. Ramond
Stociens, par V Laurand
Suarez, par J.-P. Coujou
Tocqueville, par A. Amiel
Vico, par P Girard
Voltaire, par G. Waterlot
Wittgenstein. par Ch. Chauvir
et J. Sackur
Ellipses dition Marketing S.A . 2002 - www.editions-ellipses.com
32. rue Bargue 75740 Paris cedex 15
Le Code de la proprit intellectuelle n'autorisant, aux tennes de l'article L.122-5.2 et 3a),
d'une part, que les Ct copies ou reproductions strictement r..'ierves rusage priv du copiste et
non destines une uti1isatioll collective , et d'autre part, que les analyses et les courtes
citations dans un hut d'exemple el d'illustration, toute reprsentation ou reproduction
intgrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause est illicite (Art. L.122-4).
Celte reprsentation ou reproduction. par quelque procd que ce soit constituerait une
cOnlrefaon sanctionne par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la proprit
intellectuelle.
L'uvre de Michel Foucault est complexe on en a souvent soulign
la grande varit des champs d'enqute, l'tonnante criture baroque, les
emprunts d'autres disciplines, les tournants et les retournements, les
changements de terminologie, la vocation tout tour philosophique et
journalistique - bref, rien qui puisse ressembler ce que la tradition
nous a habitu concevoir comme un systme philosophique. Le
vocabulaire de Foucault s'inscrit dans cette mme diffrence, puisqu'il
prsente tout la fois la reprise de concepts philosophiques hrits
d'autres penses - et parfois largement dtourns de leur sens
initial-, la cration de concepts indits et l'lvation la dignit
philosophique de termes emprunts au langage commun ; par ailleurs,
c'est un vocabulaire qui merge trs souvent partir de pratiques et qui
se propose son tour comme gnrateur de pratiques parce qu'un
outillage conceptuel, c'est la lettre, aimait rappeler Foucault, une
bote outils . Enfin, avant d'tre fix dfinitivement dans les livres,
le vocabulaire se forge et se modle dans le laboratoire de l'uvre
l'norme corpus de textes pars repris il y a quelques annes sous le titre
de Dits et crits fournit de ce point de vue un aperu formidable du
travail de production de concepts qu'implique l'exercice de la pense;
c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on trouvera dans ce
volume des rfrences aux textes des Dits et crits et non pas aux
ouvrages de Foucault. Il faut galement souligner que ce laboratoire de
la pense n'est pas seulement le lieu o se crent les concepts mais bien
souvent aussi le lieu o, dans un mouvement de retournement qui est
toujours prsent chez Foucault, ils sont dans un second temps passs au
crible de la critique interne les termes sont donc produits, fixs puis
rexamins et abandonns, modifis ou largis dans un mouvement
continu de reprise et de dplacement.
3
Le projet d'un vocabulaire de Foucault se devait de rendre
compte de tout cela la fois. Tche ardue, certes, puisqu'il ne s'agissait
en aucun cas de chercher immobiliser ce mouvement, mais qu'en
mme temps il fallait chercher rendre intelligible la cohrence
fondamentale de la rflexion foucaldienne. Nous avons donc d oprer
des choix - souvent difficiles - afin de rendre visibles les passages
essentiels de cette problmatisation continue; et dans la mesure du
possible, nous avons tent de tisser systmatiquement, travers un jeu
de renvois, la trame partir de laquelle le parcours philosophique de
Foucault pouvait tre rendu intelligible dans la complexit de ses
ramifications et de ses retournements. la fin de sa vie, Foucault aimait
parler de problmatisation et n'entendait pas par l la re-
prsentation d'un objet prexistant ni la cration par le discours d'un
objet qui n'existe pas, mais l'ensemble des pratiques discursives ou
non-discursives qui fait entrer quelque chose dans le jeu du vrai et du
faux et le constitue comme objet pour la pense (que ce soit sous la
forme de la rflexion morale, de la connaissance scientifique, de
l'analyse politique, etc.) . Il dfinissait donc ainsi un exercice critique
de la pense s'opposant l'ide d'une recherche mthodique de la
solution , parce que la tche de la philosophie n'est pas de rsoudre
- y compris en substituant une solution une autre - mais de
problmatiser , non pas de rformer mais d'instaurer une distance
critique, de faire jouer la dprise . Le plus grand hommage que nous
puissions aujourd'hui rendre Foucault, c'est prcisment de restituer
sa pense sa dimension problmatique. Ce vocabulaire se veut donc
moins un simple ensemble de termes numrs selon l'ordre
alphabtique que la tentative de reconstituer la diversit de ces
problmatisations - successives ou superposes - qui font
l'extraordinaire richesse des analyses foucaldiennes.
4
Actualit
* La notion d'actualit apparat de deux manires diffrentes chez
Foucault. La premire consiste souligner comment un vnement
- par exemple le partage entre la folie et la non-folie - non
seulement engendre toute une srie de discours, de pratiques, de
comportements et d'institutions, mais se prolonge jusqu' nous.
Tous ces vnements, il me semble que nous les rptons. Nous les
rptons dans notre actualit, et j'essaie de saisir quel est
l'vnement sous le signe duquel nous sommes ns, et quel est
l'vnement qui continue encore nous traverser! . Le passage de
l'archologie la gnalogie sera pour Foucault l'occasion
d'accentuer encore cette dimension de prolongement de l'histoire
dans le prsent. La seconde est en revanche strictement lie un
commentaire que Foucault, en 1984, fait du texte de Kant Qu'est-
ce que les Lumires
2
. L'analyse insiste alors sur le fait que poser
philosophiquement la question de sa propre actualit, ce que fait
Kant pour la premire fois, marque en ralit le passage la
modernit.
** Foucault dveloppe deux lignes de discours partir de Kant. Pour
Kant, poser la question de l'appartenance sa propre actualit, c'est
- commente Foucault - interroger celle-ci comme un vnement
dont on aurait dire le sens et la singularit, et poser la question de
l'appartenance un nous }} correspondant cette actualit, c'est--
dire formuler le problme de la communaut dont nous faisons
partie. Mais il faut galement comprendre que si nous reprenons
aujourd'hui l'ide kantienne d'une ontologie critique du prsent,
c'est non seulement pour comprendre ce qui fonde l'espace de notre
Sexualit et pouvoir ", confrence l'universit de Tokyo (1978), repris in Dits et crits,
[dornavant cit DE], Paris, Gallimard, 1994, vol. 3, texte n 233.
2. Voir ce sujet What is Enlightenment ? , in P. Rabinow (d.), The Foucault Reader,
New York, Pantheon Books, 1984, repris in DE, vol. 4, texte n 339; et Qu'est-ce que
les Lumires", in Magazine Littraire, nO 207, mai 1984, repris in DE, vol. 4, texte
n 351.
5
discours mais pour en dessiner les limites. De la mme manire que
Kant cherche une diffrence quelle diffrence aujourd'hui
introduit-il par rapport hier
i
? , nous devons notre tour chercher
dgager de la contingence historique qui nous fait tre ce que nous
sommes des possibilits de rupture et de changement. Poser la
question de l'actualit revient donc dfinir le projet d'une critique
pratique dans la forme du franchissement possible
2
.
*** Actualit et prsent sont au dpart synonymes.
Cependant, une diffrence va se creuser de plus en plus entre ce qui,
d'une part, nous prcde mais continue malgr tout nous traverser
et ce qui, de l'autre, survient au contraire comme une rupture de la
grille pistmique laquelle nous appartenons et de la priodisation
qu'elle engendre. Cette irruption du nouveau , ce que Foucault
comme Deleuze appellent galement un vnement , devient alors
ce qui caractrise l'actualit. Le prsent, dfini par sa continuit
historique, n'est au contraire bris par aucun vnement il ne peut
que basculer et se rompre en donnant lieu l'installation d'un
nouveau prsent. C'est ainsi que Foucault trouve enfin le moyen
d'intgrer les ruptures pistmiques dont il avait pourtant eu tant de
mal rendre compte, en particulier au moment de la publication des
Mots et les Choses.
Archologie
* Le terme d' archologie apparat trois fois dans des titres
d'ouvrages de Foucault - Naissance de la clinique. Une
archologie du regard mdical (1963), Les Mots et les Choses. Une
archologie des sciences humaines (1966) et L'Archologie du
Savoir (1969) - et caractrise jusqu'au dbut des annes 70 la
mthode de recherche du philosophe. Une archologie n'est pas une
histoire dans la mesure o, s'il s'agit bien de reconstituer un
champ historique, Foucault fait en ralit jouer diffrentes
dimensions (philosophique, conomique, scientifique, politique etc.)
1. What is Enlightenment ? , op. cit.
2. Ibid.
6
afin d'obtenir les conditions d'mergence des discours de savoir en
gnral une poque donne. Au lieu d'tudier l'histoire des ides
dans leur volution, il se concentre par consquent sur des
dcoupages historiques prcis - en particulier l'ge classique et le
dbut du XIxe sicle -, afin de dcrire non seulement la manire
dont les diffrents savoirs locaux se dterminent partir de la
constitution de nouveaux objets qui ont merg un certain moment,
mais comment ils se rpondent entre eux et dessinent de manire
horizontale une configuration pistmique cohrente.
** Si le terme d'archologie a sans doute nourri l'identification de
Foucault au courant structuraliste - dans la mesure o il semblait
mettre au jour une vritable structure pistmique dont les diffrents
savoirs n'auraient t que des variantes -, son interprtation
foucaldienne est en ralit bien autre. Comme le rappelle le sous-titre
des Mots et les Choses, il ne s'agit pas de faire ['archologie mais
une archologie des sciences humaines plus qu'une description
paradigmatique gnrale, il s'agit d'une coupe horizontale des
mcanismes articulant diffrents vnements discursifs - les savoirs
locaux - au pouvoir. Cette articulation est bien entendu entirement
historique elle possde une date de naissance - et tout l'enjeu
consiste envisager galement la possibilit de sa disparition,
comme la limite de la mer un visage de sable' .
*** Dans archologie , on retrouve la fois l'ide de l'arch,
c'est--dire du commencement, du principe, de l'mergence des
objets de connaissance, et l'ide de l'archive -l'enregistrement de
ces objets. Mais de la mme manire que l'archive n'est pas la trace
morte du pass, l'archologie vise en ralit le prsent Si je fais
cela, c'est dans le but de savoir ce que nous sommes aujourd'hui2 .
Poser la question de l'historicit des objets du savoir, c'est, de fait,
problmatiser notre propre appartenance la fois un rgime de
discursivit donn et une configuration du pouvoir. L'abandon du
1. Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966 ; red. coll. Tel, p. 398.
2. Dialogue sur le pouvoir , in S. Wade. Chez Foucault, Los Angeles, Circabook, 1978,
repris in DE, vol. 3, texte nO 221.
terme archologie au profit du concept de gnalogie , au tout
dbut des annes 70, insistera sur la ncessit de redoubler la lecture
horizontale des discursivits par une analyse verticale - oriente
vers le prsent - des dterminations historiques de notre propre
rgime de discours.
Archive
8
* l'appellerai archive non pas la totalit des textes qui ont t
conservs par une civilisation, ni J'ensemble des traces qu'on a pu
sauver de son dsastre, mais le jeu des rgles qui dterminent dans
une culture l'apparition et la disparition des noncs, leur rmanence
et leur effacement, leur existence paradoxale d'vnements et de
choses. Analyser les faits de discours dans l'lment gnral de
l'archive, c'est les considrer non point comme documents (d'une
signification cache, ou d'une rgle de construction), mais comme
monuments; c'est - en dehors de toute mtaphore gologique, sans
aucune assignation d'origine, sans le moindre geste vers le
commencement d'une arch - faire ce que l'on pourrait appeler,
selon les droits ludiques de l'tymologie, quelque chose comme une
archologie' .
** De J'Histoire de la Folie L'Archologie du savoir, l'archive
reprsente donc l'ensemble des discours effectivement prononcs
une poque donne et qui continuent exister travers l'histoire.
Faire l'archologie de cette masse documentaire, c'est chercher en
comprendre les rgles, les pratiques, les conditions et le
fonctionnement. Pour Foucault, cela implique avant tout un travail de
recollection de l'archive gnrale de l'poque choisie, c'est --dire de
toutes les traces discursives susceptibles de permettre la
reconstitution de l'ensemble des rgles qui, un moment donn,
dfinissent la fois les limites et les formes de la dicibilit, de la
conservation, de la mmoire, de la ractivation et de l'appropriation.
L'archive permet donc Foucault de se distinguer en mme temps
Sur l'archologie des sciences. Rponse au Cercle d'pistmologie , Cahiers pour
l'analyse, n 9, t 1968, repris in DE, vol. 1, texte nO 59.
des structuralistes - puisqu'il s'agit de travailler sur des discours
considrs comme vnements et non pas sur le systme de la langue
en gnral-, et des historiens - puisque si ces vnements ne font
pas, la lettre, partie de notre prsent, ils subsistent et exercent,
dans cette subsistance mme l'intrieur de l'histoire, un certain
nombre de fonctions manifestes ou secrtes . Enfin, si l'archive est
la chair de l'archologie, l'ide de constituer une archive gnrale,
c'est--dire d'enfermer dans un lieu toutes les traces produites, est
son tour archologiquement datable le muse et la bibliothque sont
en effet des phnomnes propres la culture occidentale du
XIxe sicle.
*** partir du dbut des annes 70, il semble que l'archive change
de statut chez Foucault. la faveur d'un travail direct avec les
historiens (pour Pierre Rivire, en 1973 ; pour L'Impossible prison,
sous la direction de Michelle Perrot, en 1978 ; ou avec Arlette Farge,
pour Le dsordre des familles, en 1982), celui-ci revendique alors de
plus en plus la dimension subjective de son travail (<< Ce n'est point
un livre d'histoire. Le choix qu'on y trouvera n'a pas eu de rgle plus
importante que mon got, mon plaisir, une motion 1 ), et se livre
une lecture souvent trs littraire de ce qu'il appelle parfois
d'tranges pomes . L'archive vaut dsormais davantage comme
trace d'existence que comme production discursive sans doute
parce qu'en ralit Foucault rintroduit au mme moment la notion
de subjectivit dans sa rflexion. Le paradoxe d'une utilisation non-
historienne des sources historiques lui a en ralit souvent t
ouvertement reproch.
Aufklarung
* Le thme de l'Aufkliirung apparat chez Foucault de manire de
plus en plus insistante partir de 1978 il renvoie toujours au texte
de Kant, Was ist Aufkliirung (1784). L'enjeu en est complexe si
d'emble Foucault assigne la question kantienne le privilge
La vie des hommes infmes , Les Cahiers du chemin, n 29, 1977, repris in DE, vol. 3,
te1{te n 198.
9
d'avoir pos pour la premire fois le problme philosophique (ou,
comme le dit Foucault, de journalisme philosophique) de
l'actualit, ce qui intresse le philosophe semble tout d'abord le
destin de cette question en France, en Allemagne, et dans les pays
anglo-saxons. Ce n'est que dans un second temps que Foucault
transformera la rfrence au texte kantien en une dfinition de cette
ontologie critique du prsent dont il fera son propre programme
de recherche.
** Foucault dveloppe en ralit trois niveaux d'analyse diffrents.
Le premier cherche reconstituer de manire archologique le
moment o l'Occident a rendu sa raison la fois autonome et
souveraine en ce sens, la rfrence aux Lumires s'insre dans une
description qui la prcde (la rforme luthrienne, la rvolution
copernicienne, la mathmatisation galilenne de la nature, la pense
cartsienne, la physique newtonienne etc.) et dont elle reprsente le
moment de plein accomplissement mais cette description
archologique est toujours gnalogiquement tendue vers un prsent
dont nous participons encore il faut donc comprendre ce que peut
tre son bilan actuel, quel rapport il faut tablir ce geste
fondateur' . Le second tente de comprendre l'volution de la
postrit de l' Aufkliirung dans diffrents pays et la manire dont elle
a t investie dans des champs divers en particulier en Allemagne,
dans une rflexion historique et politique sur la socit (<< des
hgliens l'cole de Francfort et LuUcs, Feuerbach, Marx,
Nietzsche et Max Weber
2
) en France, travers l'histoire des
sciences et la problmatisation de la diffrence savoir/croyance,
connaissancelreligion, scientifique/prscientifique (Comte et le
positivisme, Duhem, Poincar, Koyr, Bachelard, Canguilhem).
Enfin, le troisime pose la question de notre propre prsent: Kant
ne cherche pas comprendre le prsent partir d'une totalit ou d'un
Introduction l'dition amricaine du Normal et le Pathologique, de G. Canguilhem
On the Normal and the Pathological, Boston, D. Reidel, 1978, repris in DE, vol. 3, texte
nO 219.
2. Ibid.
10
achvement futur. Il cherche une diffrence quelle diffrence
aujourd'hui introduit-il par rapport hier
l
? C'est cette recherche
de la diffrence qui caractrise non seulement l'attitude de la
modernit mais l'thos qui nous est propre.
*** Le commentaire de Kant a t au centre d'un commencement de
dbat avec Habermas, malheureusement interrompu par la mort de
Foucault. Les lectures que donnent les deux philosophes de la
question des Lumires sont diamtralement opposes, en particulier
parce que Habermas cherche en ralit dfinir partir de la
rfrence kantienne les conditions requises pour une communaut
linguistique idale, c'est --dire l'unit de la raison cri tique et du
projet social. Chez Foucault, le problme de la communaut n'est pas
la condition de possibilit d'un nouvel universalisme mais la
consquence directe de l'ontologie du prsent pour le philosophe,
poser la question de l'appartenance ce prsent, ce ne sera plus du
tout la question de son appartenance une doctrine ou une
tradition ce ne sera plus simplement la question de son
appartenance une communaut humaine en gnral, mais celle de
son appartenance un certain "nous", un nous qui se rapporte un
ensemble culturel caractristique de sa propre actualit
2
.
Auteur
* En 1969, Foucault tient une confrence sur la notion d'auteur qui
s'ouvre par ces mots "Qu'importe qui parle?" En cette
indiffrence s'affirme le principe thique, le plus fondamental peut-
tre, de l'criture contemporaine
3
. Cette critique radicale de l'ide
d'auteur - et plus gnralement du couple auteur/uvre - vaut la
fois comme diagnostic sur la littrature (en particulier dans le triple
sillage de Blanchot, du nouveau roman et de la nouvelle critique), et
comme mthode foucaldienne de lecture archologique en effet, si
1. What is Enlightenment ? , op. cit.
2. Qu'est-ce que les Lumires , op. cit.
3. Qu'est-ce qu'un auteur? , Bulletin de la socit franaise de philosophie, juin-
septembre 1969, repris in DE, vol. l, texte nO 69.
11
l'on retrouve souvent la thorisation de ce lieu vide chez certains
crivains que Foucault commente l'poque, il est galement vrai
que l'analyse laquelle se livre le philosophe dans Les Mots et les
Choses cherche son tour appliquer l'archive, c'est--dire
l'histoire, le principe d'une lecture de masses d'noncs ou
nappes discursives qui ne seraient pas scandes par les units
habituelles du livre, de l'uvre et de l'auteur
l
. De ce point de vue,
le dbut de L'ordre du discours ne fait que poursuivre dans la
description d'un flux de parole qui serait la fois historiquement
dtermin et non-individualis, et qui dicterait les conditions de
parole de Foucault lui-mme J'aurais aim m'apercevoir qu'au
moment de parler, une voix sans nom me prcdait depuis
longtemps2 .
** Du point de vue de la mthode, Foucault est en apparence assez
proche de ce que fait Barthes la mme poque, puisque l'analyse
structurale du rcit ne se rfre pas la psychologie, la biographie
personnelle ou aux caractristiques subjectives de l'auteur mais aux
structures internes du texte et au jeu de leur articulation. C'est
probablement partir du constat de ce voisinage mthodologique
(qui le rapproche galement d'Althusser, de Lvi-Strauss ou de
Dumzil) qu'on a gnralement associ Foucault au courant
structuraliste. La recherche de structures logiques est cependant
teinte chez lui d'une veine blanchotienne particulire (<< l'uvre
comporte toujours pour ainsi dire la mort de l'auteur lui-mme. On
n'crit que pour en mme temps disparatre
3
) qui, au-del du
simple reprage de la caducit historique d'une catgorie que l'on
avait crue jusque-l incontournable, pousse Foucault vers une
analyse des rapports qu'entretiennent le langage et la mort. la
description de l'effacement d'une notion dont il dcrit
historiquement la constitution et les mcanismes puis la dissolution
1. Qu'est-ce qu'un auteur? , op. cit.
2. L'Ordre du Discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 7.
3. Interview avec Michel Foucault , Bonniers Litteriire Magasin, Stockholm, nO 3, mars
1968, repris in DE, vol. l, texte nO 54.
12
(ce en quoi la notion d'auteur reoit peu prs le mme traitement
que celle de sujet), Foucault ajoute donc la fois l'identification
de son propre statut de parole et la problmatisation d'une exprience
de l'criture conue comme passage la limite.
*** Cette influence blanchotienne l'amnera tout au long des annes
60, et en marge des grands livres, s'attarder sur un certain nombre
de cas littraires possdant tous une parent avec la folie (et on
est alors bien loin des propos de l'Histoire de la Folie) ou avec la
mort. Foucault commentera donc Hlderlin et Nerval, Roussel et
Artaud, Flaubert et Klossowski, et mme certains crivains proches
de Tel Quel, en soulignant leur valeur exemplaire Le langage a
alors pris sa stature souveraine; il surgit comme venu d'ailleurs, de
l o personne ne parle; mais il n'est uvre que si, remontant son
propre discours, il parle dans la direction de cette absence 1
B iopol itique
* Le terme biopolitique dsigne la manire dont le pouvoir tend
se transformer, entre la fin du XVIIIe sicle et le dbut du
XIxe sicle, afin de gouverner non seulement les individus travers
un certain nombre de procds disciplinaires, mais l'ensemble des
vivants constitus en population la biopolitique - travers des bio-
pouvoirs locaux - s'occupera donc de la gestion de la sant, de
l'hygine, de l'alimentation, de la sexualit, de la natalit etc., dans
la mesure o ils sont devenus des enjeux politiques.
** La notion de biopolitique implique une analyse historique du
cadre de rationalit politique dans lequel elle apparat, c'est--dire la
naissance du libralisme. Par libralisme, il faut entendre un exercice
du gouvernement qui non seulement tend maximiser ses effets tout
en rduisant ses cots, sur le modle de la production industrielle,
mais affirme qu'on risque toujours de trop gouverner. Alors que la
raison d'tat avait cherch dvelopper son pouvoir travers la
croissance de l'tat, la rflexion librale ne part pas de l'existence
Le "non" du pre , Critique nO 178, mars 1962, repris in DE, vol. 1, texte nO 8.
13
de l'tat, trouvant dans le gouvernement le moyen d'atteindre cette
fin qu'il serait pour lui-mme; mais de la socit qui se trouve tre
dans un rapport complexe d'extriorit et d'intriorit vis--vis de
l'tat
l
. Ce nouveau type de gouvernementalit, qui n'est rductible
ni une analyse juridique, ni une lecture conomique (bien que
l'une et l'autre y soient lies), se prsente par consquent comme une
technologie du pouvoir qui se donne un nouvel objet la
population . La population est un ensemble d'tres vivants et
coexistants qui prsentent des traits biologiques et pathologiques
particuliers, et dont la vie-mme est susceptible d'tre contrle afin
d'assurer une meilleure gestion de la force de travail La
dcouverte de la population est, en mme temps que la dcouverte de
l'individu et du corps dressable, l'autre grand noyau technologique
autour duquel les procds politiques de l'Occident se sont
transforms. On a invent ce moment-l ce que j'appellerai, par
opposition l'anatomo-politique que j'ai mentionne l'instant, la
bio-politique
2
. Alors que la discipline se donnait comme anatomo-
politique des corps et s'appliquait essentiellement aux individus, la
biopolitique reprsente donc cette grande mdecine sociale qui
s'applique la population afin d'en gouverner la vie la vie fait
dsormais partie du champ du pouvoir.
*** La notion de biopolitique soulve deux problmes. Le premier
est li une contradiction que l'on trouve chez Foucault lui-mme
dans les premiers textes o apparat le terme, il semble tre li ce
que les Allemands ont appel au XVIIIe sicle la Polizei-
wissenschaft, c'est--dire le maintien de l'ordre et de la discipline
travers la croissance de l'tat. Mais, par la suite, la biopolitique
semble au contraire signaler le moment de dpassement de la
traditionnelle dichotomie tat/socit, au profit d'une conomie
Naissance de la biopolitique , Annuaire du Collge de France, 79" anne, Chaire
d'histoire des systmes de pense, anne /978-1979, 1979, repris in DE, vol. 3, texte
na 818.
2. Les mailles du pouvoir , confrence l'universit de Bahia, 1976, Brbarie, na 4 et
na 5, 1981, repris in DE, vol. 4, texte na 297.
14
politique de la vie en gnral. C'est de cette seconde formulation que
nat l'autre problme s'agit-il de penser la biopolitique comme un
ensemble de bio-pouvoirs ou bien, dans la mesure o dire que le
pouvoir a investi la vie signifie galement que la vie est un pouvoir,
peut-on localiser dans la vie elle-mme - c'est--dire bien entendu
dans le travail et dans le langage, mais aussi dans les corps, dans les
affects, dans les dsirs et dans la sexualit - le lieu d'mergence
d'un contre-pouvoir, le lieu d'une production de subjectivit qui se
donnerait comme moment de dsassujettissement ? Dans ce cas, le
thme de la biopolitique serait fondamental pour la reformulation
thique du rapport au politique qui caractrise les dernires analyses
de Foucault; plus encore la biopolitique reprsenterait exactement
le moment du passage du politique l'thique. Comme l'admet
Foucault en 1982, l'analyse, l'laboration, la remise en question
des relations de pouvoir, et de l'''agonisme'' entre relations de
pouvoir et intransitivit de la libert, sont une tche politique
incessante [ ... ] c'est mme cela, la tche politique inhrente toute
existence sociale
l
.
Contrle
* Le terme de contrle apparat dans le vocabulaire de Foucault
de manire de plus en plus frquente partir de 1971-72. Il dsigne
dans un premier temps une srie de mcanismes de surveillance qui
apparaissent entre le XVIIIe et le XIxe sicle et qui ont pour fonction
non pas tant de punir la dviance que de la corriger et surtout de la
prvenir Toute la pnalit du XIxe sicle devient un contrle, non
pas tant sur ce que font les individus - est-ce conforme ou non la
loi? - mais sur ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils sont capables de
faire, de ce qu'ils sont sujets faire, de ce qu'ils sont dans
l'imminence de faire2 . Cette extension du contrle social
Le sujet et le pouvoir , in H. Dreyfus et P Rabinow, Michel Foucault Beyond
Structuralism and Hermeneutics, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, repris
in DE, vol. 4, texte nO 306.
2. La vrit et les formes juridiques ", confrences l'universit de Rio de Janeiro, mai
1973, repris in DE, vol. 2, texte nO 139.
15
16
correspond une nouvelle distribution spatiale et sociale de la
richesse industrielle et agricole! c'est la formation de la socit
capitaliste, c'est--dire la ncessit de contrler les flux et la
rpartition spatiale de la main d'uvre en tenant compte des
ncessits de la production et du march du travail, qui rend
ncessaire une vritable orthopdie sociale dont le dveloppement de
la police et la surveillance des populations sont les instruments
essentiels.
** Le contrle social passe non seulement par la justice mais une
srie d'autres pouvoirs latraux (les institutions psychologiques,
psychiatriques, criminologiques, mdicales, pdagogiques la
gestion des corps et l'institution d'une politique de la sant; les
mcanismes d'assistance, les associations philanthropiques et les
patronages etc.) qui s'articulent en deux temps il s'agit, d'une part,
de constituer des populations dans lesquelles insrer les individus
- le contrle est essentiellement une conomie du pouvoir qui gre
la socit en fonction de modles normatifs globaux intgrs dans un
appareil d'tat centralis -; mais de l'autre, il s'agit galement de
rendre le pouvoir capillaire, c'est--dire de mettre en place un
systme d'individualisation qui s'attache modeler chaque individu
et en grer l'existence. Ce double aspect du contrle social
(gouvernement des populations/gouvernement par
l'individualisation) a t particulirement tudi par Foucault dans le
cas du fonctionnement des institutions de sant et du discours
mdical au XIxe sicle, mais aussi dans l'analyse des rapports entre
la sexualit et la rpression dans le premier volume de l' Histoire de
la Sexualit.
*** Toute l'ambigit du terme contrle tient au fait qu' partir
du dbut des annes 80, Foucault laisse sous-entendre qu'il dfinit
par l un mcanisme d'application du pouvoir diffrent de la
discipline. C'est en partie sur ce point que s'effectue le revirement
programmatique de l' Histoire de la Sexualit, entre la publication du
La vrit et les fornles juridiques , op. cit.
premier volume (1976) et celle des deux derniers (1984) Le
contrle du comportement sexuel a une forme tout autre que la forme
disciplinaire 1 . L'intriorisation de la norme, patente dans la gestion
de la sexualit, correspond la fois une pntration extrmement
fine du pouvoir dans les mailles de la vie, et une subjectivation de
celle-ci. La notion de contrle, une fois rendue indpendante des
analyses disciplinaires, conduit alors Foucault la fois vers une
ontologie critique de l'actualit et vers une analyse des modes de
subjectivation qui seront au centre de son travail dans les annes 80.
Corps (investissement politique des)
* Il y a eu, au cours de l'ge classique, toute une dcouverte du
corps comme objet et cible du pouvoir
2
les analyses de Foucault
dans les annes 70 cherchent avant tout comprendre comment on
est pass d'une conception du pouvoir o il s'agissait de traiter le
corps comme une surface d'inscription des supplices et des peines
une autre, qui cherchait au contraire former, corriger et rformer
le corps. Jusqu' la fin du XVIIIe sicle, le contrle social du corps
passe par le chtiment et par l'enfermement avec les princes, le
supplice lgitimait le pouvoir absolu, son "atrocit" se dployait sur
les corps parce que le corps tait l'unique richesse accessible
3
; en
revanche, dans les instances de contrle qui apparaissent ds le dbut
du XI xe sicle, il s'agit davantage de grer la rationalisation et la
rentabilisation du travail industriel par la surveillance du corps de la
force de travail Pour qu'un certain libralisme bourgeois ait t
possible au niveau des institutions, il a fallu, au niveau de ce que
j'appelle les micro-pouvoirs, un investissement beaucoup plus serr
des individus, il a fallu organiser le quadrillage des corps et des
comportements
4
.
1. Interview de Michel Foucault , Krisis, mars 1984, repris in DE, vol. 4, texte n 349.
2. Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 138.
3. La prison vue par un philosophe franais , L'Europeo, n 1515, avril 1975, repris in DE,
vol. 2, texte nO 153.
4. Sur la sellette , Les Nouvelles Littraires, nO 2477, mars 1975, repris in DE, vol. 2, texte
nO 152.
17
** Ce qu'a mis en jeu le grand renouvellement de l'poque, c'est
un problme de corps et de matrialit, c'est une question de
physique nouvelle forme prise par l'appareil de production,
nouveau type de contact entre cet appareil et celui qui le fait
fonctionner nouvelles exigences imposes aux individus comme
forces productives [ ... ] c'est un chapitre de l'histoire des COrpSI .
Sur cette base, Foucault va dvelopper son analyse dans deux
directions la premire correspond une vritable physique du
pouvoir ou, comme la dsignera ailleurs le philosophe, une
anatomopolitique, une orthopdie sociale, c'est--dire une tude des
stratgies et des pratiques par lesquelles le pouvoir modle chaque
individu depuis l'cole jusqu' l'usine; la seconde correspond au
contraire une biopolitique, c'est--dire la gestion politique de la
vie il ne s'agit plus de redresser et de surveiller les corps des
individus, mais de grer des populations en instituant de
vritables programmes d'administration de la sant, de l'hygine etc.
*** Quand Foucault commence travailler sur la sexualit, il prend
cependant conscience de deux choses d'une part, c'est partir d'un
rseau de somato-pouvoir que nat la sexualit comme phnomne
historique et culturel dans lequel nous nous reconnaissons
2
, et non
pas partir d'une pntration morale des consciences il faut donc
en faire l' histoire; de l'autre, l'actualit de la question des rapports
entre le pouvoir et les corps est essentielle va-t-on pouvoir
rcuprer son propre corps? La question est d'autant plus pertinente
que Foucault participe la mme poque aux discussions du
mouvement homosexuel et que c'est cette lutte pour les corps qui
fait que la sexualit est un problme politique
3
. Le corps reprsente
ds lors un enjeu de la rsistance au pouvoir, l'autre versant de cette
----------------
La socit punitive , Annuaire du Collge de France, 1972-1973, repris in DE, vol. 2,
texte nO 131.
2_ Les rapports de pouvoir passent l'intrieur des corps , La Quinzaille Littraire,
n 247, janvier 1977, repris inDE, vol. 3, texte nO 197
3. Sexualit et politique , Combat, nO 9274, avril 1974, repris in DE, vol. 2, texte n 139.
18
biopolitique qui devient le centre des analyses du philosophe la
fin des annes 70.
Dehors
* En 1966, dans un texte consacr Maurice Blanchot', Foucault
dfinit ce qu'est l' exprience du dehors comme la dissociation du
je pense et du je parle le langage doit affronter la disparition
du sujet qui parle et enregistrer son lieu vide comme source de son
propre panchement indfini. Le langage chappe alors au mode
d'tre du discours, c'est--dire la dynastie de la reprsentation, et la
parole littraire se dveloppe partir d'elle-mme, formant un rseau
dont chaque point, distinct des autres, distance mme des plus
voisins, est situ par rapport tous dans un espace qui la fois les
loge et les spare
2
.
** Ce passage au dehors comme disparition du sujet qui parle et,
contemporainement, comme apparition de l'tre mme du langage,
caractrise pour Foucault une pense dont il faudra bien un jour
essayer de dfinir les formes et les catgories fondamentales , et
dont il repre une sorte de lignage dans les marges de la culture
occidentale. De Sade HOlderlin, de Nietzsche Mallarm, d'Artaud
Bataille et Klossowski, il s'agit toujours de dire ce passage au
dehors, c'est --dire la fois l'clatement de l'exprience de
l'intriorit et le dcentrement du langage vers sa propre limite en
ce sens, selon Foucault, Blanchot semble avoir russi dloger du
langage la rflexivit de la conscience et transform la fiction en une
dissolution de la narration faisant valoir l'interstice des images .
Le paradoxe de cette parole sans racine et sans socle, qui se rvle
comme suintement et comme murmure, comme cart et comme
dispersion, c'est qu'elle reprsente une avance vers ce qui n'a
jamais reu de langage -le langage lui-mme, qui n'est ni
rflexion, ni fiction, mais ruissellement infini -, c'est--dire
l'oscillation indfinie entre l'origine et la mort.
1. La pense du dehors , Critique, n 229, 1966, repris in DE, vol. l, texte nO 38.
2. Ibid.
19
*** Le thme du dehors est intressant la fois parce qu'il rend
raison des auteurs dont Foucault s'occupe dans la mme priode
-le lignage du dehors , dont Blanchot serait l'incarnation la plus
clatante - et parce qu'il forme un contrepoint radical ce que le
philosophe s'attache dcrire simultanment dans ses livres. En
effet, quand Foucault souligne le risque de reconduire l'exprience
du dehors la dimension de l'intriorit et la difficult de la doter
d'un langage qui lui soit fidle, il dit la fragilit de ce dehors or
il n'y a point de dehors possible dans une description archologique
des dispositifs discursifs telle qu'elle est prsente dans Les Mots et
les Choses. Ce n'est que bien plus tard que Foucault cessera de
penser le dehors comme un passage la limite ou comme une
pure extriorit, et qu'il lui donnera un lieu au sein mme de l'ordre
du discours l'opposition ne sera alors plus entre le dedans et le
dehors, entre le rgne du sujet et le murmure anonyme, mais entre le
langage objectiv et la parole de rsistance, entre le sujet et la
subjectivit, c'est--dire ce que Deleuze appellera le pli . Le pli
- et le terme est dj trangement utilis par Foucault en 1966-,
c'est la fin de l'opposition dehors/dedans, parce que c'est le dehors
du dedans. Et Foucault de conclure [ ... ] on est toujours
l'intrieur. La marge est un mythe. La parole du dehors est un rve
qu'on ne cesse de reconduire
1
.
Discipline
20
* Modalit d'application du pouvoir qui apparat entre la fin du
XVIIIe et le dbut du XIxe sicle. Le rgime disciplinaire se
caractrise par un certain nombre de techniques de coercition qui
s'exercent selon un quadrillage systmatique du temps, de l'espace et
du mouvement des individus, et investissent particulirement les
attitudes, les gestes, les corps Techniques de l'individualisation
du pouvoir. Comment surveiller quelqu'un, comment contrler sa
conduite, son comportement, ses aptitudes, comment intensifier sa
L'extension sociale de la nonne , Politique Hebdo, n 212, mars 1976, repris in DE,
vol. 3, texte nO 173.
performance, multiplier ses capacits, comment le mettre la place
o il sera plus utile
l
. Le discours de la discipline est tranger la
loi, ou celui de la rgle juridique drive de la souverainet elle
produit un discours sur la rgle naturelle, c'est--dire sur la norme.
** Les procds disciplinaires s'exercent davantage sur les processus
de l'activit plutt que sur ses rsultats et l'assujetissement
constant de ses forces [ ... ] impose un rapport de docilit-utilit
2
.
Les disciplines ne naissent bien entendu pas vraiment au
XVIIIe sicle - on les trouve depuis longtemps dans les couvents,
dans les armes, dans les ateliers -, mais Foucault cherche
comprendre de quelle manire elles deviennent un certain moment
des formules gnrales de domination. Le moment historique des
disciplines, c'est le moment o nat un art du corps humain, qui ne
vise pas seulement la croissance de ses habilets, ni non plus
l'alourdissement de sa sujtion, mais la formation d'un rapport qui
dans le mme mcanisme le rend d'autant plus obissant qu'il est
plus utile, et inversement
3
. Cette anatomie politique investit
alors les collges, les hpitaux, les lieux de la production, et plus
gnralement tout espace clos qui puisse permettre la gestion des
individus dans l'espace, leur rpartition et leur identification. Le
modle d'une gestion disciplinaire parfaite est propos travers la
formulation benthamienne du panopticon , lieu d'enfermement o
les principes de visibilit totale, de dcomposition des masses en
units et de rordonnancement complexe de celles-ci selon une
hirarchie rigoureuse permettent de plier chaque individu une
vritable conomie du pouvoir de nombreuses institutions
disciplinaires - prisons, coles, asiles - possdent encore
aujourd'hui une architecture panoptique, c'est--dire un espace
caractris d'une part par l'enfermement et la rpression des
individus, et de l'autre par un allgement du fonctionnement du
pouvoir.
1. Les mailles du pouvoir , op. cil.
2. SU/veiller el Punir, op. cit, p. 139.
3. Ibid.
21
* ** Le modle disciplinaire a sans doute t en partie construit
partir de l'exprience que Foucault a faite, partir de 1971-72, au
sein du G.LP (Groupe d'Information sur les Prisons). Il n'en reste
pas moins qu'entre la publication de Surveiller et Punir (1975) et les
cours au Collge de France de 1978-79, Foucault commence
travailler un autre modle d'application du pouvoir, le contrle, qui
travaille la fois la description de l'intriorisation de la norme et de
la structure rticulaire des techniques d'assujettissement, la gestion
des populations et aux tecniques de soi. Ce passage d'une lecture
disciplinaire de l'histoire moderne une lecture contemporaine
du contrle social a correspondu, la fin des annes 70, un net
engagement en faveur de ce que Foucault appelait une ontologie de
l' actuali t .
Discours
22
* Le discours dsigne en gnral chez Foucault un ensemble
d'noncs qui peuvent appartenir des champs diffrents mais qui
obissent malgr tout des rgles de fonctionnement communes. Ces
rgles ne sont pas seulement linguistiques ou formelles, mais
reproduisent un certain nombre de partages historiquement
dtermins (par exemple le grand partage raison/draison) 1' ordre
du discours propre une priode particulire possde donc une
fonction normative et rgle et met en uvre des mcanismes
d'organisation du rel travers la production de savoirs, de stratgies
et de pratiques.
** L'intrt de Foucault pour les nappes discursives a t
immdiatement double. D'une part, il s'agissait d'analyser les traces
discursives en cherchant isoler des lois de fonctionnement
indpendantes de la nature et des conditions d'nonciation de celles-
ci, ce qui explique l'intrt de Foucault la mme poque pour la
grammaire, la linguistique et le formalisme il tait original et
important de dire que ce qui tait fait avec le langage - posie,
littrature, philosophie, discours en gnral- obissait un certain
nombre de lois ou de rgularits internes: les lois et les rgularits
du langage. Le caractre linguistique des faits de langage a t une
dcouverte qui a eu de l'importance! ; mais, de l'autre, il s'agissait
de dcrire la transformation des types de discours au XVIIe et au
XVIIIe sicle, c'est--dire d'historiciser les procdures d'identifica-
tion et de classification propres cette priode en ce sens, l' archo-
logie foucaldienne des discours n'est plus une analyse linguistique
mais une interrogation sur les conditions d'mergence de dispositifs
discursifs dont il arrive qu'ils soutiennent des pratiques (comme dans
Histoire de la Folie) ou qu'ils les engendrent (comme dans Les Mots
et les Choses ou dans L'Archologie du Savoir). En ce sens, Foucault
substitue au couple saussurien langue/parole deux oppositions qu'il
fait jouer alternativement le couple discours/langage, o le discours
est paradoxalement ce qui est rtif l'ordre du langage en gnral
(c'est par exemple le cas de 1' sotrisme structural de Raymond
Roussel) - et il faut remarquer que Foucault lui-mme annulera
l'opposition en intitulant sa leon inaugurale au Collge de France
L'Ordre du Discours, en 1971-; et le couple discours/parole, o le
discours devient l'cho linguistique de l'articulation entre savoir et
pouvoir, et o la parole, en tant que subjective, incarne au contraire
une pratique de rsistance 1' objectivation discursive .
*** L'abandon apparent du thme du discours aprs 1971, au profit
d'une analyse des pratiques et des stratgies, correspond ce que
Foucault dcrit comme le passage d'une archologie une
dynastique du savoir non plus seulement la description d'un
rgime de discursivit et de son ventuelle transgression, mais
l'analyse du rapport qui existe entre ces grands types de discours et
les conditions historiques, les conditions conomiques, les conditions
politiques de leur apparition
2
. Or ce dplacement, qui revient en
ralit problmatiser le passage mthodologique de l'archologie
la gnalogie, permet galement de poser le problme des conditions
de leur disparition le thme des pratiques de rsistance,
1. La vrit et les formes juridiques , op. cil.
2. De l'archologie la dynastique , entretien avec S. Hasumi, septembre 1972, repris in
DE, vol. 3, texte n 119.
23
omniprsent chez Foucault partir des annes 70, possde donc en
ralit une origine discursive.
Dispositif
* Le terme dispositifs apparat chez Foucault dans les annes 70
et dsigne initialement des oprateurs matriels du pouvoir, c'est--
dire des techniques, des stratgies et des formes d'assujetissement
mises en place par le pouvoir. partir du moment o l'analyse
foucaldienne se concentre sur la question du pouvoir, le philosophe
insiste sur l'importance de s'occuper non pas de l'difice juridique
de la souverainet, du ct des appareils d'tat, du ct des
idologies qui l'accompagnent! , mais des mcanismes de
domination c'est ce choix mthodologique qui engendre
l'utilisation de la notion de dispositifs . Ceux-ci sont par
dfinition de nature htrogne il s'agit tout autant de discours que
de pratiques, d'institutions que de tactiques mouvantes c'est ainsi
que Foucault en arrivera parler selon les cas de dispositifs de
pouvoir , de dispositifs de savoir , de dispositifs
disciplinaires , de dispositif de sexualit etc.
** L'apparition du terme dispositif dans le vocabulaire
conceptuel de Foucault est probablement lie son utilisation par
Deleuze et Guattari dans L'Anti-dipe (1972) c'est tout du moins
ce que laisse entendre la prface que Foucault crit en 1977 pour
l'dition amricaine du livre, puisqu'il y remarque les notions en
apparence abstraites de multiplicits, de flux, de dispositifs et de
branchements2 . Par la suite, le terme recevra une acception la fois
de plus en plus large (alors qu'au dbut, Foucault n'utilise que
l'expression dispositif de pouvoir) et de plus en plus prcise,
jusqu' faire l'objet d'une thorisation complte aprs La volont de
savoir (1976), o l'expression dispositif de sexualit est centrale
-------------
Cours du 14 janvier 1976 ", in Microfisica dei Potere interventi politici, Turin, Einaudi,
1977, repris in DE, vol. 3. texte n 194.
2. Prface G. Deleuze et F Guattari, Anti-Oedipus Capitalism and Schizophrenia, New
York, Viking Press, 1977, repris in DE, vol. 3, texte nO 189.
24
un dispositif est un ensemble rsolument htrogne, comportant
des discours, des institutions, des amnagements architecturaux, des
dcisions rglementaires, des lois, des mesures administratives, des
noncs scientifiques, des propositions philosophiques, morales,
philanthropiques, bref du dit aussi bien que du non-dit [ ... ]. Le
dispositif lui-mme, c'est le rseau qu'on peut tablir entre ces
lments! . Le problme est alors pour Foucault d'interroger aussi
bien la nature des diffrents dispositifs qu'il rencontre que leur
fonction stratgique.
*** En ralit, la notion de dispositif remplace peu peu celle
d'pistm, employe par Foucault tout particulirement dans Les
Mots et les Choses et jusqu' la fin des annes 60. En effet,
l'pistm est un dispositif spcifiquement discursif, alors que le
dispositif au sens ou Foucault l'emploiera dix ans plus tard
contient galement des institutions et des pratiques, c'est--dire
tout le social non-discursif2 .
pistm
* Le terme d' pistm est au centre des analyses des Mots et les
Choses (1966) et a donn lieu des dbats nombreux dans la mesure
o la notion est la fois diffrente de celle de systme - que
Foucault n'utilise pratiquement jamais avant que sa chaire au Collge
de France ne soit rebaptise, en 1971 et sa demande, chaire
d'histoire des systmes de pense - et de celle de structure .
Par pistm, Foucault dsigne en ralit un ensemble de rapports
liant diffrents types de discours et correspondant une poque
historique donne ce sont tous ces phnomnes de rapports entre
les sciences ou entre le.s diffrents discours scientifiques qui
constituent ce que j'appelle pistm d'une poque
3
.
Le jeu de Michel Foucault ", Ornicar ? Bulletin priodique du champ freudien, nO 10,
juillet 1977, repris in DE, vol. 3, texte n 206.
2. ibid.
3. Les problmes de la culture. Ull dbat Foucault-Preti ", Il Bimestre, n 22-23, sept.-dc.
1972, repris ill DE, vol. 2, texte nO 109.
25
** Les malentendus engendrs dans les annes 60 par l'usage de la
notion tiennent deux raisons on interprte d'une part l'pistm
comme un systme unitaire, cohrent et ferm, c'est--dire comme
une contrainte historique impliquant une surdtermination rigide des
discours ; et de l'autre, on somme Foucault de rendre compte de sa
relativit historique, c'est--dire d'expliquer la rupture pistmique
et la discontinuit que le passage d'une pistm une autre implique
ncessairement. Sur le premier point, Foucault rpond que l'pistm
d'une poque n'est pas la somme de ses connaissances, ou le style
gnral de ses recherches, mais l'cart, les distances, les oppositions,
les diffrences, les relations de ses multiples discours scientifiques
l'pistm n'est pas une sorte de grande thorie sous-jacente, c'est
un espace de dispersion, c'est un champ ouvert [ ... ] l'pistm n'est
pas une tranche d'histoire commune toutes les sciences; c'est un
jeu simultan de rmanences spcifiques
1
Plus qu'une forme
gnrale de la conscience, Foucault dcrit donc un faisceau de
relations et de dcalages non pas un systme, mais la prolifration
et l'articulation de multiples systmes qui se renvoient les uns aux
autres. Sur le second point, Foucault revendique travers l'usage de
la notion la substitution de la question abstraite du changement
(particulirement vive l'poque chez les historiens) par celle des
diffrents types de transformation remplacer, en somme, le
thme du devenir (forme gnrale, lment abstrait, cause premire
et effet universel, mlange confus de l'identique et du nouveau) par
l'analyse des transformations dans leur spcificit
2
.
*** L'abandon de la notion d'pistm correspond au dplacement
de l'intrt de Foucault, d'objets strictement discursifs des ralits
non-discursives - pratiques, stratgies, institutions etc Dans Les
Mots et les Choses, en voulant faire une histoire de l'pistm, je
restais dans une impasse. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est
essayer de montrer que ce que j'appelle dispositif est un cas
Rponse une question , Esprit, n 371, mai 1968, repris in DE, vol. 1, texte nO 58. Les
italiques sont ceux de Foucault.
2. Ibid.
26
beaucoup plus gnral de l'pistm. Ou plutt que l'pistm, c'est
un dispositif spcifiquement discursif, la diffrence du dispositif
qui est, lui, discursif et non discursif, ses lments tant beaucoup
plus htrognes
l
.
Esthtique (de l'existence)
* Le thme d'une esthtique de l'existence apparat trs
nettement chez Foucault au moment de la parution des deux derniers
volumes de l'Histoire de la sexualit, en 1984. Foucault fait en effet
la description de deux types de morale radicalement diffrents, une
morale grco-romaine tourne vers l'thique et pour laquelle il s'agit
defaire de sa vie une uvre d'art, et une morale chrtienne o il
s'agit au contraire essentiellement d'obir un code Et si je me
suis intress l'Antiquit, c'est que, pour toute une srie de raisons,
l'ide d'une morale comme obissance un code de rgles est en
train, maintenant, de disparatre, a dj disparu. Et cette absence de
morale rpond, doit rpondre une recherche qui est celle d'une
esthtique de l' existence
2
. Les thmes de l'thique et de
l'esthtique de l'existence sont donc troitement lis.
** L' esthtique de l'existence lie la morale antique marque
chez Foucault le retour au thme de l'invention de soi (faire de sa vie
une uvre d'art) une problmatisation laquelle il tait dj arriv
en filigrane dans un certain nombre de textes littraires dans les
annes 60 (par exemple dans le Raymond Roussel, mais galement
dans les analyses consacres Brisset et Wolfson), et qu'il reprend
vingt ans plus tard travers une double srie discours. La premire,
au sein de l'Histoire de la Sexualit, est essentiellement lie la
problmatisation de la rupture que reprsente la pastorale
chrtienne par rapport l'thique grecque; la seconde passe en
revanche par l'analyse de 1' attitude de la modernit ( travers la
reprise du texte kantien sur les Lumires) et fait de l'invention de soi
1. Le jeu de Michel Foucault , op. cit.
2. Une esthtique de l'existence , Le Monde, 15-16 juillet 1984, repris in DE, vol. 4, texte
nO 357.
27
l'une des caractristiques de cette attitude la modernit, ce n'est pas
seulement le rapport au prsent mais le rapport soi, dans la mesure
o tre moderne, ce n'est pas s'accepter soi-mme tel qu'on est
dans le flux des moments qui passent; c'est se prendre soi-mme
pour objet d'une laboration complexe et dure ce que Baudelaire
appelle, selon le vocabulaire de l'poque, le "dandysme
l
" .
L'esthtique de l'existence, c'est donc la fois ce que Foucault
repre hors de l'influence de la pastorale chrtienne (temporel-
lement le retour aux Grecs; spatialement l'intrt contemporain de
Foucault pour le zen et la culture japonaise) et ce qui doit nouveau
caractriser le rapport que nous entretenons avec notre propre
actualit.
*** Le thme de l'esthtique de l'existence comme production
inventive de soi ne marque cependant pas un retour la figure du
sujet souverain, fondateur et universel, ni un abandon du champ
politique je pense au contraire que le sujet se constitue travers
des pratiques d'assujettissement ou, d'une faon plus autonome,
travers des pratiques de libration
2
. L'esthtique de l'existence,
dans la mesure o elle est une pratique thique de production de
subjectivit, est en mme temps assujettie et rsistante c'est donc un
geste minemment politique.
thique
* Dans les derniers volumes de l'Histoire de la sexualit, Foucault
distingue clairement entre ce qu'il faut entendre par morale et ce
que signifie thique . La morale est au sens large un ensemble de
valeurs et de rgles d'action qui sont proposs aux individus et aux
groupes par l'intermdiaire de diffrents appareils prescriptifs (la
famille, les institutions ducatives, les glises etc.) ; cette morale
engendre une moralit des comportements , c'est--dire une
variation individuelle plus ou moins consciente par rapport au
systme de prescriptions du code moral. En revanche, l'thique
1. What is Enlightenmellt ? , op. cit.
2. Une esthtique de l'existence , op. cit.
28
concerne la manire dont chacun se constitue soi-mme comme sujet
moral du code Un code d'actions tant donn [ ... ], il Y a
diffrentes manires de "se conduire" moralement, diffrentes
manires pour l'individu agissant d'oprer non seulement comme
agent, mais comme sujet moral de cette action! .
** toute thique correspond la dtermination d'une substance
thique , c'est--dire la manire dont un individu fait de telle ou
telle part de lui-mme la matire principale de sa conduite morale
de la mme manire, elle implique ncessairement un mode
d'assujettissement, c'est--dire la manire dont un individu entre en
rapport avec une rgle ou un systme de rgles et prouve
l'obligation de les mettre en uvre. L'thique grco-romaine que
dcrit Foucault, en particulier dans le second volume de l' Histoire de
la Sexualit, L'Usage des Plaisirs, a pour substance thique les
aphrodisia, et son mode d'assujettissement est un choix personnel
esthtico-politique (il ne s'agit pas tant de respecter un code que de
faire de sa vie une uvre d'art). En revanche, la morale
chrtienne fonctionne non pas sur le choix mais sur l'obissance, non
pas sur les aphrodisia (qui sont en mme temps le plaisir, le dsir et
les actes) mais sur la chair (qui met entre parenthses aussi bien
le plaisir que le dsir) avec le christianisme, le mode
d'assujettissement est prsent constitu par la loi divine. Et je pense
que mme la substance thique se transforme son tour elle n'est
plus constitue par les aphrodisia, mais par le dsir, la
concupiscence, la chair etc.
2
*** Le terme d'thique apparat pour la premire fois de manire
rellement significative en 1977, dans un texte sur l'Anti-dipe de
Deleuze et Guattari Je dirais que l'Anti-dipe (puissent ses
auteurs me pardonner) est un livre d'thique, le premier livre
Usage des plaisirs et techniques de soi , Le Dbat, nO 27, novembre 1983, repris in DE,
vol. 4, texte nO 338.
2. propos de la gnalogie de l'thique un aperu du travail en cours , in H. Dreyfus et
P. Rabinow, Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics, op. cit., repris in
DE, vol. 4, texte nO 326.
29
d'thique que l'on ait crit en France depuis assez longtempsl . Et il
est intressant de constater que Foucault caractrise de la mme
manire, quelques annes plus tard, sa propre Histoire de la
Sexualit si, par "thique" vous entendez le rapport qu'a
l'individu lui-mme lorsqu'il agit, alors je dirais qu'elle tend tre
une thique, ou du moins montrer. ce que pourrait tre une thique
du comportement sexueF . Et au-del de la sexualit, le projet d'une
ontologie critique de l'actualit reoit parfois la formulation
d'une politique comme une thique c'est dire que l'intrt pour
l'thique des annes 80, bien loin d'tre la fin de la problmatisation
philosophique et historique des stratgies du pouvoir et de leur
application aux individus, repropose l'analyse du champ politique
partir de la constitution thique des sujets, partir de la production
de subjectivit.
vnement
* Par vnement, Foucault entend tout d'abord de manire ngative
un fait dont certaines analyses historiques se contentent de fournir la
description. La mthode archologique foucaldienne cherche au
contraire reconstituer derrire le fait tout un rseau de discours, de
pouvoirs, de stratgies et de pratiques. C'est par exemple le cas du
travail ralis sur le dossier Pierre Rivire en reconstituant ce
crime de l'extrieur [ ... l, comme si c'tait un vnement, et rien
d'autre qu'un vnement criminel, je crois qu'on manque
l'essentieP . Cependant, dans un deuxime temps, le terme
vnement commence apparatre chez Foucault, de manire
positive, comme une cristallisation de dterminations historiques
complexes qu'il oppose l'ide de structure On admet que le
structuralisme a t l'effort le plus systmatique pour vacuer non
Prface" Gilles Deleuze et Flix Guattari, Anti-Oedipus Capitalism and
Schizophrenia, op. cit.
2. Une interview de Michel Foucault par Stephen Riggins", Ethos, vol. l, nO 2, 1983,
repris in DE, vol. 4, texte nO 336.
30
Entretien avec Michel Foucault , Cahiers du Cinma, nO 271, novembre 1976, repris in
DE, vol. 3, texte nO 180.
seulement de l'ethnologie, mais de toute une srie d'autres sciences,
et mme la limite de l'histoire, le concept d'vnement. Je ne vois
pas qui peut tre plus anti-structuraliste que moil . Le programme
de Foucault devient donc l'analyse des diffrents rseaux et niveaux
auxquels certains vnements appartiennent. C'est par exemple le
cas, quand il lui arrive de dfinir le discours comme une srie
d'vnements, et qu'il se pose plus gnralement le problme du
rapport entre des vnements discursifs et des vnements d'une
autre nature (conomiques, sociaux, politiques, institutionnels).
** C'est partir de cette position de l'vnement au centre de ses
analyses que Foucault revendique le statut d'historien - peut-tre
aussi parce que, comme il le remarque lui-mme, l'vnement n'a
gure t une catgorie philosophique, sauf peut-tre chez les
Stociens Le fait que je considre le discours comme une srie
d'vnements nous place automatiquement dans la dimension de
l'histoire [ ... ]. Je ne suis pas un historien au sens strict du terme,
mais les historiens et moi avons en commun un intrt pour
l'vnement [ ... ]. Ni la logique du sens, ni la logique de la structure
ne sont pertinentes pour ce type de recherche
2
. C'est donc lors
d'une discussion avec des historiens
3
que Foucault donne la
dfinition de 1' vnementialisation non pas une histoire
vnementielle mais la prise de conscience des ruptures d'vidence
induites par certains faits. Ce qu'il s'agit alors de montrer, c'est
l'irruption d'une singularit non ncessaire l'vnement que
reprsente l'enfermement, l'vnement de l'apparition de la
catgorie de malades mentaux etc.
*** partir de la dfinition de l'vnement comme irruption d'une
singularit historique, Foucault va dvelopper deux discours. Le
premier consiste dire que nous rptons sans le savoir les
Entretien avec Michel Foucault , in A. Fontana et P Pasquino, Microfisica dei polere
interventi politici, op. cit., repris in DE, vol. 3, texte nO 192.
2. Dialogue sur le pouvoir , op. cir.
3. La poussire et le nuage , in M. Perrot (d.), L'impossible prisolt, Paris, Seuil, 1980,
repris in DE, vol. 4, texte nO 277.
31
vnements, nous les rptons dans notre actualit, et j'essaie de
saisir quel est l'vnement sous le signe duquel nous sommes ns, et
quel est l'vnement qui continue encore nous traverser .
L'vnementialisation de J'histoire doit donc se prolonger de
manire gnalogique par une vnementialisation de notre propre
actualit. Le second discours consiste prcisment chercher dans
notre actualit les traces d'une rupture vnementielle - trait
que Foucault repre dj dans le texte kantien consacr aux Lumires
et dans les rflexions sur la Rvolution Franaise, et qu'il croit
retrouver lors de la rvolution iranienne, en 1979 - car c'est sans
doute l la valeur de rupture de toutes les rvolutions La
rvolution [ ... ] risquera de retomber dans l'ornire, mais comme
vnement dont le contenu mme est important, son existence atteste
une virtualit permanente et qui ne peut tre oublie' .
Exprience
* La notion d'exprience est prsente tout au long du parcours
philosophique de Foucault, mais elle subit d'importantes
modifications au cours des annes. S'il est vrai que, de manire
gnrale l'exprience est une quelque chose dont on sort soi-mme
transform
2
, Foucault se rfre initialement une exprience qui
doit beaucoup la fois Bataille et Blanchot: au croisement d'une
exprience de la limite et d'une exprience du langage considre
comme exprience du dehors , il cherche en effet dfinir - en
particulier dans le domaine de la littrature - une exprience de
l'illimit, de l'infranchissable, de l'impossible, c'est--dire qui
affronte en ralit la folie, la mort, la nuit ou la sexualit en creusant
dans l'paisseur du langage son propre espace de parole. Dans un
second temps, trs diffremment, l'exprience devient pour Foucault
la seule manire de distinguer la gnalogie tout la fois d'une
dmarche empirique ou positiviste et d'une analyse thorique si
\. Qu'est-ce que les Lumires , op. cit.
2. Entretien avec Michel Foucault (avec Duccio Trombadori, Paris, fin 1978),
Contributo, 4
e
anne, nO l, Salerne, 1980, repris in DE, vol. 4, texte nO 28 \.
32
certaines problmatisations naissent d'une exprience (par exemple
l'criture de Surveiller et Punir aprs l'exprience du Groupe
d'Information sur les Prisons et, plus gnralement, aprs 1968),
c'est au sens o la pense philosophique de Foucault est
vritablement une exprimentation elle donne en effet voir le
mouvement de constitution historique des discours, des pratiques,
des rapports de pouvoir et des subjectivits, et c'est parce qu'elle en
fait la gnalogie qu'elle en sort elle-mme modifie Mon
problme est de faire moi-mme, et d'inviter les autres faire avec
moi, travers un contenu historique dtermin, une exprience de ce
que nous sommes, de ce qui est non seulement notre pass mais aussi
notre prsent, une exprience de notre modernit telle que nous en
sortions transforms
l
.
** Alors que l'exprience phnomnologique ( laquelle Foucault se
rfre encore en partie dans ses textes des annes 50) cherche en
ralit ressaisir la signification de l'exprience quotidienne pour
retrouver en quoi le sujet que je suis est bien effectivement
fondateur, dans SeS fonctions transcendantales, de cette exprience et
de ces significations
2
, la rfrence Nietzsche, Bataille et
Blanchot permet au contraire de dfinir l'ide d'une exprience-
limite qui arrache le sujet lui-mme et lui impose son clatement ou
sa dissolution. C'est pour cette raison que Foucault, s'il reconnat par
exemple Breton d'avoir tent de parcourir un certain nombre
d'expriences-limites, reproche pourtant aux surralistes de les avoir
maintenues dans un espace de la psych, et que la rfrence
Bataille devient du mme coup essentielle; c'est galement parce
qu'il est construit partir de l'effacement du sujet que le discours de
l'exprience comme passage la limite n'est en ralit pas si loign
des autres analyses de Foucault dans les annes 60 il rend actuel
l'horizon dessin par la fin des Mots et les Choses - la possible
disparition de l'homme la fois comme conscience autonome et
comme objet de connaissance privilgi une exprience est en
1. Entretien avec Michel Foucault , op. cil.
2. Ibid.
33
train de natre o il y va de notre pense; son imminence, dj
visible mais vide absolument, ne peut tre encore nomme) .
*** S'il est vrai que la plupart des analyses de Foucault naissent
d'une exprience personnelle - comme il le reconnat lui-mme -,
elles ne peuvent en aucun cas y tre rduites. Tout le problme
semble au contraire de trouver la manire de reformuler la notion
d'exprience en l'largissant au-del de soi (un soi dj malmen par
la critique des philosophies du sujet) l'exprience est quelque chose
que l'on fait tout seul, mais qui n'est pleine que dans la mesure o
elle chappe la pure subjectivit, c'est--dire que d'autres peuvent
la croiser ou la retraverser. partir des annes 70, c'est donc sur le
terrain d'une pratique collective - c'est--dire dans le champ du
politique - que Foucault cherche poser le problme de
l'exprience comme moment de transformation le terme est alors
associ la fois la rsistance aux dispositifs de pouvoir (exprience
rvolutionnaire, exprience des luttes, exprience du soulvement) et
aux processus de subjectivation.
Folie
34
* Le thme de la folie est bien entendu au centre de l' Histoire de la
Folie que Foucault publie en 1961 il s'agit en effet d'analyser la
manire dont, au XVIIe sicle, la culture classique a rompu avec la
reprsentation mdivale d'une folie la fois circulante (la figure de
la nef des fous) et considre comme le lieu imaginaire du
passage (du monde l'arrire-monde, de la vie la mort, du tangible
au secret etc.). L'ge classique dfinit au contraire la folie partir
d'un partage vertical entre la raison et la draison elle la constitue
donc non plus comme cette zone indtermine qui donnerait accs
aux forces de l'inconnu (la folie comme au-del du savoir, c'est--
dire la fois comme menace et comme fascination), mais comme
l'Autre de la raison selon le discours de la raison elle-mme. La folie
comme draison, c'est la dfinition paradoxale d'un espace mnag
La folie, l'absence d'uvre , La Table Ronde, nO 196: Situation de la psychiatrie,
1964, repris in DE, vol. 1, texte nO 25.
par la raison au sein de son propre champ pour ce qu'elle reconnat
comme autre.
** Le rcit de cette scission fondatrice d'inclusion passe par un
certain nombre de procdures et d'institutions qui possdent une
histoire. Le but de Foucault n'a pourtant jamais t de faire l'histoire
de l'enfermement ou de l'asile, mais du discours qui constitue les
fous comme objets de savoir - c'est--dire aussi de cet trange lien
entre raison et draison qui autorise la premire produire un
discours de savoir sur la seconde. Il s'agit par consquent de faire
avant tout l'histoire d'un pouvoir: ce qui tait impliqu au premier
chef dans ces relations de pouvoir, c'tait le droit absolu de la non-
folie sur la folie. Droit transcrit en termes de comptence s'exerant
sur une ignorance, de bon sens (d'accs la ralit) corrigeant des
erreurs (illusions, hallucinations, fantasmes), de la normalit
s'imposant au dsordre et la dviation
l
. Ce triple pouvoir
constitue la folie comme objet de connaissance, et c'est pour cette
raison qu'il faut alors faire l'histoire des modifications des discours
sur la folie du grand enfermement - invention d'un lieu inclusif
d'exclusion - l'apparition d'une science mdicale de la folie (de la
maladie mentale la psychiatrie contemporaine), Foucault fait en
ralit la gnalogie de l'un des visages possibles de cette forme
singulire du pouvoir-savoir qu'est la connaissance. On comprend
alors quel discours de Foucault ait t rapidement t associ
l'antipsychiatrie de Laing et Cooper, de Basaglia, ou - plus
tardivement - l'Anti-dipe de Deleuze et Guattari, c'est--dire
des discours de remise en cause du lien connaissance/
assujettissement dans la pratique psychiatrique Est-il possible que
la production de la vrit de la folie puisse s'effectuer dans des
formes qui ne sont pas celles du rapport de connaissance
2
? . La
lecture de l'histoire de la folie comme histoire de la constitution du
Le pouvoir psychiatrique , Annuaire du Collge de France, 74" anne, Chaire
d'histoire des systmes de pense, anlle 1973-1974, 1974, repris in DE, vol. 2, texte
nO 143.
2. Le pouvoir psychiatrique , op. cit.
35
pouvoir-savoir pousse Foucault utiliser la figure de l'asile comme
paradigme gnral d'analyse des rapports de pouvoir dans la socit
jusqu'au dbut des annes 70. Le passage une autre formulation du
pouvoir permet alors de comprendre l'abandon relatif du thme de la
folie au profit du thme plus gnral de la mdicalisation (le contrle
o m m ~ mdecine sociale) non seulement parce qu'alors que
l'enfermement ne donnait voir que le paradoxe d'une connaissance
jouant contemporainement sur l'exclusion (spatiale) et sur l'inclusion
(discursive), la figure de l'hpital rend compte de la manire dont,
partir du dbut du XIxe sicle, le pouvoir gre dsormais la vie (sous
la forme des bio-pouvoirs) ; mais parce que Foucault abandonne une
conception purement ngative du pouvoir (<< Il m'a sembl, partir
d'un certain moment, que c'tait insuffisant, et cela au cours d'une
exprience concrte que j'ai pu faire, partir des annes 1971-1972,
propos des prisons 1 ). Des recherches sur la folie aux analyses des
mcanismes de gouvernementalit, c'est donc un changement de
lecture des rapports de pouvoir qui est en jeu.
*** Pendant les annes 60, le thme de la folie est en gnralement
crois avec celui de la littrature et, plus gnralement, avec celui de
l'irrductibilit d'un certain type de parole qui est en gnral incarn
par trois figures superposes le fou (H61derlin, Nerval, Nietzsche,
Roussel, Artaud), l'crivain (Sade, Hlderlin, Nerval, Mallarm,
Roussel, Breton, Bataille, Blanchot), le philosophe (Nietzsche - et
Foucault lui-mme ?). La littrature semble retrouver sa vocation la
plus profonde lorsqu'elle se retrempe dans la parole de la folie. La
plus haute parole potique, c'est celle de Hlderlin, comme si la
littrature, pour arriver se dsinstitutionnaliser, pour prendre toute
la mesure de son anarchie possible, tait en certains moments oblige
ou bien d'imiter la folie ou bien plus encore de devenir littralement
folle
2
. En marge des analyses de l'histoire de Lafolie, l'ide d'une
parole philosophique ou littraire qui puiserait dans la folie son
1. Les rapports de pouvoir passent l'intrieur des corps , 01'
2. La folie et la socit , in M. Foucault et M. Watanabe, Telsugaku no butai, Tokyo,
1978, repris in DE, vol. 3, texte nO 222.
36
irrductibilit l'ordre du discours n'est pas seulement le rsidu
phnomnologique d'une exprience cruciale ou la reprise de
l'exprience de la limite que l'on trouve chez Bataille elle permet
Foucault de problmatiser pour la premire fois l'ide de la
rsistance au pouvoir - un thme que l'on retrouvera, dans les
annes 70, formul diffremment dans le cadre des analyses
politiques sous la forme d'un discours sur la production de
subjctivit comme dsasujettissement, c'est--dire aussi sous la
forme d'un rapport thique soi.
Gnalogie
* Ds la publication des Mots et les Choses (1966), Foucault qualifie
son projet d'archologie des sciences humaines davantage comme
une gnalogie nietzschenne que comme une uvre
structuraliste. C'est donc l'occasion d'un texte sur Nietzsche que
Foucault revient sur le concept la gnalogie, c'est une enqute
historique qui s'oppose au dploiement mtahistorique des
significations idales et des indfinies tlologies
l
, qui s'oppose
l'unicit du rcit historique et la recherche de l'origine, et qui
recherche au contraire la singularit des vnements hors de toute
finalit monotone
2
. La gnalogie travaille donc partir de la
diversit et de la dispersion, du hasard des commencements et des
accidents en aucun cas elle ne prtend remonter le temps pour
rtablir la continuit de l'histoire, mais elle cherche au contraire
restituer les vnements dans leur singularit
** L'approche gnalogique n'est cependant pas un simple
empirisme ce n'est pas non plus un positivisme au sens ordinaire
du terme il s'agit en fait de faire jouer des savoirs locaux,
discontinus, disqualifis, non lgitims, contre l'instance thorique
unitaire qui prtendrait les filtrer, les hirarchiser, les ordonner au
nom d'une connaissance vraie [ ... ]. Les gnalogies ne sont donc pas
Nietzsche, la gnalogie, l'histoire , HO/nm.age Jean Hyppolite, Paris, PUF, 1971,
repris in DE, vol. 2, texte nO 84.
2. Ibid.
37
des recours positivistes une forme de science plus attentive ou plus
exacte; les gnalogies, ce sont trs exactement des antisciences
1
.
La mthode gnalogique est donc une tentative de ds assujettir les
savoirs historiques, c'est--dire de les rendre capables d'opposition et
de lutte contre l'ordre du discours cela signifie que la
gnalogie ne recherche pas seulement dans le pass la trace
d'vnements singuliers, mais qu'elle se pose la question de la
possibilit des vnements aujourd'hui elle dgagera de la
contingence qui nous a fait tre ce que nous sommes la possibilit de
ne plus tre, faire ou penser ce que nous sommes, faisons ou
pensons
2
.
*** La gnalogie permet de rendre compte de manire cohrente du
travail de Foucault depuis les premiers textes (avant que le concept
de gnalogie ne commence tre employ) jusqu'aux derniers.
Foucault indique en effet qu'il y a trois domaines de gnalogie
possibles une ontologie historique de nous-mmes dans nos
rapports la vrit, qui nous permet de nous constituer comme sujets
de connaissance; dans nos rapports un champ de pouvoir, qui nous
permet de nous constituer comme sujets agissants sur les autres; et
dans nos rapports la morale, qui nous permet de nous constituer en
agents thiques. Tous les trois taient prsents, mme d'une
manire un peu confuse, dans l' Histoire de la Folie. J'ai tudi l'axe
de la vrit dans Naissance de la Clinique et dans L'Archologie du
Savoir. J'ai dvelopp l'axe du pouvoir dans Surveiller et Punir et
l'axe moral dans l' Histoire de la Sexualite'3 .
Gouvernementalit
* partir de 1978, Foucault analyse dans son cours au Collge de
France la rupture qui s'est produite entre la fin du XVIe sicle et le
dbut du XVIIe sicle et qui marque le passage d'un art de gouverner
Cours du 7 janvier 1976", in Microfisica dei potere, op. cit., repris in DE, vol. 3, texte
na 193.
2. What is Enlightenment ? , op. cit.
3. propos de la gnalogie de l'thique: un aperu du travail en cours , op. cit.
38
hrit du Moyen ge, dont les principes reprennent les vertus
morales traditionnelles (sagesse, justice, respect de Dieu) et l'idal de
mesure (prudence, rflexion), un art de gouverner dont la
rationalit a pour principe et champ d'application le fonctionnement
de l'tat la gouvernement alit rationnelle de l'tat. Cette
raison d'tat n'est pas ici entendre comme la suspension
imprative des rgles prexistantes mais comme une nouvelle
matrice de rationalit qui n'a voir ni avec le souverain de justice, ni
avec le modle machiavellien du Prince.
** Par ce mot de "gouvernementalit", je veux dire trois choses.
Par gouvernementalit, j'entends l'ensemble constitu par les
institutions, les procdures, analyses et rflexions, les calculs et les
tactiques qui permettent d'exercer cette forme bien spcifique, bien
que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population,
pour forme majeure de savoir l'conomie politique, pour instrument
technique essentiel les dispositifs de scurit. Deuximement, par
gouvemementalit, j'entends la tendance, la ligne de force qui, dans
tout l'Occident, n'a pas cess de conduire, et depuis fort longtemps,
vers la prminence de ce type de pouvoir qu'on peut appeler le
"gouvernement" sur tous les autres souverainet, discipline [ ... ].
Enfin par gouvernementalit, je crois qu'il faudrait entendre le
processus ou, plutt, le rsultat du processus par lequel l'tat de
justice du Moyen ge, devenu aux xve et XVIe sicles tat
administratif, s'est trouv petit petit gouvernementalis
l
. La
nouvelle gouvernementalit de la raison d'tat s'appuie sur deux
grands ensembles de savoirs et de technologies politiques, une
technologie politico-militaire et une police . Au croisement de ces
deux technologies, on trouve le commerce et la circulation inter-
tatique de la monnaie c'est de l'enrichissement par le commerce
qu'on attend la possibilit d'augmenter la population, la main
d'uvre, la production et l'exportation, et de se doter d'armes fortes
et nombreuses. Le couple population-richesse fut, l'poque du
La gouvernementalit ", Cours au Collge de France, 1977-1978 Scurit, territoire,
population ", 4
e
leon, 1
er
fvrier 1978, in DE, vol. 3, texte nO 239.
39
mercantilisme et de la camralistique, l'objet privilgi de la
nouvelle raison gouvernementale) . Ce couple est au fondement
mme de la formation d'une conomie politique .
*** La gouvernementalit moderne pose pour la premire fois le
problme politique de la population , c'est--dire non pas la
somme des sujets d'un territoire, l'ensemble des sujets de droit ou la
catgorie gnrale de l' espce humaine , mais l'objet construit par
la gestion politique globale de la vie des individus (biopolitique).
Cette biopolitique implique cependant non seulement une gestion de
la population mais un contrle des stratgies que les individus, dans
leur libert, peuvent avoir par rapport eux-mmes et les uns par
rapport aux autres. Les technologies gouvernementales concernent
donc aussi bien le gouvernement de l'ducation et de la
transformation des individus, celui des relations familiales et celui
des institutions. C'est pour cette raison que Foucault prolonge
l'analyse de la gouvernementalit des autres par une analyse du
gouvernement de soi J'appelle "gouvernementalit" la rencontre
entre les techniques de domination exerces sur les autres et les
techniques de soi2 .
Guerre
* Foucault s'intresse la guerre pendant une priode relativement
brve, entre 1975 et 1977, et de manire extrmement intense
puisqu'il lui consacre une anne de cours au Collge de France
3
La
premire rfrence la guerre se limite retourner la formule
clausewitzienne afin de dcrire la situation de crise internationale
cre par les chocs ptroliers la politique est la continuation de la
Scurit, territoire, population , Annuaire du Collge de France, 78' anne, Histoir
des systmes de pense, anne 1977-1978, 1978, repris in DE, vol. 3, texte n 255.
2. Les techniques de soi , in Technologies of the Self. A Seminar with M. Foucault,
Massachusetts U. P., 1988, repris in DE, vol. 4, texte nO 363.
3. 11 faut dfendre la socit , Annuaire du Collge de France, 76' anne, anne 1975-
1976, repris in DE, vol. 3, texte nO 187.
40
guerre par d'autres moyens' Par la suite, Foucault revient
thoriquement sur le thme de la guerre dans la mesure o, le
pouvoir tant essentiellement un rapport de forces, les schmas
d'analyse du pouvoir ne doivent pas tre emprunts la
psychologie ou la sociologie, mais la stratgie. Et l'art de la
guerre
2
. Cette affirmation, reformule de manire interrogative,
devient le cur du cours Il faut dfendre la socit si la notion
de stratgie est essentielle pour faire l'analyse des dispositifs de
savoir et de pouvoir, et si elle permet en particulier d'analyser les
rapports de pouvoir travers des techniques de domination, peut-on
alors dire que la domination n'est qu'une forme continue de la
guerre?
** La question de savoir si la guerre peut valoir comme grille
d'analyse des rapports de pouvoir se subdivise en plusieurs
problmes la guerre est-elle un tat premier dont tous les
phnomnes de domination et de hirarchisation sociale drivent?
Les processus d'antagonisme et de luttes, qu'ils soient individuels ou
de classe, sont-ils reconductibles au modle gnral de la guerre?
Les institutions et les procds militaires sont-ils le cur des
institutions politiques? Et surtout, qui a d'abord pens que la guerre
tait la continuation de la politique par d'autres moyens, et depuis
quand ? Le cours, qui s'attarde sur la rupture entre le droit de paix et
de guerre caractristique du pouvoir mdival et la conception
politique de la guerre partir du XVIIe sicle, cherche
"essentiellement rpondre la dernire question; le modle de la
guerre est par la suite abandonn par Foucault au profit d'un modle
d'analyse des rapports de pouvoir plus complexe, la
gouvernementalit .
*** Foucault repre au XVIIe sicle un discours historico-politique
- trs diffrent du discours philosophico-juridique ordonn au
La politique est la continuation de la guerre par d'autres moyens , L'Imprvu, n l,
janvier 1975, repris in DE, vol. 2, texte nO 1 48.
2. Michel Foucault, l'iIIgalisme et l'art de punir , La Presse, nO 80, 3 avril 1976, repris in
DE, vol. 3, texte nO 175.
41
problme de la souverainet' - qui transforme la guerre en un
fond permanent de toutes les institutions de pouvoir. En France, ce
discours, qui a t dvelopp en particulier par Boulainvilliers,
affirme que c'est la guerre qui a prsid la naissance des tats non
pas la guerre imaginaire et idale comme chez les philosophes de
l'tat de nature - c'est la non-guerre pour Hobbes qui fonde l'tat
et lui donne sa forme
2
-, mais une guerre relle, une bataille
dont la mme anne, Surveiller et Punir nous incite entendre le
grondement sourd }}.
Histoire
* Bien que le terme d' histoire}} apparaisse de nombreuses
reprises dans les titres des ouvrages de Michel Foucault, il recouvre
en ralit trois axes de discours distincts. Le premier consiste en une
reprise explicite de Nietzsche, c'est--dire tout la fois de la critique
de l'histoire conue comme continue, linaire, pourvue d'une origine
et d'un telos, et de la critique du discours des historiens comme
histoire monumentale }} et supra-historique. C'est donc cette lecture
nietzschenne qui pousse Foucault adopter ds le dbut des annes
70 le terme de gnalogie}} il s'agit de retrouver la discontinuit
et l'vnement, la singularit et les hasards, et de formuler un type
d'approche qui ne prtende pas rduire la diversit historique mais
qui en soit l'cho. Le deuxime axe correspond la formulation
d'une vritable pense de l'vnement}} - de manire trs proche
de ce que fait Deleuze la mme poque -, c'est--dire l'ide
d'une histoire mineure faite d'une infinit de traces silencieuses, de
rcits de vies minuscules, de fragments d'existences - d'o l'intrt
de Foucault pour les archives. Le troisime axe se dveloppe
prcisment partir des archives, et il induit Foucault collaborer
avec un certain nombre d'historiens, c'est--dire la fois
problmatiser ce que devrait tre le rapport entre la philosophie et
l'histoire (ou plus exactement entre la pratique philosophique et la
1. Il faut dfendre la socit ,
2. Ibid.
42
pratique historienne) une fois sortis du traditionnel doublet
philosophie de l'histoire/histoire de la philosophie, et interroger de
manire critique l'volution de l'historiographie franaise depuis les
annes 60.
** En ralit, il semble que le discours de Foucault oscille entre deux
positions d'une part, l'histoire n'est pas une dure mais une
multiplicit de dures qui s'enchevtrent et s'enveloppent les unes
dans les autres [ ... ] le structuralisme et l' histoire permettent
d'abandonner cette grande mythologie biologique de l'histoire et de
la dure' - ce qui revient affirmer que seule une approche qui
fasse jouer la continuit des sries comme cl de lecture des
discontinuits rend en ralit compte des vnements qui autrement
ne seraient pas apparus
2
. L'vnement n'est pas en soi source de la
discontinuit; mais c'est le croisement d'une histoire srielle et
d'une histoire vnementielle - srie et vnement ne constituant
pas le fondement du travail historien mais son rsultat partir du
traitement de documents et d'archives - qui permet de faire merger
en mme temps des dispositifs et des points de rupture, des nappes de
discours et des paroles singulires, des stratgies de pouvoir et des
foyers de rsistance etc. vnement il faut entendre par l non pas
une dcision, un trait, un rgne, ou une bataille, mais un rapport de
forces qui s'inverse, un pouvoir confisqu, un vocabulaire repris et
retourn contre ses utilisateurs, une domination qui s'affaiblit, se
dtend et s'empoisonne elle-mme, une autre qui fait son entre,
masque
3
. D'autre part, cette revendication d'une histoire qui
fonctionnerait non pas comme analyse du pass et de la dure mais
comme mise en lumire des transformations et des vnements se
dfinit parfois comme une vritable histoire vnementielle
travers la rfrence un certain nombre d'historiens qui ont tudi le
quotidien, la sensibilit, les affects (Foucault cite plusieurs reprises
Le Roy Ladurie, Aris et Mandrou) et mme s'il est reconnu
1. Revenir l'histoire , Paideia, n Il. fvrier 1972, repris in DE, vol. 2, texte n 103.
2. Ibid.
3. Nietzsche, la gnalogie, l'histoire , op. cit.
43
l'cole des Annales - et en particulier Marc Bloch puis Fernand
Braudel- le mrite d'avoir dmultipli les dures et redfini
l'vnement non pas comme un segment de temps mais comme le
point d'intersection de dures diffrentes, il n'en reste pas moins que
Foucault finit par opposer son propre travail sur l'archive l'histoire
sociale des classements qui caractrise pour lui une bonne partie de
l'historiographie franaise depuis les annes 60 Entre l'histoire
sociale et les analyses formelles de la pense, il y a une voie, une
piste - trs troite, peut-tre - qui est celle de l'historien de la
pense! . C'est la possibilit de cette piste troite qui alimentera
le dbat toujours plus vif entre Foucault et les historiens et qui
motivera une collaboration occasionnelle avec certains d'entre eux
(depuis le groupe d'historiens ayant travaill au dossier Pierre
Rivire jusqu' Arlette Farge et Michelle Perrot).
*** Le thme de l'histoire comme enqute sur les transformations et
sur les vnements est troitement li celui de l'actualit. Si
l'histoire n'est pas mmoire mais gnalogie, alors l'analyse
historique n'est en ralit que la condition de possibilit d'une
ontologie critique du prsent. Cette position doit cependant viter
deux cueils - qui correspondent de fait aux deux grands reproches
qui ont t faits Foucault de son vivant concernant son rapport
l'histoire - l'utilisation d'une enqute historique n'implique pas
une idologie du retour (Foucault ne s'occupe pas de l'thique
grco-romaine afin de donner un modle suivre qu'il s'agirait
d'actualiser) mais une historicisation de notre propre regard partir
de ce que nous ne sommes plus l'histoire doit nous protger d'un
historicisme qui invoque le pass pour rsoudre les problmes du
prsent
2
. C'est ce double problme que l'on retrouve dans les
textes que Foucault consacre la fin de sa vie l'analyse du texte de
Kant Qu'est-ce que les Lumires il s'agit de se dfendre la
1. Vrit, pouvoir et soi ", in Technologies of the Self A Semillar with Michel Foucault,
op. cit., repris in DE, vol. 4, texte nO 362.
2. Espace, savoir, pouvoir", entretien avec P. Rabinow, Skylille, mars 1982, repris in DE,
vol. 4, nO 310.
44
fois de l'accusation d'apologie du pass et de relativisme historique,
ce que Foucault fait en particulier dans l'amorce de dbat
- interrompu par la mort - avec Habermas.
Norme
* Dans le vocabulaire de Foucault, la notion de norme est lie
celle de discipline . En effet, les disciplines sont trangres au
discours juridique de la loi, de la rgle entendue comme effet de la
volont souveraine. La rgle disciplinaire est au contraire une rgle
naturelle la norme. Les disciplines, entre la fin du XVIIIe sicle et
le dbut du XIxe sicle, dfiniront un code qui sera non pas celui
de la loi, mais de la normalisation, et elles se rfreront
ncessairement un horizon thorique qui ne sera pas celui du droit
mais le champ des sciences humaines, et leur jurispmdence sera celle
d'un savoir clinique
l
.
** La norme correspond l'apparition d'un bio-pouvoir, c'est--dire
d'un pouvoir sur la vie, et des formes de gouvernementalit qui y
sont lies le modle juridique de la socit labor entre le XVIIe et
le XVIIIe sicle cde le pas un modle mdical au sens large, et
l'on assiste la naissance d'une vritable mdecine sociale qui
s'occupe de champs d'intervention allant bien au-del du malade et
de la maladie. La mise en place d'un appareil de mdicalisation
collective grant les populations travers l'institution de
mcanismes d'administration mdicale, de contrle de la sant, de la
dmographie, de l'hygine ou de l'alimentation, permet d'appliquer
la socit toute entire une distinction permanente entre le normal et
le pathologique et d'imposer un systme de normalisation des
comportements et des existences, du travail et des affects Par
pense mdicale, j'entends une faon. de percevoir les choses qui
s'organise autour de la norme, c'est--dire qui essaie de partager ce
qui est normal de ce qui est anormal, ce qui n'est pas tout fait
justement le licite et l'illicite; la pense juridique distingue le licite
. Cours du 14 janvier 1976 , op. cit.
45
de l'illicite, la pense mdicale distingue le normal de l'anormal;
elle se donne, elle cherche aussi se donner des moyens de
correction qui ne sont pas exactement des moyens de punition, mais
des moyens de transformation de l'individu, toute une technologie du
comportement de l'tre humain qui est lie celai Les
disciplines, la normalisation travers la mdicalisation sociale,
l'mergence d'une srie de bio-pouvoirs s'appliquant la fois aux
individus dans leur existence singulire et aux populations selon le
principe de l'conomie et de la gestion politique, et l'apparition de
technologies du comportement forment donc une configuration du
pouvoir qui, selon Foucault, est encore la ntre la fin du
XX
e
sicle.
*** Le problme du passage du systme juridique de la souverainet
celui de la normalisation disciplinaire n'est pas simple Le
dveloppement de la mdecine, la mdicalisation gnrale du
comportement, des conduites, des discours, des dsirs, tout cela se
fait sur le front o viennent se rencontrer les deux nappes
htrognes de la discipline et de la souverainet
2
. Au-del des
analyses historiques, principalement concentres dans les cours au
Collge de France de la fin des annes 70, le glissement du droit la
mdecine est un thme dont Foucault signale plusieurs reprises
l'actualit absolue. La question semble alors ne plus tre celle de
l' histoire de la naissance de la mdecine sociale mais celle des
modalits prsentes de rsistance la norme comment lutter contre
la normalisation sans pour cela revenir une conception
souverainiste du pouvoir? Peut-on la fois tre anti-disciplinaire et
anti-souverainiste ?
Pouvoir
* Foucault ne traite jamais du pouvoir comme d'une entit cohrente,
unitaire et stable, mais de relations de pouvoir qui supposent des
Le pouvoir, une bte magnifique , Quadel7los para el dia/ogo, nO 238, novembre 1977,
repris in DE, vol. 3, texte n 212.
2. Cours du 14 janvier 1976 , op. cit.
46
conditions historiques d'mergence complexes et impliquent des
effets multiples, y compris hors de ce que l'analyse philosophique
identifie traditionnellement comme le champ du pouvoir. Bien que
Foucault semble parfois avoir remis en cause l'importance du thme
du pouvoir dans son travail (<< Ce n'est donc pas le pouvoir, mais le
sujet, qui constitue le thme gnral de mes recherches
L
), ses
analyses effectuent deux dplacements remarquables s'il est vrai
qu'il n'y a de pouvoir qu'exerc par les uns sur les autres - les
uns et les autres n'tant jamais fixs dans un rle mais tour
tour, voire simultanment, chacun des ples de la relation -, alors
une gnalogie du pouvoir est indissociable d'une histoire de la
subjectivit; si le pouvoir n'existe qu'en acte, alors c'est la
question du comment qu'il revient d'analyser ses modalits
d'exercice, c'est--dire aussi bien l'mergence historique de ses
modes d'application que les instruments qu'il se donne, les champs
o il intervient, le rseau qu'il dessine et les effets qu'il implique
une poque donne. En aucun cas il ne s'agit par consquent de
dcrire un principe de pouvoir premier et fondamental mais un
agencement o se croisent les pratiques, les savoirs et les institutions,
et o le type d'objectif poursuivi non seulement ne se rduit pas la
domination mais n'appartient personne et varie lui-mme dans
l'histoire.
** L'analyse du pouvoir exige que l'on fixe un certain nombre de
points 1) le systme des diffrenciations qui permet ct' agir sur
l'action des autres, et qui est la fois la condition d'mergence et
l'effet de relations de pouvoir (diffrence juridique de statut et de
privilges, diffrence conomique dans l'appropriation de la richesse,
diffrence de place dans le processus productif, diffrence
linguistique ou culturelle, diffrence de savoir-faire ou de
comptence ... ) ; 2) l'objectif de cette action sur l'action des autres
(maintien des privilges, accumulation des profits, exercice d'une
fonction ... ) ; 3) les modalits instrumentales du pouvoir (les armes,
le discours, les disparits conomiques, les mcanismes de contrle,
Le sujet et le pouvoir , op. cit.
47
les systmes de surveillance ... ) ; 4) les formes d'institutionnalisation
du pouvoir (structures juridiques, phnomnes d'habitude, lieux
spcifiques possdant un rglement et une hirarchie propres,
systmes complexes comme celui de l'tat. .. ) 5) le degr de
rationalisation en fonction de certains indicateurs (efficacit des
instruments, certitude du rsultat, cot conomique et politique ... ).
En caractrisant les relations de pouvoir comme des modes d'action
complexes sur l'action des autres, Foucault inclut par ailleurs dans sa
description la libert, dans la mesure o le pouvoir ne s'exerce que
sur des sujets - individuels ou collectifs - qui ont devant eux un
champ de possibilit o plusieurs conduites [ ... ] peuvent prendre
place. L o les dterminations sont satures, il n'y a pas de relation
de pouvoir' . L'analyse foucaldienne dtruit donc l'ide d'un face
face entre le pouvoir et la libert c'est prcisment en les rendant
indissociables que Foucault peut reconnatre au pouvoir un rle non
seulement rpressif mais productif (d'effets de vrit, de
subjectivits, de luttes), et qu'il peut inversement enraciner les
phnomnes de rsistance l'intrieur mme du pouvoir qu'ils
cherchent contester, et non pas dans un improbable dehors .
*** La gnalogie du pouvoir que dessine Foucault possde la fois
des constantes et des variables. Si, partir de Platon, toute la pense
occidentale pense qu'il y a une antinomie entre le savoir et le pouvoir
(<< la o savoir et science se trouvent dans leur vrit pure, il ne peut
plus y avoir de pouvoir politique
2
), Foucault, dans le sillage de
Nietzsche, va au contraire chercher dissoudre ce mythe et
reconstruire la manire dont, chaque poque, le pouvoir politique
est tram avec le savoir la manire dont il donne naissance des
effets de vrit et, inversement, la manire dont les jeux de vrit
font d'une pratique ou d'un discours un enjeu de pouvoir. Mais si, au
Moyen ge, le pouvoir fonctionne en gros travers la
reconnaissance des signes de fidlit et le prlvement des biens,
partir du XVIIe et du XVIIe sicle, il va s'organiser partir de l'ide
1. Le sujet et le pouvoir , op. cil.
2. La vrit et les formes juridiques , op. cil.
48
de production et de prestation. Obtenir des individus des prestations
productives, cela signifie avant tout dborder du cadre juridique
traditionnel du pouvoir - celui de la souverainet - pour intgrer
les corps des individus, leurs gestes, leur vie mme - ce que
Foucault dcrira comme la naissance des disciplines , c'est--dire
comme un type de gouvernementalit dont la rationalit est en ralit
une conomie politique. Cette disciplinarisation subit son tour une
modification, dans la mesure o le gouvernement des individus est
complt par un contrle des populations , travers une srie de
bio-pouvoirs qui administrent la vie (l'hygine, la sexualit, la
dmographie ... ) de manire globale afin de permettre une
maximalisation de la reproduction de la valeur (c'est--dire une
gestion moins dispendieuse de la production). Il y aurait donc un
schmatisme viter [ ... ] qui consiste localiser le pouvoir dans
l'appareil d'tat, et faire de l'appareil d'tat l'instrument
privilgi, capital, majeur, presque unique du pouvoir d'une classe
sur une autre classe
l
de mme que le modle juridique de la
souverainet ne permet pas de rendre compte de l'mergence d'une
conomie politique, la critique politique de l'tat ne permet pas de
mettre en vidence la circulation du pouvoir dans le corps social tout
entier et la diversit de ses applications, c'est--dire aussi la
variabilit des phnomnes d'assujettissement et, paradoxalement, de
subjectivation auxquels il donne lieu.
Problmatisation
* Dans les deux dernires annes de sa vie, Foucault utilise de plus
en plus souvent le terme problmatisation pour dfinir sa
recherche. Par problmatisation , il n'entend pas la re-prsentation
d'un objet prexistant, ni la cration par le discours d'un objet qui
n'existe pas, mais l'ensemble des pratiques discursives ou non-
discursives qui fait entrer quelque chose dans le jeu du vrai et du
faux et le constitue comme objet pour la pense (que ce soit sous la
Questions Michel Foucault sur la gographie , Hrodote, nO 1, 1976, repris in DE,
vol. 3, texte n 169.
49
forme de la rflexion morale, de la connaissance scientifique, de
l'analyse politique, etc.)' . L'histoire de la pense s'intresse donc
des objets, des rgles d'action ou des modes de rapport soi dans
la mesure o elle les problmatise elle s'interroge sur leur forme
historiquement singulire et sur la manire dont ils ont reprsent
une poque donne un certain type de rponse un certain type de
problme.
** Foucault a recours la notion de problmatisation pour distinguer
radicalement l'histoire de la pense la fois de l'histoire des ides et
de l'histoire des mentalits. Alors que l'histoire des ides s'intresse
l'analyse des systmes de reprsentation qui sous-tendent la fois
les discours et les comportements, et que l'histoire des mentalits
s'intresse l'analyse des attitudes et des schmas de comportement,
l'histoire de la pense s'intresse, elle, la manire dont se
constituent des problmes pour la pense, et quelles stratgies sont
dveloppes pour y rpondre en effet, un mme ensemble de
difficults plusieurs rponses peuvent tre donnes. Et la plupart du
temps, des rponses diverses sont effectivement donnes. Or ce qu'il
faut comprendre, c'est ce qui les rend simultanment possibles c'est
le point o s'enracine leur simultanit; c'est le sol qui peut les
nourrir les unes et les autres dans leur diversit et en dpit parfois de
leurs contradictions
2
. Le travail de Foucault est ainsi reformul
dans les termes d'une enqute sur la forme gnrale de
problmatisation correspondant une poque donne l'tude des
modes de problmatisation - c'est--dire ce qui n'est ni constante
anthropologique, ni variation chronologique - est donc la faon
d'analyser, dans leur forme historiquement singulire, des questions
porte gnrale
3
.
Le souci de la vrit , Magazille littraire, n 207, mai 1984, repris in DE, vol. 4, texte
n 350.
2. Polmique, politique et problmatisation , in P. Rabinow, The Foucault Reader, op. cit.,
repris in DE, vol. 4, texte n 342.
50
What is Enlightenment? , in P. Rabinow, The Foucault Reader, op. cit. ; repris in DE,
vol. 4, texte n 339.
*** Le terme de problmatisation implique deux consquences.
D'une part, le vritable exercice critique de la pense s'oppose
l'ide d'une recherche mthodique de la solution la tche de la
philosophie n'est donc pas de rsoudre - y compris en substituant
une solution une autre - mais de problmatiser , non pas de
rformer mais d'instaurer une distance critique, de faire jouer la
dprise , de retrouver les problmes. De l'autre, cet effort de
problmatisation n'est en aucun cas un anti-rformisme ou un
pessimisme relativiste la fois parce qu'il rvle un rel
attachement au principe que l'homme est un tre pensant - de fait,
le terme de problmatisation est particulirement employ dans le
commentaire du texte de Kant sur la question des Lumires -, et
parce que ce que j'essaie de faire, c'est l'histoire des rapports que
la pense entretient avec la vrit; l'histoire de la pense en tant
qu'elle est pense de vrit. Tous ceux qui disent que pour moi la
vrit n'existe pas sont des esprits simplistes! .
Raison/Rational it
* Le terme de raison apparat initialement chez Foucault comme l'un
des deux lments du partage raison/draison qui est au cur de la
culture occidentale alors que le Logos grec n'a pas de contraire, la
raison n'existe pas sans sa ngation, c'est--dire sans l'existence de
ce qui, par diffrence, la fait tre. Ce n'est donc pas la raison qui est
originaire, mais bien la csure qui lui permet d'exister et c'est de ce
partage entre la raison et la non-raison que Foucault cherche faire
l'histoire un moment trs prcis de notre culture - quand la raison
cherche exercer une prise sur la non-raison pour lui arracher sa
vrit, c'est--dire pour tendre ce qu'elle semble pourtant exclure
les mailles de son pouvoir sous la triple forme de discours de savoirs,
d'institutions et de pratiques. Il existe donc un moment o le partage
fondateur entre la raison et la non-raison prend la forme de la
rationalit, et c'est l'application de cette rationalit dans diffrents
champs - la folie, la maladie, la dlinquence, l'conomie
Le souci de la vrit , op. cit.
51
politique -, c'est--dire galement au type de pouvoir que cela
implique, que Foucault consacre sa recherche.
** Le moment o la csure raison/non-raison prend la forme d'une
hgmonie de la rationalit correspond au XVIIe sicle occidental,
c'est--dire l'ge classique. Cette rationalisation a diffrents
visages une rationalit scientifique et technique qui devient de plus
en plus importante dans le dveloppement des forces productives et
dans le jeu des dcisions politiques, une rationalit d'tat qui impose
des formes de gouvernementalit et des procdures de contrle
complexes, une rationalit du comportement qui fixe la mesure
sociale de la norme et de la dviance etc. Foucault, en historicisant
les transformations de la rationalit moderne, la distingue
soigneusement de la raison, alors que la confusion raison/rationalit
est prcisment l'un des mcanismes de pouvoir qu'il s'agit de
dcrire; et c'est dans cette confusion, soigneusement entretenue par
le pouvoir, que s'enracine l'ide d'une raison comme lumire
despotique! , dans la mesure o le lien entre la rationalisation et
les abus du pouvoir politique est vident2 . Il y a donc une histoire
critique de la raison qui est l'histoire de la transformation des
rationalits et non pas l'histoire de l'acte fondateur par lequel la
raison dans son essence aurait t dcouverte diffrentes
instaurations, diffrentes crations, diffrentes modifications par
lesquelles des rationalits s'engendrent les unes les autres,
s'opposent les unes aux autres, se chassent les unes les autres
3
.
*** La rfrence au texte kantien sur les Lumires (Was ist
Aujkliirung ?) pousse cependant Foucault reformuler le problme
de la raison en faisant l'hypothse d'un usage autonome, mr et
critique de la raison c'est en rcuprant l'hritage des Lumires que
l'on pourra peut-tre mettre en uvre une raison qui n'a d'effet
1. Introduction G. Canguilhem, On the NO/mal and the Pathological, op. cit.
2. Prface la deuxime dition du livre de J. Vergs, De la stratgie judiciaire, Paris,
ditions de Minuit, 1981, repris in DE, vol. 4, texte nO 290.
3. Structuralisme et post-structuralisme , Te/os, vol. XVI, n 55, printemps 1983, repris in
DE, vol. 4, texte nO 330.
52
d'affranchissement qu' la condition qu'elle parvienne se librer
d'elle-mme! .
Rsistance/T ransgression
* Le terme de rsistance est prcd chez Foucault par.un certain
nombre d'autres notions charges d'exprimer une certaine extriorit
- toujours provisoire - au systme de savoir/pouvoir dcrit par
ailleurs c'est le cas de la transgression (que Foucault emprunte
Bataille) et du dehors (que Foucault emprunte Blanchot) dans
les annes 60. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de dcrire la
manire dont un individu singulier, travers un procd qui est en
gnral d'criture (d'o l'intrt de Foucault pour Raymond Roussel,
pour Jean-Pierre Brisset ou pour Pierre Rivire), russit de manire
volontaire ou fortuite tenir en chec les dispositifs d'identification,
de classification et de normalisation du discours. Dans la mesure o
il n'y a pas de savoir possible sur des objets impossibles, ces cas
littraires sotriques , par la mise en uvre d'un certain nombre
de procds linguistiques, reprsentent dans un premier temps pour
Foucault l'impossibilit de l'objectivation normative. L'abandon la
fois de la littrature comme champ privilgi et de la notion mme de
transgression correspond cependant l'exigence de poser le
problme de manire gnrale (c'est--dire galement pour les
pratiques non-discursives) et non seulement au niveau de l'action
individuelle mais en fonction de l'action collective. Le terme de
rsistance apparat alors partir des annes 70 dans un sens assez
diffrent de celui qu'avait la transgression la rsistance se donne
ncessairement l o il y a du pouvoir, parce qu'elle est insparable
des relations de pouvoir il arrive qu'elle fonde les relations de
pouvoir tout comme elle en est parfois le rsultat; dans la mesure o
les relations de pouvoir sont partout, la rsistance est la possibilit de
creuser des espaces de luttes et de mnager des possibilits de
transformation partout. L'analyse des rapports entre les relations de
La vie, l'exprience, la science , Revue de mtaphysique et de morale, 90
e
anne, nO 1:
Canguilhem, 1985, repris in DE, vol. 4, texte nO 361.
53
pouvoir et les foyers de rsistance est donc faite par Foucault en
termes de stratgie et de tactique. chaque mouvement de l'un sert de
point d'appui pour une contre-offensive de l'autre.
** Le rapport entre les relations de pouvoir et les stratgies de
rsistance n'est pas simplement rductible un schma dialectique
(comme cela tait le cas, quoi qu'en ait dit Foucault l'poque, pour
le couple limite/passage la limite qui fondait en ralit la notion de
transgression
1
), parce que la description du pouvoir s'est entre-temps
complexifie. Foucault insiste donc sur trois points la rsistance
n'est pas antrieure au pou voir qu'elle contre. Elle lui est
coextensive et absolument contemporaine
2
cela signifie qu'il n'y
a pas d'antriorit logique ou chronologique de la rsistance -le
couple rsistance/pouvoir n'est pas le couple libert/domination - ;
la rsistance doit prsenter les mmes caractristiques que le
pouvoir aussi inventive, aussi mobile, aussi productive que lui.
[ ... ] comme lui, elle s'organise, se coagule et se cimente. [ ... ]
comme lui, elle vient d'en bas et se distribue stratgiquement
3
la
rsistance ne vient donc pas de l'extrieur du pouvoir, elle lui
ressemble mme, parce qu'elle en assume les caractristiques - ce
qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas possible; la rsistance peut
son tour fonder de nouvelles relations de pouvoir, tout comme de
nouvelles relations de pouvoir peuvent, inversement, susciter
l'invention de nouvelles formes de rsistance Elles constituent
l'une pour l'autre une sorte de limite permanente, de point de
renversement possible [ ... ] En fait, entre relations de pouvoir et
stratgies de lutte, il y a appel rciproque, enchanement indfini et
renversement perptueI
4
. La description de Foucault de cette
rciprocit indissoluble n'est pas rductible un modle
simpliste o le pouvoir serait entirement considr comme ngatif et
Voir ce sujet le texte Prface la transgression", Critique nO 195-196: Hommage
Georges Bataille, 1963, repris in DE, vol. 1, texte nO 13.
2. Non au sexe roi , Le Nouvel Observateur, n 644, mars 1977, repris in DE, vol. 3, texte
nO 200.
3. Ibid.
4. Le sujet et le pouvoir ", op. cit.
54
les luttes comme des tentatives de libration non seulement le
pouvoir, en tant qu'il produit des effets de vrit, est positif, mais les
relations de pouvoir ne sont partout que parce que partout les
individus sont libres. Ce n'est donc pas fondamentalement contre le
pouvoir que naissent les luttes, mais contre certains effets de pouvoir,
contre certains tats de domination, dans un espace qui a t
paradoxalement ouvert par les rapports de pouvoir. Et inversement
s'il n'y avait pas de rsistance, il n'y aurait pas d'effets de pouvoir
mais simplement des problmes d'obissance.
*** Alors qu'au dbut de sa recherche, Foucault se posait le
problme de la possibilit de la rsistance au sein de la grille des
dispositifs de pouvoir, il en vient dans les dernires annes
renverser cette proposition. Le projet d'une ontologie critique de
l'actualit va de pair avec l'ide d'une analyse qui prendrait pour
point de dpart les formes de rsistance aux diffrents types de
pouvoir plutt que d'analyser le pouvoir du point de vue de sa
rationalit interne, il s'agit d'analyser les relations de pouvoir
travers l'affrontement des stratgies
l
.
Savoir/Savoirs
* Foucault distingue nettement le savoir de la connaissance
alors que la connaissance correspond la constitution de discours sur
des classes d'objets jugs connaissables, c'est--dire la mise en
uvre d'un processus complexe de rationalisation, d'identification et
de classification des objets indpendamment du sujet qui les connat,
le savoir dsigne au contraire le processus par lequel le sujet de
connaissance, au lieu d'tre fixe, subit une modification lors du
travail qu'il effectue afin de connatre. L'analyse archologique
mene par Foucault jusqu'au dbut des annes 70 s'occupe de
l'organisation de la connaissance une poque donne et en fonction
de classes d'objets spcifiques l'analyse gnalogique qui lui
succde essaie de reconstituer la manire dont le savoir implique la
. Ibid.
55
fois un rapport aux objets de connaissance (mouvement
d'objectivation) et au soi connaissant (processus de subjectivation).
** Le savoir est essentiellement li la question du pouvoir, dans la
mesure o, partir de l'ge classique, c'est travers le discours de la
rationalit - c'est--dire la sparation entre le scientifique et le non-
scientifique, entre le rationnel et non-rationnel, entre le normal et
l'anormal- que va s'effectuer une mise en ordre gnrale du
monde, c'est--dire aussi des individus, qui passe la fois par une
forme de gouvernement (l'tat) et par des procds disciplinaires. La
disciplinarisation du monde travers la production de savoirs locaux
correspond la disciplinarisation du pouvoir lui-mme en ralit, le
pouvoir disciplinaire, quand il s'exerce dans ses mcanismes fins,
ne peut pas le faire sans la formation, l'organisation et la mise en
circulation d'un savoir ou, plutt, d'appareils de savoir' , c'est--
dire d'instruments effectifs de cumul du savoir, de techniques
d'archivage, de conservation et d'enregistrement, de mthodes
d'investigation et de recherche, d'appareils de vrification etc. Or le
pouvoir ne peut disciplinariser les individus sans produire galement,
partir d'eux et sur eux, un discours de savoir qui les objectivise et
anticipe toute exprience de subjectivation. L'articulation
pouvoir/savoir(s) sera donc double pouvoir d'extraire des
individus un savoir, et d'extraire un savoir sur ces individus soumis
au regard et dj contrls
2
. Il s'agira par consquent d'analyser
non seulement la manire dont les individus deviennent des sujets de
gouvernement et des objets de connaissance, mais la manire dont il
finit par tre demand aux sujets de produire un discours sur eux-
mmes - sur leur existence, sur leur travail, sur leurs affects, sur
leur sexualit etc. - afin de faire de la vie-mme, devenue objet de
multiples savoirs, le champ d'application d'un bio-pouvoir.
*** La transformation des procdures de savoir accompagne les
grandes mutations des socits occidentales c'est ainsi que Foucault
1. Cours du 14 janvier 1976", op. cit.
2. La vrit et les formes juridiques , op. cit.
56
est amen reprer diffrentes formes de pouvoir-savoir et
travailler successivement sur la mesure (lie la constitution de la
cit grecque), sur l'enqute (lie la formation de l'tat mdival) et
sur l'examen (li aux systmes de contrle, de gestion et d'exclusion
propres aux socits industrielles). La forme de l'examen sera
centrale dans les analyses que Foucault consacre la naissance de la
gouvernementalit et au contrle social elle implique un type de
pouvoir essentiellement administratif qui a impos au savoir la
forme de la connaissance un sujet souverain ayant fonction
d'universalit et un objet de connaissance qui doit tre
reconnaissable par tous comme tant dj l! . Or le paradoxe tient
prcisment au fait qu'il ne s'agit en ralit pas des modifications du
savoir d'un sujet de connaissance qui serait affect par les
transformations de l'infrastructure, mais de formes de pouvoir-savoir
qui, fonctionnant au niveau de l'infra-structure, donnent lieu au
rapport de connaissance historiquement dtermin qui est fond sur
le couple sujet-objet.
Sexualit
* Le thme de la sexualit apparat chez Foucault non pas comme un
discours sur l'organisation physiologique du corps, ni comme une
tude du comportement sexuel, mais comme le prolongement d'une
analytique du pouvoir il s'agit en effet de dcrire la manire dont
celui-ci, partir de la fin du XVIIIe sicle, investit travers des
discours et des pratiques de mdecine sociale un certain nombre
d'aspects fondamentaux de la vie des individus la sant,
l'alimentation, la sexualit etc. La sexualit n'est donc dans un
premier temps que l'un des champs d'application de ce que Foucault
appelle l'poque les bio-pouvoirs. Dans un deuxime temps,
Foucault transforme cependant la sexualit en un objet d'enqute
spcifique dans la mesure o, insistant sur la manire dont le pouvoir
s'articule toujours sur des discours de vridiction c'est--dire des
La maison des fous , in F. Basaglia et F. Basaglia-Ongaro, Crimirli di pace, Turin,
Einaudi, 1975, repris in DE, vol. 3, texte nO 146.
57
jeux de vrit , ces rapports au dire vrai ne sont nulle part ailleurs
plus vidents qu' propos de la sexualit nous appartenons une
ci vilisation o l'on demande aux hommes de dire la vrit propos
de leur sexualit pour pouvoir dire la vrit sur eux-mmes. La
sexualit, bien plus qu'un lment de l'individu qui serait rejet hors
de lui, est constitutive de ce lien qu'on oblige les gens nouer avec
leur identit sous la forme de la subjectivit! . Le projet d'une
histoire de la sexualit devient donc une interrogation sur la faon
dont les pratiques et les discours de la religion, de la science, de la
morale, de la politique ou de l'conomie ont contribu faire de la
sexualit la fois un instrument de subjectivation et un enjeu de
pouvoir.
** Foucault distingue soigneusement entre sexe et sexualit
ce quoi s'est d'abord appliqu le discours de sexualit, ce n'tait
pas le sexe, c'tait le corps, les organes sexuels, les plaisirs, les
relations d'alliance, les rapports inter-individuels [ ... ] un ensemble
htrogne qui a finalement t recouvert par le dispositif de
sexualit, lequel a produit, un moment donn comme clef de vote
de son propre discours et peut-tre de son propre fonctionnement,
l'ide du sexe
2
. Si l'ide du sexe est intrieure au dispositif de la
sexualit, alors on doit retrouver son fondement une conomie
positive du corps et du plaisir c'est dans cette direction qu'ira
l'analyse de Foucault quand elle cherchera distinguer la
problmatisation de la sexualit comme aphrodisia dans le monde
grco-romain, et celle de la chair dans le christianisme.
*** La modification du projet de l'Histoire de la sexualit tel qu'il
avait tout d'abord t expos dans la prface La volont de savoir,
en 1976, peut se comprendre partir du travail effectu sur le thme
de la sexualit. Ce qui semble en effet intresser Foucault partir de
la fin des annes 70, c'est davantage le problme pos par les
techniques de soi et par la possibilit des processus de
SelCualit et pouvoir , confrence l'universit de Tokyo, 20 avril 1978, repris in DE,
vol. 3, texte nO 233.
2. Le jeu de Michel Foucault , op. cil.
58
subjectivation que l'histoire de la sexualit comme objet de
vridiction l'rotique grecque prsente la sexualit plus comme un
problme de choix que comme un lieu de vrit sur soi. Le passage
par la culture antique a par consquent permis Foucault de
dvelopper son analyse du pouvoir hors du champ de la connaissance
au sens strict - qu'il s'agisse de discours, d'institutions ou de
pratiques -, c'est--dire au contraire dans un rapport soi qui se
donne avant tout comme exprience de soi, comme ethos.
Souci de soi/techniques de soi
* Au dbut des annes 80, le thme du souci de soi apparat dans le
vocabulaire de Foucault dans le prolongement de l'ide de
gouvernementalit. l'analyse du gouvernement des autres suit en
effet celle du gouvernement de soi, c'est--dire la manire dont les
sujets se rapportent eux-mmes et rendent possible le rapport
autrui. L'expression souci de soi , qui est une reprise de
l'epimeleia heautou que l'on rencontre en particulier dans le Premier
Alcibiade de Platon, indique en ralit l'ensemble des expriences et
des techniques qui laborent le sujet et l'aident se transformer soi-
mme. Dans la priode hellnistique et romaine sur laquelle se
concentre rapidement l'intrt de Foucault, le souci de soi inclut la
maxime delphique du gnthi seauton mais ne s'y rduit pas
l'epimeleia heautou correspond davantage un idal thique (faire
de sa vie un objet de tekhn, une uvre d'art) qu' un projet de
connaissance au sens strict.
** L'analyse du souci de soi permet en ralit d'tudier deux
problmes. Le premier consiste comprendre en particulier comment
la naissance d'un certain nombre de techniques asctiques partir du
concept classique de souci de soi ont t par la suite attribues au
christianisme. Aucune technique, aucun talent professionnel ne
peut tre acquis sans pratique; et l'on ne peut pas davantage
apprendre l'art de vivre, la tekhn tau biou sans une asksis qui doit
59
tre considre comme un apprentissage de soi par soi! . Quel est
alors l'lment qui diffrencie l'thique grco-romaine de la morale
pastorale chrtienne, et n'est-ce pas prcisment dans l'articulation
du souci de soi aux aphrodisia que l'on peut comprendre ce
passage? Le second problme concerne en ralit l'histoire de ces
aphrodisia comme champ d'investigation spcifique du rapport
soi il s'agit de chercher saisir comment les individus ont t
amens exercer sur eux-mmes et sur les autres une
hermneutique du dsir dont leur comportement sexuel a sans doute
bien t l'occasion mais n'a certainement pas t le domaine
exclusif , et d'analyser les diffrents jeux de vrit l'uvre dans le
mouvement de constitution de soi comme sujet de dsir.
*** Dans l'Antiquit classique, le souci de soi n'est pas oppos au
souci des autres il implique au contraire des rapports complexes
avec les autres parce qu'il est important, pour l'homme libre,
d'inclure dans sa bonne conduite une juste manire de gouverner
sa femme, ses enfants ou sa maison. L'thos du souci de soi est donc
galement un art de gouverner les autres, et c'est pour cela qu'il est
essentiel de savoir prendre soin de soi pour pouvoir bien gouverner la
cit. C'est sur ce point, et non sur la dimension asctique du rapport
soi, que s'effectue la rupture de la pastorale chrtienne l'amour de
soi devient la racine de diffrentes fautes morales, et le souci des
autres implique dsormais un renoncement soi lors du sjour
terrestre.
Subjectivation (processus de)
60
* Le terme de subjectivation dsigne chez Foucault un processus
par lequel on obtient la constitution d'un sujet, ou plus exactement
d'une subjectivit. Les modes de subjectivation ou processus de
subjectivation de l'tre humain correspondent en ralit deux
types d'analyse d'une part, les modes d'objectivation qui
transforment les tres humains en sujets - ce qui signifie qu'il n'y a
propos de la gnalogie de l'thique: un aperu du travail en cours ,
de sujets qu'objectivs, et que les modes de subjectivation sont en ce
sens des pratiques d'objectivation; de l'autre, la manire dont le
rapport soi travers un certain nombre de techniques permet de se
constituer comme sujet de sa propre existence.
** Foucault repre dans un premier temps trois modes de
subjectivation principaux les diffrents modes d'investigation qui
cherchent accder au statut de science
1
comme l'objectivation du
sujet parlant en grammaire ou en linguistique, ou encore celle du
sujet productif dans l'conomie et l'analyse des richesses; les
pratiques divisantes , qui divisent le sujet l'intrieur de lui-
mme (ou par rapport aux autres sujets) pour le classer et en faire un
objet - comme la division entre le fou et le sain d'esprit, le malade
et l'homme en bonne sant, le brave homme et le criminel, etc.
enfin, la manire dont le pouvoir investit le sujet en se servant non
seulement des modes de subjectivation dj cits mais en en
inventant d'autres c'est tout l'enjeu des techniques de
gouvernementalit. Dans un second temps, la question de Foucault
semble se renverser s'il est vrai que les modes de subjectivation
produisent, en les objectivant, quelque chose comme des sujets,
comment ces sujets se rapportent-ils eux-mmes? Quels procds
l'individu met-il en uvre afin de s'approprier ou de se rapproprier
son propre rapport soi ?
*** C'est partir de ce dernier point que Foucault se livre par
exemple l'analyse dtaille des hupomnmata, et plus gnralement
de l'criture prive entre l'antiquit classique et les premiers sicles
de l're chrtienne dans tous les cas, il s'agit de comprendre les
modalits d'un rapport soi qui passe par la mise en pratique sans
cesse recommence d'un procd d'criture de soi et pour soi, c'est-
-dire d'un procd de subjectivation. Mais alors que pour les
hupomnmata grecques il s'agissait de se constituer soi-mme
comme sujet d'action rationnelle par l'appropriation, l'unification et
la subjectivation d'un dj-dit fragmentaire et choisi, dans le cas de
Le sujet et le pouvoir . op. cit.
61
la notation monastique des expriences spirituelles, il s'agira de
dbusquer de l'intrieur de l'me les mouvements les plus cachs de
manire pouvoir s'en affranchir' .
Sujet/subjectivit
* La pense de Foucault se prsente ds le dpart comme une
critique radicale du sujet tel qu'il est entendu par la philosophie de
Descartes Sartre , c'est--dire comme conscience solipsiste et a-
historique, auto-constitue et absolument libre. L'enjeu est donc, au
rebours des philosophies du sujet, d'arriver une analyse qui
puisse rendre compte de la constitution du sujet dans la trame
historique. Et c'est ce que j'appellerais la gnalogie, c'est--dire une
forme d'histoire qui rende compte de la constitution des savoirs, des
discours, des domaines d'objet, etc., sans avoir se rfrer un sujet,
qu'il soit transcendant par rapport au champ d'vnements, ou qu'il
courre dans son identit vide, tout au long de l'histoire
2
. Il reste
donc penser le sujet comme un objet historiquement constitu sur la
base de dterminations qui lui sont extrieures la question que pose
par exemple Les Mots et Les Choses revient alors interroger cette
constitution selon la modalit spcifique de la connaissance
scientifique, puisqu'il s'agit de comprendre comment le sujet a pu,
une certaine poque, devenir un objet de connaissance et,
inversement, comment ce statut d'objet de connaissance a eu des
effets sur les thories du sujet en tant qu'tre vivant, parlant,
travaillant.
** L'affirmation que le sujet a une gense, une formation, Une
histoire, et qu'il n'est pas originaire, a sans doute t trs influence
chez Foucault par la lecture de Nietzsche, de Blanchot et de
Klossowski, et peut-tre aussi par celle de Lacan; elle n'est pas
indiffrente l'assimilation frquente du philosophe au courant
L'criture de soi , Corps crit, nO 5 L'Autoportrait, 1983, repris in DE, vol. 4, texte
n 329.
2. Entretien avec Michel Foucault , in Microfisica dei potere : interventi politici, op. cit.,
repris in DE, vol. 3, texte nO 192.
62
structuraliste dans les annes 60, puisque la critique des philosophies
du sujet se retrouvent aussi bien chez Dumzil, chez Lvi-Strauss, ou
chez Althusser. Le problme de la subjectivit, c'est--dire la
manire dont le sujet fait l'exprience de lui-mme dans un jeu de
vrit o il a rapport soi
l
devient alors le centre des analyses du
philosophe si le sujet se constitue, ce n'est pas sur le fond d'une
identit psychologique mais travers des pratiques qui peuvent tre
de pouvoir ou de connaissance, ou bien par des techniques de soi.
*** Le problme de la production historique des subjectivits
appartient donc la fois la description archologique de la
constitution d'un certain nombre de savoirs sur le sujet, la
description gnalogique des pratiques de domination et des
stratgies de gouvernement auxquelles on peut soumettre les
individus, et l'analyse des techniques travers lesquelles les
hommes, en travaillant le rapport qui les lie eux-mmes, se
produisent et se transforment au cours de leur histoire, les
hommes n'ont jamais cess de se construire eux-mmes, c'est--dire
de dplacer continuellement leur subjectivit, de se constituer dans
une srie infinie et multiple de subjectivits diffrentes et qui
n'auront jamais de fin et ne nous placeront jamais face quelque
chose qui serait l'homme
2
. Ce lieu inassignable de la subjectivit
en mouvement, en perptuelle dprise par rapport elle-mme,
c'est la fois pour Foucault le produit des dterminations historiques
et du travail sur soi (dont les modalits sont leur tour historiques),
et c'est dans ce double ancrage que se noue le problme de la
rsistance subjective des singularits le lieu de l'invention de soi
n'est pas l'extrieur de la grille du savoir/pouvoir mais dans sa
torsion intime - et le parcours philosophique Foucault semble l
pour nous en donner l'exemple.
Foucault , in D. Huisman, Dictionnaire des philosophes, Paris, PUF, 1984, repris in DE,
vol. 4, texte n 345.
2. Entretien avec Michel Foucault , Il Contributo, 1978, op. cil.
63
Vrit/Jeux de vrit
* Alors que la philosophie moderne, depuis Descartes, a toujours t
lie au problme de la connaissance, c'est--dire la question de la
vrit, Foucault en dplace le lieu Depuis Nietzsche, la question
s'est transforme. Non plus quel est le chemin le plus sr de la
Vrit ?, mais quel a t le chemin hasardeux de la vrit
l
? . Il
s'agit par consquent de reconstituer une vrit rendue l'histoire et
exempte de rapports avec le pouvoir, et d'en identifier la fois les
contraintes multiples et les enjeux dans la mesure o chaque socit
possde son propre rgime de vrit, c'est--dire les types de
discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrais ; les
mcanismes et les instances qui permettent de distinguer les noncs
vrais ou faux, la manire dont on sanctionne les uns et les autres ; les
techniques et les procdures qui sont valorises pour l'obtention de la
vrit; le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne
comme vrai2 .
** Les analyses de Foucault ont en particulier cherch mettre en
lumire les caractristiques de notre propre rgime de vrit. Celui-ci
possde en effet plusieurs spcificits la vrit est centre sur le
discours scientifique et sur les institutions qui le produisent; elle est
en permanence utilise aussi bien par la production conomique que
par le pouvoir politique; elle est trs largement diffuse, aussi bien
travers les instances ducatives que par l'information; elle est
produite et transmise sous le contrle dominant de quelques grands
appareils politiques et conomiques (universits, mdias, criture,
arme) ; elle est l'enjeu d'un affrontement social et d'un dbat
politique violents, sous la forme de luttes idologiques . Le
problme semble par consquent tre pour Foucault d'interroger les
jeux de vrit - c'est--dire les rapports au travers desquels l'tre se
constitue historiquement comme exprience - qui permettent
l'homme de se penser quand il s'identifie comme fou, comme
1. Questions Michel Foucault sur la gographie , op. cit.
2. La fonction politique de l'intellectuel , Politique-Hebdo, 29 novembre-5 dcembre
1976, repris in DE, vol. 3, texte na 184.
64
malade, comme dviant, comme travaillant, vivant ou parlant, ou
encore comme homme de dsir. C'est pour cette raison que le
philosophe dfinit la fin de sa vie, et de manire rtrospective, son
travail comme une histoire de la vrit .
*** Le thme des jeux de vrit est omniprsent chez Foucault
partir du moment o l'analyse des conditions de possibilit de la
constitution des objets de connaissance et celle des modes de
subjectivation sont donnes comme indissociables. Dans la mesure
o cette objectivation et cette subjectivation sont dpendantes l'une
de l'autre, la description de leur dveloppement mutuel et de leur lien
rciproque est prcisment ce que Foucault appelle des jeux de
vrit , c'est--dire non pas la dcouverte de ce qui est vrai, mais les
rgles en fonction desquelles ce que dit un sujet propos d'un certain
objet peut relever de la question du vrai ou du faux. Parfois, Foucault
utilise galement le terme de vridiction afin de dsigner cette
mergence de formes qui permettent des discours, qualifis de vrais
en fonction de certains critres, de s'articuler sur un certain domaine
de choses.
Bibliographie
Livres de Michel Foucault
Maladie mentale et personnalit, Paris, PUF, 1954; red. modifie Maladie
mentale et psychologie, Paris, PUF, 1962.
Folie et draison. Histoire de la folie l'ge classique, Paris, Plon, 1961 ;
red. modifie (nouvelle prface et deux appendices) Histoire de lafolie
l'ge classique, Paris, Gallimard, 1972.
Naissance de la clinique. Une archologie du regard mdical, Paris, PUF,
1963 (red. lgrement modifie en 1972).
Raymond Roussel, Paris, Gallimard, 1963.
Les Mots et les Choses. Une archologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard, 1966.
L'Archologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
L'Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971.
Moi, Pierre Rivire, ayant gorg ma sur, ma mre et mon frre. Un cas de
parricide au x/xe sicle (ouvrage collectif), Paris, Gallimard-Julliard, 1973.
Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
Histoire de la sexualit, t. 1 La Volont de savoir, Paris, Gallimard, 1976 ;
t. II Le Dsordre des familles. Lettres de cachet des archives de la Bastille
(avec Arlette Farge), Paris, Gallimard-Julliard, 1983.
L'Usage des plaisirs, et t.1II: Le Souci de soi, Paris, Gallimard, 1984.
Rsum des cours au Collge de France, Paris, Julliard, 1989 (dsormais
repris in Dits et crits, Gallimard, 1994).
Dits et crits, Paris, Gallimard, 1991,4 vol. (d. tablie sous la direction de
Franois Ewald et Daniel Defert, avec la collaboration de Jacques Lagrange).
Il faut dfendre la socit, cours au Collge de France, 1975-1976, Paris,
Gallimard-Seuil-EHESS, 1997.
Les Anormaux, cours au Collge de France, 1974-1975, Paris, Gallimard-
Seuil-EHESS, 1999.
L'Hermneutique du sujet, cours au Collge de France, 1981-1982, Paris,
Gallimard-Seuil-EHESS, 2001.
67
fJuelques ouvrages critiques en languefranaise
L'impossible prison. Recherches sur le systme pnitentiaire au XIxe sicle
(ouvrage collectif sous la direction de Michelle Perrot), Paris, Seuil, 1980.
Hubert Dreyfus et Paul Rabinow, Michel Foucault, un parcours
philosophique, Paris, Gallimard, 1984.
Gilles Deleuze, Foucault, Paris, d. de Minuit, 1986.
Maurice Blanchot, Michel Foucault tel que je l'imagine, Paris, d. Fata
Morgana, 1986.
Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale de Paris, 9-10-
Il janvier 1988 (ouvrage collectif), Paris, Seuil, 1989.
Didier Eribon, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1991.
Penser la folie. Essais sur Michel Foucault (ouvrage collectif), Paris,
Galile, 1992.
Michel Foucault. Ure l'uvre (ouvrage collectif sous la direction de Luce
Giard). Grenoble, d. Jrme Millon, 1992.
David Macey, Michel Foucault, Paris, Gallimard, 1994.
Frdric Gros, Michel Foucault, Paris, PUF, coll, Que sais-je? , 1996.
Au risque de Foucault (ouvrage collectif), Paris, Centre Georges Pompidou,
1997.
Sommaire
Actualit ................................................................................. 5
Archologie ............................................................................ 6
Archive ................................................................................... 8
Aufkliirung .............................................................................. 9
Auteur Il
Biopolitique .......................................................................... 13
Contrle ................................................................................ 15
Corps (investissement politique des) .................................... 17
Dehors 19
Discipline .............................................................................. 20
Discours ................................................................................ 22
Dispositif .............................................................................. 24
pistm ............................................................................... 25
Esthtique (de l'existence) ................................................... 27
thique .................................................................................. 28
vnement ............................................................................ 30
Exprience ............................................................................ 32
Folie ...................................................................................... 34
Gnalogie ............................................................................ 37
Gouvernementalit ............................................................... 38
Guene ................................................................................... 40
Histoire ................................................................................. 42
Norme ................................................................................... 45
Pouvoir ................................................................................. 46
Problmatisation ................................................................... 49
RaisonlRationalit ................................................................ 51
Rsistancerrransgression ..................................................... 53
Savoir/Savoirs ...................................................................... 55
Sexualit ............................................................................... 57
Souci de soi/techniques de soi .............................................. 59
Subjectivation (processus de) ............................................... 60
Sujet/subjectivit 62
Vrit/Jeux de vrit ............................................................. 64
Aubin Imprimeur
LIGUG, POITIERS
Achev d'imprimer en avril 2002
W d'impression L 63393
Dpt lgal, mai 2002
Imprim en France
Vous aimerez peut-être aussi
- Chronique des Indiens Guayaki de Pierre Clastres (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandChronique des Indiens Guayaki de Pierre Clastres (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Schopenhauer, Nietzsche, Deleuze Par Arnaud FrançoisDocument7 pagesSchopenhauer, Nietzsche, Deleuze Par Arnaud FrançoisKyla BruffPas encore d'évaluation
- Deleuze - L Empirisme Transcendental - Anne SauvargnaguesDocument446 pagesDeleuze - L Empirisme Transcendental - Anne SauvargnaguesRemy Sarcthreeoneone100% (2)
- Deleuze La Clameur de L'êtreDocument186 pagesDeleuze La Clameur de L'êtreFLAKUBELA100% (4)
- Althusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaD'EverandAlthusser et Spinoza : Détours et retours: Avec trois textes inédits de Louis Althusser sur SpinozaPas encore d'évaluation
- Les Anormaux Michel FoucaultDocument230 pagesLes Anormaux Michel FoucaultÉric Zuliani100% (7)
- Arnaud Villani La Guepe Et L Orchidee Essai Sur Gilles DeleuzeDocument142 pagesArnaud Villani La Guepe Et L Orchidee Essai Sur Gilles DeleuzeAndrée-Ann Métivier100% (3)
- Deleuze Le Bergsonisme PDFDocument124 pagesDeleuze Le Bergsonisme PDFSalihabensala100% (1)
- Humanisme Et TerreurDocument168 pagesHumanisme Et Terreurdavid balibal100% (1)
- Le-Vocabulaire-de-Nietzsche - Copie PDFDocument63 pagesLe-Vocabulaire-de-Nietzsche - Copie PDFsecond_opportunity100% (4)
- Dits Et Ecrits I 1954 1969 Michel FoucaultDocument536 pagesDits Et Ecrits I 1954 1969 Michel FoucaultPaulo Henrique Teston100% (2)
- Histoire de La Folie À L'age Classique M FoucaultDocument295 pagesHistoire de La Folie À L'age Classique M Foucaultigoramelo100% (8)
- Gilles Deleuze Difference Et Repetition PDFDocument411 pagesGilles Deleuze Difference Et Repetition PDFRaphaël Huleux100% (5)
- Bergson (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandBergson (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Gros - Foucault, Kant Et Les LumieresDocument18 pagesGros - Foucault, Kant Et Les Lumiereskairotic100% (2)
- Cours de philosophie positive d'Auguste Comte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandCours de philosophie positive d'Auguste Comte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandTractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein - Le statut de la philosophie (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandTractatus logico-philosophicus de Wittgenstein - Le statut de la philosophie (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Foucault Dits Et Ecrits II 19701975Document852 pagesFoucault Dits Et Ecrits II 19701975Collectif Les EntropiquesPas encore d'évaluation
- Foucault Histoire de La Sexualite Vol 1 La Volonte de SavoirDocument212 pagesFoucault Histoire de La Sexualite Vol 1 La Volonte de Savoirrandom_thotz4344100% (2)
- Balibar, Cosmopolitisme Et InternationalismeDocument28 pagesBalibar, Cosmopolitisme Et InternationalismeSpinoza1974Pas encore d'évaluation
- HeideggerDocument152 pagesHeideggersiavash90100% (4)
- Deleuze Une Philosophie de L'évènementDocument130 pagesDeleuze Une Philosophie de L'évènementSelim Ben Cheikh100% (1)
- Foucault Hermeneutique Du SujetDocument19 pagesFoucault Hermeneutique Du SujetRosa O'Connor AcevedoPas encore d'évaluation
- Cathérine Clément, Lévi-Strauss Ou La Structure Et Le MalheurDocument162 pagesCathérine Clément, Lévi-Strauss Ou La Structure Et Le Malheurmaxhina100% (2)
- Actuel Marx 2012-N°52 - Deleuze GuattariDocument224 pagesActuel Marx 2012-N°52 - Deleuze GuattariHugo VezzettiPas encore d'évaluation
- Vocabulaire de Deleuze (Réalisé Par Raphaël Bessis)Document21 pagesVocabulaire de Deleuze (Réalisé Par Raphaël Bessis)Levindo PereiraPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze - Cours Sur SpinozaDocument531 pagesGilles Deleuze - Cours Sur SpinozaSangwoon Rhee100% (1)
- Derrida, J. PositionsDocument67 pagesDerrida, J. PositionsJohann HoffmannPas encore d'évaluation
- Bouveresse, Jacques-Wittgenstein, La Rime Et La Raison (VTXT)Document234 pagesBouveresse, Jacques-Wittgenstein, La Rime Et La Raison (VTXT)140871raph100% (1)
- Franck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFDocument174 pagesFranck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFEser KömürcüPas encore d'évaluation
- Cahier François JullienDocument9 pagesCahier François JullienHerne Editions33% (3)
- Marcel Gauchet Lavènement de La Démocratie, I La Révolution ModerneDocument201 pagesMarcel Gauchet Lavènement de La Démocratie, I La Révolution ModerneJacky Tai100% (1)
- Foucault Michel Dits Et Ecrits 1 1954-1969Document430 pagesFoucault Michel Dits Et Ecrits 1 1954-1969jotarelaPas encore d'évaluation
- Empirisme Et Subjectivité DeleuzeDocument82 pagesEmpirisme Et Subjectivité DeleuzeSelim Ben CheikhPas encore d'évaluation
- Worms, Frédéric - Le Vocabulaire de BergsonDocument64 pagesWorms, Frédéric - Le Vocabulaire de BergsonFar CeurPas encore d'évaluation
- Le Monde comme volonté et comme représentation: Tome ID'EverandLe Monde comme volonté et comme représentation: Tome IPas encore d'évaluation
- Le Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandLe Léviathan de Hobbes - Des causes de la génération et de la définition d'une République (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Fondements de la métaphysique des moeurs de Kant - Le règne des fins (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandFondements de la métaphysique des moeurs de Kant - Le règne des fins (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Les règles de la méthode sociologique (texte intégral de 1895): Le plaidoyer d'Émile Durkheim pour imposer la sociologie comme une science nouvelleD'EverandLes règles de la méthode sociologique (texte intégral de 1895): Le plaidoyer d'Émile Durkheim pour imposer la sociologie comme une science nouvellePas encore d'évaluation
- Philosophie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Être et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandÊtre et Temps de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Être et Temps de Heidegger - Nécessité, structure et primauté de la question de l'être (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandÊtre et Temps de Heidegger - Nécessité, structure et primauté de la question de l'être (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Durkheim (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandDurkheim (Fiche philosophe): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation
- Le Malaise dans la culture de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Malaise dans la culture de Sigmund Freud: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Protagoras de Platon - Le mythe de Protagoras (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frD'EverandProtagoras de Platon - Le mythe de Protagoras (Commentaire): Comprendre la philosophie avec lePetitPhilosophe.frPas encore d'évaluation