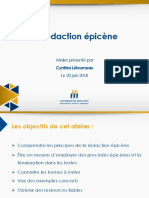Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ricoeur Esprit
Ricoeur Esprit
Transféré par
slamaCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ricoeur Esprit
Ricoeur Esprit
Transféré par
slamaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Monsieur Paul Ricur
De l'Esprit
In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrime srie, Tome 92, N2-3, 1994. pp. 246-253.
Rsum
Le terme esprit est ici employ pour dsigner le dynamisme qui anime aussi bien le dsir de vrit, la puissance d'agir dans le
champ pratique et les sentiments moraux de base. Dans les trois domaines l'esprit se manifeste d'abord par la dialectique entre
l'unit d'un acte gnrateur et la multiplicit des objets thoriques, pratiques ou thiques dans lesquels cette unit se disperse et
se rassemble. En outre, la mme pulsation se retrouve entre l'unit suprapersonnelle du dsir de vrit, de la puissance d'agir et
de la force d'aimer, et la pluralit des chercheurs de vrit, des agents de l'interaction sociale et des protagonistes de la qute de
justice.
Abstract
The term spirit is used here to refer to the dynamism which underpins the desire for truth, the capacity to act in the practical
field and basic moral feelings. In the three areas the spirit manifests itself firstly through the dialectic between the unity of a
generative act and the multiplicity of the theoretical, practical or ethical objects in which this unity is dispersed and brought
together again. Furthermore, the same movement exists between the suprapersonal unity of the desire for truth, the capacity to
act and the strength to love, and, on the other hand, the multiplicity of those searching truth, of agents of social interaction and of
protagonists in the search for justice. (Transl. by J. Dudley).
Citer ce document / Cite this document :
Ricur Paul. De l'Esprit. In: Revue Philosophique de Louvain. Quatrime srie, Tome 92, N2-3, 1994. pp. 246-253.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0035-3841_1994_num_92_2_6854
De
l'Esprit*
Je voudrais mditer en philosophe sur les authentiques attentes qui
se cachent tantt sous la formule en forme de slogan: le retour du spi
rituel, tantt sous la crainte diffuse que nourrit le spectacle contempor
ain d'une rsurgence en ordre dispers, voire anarchique, des figures
innombrables du spirituel.
Vous me permettrez de proposer votre rflexion le substantif fort,
l'Esprit, dont le spirituel est une pithte drive et plus ou moins dfra
chie. De l'Esprit, me risquerai-je intituler mon allocution. J'aimerais
montrer que l'Esprit est pressenti la fois comme un, unique, unifiant,
et comme force de dispersion dans des manifestations et des figures irr
ductiblement multiples. Cette pulsation, cette respiration qui fait tour
tour prvaloir l'Un et le Multiple se retrouve chacun des niveaux que
nous allons parcourir. Non seulement ces niveaux sont eux-mmes mult
iples,
quoiqu'
exprimant un unique Esprit, mais chacun d'eux l'Esprit
se laisse ressaisir dans l'unit de son acte par-del ou en-de des mult
iples figures dans lesquelles il se dploie et s'enveloppe.
I
En quel sens d'abord est-il lgitime de parler d'esprit propos de la
connaissance visant au vrai, telle que celle-ci s'incarne dans l'activit
scientifique la plus mthodique et la plus objective? On le peut et on le
doit, ds lors que l'on s'interroge, non sur la mthodologie des sciences
et sur les preuves de vrification et de falsification qui en assurent la
scientificit, mais sur le dynamisme qui anime le vouloir connatre. Il
apparat alors que le dsir de vrit, constitutif de la spiritualit de l'acte
cognitif, est tendu comme une flche de sens dont aucun sujet de science
ne matrise ni l'origine ni la destination. Seule la conjugaison de la
mthode reflexive et de la mthode phnomnologique permet de donner
un dbut de contenu ces deux ides qui restent deux ides direc-
* Ce texte reproduit un expos fait lors de la fte patronale de l'Universit catho
lique de Louvain, le 2 fvrier 1994. Publi une premire fois dans la revue Louvain
(fvrier-mars 1994, n 46, pp. 26-29), il a t revu par l'auteur pour ce numro spcial.
De l'Esprit 247
trices d'origine et de destination. La rflexion, d'un ct, me dit que
l'acte de penser, que l'on peut assimiler l'acte de juger, au sens d'unif
ier un divers, ne se laisse reprsenter par aucune des formes dans les
quelles cet acte s'objective. Le surplus de l'acte sur l'objet, l'arrire de
l'entreprise du savoir, laisse souponner quelque chose de l'esprit, en
tant qu'origine fondatrice de l'cart entre penser et connatre. En sens
inverse, l'analyse phnomnologique, applique la vise par laquelle
l'acte de connatre se projette hors de soi, en avant de soi, laisse entendre
que tous les systmes d'objets dans lesquels le savoir se dpose et s'arti
cule n'puisent pas non plus l'horizon de sens qui opre en quelque sorte
d'avant en arrire, comme exigence jamais sature de coordination et
promesse jamais remplie de signifiance. Ainsi, qu'il s'agisse de l'excs
de l'acte sur l'objet, l'origine du connatre, ou de l'excs de l'horizon
sur tous les systmes constitus d'objets de savoir, l'esprit qui anime le
vouloir connatre, le vouloir savoir, le vouloir dire, se rvle comme
non-objectivable, la fois en terme d'origine et en terme de destination.
J'en ai dit assez ce premier niveau, celui sur lequel se dploient
nos activits d'universitaires et de scientifiques, pour que se rvle de
faon significative ce que j'ai appel le rythme de pulsation entre l'Un et
le Multiple par quoi l'esprit se donne penser. Ce rythme revt dj ce
niveau plusieurs aspects: unit de l'acte gnrateur et de l'horizon de
signifiance, dialectiquement oppos la diversit des domaines d'objets,
des champs scientifiques, des systmes d'objets et de relations. Unit
aussi du sujet du savoir et multiplicit des sujets de la recherche du
savoir. J'insiste sur cet aspect subjectif dans la mesure o cette nouvelle
caractrisation du rythme d'unification et de dispersion de l'esprit nous
servira de transition vers d'autres niveaux opratoires de la spiritualit.
Si l'on s'interroge sur le sujet, dans lequel se resserre en quelque sorte
l'acte de juger, on peut ne faire attention qu' l'esprit impersonnel qui en
quelque sorte pense en tous et pour tous dans toute nonciation prten
dant au vrai. L'esprit tend alors s'identifier au sujet transcendantal
kantien. Mais, mme ainsi rduit au monologue, ce sujet ne s'avre
comme source de dynamisme, et non pas seulement comme garant de
formalisme, que s'il assume le minimum de personnalit requis par la
responsabilit de la volont de vrit. Mais ce n'est pas tout: le dyna
misme de recherche de la vrit engendre une histoire marque par des
avances, des ruptures, des changements de paradigmes, des intgra
tions, bref des vnements de pense, qui bien souvent portent un nom
propre qui est celui du style singulier, au sens de Granger, de la
248
Paul Ricur
dcouverte. Par ce ct historique et vnementiel, le je pense, qui
accompagne toutes les reprsentations des chercheurs individuels, se dis
tribue entre les membres d'une communaut de recherche qui a elle-
mme pour horizon, au-del de la communaut scientifique, l'humanit
entire considre comme un seul homme qui sans cesse apprend et se
souvient, selon le mot de Pascal. C'est ainsi que l'esprit un du vouloir
savoir se disperse et se rassemble dans la pluralit des chercheurs et des
dcouvreurs de vrit.
II
Je propose que nous changions de niveau et que nous passions du
plan thorique au plan pratique. vrai dire le thorique et le pratique
sont de niveau gal, comme nous le rappelle l'antique distinction entre
les transcendantaux du vrai, du bien et du beau, dont les penseurs de la
scolastique nous disaient qu'ils s'changent entre eux et sur un pied
d'galit avec l'tre. En ce sens, c'est une nouvelle configuration de l'un
et du multiple qui s'offre ici notre regard, la pense se distribuant et se
multipliant selon la diversit des transcendantaux. Cela dit, on peut tenir
l'agir humain pour l'englobant sous lequel se rangent le dire en tant que
faire, l'action ordinaire en tant qu'intervention dans le cours des choses,
le rcit en tant que rassemblement narratif d'une vie tire dans le temps,
enfin la capacit d'imputer soi-mme ou aux autres la responsabilit de
l'agir et du faire souffrir les autres agents rduits au statut de patients,
voire de victimes. H bien! sous le sigle de l'analogie de l'agir, nous
voyons tour tour se dilater et se contracter l'esprit comme pouvoir
d'agir: se dilater, selon les articulations majeures que l'on vient d'vo
quer, dire, agir, raconter, se tenir responsable etc. du champ pratique,
mais se concentrer dans la reprsentation unitive de l'homme capable.
Homo capax. Capable d'agir et de souffrir.
Quelle est, demanderez-vous alors, la marque spcifique de l'esprit
dans cette pulsation du pouvoir faire, de la capacit d'agir et de souffrir?
Franchissant htivement bien des chelons intermdiaires, en raison
de la brivet de cet expos, je me porterai d'un bond au niveau mta-
thique de l'amour, dont la qualification spirituelle est indniable. Celle-
ci se reconnat sa logique propre, qui n'est pas la logique d'quivalence
de la justice, mais la logique de surabondance de l'amour, la logique
d'une conomie du don. Mais peut-tre avons-nous t trop vite en
direction de ce sommet. C'est en rpondant quelques objections, en
De V Esprit 249
dissipant quelques malentendus, que nous allons combler l'intervalle
que nous avons franchi trop vite entre le plan d'action ordinaire, le plan
moral de l'imputation de responsabilit et ce plan potique mta-thique
du don, de la charit, de l'amour.
En effet, une apologie trop htive de l'amour ne l'exile-t-il pas dans
un spiritualisme thr, dsincarn? Le spiritualisme n'est-il pas le pige
tendu une mditation sur l'esprit?
cette lgitime suspicion, je donnerai trois rponses qui nous
feront mieux comprendre en quel sens l'esprit un et multiple retient et
dpasse tous les chelons intermdiaires entre une anthropologie de
l'agir humain et une pneumatologie de l'amour supra-thique.
Premire rponse un premier malentendu: il serait tout fait
erron de superposer l'opposition de l'esprit et de la chair, familire aux
lecteurs du Nouveau Testament, celle de l'me et du corps, dont on
connat les vicissitudes au cours de l'histoire de la philosophie. La que
relle de l'union de l'me et du corps se dploie dans l'espace de la mta
physique: son enjeu est un monisme ou un dualisme substantiel, ou
quelque mlange des deux. Tout autre est l'opposition de l'esprit et de la
chair; elle relve d'une tout autre conomie de pense: quand l'aptre
oppose les fruits de l'esprit aux fruits de la chair, il oppose deux rgimes
existentiels, deux manires d'tre au monde, si l'on peut dire, selon pr
cisment les deux logiques adverses de l'quivalence et de la surabon
dance, de l'intrt raisonn et du don. C'est de cette logique du don qu'il
va maintenant tre question pour y discerner le rythme d'unit et de plu
ralit par lequel nous avons ds le dbut caractris la vie de l'esprit.
Deuxime rponse un second malentendu, proche encore du pr
cdent. Mme si l'on carte le dualisme de l'me et du corps, ne
retrouve-t-on pas celui d'agap et d'ros, sur lequel trop de thologies
morales, mon sens, se sont difies la suite de Nygren? cette anti
thse brutale j'opposerai, de faon peut-tre aussi trop sommaire, faute
de temps, une suggestion que je retire de la lecture du Cantique des Cant
iques; la suggestion est celle-ci: ne faut-il pas tenir les trois figures
d'ros, de philia et d'agap, pour les degrs d'une unique chelle, qui
peut tre parcourue de bas en haut et de haut en bas, en vertu de la capac
it de mtaphorisation qui permet chacun de ces degrs de symbolis
er les autres. Voil l'un et le multiple de l'conomie du don. Je le dis
vite, trop vite sans doute: l'esprit n'est autre, du moins dans la dimens
ion du sentiment o nous nous tenons maintenant, que cette puissance
cratrice, gnreuse, susceptible de se dployer dans les trois niveaux de
250 Paul Ricur
l'erotique, de l'amiti et de l'amour, et de se rassembler sous la figure
unitive du don, de la donation. Esprit un du don, multiple de la triade
ros, philia, agap.
Mais j'arrive au troisime malentendu, lequel nous donnera l'occa
sion de montrer de quelle faon la puissance de l'esprit, aprs s'tre
recentre sur l'conomie du don, se diversifie, se pluralise, se disperse,
et ainsi reprend en charge les niveaux qu'elle avait dpasss en se por
tant d'un bond son sommet.
Le malentendu est le suivant: si l'esprit, dites-vous, c'est la charit,
et si la charit c'est l'aumne, l'conomie du don ne se substitue-t-elle
pas la justice? Ce que je voudrais dire, c'est ceci: loin que l'ordre de
la charit abolisse celui de la justice, il lui confre sa pleine justifica
tion. Ce que l'amour demande la justice et donne la justice d'tre,
c'est d'aller jusqu'au bout de son projet, c'est d'tre toujours plus com
pltement elle-mme. Et cela selon les multiples intentions de la justice.
La justice prtend tre universelle? Alors, qu'elle le soit effective
ment, et non pas seulement en intention et en prtention! Or, l'histoire
nous montre que c'est par des exceptions, des ruptures, des excs, des
subversions, que l'amour tourn vers les exclus des sphres historiques
de justice aide la justice briser les frontires qui d'abord la confinent
dans les limites du clan, de la tribu, du peuple, de la nation, des allis.
Le symbole de cet excs, c'est le commandement vanglique d'aimer
les ennemis: quoi de plus difficile que d'aimer celui du dehors le plus
absolu! Exigence hyper-thique, hyper-politique aussi, mais qui, par sa
puissance d'effraction, conduit la justice au terme qu'elle ne sait encore
que viser et rver, sous les noms exigeants de la paix perptuelle et du
statut cosmopolitique du citoyen venir.
Autre intention de la justice: son projet, c'est non seulement celui
de l'universalisation des normes, mais aussi celui de la singularisation
des gards dus aux personnes. Or, comment la justice se ferait-elle
quit, c'est--dire attention aux situations singulires, sans le regard sin
gularisant de l'amour, pour lequel les rles sociaux sont changeables,
certes, mais les personnes qui tiennent ces rles sont insubstituables? Et
voici l'esprit nouveau dispers dans l'altrit indfiniment multiplie
des conditions personnelles indnombrables.
Autre intention de la justice: elle voudrait bien s'lever au-dessus
du calcul utilitaire des intrts compenss o le mien et le tien sont sim
plement dpartags par la rgle de l'intrt dsintress; la justice voud
rait contribuer la cohsion du lien social et pour cela tendre vers son
De l'Esprit 251
maximum, qui serait le sentiment d'un mutuel endettement. N'est-ce pas
encore la gnrosit du don qui motive cette ambition de la justice pas
ser d'une relation instrumentale, stratgique, une relation authentique-
ment communicationnelle?
III
Me permettrez-vous, avant de conclure, de me hasarder au plan du
religieux? En un sens, avec l'ide du supra-thique, avec l'ide de
l'conomie du don, nous avons dj franchi la frontire commune la
morale et la religion. Mais on pourrait dire que nous n'avons atteint,
pour parler comme Kierkegaard, que la rgion de la potique du rel
igieux.
Il me parat difficile, ayant dcid de parler de l'esprit, de ne pas
rappeler que dans la grande tradition trinitaire de la thologie chrtienne,
l'Esprit est nomm comme la troisime personne. Et comment ne pas
dplorer que dans l'Occident chrtien, tant germanique que latin, tant
luthrien que catholique romain, les querelles christologiques et eccl-
siologiques aient oblitr la pneumatologie, au sens le plus vaste d'une
mditation sur le Saint-Esprit?
Je ne voudrais dire ici qu'une chose concernant notre thme de l'Un
et du Multiple, du centre et des marges, de l'indivision et de la disper
sion. Le Saint-Esprit, me semble-t-il, est le point focal vers lequel tout se
rassemble concernant la vie de l'esprit et partir duquel tous les rayons
se dispersent.
Ce rythme de systole et de diastole se laisse transposer, dans un
vocabulaire qui est encore celui de la philosophie, mais de la philosophie
se portant ses confins et considrant les deux cts de la limite qui
borne sa comptence argumentative, dans le vocabulaire de l'attestation
et du tmoignage.
L'attestation pointe vers l'extrme intriorit, le tmoignage il
vaudrait mieux dire les tmoignages se dploie dans l'extriorit de
l'histoire. Concernant le caractre centripte de l'attestation, je dirais
que l'hermneutique du soi en donne un avant-got en faisant de l'attes
tation la conviction intime de l'homme capable, la certitude et la
confiance, la crance et la fiance, que je peux, que je peux parler,
agir, me raconter, me tenir responsable de mes actes. C'est dans le pro
longement de cette intime conviction que la confession proprement rel
igieuse peut s'autoriser de ce que l'aptre appelle le tmoignage int-
252 Paul Ricur
rieur du Saint-Esprit. Mais le mouvement centripte de l'attestation
appelle la sanction, la vrification, l'encouragement, des tmoignages
rendus hors de nous, dans l'histoire extrieure, dans des actes, par des
tres qui rendent tmoignage, selon l'expression de Jean Nabert, au
divin: sacrifice, sublime, pardon, autant de signes disperss de la pr
sence de l'esprit l'histoire. Mais alors il ne faut pas s'inquiter de la
diversit non matrisable des mergences du spirituel, de ce que nous
appelons, avec suspicion, voire mpris, le retour du spirituel. Personne
ne domestiquera jamais l'esprit. La seule rplique donner cette
crainte, c'est la capacit pour chacun d'intrioriser les avances de
l'esprit selon ce que l'aptre Paul appelait la croissance de l'homme
intrieur. En ce qui concerne le plan institutionnel que je ne veux ni lu
der, ni majorer, l'important est qu'il subsiste des noyaux stables de la
confession de foi selon les grandes traditions tablies de la communion
des chrtiens, afin que joue de faon souple la dialectique du centre et
des marges. Le centre les centres faudrait-il dj dire ne seront ou
ne redeviendront attractifs que dans la mesure o il laisseront tre les
marges et les considreront avec respect et gnrosit.
Laissez-moi terminer par l'examen de l'apparente antinomie o tout
cela semble nous conduire. vrai dire, cette antinomie a gravement
affect les rapports non seulement entre les diffrentes confessions chr
tiennes, mais entre celles-ci et les autres religions, et finalement entre les
religieux et les non-religieux. L'antinomie est celle-ci: si je suis
convaincu que ma confession est dpositaire de la vrit, alors les autres
confessions, les autres religions et non-religions, sont fausses et ne peu
vent tre que tolres au nom de la lacit d'abstention de l'tat, lequel
est par principe (et par consentement de tous) sans religion. Je voudrais
au moins esquisser de quelle manire la rfrence l'esprit un et mult
iple peut contribuer sinon rsoudre l'antinomie, du moins l'assumer
et la vivre courageusement et si possible joyeusement sous le signe de
la reconnaissance de l'autre.
Ce quoi il faut d'abord renoncer, c'est un rapport possessif la
vrit; dire: non pas j'ai la vrit, mais j'espre tre dans la vrit.
Second pas: je ne puis esprer tre moi-mme dans la vrit sans esp
rer et sans croire que vous aussi qui ne croyez pas ce que je crois, vous
tes, d'une faon que je ne sais pas, dans la vrit. Et cette manire, je
ne puis la savoir en vertu du caractre fini, limit de toute comprhens
ion. Cette autre part de vrit, je ne puis que la pressentir, la reconnatre
latralement, de biais en quelque sorte, donc sans que je puisse compa-
De l'Esprit 253
rer du dehors, comme vues de Sirius, la croyance de l'autre et la mienne.
Il n'y a pas l de relativisme. Le relativisme suppose comparaison, sur
vol et surplomb. C'est plutt du fond de ma conviction c'est--dire de
quelque part que j'aperois latralement les autres convictions,
croyances et non-croyances. De nulle part, il n'y a plus de convictions
pour personne, mais des opinions, si diffrentes qu'elles en deviennent
indiffrentes. Ds lors, la pire manire de rencontrer l'autre, c'est
d'annuler son intention de vrit en mme temps que la mienne. Tout
dialogue disparat lorsqu'il n'y a plus confrontation, et il n'y a plus
confrontation, l o il n'y a plus conviction. Je sais que ce paradoxe, qui
a pris la place de l'antinomie, est le plus difficile tenir. Mais n'est-ce
pas cela la vrit dans la charit, don excellent de l'Esprit? L'Esprit
est un, mais nul ne sait d'o souffle le vent.
19, rue Henri-Marrou, Paul Ricur
F-92290 Chtenay-Malabry.
Rsum. Le terme esprit est ici employ pour dsigner le dynamisme
qui anime aussi bien le dsir de vrit, la puissance d'agir dans le champ pra
tique et les sentiments moraux de base. Dans les trois domaines l'esprit se manif
este d'abord par la dialectique entre l'unit d'un acte gnrateur et la multipli
cit des objets thoriques, pratiques ou thiques dans lesquels cette unit se
disperse et se rassemble. En outre, la mme pulsation se retrouve entre l'unit
suprapersonnelle du dsir de vrit, de la puissance d'agir et de la force d'aimer,
et la pluralit des chercheurs de vrit, des agents de l'interaction sociale et des
protagonistes de la qute de justice.
Abstract. The term spirit is used here to refer to the dynamism
which underpins the desire for truth, the capacity to act in the practical field and
basic moral feelings. In the three areas the spirit manifests itself firstly through
the dialectic between the unity of a generative act and the multiplicity of the
theoretical, practical or ethical objects in which this unity is dispersed and
brought together again. Furthermore, the same movement exists between the
suprapersonal unity of the desire for truth, the capacity to act and the strength to
love, and, on the other hand, the multiplicity of those searching truth, of agents
of social interaction and of protagonists in the search for justice. (Transi, by
J. Dudley).
Vous aimerez peut-être aussi
- Corrigé Croire Ou SavoirDocument5 pagesCorrigé Croire Ou SavoirLetudiant.fr100% (3)
- Chodron Pema - Entrer en Amitie Avec Soi-MemeDocument215 pagesChodron Pema - Entrer en Amitie Avec Soi-Memeeforgues564100% (2)
- Hering Phenomenologie Et Philosophie Religieuse 1925Document162 pagesHering Phenomenologie Et Philosophie Religieuse 1925Guisepp BancoPas encore d'évaluation
- Oswald Wirth L Imposition Des MainsDocument36 pagesOswald Wirth L Imposition Des Mainseforgues564100% (2)
- DH Part7 FDocument14 pagesDH Part7 Feforgues564Pas encore d'évaluation
- Code Conduite - Part2 - FDocument5 pagesCode Conduite - Part2 - Feforgues564Pas encore d'évaluation
- Guide Du Permaculteur DebutantDocument20 pagesGuide Du Permaculteur Debutanteforgues564100% (1)
- Consommation VégétarienneDocument35 pagesConsommation Végétarienneeforgues564Pas encore d'évaluation
- Code Conduite Introduction FDocument4 pagesCode Conduite Introduction Feforgues564Pas encore d'évaluation
- Rédaction Épicène PDFDocument29 pagesRédaction Épicène PDFeforgues564Pas encore d'évaluation
- DzogchenDocument44 pagesDzogchenThibaultRousselPas encore d'évaluation
- Guide Transfert de ConnaissancesDocument51 pagesGuide Transfert de Connaissanceseforgues564Pas encore d'évaluation
- GodelierDocument9 pagesGodeliereforgues564Pas encore d'évaluation
- Le Reiki, Medecine Mystique Du DR Mikao Usui MAJ 2009 - Tome 3Document133 pagesLe Reiki, Medecine Mystique Du DR Mikao Usui MAJ 2009 - Tome 3eforgues564100% (2)
- Mycoflor 2014Document16 pagesMycoflor 2014eforgues564Pas encore d'évaluation
- Le Reiki, Medecine Mystique Du DR Mikao Usui MAJ 2009 - Tome 2Document293 pagesLe Reiki, Medecine Mystique Du DR Mikao Usui MAJ 2009 - Tome 2eforgues56467% (3)
- HEGEL Leçons Sur La Philosophie de La Religion Berlin 1821 1831 Volume 1 LE CONCEPT DE LA RELIGION Pierre Garniron Paris 1996Document644 pagesHEGEL Leçons Sur La Philosophie de La Religion Berlin 1821 1831 Volume 1 LE CONCEPT DE LA RELIGION Pierre Garniron Paris 1996francis batt100% (4)
- Faut-Il Tout DemontrerDocument6 pagesFaut-Il Tout DemontrerMourad MouradbensalemPas encore d'évaluation
- Les Expressions de Puissance D'agir Chez Spinoza - Ad Captum VulgiDocument20 pagesLes Expressions de Puissance D'agir Chez Spinoza - Ad Captum VulgiAnselmo NykeyPas encore d'évaluation
- La Connaissance Metaphysique - Claudine TiercelinDocument24 pagesLa Connaissance Metaphysique - Claudine TiercelinMathieu DomingoPas encore d'évaluation
- Coach Confiance en Soi: Les Exercices Les Plus Puissants !Document16 pagesCoach Confiance en Soi: Les Exercices Les Plus Puissants !plbussacPas encore d'évaluation
- Emilio Brito SJ, Le Sentiment Religieux Selon Schleiermacher NRT 114-2 (1992) p.186-211Document26 pagesEmilio Brito SJ, Le Sentiment Religieux Selon Schleiermacher NRT 114-2 (1992) p.186-211aminickPas encore d'évaluation
- Revue PHARES - Revue Philosophique Étudiante de L'université LavalDocument11 pagesRevue PHARES - Revue Philosophique Étudiante de L'université Lavalsecretariat_17705603Pas encore d'évaluation
- Folie Et Raison PureDocument6 pagesFolie Et Raison Pureachille7Pas encore d'évaluation
- Perelman - A Filosofia Do Raciocínio PDFDocument11 pagesPerelman - A Filosofia Do Raciocínio PDFJuan ErllePas encore d'évaluation
- Edmund Husserl-Méditations Cartésiennes - Introduction A La Phénoménologie-Libraire Philosophique J. Vrin (1966)Document146 pagesEdmund Husserl-Méditations Cartésiennes - Introduction A La Phénoménologie-Libraire Philosophique J. Vrin (1966)Luz AscáratePas encore d'évaluation
- Avenir, MJ - Methodologie Sans EpistemologieDocument15 pagesAvenir, MJ - Methodologie Sans EpistemologiecomunidadcomplejidadPas encore d'évaluation
- Marxisme Et Sociologie de La ConnaissanceDocument30 pagesMarxisme Et Sociologie de La ConnaissanceLycophron100% (1)
- Ismaélisme Prophétie Razi Paul Kraus PDFDocument23 pagesIsmaélisme Prophétie Razi Paul Kraus PDFAnonymous k1NWqSDQiPas encore d'évaluation
- Yahata Keiichi Merleau PontyDocument309 pagesYahata Keiichi Merleau PontycanvellPas encore d'évaluation
- Theorie Et Experience La Raison Et Le ReelDocument4 pagesTheorie Et Experience La Raison Et Le ReelAnna MPas encore d'évaluation
- Grondin, Jean - La Conclusion de La Critique de La Raison PureDocument20 pagesGrondin, Jean - La Conclusion de La Critique de La Raison PurehighrangePas encore d'évaluation
- Le Jugement Comme Faculté PolitiqueDocument259 pagesLe Jugement Comme Faculté PolitiqueAntonio Glauton Varela RochaPas encore d'évaluation
- Biais CognitifDocument4 pagesBiais CognitifAboudramane DialloPas encore d'évaluation
- Texte de Merleau Ponty La Hardiesse de LamourDocument11 pagesTexte de Merleau Ponty La Hardiesse de LamourRené AramayoPas encore d'évaluation