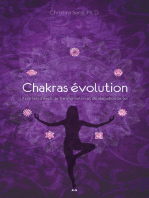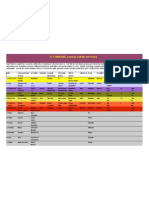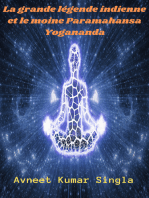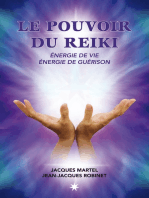Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Memoire Artaud
Memoire Artaud
Transféré par
HelmiBelgaiedCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Memoire Artaud
Memoire Artaud
Transféré par
HelmiBelgaiedDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Flicie ARTAUD
TAC 4 insas
Mmoire de fin dtudes sous la direction de
Jetty ROELS et Eric PAUWELS
Octobre 2002
Mudra dcrivant les deux dons du Guru ( professeur ):
Lacte de donner de la main droite; denseigner de la main gauche.
Bronze Nepal, XVI
eme
sicle.
LES MUDRAS. TUDE DES GESTES SACRS
Sommaire
Prface.
DFINITION ET ORIGINE DES MUDRAS:
- Dfinition des mudras : des gestes sacrs originaires de l'Inde
- Origine des mudras : la gestuelle des yogis et des prtres de l'Inde vdique
- Dveloppement des mudras : l'utilisation thrapeutique des mudras et les mudras entrent
dans la danse.
LES MUDRAS COMME GESTUELLE RELIGIEUSE :
- Introduction:
Les mudras dans l'hindouisme, le bouddhisme et le yoga
Voyage des mudras en Asie
- Les mudras dans l'iconographie religieuse :
Les mudras du Bouddha historique : de l'histoire au symbole
Les mudras du bouddhisme sotrique : sceaux qui runissent l'humain et le divin
- Faire corps et me avec le divin : tude des rites de la secte shingon
La " comprhension silencieuse " de l'enseignement sotrique
La fusion avec le Bouddha par l'esprit, le corps et la voix
Le thtre des gestes du rituel de Djo Foudo
- Conclusion
LES MUDRAS DANS LA DANSE INDIENNE :
- Introduction/
Les mudras sont-elles une langue communicante ?
L'exprience du Rasa
- La danse comme expression du " Manifeste et du Cach "
Comparaison entre la langue des mudras et le langage des signes franais
Rles du symbole et de la mtaphore dans le langage gestuel des mudras
Lart interprtatif
Faire jaillir le sens cach
- La danse comme rituel et comme prire
Origine sacre de la danse
La danse comme bhakti-yoga et nada-yoga
La danse comme rituel commmoratif
La danse cosmique de Shiva
- Conclusion
CONCLUSION GNRALE:
- Les symboles religieux dans le thtre actuel
- Faire un geste qui soit un signe
- Rgnrer le langage verbal par lexprience corporelle
BIBLIOGRAPHIE
2
3
Photo: Marie-Laure de Decker
Phnom Penh, Cambodge 1971
PRFACE :
Alors que je prparais mon sujet de mmoire cette phrase m'a frappe car je cherchais un
sujet qui me permette d'tudier le Barhata-Natyam, qui est une danse du Sud de l'Inde que j'ap-
prends depuis deux ans. La dimension mystique de l'expression veillait galement mon attention,
car un sujet qui " problmatise " la danse indienne, pouvait difficilement faire abstraction du
caractre sacr qui lui est attribue.
La premire chose que nous ayons apprise en cours de danse est le Namast, c'est--dire le salut
qui ouvre et ferme chaque moment de danse, que ce soit un moment d'apprentissage ou de
reprsentation. Le salut commence par les pieds qui frappent deux fois la terre; aprs on s'ac-
croupit, et les mains touchent alternativement le sol et les yeux ; enfin on se relve et on salue.
Ce geste est un geste de rvrence religieuse, mais aussi une manire de toucher le sol sur lequel
d'autres personnes ont accompli et pratiqu la mme danse et par l, s'inscrire dans la tradition.
Il s'agit ni plus ni moins de reconnatre l'origine et la longue filiation de la danse, les dieux qui
l'ont initie mais galement toutes les personnes qui en dansant l'ont achemine jusqu' nous, et
qui du certaine manire soutiennent l'effort de celui ou celle qui va se mettre danser.
Rflchir sur les origines et le caractre sacr dzes mudras est pour moi une prise de contact avec
l'histoire de cette danse, prise de contact d'autant plus ncessaire, que je suis loigne de la culture
indienne. Essai pour combler l'cart culturel peut-tre, mais galement pour comprendre quels
chos cette danse peut avoir avec la pratique thtrale.
4
" Nous allons maintenant accompagner la mort
et connatre de nouveau le chagrin
Nous allons danser de nouveau et terrasser les dmons
Si l'on ne sait pas d'o vient la danse
On ne doit pas en parler
Si on ignore l'origine de la danse
On ne peut pas danser. "
DFINITION ET ORIGINE DES MUDRAS
Des gestes sacrs originaires de l'Inde.
Les mudras sont des poses ou gestes des mains, vraisemblablement originaires de l'Inde qui ont t
et sont encore employes dans de multiples pratiques caractre religieux. C'est ce qui leur vaut d'-
tre nomms par les chercheurs de diffrentes disciplines comme " gestes sacrs " ou " gestes mys-
tiques " ou encore " gestes magiques " leur appellation tant bien entendu lie au rle qu'elles
dtiennent dans ces diffrentes pratiques. Ainsi parle-t'on encore de " langage symbolique " dans
les ouvrages sur la danse indienne puisqu'elles ont t dveloppes dans cet art, jusqu' devenir un
vritable langage de signes permettant de raconter des histoires. Elles se sont implantes dans d'au-
tres pays que l'Inde par le biais mme de ces pratiques, puisque l'Inde fut grande exportatrice de
disciplines spirituelles.
On les retrouve dans des arts de reprsentation, tels que la danse, mais galement la peinture et la
sculpture aussi bien que dans des pratiques spirituelles, cultes, rites, mditations. On atteste leur pr-
sence dans l'iconographie hindouiste et bouddhiste, dans les danses indiennes, balinaises, dans des
rites du bouddhisme sotrique japonais, dans les anciens cultes tantriques indiens, dans le yoga qui
fut lui-mme assimil aux pratiques de dlivrance inhrente au bouddhisme et l'hindouisme. Les
mudras ne peuvent donc tre rattaches une religion particulire mais sont lies la longue vo-
lution spirituelle de l'Inde et sa grande capacit crer, fusionner, et exporter diffrents modes
de croyance et d'expressions de ces croyances.
5
Danse de Devi. Collection prive.
L'tude prsente ne se veut pas une description exhaustive de l'emploi des mudras dans le
large domaine religieux et sacr, mais bien plutt la prise de contact avec la notion de geste sacr -
c'est--dire ce qui le dfinit et lui permet d'exister en tant que tel - en regardant des pratiques o
l'utilisation des mudras a t particulirement dveloppe, et sur lesquelles des tudes srieuses ont
t faites.
Il n'en ressortira vraisemblablement pas une dfinition unie, ni complte, de ce qu'on appelle geste
sacr, mais un corpus d'exemples et de paramtres qui permettront d'approcher plus concrtement
pourquoi on dit de ces gestes des mains- si courants par ailleurs dans notre langage quotidien- qu'ils
sont " liturgiques" ou " mystiques " ou " symboliques ". Cette approche me permettra galement
d'tudier comment les mudras font sens en tant que langue gestuelle, et d'tudier ainsi une typolo-
gie de gestes.
Origine des mudras : la gestuelle des yogis et des prtres.
Le terme de mudra se rfre une gestuelle religieuse propre la fois aux yogis et aux pr-
tres de l'poque vdique. Ces derniers auraient accompagnes leurs rcitations sacres de ces ges-
tes des mains.
L'poque vdique correspond en Inde une priode de premire formalisation des croyances reli-
gieuses par l'laboration des quatre livres sacrs des Vedas entre 1700 et 1200 avant notre re.
Quant savoir si la pratique rituelle des prtres fut antrieure ou simultane de celle des yogis, nous
l'ignorons. Les premires traces de yoga sont trs anciennes, elles remontent 2000 2500 ans
avant notre re. Cependant l'emploi des mudras dans le yoga n'est formalis que bien plus tard. On
suppose que les yogi accompagnaient et stimulaient leurs exercices de mditation l'aide de ces
positions de doigts. On retrouve d'ailleurs dans l'iconographie religieuse de nombreuses mudras de
mditation, attribues Bouddha ou diffrents dieux de l'hindouisme, ce qui laisse penser que
la pratique des yogi aurait inspir ces reprsentations.
Ce qui est remarquable dans ces premiers emplois des mudras, c'est qu'ils persistent encore de nos
jours :
" Les hymnes vdiques, surtout ceux du Sama-Veda continuent toujours tre chants et psalmo-
dis l'aide de mouvements extrmement complexes et prcis des doigts. Le mot mudra est sou-
vent associ celui de mantra, syllabe sacre renfermant la puissance vibratoire d'une divinit par-
ticulire. Signifiant au sens littral " sceau " la mudra est le pouvoir octroy la main pour " sceller
" l'action rituelle : celle-ci renferme dans le geste l'intensit d'un tat intrieur, d'une image divine,
d'une volont personnelle. Comme une sorte d'opration magique, la main cre tout un univers
dont l'origine est scelle dans le cur de l'homme. Le yogin en est l'exemple extrme lorsque sa
mudra renferme le souffle l'intrieur de son corps, donnant vie la puissante kundalini (nergie
cosmique)".( Katia Legeret Manuel Traditionnel du Bharata-Ntyam p120)
La mudra dfinie comme sceau nous apporte de prcieuses informations sur le sens et le rle de
ces gestes de main. La mudra s'excutant le plus souvent en joignant ou en fermant les doigts ou
6
* Voici la phrase exacte de Gertrud Hirshi :
" Lorsque je mditais rcemment sur la notion de " mudr ", le symbole de sceau m'est apparu avec une force particulire. Nous aussi,
nous utilisons inconsciemment un certain geste pour sceller, par exemple un accord conclu avec quelqu'un ou mme avec la conscien-
ce cosmique, ou pour donner un poids particulier une dcision. De la mme manire, nous pouvons aussi sceller quelque chose avec
nos forces intrieures : nous pouvons aussi conclure un trait avec nous-mme. Un sceau protge aussi toujours ce qu'il y a de mys-
trieux. Je ne crois pas que nous comprendrons jamais entirement l'essence d'une mudr. Car, l o il y a du mystre, on touche au
divin -de sorte que chaque mudr nous amne aussi en fin de compte une liaison spciale avec la conscience cosmique ( ou ce qu'on
appelle le divin ). " ( Gertrud Hirshi Les Mudras. Le yoga au bout des doigts. p16)
encore les mains entre elles, on comprend pourquoi ce geste renferme et scelle l'nergie dgage
par celui qui le fait. En fait, on peut remarquer comme le dit Gertrud Hirshi, dans Mudra Le yoga au
bout des doigts*, que nous faisons dans la vie de tous les jours, des gestes inconscients pour confir-
mer une dcision intrieure ou pour donner du poids une dcision particulire : un poing qui se
sert sous le coup d'une volont, ou parce qu'on marque son adhsion. Appliqu au domaine reli-
gieux, ce geste devient conscient il devient un acte rituel d'authentification. Dans son article "
Mudra, La main enchante ", Savitry Nar la dfinit ainsi :
" Elle dsigne la fois l'anneau sigillaire et le sceau et par extension tout ce qui contient la notion
d'impression : tampe, cachet, plomb. ( ) Lorsque le culte se prsente comme un rituel ou une
prire -psalmodie d'un texte ou d'une formule secrte- les mudras servent " estamper " le pouvoir
des mots et des gestes dans la reprsentation (murti) de la divinit. " (Savitry Nar " Le courrier de
l'Unesco " p34)
Ainsi non seulement la mudra scelle une nergie ou une dcision intrieure par une action physique,
mais elle est galement signe authentique de son pouvoir et du pouvoir des sons. On retrouve ce
double aspect de la mudra dans son quivalent japonais. Le mot " In " signifie galement sceau et
englobe la fois les gestes des mains et les formules qui accompagnent les rites. Enfin, tout comme
le sceau authentifie un document, la mudra exclut toute possibilit de mensonge. Elle est selon
Ingrid Ramm-Bonwitt comme un contrat conclu entre le croyant et la divinit. ( Mudras. Le langage
secret des yogis p245).
Tout ceci nous claire sur le rle que devait dj avoir pour le prtre de l'poque vdique l'utilisa-
tion conjointe des mudras et des rcitations sacres, que ce soient des mantras ou les textes sacrs
des Vedas.
De par son origine, on voit que les mudras sont relies des pratiques spirituelles et non
une religion dtermine. En effet, l'poque vdique n'est encore qu'une priode de balbutiement
de l'hindouisme, o les croyances des migrants indo-europens fusionnent lentement avec les
croyances et cultes des peuples indignes.
Selon Jacques Dupuis, le vdisme est une " religion de rites ", rites qui sont avant tout des rites de
purification qui permettent d' " approcher le divin " et de " se propitier les Dieux " (Jacques Dupuis
L'Inde. Une introduction la connaissance du monde indien. p114). Ces rites ne correspondent pas des
concepts moraux -offense ou non l'ordre moral - mais des concepts d'ordre mtaphysique :
" Le divin est pur dans son ensemble ; il s'oppose en tant que tel l'humain. Les hommes sont
impurs en raison de leur caractre prissable et de leur activit () On a trouv depuis longtemps
des moyens rituels de purification, qu'il ne faut point confondre avec le pardon et la rmission des
pchs en Occident. Tels sont notamment l'ascse, les bains en des lieux dtermins, la rcitation
de certaines formules magiques ". ( Jacques Dupuis p112-113).
Les mudras sont donc vraisemblablement utilises dans ce cadre rituel, le prtre rcitant les man-
tras (formules magiques) en adoptant une position fixe des mains, ou en passant d'une position
l'autre au gr des mots ou plutt des sonorits.
Cette attitude qui permet de convoquer la divinit par le mot et par le geste nous voque le com-
portement chrtien de prire : quand le prtre invite les croyants rciter le " Notre Pre " pendant
l'office religieux, il ouvre les mains vers l'assemble, les joint en signe de prire pendant la rcita-
tion, et les ouvre de nouveau la fin de celles-ci. Ces mouvements prcisent bien son rle d'inter-
mdiaire entre les croyants et Dieu : il se met en contact avec les croyants par le premier geste, et
se relie Dieu par le geste ascendant des mains jointes.
La mudra pratique par le prtre l'poque vdique, tout comme le geste du prtre pendant la
messe n'est pas pratique dans un lieu indiffrent, ni par une personne indiffrente. Cette prdo-
minance du prtre comme dtenteur du savoir et du pouvoir est trs importante dans la religion
7
primitive des rites puisque " les textes sacrs, les rites, les formules magiques (mantra) taient consi-
drs comme un matriel contenant un norme pouvoir et dont la manipulation par des officiants
inexperts pouvait tre trs dangereuse. De ce matriel religieux, dpend en effet le Dharma ou l'or-
dre du monde, et toute erreur de manipulation pouvait entraner des cataclysmes mtoriques, des
mauvaises rcoltes et des famines, des guerres, l'effondrement des royaumes. On comprend ainsi
que les fonctions religieuses aient toujours t considres comme rserves une lite et que les
Brahmanes aient essay de s'en assurer le monopole. "( Jacques Dupuis p136)
Si les mudras taient automatiquement associes la rcitation des mantras, comme on le suppose,
ces gestes devaient relever eux aussi d'une connaissance et d'un pouvoir dont le peuple tait priv.
Il pouvait en bnficier par l'intermdiaire du prtre mais non pas s'en servir comme moyen per-
sonnel de communiquer avec les Dieux. Reginald Massey crit dans son livre sur la danse Kathak ,
que les professeurs Brahmines ne voulaient pas que le savoir tombe dans de mauvaises mains, ce
qui expliquerait l'expression allgorique des textes sacrs ainsi que l'existence des mantras, qui
devaient tre interprts par des experts.
Cette prcision sur le caractre magique et dangereux du matriel religieux nous donne un autre
point de vue sur l'emploi conjoint des mudras et des mantras. Leur caractre cod servirait assu-
rer le ct secret et magique, dont l'usage et la comprhension auraient t rservs aux prtres. Le
peuple pouvait en recevoir les bnfices mais ne pouvait pas en pntrer le sens exact.
l'poque vdique, les yogis se trouvaient gnralement dans les castes des Brahmanes et
des Kshatryas (respectivement castes des dtenteurs du savoir religieux et des guerriers).
Cependant, cette pratique devait tre ouverte tous sans considration de caste. On a vu que
Jacques Dupuis cite l'ascse parmi les rites de purification, le yoga est donc li au vdisme mais cer-
tainement pas comme une pratique sacerdotale. Le yoga devait tre une qute spirituelle, une
recherche personnelle de ralisation intrieure, d'une illumination.
Le yoga signifie littralement " union " et vise la fusion de l'me individuelle dans l'me universel-
le, ou brahman. Le stade ultime de la pratique yogique est le samhdi, tat de concentration parfai-
te, o la conscience subjective est vide, les contradictions apparentes de l'existence sont dpasses,
et o celui qui mdite et l'objet de sa mditation ne font qu'un. Selon Patanjali, qui est le premier
en avoir formalis les principes, le yoga est l'effort pour atteindre la perfection par la matrise du
corps, des sens et de l'esprit. Dans les yoga-sutras ( IV-Vme sicle), il dcrit des moyens indirects
et directs de parvenir la dlivrance : cela va de rgles lmentaires de vie, la pratique de divers
types mditations, en passant par des postures physiques et des exercices de respiration, le dernier
type de mditation menant au samdhi. Patanjali ne parle pas des mudras, mais on peut imaginer
que l'exercice des mudras devait faire partie la fois des exercices de mditation et des postures cor-
porelles.
Or ce qui rend l'tude complique en cette matire, c'est que les mudras dsignent en yoga tout
autant les postures corporelles, les exercices de respirations, les bhandas (ou ligatures) que les posi-
tions de mains. Les premiers traits qui parlent de mudras sont ceux du Hatha-yoga, qui formulent
tardivement des positions corporelles qu'on trouvent prsentes dans de trs anciennes sculptures et
dans les plus anciens traits comme les Vedas. Les mudras qui sont dcrites dans le Hatha-yoga-pra-
dipika ou la Gheranda-Samhita sont des exercices qui mlent toutes ces utilisations du corps. Des
positions spcifiques des mains y sont prsentes ou non, et ne semblent pas majoritaires.
Ces exercices sont des mudras au sens o ils doivent sceller le prana (souffle, nergie vitale) l'in-
trieur du corps. Cette nergie vitale qui se trouve la racine de notre colonne vertbrale, doit donc
tre concentre l'intrieur du corps, pour remonter le long de la colonne, travers les chakras.
Quand elle culmine dans le plus haut chakra, celui de la conscience cosmique, elle se transforme en
nergie spirituelle et donne lieu la Kundalini (nergie cosmique). Pratiquement, elle s'obtiendrait
8
9
travers diffrents exercices de stimulation de organes vitaux et notamment les organes sexuels,
puisque c'est dans cette rgion qu'est cense reposer la force lmentaire.
Cependant, certaines coles ont dvelopp un yoga de la Kundalini et ont attribu un rle plus
important la main. Selon Lothar-Rdiger Ltke " le yoga de la Kundalini part du principe que
chaque zone de la main est une zone reflexe correspondant une partie du corps et du cerveau. De
cette manire, nos mains deviennent un miroir du corps et de l'esprit." ( Lothar-Rdiger Ltke
Kundalini p 69*).
Cette vision de la main en relation avec tout le corps se retrouve d'ailleurs dans la mdeci-
ne indienne et dans les rituels bouddhistes sotriques comme nous le verrons plus tard. Dans le
yoga de la Kundalini, les mudras des doigts sont en lien avec une posture et en renforcent l'effet.
La concentration du prana (nergie vitale) l'intrieur du corps apporte un double clairage sur les
sens du mot yoga et du mot mudra. Yoga signifie la fois l' " union " et " tre uni ". La pratique
yogique permet d'tre uni en soi et de s'unir au Soi, l'nergie cosmique et ceci grce une action
de connexion qui est le sceau.
Cependant, il est toujours difficile de dire si le sens du mot mudra qui se dgage de la pratique yogi
a initi le mot mudra comme position des mains, ou si ce sont les mudras positions des mains qui
ont donn leur appellation une pratique corporelle plus vaste. Il n'est pas de mon ressort de
rpondre. On peut seulement dire que c'est la pratique des yogis des temps anciens qui est l'ori-
gine d'un certains nombres de postures corporelles et de gestes des mains du yoga actuel et de dif-
frentes pratiques de mditation.
La Dhyana-mudra, la Jnana-mudra ou la Chin-mudra sont des positions des mains associes la
mditation. Ces positions des mains rsultaient vraisemblablement d'tats particulirement inten-
ses, de moments o ces yogis se trouvaient proches de l'illumination qu'ils recherchaient. Faisant le
chemin en sens inverse, on utilise ces positions pour retrouver cet tat, ou en les utilisant de mani-
re symbolique pour signifier cet tat. C'est pourquoi on les retrouve dans les sculptures pour sym-
* Cette phrase est cite par Gertrud Hirshi dans Les Mudras. Le yoga au bout des doigts p16.
Zones rflexes de la main dans le Kundalini-Yoga.
boliser la mditation de Bouddha, et plus largement la sagesse de nombreux dieux bouddhiques et
hindous.
La pratique ancienne des yogis devait d'ailleurs rsider dans une
recherche empirique, o la seule rgle tait l'exprimentation.
Gertrud Hirshi explique concrtement cette dmarche : " Les
yogis savaient depuis longtemps comment de nombreux tats
d'me tels que la tristesse, la joie, la colre, la placidit,etc. s'ex-
priment dans les gestes et les attitudes du corps et comment inversement, la psych peut tre
influence positivement par certains gestes ". (Les mudras. Le yoga au bout des doigts. p 20)
Cette liaison du corps et de l'esprit visible dans les
dbuts du yoga va alimenter la pratique des mudras autant dans
les rituels religieux que dans la danse. L'exportation des mudras
dans les pays de toute l'Asie est peut-tre tout autant l'exporta-
tion de symboles religieux que l'exportation de cette pense de la
liaison intime entre le physique et le spirituel.
Dveloppement des mudras : l'utilisation thrapeutique des mudras; et les mudras entrent dans la
danse.
Il n'est pas indiffrent que les mudras soient galement
employs de manire thrapeutique afin de remdier aux insuffi-
sances et aux maladies.
Dans la mdecine indienne comme dans la mdecine chinoise, les
pieds et les mains sont en troite relation avec les organes prin-
cipaux. Ce qui est d'ailleurs l'origine de mthodes de gurison
chinoise que nous connaissons en Occident : l'acupuncture et l'a-
cupressure. Dans les mudr, le contact d'un doigt avec certains
points de la main, permet de presser ou de stimuler les organes correspondant comme on pourrait
le faire par l'acupuncture ou l'acupressure.
Dans l'ayurveda (mdecine ancienne indienne), chaque doigt de la main correspond un chakra de
la colonne vertbrale et un des cinq lments. Le dysfonctionnement d'un chakra qui est aussi pr-
sence insuffisante d'un lment dans le corps, peut mener un drangement corporel ou mental.
Gertrud Hirshi explique bien le rapport entre maladie et lment quand elle dit :
" Les gurisseurs hindous considrent chaque maladie comme une dysharmonie dans le corps de
l'homme. La gurison peut avoir lieu partir du moment o l'quilibre est rtabli. Ils avaient com-
pris que la conscience cre la maladie et qu'elle est une nergie qui se manifeste selon cinq princi-
pes fondamentaux ou lments. Si l'un des lments est trop ou pas assez reprsent, une dyshar-
monie se cre (la maladie), la sant est rtablie si l'on prend des mesures appropries. " (Les mudras.
Le yoga au bout des doigts p48)
Ingrid Ramm-Bonwitt dcrit cette interaction en donnant un exemple :
" La jonction du pouce et du petit doigt permet
le retour de l'lment eau au sein du corps. Le
manque de cet lment se manifeste par une
bouche sche, des yeux rouges et secs et un
mauvais fonctionnement des reins. Par ailleurs,
le got est galement stimul par cette mudr. "
(Mudras. Le langage secret des yogis p238)
10
Chin-mudra
Chakras du corps.
Les personnes qui, comme Gertrud Hirshi se sont penches sur les capacits thrapeutiques des
mudras, se sont videmment appuyes sur de telles thories. Les cinq lments refltent des prin-
cipes physiques et psychiques qui agissent sur le corps. Ils sont comme les chakras, des " images "
de processus physiologiques, nergtiques et psychiques concrets. La mudras n'agit donc pas seu-
lement sur des reprsentations mais vraisemblablement sur le corps.
Pour finir, il me faut parler de la danse indienne qui existait vraisemblablement sous une
forme ou sous une autre aux temps vdiques. Les plus anciennes traces de la danse remontent
comme celles du yoga 2000 ou 2500 ans avant notre re : ce sont les fouilles du Mohenjo-Daro
qui permirent de dcouvrir des sculptures montrant des attitudes de danse et des postures propres
au yoga.
Dans les Vedas se trouvent de nombreuses allusions aux divinits qui dansent et l'on pense que la
danse tait associe aux rites religieux. Si les mudras sont prsentes dans la danse indienne, elles le
doivent vraisemblablement cette promiscuit entre danse et rite, une transfusion de la gestuelle
des prtres dans la danse. Peut-tre nous est-il mme permis de penser que ce sont l'origine les
prtres qui dansaient.
Dans le Natya-Shastra, premier trait de danse et cinquime Veda selon les Indiens, ces positions
de mains sont dcrites. Le Natya-Shastra a t compos entre le 1er sicle avant et le 5me sicle
aprs notre re, une poque o la danse, la musique et le thtre tait en plein essor dans le sous-
continent indien. Il devait fixer des pratiques qui taient en usage et en laboration progressive
depuis bien longtemps.
Ce tour d'horizon m'a permis de comprendre que les diffrents emplois des mudras com-
prennent trois aspects fondamentaux du geste sacr, qui sont l'origine indissolublement lis : dans
les socits primitives, le geste rituel est la fois religieux, dramatique et thrapeutique.
Les phnomnes de transe, que ce soit dans le chamanisme ou dans les rites de possession, appa-
raissent en ce sens comme relativement caractristiques : l'homme ou la femme qui est possd
entre en communication avec un esprit (c'est le religieux), moyennant quoi il manifeste une attitu-
de singulire, se dplace et agit pour un moment comme l'esprit et ceci sous le regard de la com-
munaut : c'est l'aspect dramatique ou thtral. Enfin, entrent en transe des personnes particulires
: pour les communauts concernes ce sont des tres lus, pour nous ce sont des personnes qui en
" ont besoin ", parce qu'elles prouvent un dsquilibre qui peut trouver une rsolution dans la
transe. A travers cette catharsis, l'individu expulse des tensions qui sinon, seraient insupportables
mais il libre galement la communaut qui reoit les bnfices de cette transe. C'est l'aspect thra-
peutique.
Les mudras permettent de communiquer avec les Dieux dans les rituels. Elles ont une fonction dra-
matique dans les danses indiennes, puisqu'ils s'adressent une communaut de spectateurs. Elles
sont thrapeutiques dans le yoga ou la mdecine. Si la mudra peut nous apparatre comme un geste
polic par rapport la transe, un geste qui se serait progressivement affin et civilis, elle a gard
les fonctions multiples des gestes primitifs, fonctions qui se sont cristallises dans les domaines de
l'art, de la religion et de la mdecine. Cependant, la mudra garde des traces vivaces de cette liaison
entre le religieux, le thtre et le soin.
Mon intrt pour les rapports entre langage gestuel et production du sens me portera tudier le
domaine religieux et le domaine thtral de manire privilgie, mme si un dtour sur les fonctions
thrapeutiques de la main me semble bien clairer ce qui va suivre. J'tudierai donc les mudras
comme gestuelle religieuse puis comme gestuelle thtrale tout en suivant le fil rouge du " geste
sacr ".
11
LES MUDRAS COMME GESTUELLE RELIGIEUSE, UNE INTRODUCTION
Les mudras dans l'hindouisme, le bouddhisme et le yoga.
L'utilisation des mudras par les prtres vdiques nous apprend que ces gestes sont des "
sceaux " et qu'ils accompagnent la rcitation des mantras. Cette association mantra-mudra est enco-
re prsente aujourd'hui dans les pratiques religieuses hindouistes, mais galement dans le boud-
dhisme tibtain, japonais et dans les cultes hindouistes et
bouddhiques de Bali. L'excution des mudras et la pro-
nonciation des mantras participent de rites, qui comme on
va le voir, visent la fusion avec l'esprit divin, ou suprme.
Elles sont donc en troite relation avec la pratique yogique,
qui par sa dfinition mme est recherche de l'union. Le
yoga originaire de l'Inde s'est en effet, intiment mlang
avec les pratiques de mditation et les rites de ces religions.
On retrouve ainsi des points de ressemblance entre le yoga
et mais galement entre le bouddhisme et l'hindouisme..
Dans cette image, on voit un prtre hindouiste de Bali faire
le Prana-yama qui est un exercice de respiration du Hatha-
Yoga : il s'agit de fermer une narine avec les deux doigts
(formant ainsi une mudra) et d'inspirer avec l'autre narine.
Il faut ensuite retenir son souffle, puis boucher la deuxi-
me narine afin d'expirer par la premire. Cet exercice de
respiration vise l'acquisition de pouvoirs psychiques. Pendant la crmonie le prtre balinais fait
seulement le geste sans respirer.
12
LES MUDRAS COMME GESTUELLE RELIGIEUSE
Avalokiteshvara ( saint bouddhique )
Bronze argent, dor.
Jakarta VIII
eme
, IX
eme
sicle.
Il existe galement des points de ressemblances entre les
pratiques bouddhiques et hindouistes. A Bali toujours, on
remarque que les rites de prtres bouddhiques et des prtres
shivastes sont proches. La base en est l'utilisation conjointe
des mantra et mudr, un certain nombres d'instruments de
culte, et videmment le but poursuivi, mme si dans un cas la
recherche de fusion s'exprime en direction du Bouddha Varochana, (Bouddha du savoir sot-
rique) et dans l'autre en direction de Shiva ( un des principaux dieux hindous) .
Si le bouddhisme a pu tre considr comme une alternative religieuse l'hindouisme et
vraisemblablement au pouvoir brahmanique, il n'en reste pas moins qu'il a comme terre d'origine
l'Inde et qu'il s'est difi partir des conceptions mtaphysique de la civilisation brahmanique. Au
VIme sicle avant notre re, Gautama Bouddha prenait la voie de nombreux renonants de son
poque, afin de dcouvrir le secret de la cessation de la douleur. L'ide que l'existence est assujettie
au cycle sans fin des renaissances, et qu'il faut s'en librer parce que toute vie est souffrance, tait
videmment une conception de l'Inde brahmanique. Aujourd'hui, les pratiques rituelles qui visent
la fusion avec le divin, sont aussi des moyens de s'abstraire de ce cycle de renaissances et d'attein-
dre la dlivrance. Jacques Dupuis explique ainsi cette proximit de dpart entre les deux religions:
"Sauf pour les brahmanes, la question d'un choix entre le bouddhisme et brahmanisme ne se posait
pas nettement () La vrit est que le bouddhisme n'a jamais interdit ses fidles de pratiquer une
autre religion. Ceci nous explique que dans la ralit les bouddhistes sont aussi des hindous et que
lorsque la doctrine du Bienheureux s'est rpandue en dehors d'Inde, en Chine au Japon, Ceylan,
en Asie du Sud-Est (o elle a t largement remplace par l'islam), ce type de co-existence poly-
morphe a survcu. " ( Jacques Dupuis Une introduction la connaissance du monde indien p 131).
En Inde, bouddhisme et brahmanisme sont donc mutuellement influencs jusqu' ce que le boud-
dhisme disparaisse du pays au XIIme sicle.
Ce qui dmarquait le yoga et le bouddhisme des origines, du brahmanisme, tait l'absence de
croyance dans les divinits, la mditation devant mener une union avec l'esprit cosmique et non
avec un dieu particulier. Le bouddhisme va cependant voluer au fil du temps : c'est ainsi qu'appa-
ratront de nombreuses divinits comme nous allons le voir.
Le voyage des mudras en Asie.
Le voyage des mudras dans les pays d'Asie est probablement du la formidable extension
de la religion bouddhique vers le Sud et vers le Nord de l'Asie. Ds le 1er sicle de notre re, les
prtres bouddhistes vont Ceylan, en Birmanie, en Thalande au Cambodge et en Indonsie pour
enseigner la Loi bouddhique. Ils parviennent galement en Chine o le bouddhisme connatra un
grand panouissement, ce qui permettra enfin sa propagation en Core et au Japon.
C'est aussi aux premiers sicles de notre re que l'image canonique du Bouddha se constitue : elle
est reprsente, sculpte dans des uvres architecturales et artistiques. Les mudras devaient appa-
ratre dans ce cadre -hormis celui des rituels qui devaient galement tre transmis- puisque elles ser-
vaient raconter les pisodes les plus clbres de la vie de Bouddha. Les mudras du Bouddha sont
intressantes car elles sont censes imiter des gestes faits par le Bienheureux : elles servaient ainsi
rpandre l'enseignement bouddhique et vhiculer les plus importants symboles de cette religion.
Le symbolisme inhrent aux mudras fut sujet de nombreux dveloppements puisque le boud-
dhisme ne se prsente pas comme un corpus de dogmes bien tablis et qu'il prit des voies diverses,
suivant les coles et les lieux.
13
Union de lhomme et du dieu Shiva.
En effet, quelques sicles aprs la mort de Bouddha, des dissensions apparurent au sein de
la communaut monastique bouddhique, ce qui provoqua la cration de diffrentes coles ou sec-
tes. Cet clatement marque au dbut de notre re un renouvellement des conceptions bouddhiques.
C'est le tournant doctrinal du Mahyna, qualifi par ses adeptes de " Grand moyen de progression
vers le salut ". A l'idal du renonant qui ne peut obtenir la dlivrance que par la voie rmitique,
le Mahyna substitue en effet la figure du Boddhisattva (ou saint bouddhique) qui uvre dans ce
monde pour le salut de tous les tres. Le bouddhisme devient alors une religion btie sur la foi et
la dvotion : chaque tre humain participe de la " bouddhit " et peut raliser la " nature de boud-
dha " qui est en lui. Cette volution est marque par la divinisation du Bouddha qui tait consid-
r l'origine comme un simple mortel, saint peut-tre, mais humain. Et avec cette divinisation, la
cration d'un vritable panthon bouddhique : les nombreux bouddhas apparaissent alors comme
les ralisations de divers moments caractristiques de la carrire du seul et unique Bouddha.
Varochana, Amithba sont de ces bouddhas qui jouissent alors de cultes divers, tout comme de
nombreux boddhisattvas : ils vont tre reprsents eux aussi avec des gestes codifis, soit qu'ils
empruntent les mudras du Bouddha historique, soit qu'ils aient des gestes spcifiques.
C'est le bouddhisme du Mahyna qui fut export en Chine et au Japon, et qui est aujourd'hui majo-
ritaire.
Mon tude portera d'abord sur les mudras dans l'iconographie bouddhique et notamment
les mudra qui racontent la vie de Bouddha. Des comparaisons avec les mudras hindoues et la ges-
tuelle chrtienne permettront de rflchir sur les codes du vocabulaire gestuel et sur les processus
de symbolisation. L'tude de ces mmes mudras dans les coles bouddhiques japonaises, et parti-
culirement la secte shingon fera apparatre de manire plus prcise, la dfinition de la mudra
comme sceau, ces positions des mains reliant l'humain et le divin d'une part et organisant l'unit au
sein de l'homme d'autre part. Ceci nous amnera logiquement aux mudras des rituels, et nous com-
prendrons alors quel rle mudras et mantras ont, dans ce dsir de fusion avec le divin.
14
15
LES MUDRAS DANS L'ICONOGRAPHIE RELIGIEUSE.
Dans les reprsentations iconographiques, les mudras permettent d'exprimer la nature et
la fonction des divinits. Dans le cas de l'art bouddhique, elles furent d'abord employes afin d'-
voquer la geste de Bouddha. Elles " forment un vocabulaire symbolique, d'emble intelligible pour
le dvot, et associ aux attitudes canoniques admises pour la reprsentation du Bienheureux "
(ABCdaire du Bouddhisme p22). Ainsi, de clbres pisodes de l'existence de Bouddha peuvent tre
relats : mditation sous l'arbre de Bodhi, prise tmoin de la Terre, premier prche Sarnath
Ces reprsentations ont servi l'expansion du Bouddhisme dans les pays d'Asie, puisqu'elles met-
taient en images les rcits et lgendes transmis par les prtres. On retrouve ici la mme vocation
que dans l'iconographie chrtienne : l'image tait cense se substituer aux textes auxquels n'avait pas
accs les gens du peuple, elle assurait ainsi la transmission religieuse.
Dans le mme temps, l'attitude donne par la main exprime un concept religieux : en effet, chaque
fait de la vie de Bouddha dessine une conduite spirituelle, un rapport au monde et aux hommes
dont le croyant peut s'inspirer. Ces concepts sont devenus plus labors dans les sectes sotriques
parce que ces sectes attribuent aux mudras du Bouddha historique un sens complexe, correspon-
dant une vision cosmique et religieuse qui leur est propre.
Dans le domaine sotrique l'emploie du symbole est plus radical que dans le domaine exot-
rique*1. Dans Langage des signes, Georges Jean crit propos des sciences occultes : " Le symbole ne
se contente pas d'tre le signe de la chose ou de l'ide qu'il reprsente, il prtend s'y substituer. Il
devient la chose elle-mme " ( Georges Jean p124).
En effet, l'emploi des mudras dans la secte japonaise shingon montre que ce n'est pas la pose de
la main qui voque l'attitude du Bouddha, mais bien le Bouddha qui est dj symbolis dans la main.
Du coup, le signe n'voque pas seulement le Bouddha, d'une certaine manire, il le ralise.
L'tude de l'iconographie bouddhique est intressante de ce fait, car on peut y observer
comment les mudras primitivement relis la vie du Bouddha historique sont interprtes de
manire de plus en plus conceptuelle. Ceci a vraisemblablement voir avec les dveloppements
spculatifs du Mahyna et la cration de diffrentes figures de vnration. Les mudras seront donc
d'abord expliques par rapport l'histoire du Gautama Bouddha, puis selon l'interprtation qu'ont
pu en faire les sectes du Mahyna, et en particulier la secte japonaise shingon, secte particulire-
ment prodigue dans l'emploi des mudras, et particulirement labore dans le sens qu'elle leur attri-
bue.
Les Mudras comme moyen de raconter la vie de Bouddha : de l'histoire au symbole.
Dans la Bhmishparsha-mudra, on voit le Bouddha
toucher le sol de sa main droite : c'est la mudra de prise tmoin
de la terre. Elle correspond au moment o Bouddha dcide de
mditer jusqu' ce qu'il trouve le secret de la cessation de la dou-
leur. Il prend la terre tmoin des mrites qu'il a accumuls lors
de ses prcdentes incarnations. La tradition dit galement qu'il
prit la terre tmoin, face au dmon tentateur Mara, qui lui dis-
ait que mme le bout de terre sur lequel il tait assis ne lui appar-
tenait pas. La terre rpond suivant les rcits, en proclamant que
Gautama Bouddha de par ses expriences passes a le droit de
s'asseoir sur " le trne de diamant " ou en envoyant une arme
de divinits qui tuent les dmons de la horde de Mara.
Quelques soient les rcits, la mudra de prise tmoin de la terre symbolise la fermet, la rsolution
de Bouddha et est annonciatrice de l'imminence de l'Eveil. C'est en effet, l'issue de cette mdita-
tion que Bouddha formulera les quatre nobles vrits.
* exotrique : se dit de doctrines enseignes au public, vulgarises (Petit Robert)
La Dhyana-mudra est le geste de Bouddha dans sa
mditation. Cette pose des mains est intressante car elle est
couramment employe par les gens qui mditent. C'est une
mudra qu'on retrouve dans le zen par exemple qui a centr sa
pratique sur la mditation. Cette pose est gnralement consi-
dre comme permettant la runion et la circulation de l'ner-
gie.
Selon Louis Frdric, " c'est une position qui tait naturelle-
ment prise ds avant son poque, par les yogins pendant leurs
exercices de mditation et de concentration. " (Les Dieux du
Bouddhisme p42)
On verra comment cette position des mains se retrouve avec des variantes chez Amithba, le
Bouddha de l'au-del et prend de nouvelles significations dans les sectes sotriques japonaises.
Le caractre concret de ces gestes me pousse les citer en exemple, puisque le passage d'un
geste " naturel " ou en tout cas pratique un signe voquant une attitude religieuse -ferme volon-
t, mditation intense- est net. On conoit que ces mudras soient tout fait lisibles pour le croyant
qui les met en rapport d'une part avec l'histoire du Bouddha, mais galement avec une exprience
qui, si elle ne lui est pas propre, est en tout cas accessible.
Certaines mudras ne correspondent pas un moment prcis de l'histoire de Bouddha mais
voquent un mode de vie ou une qualit qui lui est propre.
C'est le cas de la Buddhaptra-mudra ou mudra du bol d'aumnes. Les
mains sont disposes de telle manire qu'elles pourraient tenir ce rceptacle
nourriture. Le bol est d'ailleurs souvent prsent dans l'iconographie. Bouddha
tait un mendiant et dans le bouddhisme, la mendicit est une action vertueu-
se. C'est le moyen de mener une vie sans attache et d'exercer un contrle sur ses penses et ses sens.
Bouddha en demandant l'aumne faisait galement uvre de charit, puisqu'il permettait ceux qui
lui donnaient de gagner le salut. Dans ce cas, la position des mains est la limite du mime, qui
voque en le modelant un objet inexistant.
Lorsque le bol d'aumnes est reprsent, il est ce qu'on appelle un attribut : en effet, sont attribues
toutes les divinits hindouistes et bouddhiques des objets, des lments cosmiques, des animaux
qui les voquent. Les mudras servent les reprsenter ou encore les tenir, ce qui fait que la mudra
est elle-mme parfois dsigne comme un attribut.
L'Abhaya-mudra symbolise respectivement l'absence
de crainte, la protection, la paix et la Varadra-mudra la
charit, la compassion. Elles sont d'ailleurs rgulirement
associes. Ces sont deux grandes qualits du Bouddha et
pourrait-on dire des qualits universellement divines.
Elles sont prsentes dans toute l'iconographie hindoue
o elles ont les mmes significations.
L'Abhaya-mudra ressemble d'ailleurs au geste chrtien de bndiction qui comme le geste de
Bouddha assure au fidle protection et bienveillance.
Cette communaut de sens tient vraisemblablement au fait que ce geste ait couramment t utilis
par les hommes entre eux, parce qu'il signifiait de manire simple la non-agression : " Cette mudra
qui parat de prime abord un geste naturel fut probablement utilis ds la prhistoire en signe de
bonne intention : la main leve et sans arme propose l'amiti ou tout au moins la paix. Ce fut ga-
lement, depuis l'Antiquit un geste affirmant la puissance : c'est la magna manus des empereurs
romains, qui lgifre et donne la paix en mme temps." (Louis Frdric Les Dieux du Bouddhisme
p37).)
16
Abhaya Abhaya-Varadra Varadra
Celui qui offre sa bndiction est donc caractris par sa puis-
sance. Nous retrouvons ce mme sens dans l'imposition des
mains des chrtiens.
" L'imposition de la main ou des mains au-dessus de la tte affir-
me et transmet un pouvoir. Ce geste est rserv des person-
nages que leur nature et leur fonction ont dot d'un savoir et
d'une autorit. " (Franois Garnier Le langage de l'image au Moyen-
Age p 196)
La main de Shiva en
Abhaya-Mudra est aussi
symbole de sa puissance,
par cette main qui protge,
il a le pouvoir de prserver
l'ordre du monde.
Dans ce cas-ci, la pose des mains aurait volu du signe de
non-agression, celui de protection, impliquant du coup la
puissance de celui qui protge.
Au cur de la mudra , nous trouvons un processus fort de symbolisation. Un geste quoti-
dien qui a du sens par rapport une ralit pratique est fig dans une forme et un sens prcis pour
devenir symbole.
Le fait que les mains soient le lieu privilgi de cette expression symbolique, tient certainement au
fait que la main est partie prenante du geste lui-mme, et que du certaine manire elle peut le minia-
turiser. C'est comme si dans la position de la main fige, se trouvait l'tat embryonnaire le geste
amplement dploy. D'autre part, les mains par les innombrables variations qui peuvent tre les
siennes sont propices un langage formalis. La convention qu'implique toute cration de langage
y trouve aussi un terrain privilgi.
On pourrait ainsi rechercher dans les diffrentes mudras, le geste qui l'a fait natre et voir
comment il a t codifi.
L'Abhaya-mudra est selon Louis Frdric d'abord un signe de non-agression. Qu'il atteste symbo-
liquement de la puissance protectrice d'un individu ou d'un Dieu, explique que cette main reste en
hauteur. Dans l'imposition des mains des chrtiens, la main est souvent situe lgrement au-des-
sus de la personne, laquelle ce geste s'adresse.
Dans la Varadra-mudra, on reconnatrait la position d'une main qui offre un prsent. La
paume ouverte vers le bas semble recueillir et tendre un objet. Elle symbolise en effet
la charit des dieux : chez les dieux hindous, elle reprsente la volont d'exaucer les
vux des hommes, chez Bouddha la dcision de se consacrer leur salut.
L'tude des enluminures chrtiennes du Moyen-Age,
met bien en valeur la codification de gestes quotidiens
ou d'attitudes corporelles expressives, dans un but narratif. On
remarque ainsi que la main prsente de dos est au contraire un
signe de refus. Dans cette image dont la lgende est " Le peuple ne
peut souffrir la grande clart de la parole des bons prlats ", on voit
que l'attitude corporelle de retrait de l'homme et de la femme, est
renforce par l'orientation des mains, dont la paume est rejete vers
l'intrieur. Le recul ou la rtractation du corps qui est la forme la
plus pulsionnelle du refus ou de la rpulsion, permet ici d'identifier
le sentiment. Cette expressivit permettait vraisemblablement de
rendre ses images lisibles pour tous les croyants.
17
On peut voir aussi que la mme attitude de
refus peut tre codifie par la seule orientation
de la main. Dans cette image, " Dieu bnit les
bons chrtiens de la main droite ", sa paume
est ouverte, quand il " rejette les mauvais prin-
ces, les usuriers et les voleurs de la main gau-
che " et il montre le dos de la main.
C'est cette symbolisation par la main, d'une
attitude plus gnrale qu'on peut percevoir
dans les mudras. Cette rfrence au geste rel
peut cependant compltement disparatre dans certaines mudras, preuve que plus on dveloppe le
langage gestuel, plus celui-ci tend vers l'abstraction. En effet, partir du moment o je fixe " telle
position de mains " pour " tel sentiment ", je peux crer d'innombrables variantes qui ne signifie-
ront plus qu'en fonction du premier geste.
Les premires reprsentations du Bouddha devaient vraisemblablement leur efficacit la
simplicit du code gestuel et au fait qu'il fasse le plus souvent rfrence un geste physique. De
plus, en voquant l'histoire de Bouddha, elles taient pour les fidles des modles visibles d'aspira-
tions spirituelles. Le symbole contenu par la mudra appelle une rponse mentale chez le spectateur,
qu'il reprsente un espoir, une promesse, un modle appliquer, il suscite chez lui une motion, ou
une prise de conscience. On imagine assez bien qu'elles sont encore aujourd'hui un rappel pour le
croyant, des prceptes qui doivent diriger sa vie, un exemple de conduites et de valeurs idales. Ainsi
le code gestuel ne sert pas seulement signifier une attitude au sein de l'image, il s'labore aussi en
fonction du regard du croyant.
L' Abhaya-mudra en exprimant l'absence de crainte du Bouddha est cens procurer ce mme sen-
timent celui qui la regarde. C'est pourquoi elle est galement signe de protection..
Les diffrentes faons d'interpeller le croyant peuvent tre visibles dans la position de
la main. Dans l'iconographie hindouiste la Chin-mudra (ou geste de transmission de
la doctrine) est excute en direction du croyant. La main dans la mme configuration
mais oriente vers le dieu lui-mme hauteur de la poitrine est appele Jnana-mudra
et symbolise la sagesse du Dieu. D'un ct le croyant est interpell et appel recevoir
l'enseignement dlivr par le Dieu, de l'autre il est pris tmoin de la sagesse du Dieu,
ce qui vraisemblablement suscite sa vnration. On pourrait donc percevoir dans l'o-
rientation des mains, des gestes qui appellent la participation directe du spectateur, la Chin-mudra
ne prenant finalement sens que si un homme se met en face du Dieu
pour " recevoir le savoir ", et des gestes qui le convoquent comme
spectateur des qualits du Dieu.
Le vocabulaire des mudras produit donc du sens l'aide de l'espace,
et cet espace a comme fondement et rfrence premire le corps de
celui qui l'excute.
En ce sens, on retrouve dans le vocabulaire des mudras, cette
capacit de l'homme concevoir et organiser l'espace en fonction de
son propre corps.
Ainsi Marcel Jousse crit-il :
Et l'homme va partager le monde selon sa structure bilatrale : il cre la droite et il cre la gauche,
il cre l'avant et l'arrire, il cre le haut, et il cre le bas. Avec au centre l'homme qui fait le partage
". (Marcel Jousse L'anthropologie du geste p203)
L'homme fait le partage du monde et il le peuple de sens. A fortiori le domaine religieux est un
domaine privilgi de cette organisation, puisqu'il dfinit l'espace du monde divin, celui du monde
humain, et celui de leur runion possible. Les mudras la fois comme langage de signes oprant
dans l'espace, et comme symboles religieux expriment d'autant mieux cette conception duale du
monde.
18
Les mudras dans l'iconographie apportent donc des lments de comprhension de ce
qu'on peut appeler gestes sacrs. Les signes du Bouddha qui viendraient l'origine des gestes natu-
rels, sont relis la vie du Bouddha et deviennent par l mme, symboliques d'une conduite spiri-
tuelle. Leur signification s'ancre donc sur une culture donne (le fonds historique et religieux de la
vie de Bouddha) mais galement sur une codification des gestes qui comprend des units ( ce sont
les formes spcifiques de la main dans les mudras), mais aussi un dbut de syntaxe (l'orientation de
la main dans l'espace produit du sens). Pour toutes ces raisons, les mudras ont une valeur commu-
nicative et suscitent une rponse mentale de la part de l'homme qui les regarde. On remarque en
outre que la structure symtrique du corps de l'homme l'amne dfinir des directions qui nour-
rissent le dualisme inhrent aux religions, qui, tymologiquement relient deux domaines apparem-
ment distincts celui des hommes et celui des Dieux.
Les mudras de Bouddha dans le domaine sotrique : runion du monde divin et du monde
humain.
Dans le bouddhisme sotrique, l'univers est rgi par deux principes majeurs, comparables
au Yin et au Yang chinois, qui trouvent une expression dans les deux mandalas Garbhadhtu et
Vajradhtu traduits dans le livre d'Ingrid Ramm-Bonwitt comme le " mandala du Giron maternel
", et le " mandala du Diamant ".( Mudras La langue secrte des yogis p245)
Ces deux principes fminin et masculin sont symboliss par chaque main, la droite correspondant
au monde du diamant et la gauche au monde du giron maternel ou de l'embryon suivant d'autres
traductions. Les mains sont investies de tout un rseau symbolique, puisque elles symbolisent alors
les ralits que recouvre chaque mandala.
Les doigts enfin symbolisent les cinq grands Bouddha du bouddhisme sotrique, et les cinq sor-
tes d'intelligence qui leur sont propres, les cinq lments mais aussi cinq types d'existence. En un
mot et selon l'expression d'Ingrid Ramm-Bonwitt, les mains sont " symboles du Cosmos ".
Cette polarit des mains va nourrir toute l'interprtation des mudr dans les sectes sot-
riques. En reprenant certaines mudras dont nous avons parl prcdemment, nous allons voir com-
ment elles s'intgrent dans ce rseau symbolique.
La Dhyna-mudra, ou mudra de la mditation, est trs couramment associe au Bouddha
Amithba dont le culte est trs rpandu au Japon. Dans ce cas, la mudra symbolise la mditation
mais galement l'accueil dans la Terre pure. Amithba est en effet le grand Bouddha de la compas-
sion, qui promet aux hommes un paradis aprs leur mort. Dans les variantes de la Dhyan-mudra
-ou Jo-In en japonais- les mains forment deux cercles qui se rejoignent, chaque cercle tant form
par la jonction du pouce et d'un autre doigt.
19
Main droite
Le Diamant
Le monde des Bouddhas
Le soleil
La connaissance
L'activit
Le masculin
Le monde tel qu'il parat
L'unit
La subjectivit
Non
Main gauche
Le Giron maternel
Le monde des tres vivants
La lune
L'intuition
La passivit
Le fminin
Le monde tel qu'il est
La multiplicit
L'objectivit
Oui
Le cercle est symbole de perfection et reprsente la loi bouddhique. Selon le symbolisme inhrent
chaque main, la main gauche symbolise la loi humaine de Bouddha, et la main droite, la loi divi-
ne de Bouddha. Relis par la Dhyna-Mudra, ces deux cercles expriment l'harmonie des deux lois
et des deux mondes, et en dfinitive l'identit de l'homme avec le Bouddha Amithba qui est toute
dlivrance et toute compassion.
Nous voyons une mme volution d'une autre pose du Bouddha : l'Abhaya-Varadra mudr ou
Raigo-In.
Pour les variantes du Raigo-In, la main droite leve symbolise selon Ingrid Ramm-Bonwitt, la
recherche de l'Eveil, les cinq doigts de cette main figurant le monde des Bodhisattva ( saints du pan-
thon bouddhique), des bouddha exotriques et sotriques. La main gauche dirige vers le bas,
reprsente le monde des tres humains, les cinq doigts symbolisent alors le monde des hommes,
des divinits*, des morts, des animaux et des tres infernaux (Mudras La lan-
gue secrte des yogis p258).
En plus d'une polarit droite/gauche, nous trouvons dans cette mudra une
polarit haut/bas. Les Raigo-in symbolisent ainsi la descente d'Amithba sur
la terre pour chercher l'me des morts. Le mouvement suggr par la juxta-
position des deux mains, l'une vers le ciel, l'autre vers la terre indique claire-
ment cela.
Nous voyons dans cette image une communication trs forte entre les mains
d'Amithba et de celle du fidle (en Anjali-mudra), qui cre un vritable
mouvement ascendant. En mme temps, Amithba semble tendre la main au
fidle pour l'emmener dans son paradis qu'il semble dsigner de l'autre main.
Ces mudras s'intgrent d'ailleurs dans un
corpus plus vaste, puisqu'elles permettent
de reprsenter les diffrents degrs d'acces-
sion au paradis. Elles forment ainsi les
mudras d'accueil parmi lesquelles sont
ajoutes les variantes de la Virtaka-mudr,
autre pose canonique du Bouddha. Celle-ci correspond initiale-
ment au geste de la discussion de la doctrine et symbolise la capa-
cit de persuasion du Bouddha.
De nombreuses interprtations existent sur ces mudras d'accueil :
pour certains, les classes accueillent par ordre d'importance les fidles les plus sincres jusqu'aux
lacs qui ont prononc au moins une fois au moment de leur mort l'invocation au nom
d'Amithbaa. Pour d'autres, la plus haute classe est rserve aux fidles d'Amithba avec les degrs
20
* Si dans le Raigo-in, la main gauche symbolise aussi le monde des divinits, c'est certainement parce que ces divinits sont perues
appartenant aux croyances et aux illusions des hommes, par opposition aux bouddhas qui sont considrs comme la seule ralit trans-
cendante. Celles-ci correspondent vraisemblablement aux divinits indignes des peuples chez lesquels le bouddhisme a pntr, et
qu'il a intgr ces conceptions.
propres la maturit et la perfection de chaque fidle, la deuxime classe aux mes errantes et la
troisime aux animaux. A l'intrieur de chaque classe, il y a en effet trois degrs correspondant la
plus ou moins grande perfection des tres qui y sont reus.
Les plus reprsentes sont les trois premires mudras , c'est--dire les trois diffrentes poses o le
pouce touche l'index. Louis Frdric crit ce propos:
" Il est galement probable que les artistes eurent cur () de montrer comment les fidles les
plus mritants taient accueillis dans la Terre pure, ce qui leur permettait de raliser une image du
paradis plus frappante et surtout plus reprsentative aux yeux du peuple (et srement leurs prop-
res yeux) ". (Louis Frdric Les Dieux du Bouddhisme p124)
On peut voir que les trois mudras du Bouddha primitif sont utilises de telle sorte que leurs signi-
fications premires ( mditation, charit et protection, enseignement de la doctrine) sont prsentes
mais l'arrire-plan : ce sont d'abord des sceaux qui relient le monde divin et humain. De plus, en
formant les mudras d'accueil, elles deviennent un vocabulaire de signes extrmement cod, intelli-
gible seulement par un petit nombre de fidles. Bel exemple d'un dveloppement du vocabulaire
vers des signes de plus en plus labors. Elles correspondent bien en outre l'volution du boud-
dhisme vers des tendances de plus en plus spculatives.
En liant le monde humain et le monde divin, les mudras affirment que la sagesse rside dans le
dpassement de la dualit. Selon la doctrine sotrique, les mandala du Giron Maternel et du
Diamant ne sont contradictoires qu'en apparence, ils sont pour celui qui sait le voir dans une har-
monie absolue. Les deux mains runies par le sceau de la mudra attestent de cette harmonie, prou-
vent l'identit de l'homme et du Bouddha. La mudra est une expression on ne peut plus claire, de
ce qu'on peut tre un signe religieux : c'est celui qui runit l'homme et la divinit.
En ce sens, l'Anjali-mudra ou Gassh-In est
un trs bon exemple par sa simplicit et le
caractre quasi-universel qu'il dtient. C'est la
mudra de l'offrande et de la vnration. Les
deux mains jointes comme pour le geste chr-
tien de prire sert dans toute l'iconographie
bouddhique et hindoue pour dsigner les
orants.
C'est aussi une pose de mains couramment
utilise dans la vie quotidienne :
"Cette mudra universellement utilise par le
commun des mortels en Inde et dans le Sud-
Est asiatique pour la salutation, voque une
offrande ( de bons sentiments, de sa person-
ne) et indique galement la vnration si
elle est faite hauteur du visage " ( Louis
Frdric Les dieux du Bouddhisme p44).
Dans la secte Shingon cette mudra sert dsi-
gner les boddhisattvas qui affirment par ce
geste de runion des mains gauche et droite,
leur connaissance et leur sagesse : il n'y a pas
de diffrence entre le bien et le mal, le pur et
l'impur, le monde matriel et le monde trans-
cendant, mais seulement le dpassement de la
dualit et l'unit de l'esprit.
Or, chaque mudra de runion des deux mains
est aussi une affirmation de la capacit de l'homme raliser la nature de Bouddha qui est en lui.
Si l'homme fait un avec la divinit, c'est qu'il a en lui cach une part de divinit, qui demande tre
dveloppe.
21
Or au sein de l'Anjali-mudr des fidles de l'hindouisme, nous retrouvons en fait la mme ide que
dans le bouddhisme sotrique. David Bolland crit ainsi dans son guide sur le Kathakali :
"Les indiens se rappellent constamment, en accomplissant leur geste de salut quotidien les mains
en Anjali, la part de divin qui est en eux". (David Bolland Un guide de Kathakali p144)
Ce geste de salut, de prire, ou encore de vnration est porteur de ce qui peut tre la plus grande
affirmation religieuse : l'homme n'est pas spar des Dieux mais relis eux et cette liaison lui per-
met de dvelopper l'aspect divin qui est en lui.
Dans le Zen, la Gassh-In permet de runir deux aspects de l'homme, ce qui est intuitif et ce qui
est raisonn*. Il s'agit donc toujours dans ce geste de faire l'exprience de l'unit. On comprend que
ce geste extrmement simple favorisant la concentration dans l'exercice de prire ou de mditation,
soit pour la personne qui le fait runion de forces contradictoires et source de paix.
Dans l'histoire de la chrtient ce geste apparat d'abord comme signe d'acceptation et de soumis-
sion la puissance d'un souverain dans le systme fodal. Ce mme sens se retrouve quand ce geste
devient un geste canonique religieux, le chrtien tant alors peru comme vassal du Dieu. De mme
que l'imposition de la main est un geste de puissance, les mains rejointes sont un signe d'accepta-
tion de cette puissance. On peut penser dans ce sens que le croyant ne peut accepter d'tre soumis
une force aussi grande, s'il ne l'accepte pas " en corps et en esprit ".
L'homme doit tre uni en lui-mme avant d'tre uni avec la divinit. Nous touchons ici
un point fondamental pour comprendre le sens de la mudra comme sceau, le geste devenant le lieu
de runion entre l'homme et le Dieu, mais galement de rconciliation au sein de l'homme. La gran-
de ide du bouddhisme shingon de dpassement des dualits met en avant des caractristiques du
geste des mains qui ne sont pas propres qu' son primtre religieux. On peut aller plus avant dans
cette ide de faire corps et me avec la divinit, en tudiant l'inscription des mudras dans les rituels
des prtres shingon.
22
* Cette polarit renvoie vraisemblablement la correspondance entre les mains et les deux hmisphres du cerveau. Des tudes sur
le cerveau ont permis de montrer qu' l'hmisphre gauche du cerveau correspondait de manire privilgie une apprhension ration-
nelle et analytique des objets, tandis que l'hmisphre droit permet une apprhension plus intuitive.
Les mains comme les yeux sont en liaison inverses avec les deux hmisphres (hmisphre gauche pour main et il droits et inver-
sement). Ceci expliquerait la bi-partition symbolique qui est faite entre les mains gauche et droite, dans le Gassh-In et dans les aut-
res mudra ; la main qui correspondrait l'aptitude plus rationnelle de l'homme tant d'ailleurs toujours valorise.
La comprhension silencieusede lenseignement sotrique.
Tandis que les quelques sectes sotriques japonaises comme le Tendai, Zen, Jodo, Shin utilisent
principalement les mudras comme signes mtaphysiques dans l'iconographie, la secte shingon uti-
lise d'innombrables mudras dans son rituel, pour relier le croyant au monde divin.
Selon Ingrid Ramm-Bonwitt, l'importance des mudra dans le bouddhisme sotrique est du l'i-
de que " l'enseignement secret ne peut tre transmis de manire verbale, mais l'aide de symboles
qui parlent l'inconscient ".( Ingrid Ramm-Bonwitt Mudras. La langue secrte des yogis p243). En effet
le mot apparat comme trop caractristique, trop slectif pour signifier la multiplicit de la ralit.
Les mains peuvent tre l'outil privilgi de ce langage symbolique qui permettrait de saisir et trans-
mettre " la pure et indtermine vrit (qui) gt au-del de ce qui peut tre dit avec les mots ".(Ingrid
Ramm-Bonwitt p143)
Langage symbolique donc parce qu'il correspondrait mieux la nature de l'enseignement spirituel,
mais certainement aussi parce que les signes symboliques des mains peuvent assurer le caractre
secret de cet enseignement. Tandis que le mot est plus o moins intelligible par tous, le signe des
mains cre dans le cercle ferm du bouddhisme sotrique ne peut tre compris que par les initis.
L'accs au symbole est en ce sens une qute et elle procde d'un mrite.
L'initiation procde donc d'un double effort : celui de l'engagement dans la vie monastique, mais
galement effort pour comprendre de manire intuitive, sans demander d'explication verbale. Ceci
se rfre la tradition de " comprhension silencieuse " prtendument initie par Bouddha. Une
anecdote clbre sur l'enseignement de Bouddha ses disciples montre que le Bienheureux tient
une transmission d' " me me ", qui " chappe toute description et reste ferme tous ceux
qui ne sont pas devenus des matres grce une longue pratique ". (Karlfried Drckeim Le mer-
veilleux chat p60 )*
2
Quand Yoshi Oda raconte son initiation aux rituels shingon, il emploie pour cette transmission une
mtaphore intressante :
" C'est une transmission personnelle du matre au disciple, comme de l'eau qu'on verse d'une main
dans une autre ". (Yoshi Oda L'Acteur flottant p146)
23
*1. Cette citation est extraite "Quelques pages de l'histoire religieuse du Japon" de Anesaki Masaharu (Annales du Muse Guimet XLIII
Paris 1921 p55-56)
Kobo Dashi a introduit au VIIIme sicle au Japon les grands principes de l'cole chinoise Mantra. Sa pense a eu une grande influen-
ce sur les sectes japonaises. Il affirmait qu'en se dvouant au Bouddha Varochana on pouvait raliser en soi l'essence de Bouddha.
Varochana est le Bouddha qui symbolise le savoir sotrique, c'est--dire la trinit parole/pense/corps qui permet de rentrer en union
avec le Bouddha.
*2. Cette citation est tire de Mudras La langue secrte des yogis de Ingrid Ramm-Bonwitt p244.
" Maintenant s'ouvre le magasin des paroles mystiques
O les trsors cachs viennent tous au jour,
O toutes les vertus et les puissances se concrtisent.
Les Bouddha dans les innombrables royaumes bouddhiques
Ne sont pas autre chose que l'Unique Bouddha au fond de notre me ;
Et les lotus d'or, aussi nombreux que les gouttes d'eau de l'ocan,
C'est notre corps. "
Kobo Daishi *
1
FAIRE CORPS ET ME AVEC LE DIVIN. ETUDE DES GESTES DANS LES RITUELS SHINGON.
La prsence des mains dans cette dfinition n'est certainement pas trangre la pratique des mudras dans
les rituels, et cette image qui est d'ordre sensorielle et tactile montre que cet enseignement s'prou-
ve plus qu'il ne s'explique. Le matrialit des mudras et des mantras rejoint cette conception du
savoir religieux : la liaison avec le divin s'appuie sur une expression non rationnelle. C'est le pouvoir
symbolique de la mudra, la force vibratoire des mantras, l'intensit de la concentration qui per-
mettent de rentrer en contact avec des forces qui ne sont pas compltement dfinissables, mme si
elles ont pour nom " Bouddha ".
La fusion avec le Bouddha par le corps, lesprit et la voix.
Le concept shin, kou, yi tel que l'explique Yoshi Oda, rsume les moyens d'accs cette puissance:
" Shin est le mouvement du corps, kou est l'expression verbale et yi est la volont, l'intention et l'i-
magination (la concentration mentale) "( Yoshi Oda Lacteur flottant p146)
C'est l'ide selon Ingrid Ramm-Bonwitt que " le croyant doit penser la pense de Bouddha, parler
la parole de Bouddha, et reprsenter avec son corps le corps de Bouddha, ce dernier grce aux
signes symboliques des mains. " (Ingrid Ramm-Bonwitt Mudras. La langue secrte des yogis p250)
On pourrait ainsi relier les mudras au corps de Bouddha, les mantras sa parole, et l'intention sa
pense.
Yoshi Oda dcrit ainsi les rituels qu'il a accompli dans un monastre shingon :
" Quand j'tais dans le temple, je dus excuter quatre rituels sotriques. En un sens, chacun tait
comme un acte thtral. Sur l'autel, on place une coupe pleine d'eau, une fleur, de l'enscens et un
instrument de musique. Puis l'on invite Dieu descendre sur l'autel. Cela s'accomplit de trois
manires. On forme d'abord les mudras avec les mains ( les mudras sont des positions de main sp-
cifiques qui apparaissent dans l'art et les rituels bouddhistes). En fait dans la mudra tout le corps
est impliqu, mme si l'action visible se pratique avec les doigts. C'est donc une action physique. On
entonne ensuite un mantra ( une structure rythmique de mots) en sanskrit. Mais tout en rcitant les
paroles, il faut rester conscient de l'intention derrire le mantra : c'est l'quivalent du sous-texte en
thtre. Je devais accomplir ces trois actions en mme temps, en prsence de l'invit sacr, Dieu."
(Yoshi Oda Lacteur flottant p155).
Dans cette description, nous comprenons que la mudra n'est pas seulement considre comme un
signe symbolique mais aussi comme une action physique.
" Dans le bouddhisme sotrique, les doigts sont des versions miniaturise du corps tout entier.()
Si bien que, lorsqu'on bouge les doigts, on exerce, en un sens tout son corps. " (Yoshi Oda p180)
Cette liaison interne entre la main et le corps est donc une conception largement rpandue en Inde,
en Chine et au Japon. Rappelons-nous d'ailleurs que nous l'avions rencontre dans certaines pra-
tiques yogiques, et que le yoga apparat comme la source de toutes les pratiques du bouddhisme
sotrique. Quand les initis forment ce qu'on appelle "mudra de l'il ", "mudra du nombril " ou
encore du "front" de Bouddha, on peut se demander si ces positions des mains ne permettent pas
en premier lieu, d'agir sur leur propre corps, en stimulant les rgions des yeux du nombril et du
front.
Cette triple pratique de la voix, du corps et de l'esprit est le moyen mme pour rentrer en contact
avec le Bouddha dsign. Ainsi les positions des mains, les mantra, le type de pense sont spci-
fiques chaque bouddha.
Prenons l'exemple du Bouddha Amithba dont nous parlions prcdemment. Dans le culte
d'Amithaba connu sous le nom d'Amida au Japon, le fidle prononce la formule " Namu-Amida-
Butsu ", excute un mudra tel que le Jo-In, et concentre son esprit sur la perfection de la Terre pure
(ou paradis) et ceci en vue d'une identification mystique avec le Bouddha.
Le "Namu-Amida-Butsu" est rcit constamment par les fidles qui veulent renatre dans la terre
24
pure, car il leur permet de prendre conscience qu'ils portent d'une certaine manire ce paradis en
eux. Cette formule qui signifie " Je cherche un asile en Bouddha Amida " donne une ide assez juste
de la recherche de fusion. Elle est d'ailleurs thoriquement scinde en deux parties : " Namu " qui
reprsente les hommes chargs de leurs fautes et " Amida-Butsu " qui reprsente le Bouddha de la
lumire et de la vie ternelle. On voit alors que le mantra est scind symboliquement de la mme
manire que la mudra : d'un ct le monde des humains, de l'autre celui des bouddha.
On comprend maintenant pourquoi le mot japonais pour mudra (In) dsigne la fois les gestes uti-
liss comme sceau rituel, et les formules magiques qui les accompagnent. Tout est sceau, liaison
avec le divin.
La pratique des prtres vdiques se serait d'ailleurs fonde sur l'quivalence stricte des mudras et
des mantras. Selon Tyra de Kleen, les positions des doigts permettaient de figurer les lettres sans-
krites des paroles des mantras. Elle affirme galement qu'au Tibet, au Japon et Bali une couleur
particulire est assigne chaque doigt comme chaque syllabe du mantra.(Tyra de Kleen Mudras.
Les poses des mains rituelles des prtres bouddhistes et shivastes p18)
La trinit Corps, Discours, Esprit reprsente tout le savoir sotrique et est la base de nombreux
rituels. Le Mushofushi-In ou mudra de la prsence consacre d'ailleurs cet tat de fait : les trois
ouvertures formes par les doigts reprsentent les trois mystres, qui sont les trois aspects d'une
mme ralit.
Le corps, la parole et l'esprit sont les trois manires complmentaires pour
accder cette fusion avec la divinit. Ce sont trois aspects d'une mme rali-
t, comme l'affirme la doctrine sotrique. C'est ce qui explique que les mudras
servent voquer le corps de Bouddha, mais galement sa voix et son esprit :
par exemple, le Horo-No-In ou mudra de la conque symbolise la voix de
Bouddha, car celle-ci est aussi puissante que le son de la conque. De nom-
breuses mudras reprsentent aussi des traits de caractre et d'intelligence des
diffrents Bouddha : la charit de Matreya, la sagesse de Varochana
Grce cette pratique du corps de la voix et de l'esprit, le prtre invoque donc le Dieu et s'attribue
des pouvoirs qui sont en lui. C'est pourquoi les gestes du bouddhisme shingon sont magico-rel-
gieux.
Avec le rituel invoquant la desse Marichi le caractre magique est net : il permet de se drober aux
yeux des autres. La position de l'Ongyo-In concrtise d'ailleurs cette invisibilit : une main recouv-
re et cache le poing de l'autre main en un mime symbolique.
Le croyant excute l'Ongyo-In, rcite un mantra invoquant Marichi et
s'imagine tre cach dans le cur de la desse : il devient alors invisi-
ble pour tous ses ennemis et vite les catastrophes.
Le caractre magique du rituel est conditionn par des rgles prcises.
Il s'agit de faire le geste juste, de formuler la juste invocation, et d'avoir
la juste pense. Rappelons que la justesse des mantras n'est pas d'abord
dans le sens mais dans la forme de la rcitation : les mantras oprent autant et sinon plus grce
une vibration et un rythme particuliers. D.Thomas Ohm crit ce propos :
" Afin que cette force magique se dploie, il faut observer les formes prescrites dans le Gi-Ki ou
rgles du rituel, et qui sont dfinies dans les moindres dtails. Tandis que la moindre approximation
peut rendre le rituel inefficace, la fusion de l'homme avec le Bouddha par le corps, la bouche et
l'esprit le prserve galement de toute nuisance. Le rituel s'appelle par ailleurs " mthode de pro-
tection du corps "".( D.Thomas Ohm Le christianisme et les gestes de prire du peuple p239 )*
25
* Cette citation est tire de Mudras La langue secrte des yogis de Ingrid Ramm-Bonwitt p250
Le terme de mthode de protection du corps est en ce sens trs adapt au rituel Marichi puisqu'il
permet de se protger de ses ennemis. Louis Frdric crit d'ailleurs que de nombreux guerriers
japonais du Moyen-Age y avaient recours pour se protger.
La puissance magique de ces rituels nous permet aussi de comprendre pourquoi les brahmanes de
l'Inde vdique taient considrs comme dtenant des pouvoirs exceptionnels. A Bali, les prtres
shivastes et bouddhistes qui accomplissent des rituels semblables inspirent rvrence et crainte
chez les habitants de l'le, mme si la plupart ne pntrent d'ailleurs pas la signification de ces rites.
La fusion avec le divin prsuppose l'harmonisation des capacits physiques et mentales de
l'individu et un effort pour sortir de soi. C'est pourquoi hors d'une recherche spirituelle, Yoshi Oda
s'y est tellement intress, y voyant un rapport fort avec le jeu thtral :
" L'unit que l'on tente d'obtenir entre le shin, le kou, et le yi, dans la pratique shingon, est ton-
namment semblable au processus du jeu thtral. Quand l'acteur interprte son rle, il doit modi-
fier son discours, son action et sa pense." (Yoshi Oda Lacteur flottant p146)
L'officiant pour accomplir le rituel doit s'efforcer d'effacer le moi pour laisser la place une " force
autre ". L'investissement complet qu'implique la triple action permet vraisemblablement celui qui
le fait de s'oublier et de s'absorber dans l'invocation de cette force autre. Yoshi Oda semble
d'ailleurs avoir fait l'exprience de la difficult que cela peut parfois reprsenter :
" Parvenir psalmodier pour la premire fois de ma vie le sotra (rcitation) shingon Rishukyo me
parut difficile et je mis longtemps en venir bout ". (Yoshi Oda p 154). L'effort mobilise la per-
sonne et la " sort d'elle-mme ". D'autre part, l'utilisation des mudras rend compte de l'ide qu'une
position corporelle peut tre gnratrice de sentiments intrieurs.
La pratique spirituelle n'est donc pas seulement recherche de l'esprit mais forte intuition des mca-
nismes psychophysiologiques. De telles donnes ont intress Yoshi Oda autant dans les proces-
sus de cration de rle que dans les mcanismes de reprsentation.*
Enfin, ce que met en valeur la puissance magique du rituel, c'est que le geste comme la parole sont
efficaces. En tudiant le rituel Djo-Foudo, je prciserai l'ide de geste efficace mais aussi d'un geste
qui atteste qu'il est efficace. C'est d'ailleurs ce qui lui donne des potentialits thtrales.
Le thtre des gestes dans le rituel Djo-Foudo
C'est un rituel de purification qui comprend l'excution de sept mudras
successives, et se droule la manire d'un mime miniature, puisqu'es-
sentiellement accompli par les mains. Il doit amener le prtre qui prend
la personnalit et le corps du Bouddha Foudo Myoo se purifier et
purifier le temple. Foudo-Myoo est en effet le Bouddha qui procure la
force d'liminer les dmons qui sont en soi. L'pe est un signe carac-
tristique de Foudo Myoo, elle permet de combattre l'ego et les dsirs.
26
* Denise Schrpfer en rflchissant sur le jeu de cet acteur explique ainsi :
" Le grand acteur convoquerait une sorte de vacuit en lui-mme au profit d'un objet imaginaire " (article de Denise Schrpfer Peut-on
enseigner la prsence ? : La leon de Yoshi Oda dans La prsence de lacteur p62). Cette vacuit qui permet au prtre d'invoquer et
de recevoir la " personnalit divine " permet l'acteur de laisser la place l'imaginaire du texte, du personnage, des autres acteurs ou
encore des spectateurs.
Ce rituel se compose de gestes purement symboliques tels que les
deux premires mudras, et de gestes qui sont plus thtraux en ce
qu'ils relvent du mime. Tirer l'pe, la rengainer, faire tourner le
fourreau, tiennent de l'action mime mme si celle-ci aboutit une
position fixe des mains. Le caractre symbolique ne disparat pas
pour autant au profit d'une action qui serait faite de manire ralis-
te. Le fait que les actions soient miniaturises et on pourrait dire "
essentialises " prserve le caractre cod et symbolique du geste.
La succession des actions qui permettent la ralisation progressive
du rituel, les tapes de passage ncessaire, confre un ct pique et
dramatique ces gestes. On peut y voir une progression dramatique
qui nous amne de la prparation du combat, la menace, et de la
menace au combat lui-mme et son effet immdiat : la purifica-
tion du temple.
Tout un petit thtre de gestes permet au prtre la fois de figurer
cette purification et de la raliser. Car le geste est dans ce rituel effi-
cace, c'est--dire suivi d'effet. La preuve en est la successions des
actions : si le prtre dans la phase sept, peut rengainer l'pe, c'est
que la mission est accomplie et que les dmons sont en fuite. Cette
succession est la preuve que le geste de purification est oprant.
Dans le domaine religieux, la parole comme le geste sont efficaces,
car les partenaires en prsence -celui qui agit comme celui qui subit
ou regarde- accordent leur crdit cette action et qu'elles en sentent
du coup le bnfice. De la mme manire, dans la religion chrtien-
ne, lorsqu'un prtre fait le signe de bnir un croyant, il fait un geste
efficace : le croyant est et se sent bni. D'une part, parce que c'est
un geste symbolique, dtermin et reconnu par la communaut religieuse comme geste de bn-
diction, d'autre part parce que le prtre est habilit le faire. Dans le cas du rituel Djo-Foudo, le
27
De haut en bas
1.Le prtre en faisant cette mudra contre sa poitrine, doit s'approprier le corps et la per-
sonnalit du Bouddha.
2. Il accomplit cette mudra qui symbolise les flammes de Foudo, et rcite le mantra Ra
: ce faisant, il obtient une purification de tout son tre.
3. Maintenant, le prtre fait le geste de tirer l'pe pour combattre les dmons. La main
droite- ou main de la sagesse- figure l'pe, la gauche le fourreau dont il tire l'pe.
4. Le prtre tient le fourreau au-dessus de sa tte et le tourne trois fois, tandis que sa
main droite est pose sur le ct droit de sa poitrine. Cette mudra symbolise la premi-
re menace.
5. Le prtre remet l'pe dans le fourreau.
6. Cette mudra symbolise la deuxime menace. En tenant son pe (main droite)
devant sa poitrine, le prtre purge le temple de tous les dmons.
7. Les dmons sont en fuite, et le prtre rengaine l'pe.
rle du prtre comme intermdiaire entre Dieu et les hommes est accentu, puisqu'il incarne le
Bouddha lui-mme pour un moment. La premire mudra, est le moyen d'incarner le Bouddha en
s'appropriant sa personnalit et son corps et finalement de pouvoir "reprsenter" et raliser l'ac-
tion purificatrice du Bouddha.
Ce que met aussi en avant cette srie d'actions, c'est le regard que peut avoir la commu-
naut sur les gestes du prtre. Pendant cette tude des rituels, j'ai en effet envisag la mudra sous le
signe exclusif de la communication entre le croyant et le dieu. Ici on imagine bien le prtre accom-
plir le rituel Djo-Foudo devant les initis, l'action concernant d'ailleurs toute la communaut puis-
qu'elle vise purifier le temple, et par l vraisemblablement les fidles qui s'y trouvent. Rappelons
en effet, que Foudo Myoo donne d'abord le pouvoir de chasser les dmons qui sont en soi.
Nous remarquons ainsi les capacits dramatiques du langage des mudras : elles sont des signes sym-
boliques mais peuvent aussi se dvelopper un vritable langage qui peut " raconter " des actions et
des tats de fait. Dans la danse indienne, les mudras sont les units d'un langage complet qui peut
dcrire des tats d'me, des tres, et pas seulement la relation symbolique de l'homme et du divin.
De la sorte, on verra que le langage des mudras dans la danse tend vers une expression mime,
comme dans le rituel Djo-Foudo.
Je ferai deux remarques sur la manire dont s'organise le langage gestuel dans ce rituel, et nous ver-
rons qu'elle se retrouveront dans les mudras de la danse.
D'abord il se nourrit de mtaphores. Quand le prtre figure une pe avec sa main, il fait appel
une mtaphore plus que courante : l'pe pour le combat. Elle est videmment lie la connais-
sance pratique de l'pe en tant qu'arme. Cette utilisation mtaphorique du langage se double du
contexte religieux, puisque par ce geste, le prtre dsigne d'abord l'pe du Bouddha Foudo Myoo,
et que celle-ci sert prcisment combattre les dmons. Elle relve d'un code symbolique spci-
fique extrmement prcis et clos sur lui-mme. Ce mlange entre une expression mtaphorique
courante et un symbolisme typiquement religieux est une des constantes de ces gestes sacrs dans
la danse.
D'autre part, nous remarquons que lorsque le prtre fait la mudra d'"incorporation" du Bouddha,
il fait le signe contre sa poitrine. L'emplacement des mains n'est pas neutre, comme nous l'avons vu
avec la Chin-mudra et la Jnana-mudra dans le chapitre sur l'iconographie. Le cur ou la poitrine
qui sont mtaphoriquement les lieux de l'intriorit permettent de dire que le prtre subit une trans-
formation en lui-mme. On remarque une mme utilisation du code gestuel
dans l'iconographie du Moyen-Age chrtien. Lorsqu'un personnage est
reprsent avec la ou les mains sur sa poitrine, l'iconographe signifie qu'il
est dans la situation voque, totalement sincre: cest ainsi ce que nous
voyons dans cette image o Yseult reoit un message de Tristan. Dans cette
autre scne, Rebecca est remise Issac, et le commentaire prcise quelle est
modeste et consentante. (Franois Garnier Le langage de limage au Moyen-
Age p186). Les mains sur la poitrine est aussi cou-
ramment utilise pour reprsenter la vierge de lan-
nonciation, et exprime toujours le caractre profon-
dmment senti du comportement.
Lemplacement de la main a dans la danse indienne une grande importance
car elle permet partir quun petit corpus de signes recouvrent une multi-
plicit de sens, comme je le montrerai dans le prochain chapitre. Le rituel
Djo-Foudo nous rappelle la nature double du geste sacr qui nest pas seu-
lement communication avec le divin mais aussi avec la communaut.
28
29
CONCLUSION :
Il n'y a pas de geste sacr en soi. Le geste n'est sacr que par sa rfrence un dieu, un
saint, une histoire religieuse ou encore un concept religieux et il devient symbolique de ceux-ci.
Le geste apparat d'abord comme un outil privilgi de communication. Dans le cas des reprsen-
tations iconographiques du Bouddha, les mudras sont de vritables outils de transmission. Elles
concrtisent et magnifient l'histoire du Bienheureux, en font une reprsentation la fois vivante et
exemplaire qui doit marquer le fidle. L'image est parlante la fois parce qu'elle se fonde sur des
gestes simples et lisibles par tous et parce qu'elle est le symbole dune conduite religieuse.
Dans le cercle des sectes sotriques, c'est galement cette puissance symbolique qui est mise en
avant : le recours au symbole permettant une expression plus juste de la ralit divine en compa-
raison des mots paraissant toujours limits. Le symbole est frappant, parce que d'une certaine
manire, il excde toujours son sens.
On a remarqu que les mudras des sectes sotriques s'loignent de la rfrence un geste rel pour
tre un pur symbole d'une conception religieuse. La main du monde des Bouddha se joint la main
du monde humain : la mudra est alors ce " sceau " dont je parlais dans l'introduction, et l le geste
scelle, lie, le croyant et le dieu. Elle est ce contrat dont parlait Ingrid Ramm-Bonwitt, conclu entre
l'homme et le divin.
La mudra est galement un sceau, au sens dune marque dauthentification. Dans l'iconographie, la
mudra atteste du pouvoir du Dieu que ce soit le Bouddha historique ou un des nombreux boud-
dha. Dans le rite, l'initi refait la mudra symbolique du Bouddha ou d'une divinit, donc ce geste
authentifi, reconnu comme tant le sien (dans nos exemples, la mudra d'Amida, de Varochana, ou
de la desse Marichi) et par l acquiert une part de sa puissance et de son savoir. Le symbole est
donc aussi une puissance agissante. Par sa puissance symbolique, le geste est magique, ou tout sim-
plement efficace au sens o le croyant en ressent les effets.
Dans les rites sotriques, l'homme rejoint le Dieu en mimant son geste, mais galement en disant
sa parole et en pensant sa pense. Dans l'ide que " tout est Bouddha " ces multiples vocations ne
sont pas spares. On la vu, la mudra symbolise le corps ou la voix de Bouddha, tout autant qu'u-
ne aptitude divine. Il importe de ne plus user des catgories distinctives habituelles : l'humain et le
divin, la parole, le corps et l'esprit ne sont pas spars, tout participe d'une mme ralit. C'est aussi
pourquoi la pratique rituelle demande l'initi une participation totale de son tre.
C'est ainsi que la mudra met en avant l'ide de l'unit : l'excution des mudras, la rcitation des man-
tras et la concentration sont trois moyens similaires de s'adresser au Dieu et de l'invoquer. En
accomplissant ces actes rituels, le croyant s'oublie, et oublie donc les contradictions inhrentes sa
nature d'homme, pour ne faire qu'un avec la divinit. L'Anjali-mudra nous donne l'exemple le plus
clair de ce geste qui doit runir les contraires, apaiser l'homme et lui permettre de dvelopper la
nature divine qui est en lui.
D'autre part, quand Gertrud Hirshi dit que nous faisons dans la vie de tous les jours des gestes
inconscients qui renforcent une pense ou une parole, c'est vraisemblablement partir de cette atti-
tude que la mudra s'est codifie. Attester et renforcer le pouvoir de la parole c'est ainsi pour le pr-
tre de l'poque vdique, faire avec les doigts les lettres du mantra. C'est encore rechercher l'unit de
l'expression mais aussi renforcer son pouvoir afin de toucher l'indicible, l'invisible, ce qui ne peut
tre voqu par les mots et les attitudes quotidiennes.
Le geste de la mudra ft donc d'abord un geste mystrieux, scandant l'incantation des mantra, ayant
une puissance magique, avant d'tre ce code qui permet de raconter l'histoire de Bouddha aux fid-
les de toute l'Asie.
Enfin, les mudras mettent en valeur la capacit de l'homme ordonner le monde visible et invisi-
ble, architecturer les relations entre ces mondes les rejouer par le mouvement de ces mains.
30
L'homme partage le monde selon sa structure bilatrale dit Marcel Jousse. Le haut le bas, le devant
le derrire, la gauche la droite sont les repres qui permettent d'une part la cration d'un langage
communiquant -et c'est net dans les reprsentations iconographiques-et qui permettent d'autre part
d'exprimer l'aspiration mystique de fusion avec la divinit, comme c'est le cas dans les rituels. Par le
geste, l'homme peut rejouer le monde et le sublimer. Cette aspiration reprsenter le monde d'un
point de vue divin, ce qui implique ncessairement le recours l'analogie et la mtaphore, va tre
dvelopp de manire privilgie dans la danse indienne.
LES MUDRAS DANS LA DANSE INDIENNE : UNE INTRODUCTION
Les mudras sont-elles une langue communicante?
Dans les danses indiennes, les mudras dsignent aussi bien des gestes abstraits que des ges-
tes signifiants. Dans la danse pure, une position des mains accompagne chaque mouvement des
bras et des jambes, en une chorgraphie trs vive. Elle est expressive sans avoir de sens, elle est
selon l'expression de Barba " une simple sonorit ". Dans la danse narrative, la mudra devient signe
et s'inscrit dans un langage la fois mim et conventionnel. Mudras abstraites et mudras symbo-
liques ne sont pas spares, elles s'intgrent dans le mme alpha-
bet. Ainsi, une mme position des mains telle que Alapdma se
retrouve trs couramment dans les sries de mouvement de
danse pure, mais elle sert galement, dans une squence narrati-
ve, signifier une fleur ouverte, la pleine lune, la beaut et une
foule d'autres choses.
Chaque mudra recouvre un trs grand nombre de signi-
fications selon le contexte et la manire dont elle est excute.
La manire dont la mudra est excute, c'est l'emplacement, le
mouvement : la mudra alapdma faite en hauteur avec un mou-
vement circulaire dsigne la pleine lune. A hauteur du la tte, faisant le tour du visage, dans un mou-
vement circulaire galement, elle exprime la beaut physique de quelqu'un.
Le contexte c'est dans la reprsentation, le chant qui accompagne la danse. Prire en l'honneur d'un
Dieu, ou pisode d'une histoire divine ou humaine, elle informe le public. Cependant, tous les tex-
tes de danse ne sont pas chants dans la langue maternelle des spectateurs. D'une part parce que
les langues de l'Inde sont nombreuses, d'autre part parce que les textes peuvent tre en Sanskrit, qui
est lquivalent du latin pour nous. C'est alors la connaissance qu'a le public indien, des Dieux, de
31
LES MUDRAS DANS LA DANSE INDIENNE
Shiva dansant , bronze traditionnel.
* Signer signifie s'exprimer en langage des signes et est gnralement utilis pour parler des sourds-muets.
* Les danses indiennes actuelles telles le Baratha-Natyam se sont inspires de l'Abhinya-Darpana, trait de danse plus tardif qui comp-
te vingt-huit mudras qui sont faits d'une seule main, et vingt-trois mudras deux mains. cf liste des mudras p
la manire dont ils sont reprsents et des faits qui leur sont
attribus, qui opre pour la comprhension. Ainsi, quand la
danseuse mime le fait de jouer de la flte, chacun reconnat le
dieu Krishna dont c'est l'une des caractristiques.
Je retrouve ici un lment commun avec ce que dit
Danielle Bouvet sur les signes des mains du
langage sourd-muet : ils sont " transparents "
mais pas " translucides ".(Danielle Bouvet
Corps et mtaphore dans les langues gestuelles. p15). " Transparent ", dans son langage,
c'est l'ide que le signe de la main faisant appel l'image de la chose, il a un carac-
tre d'vidence. Il rappelle l'exprience visuelle et corporelle que nous avons de
cette chose, puisqu'il emprunte la fois sa forme, et son mouvement. Nous pou-
vons voir sur ces croquis, que le mme processus est loeuvre dans les mudras.
Mais il n'est pas " translucide ", dans la mesure o l'entendant qui regarde un sourd-
muet signer*, ne comprendra pas le contenu de son discours. En revanche, et elle
raconte des expriences qui ont t faites sur le sujet, si l'entendant a une ide pr-
alable du contenu, il parviendra reconnatre bon nombre de signes.
Or le contexte culturel tout comme le chant qui accompagne la
danse indienne joueront le mme rle qu'a pour l'entendant une
brve information sur le discours du sourd-muet. Le public indien ne connat donc
pas le langage des mudras, comme le suppose certaines personnes, il ne s'en sert pas quotidienne-
ment pour parler. C'est l'association des capacits expressives de ce langage, des autres donnes de
la reprsentation et la connaissance par tous les indiens des grandes popes qui permettent de faire
des mudras une langue communicante.
On peut galement dire du langage gestuel des mudras qu'il s'appuie sur une expression
corporelle plus vaste. La danseuse peut marcher pour indiquer un dplacement, se pencher pour
regarder un enfant, s'accroupir pour laver du linge ou prparer un plat. Enfin, son visage joue un
rle trs important dans la signification. Dans la danse indienne, les yeux suivent toujours la main,
y compris dans la danse pure o ils concourent ainsi l'unit du mouvement. Dans la danse nar-
rative, les yeux suivront la main et participeront galement l'expression gnrale du visage pour la
transmission des motions.
Ces techniques expressives ont t notifies dans le Natya-Shastra qui est l'un des plus vieux trait
de danse du monde. Rdig entre le 5me et le 1er sicle avant JC, le Natya-Shastra regroupe tou-
tes les donnes de la reprsentation, dcrivant l'difice idal, les rgles de prosodie et de diction, les
types de personnage, la reprsentation des sentiments, les mouvements de chaque membre. Sont
ainsi notifis et dcrits soixante-sept mudr ou positions de la main, et trente-six mouvements des
yeux.*
32
L'Abhinaya ou art de la communication (le mot vient de abhi qui signifie vers, et de ni, conduire) y
est divis en quatre catgories :
-l'angikabhinaya qui comprend les mouvements des membres et les gestes de la main
-le vacikabhinaya qui est l'expression communique par la posie, le chant, la musique et le rythme
(Le natya-shastra dcrit ainsi des rythmes propres aux passages comiques ou dramatiques)
-l'aharyaabhinaya est l'expression obtenue par les costumes, le maquillage, les bijoux
-le sattvikabhinya est l'expression communique par l'expression par les motions et sentiments.
Le langage des mudras n'est donc pas le seul lment narratif de la danse. Dans la reprsentation
danse beaucoup d'lments font signe. Ainsi, sont dcrits dans le Natya-Shastra les costumes et
bijoux qui indiquent chaque type de personnage, les dmonesses ont un costume noir et des saphirs
dans les cheveux par exemple. Dans le Kathakali, le maquillage et le costume sont des signes trs
importants, chaque acteur a un costume et un maquillage trs labor suivant le personnage qu'il
incarne. C'est un peu moins visible dans les autres danse indiennes qui sont le plus souvent excu-
tes en solo : l'interprte-narrateur endosse plusieurs personnages. Dans ce cas, le langage des
mudras permet alors de dfinir chaque personnage. Ainsi, dcrira-t'on couramment avec les mains
l'aspect physique dune personne ou dun dieu, ses qualits, son rang social.
Le langage des mudras s'inscrit dans des techniques de reprsentation non dissociables et
trs codifies. C'est certainement ce dernier aspect qui fait de la danse indienne un art de la distan-
ce. L'actrice-danseuse n'a pas besoin d'incarner le personnage puisque sont sa disposition un cer-
tain nombre de signes qui l'voquent. Elle est une narratrice qui dsigne le personnage mme quand
elle prend son attitude.
Ensuite, les mains qui forment les mudras ne sont pas les mains convulses de la transe, ce sont
mme des mains domptes tant certaines mudras sont d'ailleurs difficiles excuter. Elles sont
rgies par un sens rigoureux de l'esthtique, et mme un geste quotidien est dessin par une posi-
tion des mains complexes. Je dfinirai le langage des mudras comme un langage la fois mim et
conventionnel, expressif et minimal.
Lexprience du Rasa.
La danse indienne ne suscite pas des motions mais est cense crer chez le spectateur une
lvation de la conscience. Le processus qui amne cet tat du spectateur est dcrit par un clb-
re aphorisme dans l'Abhinya-Darpana :
" O va la main, va l'il ; o va l'il va l'esprit ; o va l'esprit le sentiment s'veille et lorsque le sen-
timent s'veille, nat le got "
Le " got " c'est la traduction du mot sanskrit rasa. Suivant les citations, il est galement traduit par
" joie " ou " exprience esthtique ". Le rasa est selon Manjula Lusti-Narasimhan " un embrase-
ment de l'motion qui engendre un plaisir impersonnel, quelque soit l'motion ( exprime par la
danseuse)". Elle poursuit en donnant le tmoignage de la danseuse Mrinalini Sarabhai : " Mme s'il
assiste une scne triste, le spectateur n'prouve rien de dsagrable mais un vrai plaisir, un senti-
ment d'ananda ( allgresse divine) communiqu par l'interprtation de la danseuse. "( Manjula Lusti-
Narasimhan BarathaNatyam La danse classique de lInde p120)
J'interprterais ce plaisir impersonnel galement comme plaisir de la comprhension. En assistant
des reprsentations en Inde, j'ai pu prouver ce plaisir de comprendre les histoires aprs quelques
reprsentations qui taient dabord tout fait impntrables. La conjonction d'une forme esthtique
acheve et du plaisir " intellectuel " de comprendre me semble significative du plaisir qu'on peut
prendre devant la danse indienne. Mon professeur de Baratha-natyam nous explique que chez le
public indien, il y a un grand plaisir reconnatre : reconnatre les histoires, les chants, les mouve-
33
ments. Or, ce plaisir de reconnaissance se nourrit selon moi du mlange de familiarit et d'trange-
t, puisque le langage de la danse est avant tout et selon l'expression de Barba " extra-quotidien ".
Le geste est extra-quotidien quand il propose un quivalent du geste quotidien dans une forme plus
concentre et plus expressive. Ce geste relve gnralement d'une codification du comportement
qui s'appuie sur une gestion particulire de l'quilibre et la mise en uvre dans le corps de tensions
musculaires qui rendent l'acteur prsent.
J'tudierai le langage de la danse comme expression du " Manifeste et du cach " prcisant
ainsi la dfinition des mudras comme sceaux qui scellent le visible et l'invisible, puis comme sym-
bole en mouvement, je montrerai comment la mudra dans la danse exprime une vision religieuse
de manire spcifique. Enfin, la danse narrative tant amene rejouer l'histoire des Dieux, elle est
commmoration et prire, le langage gestuel a donc une dimension rituelle.
34
35
MUDRAS DU BHARATA-NATYAM: MAINS SIMPLES
MUDRAS DU BHARATA-NATYAM: MAINS DOUBLES
" L'histoire de la danse indienne ( ) c'est l'histoire de l'me
indienne et, par consquent, une expression la fois du Manifeste
et du Cach ; c'est l'esprit de l'ternit et du temps, de l'homme et
de la femme. La danse indienne est purusa et prakti (esprit et
matire), expression du mouvement se dployant, force vritable-
ment cratrice qui nous vient du fonds des temps. Cette incarna-
tion du son et du rythme, cratrice d'une posie de l'expression spi-
rituelle, est appele danse ou nrtya. Celle-ci est insparable de la
religion et de la philosophie qui en Inde, ne sont pas uniquement
des conceptions intellectuelles (spculatives) ou de simples ensem-
bles de rgles et de prcepte (systmes). La religion, la philosophie
et l'art relvent en propre de l'Esprit Un, indivisible et accessible
aussi bien au sage, qu'au saint, qu'au plus vil des tres humains.
Chacun est habit par l'Esprit divin, chacun vit sous l'autorit du
crateur, tous sont habits par un dsir ternel d'atteindre le vrai
bonheur, la batitude ou moksa.
C'est pour satisfaire chaque tre humain et, en mme temps, le ren-
dre capable d'accder cette flicit que les Vedas, les Upanisads,
ainsi que la danse et la musique existent. Il est donc possible tout
mortel et tout tre divin de danser, chacun la mesure de son
entendement mais dans l'allgresse divine ou ananda. En Inde, la
danse ne procde pas de l'homme et de ses expriences mais de la
divinit elle-mme. "
Rukmini Devi Arundale (1957)*
36
LA DANSE INDIENNE COMME EXPRESSION DU MANIFESTE ET DU CACH
La danse indienne est expression " du Manifeste et du Cach " selon Rukmini Devi
Arundale, introduisant pour moi une parfaite dfinition de ce qu'est le langage gestuel des mudras.
Le manifeste est " ce dont l'existence est attest " (Petit Robert) et plus largement ce qui est clair,
ce qui se voit . On a vu que la langue gestuelle des mudras exprime du manifeste puisqu'elle est imi-
tative et descriptive. Les mains reprennent la vie des choses, des tres des animaux et stimule, rap-
pelle, convoque notre plaisir de voir.
Le cach est ce qui n'est pas visible, et par extension les ralits abstraites, les sentiments, les dieux
auxquels le langage des mudras doit trouver un quivalent gestuel, un signe. Ce processus de sym-
bolisation nous amnera comprendre que dans la danse indienne, l'expression du cach est
expression du sacr.
Rukmini Devi Arundale fut pionnire du renouveau du Bharata-Natyam et fonda lcole de Kalaksetra. Cette citation est tire du
livre de Manjula Lusti-Narasimhan Bharata-Natyam, la danse classique de lInde, p 16.
Comparaison entre le langage des mudras et le Langage des Signes Franais.
En premier lieu, cette dialectique du manifeste et du cach puise dans les capacits de tout langage
gestuel exprimer des ralits concrtes visibles aussi bien que des ralits abstraites ou invisibles.
Arrtons-nous un instant sur le langage des sourds-muets et l'tude qui en a t faite par Danielle
Bouvet. Dans Le Corps et la mtaphore dans les langues gestuelles, Madame Bouvet explique que notre
apprhension du monde est visuelle et physique et que cette exprience corporelle est source de
mtaphores qui nous permettront d'exprimer ce qui n'est pas du domaine tangible.
" Nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques-autrement dit nous
conceptualisons le moins distinct en termes plus distincts "(Danielle Bouvet Le Corps et la mtapho-
re dans les langues gestuelles p84)
Ceci n'est pas propre la langue gestuelle -le langage verbal utilise les mmes mtaphores- mais la
langue gestuelle rend manifeste, la source physique de nos reprsentations. Ceci est trs net dans sa
syntaxe puisqu'elle utilise les relations spatiales comme relations de sens :
" La vie est avant tout une exprience visuelle qui se situe dans l'espace et une langue visuelle, spa-
tiale peut en rendre compte avec efficacit et lgance(.) L'homme est ce point un animal
voyant qui se dplace dans l'espace qu'il conoit souvent les choses non spatiales en termes spa-
tiaux-ce qui agrandit l'infini le monde d'expriences que la langue des signes exprime aisment. "
(H.Lane Quand l'esprit entend p216 )*
S'appuyant sur les expriences d'autres chercheurs, Danielle Bouvet va dfinir quelques unes de ces
mtaphores d'orientation :
" A partir d'autres expressions de la vie courante, G .Lakoff et M.Johnson ont mis en lumire d'au-
tres mtaphores d'orientation. Ainsi les expressions telles que " je suis au anges " ou " il a le moral
zro ", sont pour ces auteurs lies aux reprsentations mtaphoriques suivantes : " Le bonheur est
en haut, la tristesse est en bas " qui s'laborent partir de cette ralit physique selon laquelle " la
position penche est habituellement associe avec la tristesse et la dpression, la position droite avec
un tat affectif positif ". "( Danielle Bouvet Le Corps et la mtaphore dans les langues gestuelles p70)
Danielle Bouvet les met ensuite en relation avec une grammaire gestuelle :
" Les deux signes AIMER et NE PAS AIMER, par l'orientation de leur mouvement respectif met-
tent en jeu de telles mtaphores. Il faut noter que la paume de la main est aussi oriente vers le haut
dans le mouvement vers le haut alors qu'elle est oriente vers le bas lorsque le mouvement va vers
le bas " (Danielle Bouvet p70)
37
Aimer / Ne pas aimer
*Cette phrase est cite dans Le corps et la mtaphore dans les langues gestuelles de Danielle Bouvet p68.
En Baratha-Natyam, on retrouvera un mouvement ascendant des mains pour exprimer la joie et le
sentiment amoureux, les mains s'ouvrent en ventail (en alapadma) et dessinent un trajet vers le
haut. Le visage souriant concourt du reste l'expression du sentiment.
Cette tude m'a permis de comprendre que dans le langage des mudras comme dans le langage des
sourds-muets, les signes qui dnotent des termes abstraits comme AIMER, s'laborent bien sou-
vent partir de ces mtaphores dorientation. Ces langues ont donc le pouvoir de rvler les repr-
sentations symboliques lies lexprience, cest--dire la manire corporelle dtre au monde.
Je donnerai un autre exemple qui me semble significatif puisqu'il
met en jeu un autre type de mtaphore. Le signe DIFFICILE en
Langue des Signes Franaise s'exprime de la mme manire que
PROBLEME dans le Baratha-Natyam : on trace une sinusode
sur le front avec les doigts d'une main. En LSF c'est l'index
recourb, en danse indienne
on utilise la mudra hamsa-
sya, puisque la main est tou-
jours esthtique comme on
l'a dj dit.
Or dans les deux cas, la main dsigne la ride que le problme ou
la difficult creuse dans le front de la personne. Rappel de notre
exprience corporelle -les soucis font des rides- mais galement
parfaite illustration d'une mtaphore du langage " avoir le front
soucieux ". Or ceci met en avant une autre caractristique du langage gestuel : l'importance de l'em-
placement o le signe se fait. Le front est peru comme le sige de la pense, et bon nombre de
concepts lis des actions mentales seront exprims hauteur du front.
En LSF, la localisation sur telle ou telle partie du corps servira ainsi l'expression de concepts mta-
phoriquement lis ces organes ou membres. Ainsi, SE MEFIER, mais aussi ETRE FASCINE ou
FAIRE ATTENTION seront des termes abstraits excuts hauteur des yeux, car les yeux regrou-
pent les traits relatifs l'attention. Le terme AIMER que nous avons vu linstant, s'arrte dailleurs
hauteur du cur, vu comme sige des sentiments : il illustre si on veut un exemple, une mta-
phore comme "mon cur est plein de vous".
38
Faire attention / tre fascin / Se mefier .
Ainsi, la localisation du signe comme l'orientation du mouve-
ment procdent de mtaphores lies notre exprience corpo-
relle et nous aide comprendre comment le langage des mudras
l'instar de la langue des sourds-muets s'organise, mme si "
chaque culture a sa propre faon d'laborer des reprsentations,
et privilgie tel ou tel aspect de l'exprience. " (Danielle Bouvet
p67). On remarque d'ailleurs qu'en Inde, les reprsentations
symboliques du corps diffre un peu. Les signes qui ont voir
avec la pense se font hauteur du front, mais prcisment l'endroit du chakra du front, qui est
le chakra par lequel on apprend. C'est pourquoi dans la danse, le signe Anjali est fait devant le
milieu du front quand il s'adresse un Dieu. On salue le Dieu comme cela parce que c'est lui qui
avant tout dispense le savoir.
La langue des sourds-muets et la langue des mudras sont mtaphoriques mais pas seulement au sens
o on aurait pu l'attendre (c'est--dire comme langue potique) mais mtaphorique parce que la
mtaphore est le fondement de notre pense et de notre apprhension du monde : elle permet de
rendre clair ou manifeste des termes abstraits en les transposant dans une ralit physique. La lan-
gue gestuelle des mudras est donc effectivement "expression du manifeste et du cach", le cach
tant en l'occurrence le "non-physique", tout ce qui relve de ralits abstraites, les concepts, les
sentiments dont la danse narrative a videmment besoin.
Rle du symbole et de la mtaphore.
Le cach dans la langue des mudras c'est aussi le sens religieux de la vie, la correspondance cons-
tamment entretenue entre le monde divin et le monde humain.
" L'humain et le divin sont en relation constante, nous dit Savitry Nar. Cette correspondance entre
les deux univers est une notion fondamentale de la pense indienne () Les interactions des uni-
vers physique et mtaphysique sont la base de la philosophie hindoue : toute vie est une et indi-
visible, et chaque lment est charg de sens ".(Savitry Nar " Mudra. La main enchante " article du
Courrier de L'Unesco p34)
Le domaine religieux est celui de la transmutation, du passage entre le monde divin et le monde
humain. Les mudras sont des gestes canoniques, mais galement profondment artistiques. On
comprend alors que la "reproduction" de la vie par le biais d'une gestuelle consacre soit le terrain
privilgi de cette expression religieuse, mais aussi que l'exaltation de la beaut est exaltation du sens
religieux de la vie. On peut donner du monde une image divine, par le biais de l'esthtique, mais
aussi de l'homme puisque le corps de la danseuse est refaonn. C'est ce qui fait dire Savitry Nar
que la mudra "symbolise la relation qui existe entre les vies intrieures et extrieures de l'homme
tout comme elle tablit des parallles entre le monde divin et humain. Dans la cosmogonie indien-
ne, le monde terrestre est une rplique de sa contrepartie divine et le corps humain la forme visi-
ble du divin "(Savitry Nar p34). Les mains de la danseuse ne sont plus des mains quotidiennes, ce sont des
" mains enchantes ".
De plus, la main enchante est aussi la main symbolique :
" De nombreux gestes sont des imitations de ce que l'homme voit dans la nature. Ces manifesta-
tions de la nature sont leur tour symboliques de certains sentiments, ou caractristiques de cer-
tains Dieux. Ainsi, le coquillage, le poisson ou l'oiseau Garuda symbolisent Vishnu, tandis que le
paon reprsente Karttikeya "( Ingrid Ramm-Bonwitt Mudras. La langue secrte des yogis p 18).
Cette symbolisation est au cur de la pense indienne : les " attributs des Dieux " ( attitudes, objets,
lments cosmiques, animaux qui les voquent) sont le terrain privilgi des mudras et nous les
39
retrouvons dans les reprsentations iconographiques aussi bien que dans les rites. C'est ce qui per-
met d'ailleurs de considrer les mudras comme sceaux qui scellent le visible et l'invisible.
Il est intressant de voir comment cette dimension symbolique est l'uvre dans la chorgraphie.
L'exemple que je vais donner vient de Reginald Massey qui dcrit l'improvisation gestuelle d'un
clbre danseur Kathak. Dans cette danse du Nord de l'Inde, le danseur est aussi chanteur la dif-
frence du Barathanatyam, et le danseur voque ici l'histoire d'amour clbre entre le dieu Krishna
et Radha, une bergre. Celle-ci cherche son bien-aim et demande : " Dis-moi , cher ami, o est
parti Shyam ? ", Shyam tant un pithte de Krishna, le Sombre.
" Shambu Maharaj chantait le vers plusieurs fois, souli-
gnant chaque fois un mot ou une syllabe particulire.
Son visage et ses yeux exprimaient les motions, et ses
mains accompagnaient leur expression. Le jeu rendait
vivant des mtaphores, des images, des comparaisons et
des concepts mtaphysiques qui ne sont pas explicites
dans le pome. Par exemple, il montrait Radha se met-
tant du kohl sur les paupires. Le mouvement de son
doigt figurait la ligne et le kohl noir symbolisait Krishna,
le fonc. En d'autres termes, ceci pouvait signifier "
Shyam entoure mon me comme le kohl entoure mes
yeux ". "( Reginald Massay La danse Kahak de lInde p43)
Pour prcision, Krishna est de couleur fonce car il est
l'origine une divinit des populations indiennes indig-
nes, qui avaient la peau plus fonce que les migrants
indo-europens. Cette association symbolique (le kohl
noir pour Krishna) sert de base toute une expression
mtaphorique, o les prparations et soins de beaut
forment l'empreinte amoureuse du Dieu sur le corps de
cette mortelle. Le langage gestuel donne chair la phrase, en proposant une action trs concrte,
quotidienne, et dans le mme temps, il fait jouer les correspondances symboliques. Il met aussi en
jeu les reprsentations mtaphoriques du corps : le geste ractualise en effet les yeux comme miroir
de l'me. Dans cet exemple les capacits mtaphoriques du langage gestuel sont conjugues au sym-
bolisme purement religieux, afin de prolonger la phrase verbale et d'en exalter tout le sens.
Lart interprtatif
Le langage des mudras est donc charg d'exprimer le sous-texte. Processus qui est minemment
intressant et qui se retrouve dans notre thtre occidental. Dans Le revizor mis en scne par
Matthias Langoff il y a deux ans, tous les personnages retournaient littralement leur veste l'arri-
ve de celui qui s'avre tre le vrai revizor. Cette action physique et massive (puisqu'on voit une
dizaine de comdiens retourner leurs costumes et en exhiber les doublures pour le moins colores)
tait une audacieuse illustration d'une expression qui n'est pas
dans le texte mais qui rsulte bien videmment de la situation.
Expression courante vraisemblablement inconnue hors de nos
murs tout comme l'association Krishna /Couleur sombre.
On retrouve ces expressions mtaphoriques constamment. Au
chapitre prcdent, j'ai parl du signe alapadma : quand on fait
le tour du visage avec cette mudra, on dsigne la beaut phy-
sique d'une personne. Or quand la main finit son mouvement
40
Danseuse se fardant.
Sculpture de Khajuraho, la Cit des Dieux ( Inde )
circulaire, elle s'arrte dans la mudra candrakala qui dsigne le croissant de lune. Et ceci parce
qu'on dit en Inde, tre beau comme la lune. Non seulement, le langage gestuel se nourrit de mta-
phores mais la mtaphore est en fait un des principes de l'improvisation gestuelle. Sunil Kothari sp-
cialiste de danse indienne, nous expliquait lors d'un stage, qu'il fallait au sein de l'improvisation pro-
gressivement lever le niveau d'expression. Nous devions voquer la rponse d'un mari sa femme
jalouse : le mari montre pour se justifier qu'il l'a couverte de bijoux. Dans la deuxime phrase ges-
tuelle, la dsignation des mmes bijoux servait de comparaison avec la beaut resplendissante de son
pouse.
Faire jaillir le sens cach
L'art interprtatif permet comme le dit Savitry Nar de "faire jaillir le sens cach". Ainsi, la
danseuse peut aussi pour expliciter le sens d'un vers, le mettre en rapport avec un pisode d'un autre
rcit, ou dcrire tous les aspects ou motions qui peuvent y tre associs.
Dans un refrain typique tel que " Qu'est-il arriv ton cur ?, il est lourd comme une pierre ", la
danseuse illustre d'abord le vers avec les mudras " cur ", " lourd ", " pierre ". Mais ensuite, elle
explique comment le hros tait doux et tendre avant que son cur ne soit empoisonn par une
autre femme.
Or, ce sens cach est aussi pour Savitry Nar "celui o s'exprime l'aspiration des hommes retro-
uver leurs sources divines". Ceci apparat clairement dans l'exemple de Radha et Krishna, d'autant
que les amours du Dieu et de la mortelle sont dans la culture hindoue, l'image de l'amour des Dieux
pour les hommes. Mais, il ne faut pas uniquement se fier ce symbolisme religieux, car faire "jaillir
le sens cach" c'est dans l'art interprtatif, avant tout expliquer, faire comprendre, lever les cons-
ciences. Tout dveloppement du sens apparat alors comme une mission sacre.
Il y a une belle histoire de la mythologie hindoue qui explique bien cette vision : le dieu
Brahma est celui qui donna la danse aux hommes. Il avait instruit un sage nomm Barhata des grands
principes du thtre et l'avait charg d'organiser la premire reprsentation. (Bharata dont l'existen-
ce n'est pas atteste passe ainsi pour tre l'auteur du Natya-Shastra dont j'ai parl prcdemment).
La premire reprsentation eut lieu lors du grand festival en l'honneur du Dieu Indra et racontait
d'ailleurs la victoire de ce dieu sur les dmons qui menaaient la terre. Or les dmons se sentirent
offenss de se voir ridiculiser sur scne et de rage, ils privrent les acteurs de leurs capacits vocales
et corporelles. Indra trs en colre livra une bataille sans merci aux dmons, mais Brahma vint ensui-
te et les ramena la raison. Il leur expliqua qu'ils n'taient pas les seuls tre montrs en position
de faiblesse dans le drame, car celui-ci doit dpeindre les hommes, les dieux et les dmons dans tou-
tes les situations. " Il n'y a pas de sage maxime, pas d'enseignement, d'art ou d'artisanat, de devise
ou d'action, qui ne soit contenu dans le drame. " (Brahma prte sa voix Reginald Massey La danse
Kathak de lInde p6)
Ce qui est frappant dans cette histoire c'est qu'elle montre que le drame se nourrit aussi de senti-
ments ridicules et de bassesses. Le thtre doit instruire en montrant tous les sentiments et chaque
homme doit y trouver matire s'lever. C'est ce qui explique d'ailleurs le ct volontiers psycholo-
gique des exemples que j'ai cits plus haut.
Toute lumire pour la comprhension, et toute laboration du langage servent ainsi faire
jaillir le sens cach et sacr. Donner une vie charnelle et concrte au pome en proposant une situa-
tion, approfondir le sens en dveloppant toutes les correspondances symboliques et mtaphoriques
possibles telles sont les tches de la danseuse.
Le langage des mudras s'ancre tout autant sur des correspondances symboliques que sur une mise
en valeur trs quotidienne des sentiments et des gestes. Il est tout entier "expression du manifeste et
41
du cach" bnficiant du pouvoir la fois descriptif et mtaphorique de toute langue gestuelle et de
tout l'enrichissement symbolique des domaines culturels et religieux.
Enfin alors que dans le rite, la mantra et la mudra sont deux sceaux, et finalement deux types
d'expressions identiques, dans la danse, le geste vient complter la parole et l'enrichir. Cet cart entre
parole et geste est ce qui me semble typiquement thtral et rejoint bien videmment les buts didac-
tiques de cet art. Dans le rite le croyant s'adresse dabord aux divinits, dans la danse, la danseuse
s'adresse au dabord public et lui parle des divinits. L'art de la danse est ax sur l'information. Nous
allons maintenant voir ce qui fait d'elle un rituel et une prire.
.
42
DANSE COMME PRIRE ET RITUEL
Origine sacre de la danse
La danse n'est pas spare de la religion et est mme ds son origine un moyen de prier.
" Bien avant notre re, nous dit Katia Legeret, l'poque des premiers Purna, la danse faisait par-
tie de la vie religieuse. Le Vishnudharmottara Purna impose au sculpteur de matriser l'art de la
danse, pour russir son uvre. Il ajoute que le dvot doit prier son Dieu en dansant afin de ne plus
jamais renatre. " (Katia Legeret Manuel traditionnel du Baratha-Natyam p18). Et ceci vraisemblable-
ment parce que les dieux eux-mmes, dansent. Ingrid Ramm-Bonwitt attribue d'ailleurs la naissan-
ce de la danse classique aux danses cultuelles en l'honneur de Krishna et Shiva, qui sont des dieux
danseurs par excellence.
D'o la tradition des devadasis ou " servantes de Dieu " attaches aux temples ds la construction
de ceux-ci. Ces danseuses par qui la transmission de la danse a pu tre assure, participaient la vie
religieuse des temples, dansaient pour les ftes rituelles, taient considres comme maries aux
Dieux. Ce statut nous donne d'ailleurs un clairage de ce que peut encore reprsenter la danse :
ascension vers le divin qui est aussi le bien-aim. Si les devadasis ont pratiquement disparu*1, le
sens spirituel de cette pratique reste comme nous allons le voir.
Dans ce chapitre, je m'attacherai l'histoire de cette danse, au sens indien du terme, c'est--dire
avant tout la mythologie qui l'entoure.
La danse est comme on l'a vu, associe une origine mythique : c'est un cadeau des dieux
mais c'est galement un cadeau pour les dieux. Katia Legeret explique ceci propos des mudr :
" Parce que le Natya-Shastra est d'origine divine, ces gestes sacrs ont t crs par les Dieux eux-
mmes dans un but hdoniste ; la racine MUD du mot mudr porte ce mme sens de " plaisir ".
C'est donc pour le bon plaisir des Dieux que les danseuses se consacraient cet art ".( Katia Legeret
p16)
L'origine divine des mudras implique un principe de fidlit. Chaque geste est consacr et
reconnu comme tant le geste de telle ou telle divinit. C'est pourquoi on retrouve les mmes
mudras dans les sculptures, les danses, les rituels, toutes ces disciplines tant profondment relies.
Dans Mudra La main enchante, Savitry Nar dit ainsi :" La sculpture s'inspire des positions de la
danse et en retour, la danse emprunte librement gestes et attitudes aux arts iconographiques" (Le
courrier de lUnesco p35). De la mme manire, la danse a probablement intgr les gestes des pr-
tres. Ce principe de rciproque inspiration n'a videmment pas t total, puisque les pays, les tradi-
tions, les cultures qui ont "absorb" les mudras sont diffrents et les ont parfois modifies.
Il n'empche que ce principe de fidlit au code reste important au sein d'une pratique donne.
Tout comme les rgles du rituel sont prvues dans les moindres dtails, la danse apparat elle aussi
comme "prvue avec une justesse mathmatique " (Ingrid Ramm-Bonwitt Mudras. La langue secrte
des yogis p16). L'art de la danse s'appuie sur un sens rigoureux de la prcision. Dans le rituel comme
dans la danse, on ne fait pas un geste mais le geste. Il est rgi par une forme, une intensit et un
sens prcis, ce qui lui confre le caractre d'un geste absolu. De cette prcision dpend non plus
l'efficacit du rite magique, mais celle de la reprsentation.
En effet, la diffrence du rituel, o la mudra sert communiquer avec le Dieu et s'acqurir une
part de sa puissance, la mudra sert dans la danse l'voquer. Mais dans les conceptions indiennes,
leurs buts ne diffrent pas vraiment : la danse tant dfinie comme double-yoga, nous allons voir
qu'elle est exprience interne de l'unit d'une part, et d'autre part qu'elle exprime l'union de l'hom-
me et du divin. Ces deux notions si prsentes dans le rituel vont cependant tre intgres dans la
43
danse, selon des processus thtraux.
La danse comme bhakti-yoga et nada-yoga :
D'abord la danse est bhakti-yoga, ou yoga de l'amour selon l'expression de Katia Legeret :
" A la diffrence du yoga de l'action ( karma-yoga) purifiant la volont et du yoga de la connais-
sance (jnna-yoga) concentr sur l'intellect, le yoga de l'amour s'attache au monde psycho-physio-
logique des sentiments, celui du bhava et du rasa "(Katia Legeret Manuel traditionnel du Bharata-
Natyam p202)
Le Bhakti-yoga est un des dveloppements de la pense de Patanjali (fondateur du yoga) qui avait
dfini la dvotion, comme un des moyens d'atteindre la runion avec le Soi ou me universelle.
Cette dvotion ou Bhakti se traduit aujourd'hui par la capacit du croyant nourrir vis--vis du
divin, des sentiments extrmement simples et d'ordre humain. C'est typiquement l'amour sensuel
que Krishna inspire aux gopis (jeunes bergres de la mythologie hindoue) et qui devient en dfini-
tive amour pour l'absolu. C'est d'ailleurs par le son de sa flte et ses danses rotiques, que Krishna
attire lui toutes les gopis.
Ainsi pour le divin, toutes les mes sont fminines, et le Baratha-Natyam qui est le plus souvent une
danse de femmes reflte bien cet tat des choses : la danse est le mouvement de cette me fmini-
ne vers son bien-aim Dieu, et pour la danseuse un moyen de rechercher le contact avec le divin.
C'est aussi l'un des thmes privilgis du Baratha-Natyam :" Les rpertoires du Baratha-Natyam
puisent la bhakti dans l'amour humain, leur qualit d'inspiration dans les types d'hrones et leur
interprtation dans le sentiment dominant du Sringara-rasa ( sentiment amoureux) "(Katia Legeret
Manuel traditionnel du Bharata-Natyam p8).
Sur le plan thtral, ceci nous ramne l'exprience intellectuelle et esthtique du rasa. La
danse en s'attachant au "monde psycho-physiologique des sentiments" apporte une connaissance
intuitive du divin, celle du plaisir esthtique et du plaisir de se savoir instruit.
" Ainsi aprs avoir assist la reprsentation dramatique du Ramayana, on saura ce qu'est l'amour
lev au rang d'un sentiment universel ". (Katia Legeret p 144) C'est ce qui explique la forte com-
posante psychologique des histoires du Barhata-Natyam, car toute relation phmre entre un
homme et une femme peut tre sublime dans la danse.
Elle est intuitive parce qu'elle est dlivre de manire sensible, elle sexprime par le corps de la dan-
seuse : l'enseignement du thtre n'est pas comparable celui d'un matre rudit mais bien "au plai-
sir et la suggestion offerts exclusivement par la femme bien-aime".(Katia Legeret p144)
Ensuite, la danse est nada-yoga, qui est union de l'me et du corps, et ceci parce qu'on peut
parvenir cette unit par la danse. On l'a vu la danse ncessite un sentiment de dvotion ; et par
elle-mme, la danse parle assez bien de l'investissement physique qu'elle ncessite.
La danseuse doit matriser son corps aussi bien que ses capacits motives et expressives. Mais on
voit bien que son interprtation se double d'une espce de dtachement. En effet, elle doit avoir de
la sympathie pour le sentiment prouv par le personnage et en mme temps une distanciation int-
rieure puisque ce sentiment est universel. C'est ce qui permet aussi de l'appeler yoga, qui combat
toutes passions.
Cette liaison interne entre le corps et l'me va donner des principes de reprsentation et c'est ce que
disait dj cette citation de l'Abhinaya-Darpana :
" O va la main, va l'il, o va l'il, va l'esprit ; o va l'esprit le sentiment s'veille et lorsque le
sentiment s'veille, nat le got ".
L'unit au niveau de la reprsentation suppose que l'motion nat du mouvement, et ceci d'ailleurs
44
par une liaison rythmique entre le geste et le regard. C'est par exemple trs net quand les mains s'ou-
vrent en Alapadma : les mains s'ouvrent en ventail et sous l'impulsion de cette ouverture le regard
se lve et traduit l'motion qui est propre au moment. L'expression du visage apparat gnralement
comme un jaillissement li au mouvement corporel et musical. Ceci nous introduit une notion
fondamentale de la danse, qui est toute entire dpendante du rythme.
Le yoga des sentiments et du corps qui fait d'ailleurs penser ce qu'Artaud disait quand il parlait de
l'acteur comme un "athlte affectif ", a une dimension religieuse pour la danseuse qui lexerce mais
il est aussi au niveau de la reprsentation, unit et harmonisation des moyens d'expression.
Si la danse est prire, elle aussi rituel commmoratif puisqu'elle rejoue la scne primordiale des
dieux.
La danse comme rituel commmoratif
En religion, on refait toujours un geste initi par le Dieu. C'est le sens qu'ont pour nous les
gestes de la transsubstantiation accomplis la messe et initis primitivement par le Christ : " Vous
ferez cela en mmoire de moi ".
De manire gnrale, la danse raconte les hauts faits des
dieux et reproduit les gestes qu'ils ont accomplis. C'est
aussi pourquoi chaque mudra est accrdite d'une origi-
ne divine. L'alphabet de cette langue gestuelle c'est en
fin de compte la somme de tous les gestes faits par les
dieux:
Pataka est le geste de Brahma pour saluer Parabrahma en signe de victoire.
Suka-tunda fut employe par Parvati, la femme de Shiva en pleine dispute amoureuse.
Musti est le poing brandi par Vishnu lors d'un combat
contre Madhu.
Suci est le signe que Brahma fit en disant : " Je suis l'u-
nique " et nous pourrions continuer la liste.
Chaque reprsentation de danse commen-
ce d'ailleurs par une conscration de la scne et un
hommage aux dieux. Pushpanjali par exemple, est
une danse d'ouverture et elle est l'" offrande de
fleurs" rituelle. La danseuse tient des ptales dans
ses mains et les rpand sur la scne au cours de la
danse. La mudra ainsi forme est puspaputta.
Cette offrande rend hommage Shiva (le seigneur
de la danse) et remercie Brahma de protger la
scne. Lors de ses dboires avec les dmons,
Brahma avait en effet demand Bharata de faire
construire un difice thtral et de placer chaque
partie sous la protection d'un Dieu, Brahma pre-
nant place au centre de la scne. De cette manire,
la danse commmore aussi sa propre naissance.
45
La danse cosmique de Shiva
La danse est donc toujours rituel commmoratif, geste de l'histoire des Dieux et ce qui me
parat plus important encore, danse cosmique, car dans la philosophie indienne, la vie suprme
danse.
C'est ce qu'incarne le Shiva-nataraja ou Shiva dansant, celui qui met en mouvement la matire, qui
dtruit et recre, induit le rythme et la danse qui sont le premier son et le premier mouvement du
monde.*
" Dans la nuit du brahman, la Nature est inerte et ne peut danser avant que Shiva ne le veuille. Il
s'arrache son ravissement et en dansant, envoie travers la matire inerte des vagues sonores qui
la secouent hors de son sommeil. Et voil ! la Nature, apparaissant en gloire autour de lui, danse
elle-aussi " ( Ananda Coomaraswamy La danse de Shiva p78 *)
Rien n'est stable sauf le changement nous dit Shiva. C'est ce qui s'exprime dans les gestes de la
danseuse qui cre une ralit pour lui en substituer immdiatement une autre. Et cela parce que l'art
gestuel propose un symbole en mouvement. Dans la sculpture la mudra symbolise une vrit ter-
nelle, dans la danse, le symbole succde un autre dans un mouvement perptuel et s'enrichit de
toutes les rsonances mtaphoriques que peut crer la danseuse. Katia Legeret qui dfinit le dan-
seur de Baratha-Natyam comme un " danseur cosmographe " explique bien cela :
" Ainsi lorsque sa main montre une fleur de lotus panouie sur sa tige, le danseur ne cherche pas
faire de cette fleur un objet spar et stable. Mais il cre au contraire, dans le psychisme de tous
ceux qui regardent son geste, un champ symbolique, ouvert l'infini, de tout ce que peut repr-
senter cette fleur. Elle existe grce toutes les analogies probables qu'elle suscite.
Cette magie de la danse sacre permet l'artiste de changer en quelques secondes de personnage,
d'humeur et de sentiment, d'tre dieu puis presque simultanment un animal ; il devient ainsi juste
un passage, une transition, un mouvement de cration perptuelle entre deux lments rythmiques
".(Katia Legeret Manuel traditionnel du Barhata-Natyam p59)
L'art interprtatif dont nous parlions prcdemment s'inscrit dans cette mme vision. " La fleur
existe par toutes les analogies qu'elle suscite ", mais que la danseuse suscite aussi, puisqu'elle fait
constamment usage de mtaphore et de rapprochement. L'art interprtatif est aussi uvre de trans-
formation, glissement d'une ralit dans une autre.
C'est enfin la distance, le dtachement qui rend possible l'vocation des ralits multiples,
de forces contradictoires. Quand Shiva danse, "ses yeux rouges refltent mille humeurs diverses"
est-il crit dans un pome tamoul. Sur le plan religieux c'est la conscration du dtachement du yogi
qui voit toutes les contradictions du monde sans y croire, c'est Shiva qui est la fois l'ascte et le
danseur originel, qui runit deux aspects apparemment inconciliables : l'extatique et le contempla-
tif.
Nous retrouvons ici un des grands principes du thtre oriental qui veut que l'acteur soit " vide ",
c'est--dire point trop charg de sentiments et d'affects, mais mobilis, prsent. Le jeu de la dan-
seuse aux antipodes de l'incarnation est avant tout une mise-en-mouvement de signes. Il s'agit d'-
tre investi dans ce large mouvement et non dans chaque dtail de l'histoire, qui est trop parcellaire.
46
* Voici une phrase de Fritjof Capra cite par Manjula Lusti Narasimhan qui permet de faire un lien entre cette vision religieuse et philo-
sophique et la physique contemporaine :
" La physique moderne a montr que chaque particule infra-atomique, non seulement excute une danse nergtique, mais qu'elle
danse. C'est une pulsation cratrice et destructrice () si bien que pour la physique moderne la danse de Siva est la danse de la mati-
re infra-atomique "
(Fritjof Capra Le tao des sciences physiques Une tude des ressemblances entre physique moderne et mysticisme oriental p244-245;
cit par Manjula Lusti Narasimhan dans BharataNatyam La danse classique de l'Inde p49)
47
" Oh, mon seigneur, ta main qui tient le tambour sacr, a mis les cieux, les autres mondes
et les innombrables mes la bonne place. Ta main leve protge aussi bien l'ordre conscient que
l'ordre inconscient de la cration. Tout dans le monde est transform dans ta main qui porte le feu.
Ta main gauche offre asile aux pauvres mes souffrantes. Ton pied lev confre tous ceux qui
s'approchent une flicit ternelle ".( Ananda Coomaraswamy La danse de Shiva p66 )
Mudra Pataka ou Abhaya symbole de
protection.
La main tient le Damaru ( tambour qui
reprsente le rythme vital )
La Kari-Hasta signifie : me voici: Shiva
recentre ainsi sur lui tout ce qui est.
La jambe gauche leve conduit sur la
voie du salut.
Mudra Ardhacandra :
elle porte le feu qui
dtruit et purifie.
48
Enfin, cette conscration de la vie comme mouvement perptuel s'appuie sur une danse
qui est tout entire rythmique. Dans la danse pure, le pied de la danseuse marque le tempo, et
chaque pas marque la naissance d'un geste du bras, de la main et des yeux. C'est ce qui confre
cette danse une grande vivacit. Dans la danse narrative, chaque signe se substitue un autre dans
un rythme donn, li la fois au mode rythmique du morceau mais aussi la ralit laquelle ren-
voie le geste. Dans la danse " Ganeshkauttuvam ", l'abhinaya (art de la communication gestuelle)
consiste montrer Ganesh, son origine, son caractre charitable, et les hommages que les hommes
lui rendent. Cette partie narrative se fait sur un tempo binaire : mais tandis que chaque geste de nar-
ration est excute sur deux temps, les mudras qui reprsentent Ganesh en propre se font sur qua-
tre temps. On voque limage du Dieu avec plus de rvrence et donc sur une dure plus longue.
Lhistoire raconte est donc galement dpendante dun rythme. Le tempo et la mlodie sont
dailleurs diffrents en fonction des sentiments ou des situations exprims par le pome.
Le rythme c'est l'intuition essentielle d'un mouvement biologique, battement du cur, mouvement
de la respiration, et d'un mouvement du monde, alternance des saisons, cycle de mort et de renais-
sance. Ainsi, Ys Tardan-Masquellier crit-elle :
" Entre rythme et rite, entre la vibration qui atteste la prsence de la vie et la sacralisation de cette vie
par le biais d'une gestuelle canonique, s'est dvelopp l'un des domaines privilgi du religieux ".
La danse indienne rejoint ici le rite, au sens du mot sanskrit rita, c'est--dire, " ensemble d'attitudes
ou de gestes destins maintenir ou recrer l'ordre du monde, l'agencement primordial voulu par
le divin. " (Ys-Tardan Masquellier Le cur, le jour, la nuit article dans Le courrier de l'Unesco p14-15)
*1.Entre le XVIIme et le XIXme, les devadasis partirent des temples qui ne pouvaient plus les prendre en charge, et cherchrent asile
dans les cours princires. Ceci entrana une lacisation des thmes de la danse, mais surtout un changement de statut social de ces
danseuses qui furent finalement considres comme de simples courtisanes. Le Baratha-Natyam tomba dans une disgrce telle qu'il fut
menac d'interdiction, et que sans l'effort de grandes personnalits comme E.Krishna Iyer et Rukmini Devi Arundale, ce serait mainte-
nant un art oubli. Renaissant de ces cendres, il suscite aujourd'hui un grand engouement et est reprsent dans des difices religieux
aussi bien que non religieux. Cependant cette priode de l'histoire a marqu l'extinction des devadasis comme danseuses exclusive-
ment dvoues au temples. L'ambigit du statut des devadasis qui taient aussi des " prostitues divines " -ce qui suivant les femmes,
revtaient d'ailleurs un sens diffrent- explique aussi cette volution. Elle explique aussi pourquoi on a considr cette danse comme
inconvenante et mme obscne.
CONCLUSION DANSE
La danse indienne est sacre d'abord parce que dans la pense hindoue, la danse " procde de
l'esprit divin ". Les Dieux dansent, ils ont donn la danse comme cadeau aux hommes, et chacun
de leur geste a initi les gestes que la danseuse fait sur scne.
Pratiquement, c'est en racontant le monde " sous un point de vue divin " que le langage gestuel
rejoint le geste sacr : d'abord, il exprime et sacralise la vie en l'ordonnant dans des gestes esth-
tiques et rythms. La beaut des gestes doit magnifier les objets qu'ils reprsentent et la beaut de
la danseuse, elle-mme refaonne l'image de l'homme. Le rythme, c'est la pulsation du monde, qui
marque la cration et la destruction de la matire, que la danseuse reproduit en voquant de multi-
ples ralits dans un rythme donn.
D'autre part, le langage gestuel est sacr car il permet d'instruire le spectateur : la danseuse racon-
te une histoire et dveloppe tous les sens qu'elle peut avoir. En utilisant les mtaphores et les cor-
respondances symboliques, elle lve les sentiments dont elles parlent et les rend exemplaires.
Le geste sacr vaut donc toujours pour sa capacit sublimer le monde, montrer les liens qui exis-
tent entre le monde divin et humain. Mais contrairement au rite, il le fait par la voie de la narration.
Alors que dans le rituel, le geste est synthtique, il affirme en un seul signe la relation et l'union de
l'homme et du divin, la danse dveloppe toutes les analogies possibles, s'enfonce dans les replis de
la vie psychologique et lui donne une dimension potique et spirituelle.
Et l encore cette vision religieuse se nourrit des donnes du langage gestuel puisqu'on a vu que
celui-ci est propre l'expression mtaphorique et pas seulement l'vocation de ralits concrtes.
En rvlant les fondements mtaphoriques de la production des signes sourds-muets, Danielle
Bouvet met en vidence l'aptitude humaine conceptualiser du " non-physique " par des termes
physiques.
Cet esprit d'analogie trouve dans la pense indienne un terrain privilgi puisqu'elle tablit un lien
constant entre le divin et l'humain.
Il peut galement apparatre comme une attitude gnrale de l'homme ou plutt de cet " homme-
mimeur " dont parle Marcel Jousse dans L'Anthropologie du geste. Selon Marcel Jousse en effet, l'hom-
me reproduirait spontanment les actions du monde qui l'entourent et ceci dans un processus de
connaissance et d'appropriation de l'univers. Ainsi l'enfant imite-t'il le train en marche, en repro-
duisant son mouvement partir de son propre corps. Ces gestes spontans vont se fixer en un code
ou " une strotypie de gestes ", auxquelles l'homme va prter un sens qui excde la pure repro-
duction physique :
" Son chant de triomphe c'est l'invention de l'analogie () L'homme va pouvoir prendre chacun
de ses gestes mimismologiques et en sublimer le sens ".( Marcel Jousse La parole, le parlant et la souf-
fle p55).
Mais en imitant les interactions du rel ambiant, " l'homme exprime un langage gestuel, spontan
et universel " et " il met un langage de type ethnique et particularis ". ( Marcel Jousse
L'anthropologie du geste p43). En effet, si on peut dfinir ce mimtisme comme un mode universel de
connaissance et de dcouverte, il faut effectivement convenir que l'homme ne slectionne pas les
mmes donnes de l'exprience corporelle et qu'il ne les exprime pas non plus de la mme mani-
re, autant dans le langage verbal que dans le langage corporel. Ceci a son importance dans cette
tude, qui ne milite aucunement pour l'universalit du geste par opposition ce qui serait la non-
universalit de la parole. Si la langue gestuelle apparat comme plus propre parler de notre exp-
rience corporelle au monde, il n'empche qu'elle est aussi une institution culturelle. Dans l'ide de
pouvoir faire des liens entre l'tude des mudras indiens et une dmarche thtrale quelconque, cette
remarque me semble importante.
49
Le geste est aussi culturel : il ne s'agit donc pas de s'intresser au langage gestuel comme
moyen de communication universelle, mais comme potentiel expressif et signifiant, et par l, th-
tral. Il ne s'agit pas non plus de sparer le pouvoir de la parole et de celui du corps, dans la mesu-
re o il n'y a pas d'un ct un langage du corps qui serait naturel et expressif et de l'autre ct, un
langage verbal qui serait culturel et signifiant. Dans Phnomnologie de la perception, Merleau-Ponty
explique ainsi:
" Tout est fabriqu et tout est naturel chez l'homme, comme on voudra dire, en un sens qu'il n'est
pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose l'tre biologique- et qui en mme temps
ne se drobe la simplicit de la vie animale, ne dtourne de leur sens les conduites vitales, par une
sorte d'chappement et par un gnie de l'quivoque qui pourraient servir dfinir l'homme. ()
Par exemple, le froncement de sourcil destin, selon Darwin, protger l'il du soleil, ou la conver-
gence des yeux, destine permettre la vision nette, deviennent des composantes de l'acte humain
de mditation et le signifie au spectateur. Le langage son tour ne se pose pas d'autre problme :
une contraction de la gorge, une mission d'air sifflante entre la langue et les dents, une certaine
manire de jouer avec notre corps se laisse soudain investir d'un sens figur et le signifient hors de
nous. Cela n'est ni plus ni moins miraculeux que l'mergence de l'amour dans le dsir ou celle du
geste dans les mouvements incoordonns du dbut de la vie."( Merleau-Ponty Phnomnologie de la
perception p221 et226)
Cette citation de Merleau-Ponty me semble bien mettre en vidence que la matrialit de nos outils
d'expression, (de notre corps et de notre voix), nous permet de produire un sens figur. En ce sens,
il n'y a pas d'action physique purement efficace, tout comme il n'y a pas de parole qui ne se rdui-
rait qu' son contenu verbal : on signifie toujours plus que ce qu'on fait et que ce qu'on dit.
On comprend donc que la parole est expressive tout comme le corps signifie, et ceci par ce gnie
de l'quivoque dont parle Merleau-Ponty , et que Marcel Jousse appellerait sans doute " sublima-
tion ".
Dans l'tude des mudras je me suis attache voir comment le geste signifie par une codification
volontaire et consciente, en vue d'une communication religieuse d'une part, thtrale de l'autre.
L'ide que les mudras sont des " gestes sacrs " nourrit videmment cette recherche, le sacr cris-
tallisant ce qu'on pourrait percevoir comme de plus fort et de plus frappant dans la communication
du sens.
Trois questions en lien avec la dmarche thtrale, sen dgagent :
La puissance du symbole religieux est-elle dans notre socit encore oprante et peut-elle consti-
tuer un matriau thtral ?
Est-il possible de crer un code gestuel au sein d'une reprsentation et qu'est-ce que cela implique
du point de vue de l'acteur ?
Enfin, quel rle peut avoir une pratique corporelle aux cts de l'expression verbale ?
Les symboles religieux dans le thtre daujourdhui
Les symboles religieux hrits de notre culture chrtienne, quand ils sont ports la scne attes-
tent de la perte du sacr dans nos vies.
En septembre 2001, Ingrid Wantoch-Rekowski proposait dans " In-H-Moll ", une mise en scne
d'une messe de Jean-Sbastien Bach, qu'on pourrait dire " maniriste ". Les mains des personna-
ges taient anims de mouvement constants reproduisant avec mollesse et lascivit des symboles
religieux. De ces attitudes des mains il ne restait que la posture, et en ayant perdues leurs sens, elles
50
CONCLUSION GNRALE
inspiraient un sentiment de dcadence.
L'anne d'avant, dans son spectacle " Rien de rien " le chorgaphe Sidi Larbi-Cherkaoui utilisait
ces mmes gestes religieux mais en les magnifiant : un signe de la main se substituait un autre
comme si on avait vu dfiler les unes aprs les autres les attitudes du Christ et de nombreux saints.
La chorgraphie exprimait une trs grande douceur et ces gestes apparaissaient comme l'vocation
d'un paradis perdu.
Dans ces deux exemples on voit que le symbolisme religieux quand il apparat sur nos scnes parle
d'abord de l'cart qui existe entre ces symboles et nos vies. Et pourtant le fort sentiment que les
deux reprsentations m'ont laiss, se nourrissait de cette motion de la reconnaissance qui me sem-
ble typique des symboles religieux. Si nous ne savons pas ou plus le sens prcis de ces gestes des
mains, ils veillent en nous le souvenir d'images, de rcits, d'attitudes religieuses, et sont " nimbs "
de spiritualit. Le mystre qui entoure leur sens exact participe d'ailleurs de cette atmosphre spiri-
tuelle qu'il dgage. Gertrud Hirshi disait ainsi propos de la mudra :" Un sceau protge aussi tou-
jours ce qu'il y a de mystrieux. Je ne crois pas que nous comprendrons jamais entirement l'essence
d'une mudra. Car, l o il y a du mystre, on touche au divin ". C'est un degr plus fort ce qui
nous arrive face aux symboles religieux chrtiens.
Dans " Rien de rien ", on ressentait une espce de nostalgie l'gard de ces signes sacrs, nostalgie
de la " puret " peut-tre, de la douceur, en tout cas d'une transcendance dont nous serions privs.
L'vocation des symboles religieux dans " In-H-Moll " est plus complexe : la raison en tant peut-
tre que le propos de la mise-en-scne ne rsidait pas exclusivement dans une mise en perspective
du sacr. Il s'en dgageait un aspect sacrilge du fait du mlange entre l'rotisme que suggraient
les corps des personnages et les attitudes religieuses qu'ils prenaient. On pourrait d'ailleurs y voir
une vocation de la sensualit qu'expriment certains tableaux religieux, de ces saintes et ces saints
en extase et de leurs postures. Cette sensualit trouble signifiait avant tout le manirisme des chan-
teurs et peut-tre de la grande musique religieuse, donc d'un certain type de code thtral.
Cependant, le caractre sacrilge qui sen dgageait est intressant, dans la mesure o le symbole
religieux circonscrit un cercle de sens dont l'rotisme est banni, en tout cas un rotisme profane. Le
geste sumbolique chrtien conserve donc un pouvoir de communication, et une mise en scne qui
droge aux rgles inhrentes cette communication religieuse, produit une " friction de sens".
Le symbole religieux dit aussi quelque chose du pouvoir et de la soumission. Dans limage
dAmithaba et du fidle ou dans certaines scnes d'imposition des mains, le puissant fait le signe de
bndiction ou de protection, celui qui est protg joint ses mains en signe de soumission. Le
domaine religieux implique une hirarchie entre les tres, en fonction de leur saintet et de leur pro-
ximit avec les plus hautes valeurs spirituelles. Cette hirarchie implique mme un code de lecture
dans les images du Moyen-Age : on ne peut " lire " ce que disent les mains, que si on se rfre au
statut social des personnages.
Dans un exercice de jeu de 3me anne l'Insas, nous avions utilis un geste d'invocation dans le
sens dune soumission. Dans ladaptation du mythe dAlceste, Alcmne voyant que sa femme,
Alceste a russi braver la mort en tuant son " soldat " (le cerbre de la mythologie grecque) est
saisi deffroi et dit :
" Pardonne-moi. La vrit est parfois cruelle, pourtant je la dirai : un qui meurt c'est injuste, pro-
fondment cruel, mais n'est-ce pas mieux que l'anantissement de tous ? Oui l'anantissement. La
vie retrouve, qu'est-ce que c'est ? Un outrage la mort, un soufflet la mort ! Elle cherchera se
venger. Alors que verrons-nous ? Nos enfants frapps, et frapps aussi les frres et les surs, frap-
ps nos parents, ma mre et la tienne, femme, et nous-mmes en dernier incapables de sauver notre
famille. L'extermination, voil ce que nous vaudra le dernier bonheur de te revoir. L'extermination.
" ( Trompe-l'il (Naissance du thtre) dans Pices d'identit de Jean-Marie Piemme p 42)
51
Pendant toute cette tirade, le comdien avait les bras tendus au ciel dans une attitude rigide et exta-
tique. Ce geste d'imploration renforait le comportement senti de cet homme qui a peur et le carac-
tre apocalyptique de son langage, mais du mme coup il accentuait la lchet de son discours :
acceptation de la fatalit, subordination une force vcue comme plus grande que soi, supplique
lche face une force meurtrire.
Il posait galement question sur la demande de transcendance. Le geste d'imploration montre un
homme qui s'abandonne au Dieu et sa Loi. Mais si cette loi est inique, si le Dieu est cette force
implacable et injuste qu'est la mort, que devient cette demande d'une ralit transcendante ?
En fait on voyait s'oprer un renversement des valeurs : il n'y a pas de Dieu, il n'y a que la mort qui
rgne encore; c'est donc dans le geste humain, dans l'audace, la lutte et mme une sorte de mga-
lomanie, que rside la transcendance. Alceste brave la mort, c'est elle le " sauveur " :
" Oui ta vie m'est sacre, elle est mon sacrement, ma rdemption, ce que j'ai donn, je l'ai donn et
je prfre le perdre que de le donner moiti () Tu ne prends pas ma vie pour sauver la tienne,
je te la donne, ma vie, oui je te la donne, la voil, prends je te la donne comme un royal cadeau et
ce cadeau l tu ne pourras jamais me le rendre, et ainsi, jamais pour les sicles des sicles, je rgne-
rai sur toi. " (p36)
Les valeurs sacres ne sont pas o on les attend. Dans ce texte autant que dans le geste dinvoca-
tion, on comprend que lattitude religieuse recle une puissance, mme si elle est dtourne. Elle
signifie avec intensit des situations et des prises de position, car le langage de la foi est une expres-
sion ancre dans notre culture.
Faire un geste qui soit un signe.
Cette tude pose galement la question du code. On peut prendre des gestes symboliques prexis-
tant et les mettre en scne, mais peut-on en crer ?
La danse indienne en utilisant un langage gestuel raffin pour dcrire des situations quotidiennes,
montre une manire de " magnifier " le geste quotidien. Cest dj un moyen de crer un code ges-
tuel, de proposer des gestes exemplaires. Dans le cinma expressionniste, on retrouve le mme pro-
cessus : les mouvements du corps sont amplifis et dramatiss, chaque mouvement est devanc par
un contre mouvement qui permet d'en saisir le dploiement. Dans ces films, on reconnat des ges-
tes rels, mais en plus forts, en plus signifiants. On y voit galement une manire de matrialiser
les motions, les attitudes corporelles signifiant aussi des penses et des sentiments. Cette expres-
sion vient du linguiste I.Fonagy qui explique que la parole est un " geste buccal " :
" Chaque attitude extriorise le contenu mental d'une attitude motive et intellectuelle() On pour-
rait parler d'une matrialisation de l'motion. L'motion qui n'est, semble-t-il qu'une internalisation
d'une action refoule, est retransforme en actes ".(I. Fonagy La vive voix p40 et 42)
Ce que dit ce linguiste de la vive voix, dans des images physiques pourrait s'appliquer au langage
corporel du thtre : elle montre que l'motion peut tre considre comme un geste refoul mais
aussi que dans un processus de communication, les penses et sentiments sont retransforms en
actes. La codification des attitudes dans les reprsentations du Moyen-Age me semble intressan-
te de ce point de vue.
Dans le geste de refus du peuple " face la parole des bons prlats " ( cf le chapitre sur l'icono-
graphie religieuse), on reconnat le geste de rpulsion qui serait le plus pulsionnel, le cas d'une mo-
tion o justement le geste ne serait pas retenu, mais celui-ci est cependant comme " fig mi-cour-
se ". La main retourne au bout d'un bras tendu est alors le signe de ce refus : signe qui exprime la
violence du geste qui le sous-tend et en mme temps le mdiatise.
Ceci me semble galement une clef pour la reprsentation thtrale. On ne peut aller dans la vio-
lence motionnelle et mme dans une forme de sauvagerie que si on trouve un signe, un quivalent
52
qui l'exprime. Dans le code gestuel, on pourrait trouver une forme qui voque le geste le plus
dchan et le plus violent, qui montre que la violence est sa source et qui en mme temps la cana-
lise. Ceci me semble intressant d'une part comme processus gnral de " matrialisation de l'mo-
tion ", mais particulirement si l'on doit reprsenter des actes que j'appellerais " honteux ": l'humi-
liation, le meurtre, le viol par exemple. Comment trouver des quivalents scniques qui communi-
quent cette violence sans l'exhiber ?
Cette violence symbolique, le thtre pourrait d'ailleurs parfois la puiser dans certains gestes rituels.
" Lorsque dans la Chine classique le fils tmoigne du deuil de son pre par une srie de sautille-
ments protocolaires, il n'exprime pas seulement la douleur par une gestuelle rituelle cathartique : il
mime galement la mort et le passage, car le saut, li au discontinu, symbolise la rupture entre deux
tats, entre deux mondes. Il actualise la sparation, la reprsente dans un crmonial qui lui permet
de l'assimiler et de la rendre psychologiquement et socialement acceptable ". (Ys Tardan-
Masquellier article Le cur, le jour, la nuit dans Le courrier de l'Unesco p 15)
Lorsque Ys Tardan-Masquellier dcrit cette " gestuelle cathartique ", on ne peut s'empcher d'y
voir le matriau mme du thtre. Dj, on pourrait mettre l'essai cette action rituelle sur scne et
demander l'acteur qui joue Hamlet de sautiller prs de la tombe de son pre. On verrait si cette
action peut nous raconter une immense douleur. On pourrait galement se demander si nous iden-
tifions ce saut comme un mime du passage, et rflchir un geste qui dans notre culture, pourrait
exprimer ce passage de la vie la mort.
D'autre part, ce rituel qui permet de rendre la mort " psychologiquement et socialement accepta-
ble ", me semble une ide qu'on pourrait avoir du thtre, c'est dire une reprsentation qui per-
mette d'apprivoiser les mystres et les douleurs de l'existence en les ritualisant, en leur donnant
forme.
Le caractre symbolique des mudras tient au fait qu'elles apparaissent comme un lien entre le visi-
ble et l'invisible. L'ide que le geste est un sceau a pour moi une forte rsonance thtrale. Dans la
scne de Radha attendant son amoureux Krishna on a vu que ses gestes de prparation dcrivait
aussi symboliquement l'empreinte amoureuse du Dieu sur le corps de cette femme. Comment sur
scne trouver des gestes ou des actions qui rpondent la fois de la manire la plus adquate et la
plus concrte une situation, et comment y insuffler un peu de mythologie, en faire un geste qui
rsonne avec une attitude plus fondamentale ?
Dans " Amazone ", un spectacle jeune public sur lequel j'ai travaill cette anne, nous avions inven-
t un rituel du matin qui consistait se mettre de la poudre sur le visage avant de commencer la
journe. Nous sommes dans une classe d'amazones, o l'institutrice apprend aux lves se mfier
et combattre l'ennemi. La poudre sur le visage voquait la fois un monde fminin et une pein-
ture de guerre, comme si le rituel de coquetterie tait aussi une prparation au combat. C'tait une
manire de rendre compte de la mythologie de ces femmes guerrires tout en restant dans le cadre
absolument quotidien des ablutions matinales.
Ce parallle paratra peut-tre dplac puisqu'il chappe la dimension du geste sacr, mais c'est en
fait par ce biais l que m'intressent le langage gestuel de la danse indienne : il fait jouer en mme
temps, une situation concrte et un sens plus large. En ce sens, on pourrait lappeller geste symbo-
lique.
De nouveau, le langage du Moyen-Age exprime bien cette manire de crypter le geste rel. Dans
la scne qui suit, Ponce Pilate est face Jsus et va se " laver les mains ". Or, l'attitude des mains
indique autre chose grce au code gestuel : selon Franois Garnier, la " main tenant son poignant
ou sa main " est signe d'impuissance. L'individu en se ligotant la main montre qu'il ne peut agir.
Cette attitude gestuelle est employe, dans une situation dramatique, o l'individu ressent une dou-
leur intense parce que les vnements auxquels il est confront, sont irrmdiables. Face la mort
53
d'un homme, les pleureuses font souvent ce
geste. Chez l'iconographe qui dessine Ponce
Pilate, on retrouve ce " gnie de l'quivoque
", " cet chappement du sens " dont parlait
Merleau-Ponty : non, Ponce Pilate ne s'en
lave pas les mains, " il est partag entre la
peur et l'envie de sauver le juste ". ( Franois
Garnier Le langage de l'image au Moyen-Age p
102 et 105). Ce geste est donc concret et
figur, ce qui me parat bien rpondre au
sceau qui scelle le visible et l'invisible. A
nouveau, pourrions nous sur une scne uti-
liser cette attitude des mains, pour exprimer
les tensions psychiques d'un individu, pour-
rions-nous l'imposer comme code ?
Du point de vue de l'acteur enfin, on peut galement retirer quelque chose de la thtrali-
t de la danse indienne, qui est d'abord comme je l'ai dit, mise en mouvement de signes et non pas
interprtation psychologique. Si l'acteur parie sur un signe pour exprimer un sentiment, un tat ou
une situation, il parie sur quelque chose de plus fort que s'il compte seulement sur ses propres for-
ces motionnelles. Ceci pour moi rejoint d'ailleurs la dmarche de Yoshi Oda quand il s'intresse
aux rituels shingon. Dans une scne du " Mahabaratha ", o Drona se suicide, cet acteur enlevait le
haut de ses vtements et se renversait sur la tte une grande jarre d'eau, de couleur rouge sang, qui
se rpandait ainsi sur son corps imprgnait la terre. Il dcrit ainsi son travail d'acteur pendant cette
scne :
" Au dbut, le musicien japonais Toschi Tsuchitori commenait un battement rgulier de tambour.
Je le prenais pour point d'appui et je m'efforais seulement de relier mes mouvements au tambour.
Pour moi, il n'y avait rien d'autre, seul le lien entre le tambour et les mouvements de mon corps ;
je restais conscient du jo-ha-kyu ( progression rythmique) et je n'oubliais pas la nature de la situa-
tion. C'tait un moment sinistre mais je ne jouais pas la tristesse Je ne m'encombrais pas l'int-
rieur de tout un fatras psychologique ; je me contentais de respecter la situation et de me concent-
rer sur la musique. En retour cette concentration provoquait une sorte de vacuit intrieure o le
public pouvait projeter son propre imaginaire et s'inventer toutes sortes d'histoires propos de ce
que je ressentais. "
(tmoignage de Yoshi Oda dans l'article de Denise Schrpfer Peut-on enseigner la prsence ? La leon de
Yoshi Oda dans La prsence de l'acteur p 63)
Ici on comprend bien que la voie prise par la mise-en-scne de Peter Brook est celle du signe plu-
tt que de l'interprtation psychologique. Du coup, l'acteur se concentre sur la ralisation de cette
action symbolique. Quand Yoshi Oda explique, qu'il reste conscient de la situation, j'y vois un type
d'motion particulire non pas lie au sentiment, mais lie la conscience de la porte symbolique
de son action. C'est mon sens ce qui se joue dans les gestes rituels shingon, o l'initi a conscience
du symbole qu'il cre par ses doigts, et que cette conscience le met dans un tat particulier.
C'est la concentration sur laction elle-mme qui semble donner de l'intensit au jeu de Yoshi Oda.
Dans le rituel, on a vu que l'initi doit se concentrer galement sur le faire, par la rcitation exacte
des mantras et l'excution des mudras.
Ceci tend dire que le jeu de l'acteur pourrait parfois rsider dans le " bien faire un geste ". Et du
point de vue du metteur-en-scne, elle indique quon peut dfinir une action en termes concrets et
physiques autant quen termes daffects.
54
Rgnrer le langage verbal par le corps.
Enfin, dans l'ide d'une recherche thtrale, l'tude du langage par le biais du corps me semble une
voie intressante. Danielle Bouvet dit ainsi :
Ce qui rend fascinant lapprentissage des langues gestuelles, cest quelles veillent chaque sujet
parlant la conscience des fondements mtaphoriques de la pense, fondements souvent ensevelis
sous les expressions verbales dsincarnes de la gestuelle qui les a fait natre, mais que le medium
dune langue gestuelle fait ressurgir. ( Danielle Bouvet Le corps et la mtaphore dans les langues gestuel-
les p88).
Dans la pratique thtrale, on peut retrouver de telles proccupations. Il m'est arriv ainsi de tra-
vailler selon la mthode de Jacques Lecoq, sur les " gestes dactions". En les jouant de manire phy-
sique, on peut revenir la source dactions qui trouvent principalement un sens mtaphorique dans
le langage verbal. Quelles forces physiques engagent le fait de " pousser " ou encore de " tirer "
quelqu'un ou quelque chose ? C'est ce rapport physique qu'on oublie gnralement quand on dit "
j'ai t tir d'embarras " ou encore " j'ai t pouss telle ou telle extrmit ". Dans le thtre, nous
avons peut-tre apprendre de ces expressions prises au pied de la lettre, car elles clairent nou-
veau le sens fondamental de nos mots. C'est exactement ce mme type de pense qui me semble
l'uvre dans la mise en scne de Matthias Langoff dont jai parle prcedemment. L'expression "
retourner sa veste" en tant joue de manire littrale, merge avec une nouvelle intensit. Ce qui
frappe, c'est la fois la nouveaut du procd mais aussi la froce vidence du geste. Comme si en
revenant la base de cette expression, on retrouvait toute sa vigueur et son pouvoir ironique.
Nous avons ici une dmarche inverse celle prcedemment dcrite. Au lien de donner un sens figu-
r une action concrte, on chercherait ce quil y a de concret dans les expressions figures, mais
tout cela dans le mme but, rendre le corps signifiant, cest--dire le concevoir comme un lieu dex-
pression charnelle et spirituelle.
55
BIBLIOGRAPHIE
Antonin ARTAUD, Le thtre et son double, folio, 1994 Saint-Amand, collection folio essais.
Eugnio BARBA, Nicola SAVARESE, Anatomie de l'acteur Un dictionnaire d'anthropologie thtrale,
Bouffoneries Contrastes, 1988 France.
Hlne BAYON, Amida OKADA, Brnice GEOFFROY-SCHNEITER, L'ABCdaire du
Bouddhisme, Flammarion, 2000 Paris.
David BOLLAND, A guide to Kathakali ( Un guide de Kathakali) Sterling Paperbacks, 1980 New-
Dehli.
Danielle BOUVET, Le corps et la mtaphore dans les langues gestuelles A la recherche du mode du production
des signes, L'Harmattan, 1997 Paris, collection Smantiques.
Ananda COOMARASWAMY, The dance of Shiva, (La danse de Shiva), Asian Publishing House,
1948 Bombay.
Jacques DUPUIS, Inde. Une introduction la connaissance du monde indien, Edition Kalash, 1997
Pondicherry Inde, collection Civilisation et Socit.
Louis FREDERIC, Les Dieux du Bouddhisme. Guide iconographique, Flammarion, 1992 Tours.
Franois GARNIER, Le langage de l'image au Moyen-Age:
Tome 1 : Signification et symbolique, Le lopard d'Or, 1982 Paris
Tome 2 : Grammaire des gestes, Le Lopard d'Or, 1989 Paris
Gertrud HIRSHI, Les mudras. Le yoga au bout des doigts, Le courrier du Livre, 2000 France.
Georges JEAN, Langage des signes. L'criture et son double, Gallimard, 1989 Evreux, collection
Dcouvertes.
Marcel JOUSSE, L'anthropologie du geste, Gallimard, 1991 Mayenne.
Tyra de KLEEN, The ritual Hand-poses of the Buddha priests and the Shiva priests of Bali (Les poses de
mains rituelles des prtres bouddhistes et shivastes Bali), ESS ESS Publications, 1975 Dehli.
Katia LEGERET, Manuel traditionnel du Bharata-Natyam. Le danseur Cosmographe, Librairie orienta-
liste Paul Geuthner Reugny, 1999 France.
Manjula LUTSI-NARASIMHAN, Baratanatyam. la danse classique de l'Inde, Edition Adam Biro
Muse ethnographique de Genve, 2002 Italie.
Reginald MASSEY, India's Kathak Dance Past, Present Future ( La danse Kathak de l'Inde :Pass, Prsent,
Futur), Abhinav Publications, 1999 India
Savitry NAIR, article Mudr la main enchante, dans la revue Le courrier de l'Unesc, ( Geste, Rythme
et Sacr. La Nostalgie des origines ), Septembre 1993.
Yoshi OIDA, L'Acteur flottant, Actes Sud, 2001 Mayenne.
Ingrid RAMM-BONWITT, Mudras-Geheimsrpache der Yogis ( Mudras La langue secrte des yogis), Aller,
1987 Freiburg.
56
Denise SCHROPFER, article Peut-on enseigner la prsence ? La leon de Yoshi Oda, dans l'ouvrage col-
lectif Brler les planches Crever l'cran La prsence de l'acteur, L'entretemps, 2001 Saint-Jean-de-Vdas.
Ys TARDAN-MASQUELIER, article Le cur, le jour, la nuit, , dans la revue Le courrier de
l'Unesco, ( Geste, Rythme et Sacr La Nostalgie des origines ) Septembre 1993.
Dharam VIR SINGH, Hinduism an Introduction ( L'hindouisme une introduction), Travel Wheels, 1991
New-Dehli.
Ouvrages cits par certains auteurs ci-dessus :
Cits dans le livre d'Ingrid RAMM-BONWITT :
Karlfried DURCKHEIM, Wunderbare Katze (Le chat merveilleux ), Scherz Verlag, 1982 Bern
Mnchen Wien.
D. Thomas OHM, Die Gebetsgebrde der Vlker und das Christentum ( Le Christianisme et les gestes de
prire du peuple), E.J Brill, 1948 Leiden
Cits dans le livre de Danielle Bouvet :
H. LANE, Quand l'esprit entend, Odile Jacob, 1991 Paris.
M. MERLEAU-PONTY Phnomnologie de la perceptionn Gallimard, 1945 Paris.
I. FONAGY La vive voix, Payot, 1943 Paris.
Cits dans le livre de Manjula LUTSI-NARASIMHAN :
Fritjof CAPRA, The Tao of Physics. An exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern
Mysticism ( Le Tao des sciences physiques. Une tude des ressemblances entre physique moderne et mysticisme
oriental), Shambhala Publications, 1985 Boston.
57
Vous aimerez peut-être aussi
- Devi Mahatmya en FrançaisDocument37 pagesDevi Mahatmya en FrançaisRozalia Nagy100% (1)
- Liste de Mantras (Partie 1)Document4 pagesListe de Mantras (Partie 1)BenSolBard100% (5)
- Kundalini Le Yoga Du Feu Michel Coquet PDFDocument308 pagesKundalini Le Yoga Du Feu Michel Coquet PDFbrumim-1100% (3)
- Energie Vitale Et Autoguérison - Mantak ChiaDocument89 pagesEnergie Vitale Et Autoguérison - Mantak Chiajeromyst100% (9)
- LE CODE SOPHIA: Une transmission vivante de la Tribu des Dragons de SophiaD'EverandLE CODE SOPHIA: Une transmission vivante de la Tribu des Dragons de SophiaPas encore d'évaluation
- Mantras Et Diagrmammes Rituels Dans L.hindouisme. (T.ronde) (Paris, 1986)Document246 pagesMantras Et Diagrmammes Rituels Dans L.hindouisme. (T.ronde) (Paris, 1986)chetanpandey95% (20)
- La Doctrine Secrete de La Deesse Tripura PDFDocument166 pagesLa Doctrine Secrete de La Deesse Tripura PDFtchouang_zu100% (5)
- Les ChakrasDocument14 pagesLes Chakrasbokajude100% (5)
- La KundaliniDocument24 pagesLa Kundalinizindabad780% (5)
- Le Dieu ShivaDocument3 pagesLe Dieu ShivanicolasPas encore d'évaluation
- Pierre Feuga - Tantrisme PDFDocument347 pagesPierre Feuga - Tantrisme PDFbooksocialist100% (9)
- Souffle et corps subtil: Nâdis,chakras,padmas,tattvas,vayusD'EverandSouffle et corps subtil: Nâdis,chakras,padmas,tattvas,vayusPas encore d'évaluation
- Kundalini: Le Guide Ultime Pour Éveiller Vos Chakras Par Le Yoga Kundalini Et La Méditation Et Pour Faire L'expérience De La Conscience Supérieure, De La Clairvoyance, Du Voyage Astral, De L'énergie Des Chakras Et Des Visions PsychiquesD'EverandKundalini: Le Guide Ultime Pour Éveiller Vos Chakras Par Le Yoga Kundalini Et La Méditation Et Pour Faire L'expérience De La Conscience Supérieure, De La Clairvoyance, Du Voyage Astral, De L'énergie Des Chakras Et Des Visions PsychiquesPas encore d'évaluation
- Sogyal Rinpoché: Les neufs yana et conseil essentiel: comment pratiquerD'EverandSogyal Rinpoché: Les neufs yana et conseil essentiel: comment pratiquerPas encore d'évaluation
- Chakras évolution: 7 portails d’éveil, de transformation et de réalisation de SoiD'EverandChakras évolution: 7 portails d’éveil, de transformation et de réalisation de SoiPas encore d'évaluation
- Bruno Bayle de Jessé - Initiation Tantrique (1991) PDFDocument335 pagesBruno Bayle de Jessé - Initiation Tantrique (1991) PDFbooksocialist100% (11)
- Mantras - Boudhisme Belle Selection - FRDocument4 pagesMantras - Boudhisme Belle Selection - FRMateta EliePas encore d'évaluation
- Les 21 ChakrasDocument1 pageLes 21 Chakraslsakhraji0% (1)
- Ganapati Upanishad PDFDocument6 pagesGanapati Upanishad PDFJuliano CostaPas encore d'évaluation
- Les 36 TattvasDocument1 pageLes 36 TattvaslsakhrajiPas encore d'évaluation
- Third Eye e Book in French PDFDocument50 pagesThird Eye e Book in French PDFnicolas100% (1)
- Lilian Silburn - La Kundalini, Ou L'énergie Des Profondeurs PDFDocument252 pagesLilian Silburn - La Kundalini, Ou L'énergie Des Profondeurs PDFbooksocialist100% (12)
- Chant Du Silence 2Document470 pagesChant Du Silence 2Marianne CostaPas encore d'évaluation
- Tout Savoir Sur Les ChakrasDocument16 pagesTout Savoir Sur Les ChakrasBrunet Isabelle100% (2)
- L'EVEIL, La Vie de Paramhansa YOGANANDA - Abord de La Spiritualité Par L'esprit Journalistique.Document13 pagesL'EVEIL, La Vie de Paramhansa YOGANANDA - Abord de La Spiritualité Par L'esprit Journalistique.Richard ANDREPas encore d'évaluation
- 1955 Les Mysteres Du Feu PDFDocument51 pages1955 Les Mysteres Du Feu PDFalassw100% (2)
- Lexique Sanskrit de Philosophie Du YogaDocument29 pagesLexique Sanskrit de Philosophie Du Yogacorina_bianca2001100% (1)
- Les Chakras Et L InitiationDocument129 pagesLes Chakras Et L InitiationFréderic PertusaPas encore d'évaluation
- Aspects Ignorés Du TantrismeDocument5 pagesAspects Ignorés Du TantrismeMarc75% (8)
- La Maitrise Du Prana PsychiqueDocument2 pagesLa Maitrise Du Prana Psychiquejean_bon_1Pas encore d'évaluation
- Bouchart D'orval, Jean - Reflets de La Splendeur - Le Shivaïsme Tantrique Du Cachemire (2009, Almora)Document352 pagesBouchart D'orval, Jean - Reflets de La Splendeur - Le Shivaïsme Tantrique Du Cachemire (2009, Almora)tiboPas encore d'évaluation
- Chant Des VoyelleDocument8 pagesChant Des VoyelleGasy CoolPas encore d'évaluation
- Le Pranayama de La Respiration - YoganiDocument107 pagesLe Pranayama de La Respiration - YoganiKlipschman100% (6)
- Les Chakras ExercicesDocument28 pagesLes Chakras ExercicesJean-Jacques Daubie100% (3)
- Livre Des Chakras VF Version LegereDocument14 pagesLivre Des Chakras VF Version LegereSylvieFumeronPas encore d'évaluation
- Se Nourrir de PranaDocument9 pagesSe Nourrir de PranaMichel ManginPas encore d'évaluation
- L'Arbre Qui Parle - Elever La Kundalini Grace A Sahaja Yoga - 1er Mars 2002Document2 pagesL'Arbre Qui Parle - Elever La Kundalini Grace A Sahaja Yoga - 1er Mars 2002Rozalia NagyPas encore d'évaluation
- Ta NTRaDocument238 pagesTa NTRaykarmaouiPas encore d'évaluation
- Yogani - Asanas, Mudras Et Bandhas - Eveiller La Kundalini extatique-AYP (2014)Document133 pagesYogani - Asanas, Mudras Et Bandhas - Eveiller La Kundalini extatique-AYP (2014)Vijay Panchal100% (2)
- Divers MantrasDocument6 pagesDivers MantrasSilence dombre0% (1)
- Chakras Et SubtilsDocument32 pagesChakras Et SubtilsBlandine Belkalem100% (1)
- La GayatriDocument27 pagesLa Gayatrierutirce0% (1)
- 1954 Traite D Alchimie SexuelleDocument92 pages1954 Traite D Alchimie Sexuellenicole_plante100% (2)
- Enseignements ésotériques du Tantra Tibétain (Traduit): Y compris les sept rituels d'initiation et les six yogas de Nāropā dans le commentaire de Tsong-Kha-Pa, traduit par Chang Chen ChiD'EverandEnseignements ésotériques du Tantra Tibétain (Traduit): Y compris les sept rituels d'initiation et les six yogas de Nāropā dans le commentaire de Tsong-Kha-Pa, traduit par Chang Chen ChiPas encore d'évaluation
- La grande légende indienne et le moine Paramahansa YoganandaD'EverandLa grande légende indienne et le moine Paramahansa YoganandaPas encore d'évaluation
- Le pouvoir du Reiki: Énergie de vie - Énergie de guérison: Une approche simple et accessible, pour tous ceux qui s'intéressent à l'énergie et à la guérisonD'EverandLe pouvoir du Reiki: Énergie de vie - Énergie de guérison: Une approche simple et accessible, pour tous ceux qui s'intéressent à l'énergie et à la guérisonPas encore d'évaluation
- Découvrez l´énergie des quatre animaux: Qigong appliqué dans la vie quotidienne, thérapie et entraînementD'EverandDécouvrez l´énergie des quatre animaux: Qigong appliqué dans la vie quotidienne, thérapie et entraînementPas encore d'évaluation
- L'éveil de la Kundalini: Découvrez comment améliorer l'intuition, la conscience psychique, la puissance mentale, les capacités psychiques et le voyage astralD'EverandL'éveil de la Kundalini: Découvrez comment améliorer l'intuition, la conscience psychique, la puissance mentale, les capacités psychiques et le voyage astralÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Héritage bloqué...: Faites appel aux Forces Cosmiques & à la télépathie (entre autres).D'EverandHéritage bloqué...: Faites appel aux Forces Cosmiques & à la télépathie (entre autres).Pas encore d'évaluation
- L' ANCIEN SECRET DE LA FLEUR DE VIE, TOME 2D'EverandL' ANCIEN SECRET DE LA FLEUR DE VIE, TOME 2Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4)