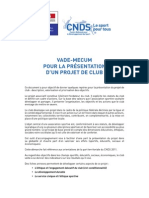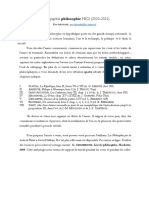Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Exercice de Communicaton
Exercice de Communicaton
Transféré par
AhmedBahrarCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Exercice de Communicaton
Exercice de Communicaton
Transféré par
AhmedBahrarDroits d'auteur :
Formats disponibles
M ichel FU STIER
Exercices pratiques
de communication
lusage du formateur
ditions dO rganisation, 2004
ISB N : 2-7081-2479-X
LIDENTIFICATION
( la place de lautre)
La difficult de notre communication tient videm m ent des
raisons techniques : nous ne m atrisons pas le langage ni la
logique dans lesquels nous tentons dcouter et de nous expri-
m er. M ais elle tient peut-tre encore plus des raisons
affectives : nous som m es incapables de nous m ettre la place
de notre interlocuteur pour savoir dans quel contexte nous lui
parlons et com m ent il entend ce que nous lui disons. Si nous
som m es en tat dhostilit vis--vis de lautre (refus dentrer
dans ses perspectives et ses proccupations), nous ne pouvons
com prendre le m essage quil nous envoie, m m e sil est gram -
m aticalem ent parfait. Si, au contraire, nous sommes vis--vis
de lui en tat de sympathie, nous saisissons parfaitem ent tout
ce quil nous dit, m m e sil le dit en bafouillant.
C om m ent essayer de sortir de nous pour entrer en sym pa-
thie avec les autres ? N otre don naturel peut tre en tout cas
soutenu par quelques exercices. C ela peut ne pas paratre bien
difficile. Eh bien, quon essaie seulem ent de parler la place
de lautre en disant je et lon verra quel effort cela suppose !
ditions dOrganisation 47
eX
e
r
c
i
ce n
o
3
M ais aussi quelle prise de conscience cela peut provoquer.
A ucun directeur qui veut traiter par exem ple avec des ouvriers
posts en trois huit tournants ne devrait le faire sans avoir au
m oins m entalem ent revtu leur genre de vie.
Attention : ceci na rien voir avec le psychodrame. Dans le
psychodrame, on cherche sexprimer soi-mme travers
un personnage fictif ; dans lidentification, on cherche au
contraire se dpouiller de soi-mme et prouver en pro-
fondeur ltat desprit, les penses, les problmes, les joies
ou les souffrances dun individu trs concret.
N aturellem ent cet exercice doit tre fait avec beaucoup de pru-
dence : la recherche dune com m unication en profondeur avec
lautre est parfois insupportable.
THMES DE LEXERCICE
Selon le degr de maturit et dquilibre des sujets, on devra
prendre des personnages plus ou moins connus, plus ou moins
impliquants.
Dans le voisinage
Le voisin, le chef hirarchique, linfrieur, le camarade de travail,
le client (au sens large), le conjoint, les enfants, les parents,
etc.
Au loin
Un cultivateur chinois, un migr en France, un prisonnier poli-
tique, le prsident de la Rpublique, un chmeur, un rfugi, etc.
Thtre
Exercices pratiques de communication
ditions dOrganisation 48
Les autres : lidentification
Les premiers de ces personnages sont bien connus. Il ny aura
donc pas de difficult technique les faire vivre. Il se peut
cependant quen raison de tensions ou daffrontements pro-
fonds entre lui-mme et son double, il faille viter un sujet fra-
gile ce qui serait une dure preuve.
Les seconds de ces personnages sont moins connus. Il faudra
donc plus dimagination pour, partir des quelques lments
connus, reconstituer une situation. Dautre part, la difficult de
lexercice viendra, non dun tat de tension avec le double, mais
de la duret ventuelle de la prise de conscience.
DROULEMENT DE LEXERCICE
Premire phase : prparation
Cet exercice doit dabord tre fait par un seul participant en
prsence de tout le groupe et sous le contrle de lanimateur :
il sagit en effet dun exercice trs difficile, car il suppose un
trs gros effort sur soi-mme. Il faut donc crer un environne-
ment indispensable de silence et dattention. Un groupe rduit
de 10 12 sera videmment plus favorable quun groupe de
20 ou 30. Les thmes didentification devront de mme tre
choisis avec -propos et dlicatesse, de faon ne pas crer
de situations embarrassantes ou irrversibles, ou ne pas
mettre les participants en face dun problme quils ne seraient
pas capables daffronter.
Deuxime phase : identification
Celui qui doit faire lexercice prend donc de la distance par rap-
port au groupe ; il ferme les yeux, se concentre, se prend mme
Thtre
ditions dOrganisation 49
la tte entre les mains, oublie tout ce qui lentoure et dit : Je
suis Yves... et il explique la premire personne qui est Yves,
quel milieu il appartient, qui sont ses proches, ce quil fait pen-
dant sa journe, comment il ragit ce qui lentoure...
Si le participant qui fait lexercice a une grande facilit verbale,
on peut le laisser parler pendant dix ou quinze minutes jusqu
ce que lui-mme, puis, sarrte et crie pouce . Si, au
contraire, la description intrieure est plus difficile, lanimateur
peut relancer lidentification en posant des questions, cest--
dire offrir au sujet un soutien et linviter pour ainsi dire faire
la route deux. De toute faon, il ne faut pas laisser un parti-
cipant senliser dans un silence profond qui peut tre le signe
dune grande angoisse et dun grand bouleversement intrieur.
Cest pour cette raison dailleurs quil faut choisir pour cet exer-
cice des sujets qui aient une scurit affective suffisante.
Troisime phase : rflexion critique
Lorsque lidentification sera termine, on revient une phase de
commentaire et dexplication raisonne. Le membre du groupe
qui aura fait lexprience cessera dtre son personnage et il se
regardera lui-mme avec les autres. Pourquoi Yves a-t-il dit ou
a-t-il fait cela ? Est-ce quil prouvait tel ou tel sentiment ?
Quelle tait son intention ? Et ainsi on prolongera par lanalyse
leffet de laction dramatique, tout en faisant baisser la tension
qui laccompagnait.
En dehors de ses effets psychologiques certains, cet exercice
est un puissant stimulant de limagination et de lexpression.
Il est souhaitable, si le temps le permet, que tous les membres
du groupe fassent leur propre exprience.
Exercices pratiques de communication
ditions dOrganisation 50
Les autres : lidentification
ditions dOrganisation 51
ADAPTATION AU MILIEU SCOLAIRE
qui peut-on proposer lenfant ou ladolescent de sidentifier ?
Voici quelques suggestions qui sajoutent aux thmes prcdents.
1) tel ou tel hros de film, de roman ou de bande dessine, de
feuilleton :
lIndien qui part lassaut du fort,
lespion qui vient dtre fait prisonnier,
la femme qui vient de perdre son mari.
2) des personnages dune autre civilisation, dont on tudie la
langue, lhistoire ou la gographie. Par exemple :
un petit Amricain,
un petit Indien,
un petit Russe.
3) tel ou tel personnage du milieu social dans lequel on est
plong et dont les comportements sont suffisamment connus
pour permettre lidentification. Par exemple :
un enfant dimmigr,
un balayeur municipal,
un mdecin,
le maire,
une femme de mnage,
un joueur de football.
5-8 ans Lexercice doit tre fait simplement, en utilisant non seu-
lement le langage verbal mais les gestes, les mimiques et
tous les moyens dexpression. Sans chercher donner
lexercice sa totale signification, on peut par exemple
demander aux enfants de simiter les uns les autres.
8-13ans A cet ge, on peut commencer ouvrir srieusement les
yeux sur le monde et se poser de vrais problmes. La
libert de comportement qui caractrise alors les enfants
est trs favorable au dveloppement de lexercice, mais
sans doute auront-ils de la peine se dpouiller complte-
ment de leur personnalit pour revtir celle de leur sujet.
13-18 ans On aura probablement renverser les barrires des
conventions et du conformisme. Les enfants noseront pas
parler. Les premiers exercices seront durs et devront tre
entours de beaucoup de prcautions. En particulier, appa-
ratront tous les blocages dus la contrainte scolaire de
lordre-silence , mais cest probablement cet ge, o se
forme la personnalit, que cet exercice peut avoir le plus
de rsonance.
Exercices pratiques de communication
ditions dOrganisation 52
Vous aimerez peut-être aussi
- Anonyme (Planche) - de L'equerre Au CompasDocument5 pagesAnonyme (Planche) - de L'equerre Au CompasDamien J. E. Charitat100% (1)
- Vademecum Projet de Club 1Document10 pagesVademecum Projet de Club 1AhmedBahrarPas encore d'évaluation
- Gestion de Projet Associatif - ANIMAFAC PDFDocument228 pagesGestion de Projet Associatif - ANIMAFAC PDFAhmedBahrarPas encore d'évaluation
- Dossier Pedagogique Mieux Comprendre Maree NoireDocument118 pagesDossier Pedagogique Mieux Comprendre Maree NoireAhmedBahrarPas encore d'évaluation
- 79884017Document64 pages79884017AhmedBahrarPas encore d'évaluation
- 77819454Document102 pages77819454AhmedBahrar100% (2)
- Cours de DP 4 Eme 2021Document72 pagesCours de DP 4 Eme 2021Nadia Ben HamidaPas encore d'évaluation
- Bernard Lahire Pour La Sociologie Et PouDocument5 pagesBernard Lahire Pour La Sociologie Et PouTendry RakotoarivonyPas encore d'évaluation
- Fiche n1 Travaux Encadrés CandDocument2 pagesFiche n1 Travaux Encadrés CandFaisal RahbiPas encore d'évaluation
- Le Discours Objectivé - Très Bien ExpliquéDocument8 pagesLe Discours Objectivé - Très Bien Expliquésaa ghitaPas encore d'évaluation
- Communication en Milieu de TravailDocument119 pagesCommunication en Milieu de Travailoumaima hlioui100% (1)
- Cours de Français SelahiDocument4 pagesCours de Français SelahikafizizouchePas encore d'évaluation
- Identifier Verbe Sujet Dans Une PhraseDocument7 pagesIdentifier Verbe Sujet Dans Une PhraseSimeon AffroPas encore d'évaluation
- L'INTERPRÉTATION DE L'ÉCOUTE À L'ÉCRIT - LaurentDocument10 pagesL'INTERPRÉTATION DE L'ÉCOUTE À L'ÉCRIT - LaurentJunia COUTOPas encore d'évaluation
- Charles Levy PDFDocument2 pagesCharles Levy PDFreza100% (1)
- PGM New 56TQDocument234 pagesPGM New 56TQChamiPas encore d'évaluation
- Code ÉthiqueDocument5 pagesCode Éthiquemehdiben86Pas encore d'évaluation
- Test Initial Clasa A 6 A CentruDocument4 pagesTest Initial Clasa A 6 A CentruGrozea Allexa100% (1)
- 1 Grupe P.ECRITDocument14 pages1 Grupe P.ECRITNalia Gabriel DAVID DavidPas encore d'évaluation
- Enseignements Pour Le Nouvel Âge D'or - Part 1 Le Gourou Et Le Chéla, 4 L'Etude EfficaceDocument3 pagesEnseignements Pour Le Nouvel Âge D'or - Part 1 Le Gourou Et Le Chéla, 4 L'Etude EfficaceJonathan Livingstone KokolaPas encore d'évaluation
- Aron, Raymond - Le Spectateur Engagé (Livre de Poche, 2005)Document481 pagesAron, Raymond - Le Spectateur Engagé (Livre de Poche, 2005)Aden100% (1)
- FUGUE DU TEMPS - Jean Yves HeurtebiseDocument13 pagesFUGUE DU TEMPS - Jean Yves HeurtebisebabayagaPas encore d'évaluation
- Quality Assessment in Conference and Community InterpretingDocument16 pagesQuality Assessment in Conference and Community InterpretingJoanna MarkowskaPas encore d'évaluation
- Cours Lola CoursDocument3 pagesCours Lola CoursAmina MaamerPas encore d'évaluation
- La Science Économique Est-Elle Une ScienceDocument18 pagesLa Science Économique Est-Elle Une ScienceYannick ValidorPas encore d'évaluation
- Bibliographie Philosophie HK2 Eva AbouahiDocument2 pagesBibliographie Philosophie HK2 Eva AbouahiJamesPas encore d'évaluation
- Conditionnel: Lisez À Voix Haute La Bande Dessinée. Observez Les Différentes Formulations de La Même QuestionDocument4 pagesConditionnel: Lisez À Voix Haute La Bande Dessinée. Observez Les Différentes Formulations de La Même QuestionDarya PupkevichPas encore d'évaluation
- Chapter I Unreal Time LESSON 2023 2024Document11 pagesChapter I Unreal Time LESSON 2023 2024andy.oumina.zaouratiPas encore d'évaluation
- Analyse & 1Document106 pagesAnalyse & 1pinamarkPas encore d'évaluation
- Cherche Et Trouve Classes GrammaticalesDocument3 pagesCherche Et Trouve Classes Grammaticalesjwchkm7ykfPas encore d'évaluation
- Cours - Calcul Differentiel Dans IR PDFDocument34 pagesCours - Calcul Differentiel Dans IR PDFArsène KekpenaPas encore d'évaluation
- 537 Ef 7136 Acf 1Document3 pages537 Ef 7136 Acf 1slassina700Pas encore d'évaluation
- Réflexion Autour Du Concept D'interlangue Pour Décrire Des Variétés Non Natives Avancées en FrançaisDocument13 pagesRéflexion Autour Du Concept D'interlangue Pour Décrire Des Variétés Non Natives Avancées en FrançaisCarlacplPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que La Négritude?: Léopold S. SenghorDocument19 pagesQu'est-Ce Que La Négritude?: Léopold S. SenghorDieu merci NtokoPas encore d'évaluation
- How To Analyze People - Dark Secrets To Analyze and Influence Anyone Using Body Language by James William JAMESDocument54 pagesHow To Analyze People - Dark Secrets To Analyze and Influence Anyone Using Body Language by James William JAMESBradley Nuentsa100% (1)