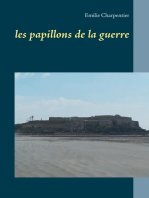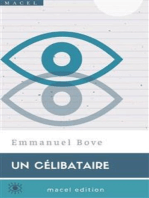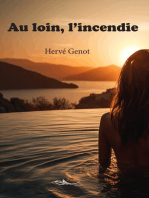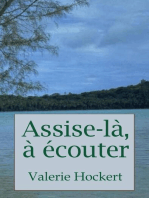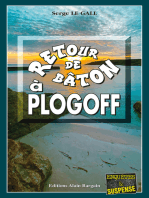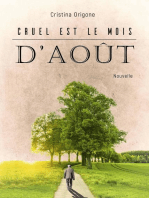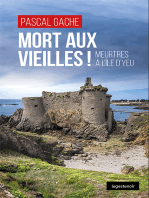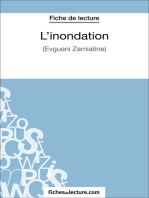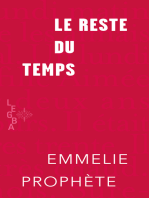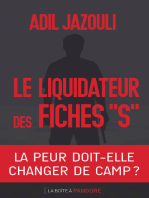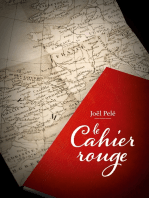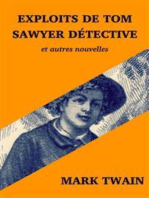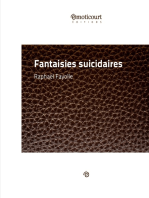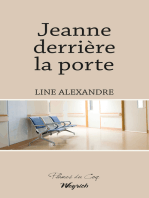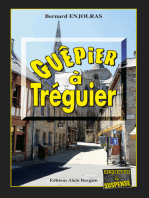Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Burroughs À Tanger de Paul Bowles
Transféré par
Deligne0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
166 vues2 pagesTitre original
Burroughs à Tanger de Paul Bowles
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
RTF, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme RTF, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
166 vues2 pagesBurroughs À Tanger de Paul Bowles
Transféré par
DeligneDroits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme RTF, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 2
Burroughs à Tanger de Paul Bowles
Je vis Bill Burroughs pour la première fois en 1953, il marchait sous la
pluie dans une rue secondaire de Tanger. Il était sous H à l’époque et
n’avait pas l’air très en forme.
Il est venu me voir l’année suivante pour me parler de quelques détails
concernant son contrat pour Junky, dans lequel il pensait s’être fait
avoir. J’avais la paratyphoïde et ne fus pas d’une grande aide. Ce n’est
pas avant l’hiver 1955-56 que nous devîmes amis et commençâmes à
nous voir régulièrement. Bien sûr j’avais entendu parler de lui : on
m’avait raconté qu’il s’entraînait au tir dans sa chambre dans la Médina
et tout le reste de la légende. En apprenant à le connaître j’ai réalisé
que la légende vivait en dépit de lui et pas à cause de lui : il s’en fichait
royalement.
Sa vie n’avait aucune organisation apparente, mais se sachant du
genre addictif il avait choisi de s’instaurer une discipline intérieure
automatique bien plus rigoureuse que toutes celles qu’il aurait pu
s’imposer objectivement. Il vivait dans une petite chambre humide dont
la seule porte donnait sur le jardin de l’hôtel Villa Muniriya. L’un des
murs de la pièce, sa galerie de tir, était grêlée de trous de balle. Un
autre était entièrement recouvert d’instantanés, dont la majorité avait
été prise dans les sources de l’Amazone. J’aimais entendre des histoires
sur ce voyage, et m’arrangeais toujours pour qu’il m’en parle
longuement.
Aller là-bas avait fait partie de cette discipline qu’il s’était imposée,
puisque l’unique raison du déplacement avait été d’essayer les effets
d’une drogue locale appelée Yagé, une concoction faite par les Indiens
de la région, et qui doit être prise sur place car son efficacité disparaît
quelques heures après son brassage. L’intérêt du Yagé est qu’elle est,
bien plus que toutes les autres, une drogue d’équipe, sa principale
propriété étant qu’elle facilite la télépathie mentale et provoque une
empathie émotionnelle parmi ceux qui en ont pris. Il insista sur le fait
qu’elle rendait possible la communication avec les Indiens, bien qu’elle
le rendît violemment malade.
Pendant les deux années où je vis Bill régulièrement à Tanger, il ne prit
que du kif, du majoun et de l’alcool. Mais il s’arrangea pour prendre de
larges quantités de chacun des trois. La poubelle sur son bureau et en
dessous de celui-ci, sur le sol, était chaotique, mais elle ne contenait
que des pages du Festin Nu, sur lequel il travaillait constamment.
Quand il en lisait des pages à haute voix, dans n’importe quel ordre
(n’importe quelle feuille qu’il attrapait faisait l’affaire) il riait beaucoup,
ce qui est compréhensible, puisque c’est très drôle, mais il pouvait
aussi se lancer, tout à coup au cours de la lecture (le papier toujours en
main) dans une attaque conversationnelle amère sur n’importe quel
aspect de la vie que le passage `qu’il venait de lire lui avait évoqué. Ce
qu’il y a de mieux avec Bill Burroughs c’est qu’il est toujours sensé et
qu’il a toujours beaucoup d’humour, même dans ses moments les plus
corrosifs. Si vous tombez sur lui à n’importe quel moment du jour ou de
la nuit, vous vous rendrez compte que la machine entière fonctionne à
plein régime, et ça veut dire qu’il rie ou s’apprête à le faire.
J’ai remarqué qu’il dépensait plus d’argent pour la nourriture que la
majorité de nous autres Tangérois - peut-être en a-t-il plus à dépenser,
je ne sais pas - mais le fait est qu’il met un point d’honneur à bien
manger, ce qui fait partie de sa volonté de vivre à tous moments
comme il l’entend. (Gertrude Stein l’aurait défini comme complaisant
avec lui-même : il est vrai que l’ombre même du sentiment de
culpabilité ne l’a jamais entravé, jamais.) Il suit sa route jouissant
même de ses infortunes. Je ne l’ai jamais entendu mentionner une
expérience qui le rendit plus que temporairement heureux. À l’hôtel
Muniriya, il avait une boîte à orgone de Reich dans laquelle il avait
l’habitude de s’asseoir plié en deux, en fumant le kif. Je crois qu’il l’a
fabriqué lui-même. Il avait un petit poêle dans sa chambre dans lequel
il faisait cuire des bonbons de Haschisch, dont il était très fier, et qu’il
distribuait à quiconque était intéressé.
Pendant les mois qu’Allen Ginsberg passa ici à Tanger, lui et Bill
avaient pour habitude de passer la moitié de la nuit assis, lancés dans
d’interminables disputes au sujet de la littérature et de l’esthétique.
C’était toujours Bill qui attaquait l’intellect de tous bords, ce qui, je
crois bien, est exactement ce qu’Allan voulait. C’était assurément une
chose à ne pas manquer, voir Bill trébucher d’un coin à l’autre de la
pièce, l’entendre hurler avec sa voix de cow-boy, le voir promener ses
verres ici et là sans s’arrêter, avec l’index et l’annulaire, et deux ou
trois cigarettes de kif allumées en même temps mais dans différents
cendriers qu’il utilisait un par un en faisant le tour de la pièce.
Vous aimerez peut-être aussi
- Même si mes yeux pleuraient, mes larmes ne couleraient pasD'EverandMême si mes yeux pleuraient, mes larmes ne couleraient pasPas encore d'évaluation
- Franc-tireur: Georges Mattéi, de la guerre d'Algérie à la guérillaD'EverandFranc-tireur: Georges Mattéi, de la guerre d'Algérie à la guérillaPas encore d'évaluation
- Retour de bâton à Plogoff: Les enquêtes du commissaire Landowski - Tome 31D'EverandRetour de bâton à Plogoff: Les enquêtes du commissaire Landowski - Tome 31Pas encore d'évaluation
- La nuit qui n'a jamais porté le jour: Roman historiqueD'EverandLa nuit qui n'a jamais porté le jour: Roman historiquePas encore d'évaluation
- La mort n'est pas contagieuse: (Mémoires d'une fille de)D'EverandLa mort n'est pas contagieuse: (Mémoires d'une fille de)Pas encore d'évaluation
- Delarue - Carnets SecretsDocument111 pagesDelarue - Carnets SecretsLakhdar Hadjarab100% (1)
- Il Était Une Fois Trois Soleils…: Trilogie Sur L’Amour MirageD'EverandIl Était Une Fois Trois Soleils…: Trilogie Sur L’Amour MiragePas encore d'évaluation
- Avec capacités spéciales (ACS): SIGURD Sous le charme des nanites Vol.1D'EverandAvec capacités spéciales (ACS): SIGURD Sous le charme des nanites Vol.1Pas encore d'évaluation
- Le liquidateur des fiches S: Roman inspiré de faits réelsD'EverandLe liquidateur des fiches S: Roman inspiré de faits réelsPas encore d'évaluation
- Mémoire d'un fils unique: Mes sentiments de jeunesse sur la vie, la guerre, et l'amour entre 1939 et 1969D'EverandMémoire d'un fils unique: Mes sentiments de jeunesse sur la vie, la guerre, et l'amour entre 1939 et 1969Pas encore d'évaluation
- La conjuration des imbéciles: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandLa conjuration des imbéciles: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Itinéraire d'un sale gosse… De 7 à 77 ans: ou l’art de croquer la vie à belles dentsD'EverandItinéraire d'un sale gosse… De 7 à 77 ans: ou l’art de croquer la vie à belles dentsPas encore d'évaluation
- Compte Rendu Le HorlaDocument4 pagesCompte Rendu Le HorlaLucasPas encore d'évaluation
- Guêpier à Tréguier: Les enquêtes de Bernie Andrew - Tome 7D'EverandGuêpier à Tréguier: Les enquêtes de Bernie Andrew - Tome 7Pas encore d'évaluation
- Joe Hill - Le Costume Du MortDocument346 pagesJoe Hill - Le Costume Du MortThierno Mamadou Aliou DIALLOPas encore d'évaluation
- La Librairie Des Coeurs BrisesDocument13 pagesLa Librairie Des Coeurs BrisesSah RkmPas encore d'évaluation
- Les Enseignements Dun Sorcier Yaqui 2 (Castaneda Carlos)Document267 pagesLes Enseignements Dun Sorcier Yaqui 2 (Castaneda Carlos)Raise YourBackPas encore d'évaluation
- Le Fauconnier Yi Chong JunDocument30 pagesLe Fauconnier Yi Chong JunkiwibleuPas encore d'évaluation
- Vdocuments - MX Au Nom de Tous Les MiensDocument1 472 pagesVdocuments - MX Au Nom de Tous Les MiensALEXANDROAIE DANPas encore d'évaluation
- 01-Carlos CASTANEDA-VOIR (Les Enseignements D'un Sorcier Yaqui)Document296 pages01-Carlos CASTANEDA-VOIR (Les Enseignements D'un Sorcier Yaqui)khalil GibranPas encore d'évaluation
- Voir - Carlos CastanedaDocument236 pagesVoir - Carlos CastanedaMIERDA-LOKA9108Pas encore d'évaluation
- Tahar Ben Jelloun - Amours Sorciã ResDocument0 pageTahar Ben Jelloun - Amours Sorciã ResMima24000100% (3)
- La Vie Est Belle PDFDocument260 pagesLa Vie Est Belle PDFAlicia DíazPas encore d'évaluation
- Thème 5 Et Version 5 L1 2020Document1 pageThème 5 Et Version 5 L1 2020styrene-lime.0lPas encore d'évaluation
- VoirDocument208 pagesVoirstéphane cariouPas encore d'évaluation
- Larrêt de Mort by Blanchot, Maurice (Maurice, Blanchot)Document62 pagesLarrêt de Mort by Blanchot, Maurice (Maurice, Blanchot)Giacomo MichelaucigPas encore d'évaluation
- 1984 OrwellDocument3 pages1984 Orwellmatisse.g2bPas encore d'évaluation
- Albert Camus - Actuelles IIDocument68 pagesAlbert Camus - Actuelles IIDelignePas encore d'évaluation
- Expériences de Mort Imminente - La Preuve ImpossibleDocument15 pagesExpériences de Mort Imminente - La Preuve ImpossibleDelignePas encore d'évaluation
- Guy Debord - Introduction À Une Critique de La Géographie UrbaineDocument5 pagesGuy Debord - Introduction À Une Critique de La Géographie UrbaineDeligne100% (1)
- L'art de Péter de Pierre-Thomas-Nicolas HurtautDocument3 pagesL'art de Péter de Pierre-Thomas-Nicolas HurtautDeligne100% (1)
- Albert Camus - Nos Frères D'espagne - Combat 07 09 44Document2 pagesAlbert Camus - Nos Frères D'espagne - Combat 07 09 44DelignePas encore d'évaluation
- Cioran La Chute Dans Le TempsDocument2 pagesCioran La Chute Dans Le TempsDeligne100% (2)
- 4e. Galerie de Portraits Issus Des Miserables Avec Questions Et ConsignesDocument2 pages4e. Galerie de Portraits Issus Des Miserables Avec Questions Et Consigneselmorabitmeryem9Pas encore d'évaluation
- L'Écume Des Jours.: Chapitre Ii: Visions Poetiques Du MondeDocument1 pageL'Écume Des Jours.: Chapitre Ii: Visions Poetiques Du MondeMichael MAHTALPas encore d'évaluation
- Activités de Production ÉcriteDocument2 pagesActivités de Production ÉcriteMohamed El Glafi0% (1)
- Le Soleil Et Lacier by Mishima, YukioDocument76 pagesLe Soleil Et Lacier by Mishima, YukioYes noPas encore d'évaluation
- Le Texte InformatifDocument15 pagesLe Texte Informatiftrgmvwc5y4Pas encore d'évaluation
- SadafiDocument27 pagesSadafiSo' FinePas encore d'évaluation
- MONTAIGNE Les Essais Extrait 2Document2 pagesMONTAIGNE Les Essais Extrait 2lupinPas encore d'évaluation
- Formules de Politesse PDFDocument4 pagesFormules de Politesse PDFAzzeddine DahbiPas encore d'évaluation
- Le Recueil Ouvert - Étude Théorique Des Épopées AfricainesDocument8 pagesLe Recueil Ouvert - Étude Théorique Des Épopées AfricainesJulien KemlohPas encore d'évaluation
- Etty HillesumDocument9 pagesEtty HillesumRichard TremblayPas encore d'évaluation
- Fiche Chanson Boris Vian Le DéserteurDocument4 pagesFiche Chanson Boris Vian Le DéserteurPierre PandeléPas encore d'évaluation
- FrancaiseDocument7 pagesFrancaiseOana Sînziana StreşinãPas encore d'évaluation
- Lecture Analytique StendhalDocument3 pagesLecture Analytique StendhallauneycarolePas encore d'évaluation
- AutobiographieDocument9 pagesAutobiographieNiniFramboisePas encore d'évaluation
- Donner Son Avis Sur Un LivreDocument1 pageDonner Son Avis Sur Un LivreJuliana PachecoPas encore d'évaluation
- 33 Focalisation Point de VueDocument1 page33 Focalisation Point de VueJamal KalkouliPas encore d'évaluation
- Correcciones Cahier D Activités Tema 5Document4 pagesCorrecciones Cahier D Activités Tema 5Natalia Serrano GonzalezPas encore d'évaluation
- Sujet Sur BiographieDocument2 pagesSujet Sur BiographiesmatidjamilPas encore d'évaluation
- Biblio - Roman PolicierDocument16 pagesBiblio - Roman PolicierRou PrincessePas encore d'évaluation
- Abreuvoir Du CommensalDocument93 pagesAbreuvoir Du Commensaldioumb100% (1)
- Explication Du Carré MagiqueDocument8 pagesExplication Du Carré MagiqueEric Merlin0% (1)
- French Cheat SheetsDocument2 pagesFrench Cheat Sheetsgwzgl100% (1)
- Oral EcritDocument2 pagesOral EcritellenaroxanaPas encore d'évaluation
- Sequence Eluard Capitale de La Douleur 1ere BacDocument20 pagesSequence Eluard Capitale de La Douleur 1ere BacPaul MboulePas encore d'évaluation
- Dissertation Corrigé Poésie (0) 3Document6 pagesDissertation Corrigé Poésie (0) 3AblayePas encore d'évaluation
- Terminologie Et Traduction MARTIN CollocationsDocument604 pagesTerminologie Et Traduction MARTIN CollocationsInma Gamarra Barrios82% (11)
- 1456 - Règlement Prix de L'europe de La Médiathèque de Bussy Saint-GeorgesDocument1 page1456 - Règlement Prix de L'europe de La Médiathèque de Bussy Saint-GeorgesPrix LittérairesPas encore d'évaluation
- Connecteurs Ou Liens LogiquesDocument2 pagesConnecteurs Ou Liens LogiquesMaximwell MaxPas encore d'évaluation
- Derrida-Le Calcul Des Langues PDFDocument108 pagesDerrida-Le Calcul Des Langues PDFMaria CopesPas encore d'évaluation
- Petit Guide de PrésentationDocument23 pagesPetit Guide de Présentationghiles7Pas encore d'évaluation